On assimile généralement notre modernité en crise au rationalisme. L’irrationalisme et autres nouveaux panthéismes apparaissent alors comme des attitudes antimodernes par excellence. Jan Marejko, dans La Cité des morts (1994), montre au contraire que ces deux attitudes, incapables de s’enraciner dans un Autre, sont solidaires d’une même réduction de l’esprit à la nature et à une vie morte, incapable d’une parole qui annonce et qui s’énonce dans son rapport au monde.
C’est une pensée forte et complète que nous donne à lire le philosophe genevois Jan Marejko (1946-2016), dans son maître ouvrage La Cité des morts. Avènement du technocosme. Le titre et le projet sont audacieux : le risque du recyclage est élevé tant l’auteur est précédé par de nombreuses et grandes critiques du « monde moderne ». L’opposition de la tradition et de la modernité est toujours menacée de devenir le lieu commun d’une pensée dissidente : mais que serait donc la tradition sans sa respiration fondamentale, celle, spirituelle, qui exige, à l’épreuve des jours nouveaux, le « renouvellement de l’intelligence », selon le mot de saint Paul (Rom. XII, 2) ?
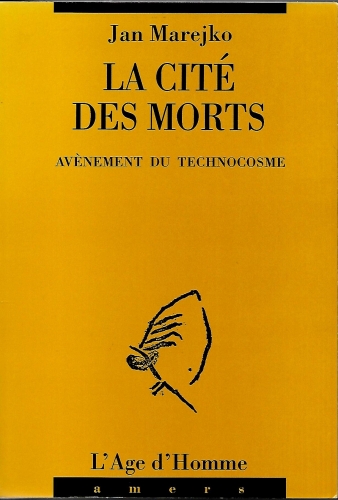 C’est sur cette exigence toujours actuelle du discernement que Jan Marejko exprime ses inquiétudes. A la dyade quelque peu habituelle entre tradition et modernité, le philosophe suisse choisit d’opposer, méthodologiquement, la triade de trois « accents », trois tendances, trois modes de rationalité irréductibles au cours historique : mythocosme / logocosme / technocosme. En effet, la dyade a ceci de dangereux qu’elle peut conduire à une certaine clôture de la pensée sur la distance haineuse de l’exclusion ou de la proximité complice de l’inclusion. La triade, quant à elle, crée un lien vivant entre trois termes dont la tension dialectique déjoue les fixations d’une pensée habituée, sans renoncer à dire le monde.
C’est sur cette exigence toujours actuelle du discernement que Jan Marejko exprime ses inquiétudes. A la dyade quelque peu habituelle entre tradition et modernité, le philosophe suisse choisit d’opposer, méthodologiquement, la triade de trois « accents », trois tendances, trois modes de rationalité irréductibles au cours historique : mythocosme / logocosme / technocosme. En effet, la dyade a ceci de dangereux qu’elle peut conduire à une certaine clôture de la pensée sur la distance haineuse de l’exclusion ou de la proximité complice de l’inclusion. La triade, quant à elle, crée un lien vivant entre trois termes dont la tension dialectique déjoue les fixations d’une pensée habituée, sans renoncer à dire le monde.
De la superstition de la vie ordinaire …
Jan Marejko ne prétend pas substituer son rythme de pensée ternaire au conflit binaire entre tradition et modernité. Lui-même, en effet, ne s’interdit nullement d’envisager le caractère inédit du monde moderne, construit sur la négation de l’esprit traditionnel. La négation de la modernité consiste en effet en le rejet d’une fidélité attachée à une double origine : chronologique (respect du passé et des Anciens) et ontologique (culte du Créateur et vie transcendante).
Seulement, l’exigence d’authenticité interdit l’antimoderne Jan Marejko de se limiter à un simple portrait du visage mort du monde moderne. Il faut d’abord savoir quel regard opposer au crépuscule, quelle autre sorte de joue tendre au soufflet orgueilleux de l’homme Prométhéen. C’est pourquoi la peinture de la Cité des morts, celle de la modernité constituée comme monde, n’intervient vraiment que dans le dernier mouvement de l’essai de Jan Marejko. Le jugement de la tradition précède la condamnation de la modernité. Ce jugement, ici, consiste à opposer deux façons en apparence traditionnelles de se rapporter au monde : l’une, mythique, ou mythocosmique (car elle n’est jamais le fait d’individus isolés), l’autre, logale, ou logocosmique.
La première est mythologique parce que non métaphysique : elle est incapable de discerner un réel au-delà de la nature (phusis), c’est-à-dire de « voir », par l’œil de l’âme, l’invisible en son lieu transcendant. Elle n’opère pas la dépossession du regard propre à la vie du verbe et regarde toujours l’invisible (qu’elle perçoit néanmoins) à travers le prisme du visible : « le sacré, dans un mythocosme, est moyen du profane et non sa fin ». En effet, « au lieu de permettre aux âmes de s’élever au-dessus de l’obsession de la survie, un tel pouvoir [mythocosmique] les enfonce dans cette obsession tout en les plongeant dans la servitude ». Dans un mythocosme, les hommes ne savent pas voir le visible pour ce qu’il est car ils y discernent sans cesse un ensemble de volontés bienveillantes ou malveillantes : aucune distance véritable ne se crée entre l’ici-bas et l’au-delà. Il s’ensuit que la conscience du plus grand que soi est comme asservie par la superstition de la vie ordinaire : « l’au-delà auquel sont renvoyés les hommes du mythocosme est l’espace imaginaire dans lequel ils projettent leurs terreurs, leurs espoirs, leurs appétits naturels (sexe et nourriture essentiellement). L’espace invisible du mythe n’est pas réellement transcendant parce qu’il n’est qu’une amplification fantasmatique de ce qui existe déjà dans la nature ». Ainsi en est-il par exemple de la vie éternelle, conçue alors comme perpétuelle par l’entendement mythocosmique, c’est-à-dire comme une certaine prolongation de l’état de vie naturel.
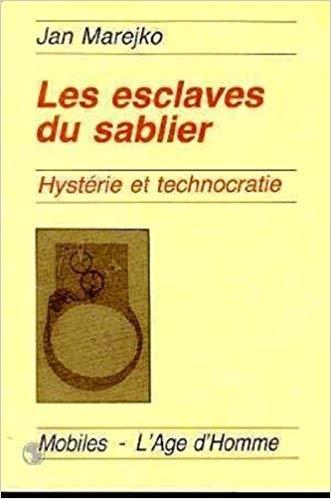 Or loin de s’opposer au mythocosme, le technocosme, c’est-à-dire le monde régi par l’arraisonnement et la technique, qui valorise exclusivement l’industrie et les préoccupations matérielles et financières, se pose en fait comme son ennemi gémellaire. Comme dans un mythocosme, le pouvoir technocosmique « médiatise des puissances dont on attend qu’elles favorisent la vie, la prolongent ou l’amplifient » : ces puissances, divines qu’elles étaient, sont économiques ou politiques. Elles tirent leur respect de leur règne anonyme, invisible, incontestable. En elles, les Hommes placent leur salut comme ils placent leur argent : ils investissent en elles pour conquérir le repos d’une vie de possédants. En elles, ils ont « réussi leur vie », pensent-ils. Il faut dire que le bonheur dans les deux cas est attaché à la jouissance des biens matériels : que le contrôle de l’environnement soit magique et cérémoniel, ou bien statistique et industriel, la nature reste l’horizon de l’activité humaine immergée dans ses petites préoccupations affairées ou moralistes, engoncée dans la roue des désirs et des souffrances. Que la distance soit minime (mythocosme) ou inexistante (technocosme), l’homme, dans les deux cas, ne s’oriente pas dans la vie logale qui est pourtant sa vocation d’animal sémantique. Ne s’arrachant pas positivement à la nature, immergé en elle, il est incapable de la regarder, de la comprendre, de l’aimer dans sa précarité.
Or loin de s’opposer au mythocosme, le technocosme, c’est-à-dire le monde régi par l’arraisonnement et la technique, qui valorise exclusivement l’industrie et les préoccupations matérielles et financières, se pose en fait comme son ennemi gémellaire. Comme dans un mythocosme, le pouvoir technocosmique « médiatise des puissances dont on attend qu’elles favorisent la vie, la prolongent ou l’amplifient » : ces puissances, divines qu’elles étaient, sont économiques ou politiques. Elles tirent leur respect de leur règne anonyme, invisible, incontestable. En elles, les Hommes placent leur salut comme ils placent leur argent : ils investissent en elles pour conquérir le repos d’une vie de possédants. En elles, ils ont « réussi leur vie », pensent-ils. Il faut dire que le bonheur dans les deux cas est attaché à la jouissance des biens matériels : que le contrôle de l’environnement soit magique et cérémoniel, ou bien statistique et industriel, la nature reste l’horizon de l’activité humaine immergée dans ses petites préoccupations affairées ou moralistes, engoncée dans la roue des désirs et des souffrances. Que la distance soit minime (mythocosme) ou inexistante (technocosme), l’homme, dans les deux cas, ne s’oriente pas dans la vie logale qui est pourtant sa vocation d’animal sémantique. Ne s’arrachant pas positivement à la nature, immergé en elle, il est incapable de la regarder, de la comprendre, de l’aimer dans sa précarité.
… à la religion de la Vie
La tradition animée par la vie du Verbe ne réduit plus le bonheur à l’horizon intéressé de la satisfaction des jouissances matérielles et narcissiques. Chez un Aristote, en effet, elle situe le bonheur dans la vie contemplative, théorétique. Pour pouvoir dire les choses, l’homme doit avoir atteint une certaine distance vis-à-vis d’elles, distance qui reconstitue les phases successives ou les aspects partiels d’un objet dans sa totalité signifiante, le rendant alors manifeste dans ce qu’il est réellement, le plus intimement. L’âme humaine, dit saint Thomas, est suspendue entre le temps et l’éternité : de cette façon, la distance vis-à-vis des choses s’enracine, dans le mouvement logal, dans une distance vis-à-vis de Dieu, dont le lieu se situe dans un Autre, jamais réductible à quelque idole que ce soit. Aussi dans la tradition juive se reconstitue l’altérité divine : les règles de la Torah, note Jan Marejko, n’ont « pas pour objet de protéger ou d’exalter la vie terrestre, mais d’orienter cette vie d’une manière telle qu’elle puisse participer à une autre vie, recevoir une lumière nouvelle et, surtout, accueillir une parole libératrice parce qu’au-dessus de tout pouvoir terrestre ».
Loin de Dieu et loin du monde, l’âme lancée dans un mouvement logal trouve sa vérité dans l’exil. Libérée du souci du monde, libérée de la peur et de l’intéressement, sa souveraineté s’établit pour qu’elle puisse prendre la parole. Alors naît la parole des prophètes Juifs comme celle, tout aussi prophétique, d’un Socrate, duquel on apprend, dans l’Apologie de Socrate de Platon, qu’il est « nommé par le dieu pour défendre la vie du verbe dans Athènes, montrer qu’il en est venu à “négliger toutes ses affaires” – qu’il y a dans cette négligence pour sa vie matérielle quelque chose de plus qu’humain ». S’appuyant sur l’historiographie d’Alexandre Koyré, Jan Marejko remarque en effet que « le dépassement du souci de la survie ou de l’utile est la condition d’une science théorétique [ou] logale ». Cette science est une connaissance pure, centrée sur la recherche de la vérité et dépouillée de l’avidité. Elle vise l’accomplissement du sujet et non son opposition exclusive ou duale vis-à-vis des objets qu’il observe. « Mais, ajoute le philosophe genevois, pour regarder l’ici-bas d’une manière désintéressée, comme une science logale l’exige, il faut avoir trouvé un point d’ancrage ailleurs que dans la nature. Sinon, on ne peut s’empêcher d’y chercher les signes d’un salut possible sans jamais voir quiconque ni quoi que ce soit ». Dans un logocosme, l’Homme comprend donc que l’amélioration de sa condition et l’objet de son bonheur ne résident pas dans le réarrangement obsessionnel et superficiel de son environnement mais avant tout dans le réarrangement intérieur de son rapport à soi et au monde : destruction de l’égoïsme, repentance, questionnement, compréhension, dialogue, par l’enracinement ontologique du sujet dans un lieu Autre, étranger aux passions passagères et aux violentes illusions de la vie mondaine.
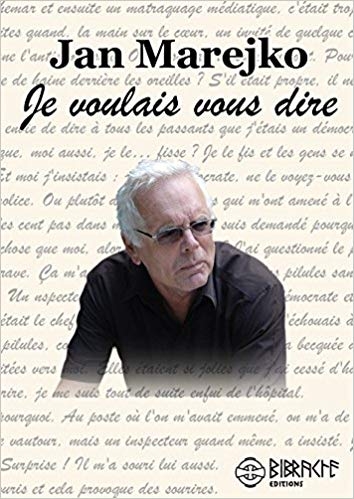 Prendre la parole
Prendre la parole
Jan Marejko, au travers des très nombreux sujets qu’il aborde dans son essai, pose donc en creux l’enjeu fondamental de la parole. Il écrit dans un monde où tout le monde parle, mais où rien ne se dit. La massification à tous les niveaux de la vie humaine dans notre modernité (démographie, informations, produits) étouffe dans son flux toute possibilité de prise sur le monde. Un pouvoir inédit s’est ajouté aux pouvoirs traditionnels : le pouvoir médiatique, qui confisque toute possibilité de réponse. Celui, en effet, qui a le monopole de la parole a le monopole du pouvoir ; or le discours médiatique s’impose en tout lieu sans que les millions des téléspectateurs puissent avoir quelque chose à redire. La démocratie moderne se fonde peut-être sur l’isonomie (l’égalité devant la loi), mais dans son droit imaginaire à la liberté d’expression, elle a été incapable d’assumer le premier élément fondamental de la démocratie grecque : l’isegoria, l’équité dans la prise de parole. « Dans les sociétés modernes [démocratiques], l’impossibilité de répondre ne tient pas à la terreur exercée par celui qui détient le pouvoir [tyrannique], mais à la structure même de la communication ».
Le principe d’inertie cher à la science moderne, qui a renversé la conception traditionnelle du mouvement conçu comme désir d’atteindre une fin, est intégré dans l’imaginaire collectif : l’espace démocratique n’est plus un lieu de relations entre des citoyens libres, mais un ensemble de champs de forces (mass media, partis politiques, syndicats…) qui interagissent entre eux sans espace politique réellement partagé. À si grande échelle et au sein d’une masse si grande d’acteurs sociaux, cette absence d’isegoria s’accompagne « d’une prolifération d’échanges aniségoriques ». Il en va, partout, de sa propre indignation, de ses propres intérêts, de ses propres jeux de langage : que les novlangues soient commerciale, inclusive ou autre, le rapport de l’homme moderne au monde est alogal du fait même qu’il a renoncé à l’accord des mots avec les choses. La parole n’ose plus se référer à un Autre du discours, désigner des objets extérieurs à son énonciation, mais se limite soit à un exclusivisme, soit à un relativisme des points de vue selon lequel, la réalité ne pouvant jamais être saisie, on ne peut rendre compte que de la manière dont on parle de notre propre réalité. Mais quelle rencontre est possible dans cette conception sourde du langage ? Qu’est-ce qui rendrait possible ici un lieu dans lequel pourraient dialoguer différents points de vue s’accordant sur un même objet ? Dans cet éclatement, « une parole qui s’est close sur sa propre opérativité (sciences) ou sa propre répétition (médias) rend absurde la notion de réponse ».
Voici donc venu, contre la vie du verbe qui prend le risque de nommer en assumant sa précarité, le règne du bavardage : « dans le champ d’un discours alogal il n’y a plus ni monde ni sujets : tout y est un état de flux permanent où il est impossible de repérer des substances capables d’être saisies dans une définition ». Il s’ensuit qu’« aussitôt qu’une parole se donne comme une combinatoire auto-suffisante (refus de la référentialité) elle ne peut ni provenir d’une subjectivité [dont la réalité est noyée dans un ensemble de constructions et de ramifications impersonnelles], ni nommer des objets [dissous dans les seules relations] ». Dans la cité des morts, c’est clair : « le verbe dérange ». Face au nihilisme ambiant, Jan Marejko oppose finalement une certaine conception, profonde, de l’annonce évangélique : non pas la défense d’une chapelle, mais la recherche, chez les volontés non encore brisées ou ramollies, d’une (re)conversion à la vie du verbe, c’est-à-dire la capacité de pouvoir répondre à une altérité. Et cela, Robinson sur son île et Narcisse devant son miroir, cohabitant dans une cité de morts, ne le vivront jamais.






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
Les commentaires sont fermés.