Né le 9 janvier 1921 dans une famille nombreuse d’origine ouvrière et paysanne présente dans la commune lorraine de Henridorff en Moselle et décédé le 10 septembre 1993 à Colmar, Julien Freund appartient aux grands penseurs du politique, ce politique qu’il étudia dans une thèse dirigée par Raymond Aron, soutenue en 1965 et parue sous le titre de L’Essence du politique.
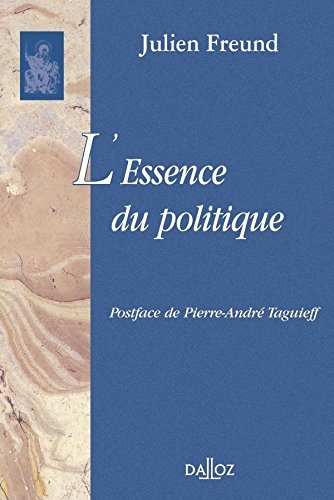 D’abord instituteur pour pallier la disparition brutale de son père, le germanophone Julien Freund se retrouve otage des Allemands en juillet 1940 avant de poursuivre ses études à l’Université de Strasbourg repliée à Clermond-Ferrand. Il entre dès janvier 1941 en résistance dans le réseau Libération, puis dans les Groupes francs de combat de Jacques Renouvin. Arrêté en juin 1942, il est détenu dans la forteresse de Sisteron d’où il s’évade deux ans plus tard. Il rejoint alors un maquis FTP (Francs-tireurs et partisans) de la Drôme. Il y découvre l’endoctrinement communiste et la bassesse humaine.
D’abord instituteur pour pallier la disparition brutale de son père, le germanophone Julien Freund se retrouve otage des Allemands en juillet 1940 avant de poursuivre ses études à l’Université de Strasbourg repliée à Clermond-Ferrand. Il entre dès janvier 1941 en résistance dans le réseau Libération, puis dans les Groupes francs de combat de Jacques Renouvin. Arrêté en juin 1942, il est détenu dans la forteresse de Sisteron d’où il s’évade deux ans plus tard. Il rejoint alors un maquis FTP (Francs-tireurs et partisans) de la Drôme. Il y découvre l’endoctrinement communiste et la bassesse humaine.
Après-guerre, il milite un temps à l’UDSR (Union démocratique et socialiste de la Résistance), une petite formation charnière de centre-gauche de la IVe République, et au SNES (Syndicat national de l’enseignement secondaire). Il s’intéresse à la philosophie et en particulier à Aristote. C’est au début des années 1950 qu’il découvre le décisionnisme de Carl Schmitt. Las de l’instabilité gouvernementale, il se félicite du retour au pouvoir du Général De Gaulle en 1958 et approuve la Ve République dont il estime les institutions adaptées au caractère polémologique du politique français.
Philosophe, Julien Freund est aussi sociologue, politologue et, avec Gaston Bouthoul, polémologue, c’est-à-dire analyste du conflit. Dans La Décadence. Histoire sociologique et philosophique d’une catégorie de l’expérience humaine (Sirey, 1984), il considère en effet qu’il faut « savoir envisager le pire pour empêcher que celui-ci ne se produise (p. 386) ». Son tempérament bien trempé, son goût pour la provocation et son refus de déménager à Paris sans oublier une vive hostilité au gauchisme culturel le marginalisent au sein de l’univers feutré et guindé de l’enseignement supérieur. Il prend d’ailleurs sa retraite anticipée dès 1979 à l’âge de 58 ans. Il profite du village alsacien de Villé.
Il collabore à Éléments et à Nouvelle École, et participe à plusieurs colloques du GRECE et du Club de l’Horloge dont il est l’un des douze maîtres à penser. En préface de L’impératif du renouveau. Les enjeux de demain (Albatros, 1983) de Bruno Mégret et des Comités d’Action républicaine, il avoue que « par profession et par goût je suis amoureux des idées, mais je déteste les flatteries de l’intellectualisme, égaré dans les abstractions et les fictions superficielles (p. 7) ». Cette attitude le distingue de ses mornes collègues. Il écrit avec une ironie certaine en préface de son essai de 1970, Le Nouvel Âge. Éléments pour une théorie de la démocratie et de la paix (Marcel Rivière et Cie, coll. « Études sur le devenir social ») : « Je suis un réactionnaire de gauche (p. 9). » Il ajoute plus loin qu’« en réalité, les notions de droite et de gauche me sont devenues indifférentes; ce sont des catégories dans lesquelles je ne pense pas politiquement (idem) ».
Dans L’Aventure du politique. Entretiens avec Charles Blanchet (Critérion, 1991), ce catholique au chef toujours couvert d’un béret, se proclame « Français, gaulliste, européen et régionaliste ». Favorable à la réconciliation franco-allemande, il s’oppose néanmoins à la CED entre 1952 et 1954 avant de le regretter bien plus tard parce que, sans communauté militaire européenne effective, le projet continental perd toute consistance réelle. D’ailleurs, s’interroge-t-il dans La fin de la Renaissance (PUF, coll. « La politique éclatée », 1980), « les Européens seraient-ils même encore capables de mener une guerre ? (p. 7) » Il ne le pense pas, car « nous ne sommes pas simplement plongés dans une crise prolongée, prévient-il encore dans ce même ouvrage, mais en présence d’un terme, du dénouement d’un règne qui s’achève; un âge historique, celui de la Renaissance, est en train de se désagréger. L’Europe est désormais impuissante à assumer le destin qui fut le sien durant des siècles. Nous assistons à la fin de la première civilisation de caractère universel que le monde ait connue (p. 8) ». Un an auparavant, sa préface de L’impératif du renouveau exprimait son inquiétude lucide : « L’Europe est recroquevillée sur ses frontières géographiques, n’ayant guère plus d’autre puissance que sur elle-même, encore qu’il subsiste des vestiges de son ancienne grandeur. Elle a juste eu le temps de mettre en route la technologie moderne, mais l’exploitation lui échappe. Par rapport à ce qu’elle fut il y a à peine une cinquantaine d’années, elle est en déclin. Elle n’échappe pas aux vicissitudes historiques qui ont frappé toutes les civilisations, en dépit des progrès accomplis par chacune. C’est dans ce contexte de décadence que la France et l’Europe sont appelées à opérer leur renouveau. Elles ne pourront conjurer cette menace et réaliser leur redressement qu’à la condition d’assumer pleinement la situation actuelle, sans se perdre dans les rêveries prophétiques, utopiques ou nostalgiques.
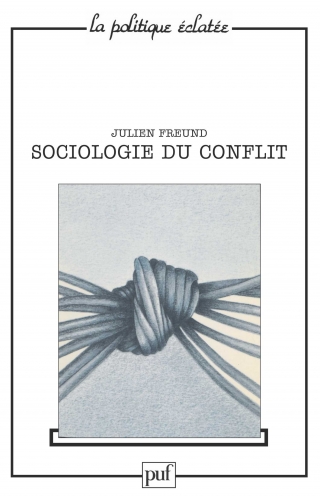 La politique se fait sur le terrain, et non dans les divagations spéculatives (p. 13). » Il relève dans son étude remarquable sur la notion de décadence que « si les civilisations ne se valent pas, c’est que chacune repose sur une hiérarchie des valeurs qui lui est propre et qui est la résultante d’options plus ou moins conscientes concernant les investissements capables de stimuler leur énergie. Cette hiérarchie conditionne donc l’originalité de chaque civilisation. Reniant leur passé, les Européens se sont laissés imposer, par leurs intellectuels, l’idée que leur civilisation n’était sous aucun rapport supérieure aux autres et même qu’ils devraient battre leur coulpe pour avoir inventé le capitalisme, l’impérialisme, la bombe thermonucléaire, etc. Une fausse interprétation de la notion de tolérance a largement contribué à cette culpabilisation. En effet, ni les idées, ni les valeurs ne sont tolérantes. Refusant de reconnaître leur originalité, les Européens n’adhèrent plus aux valeurs dont ils sont porteurs, de sorte qu’ils sont en train de perdre l’esprit de leur culture et le dynamisme qui en découle. Si encore ils ne faisaient que récuser leurs philosophies du passé, mais ils sont en train d’étouffer le sens de la philosophie qu’ils ont développée durant des siècles. La confusion des valeurs et la crise spirituelle qui en est la conséquence en sont le pitoyable témoignage. L’égalitarisme ambiant les conduit jusqu’à oublier que la hiérarchie est consubstantielle à l’idée même de valeur (p. 364) ».
La politique se fait sur le terrain, et non dans les divagations spéculatives (p. 13). » Il relève dans son étude remarquable sur la notion de décadence que « si les civilisations ne se valent pas, c’est que chacune repose sur une hiérarchie des valeurs qui lui est propre et qui est la résultante d’options plus ou moins conscientes concernant les investissements capables de stimuler leur énergie. Cette hiérarchie conditionne donc l’originalité de chaque civilisation. Reniant leur passé, les Européens se sont laissés imposer, par leurs intellectuels, l’idée que leur civilisation n’était sous aucun rapport supérieure aux autres et même qu’ils devraient battre leur coulpe pour avoir inventé le capitalisme, l’impérialisme, la bombe thermonucléaire, etc. Une fausse interprétation de la notion de tolérance a largement contribué à cette culpabilisation. En effet, ni les idées, ni les valeurs ne sont tolérantes. Refusant de reconnaître leur originalité, les Européens n’adhèrent plus aux valeurs dont ils sont porteurs, de sorte qu’ils sont en train de perdre l’esprit de leur culture et le dynamisme qui en découle. Si encore ils ne faisaient que récuser leurs philosophies du passé, mais ils sont en train d’étouffer le sens de la philosophie qu’ils ont développée durant des siècles. La confusion des valeurs et la crise spirituelle qui en est la conséquence en sont le pitoyable témoignage. L’égalitarisme ambiant les conduit jusqu’à oublier que la hiérarchie est consubstantielle à l’idée même de valeur (p. 364) ».
Ce conservateur libéral mécontent attaché au primat du régalien avance encore dans La fin de la Renaissance qu’« une civilisation décadente n’a plus d’autre projet que celui de se conserver (p. 22) ». Cette sentence réaliste explique le relatif effacement de son œuvre. Non réédités, ses ouvrages sont maintenant très difficiles à trouver chez les bouquinistes tandis que plusieurs manuscrits inédits attendent toujours quelques hardis éditeurs. Cette éclipse éditoriale contraste avec l’audience croissante de ses textes dans le monde hispanophone, dans le domaine germanophone, en Russie et chez les Anglo-Saxons. La découverte de Julien Freund à l’étranger coïncide avec la traduction soutenue des écrits de Carl Schmitt, y compris en Chine, en Corée et au Japon !
Par une franche liberté de ton, Julien Freund demeure un homme non seulement « mal-pensant », mais surtout intempestif, car « la vie est fondamentalement différenciation concrète et non universalisation abstraite (préface à L’impératif du renouveau, p. 7). Il avait deviné que le « festivisme » dépeint par Philippe Muray aboutirait à une nouvelle tyrannie postmoderniste. « Quand la transgression n’est plus occasionnelle mais devient un usage courant, ce qui s’accompagne en général d’une augmentation constante des effectifs de la police, on risque de péricliter insensiblement dans un État policier (La Décadence, p. 4). » Lire Julien Freund, c’est pouvoir aiguiser son intellect afin de mieux lutter contre le conformisme ambiant.
Georges Feltin-Tracol
• Chronique n° 32, « Les grandes figures identitaires européennes », lue le 28 janvier 2020 à Radio-Courtoisie au « Libre-Journal des Européens » de Thomas Ferrier.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
Les commentaires sont fermés.