
Luc-Olivier d'Algange: Entretien avec Anna Calosso sur "L'âme secrète de l'Europe"
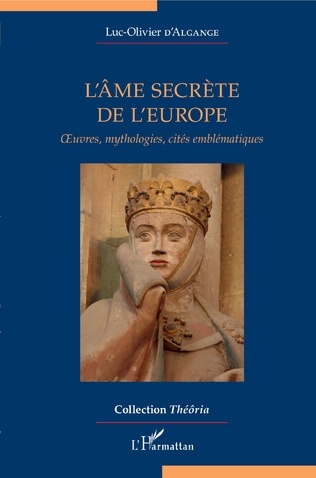 Anna Calosso : Vous venez de faire paraître un fort beau livre, au titre particulièrement évocateur pour nous, L'Ame secrète de l'Europe, dans la collection Théôrià, aux éditions de L'Harmattan, et je serais tentée de vous demander d'emblée : Qu'est-ce qu'une âme ? Et l'Europe, selon vous, a-t-elle encore une âme ?
Anna Calosso : Vous venez de faire paraître un fort beau livre, au titre particulièrement évocateur pour nous, L'Ame secrète de l'Europe, dans la collection Théôrià, aux éditions de L'Harmattan, et je serais tentée de vous demander d'emblée : Qu'est-ce qu'une âme ? Et l'Europe, selon vous, a-t-elle encore une âme ?
Luc-Olivier d'Algange : Avant de répondre directement à votre question, ou plus exactement à vos deux questions, aussi fondamentales l'une que l'autre, permettez-moi de dire quelques mots à propos de la collection où il vient de paraître, dirigée par Pierre-Marie Sigaud, nommée Théôrià. Cette collection, qui prend la suite de la collection Delphica des éditions de L'Age d'Homme, publie, depuis deux décennies, des œuvres, philosophiques et métaphysiques, qui relèvent de ce que l'on a nommé la sophia perennis . Citons, parmi les auteurs, Frithjof Schuon, Jean Borella, Jean Hani, Marco Pallis, Gilbert Durand, Françoise Bonardel, Patrick Laude ou encore Paul Ballanfat, dont un livre tout récent présente l'oeuvre de Yunus Emre, poète majeur, dont l'oeuvre poétique vient également de paraître dans cette collection.
Si l'on considère la pensée dominante, y compris dans ses aspects en apparence contradictoires, force est de reconnaître que nous sommes pris en tenaille entre le nihilisme relativiste, d'une part, et des formes de religiosités fondamentalistes, légalistes ou moralisatrices d'autre part. Entre l'homme-machine et le dévot narcissique et vengeur, entre un matérialisme et un spiritualisme (qui, soit dit en passant, obéissent également à une logique managériale), bien peu d'espace nous reste, tant et si bien que nous vivons dans un monde où nous ne respirons guère, où les souffles sont courts, où les pensées sont étroitement surveillées, où le débat intellectuel se réduit à l'accusation et à l'invective. D'où l'importance de ce corpus rassemblé sous le nom de Théôria,- mot qui veut dire contemplation, et qui redonne sa primauté à l'herméneutique, l'art de l'interprétation, l'expérience intérieure, mais avec précision et exigence, loin du fatras New Age et des « spiritualités » interchangeables ou touristiques.
Voici donc pour le paysage, où je suis heureux de me retrouver, et dans lequel le mot âme, bien sûr, vient tout de suite à l'esprit. L'expression « venir à l'esprit », au demeurant, n'est pas fortuite. L'âme, pour sortir de la sa gangue, a besoin de l'esprit. De même, que serait un esprit qui serait totalement détaché de l'âme, d'un esprit sans souci de l'âme, sinon une pure abstraction ? Une chose détachée, une chose sans cause, un pur néant.
Qu'est que l'âme ? L'âme est ce qui anime, et je serais tenté de dire, avec Jean-René Huguenin, que ce n'est pas l'âme qui est dans le corps mais le corps qui est dans l'âme. L'âme est inspir et expir, elle n'est point un épiphénomène, elle n'est pas subjective ; si intérieure qu'elle soit, c'est elle qui nous donne accès à la grande extériorité, au cosmos lui-même. Infime iota de lumière incréée dans le noir de la prunelle, elle est ce qui resplendit, la lumière sur l'eau, « la mer allée avec le soleil » dont parle Rimbaud.
Quant à la seconde partie de votre question, le titre même de l'ouvrage, donne la réponse. L'âme de l'Europe est devenue secrète. Elle existe, mais inapparente et lorsqu'elle semble apparaître, ici ou là, dans les vestiges visibles du passé, sa statuaire par exemple, ou ses œuvres contemporaines, elle est insultée, bafouée, conspuée, ou tout simplement ignorée. Cependant, le secret, dans sa modalité, n'est pas seulement un refuge, un retrait, une clandestinité, mais aussi, de par l'étymologie même du mot, un recours au sacré. Secrète, l'âme de l'Europe, n'est pas moins vive. Peut-être même pouvons-nous comprendre cette clandestinité comme une sorte de « mise-en-abyme » héraldique , la possibilité d'une récapitulation salvatrice. L'âme disparaît des apparences pour se tenir en éveil dans l'Apparaître.

Un chapitre du livre évoque cette possibilité : « Les dieux, ceux qui apparaissent ». Pour qu'une chose apparaisse, il faut qu'au préalable elle soit cachée, en attente, en puissance. Il n'est si grand hiver, qui, vers sa fin, ne laisse éclater les graines qui survivaient sous sa glace. Tout désormais, pour ceux qui sont attachés à la grande culture européenne, est affaire de survie. Or, lorsqu'elle est menacée, la survie devient métaphysique. Elle passe de l'immanence à la transcendance, elle se retourne vers son origine et sa fin dernière. Elle devient une lisière entre l'être et le néant, une expérience « gnostique » non au sens de la « gnose qui enfle », de la prétention intellectuelle, mais au sens d'une humilité nécessaire. Lorsque plus rien ne semble tenir, que tout s'effondre, et que l'horizon indépassable du « progrès » semble être un champs de ruines ou, pire encore, une réalité faussée, virtuelle, clonée, « zombique », nous devons retrouver le sens de la terre, de l'humus.
Vous avez remarqué qu'à intervalles régulier nos ordinateurs nous demandent de prouver que nous ne sommes pas des robots. Les preuves à l'appui seront, je gage, de plus en plus en plus difficiles à fournir, puis inutiles. Nous sommes intimement modifiés par les instruments que nous utilisons et par notre façon de les utiliser. En littérature, cette façon se nomme le style. Mais la littérature qui exige le silence, l'attente, la patience, la temporalité profonde, est elle-même menacée par l'ère du « clic » et du « toc » où nous sommes déjà entrés. Voyez la morale, qui fut autrefois l'objet de tant de réflexions et de passion, voyez ce qu'elle est est devenue : une chose binaire, manipulable, destructrice et d'une crétinerie sans nom, voire, pour filer la métaphore, une sorte de TOC, autrement dit un trouble obsessionnel compulsif. La morale qui fut l'objet de l'attention patiente des stoïciens, des théologiens, de Spinoza, de Montaigne, de Pascal, est devenue une forme de pathologie qui menace de tout ravager sur son passage, à commencer par la littérature, - non seulement la littérature « mal-pensante », mais la littérature en soi, autrement le langage qui n'est pas exclusivement au service d'une utilité ou d'une efficience immédiate.
 Anna Calosso : La comparaison vous paraîtra peut-être étrange, mais à lire votre livre, j'ai pensé à l'ouverture du Lohengrin de Richard Wagner. J'ai perçu là une musique, des nappes sonores, des orchestrations, des « leitmotives », comme si, en évoquant, tour à tour Nietzsche et Venise, la pensée grecque, des présocratiques à Plotin, Novalis et les romantiques allemands, l'alchimie du poème, vous vous étiez donné pour dessein de dire l'aurore attendue à travers le crépuscule : une aurore européenne, belle comme la statue de Uta von Ballenstedt qui figure sur la couverture de votre livre.
Anna Calosso : La comparaison vous paraîtra peut-être étrange, mais à lire votre livre, j'ai pensé à l'ouverture du Lohengrin de Richard Wagner. J'ai perçu là une musique, des nappes sonores, des orchestrations, des « leitmotives », comme si, en évoquant, tour à tour Nietzsche et Venise, la pensée grecque, des présocratiques à Plotin, Novalis et les romantiques allemands, l'alchimie du poème, vous vous étiez donné pour dessein de dire l'aurore attendue à travers le crépuscule : une aurore européenne, belle comme la statue de Uta von Ballenstedt qui figure sur la couverture de votre livre.
Luc-Olivier d'Algange : Je vous avoue n'y avoir pas songé, mais la façon dont vous en parlez donne à la comparaison une pertinence qui va,sans tarder, me porter à réécouter cette ouverture... Je vous avoue cependant que ces derniers temps j'ai davantage écouté du Debussy et du Ravel, voire du Nino Rota, que du Wagner. Mais vous avez sans doute raison, et Debussy fut aussi, peut-être, à sa façon, un « anti-wagnérien » wagnérien. Enfin, je vous dirai qu'entendre un livre comme de la musique, entendre la musique sur laquelle reposent les phrases, est sans doute la meilleure façon de lire, et peut-être la seule. Il n'est rien de plus navrant que ces lecteurs qui, dans un livre, se contentent de collecter les informations, des opinions, à partir desquelles ils se forgeront des avis ou des opinions, en accord ou en contradiction avec ceux du livre, peu importe. Ils seront passés à côté de ce dont naquirent les phrases ; ils seront passés à côté de l'auteur, et, ce qui est plus grave, des paysages et des figures aimées. Nous écrivons toujours avec toutes nos Muses. Les écrivains sont tous des plagiaires, - mais ce qu'ils tentent de plagier, ce n'est que malencontreusement d'autres livres. Le bon défi, en écrivant, est de tenter de plagier Scarlatti ou John Coltrane, ou encore un bruissement de feuillage ou son enchevêtrement, la neige qui tombe, la rugosité de l'écorce, la fugacité de la luciole, et les vagues, bien sûr, les vagues en leur triple mouvement. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas une seule façon de bien écrire, mais d'infinies, allant de l'évidence immobile du galet sur la plage jusqu'aux bouleversements des nuages par temps d'orage.
Anna Calosso : Cependant votre livre, si grande que soit l'importance que vous attachez à la poésie, est aussi un livre polémique, et, si j'ose dire, une sorte de « défense et illustration » de la culture européenne dans son identité profonde. Comment pourriez-vous formuler rapidement la thèse défendue?
Luc-Olivier d'Algange : Le mot « thèse » me semble inadéquat, cela supposerait une anti-thèse et une synthèse. Mon dessein est plus modeste et plus improvisé. J'obéis à des admirations, - et toutes, loin de là, ne figurent pas dans cet ouvrage... Ce livre est peut-être né du sentiment que tout conjure, aujourd'hui plus jamais, à nous faire passer à côté de la beauté des êtres et des choses. L'Europe n'est pas seulement un territoire, un ensemble de langues et de peuples plus ou moins apparentés ; elle fut aussi une possibilité de l'esprit et des corps, une réfraction particulière du monde. Qu'elle disparaisse, et ce sont des aspects de l'entendement humain qui disparaîtront, des styles, des exactitudes et des abandons, des mythes et des symboles, des inquiétudes et des aventures, des métaphysiques contradictoires, mais aussi des coutumes, des rites populaires ou aristocratiques . C'est vous dire que je ne crois aucunement en l'Europe économique ou technocratique, mais en la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal etc... Que se passe-t-il quand nous nous promenons à Paris ou à Venise, dans un village de Provence ou de l'Aveyron, quelles pensées nous viennent sur le quai du Tounis à Toulouse, ou sur le bord du Tage à Lisbonne, ou encore au Temple de Delphes, - ou tout simplement dans une forêt, sur la chemin de campagne, sur la terrasse d'un bistrot ? L'esprit des lieux, toujours, est plus grand que nous. Une certitude nous en vient : nous nous devons à ce qui est plus grand que nous, au choeur des voix qui se sont tues dont parlait Péguy, à notre langue, au Logos qui est Roi. Les grands bonheurs sont des réminiscences.

Anna Calosso : Mais qu'en est-il alors du présent, du bonheur présent ?
Luc-Olivier d'Algange : Le bonheur du présent est de devenir présence par l'afflux de la réminiscence, par les dons reçus et honorés. Il n'est pire malheur que l'amnésie ou le reniement. L'enfer sur terre a toujours été instauré par les adeptes de la table rase. Ceux-ci, remarquons-le, ne désarment pas. A peine sommes-nous remis d'un de leurs désastres programmés que les voici de nouveau à la tache, traquant, surveillant, lynchant sans relâche, honnissant leur passé et s'exaltant narcissiquement de leur présent, lui trouvant toutes sortes de vertus, et se croyant l'incarnation du Bien. A chaque homme de grande mémoire qui disparaît, notre vie s'abaisse d'un cran ; elle devient plus ennuyeuse, plus mesquine, plus calculatrice, et, en tout, plus misérable. Notre langue est notre mémoire : elle nous dit ce que nous fûmes et ce que nous pourrions être. Aussi bien s'acharne-t-on à la défigurer, à en rendre l'usage presque impossible, avec l'écriture inclusive, l'approximation, le jargon, une syntaxe effondrée, mais aussi, et surtout, un appauvrissement du vocabulaire, une uniformisation du propos autorisé, - si bien que certaines choses ne peuvent, tout simplement plus être dites. Les quelques « puristes » de la langue qui demeurent, hélas, n'y changeront rien. Tout au plus feront-ils quelques livres aimables dans un style « néo-hussard », où Blondin, Nimier, ou Jacques Laurent, certes, ne reconnaîtraient point leurs petits. Le mal est en amont. Il est dans l'expérience intérieure, l'espace intérieur. Qu'en est-il du « champs du possible » qu'évoquait Pindare ? Qu'en est-il de nos sensations à fleur de peau et des plus hautes spéculations de l'Intelligible, - au sens platonicien. Qu'en est-il de l'espace entre les deux, ce monde « imaginal » selon le néologisme de Henry Corbin, d'où apparaissent les symboles, les mythes, les épiphanies ? Qu'en est-il de l'aventure humaine ?

Anna Calosso : Vous écoutant, il me vient naturellement à l'esprit le nom de Gabriele D'Annunzio, auquel un des chapitres de votre livre est consacré. Un regret cependant, vous n'y retracez pas la fameuse équipée de Fiume, dont vous aviez parlé dans une excellente émission de radio en compagnie de Didier Carette.
Luc-Olivier d'Algange : Fiume sera présente dans un prochain livre qui porte sur le refus de la servitude volontaire. Ce fut, en effet, une aventure extraordinaire, échappant à toutes les idéologies, un exercice pratique de liberté conquise. J'y reviendrai. J'étais particulièrement heureux de l'évoquer avec Didier Carette, - qui sait particulièrement bien ce que c'est qu'être acteur, - au sens étymologique du terme. Au commencement était l'action, disait Goethe. Qu'est-ce que l'agir, qu'est-ce que la pensée ? Heidegger creuse admirablement la question. Nous croyons penser alors que nous ne pensons pas encore ; nous calculons, nous classons, nous évaluons, nous ratiocinons, mais nous ne pensons pas encore. Nous construisons des systèmes, nous inventons des orthopraxies, mais nous ne pensons pas. Il en est de même de l'action : nous nous affairons, mais l'essence de l'agir nous échappe. Le monde politique est la scène de ces actions vides, qui n'existent que par la représentation qu'elle se donnent d'elle-mêmes, - qui est flatteuse, qui n'est même que flatterie. Rien ne se fait vraiment : nos contemporains en sont flattés. Il y a des écoles de flatterie, de flagornerie, c'est une science : selon que le vent souffle, bien reconnaître le sens du poil. Un bon politicien reconnaît le sens du poil du Gros Animal dont il voudra se servir pour ne rien faire. D'où l'importance des poètes, du poien, et D'Annunzio en eut la plus haute conscience. La vie, dont il écrivit l'éloge, il la voulut, en disciple de Pindare, magnifique. Célébrer le passé afin que l'avenir revienne vers nous, ne rien renier, et tout vouloir hausser à une plus haute intensité, aimer d'un amour égal la douceur de la vie et la tragique de la mort. Sa devise est parfaite : « J'ai ce que j'ai donné ».
Anna Calosso : Quant-à-vous, cher Luc-Olivier, vous nous avez donné un beau livre, dont nous n'avons évoqué ici qu'une infime partie. Mais j'invite nos lecteurs à voyager avec vous dans le songe de Pallas-Athéna, d'entendre « le beau murmure des sages abeilles du pays », de méditer sur « la légère et infinie trame du monde », de divaguer au bord de lllissos, du Tage et de la Garonne, dans l'Allemagne d'Hölderlin, ou de Jacob Böhme, dans monde des visionnaires néoplatoniciens et des Alchimistes, « entre Albe et Aurore ». Rarement l'image de l'Attelage Ailé ne m'a semblé plus juste. Une dernière question. Dans votre hommage à Stefan George vous écrivez « La poésie est un combat ». Qu'en est-il du combat aujourd'hui ? Contre qui ou contre quoi faut-il se battre ?

Luc-Olivier d'Algange : Stefan George est un poète qui me tient à cœur. Il est tout ce que ce monde, - tantôt nihiliste malin, tantôt fondamentaliste obtus – n'est plus. Ludwig Lehnen disait de l'oeuvre de Stefan George qu'elle était un « contre-monde ». Solennelle, mais pour inviter à la légèreté de l'être ; mystérieuse mais pour donner accès au mystère de la limpidité ; aristocratique, mais par générosité. Ce « contre-monde » est l'enfance continuée. Sa langue est là, mallarméenne à certains égards, pour dire ce que nous ressentions avant de pouvoir le dire, avant l'adultération, la ratiocination, la banalité despotique.
La poésie est un combat contre le prosaïque, - elle est un combat pour la sauvegarde de ses propres sources intérieures . Le combat n'est pas idéologique, ni politique au sens actuel du terme, - qui se réduit à trouver un poste, - mais de chaque instant... A chaque instant, il nous donné de ternir ou de faire resplendir le monde. Il ne suffit plus d'être intelligent, de manier des concepts ou d'être maître dans l'art du sarcasme : il faut, comme disait Novalis « poétiser le réel ». Chacun sait, par intuition, que la vie ne suffit pas. Il faut faire danser les images et les mots en tarentelles dionysiaques... ou comme le proclamait D'Annunzio, à Fiume, aux derniers jours de l'aventure, danser une dernière fois devant la mer, aux lueurs des feux, avant la fin du rêve.
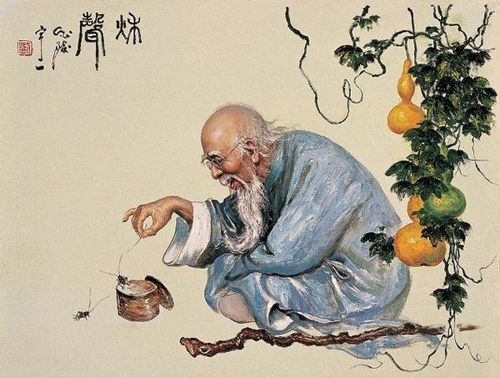






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
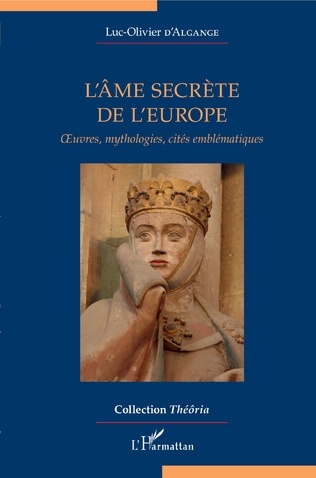 Anna Calosso :
Anna Calosso : 
 Anna Calosso :
Anna Calosso : 




