vendredi, 20 octobre 2023
Un entretien avec Pierre Le Vigan : « Penser le néant de l’époque »

Un entretien avec Pierre Le Vigan : « Penser le néant de l’époque »
Paru dans le quotidien Présent, mercredi 18 mars 2020
Questions de Pierre Saint-Servant
De votre livre Le Malaise est dans l’homme (2011) au Grand Empêchement qui vient de paraître, en passant par Soudain la postmodernité (2015) et Achever le nihilisme (2019), vous poursuivez la dissection de l’époque. Autour de quelle grande intuition ? Et peut-être, avec quel espoir ?
Ce qui m’intéresse, c’est ce qui est aux confins des permanences et des particularités de notre époque. Les maux de l’homme sont indissociables de sa sensibilité, si difficile à définir qu’Epicure préférait parler de l’ « élément sans nom » (un élément de l’âme bien sûr). L’époque actuelle, qui est une hypermodernité – une modernité intensifiée – contredit elle-même certains aspects de la modernité, comme la culture du travail, tout en la prolongeant, par l’individualisme de masse (un oxymore, mais qui résume notre époque). La quantité de modernité change sa qualité.
On pourrait appeler cela l’individualisme de masse un culte des différences, mais à condition qu’elles soient insignifiantes. Notre époque est celle du gang des postiches, qui est aussi le gang des postures. En fait, chacun souffre du vide de notre époque, qui est la désertion du sacré. Mais en son absence, chacun le remplace par des étiquettes (« noir racisé », « indigène de la république »…), qui sont des simili-identités.
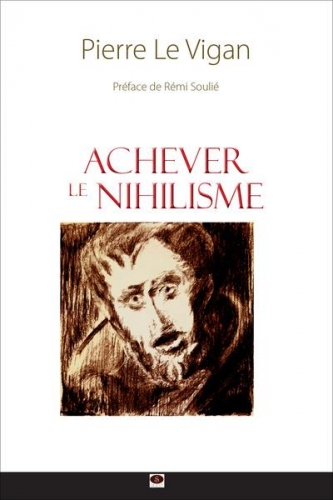 Les attitudes sociales à adopter faisaient l’objet d’un consensus normatif durant la modernité. Cette dernière (le XXe siècle jusqu’aux années 60) n’avait pas mis par terre les valeurs traditionnelles de respect de la famille, de la patrie, des Anciens. Mais elle avait mis ces valeurs au service d’un culte du travail, de la technique, du progrès. Ce culte a fini par se retourner contre ces valeurs qui, traditionnelles, avaient perdurées dans la modernité. Notre société, dominé par le Capital devenu un mode de production mondialisé, a besoin maintenant, avec l’hypermodernité, d’un culte plus ludique de l’activité, ou de « l’innovation », que le culte classique du travail, d’un culte de la consommation et de la « nouveauté » permanente, d’une individualisation croissante qui casse les formes traditionnelles de rapport au travail et le sérieux dans l’exercice des métiers.
Les attitudes sociales à adopter faisaient l’objet d’un consensus normatif durant la modernité. Cette dernière (le XXe siècle jusqu’aux années 60) n’avait pas mis par terre les valeurs traditionnelles de respect de la famille, de la patrie, des Anciens. Mais elle avait mis ces valeurs au service d’un culte du travail, de la technique, du progrès. Ce culte a fini par se retourner contre ces valeurs qui, traditionnelles, avaient perdurées dans la modernité. Notre société, dominé par le Capital devenu un mode de production mondialisé, a besoin maintenant, avec l’hypermodernité, d’un culte plus ludique de l’activité, ou de « l’innovation », que le culte classique du travail, d’un culte de la consommation et de la « nouveauté » permanente, d’une individualisation croissante qui casse les formes traditionnelles de rapport au travail et le sérieux dans l’exercice des métiers.
Notre société s’est gadgétisée. Le Capital (les forces économiques qui dominent notre société et lui donnent sa forme) a besoin d’hommes interchangeables et jetables, et non de travailleurs fidélisés, comme c’était en partie le cas dans les années 50 – ce qui ne gommait pas les conflits sociaux, mais les structurait. Le Capital a besoin d’une société plus atomisée, fluide, liquide.
Votre réflexion tente de creuser - et d’élucider – la question de l’épuisement de l’homme postmoderne. Epuisement biologique, psychologique, bien visible, mais aussi spirituel, esthétique, ce qui est certainement plus grave. Quelles sont les grandes causes de cet épuisement ?
La cause principale de cet épuisement me parait être la fin des verticalités c’est-à-dire des transmissions, des figures du Père, des fidélités. L’homme doit s’inventer, il est « libre d’être soi », mais surtout contraint d’édifier son soi (Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi). Après la mort de Dieu, ou son « éclipse » (Martin Buber), le progrès a tenu lieu de nouvelle religion. La croyance au progrès a légitimé bien des désastres, aussi bien sociaux qu’esthétiques. Mais cette religion du progrès avait le mérite d’être collective. Elle a laissé place à l’impératif individualiste de la création de soi par soi. C’est plus difficile, et cela ne fait pas lien entre nous.
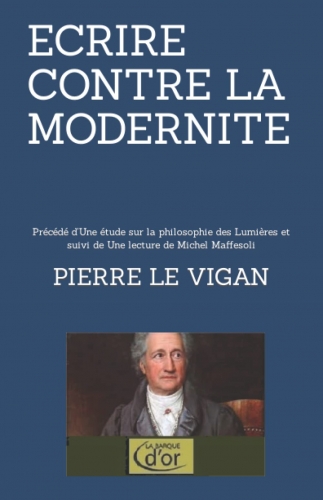 Or, si chaque homme doit se construire, toute société doit lui donner un outillage mental et moral de valeurs, et de perspectives à partir duquel il se construit. C’est ce que nos sociétés occidentales ont oublié, en tombant dans l’idéologie de la désaffiliation, et en refusant toute notion d’héritage culturel et même biologique, puisque quelqu’un né garçon pourrait « choisir » d’être fille – et réciproquement. L’idéologie du « c’est mon choix » fait de chacun l’esclave de ses engouements passagers, tandis que la notion d’engagement, qui est toujours avant tout vis-à-vis de soi-même, s’efface. Or, c’est lui qui donne contenu et sens à la vie. C’est la promesse que l’on se fait à soi-même qui est la plus importante.
Or, si chaque homme doit se construire, toute société doit lui donner un outillage mental et moral de valeurs, et de perspectives à partir duquel il se construit. C’est ce que nos sociétés occidentales ont oublié, en tombant dans l’idéologie de la désaffiliation, et en refusant toute notion d’héritage culturel et même biologique, puisque quelqu’un né garçon pourrait « choisir » d’être fille – et réciproquement. L’idéologie du « c’est mon choix » fait de chacun l’esclave de ses engouements passagers, tandis que la notion d’engagement, qui est toujours avant tout vis-à-vis de soi-même, s’efface. Or, c’est lui qui donne contenu et sens à la vie. C’est la promesse que l’on se fait à soi-même qui est la plus importante.
L’emprise numérique semble être le nouvel horizon de l’esclavage postmoderne, un esclavage volontaire qui fait vivre des milliards d’individus « dans la Caverne ». Quel regard portez-vous sur ce dernier stade du nihilisme ?
Les écrans sont à la fois une merveilleuse invention (le cinéma…) et une menace. La reproduction visuelle de la réalité remplace l’expérimentation de la réalité. Dans un musée, vous remarquerez que beaucoup de visiteurs passent plus de temps à photographier les tableaux qu’à les regarder. De là vient ce que Walter Benjamin appelait la perte de l’aura. Celle-ci est le sentiment de sacré qui nous saisit devant le caractère unique – et fragile – d’une œuvre d’art. Entre un homme et une femme, l’aura, c’est l’amour. En politique, c’est le charisme. Nous en manquons.
Auteur prolifique, vous êtes également un grand lecteur. Permettez-moi d’évoquer avec vous trois grands noms, qui, le temps d’une illumination médiatique, ont resurgi récemment : Heidegger, George Steiner et Roger Scruton. Commençons par Heidegger, dont le texte « Bâtir habiter penser » suscite un regain d’intérêt. Que devez-vous à Heidegger ?
Le texte « bâtir, habiter, penser », de 1951, a donné lieu à beaucoup d’études, et a stimulé la philosophie de l’architecture. Celle-ci est riche, de Ludger Schwarte à Chris Younès, Françoise Choay, Benoit Goetz, un grand ancien comme Paul Valery, Céline Bonicco-Donato, Marc Augé… Heidegger montre qu’habiter n’est pas seulement se loger, trouver un abri, c’est « être présent au monde et à autrui ». La question du lieu et de l’habiter est centrale dans l’anthropologie philosophique. La réflexion sur l’habiter et le lieu (qui s’oppose au non-lieu) n’est pas dissociable de l’étude d’autres textes d’Heidegger, tels « Qu’est-ce qu’une chose », et du livre inachevé Etre et temps, « chef d’œuvre de ce siècle » et « un des quelques livres éternels de la philosophie », comme disait Lévinas.
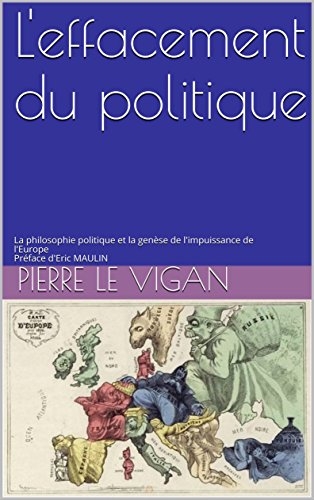 Disons quelques mots du philosophe conservateur Roger Scruton. Vous était-il familier ?
Disons quelques mots du philosophe conservateur Roger Scruton. Vous était-il familier ?
Scruton est venu au paléoconservatisme (différent du néoconservatisme libéral de Mme Thatcher) par l’esthétique, la reconnaissance de la nécessité de la beauté. C’est un bon point de départ. Toutefois, la critique par Scruton du « marxisme culturel » soixante-huitard passe largement à côté de la pensée de Marx (qui n’était pas son sujet). En outre, pour conserver (ou restaurer) ce qui mérité de l’être, il faut révolutionner l’économie, et la démondialiser. Il n’y a de bon conservatisme que révolutionnaire.
Enfin, terminons avec George Steiner, dont on connaît les dialogues lumineux avec Pierre Boutang, et qui porta si haut l’art de la lecture…
Je ne crois qu’à un sacré sans religion, ou, en tout cas, au-delà de toute religion. Si ce sacré est encore religieux, cela veut dire une « religion » sans dogme et sans révélation. Pas de théisme donc. Mais peut-être un déisme. Plus bouddhiste que chrétien, plus habité par le sacré et le numineux (Rudolf Otto, la présence absolue du divin) que par les monothéismes, quoique chrétien de civilisation. Peut-être hanté par le sentiment de la présence des dieux – ou d’un Dieu – comme reflet du tragique de la condition humaine et certitude de notre situation précaire au sein d’un immense cosmos. Plutôt lire Hubert Reeves que les textes « saints ». En somme, je suis panthéiste.
Autant dire que je ne suis pas sensible au thème du « sacrifice d’Abraham » (ni du malheureux bélier). Sans diviniser la nature, je pense qu’il n’y a de sacré que dans la nature. Quant à la sainteté, elle m’ennuie. Exemple : Roger Holeindre n’était pas un saint. Il était bien mieux que cela. Un guerrier, et un homme de passions. J’aime les hommes de passions. Mais j’aime aussi le détachement. J’écoute Renan, dans La prière sur l’Acropole : « Tout n'est ici-bas que symbole et que songe. Les dieux passent comme les hommes, et il ne serait pas bon qu'ils fussent éternels. La foi qu'on a eue ne doit jamais être une chaîne. On est quitte envers elle quand on l'a soigneusement roulée dans le linceul de pourpre où dorment les dieux morts ».
*
Propos recueillis par Pierre Saint-Servant
Présent, 18 mars 2020.
23:35 Publié dans Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entetien, philosophie, pierre le vigan, postmodernité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.