
Alternative postmoderne: un phénomène sans nom
Alexandre Douguine
Source: https://katehon.com/ru/article/alternativnyy-postmodern-yavlenie-bez-imeni?fbclid=IwAR35iYgBQytDZPH4sK718gd5glijlgpxy5K2VNCir4jvrpBrHEijJD3QNKc
Déconstruction de la postmodernité
Plusieurs aspects importants de la postmodernité doivent être clarifiés. Il ne s'agit pas d'un phénomène à part entière, et bien que ce soient les postmodernistes (en particulier Derrida [1]) qui aient introduit la notion de "déconstruction" (basée toutefois sur la notion de "destruction" de Heidegger dans "Sein und Zeit" [2]), la postmodernité elle-même peut être déconstruite à son tour, et pas nécessairement dans le style postmoderne.
La postmodernité prend forme sur la base de la modernité. Ce faisant, elle critique en partie la modernité et la prolonge en partie. Au fur et à mesure que cette tendance s'est développée, ce qu'elle critique exactement dansla modernité et comment elle critique exactement cette modernité, et ce qu'elle continue exactement à critiquer et comment elle poursuit cette critique, est devenu une sorte de dogme philosophique, contre lequel les attaques sont délibérément interdites. C'est ce qui fait que le postmoderne est postmoderne, ce qui n'est ni mauvais ni bon, mais tel qu'il est. Sinon, le phénomène finirait par se dissoudre. Mais ce n'est pas le cas, et malgré toute l'ironie, la dérobade et le manque de sincérité du discours postmoderne, il existe un noyau très précis de principes fondamentaux qu'il n'abandonne jamais et des frontières très clairement délimitées qu'il ne franchit jamais. Si nous nous plaçons à une distance critiquement significative de ce noyau, et si nous franchissons librement certaines limites interdites, nous pouvons regarder le postmoderne de loin et nous poser la question suivante: n'est-il pas possible d'enlever au postmoderne certaines lignes qu'il a lui-même empruntées quelque part et de les recombiner différemment de ce qu'il fait lui-même? Et aussi, n'est-il pas possible d'ignorer certaines limites et certains impératifs moraux qu'elle établit, et de démembrer la postmodernité en ses éléments constitutifs, en ignorant complètement ses inévitables protestations et ses cris de douleur théorique?
Démanteler le moderne: pourquoi pouvons-nous aimer le postmoderne?
Je propose les considérations les plus générales sur ce sujet. Structurons notre analyse de la manière suivante: tout d'abord, nous identifierons les lignes principale du Postmodernisme, qui sont intéressantes du point de vue d'une critique radicale de la Modernité, isolée de la morale postmoderne, puis nous énumérerons les traits qui, au contraire, sont tellement imprégnés de cette morale qu'ils en sont inséparables.

Qu'est-ce qui attire donc le critique radical de l'époque contemporaine en Europe occidentale vers le postmoderne ?
- La phénoménologie et son fonctionnement avec la notion d'intensionnalité (Brentano, Husserl, Meinong, Ehrenfels, Fink).
- Le structuralisme et l'identification d'une ontologie autonome du langage, du texte, du discours (Saussure, Troubetskoy, Jakobson, Propp, Greimas, Riker, Dumézil).
- Le pluralisme culturel et l'intérêt pour les sociétés archaïques (Boas, Mauss, Lévi-Strauss).
- La découverte du sacré comme facteur le plus important de l'existentialisme (Durkheim, Eliade, Bataille, Caillois, Gérard, Blanchot).
- L'existentialisme et la philosophie du Dasein (Heidegger et ses épigones).
- L'acceptation des thèmes psychanalytiques comme un "travail de rêve" continu subvertissant les mécanismes de la rationalité (Freud, Jung, Lacan).
- La déconstruction comme contextualisation (Heidegger).
- Attention à la narration comme mythe (Bachelard, G. Durand).
- Critique du racisme, de l'ethnocentrisme et du suprématisme occidentaux (Gramsci, Boas - Personnalité et culture, Nouvelle anthropologie).
- Critique de la représentation scientifique du monde (Newton) et de la rationalité (cartésienne et rococo principalement) qui la justifie (Foucault, Feyerabend, Latour).
- Démonstration de la fragilité, de l'arbitraire et de la fausseté des attitudes fondamentales de la modernité (Cioran, Blaga, Latour).
- Pessimisme à l'égard de la civilisation de l'Europe occidentale, exposant les mythologies utopiques de "l'avenir radieux" et du "progrès" (Spengler, Jünger, Cioran).
- Sociologie - principalement fonctionnalisme (Durkheim, Mauss), montrant le caractère illusoire des prétentions de l'individu à la liberté vis-à-vis de la société et à la souveraineté rationnelle-psychologique.
- Exposition du nihilisme du New Age (Nietzsche, Heidegger).
- Relativisation de l'homme (Nietzsche, Jünger).
- Découverte de l'intériorité de l'homme (Mounier, Corbin, Bataille, Jambet).
- Théologie politique (C. Schmitt, J. Agamben).

Progressisme postmoderne et censure
Il convient de noter d'emblée que ces tendances fondamentales ont pris forme avant le postmoderne et ont existé indépendamment de lui.
Elles ont toutes apporté quelque chose d'essentiel à la postmodernité et, à partir d'un certain moment, ont commencé à se déployer dans son contexte au point de se confondre partiellement avec elle. Mais il est évident que chacune de ces approches, leurs intersections et leurs points de rencontre, leurs dialogues et leurs discussions possibles et réelles, sont tout à fait réels et possibles, et ce, complètement en dehors du contexte postmoderne. Ayant affirmé cela, nous ne manquerons pas de nous heurter aux protestations des postmodernistes eux-mêmes. Pour eux, toute interprétation non postmoderniste de ces courants est délibérément écartée par la postmodernité elle-même, et en dehors de son contexte, elle n'est admissible qu'en tant que recherche archéologique.
Les postmodernistes insistent fermement : ces disciplines, écoles et mouvements sont devenus des objets incorporés au sujet postmoderne, qui s'est emparé de tout le pouvoir d'interprétation. En d'autres termes, tous ces courants de pensée sont considérés comme dépassés, surpassés, "enlevés" au sens hégélien, et n'ont aucun droit à une interprétation souveraine. Ils ne peuvent que continuer dans le postmoderne et selon ses règles. En elles-mêmes, toutes ces tendances ne sont pas seulement dépassées, mais toxiques, si elles sont prises en dehors du contexte postmoderne.
Néanmoins, toutes ces tendances sont apparues au tournant du vingtième siècle ou au cours du vingtième siècle et représentent un tournant systémique dans l'histoire de la modernité elle-même. La modernité y affronte frontalement sa crise sous-jacente, son échec et sa fin inévitable. Mais ce qui est important, c'est que cette confrontation a lieu avant même que la postmodernité n'acquière ses traits caractéristiques explicites. Toutes ces tendances pénètrent dans la Postmodernité, fondent son climat intellectuel, façonnent son langage et ses systèmes conceptuels, mais dans la Modernité elle-même, elles sont présentes dans un contexte différent, surveillé avec vigilance par les "orthodoxies de la pensée" - celles-là mêmes sur lesquelles la critique de la Postmodernité elle-même fonde son pathos émancipateur. Tout comme la modernité a remplacé la société traditionnelle (prémodernité) sur une vague d'antidogmatisme, mais a très vite formulé son propre dogmatisme ; tout comme les régimes communistes qui ont pris le pouvoir sous le slogan de la lutte contre la violence et l'oppression ont donné naissance à des systèmes totalitaires brutaux fondés sur une violence et une oppression bien plus grandes, il en va de même pour la postmodernité, qui a très vite acquis un caractère exclusiviste et tyrannique. Le paradoxe est que la postmodernité élève le relativisme au rang de valeur universelle, mais défend ensuite cet "acquis" avec les méthodes les plus brutales et les plus globalistes - absolutistes. La transgression passe d'une possibilité à un impératif, et l'attention accrue portée à la pathologie devient la nouvelle norme. Dès lors, tout ce qui a précédé la formation d'un tel système est soumis à une exclusion rigide.
Si nous examinons attentivement la liste ci-dessus, nous pouvons constater que ces mouvements et écoles philosophiques se considèrent en partie dans le contexte de la modernité, mais comme des mouvements de pensée qui ont découvert l'insuffisance ou la défectuosité de la modernité, et en partie (bien que beaucoup moins fréquemment) ils tirent des conclusions plus radicales sur la modernité dans son ensemble en tant que phénomène sombre, pervers, nihiliste et erroné.

Qu'est-ce qui doit être radicalement rejeté dans la postmodernité ?
Soulignons maintenant les caractéristiques de la postmodernité qui sont probablement responsables de cette renaissance totalitaire.
- Le progressisme. Mais cette fois-ci, il est paradoxal, puisque le "progrès" est désormais considéré comme le démantèlement de la foi en un "avenir radieux", le renversement de l'utopie et du projet. On peut parler de "progressisme noir" ou de "Lumières sombres" (N. Land [3]).
- Le matérialisme. Ce n'est pas seulement l'héritage non critique de la modernité, mais l'attitude ultime, puisque les formes précédentes de matérialisme sont reconnues comme trop "idéalistes". Il faut maintenant justifier le "vrai matérialisme". (Deleuze [4], Kristeva [5]).
- Le relativisme. Tout universalisme, c'est-à-dire la réduction à des instances unificatrices supérieures de la multitude environnante, est critiqué, ce qui est projeté sur toutes les formes de hiérarchies verticales et de taxonomies. Le relativisme lui-même est érigé en dogme incontestable (F. Lyotard [6], Negri et Hard [7]).
- Le Post-structuralisme. Reconnaissance de l'insuffisance de la méthode structuraliste parce qu'elle ne couvre pas les dynamiques historiques et sociales et qu'elle interdit (ou prédit sciemment) les mutations. D'où l'appel au dépassement du structuralisme (M. Foucault, J. Deleuze, R. Barthes).
- La Critique radicale de la Tradition. La Tradition est considérée (dans l'esprit du marxisme - notamment par E. Hobsbawm [8]) comme une "fiction bourgeoise", un "opium pour le peuple". Ainsi, toute allusion à une ontologie souveraine de l'esprit est complètement éliminée. La modernité elle-même est perçue comme un "re-façonnage de la Tradition", et cette remarque a valeur de verdict.
- Un nouvel universalisme - critique, sceptique -. L'exigence de soumettre toute généralisation au ridicule et à la décomposition ironique, parallèlement au déplacement de l'attention vers des fragments hétérogènes, des fractales ontiques.
- La morale de la libération totale et du dépassement des frontières. La transgression (M. Foucault [9], G. Deleuze, F. Guattari, G. Bataille [10])
- L'anti-essentialisme. De l'analyse du Dasein par Heidegger, on tire une conclusion hâtive et perverse sur le caractère vicieux du concept même d'"essence", et l'être est tellement placé dans le devenir (même dans le devenir corporel) que la question de l'essence, et a fortiori de l'espèce, est rejetée à la racine.
- L'annulation de l'identité. Toute identité apparaît comme temporaire, ludique, accidentelle et arbitraire. Seul le dépassement de l'identité, et non sa construction, devient moral.
- La théorie du genre. La découverte d'ontologies autonomes de minorités et de classes opprimées devient une contrainte totale à relativiser le genre ainsi que l'âge, dans la limite de toute identité d'espèce. (Kristeva [11], D. Harroway [12])
- La construction de modèles postmodernes de psychanalyse avec une tentative de dépasser les topiques structurelles de Freud et même de Lacan (F. Guattari [13]).
- Une haine farouche de toute hiérarchie et de toute verticalité (contre la métaphore de l'Arbre). Démocratisme radical jusqu'à l'apologie des schizo-masses et des dividuums, démembrés en organismes constitutifs souverains séparés - " parlement des organes " (B. Latour [14]).
- Le nihilisme. L'affirmation du nihilisme moderne se transforme ici en une valorisation consciente du néant, en une "volonté de néant" (Deleuze [15]). Le néant cesse d'être un concept péioratif et est pris comme une fixation de but.
- L'annulation de l'événement. Le passage au recyclage (J. Baudrillard [16]).
- Le posthumanisme. L'épuisement du début humain comme porteur d'une verticalité trop traditionnelle (B. H. Levy [17]). L'appel à transcender l'humain dans les hybrides, les "machines à désir", les cyborgs et les chimères. L'écologie profonde et les théories du cthulhuzen (D. Harroway [18]).
- L'apologie des minorités. Assimilation des cultures archaïques organiques à des sous-cultures mécaniques artificielles. Organisation artificielle de communautés en réseau de pervers et de malades mentaux.

La postmodernité comme finalisation nihiliste de la modernité
Si nous examinons attentivement ces points, nous pouvons clairement voir que la postmodernité n'est pas seulement une continuité avec la modernité, mais qu'elle porte la moralité de l'ère contemporaine à sa limite logique. Dans cette liste de traits postmodernes, nous voyons - déjà sans équivoque et sans ambiguïté (contrairement à la première liste) - une critique de la modernité par la gauche, c'est-à-dire la tristesse de voir que la modernité telle que nous la connaissons n'a pas été capable de mener ses postulats à leur pleine réalisation, et que la postmodernité est maintenant prête à s'acquitter de cette tâche difficile. Dans ce cas, le postmoderne se révèle comme la finalisation de la modernité, l'accomplissement de son telos. Mais si la Modernité a accompli son travail d'émancipation dans les conditions de la société traditionnelle (Prémodernité), les conditions de départ sont désormais la Modernité elle-même, qui doit être surmontée cette fois-ci. D'où le caractère bolchevique totalitaire des épistémologies postmodernes, qui embrassent pleinement la théorie de la terreur révolutionnaire. La modernité doit être éradiquée précisément parce qu'elle n'est pas assez moderne, parce qu'elle a échoué dans sa mission. Toute cette structure reproduit intégralement la logique du marxisme : la bourgeoisie est une classe progressiste par rapport au féodalisme, mais le prolétariat est encore plus progressiste et doit renverser le pouvoir de la bourgeoisie. La postmodernité suit strictement le même schéma: la modernité est meilleure que la tradition (prémodernité), mais la postmodernité est inévitable comme son dépassement. Un dépassement par la gauche.

Théorie critique implicite
Examinons maintenant les lignes que nous avons notées comme étant intéressantes. Si nous les séparons de la postmodernité, et surtout des aspects que nous avons jugés inacceptables, nous obtenons toute une série de théories, d'écoles et d'approches qui forment une certaine unité. Et cette globalité ne devient visible qu'après avoir soumis la postmodernité elle-même à la déconstruction et à la séparation. Le fait que toutes ces tendances se soient développées indépendamment de la postmodernité, avant elle et en dehors d'elle, nous permet de conclure que nous avons affaire à un ensemble d'idées complètement différentes et autonomes. Toutes se fondent sur la reconnaissance de la crise fondamentale et décisive de la civilisation occidentale moderne ("La crise du monde moderne" de R. Guénon [19]), tentent d'identifier le moment de l'histoire où les erreurs fatales ont été commises et ont conduit à l'état actuel des choses, identifient les principales tendances au nihilisme et à la dégénérescence et proposent leurs propres scénarios pour sortir de cette situation - certains plus radicaux, d'autres moins: de la correction de trajectoire en tenant compte des dimensions épistémologiques nouvellement découvertes à la rébellion directe contre le monde moderne ou à la révolution conservatrice. La fixation sur le nihilisme du New Age ouest-européen, et en particulier sur les phases purement négatives révélées au 20ème siècle, relie ces lignes à la postmodernité et lui permet de les intégrer dans son contexte jusqu'à un certain point. Mais si nous examinons de plus près cet ensemble de théories et de courants, nous constatons qu'ils peuvent être harmonisés entre eux - bien que de manière relative - sur la base d'un vecteur sémantique complètement différent. Ils se proposent de libérer la Modernité avant tout de cette facette qui, au contraire, est devenue dominante dans la Postmodernité.
En d'autres termes, nous avons affaire à un point de bifurcation dans la culture intellectuelle du 20ème siècle, où l'attitude critique générale à l'égard de la civilisation occidentale moderne, de sa philosophie, de sa science, de sa politique, de sa culture, etc. s'est scindée en deux lignes principales :
- La postmodernité elle-même, qui est devenue le détenteur explicite et inclusif d'un noyau d'interprétation et de valeurs, revendiquant l'unicité,
- et le second phénomène, qui n'a pas reçu de nom propre, étant déplacé, démembré et modifié par la postmodernité elle-même.

L'absence de nom pour cette direction, ainsi que le manque de consolidation de ses représentants, l'acceptation de la majorité des écoles et des courants ayant une existence isolée dans les conditions de la postmodernité naissante et la concentration sur l'étude de problèmes et de questions sectorielles locales, ne nous permettent pas de parler de cette branche de la pensée critique dans l'Occident du 20ème siècle comme de quelque chose d'intégral.
La seule tentative d'unification de ces courants disparates a été faite par la Nouvelle Droite française. Elle y est parvenue en partie, mais en partie aussi, ce mouvement de pensée a été étiqueté avec un certain nombre de positions sans principes et artificiellement marginalisé. Par conséquent, il n'y avait tout simplement pas de nom, de structure ou d'institutionnalisation pour une alternative postmoderne ou non postmoderne.
Cependant, ce n'est pas une raison décisive pour accepter cette branche de la pensée critique comme quelque chose de fantomatique et accepter les prétentions hégémoniques du postmoderne. Nous pouvons considérer l'ensemble de ces vecteurs intellectuels comme une vision du monde implicite mais tout à fait cohérente. Il est facile de le faire si nous adoptons le point de vue d'une histoire alternative dans le domaine des idées. Il est bien connu que dans l'histoire, le côté gagnant - dans les guerres, les conflits religieux, les processus apolitiques, les élections, les révolutions, les soulèvements, les coups d'État, les polémiques scientifiques et philosophiques, et dans d'autres formes d'agonalité physique et spirituelle - ne s'avère pas nécessairement être juste, bon et du côté de la vérité. Tout se passe différemment. Et nous pouvons appliquer cela au postmoderne et à son alternative, l'alt-post-moderne.

La phénoménologie
Reprenons les directions que nous avons identifiées comme attrayantes dans cette perspective.
La phénoménologie est importante avant tout parce qu'elle affirme le statut fondamental du sujet, sa priorité ontologique et sa souveraineté. Elle rompt avec l'axiomatique matérialiste de la Modernité en plaçant le sujet de l'acte intensionnel à l'intérieur même du processus de pensée et de perception. D'où le terme même d'in-tentio, se diriger vers ce qui est à l'intérieur.
Brentano, le fondateur de la phénoménologie [20], a puisé cette idée dans la scolastique européenne, et dans l'aristotélisme radical de l'ordre bénédictin (Friedrich von Freiberg, mystiques rhénans), qui insiste sur le fait que l'intellect actif est immanent à l'âme humaine. Et il est caractéristique que Brentano lui-même ait consacré sa thèse précisément au problème de l'intellect actif chez Aristote [21]. Et bien que la phénoménologie, développée par Husserl et portée aux sommets par Heidegger, soit un mouvement philosophique moderne, si l'on y regarde de près, on peut y reconnaître un style de pensée antérieur au nominalisme, au matérialisme et à l'atomisme de l'époque moderne et de l'ère contemporaine. La phénoménologie transcende les frontières de la modernité, mais en même temps, un certain nombre de ses dispositions sont très proches de la pensée classique et médiévale.
Le structuralisme
Le structuralisme est extrêmement intéressant en ce qu'il rétablit la primauté de la parole (encore la dimension subjective !) sur tout le domaine des objets extra-linguistiques. Si cette position, qui bat en brèche l'approche des positivistes convaincus de la primauté des choses réelles et des faits atomiques correspondants, est nouvelle tant dans le domaine de la linguistique que dans celui de la logique et de la philologie, on peut y reconnaître l'attitude à l'égard du Logos, de l'ontologie de l'esprit et de la parole, qui était caractéristique de la société traditionnelle. Bien que la conclusion sur l'ontologie souveraine du texte semble extravagante et même grotesque - dans le contexte de la domination du positivisme, à la fois conscient et inconscient - c'est précisément la façon dont le langage et la pensée étaient traités à l'époque précédant l'assaut total de l'approche nominaliste. Après tout, la dispute sur les universaux était essentiellement une polémique entre ceux qui affirmaient une ontologie autonome des noms (les réalistes et les idéalistes) et ceux qui la niaient (les nominalistes).
Le structuralisme entre donc bien en résonance avec le réalisme et l'idéalisme, bien qu'il déploie sa doctrine dans un contexte philosophique et culturel différent.
Une fois encore, un certain trait, régulièrement associé aux méthodologies postmodernes, s'avère proche des prémodernes.
Et si l'on tient compte des liens des grands structuralistes, des fondateurs de la phonologie, de Troubetskoy et de Jakobson avec le courant eurasien, de la proximité du thème principal des travaux de Dumézil sur l'idéologie trifonctionnelle des Indo-Européens [22] avec le traditionalisme, des parallèles des études de Propp [23] et de Greimas [24] avec les structures de la vision sacrée du monde, cette parenté apparaît encore plus substantielle et plus évidente.

Réhabilitation des sociétés archaïques
Une étude approfondie et impartiale des sociétés archaïques construites sur des mythes et des croyances, réfutant les conclusions superficielles, hâtives et fausses de l'anthropologie progressiste et évolutionniste, permet une vision complètement différente de l'essence de la culture, qui (comme F. Boas [25] et son école l'ont particulièrement insisté) doit être comprise à partir d'elle-même, sans remettre en question la sémantique et l'ontologie de chaque société à l'étude.
Cela conduit à reconnaître la pluralité des cultures et un ensemble minimal de propriétés qui pourraient être considérées comme universelles. Les structures d'échange, qui se rapportent précisément aux universaux de toute société, ont chacune une forme distinctive qui définit le paysage ontologique et épistémologique.
Le sacré
La découverte du sacré en tant que phénomène particulier s'est faite de manière synchrone en sociologie, en sciences religieuses et en philosophie traditionaliste. Alors que les traditionalistes ont directement pris position sur le sacré, reconnaissant sa perte dans la civilisation moderne comme un signe de dégradation, les sociologues se sont limités à sa description détaillée, tandis que la religion comparée - ainsi que certains courants de la psychanalyse, surtout l'école jungienne [26] - ont montré comment des éléments durables de la vie sacrée dans le monde subsistent même dans les cultures basées sur des principes rationnels-matériels.

La postmodernité utilise activement le thème du sacré, mais uniquement pour soumettre la modernité à une critique dévastatrice - parce qu'elle n'a pas réussi à mettre ses principes en pratique. Au lieu de fissurer le monde, de le désenchanter (M. Weber [27]), elle n'a produit qu'une nouvelle série de mythes. La postmodernité ne réhabilite pas le mythe; au contraire, elle veut s'en débarrasser, mais de manière plus fondamentale et plus décisive que les Lumières. Mais une telle intention n'était pas présente chez les sociologues, ni chez les chercheurs en études religieuses comparées, ni chez les pragmatistes (W. James [28]), ni même chez les traditionalistes. Par conséquent, nous pouvons facilement identifier le vaste domaine de l'étude du sacré comme un champ indépendant, ignorant complètement les objectifs postmodernistes et les stratégies correspondantes.
Philosophie du Dasein
Prouver que la philosophie de Heidegger est un champ d'idées vaste et autonome n'a aucun sens. C'est une évidence. Et il est tout aussi évident que les intentions de Heidegger à l'égard du nouveau commencement de la philosophie n'ont rien à voir avec les attitudes fondamentales des postmodernes. Les échos de Heidegger ont atteint le postmoderne par le biais de son interprétation - déjà assez sélective et déformée - dans l'école française des existentialistes (Sartre, Camus, etc.), et dans le contexte postmoderne, ils ont été transformés au point d'en être méconnaissables.
Si l'on veut, on peut trouver dans le concept fondamental de rhizome [29] de Deleuze un écho lointain du Dasein de Heidegger, mais il s'agit ici plus d'une parodie matérialiste grossière que d'une véritable continuité.
La psychanalyse
Le champ de la psychanalyse est aussi évidemment plus large que le postmoderne et que la philosophie de Heidegger. Ce qui est le plus précieux dans la psychanalyse, c'est l'affirmation de l'ontologie autonome de la psyché, le domaine de l'inconscient par rapport au monde extérieur, qui tire sa sémantique et son statut non pas tant des structures de la rationalité subjective que des mécanismes complexes du travail invisible des rêves. En même temps, la psychanalyse ne doit pas être réduite à un seul système d'interprétation - dans l'esprit du freudisme orthodoxe, du jungianisme ou du modèle de Lacan. L'anti-Œdipe de Deleuze et Guattari [30] ainsi que la psychanalyse féministe sont des phénomènes plutôt marginaux qui, contrairement aux affirmations plutôt totalitaires des postmodernistes, n'annulent en rien les autres systèmes d'interprétation. En un sens, la psychanalyse réhabilite le domaine du mythe et les structures du sacré, ce qui, dans le cas de Jung et de certains de ses disciples, se rapproche du traditionalisme et du rejet du rationalisme étroit du New Age. Les séminaires d'Eranos fournissent une vaste illustration de ces points de contact.

La déconstruction
La déconstruction, proposée par le philosophe postmoderne Jacques Derrida [31], est un développement de la méthode de destruction philosophique justifiée par Heidegger dans Sein und Zeit [32], comme nous l'avons déjà évoqué. Heidegger entendait à l'origine placer une école philosophique, une théorie ou une terminologie dans la structure délibérément définie de l'histoire de la philosophie. Dans le cas de Heidegger lui-même, cette structure était définie par un processus d'oubli progressif de l'être jusqu'à ce que la question même de l'être et de sa relation à l'être soit supprimée (ontologische Differenz). En ce sens et dans un contexte plus large, la déconstruction peut être appliquée dans une grande variété de disciplines pour retrouver les positions originales de ce que le regretté Wittgenstein [33] appelle le "jeu du langage". Il s'agit d'une analyse sémantique approfondie et correcte qui prend en compte toutes les couches de sens, depuis l'endroit où un terme, une idée ou une théorie, ainsi qu'une histoire ou un récit mythologique, apparaît pour la première fois, jusqu'à une analyse minutieuse des contextes où la sémantique a changé, a été déformée, a traversé des points de rupture et des phases de déplacement. Ici aussi, le modèle heideggérien de l'histoire de la philosophie, tout à fait pertinent et productif en soi, ne doit pas nécessairement être considéré comme le seul.

Mythanalyse
L'étude du mythe en tant que scénario soutenu de mise en relation d'images, de figures, d'actions et d'événements permet d'élucider les traits caractéristiques de récits appartenant souvent à des époques, des situations et des strates culturelles très différentes. Si la déconstruction cherche à trouver le noyau originel d'un corpus de connaissances ou d'une épistémè distincte et à retracer leur développement et leurs mutations, la mythanalyse (G. Durand [34]), au contraire, vise à identifier des schémas et des algorithmes similaires de la culture et de différents domaines de la conscience, confirmant ainsi l'unité structurelle.
Dans certains cas, la mythanalyse peut être étroitement liée à la psychanalyse jungienne. Dans d'autres cas, elle peut être appliquée à des phénomènes complètement différents dans les domaines de la sociologie, de l'anthropologie, des sciences politiques et des études culturelles [35].
L'antiracisme différentialiste
La critique de toutes les formes d'ethnocentrisme, et en particulier des prétentions à établir des hiérarchies entre les peuples, les cultures et les différents types de sociétés, ne doit pas nécessairement être construite sur la base d'un individualisme extrême, d'une apologie a priori de toutes les minorités et d'une légitimation de la déviance. La pluralité des cultures doit être reconnue comme une loi semagénétique, car les significations ne naissent que dans la culture - et dans chaque culture en particulier. Et chaque culture établit ses propres critères et évaluations, à l'aune desquels elle se mesure et mesure tout ce qui se trouve dans sa zone d'influence.
La reconnaissance de la structure multiculturelle complexe des sociétés humaines conduit au différentialisme et au rejet total de la hiérarchie. En outre, la réduction à l'individu, qui est à la base de la morale égalitaire du postmoderne, détruit les ensembles culturels au lieu de les protéger et de les renforcer. L'antiracisme différentialiste, au contraire, se contente de postuler les différences entre les sociétés, sans chercher à les évaluer à l'aide d'un quelconque critère général "transcendantal" (qui en principe ne peut exister et tout candidat à un tel statut ne serait qu'une projection de l'une des sociétés), ni à les détruire.
Cette lecture de l'école de Boas [36] et de Lévi-Strauss [37] a été caractéristique des Eurasistes russes et de la Nouvelle Droite française. Mais cette méthodologie peut être étendue de manière significative au-delà des systèmes et écoles théoriques respectifs.
Critique de la représentation scientifique du monde
Les ontologies alternatives à l'image nominaliste des sciences naturelles, qui constituent l'un des aspects les plus intéressants et attrayants de la postmodernité (M. Foucault [38], B. Latour [39], P. Feyerabend [40]), peuvent également être étudiées et reconstruites en dehors du champ postmoderne.
Une telle approche se réfère généralement à la critique de Husserl des sciences européennes modernes [41], qui - comme tout ce qui est lié à la phénoménologie - constitue un champ scientifique complètement séparé et complet. En même temps, il est nécessaire d'examiner de plus près les conceptions scientifiques qui existaient à l'époque prémoderne et qui ont été bouleversées avec l'avènement de la modernité. En Europe, il s'agit surtout des ontologies scientifiques d'Aristote et en partie de l'hermétisme [42]. Mais le postmoderne ne le fait catégoriquement pas, construisant une critique du scientisme uniquement sur la volonté de surmonter les lacunes de l'image scientifique du monde à partir de la position du "nouvel ouvert" - théorie de la relativité, théorie quantique, théorie générale des champs, logique modale, théorie des supercordes, etc. sans se référer à la science du prémoderne, la considérant, comme les scientifiques de l'ère moderne, seulement comme une "approximation grossière" et un ensemble de "préjugés erronés". Mais en même temps, c'est l'élaboration d'une critique de la science à l'ère moderne sur la base d'une tentative de dépasser ses limites et de corriger ses erreurs apparentes par la redécouverte des sciences sacrées, au-delà de l'attitude péjorative originelle à leur égard, qui pouvait donner un horizon complètement différent à l'ensemble de la connaissance scientifique naturelle [43].

La critique du rationalisme qui sous-tend l'approche scientifique, ainsi que du dualisme cartésien rigide et du mécanisme grossier de l'ontologie matérialiste de Newton, conduit à une compréhension plus subtile et nuancée de l'esprit d'une part, et d'autre part, réhabilite les notions platoniciennes et aristotéliciennes de la supériorité ontologique de l'esprit - chez Aristote l'"intellect actif", chez Platon le divin Nous (Νοῦς). Et à partir de là, il est tout à fait possible de développer de nouvelles ontologies scientifiques - en comprenant correctement les conceptions de la nature inhérentes aux cultures de l'Antiquité et du Moyen-Âge (au lieu du simulacre dont l'histoire des sciences traite aujourd'hui), pour les mettre en relation avec les conclusions des dernières tendances de la science. Ce serait extrêmement fructueux, mais le dogmatisme progressiste même du postmoderne bloque rigidement cette direction. En dehors du postmoderne, cependant, il n'y a pas d'obstacles à une telle recherche.
Critique de la modernité
La critique de la modernité en général dans le cas des postmodernistes suit la logique de la critique du capitalisme par Marx. Marx pensait que le capitalisme était un phénomène tout à fait abominable qui devait être combattu, mais il reconnaissait son inévitabilité historique et même son caractère progressiste par rapport à d'autres formations - précapitalistes [44]. Sur cette base, il a tracé une ligne de démarcation stricte entre ceux qui, comme lui, critiquaient le capitalisme à partir de positions post-capitalistes, et ceux qui rejetaient non seulement le capitalisme lui-même, mais aussi sa nécessité, son inévitabilité et son utilité. C'est le cas de nombreux partisans du socialisme conservateur, des patriotes allemands comme Ferdinand Lassalle [45] ou des Narodniki russes.
Il en va de même pour la critique de la modernité. Si les postmodernes estiment que la Modernité représente une catastrophe et un échec, ils acceptent en même temps sa moralité et les objectifs "émancipateurs" qu'elle s'est fixés, mais qu'elle n'a pas atteints. Malgré toute la justesse et parfois la pertinence de cette critique, elle souffre - comme le marxisme - de l'importance exagérée de la Modernité comme destin, alors qu'elle n'est qu'une question de choix. On peut choisir la Modernité, ou on peut choisir autre chose, comme la Tradition. La volonté de faire alliance avec tous les opposants à la modernité est la principale caractéristique de ceux qui la rejettent vraiment. Ce n'est pas un hasard si le philosophe français René Alleau [46] a qualifié René Guénon de révolutionnaire encore plus radical que Marx. Lorsque les critiques du monde moderne - par exemple André Gide [47], en partie Antonin Artaud [48], Georges Bataille [49], Ezra Pound [50] ou Thomas S. Eliot [51], ainsi que certains dadaïstes et surréalistes - sont prêts à prendre au sérieux les idées de Guénon [52] et d'Evola [53] dans leur critique impitoyable de la modernité, leurs propres arguments prennent une signification particulière. Dans le cas contraire, ils perdent une grande partie de leur acuité et se retrouvent atteints de la même maladie que celle qu'ils sont sur le point d'éliminer.
Le pessimisme à l'égard de la civilisation de l'Europe occidentale
Tout ceci est vrai pour le pessimisme concernant la civilisation de l'Europe occidentale dans son état actuel. Il est critiqué à gauche - comme Henri Bergson [54], Sartre [55] ou Marcuse [56] - et à droite - comme Nietzsche, Spengler [57], les frères Jünger ou Cioran [58]. Dans ce qu'elles ont en commun et dans la mesure où l'appel à l'alternative se projette dans l'avenir et s'inspire du passé, ces deux approches ont beaucoup de valeur. Cependant, voir dans cette civilisation autre chose qu'une maladie, une déviance ou, au pire, la Grande Parodie et le "royaume de l'Antéchrist", c'est accepter sciemment sa logique interne, c'est reconnaître sa légitimité.

En dehors de la postmodernité, un tel dialogue entre critiques de droite et critiques de gauche, bien que difficile, restait possible. La postmodernité a complètement fermé cette voie.
La pertinence de la sociologie
Les thèses de la sociologie en tant que science apparue à la fin de la modernité ont une grande validité dans l'étude de la relation entre la société et l'individu et surtout dans la découverte du caractère fondamental de la supériorité de la société qui détermine en général l'ensemble du contenu de ses membres. Durkheim [59] appelle cela le fonctionnalisme : l'individu dans la société n'est pas défini par lui-même et par son contenu supposé "autonome", mais par l'ensemble des rôles sociaux, des masques et des fonctions qu'il remplit.
Cependant, de nombreuses conclusions différentes peuvent être déduites de cette affirmation sociologique fondamentale - les exemples de F. Tönnies [60], W. Sombart [61], P. Sorokin [62], V. Pareto [63], L. Dumont [64], etc. - montrent qu'il n'y a pas de dominante univoque dans le développement de la société, ni de régularités universelles. Il est possible de constater des processus cycliques, des récessions et des hausses, des époques de développement et de dégradation dans les sociétés, mais aucun schéma linéaire ne peut être construit. Ainsi, le fer de lance de la morale libérale, qui exige la libération de l'individu de l'identité collective, est complètement rejeté, et la lecture libérale de la logique de l'histoire en tant que processus progressif de libération s'avère être une chimère insoutenable. La sociologie met brillamment à jour de nombreux mythes modernes qui ont le statut de "vérités sociales ou de lois", alors qu'il s'agit en réalité de simples idées-pouvoirs (G. Sorel [65]) utilisées par les élites dirigeantes souvent à des fins purement égoïstes.
La sociologie expose le progrès comme un préjugé insoutenable et sans fondement (P. Sorokin[66]).
La postmodernité s'appuie sur la sociologie, mais seulement pour trouver de nouvelles stratégies - exotiques - de libération de l'individu et de mutations progressives de la société : la transgression, le changement des rôles de genre, le passage de collectifs paranoïaques à des masses schizo (Deleuze/Guattari [67]), l'invention de langages individuels (R. Barth [68], F. Sollers [69], etc.). Il ne s'agit pas ici d'un retour du particulier au général, mais d'une fragmentation supplémentaire de l'individu vers le sous-individuel - vers un " parlement d'organes " (B. Latour) et une " fabrique de micro-désirs " (comme Deleuze imaginait le fonctionnement de l'inconscient).

En dehors de ce contexte, la sociologie conserve tout son potentiel herméneutique, en restaurant le statut ontologique du général (holisme) et en plaçant au centre la personne (persona), plutôt que l'individu.
Le nihilisme
Le nihilisme de la société occidentale moderne a été découvert et fixé bien avant le postmoderne - Nietzsche avait déjà parlé de ce phénomène fondamental de manière assez détaillée, et Heidegger [70], en développant ses idées, a construit sa propre théorie du néant. En fait, toute la philosophie de Heidegger est une recherche de tels chemins de pensée, selon lesquels il serait possible de sortir du labyrinthe nihiliste. Le problème du néant a été posé ici de la manière la plus sérieuse qui soit, et il le reste dans toute son ampleur.
Les postmodernes se sont empressés de s'arroger le monopole du nihilisme. Au lieu de découvrir la nature tragique de la modernité ou de la problématiser, ils l'ont transformée en un trope ironique facile : Deleuze a proclamé la volonté de néant comme la principale motivation de la culture postmoderne [71]. Ainsi, une réponse hâtive et en partie cynique a été donnée avant que la question n'ait été pleinement comprise. Le nihilisme postmoderne ressemble plus à du hooliganisme et à de l'euphémisme qu'à une philosophie sérieuse. Et les tentatives de donner à des versions de cette plaisanterie peu réussie le statut de principe épistémologique - dans la non-philosophie de François Laruelle [72] ou le nihilisme transcendantal de Ray Brasier [73] - dogmatisent définitivement le produit de l'échec philosophique.
Le nihilisme du monde moderne a encore besoin d'une réflexion profonde et très probablement d'un dépassement radical dans l'esprit de Nietzsche, qui appelait le Surhomme "le vainqueur de Dieu et du néant" [74], comme J. Evola [75] le discute en détail dans Chevaucher le Tigre.
Relativisation de l'homme
Dans la lignée de Nietzsche et de son appel à "déshumaniser l'être", de nombreux penseurs du 20ème siècle ont posé la question des limites de l'homme et remis en cause sa position centrale dans l'être. Ortega y Gasset a attiré l'attention sur la déshumanisation de l'art [76]. À son tour, Ernst Jünger [77] a décrit la phénoménologie du déplacement de la nature humaine elle-même par les structures technocratiques de la modernité.
À partir de cette position de départ, la pensée pouvait s'orienter - et s'est effectivement orientée pendant un certain temps - dans diverses directions, par exemple vers l'éthologie de Konrad Lorenz [78], la théorie de l'"environnement" de Jakob von Uxküll [79], la critique de la technologie de Friedrich Georg, le frère d'Ernst Jünger [80], ou l'"écologie de l'esprit" de Gregory Bateson [81].

La postmodernité a placé cette position dans la glorification des mutations, l'appel à la création d'espèces chimériques et bio-mécaniques et la dénonciation de tout essentialisme. La lutte contre l'anthropocentrisme a ici dépassé toutes les limites du raisonnable et s'est transformée, avec l'appui des sciences cognitives, du comportementalisme et des technologies numériques, en un véritable projet d'élimination de l'homme en tant qu'espèce, tel qu'il est glorifié par les futurologues qui glorifient la Singularité - comme Yuval Harari [82] ou Ray Kurzweil [83].
La découverte de la dimension intérieure de l'homme
La découverte de la dimension intérieure de l'homme, bien que résumée par le moderniste Georges Bataille dans son essai "L'expérience intérieure" [84], n'est en aucun cas l'apanage des Modernes. L'apôtre Paul a parlé de "l'homme intérieur" dès l'apôtre Paul. La doctrine même de l'âme, caractéristique des religions traditionnelles, en parle exactement. La modernité, avec son recours au matérialisme et à la théorie de l'évolution, a perdu presque complètement cette dimension, construisant son épistémologie et sa psychologie sur le modèle d'un homme sans âme, c'est-à-dire sans dimension intérieure souveraine. Le fait que cette dimension ait été spontanément découverte par certains artistes d'avant-garde - surréalistes, non-conformistes, etc. - au cours de leur immersion dans la compréhension de la crise de la modernité ne signifie pas que l'"homme intérieur" soit une découverte du vingtième siècle.
De manière caractéristique, parallèlement à cette découverte spontanée, le traditionaliste Julius Evola [85] et son maître René Guénon [86] ont donné les descriptions les plus étendues de la subjectivité radicale.
La même ligne a été activement développée par les personnalistes à la suite d'E. Mounier [87]. Et Henri Corbin [88] et ses disciples (Jambet [89], Lardreau [90], Lory [91], etc.) lui ont donné une signification accrue dans la figure de l'Ange (mentionnée dans le même contexte par Rilke et Heidegger commentant sa poésie).
En conséquence, dans la postmodernité, ce thème est secondaire, et les réalistes critiques en général sont radicalement opposés à toute référence à la dimension intérieure - à moins qu'il ne s'agisse de la dimension intérieure des choses elles-mêmes, complètement dépourvue de tout lien avec le Dasein (G. Harman [92]).
En dehors du contexte postmoderne, ce thème - la problématique du sujet radical [93] - est à nouveau la question la plus importante de la philosophie.
Théologie politique
La théologie politique a été formulée comme une théorie de la philosophie du politique par Carl Schmitt [94]. Le fait que les idées de Schmitt aient été développées par des philosophes de gauche proches du postmodernisme - J. Taubes [95], Ch. Mouffe [96], G. Agamben [97] - ne change rien au fait que cette théorie a un sens tout à fait autonome et peut être considérée tout à fait indépendamment des interprétations postmodernistes - vie nue, catéchisme négatif, etc.
C'est d'ailleurs dans le contexte de l'ensemble de la philosophie de Carl Schmitt, conservateur convaincu et critique de la modernité en tant que telle, que la "théologie politique" est véritablement entière.
Postmodernité et traditionalisme alternatifs
Cette analyse préliminaire, pour approximative qu'elle soit, nous ouvre une piste de réflexion fondamentale. La postmodernité a sérieusement brouillé les cartes dans le domaine philosophique, en prétendant (sans raison) résumer l'histoire intellectuelle de l'humanité. Mais en la rejetant entièrement, nous nous trouvons à notre tour dans une situation difficile, puisque nous sommes obligés de nous référer uniquement à l'époque précédente de la Modernité, d'ailleurs à bien des égards dépassée par la Postmodernité, et dont les postmodernistes ont appris à traiter les arguments avec aisance. De plus, en rejetant le postmoderne, nous sommes en désaccord avec le moderne lui-même, qui (et sur ce point les postmodernistes ont raison) est en effet l'aboutissement de la morale moderniste des Lumières. En même temps, l'appel du postmoderne à un certain nombre de courants critiques, s'il est rejeté dans son intégralité, l'oblige à les rejeter également.
De même, la gravitation formelle du postmoderne vers le "sacré" et les autres directions que nous avons identifiées comme positives et constructives peut partiellement discréditer les structures du prémoderne. Un appel direct à la Tradition sans tenir compte de l'influence fondamentale que la Modernité et la Postmodernité ont exercée sur la quasi-totalité des sociétés modernes, occidentales et non occidentales, n'est pas du tout possible, puisque nous sommes séparés du Prémoderne par un mur sémantique dans lequel les rayons de la Tradition authentique sont soit éteints, soit modifiés au point d'être méconnaissables. Pour percer vers la Tradition, nous devons d'abord nous occuper du Moderne et du Postmoderne. Sinon, nous devrons rester dans la zone de leur influence épistémologique.

Par conséquent, le phénomène que nous avons provisoirement appelé "postmodernité alternative" est d'une importance fondamentale. Il ne peut tout simplement pas être évité et nous ne pouvons pas nous en passer. Bien sûr, le noyau devrait être le traditionalisme et la critique la plus radicale de la modernité, mais sans un dialogue vivant avec l'environnement intellectuel, le traditionalisme pur dégénère rapidement et perd son pouvoir, se transformant en une secte impuissante et peu attrayante. L'alternative postmoderne, en revanche, réveille et mobilise le potentiel intérieur du traditionalisme. Le traditionaliste Julius Evola a entrepris quelque chose de similaire, répondant dans ses œuvres aux défis philosophiques, culturels, politiques et scientifiques les plus divers de la modernité, sans craindre de s'éloigner de l'orthodoxie traditionaliste, parce que dans nos conditions critiques extrêmes de dégradation cyclique, une telle orthodoxie ne peut tout simplement pas exister. Nous devrions faire de même dans le nouveau cycle.
Notes:
[1] Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2007.
[2] Heidegger M. Sein und Zeit. Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman, 1977. S. 27.
[3] Land N. Fanged Noumena: Collected Writings 1987-2007. New York; Windsor Quarry (Falmouth): Sequence; Urbanomic, 2011.
[4] Deleuze G. La logique du sens. P.: Editions de Minuit, 1969.
[5] Kristeva J. Le révolution du langage poétique. P.: Seuil, 1974.
[6] Lyotard J.-F. Le Postmoderne expliqué aux enfants : Correspondance 1982-1985. P.: Galilée, 1988.
[7] Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 2004
[8] Hobsbawm E., Ranger T. L'Invention de la tradition. P.: Éditions Amsterdam, 2006.
[9] Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб. : Университетская книга, 1997.
[10] Батай Ж. Проклятая часть. М.: Ладомир, 2006; Он же. Сад и обычный человек. Суверенный человек Сада // Маркиз де Сад и XX век. М.: Культура, 1992.
[11] Kristeva J. Le Génie féminin: la vie, la folie, les mots. P.: Fayard, 1999.
[12] Haraway D. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York; London: Routledge; Free Association Books, 1991.
[13] Guattari F. L'Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie. (avec Gilles Deleuze). P.: Minuit, , 1972; Idem. Chaosmose. P.: Galilée, 1992.
[14] Latour B. Reassembling the social. An introduction to Actor-Network Theory. Oxford: OUP, 2005.
[15] Deleuze G. La logique du sens.
[16] Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
[17] Lévy B.-H. Le Testament de Dieu. P.: Grasset, 1979.
[18] Haraway D. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham: Duke University Press, 2016.
[19] Генон Р. Кризис современного мира. М.: Арктогея, 1991.
[20] Brentano F. Psychologie vom empirischen Standpunkte. Frankfurt am Main: Ontos, 2008.
[21] Brentano F. Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos. Mainz: Franz Kirchheim, 1867.
[22] Dumézil G. L’Idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. P.: Gallimard, 1968.
[23] Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Издательство ЛГУ, 1986.
[24] Греймас А. Структурная семантика. Поиск метода. М.: Академический проект, 2004.
[25] Boas F. The mind of primitive man. A course of lectures delivered before the Lowell institute, 1910-1911. L.: The Macmillan company, 1911.
[26] Юнг К.Г. Психология бессознательного. М.: Когито-Центр, 2010.
[27] Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: Российская политическая энциклопедия, 2006.
[28] Джеймс У. Прагматизм: новое название для некоторых старых методов мышления: Популярные лекции по философии. М.: ЛКИ, 2011.
[29] Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург; Москва: У-Фактория; Астрель, 2010.
[30] Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург.: У-Фактория, 2007..
[31] Деррида Ж. Письмо и различие.
[32] Heidegger M. Sein und Zeit.
[33] Витгенштейн Л. Голубая и Коричневая книги: предварительные материалы к «Философским исследованиям». Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2008.
[34] Durand G. Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés. : Albin Michel, 1996; Idem. Figures mythiques et visages de l'œuvre. De la mythocritique à la mythanalyse. P.: Berg International, 1979.
[35] Дугин А.Г. Воображение. Философия, социология, структуры. М.: Академический проект, 2015.
[36] Boas F. Race, Language and Culture. Toronto: Collier MacMillan, 1940.
[37] Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Академический Проект, 2008.
[38] Фуко М. Археология знания. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004; Он же. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб: А-cad, 1994ж Он же. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.
[39] Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006.
[40] Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ; Хранитель, 2007.
[41] Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию. СПб.: Владимир Даль, 2004.
[42] Дугин А.Г. Интернальные Онтологии. Сакральная физика и опрокинутый мир. Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2022.
[43] Дугин А.Г. Интернальные онтологии. Сакральная физика и опрокинутый мир.
[44] Маркс К., Фридрих Э. Из ранних произведений. М.: Государственное издательство политической литературы, 1956.
[45] Lassalle F. Reden und Schriften. Neue Gesamtausgabe. Mit einer biographischen Einleitung. Band 1–3., Berlin: Expedition des Vorwärts Berliner Volksblatt, 1892–1893.
[46] Alleau R. De Marx a Guénon: d’une critique «radicale» à une critique «principielle» de sociétés modernes/ Les Dossiers H. René Guénon. P.: L’Âge d’Homme, 1984.
[47] Жид А. Собрание сочинений в 7 томах. М.: Терра; Книжный клуб , 2002.
[48] Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. СПб.; М.: Симпозиум, 2000.
[49] Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006.
[50] Pound E. Guide to Kulchur. L.: Faber & Faber, 1938.
[51] Элиот Т.С. Избранная поэзия. СПб.: Северо-Запад, 1994.
[52]Генон Р. Кризис современного мира. М.: Арктогея, 1991; Он же. Восток и Запад. М.: Беловодье, 2005; Он же. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М.: Беловодье, 2003.
[53] Эвола Ю. Восстание против современного мира. М.: Прометей, 2016.
[54] Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999.
[55] Сартр Ж. П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2000.
[56] Маркузе Г. Одномерный человек. М.: Refl-book, 1994.
[57] Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории: В 2 т. М.: Мысль, 1998.
[58] Чоран Э. После конца истории. СПб: Симпозиум, 2002.
[59] Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.
[60] Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. М.; СПб.: Фонд Университет; Владимир Даль, 2002.
[61] Зомбарт В.. Собрание сочинений в 3 томах. СПб: Владимир Даль, 2005 – 2008.
[62] Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика: Исследования изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. М.: Астрель, 2006.
[63] Парето В. Компендиум по общей социологии. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008.
[64] Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. М.: Евразия, 2001; Он же. Homo aequalis, I. Генезис и расцвет экономической идеологии. М.: Nota Bene, 2000; Он же. Эссе об индивидуализме. Дубна: Феникс, 1997.
[65] Sorel G. Commitment and Change: Georges Sorel and the idea of revolution. Toronto: University of Toronto Press, 1978.
[66] Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.· Политиздат, 1992.
[67] Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения.
[68] Barthes R. La mort de l'auteur. P.: Mantéia, 1968.
[69] Sollers Ph. L'Écriture et l'Expérience des Limites. P.: Seuil, 1968.
[70] Heidegger M. Nietzsche. 2 B. (G/A 6.1, 6.2). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1996-1997.
[71] Делёз Ж. Логика смысла. М.: Академический проект, 2010.
[72] Laruelle F. Principes de la non-philosophie. P.: PUF, 1996.
[73] Brassier R. Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction (London: Palgrave Macmillan, 2007)
[74] Ницше Ф. К генеалогии морали/Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 471.
[75] Эвола Ю. Оседлать тигра. М.: Владимир Даль, 2005.
[76] Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М.: Издательство АСТ, 2008.
Оруэлл Дж. 1984. Скотный Двор. М.: АСТ, 2014.
[77] Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О боли. СПб.: Наука Год, 2000.
[78] Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М.: «Прогресс», «Универс», 1994.
[79] Uexküll J. Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten. Berlin: J. Springer, 1934; Idem. Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Bedeutungslehre. Frankfurt a. M.: S. Fischer, 1970; Idem. Das allmächtige Leben. Hamburg: Christian Wegner Verlag, 1950.
[80] Юнгер Ф. Г. Совершенство техники. Машина и собственность. СПб: Издательство «Владимир Даль», 2002.
[81] Бейтсон Г. Экология разума: Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.: Смысл, 2000.
[82] Harari Y. Sapiens: A Brief History of Humankind. L.: Harvill Secker, 2014; Idem. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. L.: Vintage, 2017.
[83] Kurzweil R. The singularity is near. NY: Viking, 2005.
[84] Батай Ж. Внутренний Опыт. СПб: Axioma/Мифрил, 1997.
[85] Evola J. Teoria dell'individuo assoluto. Torino: Bocca, 1927; Idem. Fenomenologia dell'individuo assoluto. Torino: Bocca, 1930; Idem. Lo Yoga della potenza. Torino: Bocca, 1949.
[86] Генон Р. Человек и его осуществление согласно Веданте. Восточная метафизика. М.:Беловодье, 2004.
[87] Mounier E. Œuvres, 4 volumes. P.: Seuil, 1961-1962.
[88] Corbin H. L’Homme et son Ange. P.: Fayard, 1983.
[89] Jambet C. L’acte de l’être. P.: Fayard, 2002.
[90] Lardreau G., Jambet C. Ontologie de la révolution I. L'Ange : Pour une cynégétique du semblant. P.:Grasset, 1976.
[91] Lory P. La dignité de l'homme face aux anges, aux animaux et aux djinns. P.: Albin Michel, 2018.
[92] HarmanG. Tool-Being. Heidegger and the Metaphysics of Objects. Chicago: Open Court, 2002.
[93] Дугин А.Г. Радикальный субъект и его дубль. М.: Евразийское движение, 2009.
[94] Шмитт К. Политическая теология. М. : Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 2000.
[95] Taubes J. Abendländische Eschatologie. München: Matthes & Seitz, 1991; Таубес Я. Ad Carl Scmitt. Сопряжение противостремительного. СПб.: «Владимир Даль», 2021
[96] Mouffe Ch. On the political. London ; New York : Routledge, 2005.
[97] Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011; Он же. Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
Список литературы:
Alleau R. De Marx a Guénon: d’une critique «radicale» à une critique «principielle» de sociétés modernes/ Les Dossiers H. René Guénon. P.: L’Âge d’Homme, 1984.
Barthes R. La mort de l'auteur. P.: Mantéia, 1968.
Boas F. Race, Language and Culture. Toronto: Collier MacMillan, 1940.
Boas F. The mind of primitive man. A course of lectures delivered before the Lowell institute, 1910-1911. L.: The Macmillan company, 1911.
Brassier R. Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction. London: Palgrave Macmillan, 2007.
Brentano F. Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos. Mainz: Franz Kirchheim, 1867.
Brentano F. Psychologie vom empirischen Standpunkte. Frankfurt am Main: Ontos, 2008.
Corbin H. L’Homme et son Ange. P.: Fayard, 1983.
Deleuze G. La logique du sens. P.: Editions de Minuit, 1969.
Dumézil G. L’Idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. P.: Gallimard, 1968.
Durand G. Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés. : Albin Michel, 1996.
Durand G Figures mythiques et visages de l'œuvre. De la mythocritique à la mythanalyse. P.: Berg International, 1979.
Evola J. Teoria dell'individuo assoluto. Torino: Bocca, 1927.
Evola J. Fenomenologia dell'individuo assoluto. Torino: Bocca, 1930.
Evola JLo Yoga della potenza. Torino: Bocca, 1949.
Guattari F. L'Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie. (avec Gilles Deleuze). P.: Minuit, , 1972.
Guattari F. Chaosmose. P.: Galilée, 1992.
Harari Y. Sapiens: A Brief History of Humankind. L.: Harvill Secker, 2014.
Harari Y. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. L.: Vintage, 2017.
Haraway D. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York; London: Routledge; Free Association Books, 1991.
Haraway D. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham: Duke University Press, 2016.
Harman G. Tool-Being. Heidegger and the Metaphysics of Objects. Chicago: Open Court, 2002.
Heidegger M. Nietzsche. 2 B. (G/A 6.1, 6.2). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1996-1997.
Heidegger M. Sein und Zeit. Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman, 1977.
Hobsbawm E., Ranger T. L'Invention de la tradition. P.: Éditions Amsterdam, 2006.
Jambet C. L’acte de l’être. P.: Fayard, 2002.
Kristeva J. Le Génie féminin: la vie, la folie, les mots. P.: Fayard, 1999.
Kristeva J. Le révolution du langage poétique. P.: Seuil, 1974.
Kurzweil R. The singularity is near. NY: Viking, 2005.
Land N. Fanged Noumena: Collected Writings 1987-2007. New York; Windsor Quarry (Falmouth): Sequence; Urbanomic, 2011.
Lardreau G., Jambet C. Ontologie de la révolution I. L'Ange : Pour une cynégétique du semblant. P.:Grasset, 1976.
Laruelle F. Principes de la non-philosophie. P.: PUF, 1996.
Lassalle F. Reden und Schriften. Neue Gesamtausgabe. Mit einer biographischen Einleitung. Band 1–3., Berlin: Expedition des Vorwärts Berliner Volksblatt, 1892–1893.
Latour B. Reassembling the social. An introduction to Actor-Network Theory. Oxford: OUP, 2005.
Lévy B.-H. Le Testament de Dieu. P.: Grasset, 1979.
Lory P. La dignité de l'homme face aux anges, aux animaux et aux djinns. P.: Albin Michel, 2018.
Lyotard J.-F. Le Postmoderne expliqué aux enfants : Correspondance 1982-1985. P.: Galilée, 1988.
Mouffe Ch. On the political. London ; New York : Routledge, 2005.
Mounier E. Œuvres, 4 volumes. P.: Seuil, 1961-1962.
Pound E. Guide to Kulchur. L.: Faber & Faber, 1938.
Sollers Ph. L'Écriture et l'Expérience des Limites. P.: Seuil, 1968.
Sorel G. Commitment and Change: Georges Sorel and the idea of revolution. Toronto: University of Toronto Press, 1978.
Taubes J. Abendländische Eschatologie. München: Matthes & Seitz, 1991
Uexküll J. Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten. Berlin: J. Springer, 1934.
Uexküll J. Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Bedeutungslehre. Frankfurt a. M.: S. Fischer, 1970.
Uexküll J. Das allmächtige Leben. Hamburg: Christian Wegner Verlag, 1950.
Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011.
Агамбен Дж. Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. СПб.; М.: Симпозиум, 2000.
Батай Ж. Внутренний Опыт. СПб: Axioma/Мифрил, 1997.
Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006.
Батай Ж. Проклятая часть. М.: Ладомир, 2006; Он же. Сад и обычный человек. Суверенный человек Сада // Маркиз де Сад и XX век. М.: Культура, 1992.
Бейтсон Г. Экология разума: Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.: Смысл, 2000.
Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: Российская политическая энциклопедия, 2006.
Витгенштейн Л. Голубая и Коричневая книги: предварительные материалы к «Философским исследованиям». Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2008.
Генон Р. Кризис современного мира. М.: Арктогея, 1991.
Генон Р. Восток и Запад. М.: Беловодье, 2005.
Генон Р. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М.: Беловодье, 2003.
Генон Р. Человек и его осуществление согласно Веданте. Восточная метафизика. М.:Беловодье, 2004.
Греймас А. Структурная семантика. Поиск метода. М.: Академический проект, 2004.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию. СПб.: Владимир Даль, 2004.
Делёз Ж. Логика смысла. М.: Академический проект, 2010.
Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург.: У-Фактория, 2007..
Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург; Москва: У-Фактория; Астрель, 2010.
Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2007.
Джеймс У. Прагматизм: новое название для некоторых старых методов мышления: Популярные лекции по философии. М.: ЛКИ, 2011.
Дугин А.Г. Воображение. Философия, социология, структуры. М.: Академический проект, 2015.
Дугин А.Г. Интернальные Онтологии. Сакральная физика и опрокинутый мир. Москва; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2022.
Дугин А.Г. Радикальный субъект и его дубль. М.: Евразийское движение, 2009.
Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. М.: Евразия, 2001.
Дюмон Л. Homo aequalis, I. Генезис и расцвет экономической идеологии. М.: Nota Bene, 2000.
Дюмон Л. Эссе об индивидуализме. Дубна: Феникс, 1997.
Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.
Жид А. Собрание сочинений в 7 томах. М.: Терра; Книжный клуб , 2002.
Зомбарт В.. Собрание сочинений в 3 томах. СПб: Владимир Даль, 2005 – 2008.
Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006.
Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Академический Проект, 2008.
Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М.: «Прогресс», «Универс», 1994.
Маркс К., Фридрих Э. Из ранних произведений. М.: Государственное издательство политической литературы, 1956.
Маркузе Г. Одномерный человек. М.: Refl-book, 1994.
Ницше Ф. К генеалогии морали/Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М.: Издательство АСТ, 2008.
Оруэлл Дж. 1984. Скотный Двор. М.: АСТ, 2014.
Парето В. Компендиум по общей социологии. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008.
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Издательство ЛГУ, 1986.
Сартр Ж. П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2000.
Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика: Исследования изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. М.: Астрель, 2006.
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.· Политиздат, 1992.
Таубес Я. Ad Carl Scmitt. Сопряжение противостремительного. СПб.: «Владимир Даль», 2021
Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. М.; СПб.: Фонд Университет; Владимир Даль, 2002.
Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ; Хранитель, 2007.
Фуко М. Археология знания. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб: А-cad, 1994.
Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб. : Университетская книга, 1997.
Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 2004
Чоран Э. После конца истории. СПб: Симпозиум, 2002.
Шмитт К. Политическая теология. М. : Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 2000.
Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории: В 2 т. М.: Мысль, 1998.
Эвола Ю. Восстание против современного мира. М.: Прометей, 2016.
Эвола Ю. Оседлать тигра. М.: Владимир Даль, 2005.
Элиот Т.С. Избранная поэзия. СПб.: Северо-Запад, 1994.
Юнг К.Г. Психология бессознательного. М.: Когито-Центр, 2010.
Юнгер Ф. Г. Совершенство техники. Машина и собственность. СПб: Издательство «Владимир Даль», 2002.
Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; О боли. СПб.: Наука, 2000.
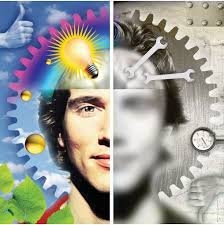




















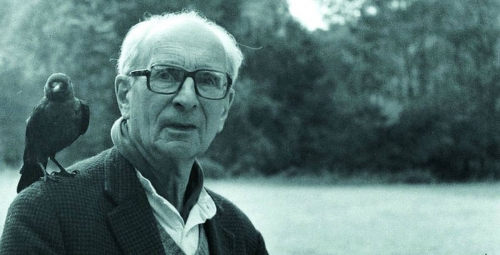

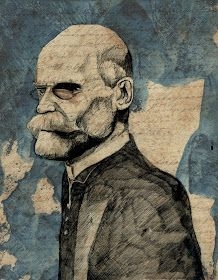






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg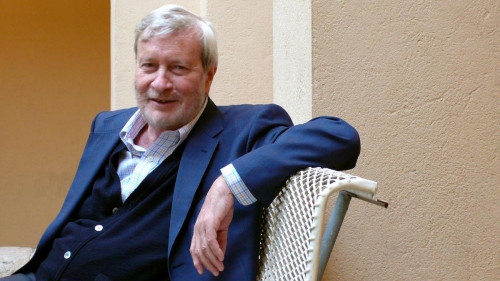

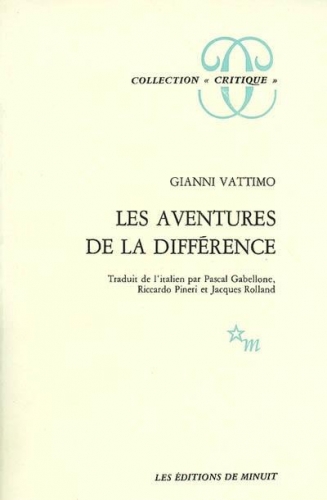


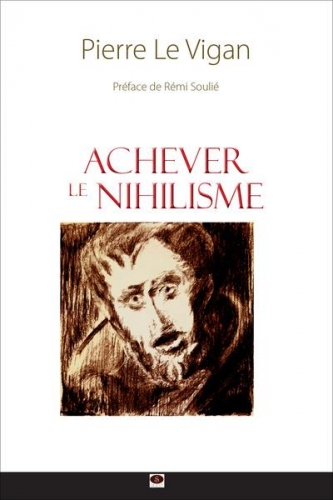 Les attitudes sociales à adopter faisaient l’objet d’un consensus normatif durant la modernité. Cette dernière (le XXe siècle jusqu’aux années 60) n’avait pas mis par terre les valeurs traditionnelles de respect de la famille, de la patrie, des Anciens. Mais elle avait mis ces valeurs au service d’un culte du travail, de la technique, du progrès. Ce culte a fini par se retourner contre ces valeurs qui, traditionnelles, avaient perdurées dans la modernité. Notre société, dominé par le Capital devenu un mode de production mondialisé, a besoin maintenant, avec l’hypermodernité, d’un culte plus ludique de l’activité, ou de « l’innovation », que le culte classique du travail, d’un culte de la consommation et de la « nouveauté » permanente, d’une individualisation croissante qui casse les formes traditionnelles de rapport au travail et le sérieux dans l’exercice des métiers.
Les attitudes sociales à adopter faisaient l’objet d’un consensus normatif durant la modernité. Cette dernière (le XXe siècle jusqu’aux années 60) n’avait pas mis par terre les valeurs traditionnelles de respect de la famille, de la patrie, des Anciens. Mais elle avait mis ces valeurs au service d’un culte du travail, de la technique, du progrès. Ce culte a fini par se retourner contre ces valeurs qui, traditionnelles, avaient perdurées dans la modernité. Notre société, dominé par le Capital devenu un mode de production mondialisé, a besoin maintenant, avec l’hypermodernité, d’un culte plus ludique de l’activité, ou de « l’innovation », que le culte classique du travail, d’un culte de la consommation et de la « nouveauté » permanente, d’une individualisation croissante qui casse les formes traditionnelles de rapport au travail et le sérieux dans l’exercice des métiers. 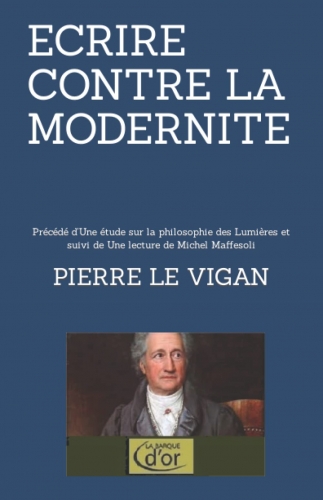 Or, si chaque homme doit se construire, toute société doit lui donner un outillage mental et moral de valeurs, et de perspectives à partir duquel il se construit. C’est ce que nos sociétés occidentales ont oublié, en tombant dans l’idéologie de la désaffiliation, et en refusant toute notion d’héritage culturel et même biologique, puisque quelqu’un né garçon pourrait « choisir » d’être fille – et réciproquement. L’idéologie du « c’est mon choix » fait de chacun l’esclave de ses engouements passagers, tandis que la notion d’engagement, qui est toujours avant tout vis-à-vis de soi-même, s’efface. Or, c’est lui qui donne contenu et sens à la vie. C’est la promesse que l’on se fait à soi-même qui est la plus importante.
Or, si chaque homme doit se construire, toute société doit lui donner un outillage mental et moral de valeurs, et de perspectives à partir duquel il se construit. C’est ce que nos sociétés occidentales ont oublié, en tombant dans l’idéologie de la désaffiliation, et en refusant toute notion d’héritage culturel et même biologique, puisque quelqu’un né garçon pourrait « choisir » d’être fille – et réciproquement. L’idéologie du « c’est mon choix » fait de chacun l’esclave de ses engouements passagers, tandis que la notion d’engagement, qui est toujours avant tout vis-à-vis de soi-même, s’efface. Or, c’est lui qui donne contenu et sens à la vie. C’est la promesse que l’on se fait à soi-même qui est la plus importante.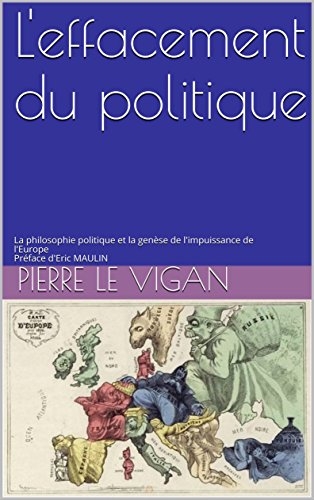






















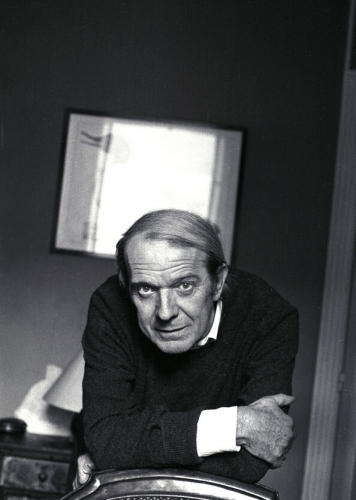
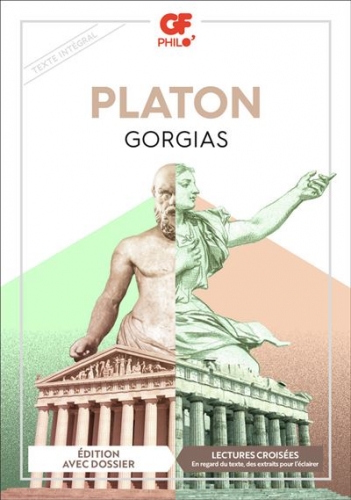

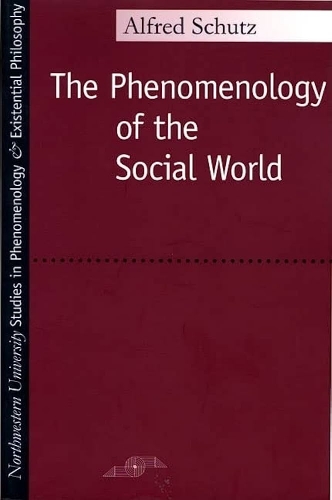




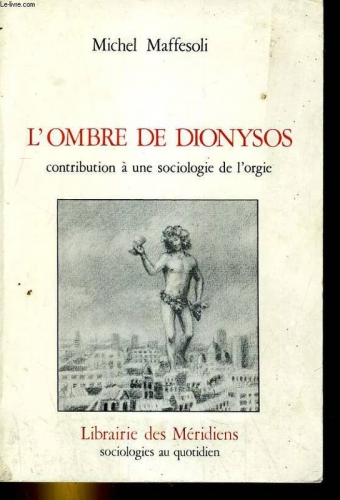
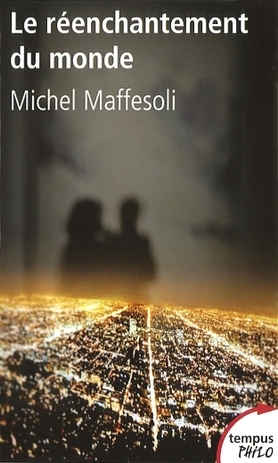

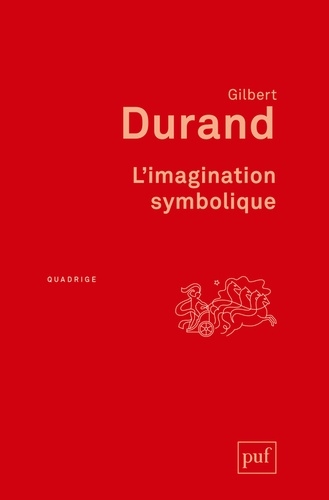

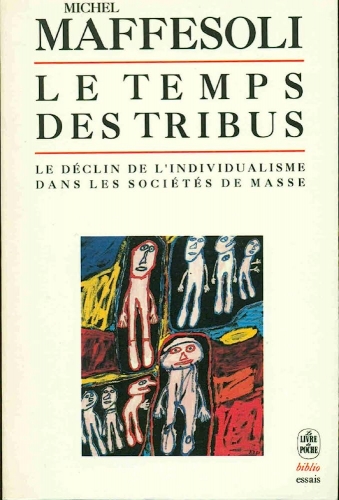





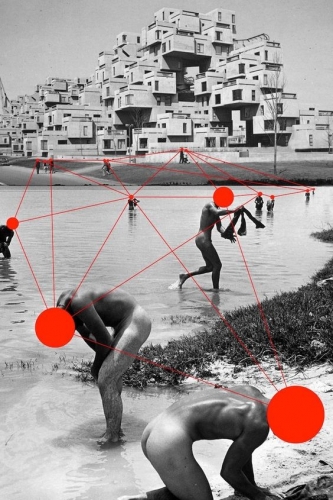

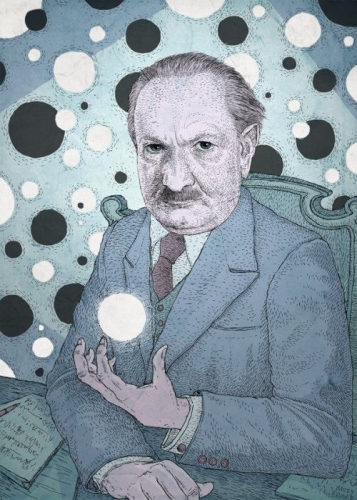



 Quelque quarante ans après l'essai de Lyotard, on peut se demander s'il est encore possible de qualifier notre condition de "postmoderne". Plus que jamais, marqués que nous sommes par des urgences économiques, pandémiques, guerrières et diplomatiques dont le résultat, pour une fois, ne peut être que d'exaspérer des processus déjà en cours, dans les difficultés, les embarras et les hypocrisies d'une classe politique culturellement désarmée... coupable d'avoir sous-estimé de manière flagrante la relation entre la démocratie et la diffusion de la connaissance, aux prises ces dernières années avec une "société civile" qui s'est souvent révélée peu civilisée, incapable de réguler les géants du numérique au point de se retrouver dans la fâcheuse situation de la fameuse grenouille bouillie à petits feux doux.
Quelque quarante ans après l'essai de Lyotard, on peut se demander s'il est encore possible de qualifier notre condition de "postmoderne". Plus que jamais, marqués que nous sommes par des urgences économiques, pandémiques, guerrières et diplomatiques dont le résultat, pour une fois, ne peut être que d'exaspérer des processus déjà en cours, dans les difficultés, les embarras et les hypocrisies d'une classe politique culturellement désarmée... coupable d'avoir sous-estimé de manière flagrante la relation entre la démocratie et la diffusion de la connaissance, aux prises ces dernières années avec une "société civile" qui s'est souvent révélée peu civilisée, incapable de réguler les géants du numérique au point de se retrouver dans la fâcheuse situation de la fameuse grenouille bouillie à petits feux doux.


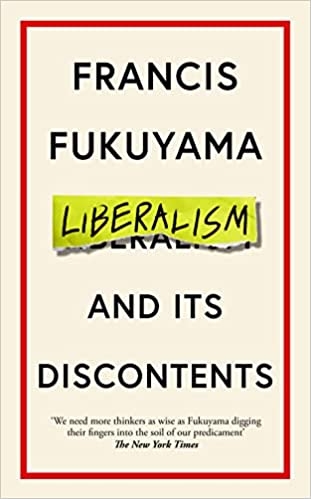 Une politique qui tente de répondre à la question suivante : quelles sont les perspectives de la démocratie dans une société qui, sous les coups d'une concentration progressive des richesses, a perdu l'idée originelle de communauté ? Une politique qui sait aller au-delà de la très générique "confiance dans les institutions démocratiques" encore prônée dans son dernier livre (Liberalism and its Discontents) par un Fukuyama qui a toujours démontré que sa conception du libéralisme est non seulement idéaliste, mais aussi profondément déformée, s'il est vrai qu'il a attribué le succès du Japon à son libéralisme économique sans comprendre que le modèle japonais était en fait le modèle étatiste de Hamilton, fondateur, au début du 19ème siècle, du système bancaire américain. La politique ne peut être réduite à devenir un spectacle digne d'Oprah Winfrey, pour qui "tout est question d'imagination". Sans une véritable culture de la politique, la démocratie sera toujours une créature à la vie trouble. Pour la récupérer, il ne suffit certainement pas, comme le font Fukuyama, Cassese et consorts, de diaboliser tous les Orbans, Le Pen et Bolsonaros du monde...
Une politique qui tente de répondre à la question suivante : quelles sont les perspectives de la démocratie dans une société qui, sous les coups d'une concentration progressive des richesses, a perdu l'idée originelle de communauté ? Une politique qui sait aller au-delà de la très générique "confiance dans les institutions démocratiques" encore prônée dans son dernier livre (Liberalism and its Discontents) par un Fukuyama qui a toujours démontré que sa conception du libéralisme est non seulement idéaliste, mais aussi profondément déformée, s'il est vrai qu'il a attribué le succès du Japon à son libéralisme économique sans comprendre que le modèle japonais était en fait le modèle étatiste de Hamilton, fondateur, au début du 19ème siècle, du système bancaire américain. La politique ne peut être réduite à devenir un spectacle digne d'Oprah Winfrey, pour qui "tout est question d'imagination". Sans une véritable culture de la politique, la démocratie sera toujours une créature à la vie trouble. Pour la récupérer, il ne suffit certainement pas, comme le font Fukuyama, Cassese et consorts, de diaboliser tous les Orbans, Le Pen et Bolsonaros du monde...

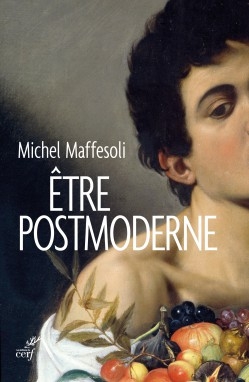 L’hypothèse postmoderne est que ce qui fait société est désormais le présentéisme, et le groupe, ou encore les tribus. C’est la reliance plus que l’appartenance, l’identification plus que l’identité, l’esthétique plutôt que la morale. L’éthique qui découle désormais de l’esthétique. Mais encore, le postmoderne, c’est l’émotion plus que la raison, ou, si on préfère, la raison sensible plus que la raison calculante. C’est l’empathie plus que le contrat écrit. C’est « ce qui est » plutôt que le « devoir-être » kantien. C’est le refus de la croyance au progrès : « Le point nodal de l’idéologie progressiste, dit Maffesoli, c’est l’ambition, voire la prétention, de tout résoudre, de tout améliorer afin d’aboutir à une société parfaite et à un homme potentiellement immortel. » (L’ère des soulèvements). Il s’agit de se libérer de cette prétention. D’autant que le progressisme est indissociable de l’utilitarisme (d’où les liens avec l’américanisation du monde) et qu’il ne tient aucun compte du besoin de symboles, de signes, d’emblèmes, qui font sens plus que le quantifiable. Une société a besoin d’intercesseurs, de totems, de saints, d’échelles qui vont du profane au sacré. Et non d’une coupure franche entre ces deux sphères. Postmodernité : « synergie de l’archaïsme et du développement technologique », dit encore Maffesoli (L’instant éternel, 2000). Cette nouvelle épistémé, comme disait Michel Foucault, ne laisse rien debout de la modernité : « Dégénérescence de quoi, sinon du mythe progressiste ? Corrélativement à l’idéologie du service public, ce progressisme s’emploie à justifier la domination sur la nature, à négliger les lois primordiales de celle-ci, et à construire un monde selon les seuls principes d’un rationalisme dont l’aspect morbide apparaît de plus en plus évident », écrit Maffesoli (L’ère des soulèvements). A partir de là, Maffesoli pône une écosophie, une philosophhie de l’écologie, comme l’avait initié Félix Guattari (Les Trois écologies, 1989 et Qu’est-ce que l’écosophie ? 1985-92, 2013). J’ai évoqué cette naissance d’une écologie philosophique dans Inventaire de la modernité avant liquidation (2007, préface d’Alain de Benoist).
L’hypothèse postmoderne est que ce qui fait société est désormais le présentéisme, et le groupe, ou encore les tribus. C’est la reliance plus que l’appartenance, l’identification plus que l’identité, l’esthétique plutôt que la morale. L’éthique qui découle désormais de l’esthétique. Mais encore, le postmoderne, c’est l’émotion plus que la raison, ou, si on préfère, la raison sensible plus que la raison calculante. C’est l’empathie plus que le contrat écrit. C’est « ce qui est » plutôt que le « devoir-être » kantien. C’est le refus de la croyance au progrès : « Le point nodal de l’idéologie progressiste, dit Maffesoli, c’est l’ambition, voire la prétention, de tout résoudre, de tout améliorer afin d’aboutir à une société parfaite et à un homme potentiellement immortel. » (L’ère des soulèvements). Il s’agit de se libérer de cette prétention. D’autant que le progressisme est indissociable de l’utilitarisme (d’où les liens avec l’américanisation du monde) et qu’il ne tient aucun compte du besoin de symboles, de signes, d’emblèmes, qui font sens plus que le quantifiable. Une société a besoin d’intercesseurs, de totems, de saints, d’échelles qui vont du profane au sacré. Et non d’une coupure franche entre ces deux sphères. Postmodernité : « synergie de l’archaïsme et du développement technologique », dit encore Maffesoli (L’instant éternel, 2000). Cette nouvelle épistémé, comme disait Michel Foucault, ne laisse rien debout de la modernité : « Dégénérescence de quoi, sinon du mythe progressiste ? Corrélativement à l’idéologie du service public, ce progressisme s’emploie à justifier la domination sur la nature, à négliger les lois primordiales de celle-ci, et à construire un monde selon les seuls principes d’un rationalisme dont l’aspect morbide apparaît de plus en plus évident », écrit Maffesoli (L’ère des soulèvements). A partir de là, Maffesoli pône une écosophie, une philosophhie de l’écologie, comme l’avait initié Félix Guattari (Les Trois écologies, 1989 et Qu’est-ce que l’écosophie ? 1985-92, 2013). J’ai évoqué cette naissance d’une écologie philosophique dans Inventaire de la modernité avant liquidation (2007, préface d’Alain de Benoist).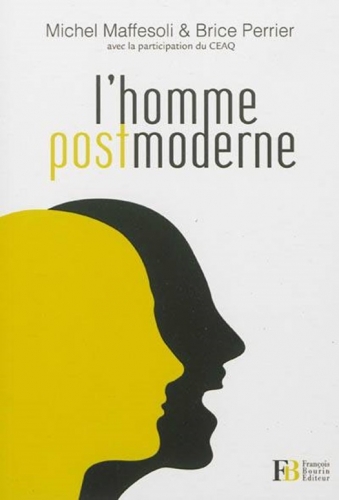 Contradictoriel, ce ne veut pas dire seulement la juxtaposition des contraires, cela veut dire leur coincidence. C’est la coincidentia oppositorum de Nicolas de Cuse (De la docte ignorance). C’est pourquoi la raison efficace est forcément une raison sensible. Autrement, elle tourne à vide. Il ne s’agit pas détruire la raison (La destruction de la raison de Georg Lukacs, 1954), il s’agit de la remettre sur un sol. « Rien de grand ne s’est fait sans passion », disait Hegel (La raison dans l’histoire). Saint-Exupéry disait pour sa part : « On ne voit bien qu’avec le cœur. » L’idée est la même. S’appuyant sur cette hypothèse de la place du passionnel, du sensible, du ressenti, Michel Maffesoli va plus loin : il en fait la source de la morale telle qu’elle se réinvente. Le bien devient l’agréable, selon l’hédonisme de George Edward Moore. Une éthique se forge ainsi au-delà des identités. L’éthique est compatible avec le passage des frontières : nationales (je suis d’ici et aussi d’ailleurs), sexuelles (la bisexualité, les expériences « de l’autre côté de sa sexualité habituelle »), professionnelles (l’architecte en train de devenir boulanger, le banquier devenu gestionnaire de parc naturel, …). Ainsi, les identités sont moins importantes – et c’est notamment en cela que consiste le tournant postmoderne – que les identifications. Or, celles-ci sont éventuellement successives et multiples. Et surtout, elles sont un bricolage mental personnel. De ces expériences multiples nait ce que Michel Foucault appelait, peu de temps avant sa mort annoncée, une « esthétique de l’existence », fondé sur un usage raisonné des plaisirs, mais raisonné par la raison sensible. De cette esthétique nait une éthique. « Une morale sans obligation ni sanction », dit Maffesoli.
Contradictoriel, ce ne veut pas dire seulement la juxtaposition des contraires, cela veut dire leur coincidence. C’est la coincidentia oppositorum de Nicolas de Cuse (De la docte ignorance). C’est pourquoi la raison efficace est forcément une raison sensible. Autrement, elle tourne à vide. Il ne s’agit pas détruire la raison (La destruction de la raison de Georg Lukacs, 1954), il s’agit de la remettre sur un sol. « Rien de grand ne s’est fait sans passion », disait Hegel (La raison dans l’histoire). Saint-Exupéry disait pour sa part : « On ne voit bien qu’avec le cœur. » L’idée est la même. S’appuyant sur cette hypothèse de la place du passionnel, du sensible, du ressenti, Michel Maffesoli va plus loin : il en fait la source de la morale telle qu’elle se réinvente. Le bien devient l’agréable, selon l’hédonisme de George Edward Moore. Une éthique se forge ainsi au-delà des identités. L’éthique est compatible avec le passage des frontières : nationales (je suis d’ici et aussi d’ailleurs), sexuelles (la bisexualité, les expériences « de l’autre côté de sa sexualité habituelle »), professionnelles (l’architecte en train de devenir boulanger, le banquier devenu gestionnaire de parc naturel, …). Ainsi, les identités sont moins importantes – et c’est notamment en cela que consiste le tournant postmoderne – que les identifications. Or, celles-ci sont éventuellement successives et multiples. Et surtout, elles sont un bricolage mental personnel. De ces expériences multiples nait ce que Michel Foucault appelait, peu de temps avant sa mort annoncée, une « esthétique de l’existence », fondé sur un usage raisonné des plaisirs, mais raisonné par la raison sensible. De cette esthétique nait une éthique. « Une morale sans obligation ni sanction », dit Maffesoli. 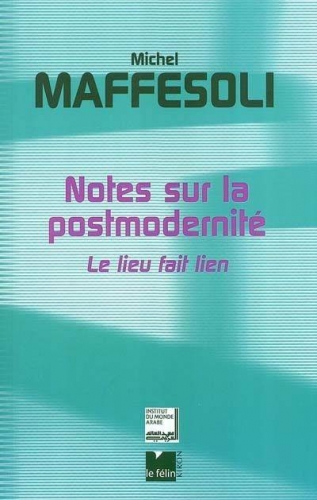 L’habitus, notion que l’on trouve chez Thomas d’Aquin (et dont Pierre Bourdieu a fait un grand usage), et qui est l’hexis d’Aristote, c’est cela : l’éducation à la communication verbale et non verbale, l’acclimatation à un « ensemble de dispositions durables pour l’action et le langage », disait à peu de choses près Pierre Bourdieu. C’est une « connaissance du sang », dit David Herbert Lawrence (comme on pourrait le dire des gens qui se comprennent sans avoir besoin de se parler), qui complète la connaissance rationnelle, et bien souvent la précède. L’école sociologique du quotidien consiste à être attentif à cela, au plaisir et à la sagesse de l’apparence, et cette école est autant celle de Nietzsche que l’école de Chicago avec Erving Goffman, Isaac Joseph, Roger Bastide et ce qu’on a appelé la microsociologie, celle qui concerne « l’aventure de la grisaille » (Roger Caillois). Cette école étudie une grisaille qui peut être sublimée. « Etre ici est splendide » (7e Elégie de Duino, R-M Rilke). La vie s’approuve jusque dans les petites choses. La sociologie dans laquelle s’inscrit Maffesoli rehausse l’intérêt de l’étude du quotidien, le theatrum mundi, étude éclairée par les références que fait Georg Simmel au pont et à la porte : la porte protège l’intériorité, le pont ouvre sur l’extérieur. Cette sociologie du quotidien est une sociologie de l’instant présent, du moment vécu, dans laquelle les grands récits et les arrières-mondes perdent de leur importance, voire même cessent d’exister. Il s’agit de réhabiliter l’instant. Les émotions artistiques ne sont plus surplombantes, elles ne concernent plus l’individu, mais une socialité partagée. L’aura, dit Maffesoli, « enveloppe désormais le quotidien ». C’est une ambiance (Stimmung), dégagée par un lieu ou par un événement qui nous enveloppe, et nous fait plus humain parce que nous sommes plus avec les autres.
L’habitus, notion que l’on trouve chez Thomas d’Aquin (et dont Pierre Bourdieu a fait un grand usage), et qui est l’hexis d’Aristote, c’est cela : l’éducation à la communication verbale et non verbale, l’acclimatation à un « ensemble de dispositions durables pour l’action et le langage », disait à peu de choses près Pierre Bourdieu. C’est une « connaissance du sang », dit David Herbert Lawrence (comme on pourrait le dire des gens qui se comprennent sans avoir besoin de se parler), qui complète la connaissance rationnelle, et bien souvent la précède. L’école sociologique du quotidien consiste à être attentif à cela, au plaisir et à la sagesse de l’apparence, et cette école est autant celle de Nietzsche que l’école de Chicago avec Erving Goffman, Isaac Joseph, Roger Bastide et ce qu’on a appelé la microsociologie, celle qui concerne « l’aventure de la grisaille » (Roger Caillois). Cette école étudie une grisaille qui peut être sublimée. « Etre ici est splendide » (7e Elégie de Duino, R-M Rilke). La vie s’approuve jusque dans les petites choses. La sociologie dans laquelle s’inscrit Maffesoli rehausse l’intérêt de l’étude du quotidien, le theatrum mundi, étude éclairée par les références que fait Georg Simmel au pont et à la porte : la porte protège l’intériorité, le pont ouvre sur l’extérieur. Cette sociologie du quotidien est une sociologie de l’instant présent, du moment vécu, dans laquelle les grands récits et les arrières-mondes perdent de leur importance, voire même cessent d’exister. Il s’agit de réhabiliter l’instant. Les émotions artistiques ne sont plus surplombantes, elles ne concernent plus l’individu, mais une socialité partagée. L’aura, dit Maffesoli, « enveloppe désormais le quotidien ». C’est une ambiance (Stimmung), dégagée par un lieu ou par un événement qui nous enveloppe, et nous fait plus humain parce que nous sommes plus avec les autres.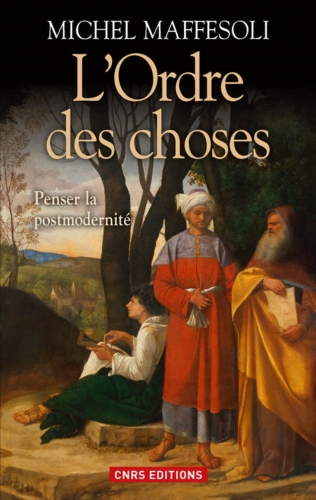
 Le pouvoir de plus en plus éloigné et abstrait ne fait plus rêver. La vie est ailleurs. Le peuple – et pas seulement les errants – fait sécession. Enfin, face à la modernité comme panopticon, visibilité de nos vies par les institutions, des stratégies d’évitement se mettent en place. L’esprit des chemineaux, éteint depuis quelque 150 ans (voir Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin, 1976), revient, sous une formé évidemment différente. Il s’agit, par la flanerie, d’éviter l’assujetissement au monde de la production. D’autant que cheminer, c’est toujours être en quête de quelque chose, ou fuir quelque chose, ce qui n’est pas très différent, comme on le voit dans le chef d’œuvre de Wim Wenders, Paris, Texas (1984). C’est une forme de rebellion passive, au moment où plus grand monde ne croit que les révolutions soient possibles et même souhaitables. L’errance spatiale va avec les rencontres rapides, avec la « dérive des sentiments » (Yves Simon) et, là aussi, le cinéma nous en donne une belle illustration avec Easy rider de Dennis Hopper (1969), avec Taxi Driver de Martin Scorsese (1976), qui montre l’épuisement de la modernité qui enferme chacun dans sa solitude. Ces errances construisent un monde bien plus qu’elles ne fuient le monde. Elles peuvent être un enracinement dynamique, comme l’a étudié Elisée Reclus qui, ce n’est pas un hasard, était socialiste libertaire, tout comme son frêre Onésime Reclus.
Le pouvoir de plus en plus éloigné et abstrait ne fait plus rêver. La vie est ailleurs. Le peuple – et pas seulement les errants – fait sécession. Enfin, face à la modernité comme panopticon, visibilité de nos vies par les institutions, des stratégies d’évitement se mettent en place. L’esprit des chemineaux, éteint depuis quelque 150 ans (voir Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin, 1976), revient, sous une formé évidemment différente. Il s’agit, par la flanerie, d’éviter l’assujetissement au monde de la production. D’autant que cheminer, c’est toujours être en quête de quelque chose, ou fuir quelque chose, ce qui n’est pas très différent, comme on le voit dans le chef d’œuvre de Wim Wenders, Paris, Texas (1984). C’est une forme de rebellion passive, au moment où plus grand monde ne croit que les révolutions soient possibles et même souhaitables. L’errance spatiale va avec les rencontres rapides, avec la « dérive des sentiments » (Yves Simon) et, là aussi, le cinéma nous en donne une belle illustration avec Easy rider de Dennis Hopper (1969), avec Taxi Driver de Martin Scorsese (1976), qui montre l’épuisement de la modernité qui enferme chacun dans sa solitude. Ces errances construisent un monde bien plus qu’elles ne fuient le monde. Elles peuvent être un enracinement dynamique, comme l’a étudié Elisée Reclus qui, ce n’est pas un hasard, était socialiste libertaire, tout comme son frêre Onésime Reclus. 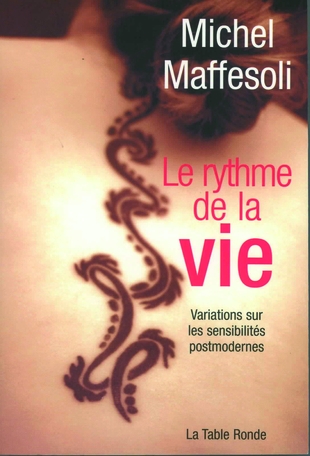 Mais l’abandon des idéaux de la modernité est-il si total dans le peuple lui-même ? Le soutien non négligeable de toute une partie de la population à une politique vaccinale délirante s’agissant d’une maladie covidienne à très faible taux de létalité laisse perplexe. D’autre part, je ne suis sans doute pas le seul à avoir entendu nombre de gens (hors des élites) dire que « nous ne sommes plus au Moyen Age », à propos de telle ou telle évolution sociétale contestable, et être par ailleurs complétement aveugle à la tyrannie croissante de notre pouvoir politique, à son caractère de plus en plus policier, arbitraire et antidémocratique. Or, que sont ces propos aveugles à la tyrannie, et s’enthousiasmant niaisement parce que « nous ne sommes plus au Moyen Age », si ce n’est des formes renouvelées de l’increvable croyance au Progrès ? Je ne demande qu’à croire que la religion du progrès est morte, et à fêter sa disparition, mais est-ce si sûr ? De même, s’il est incontestable que les grands récits politiques sont en voie d’épuisement, ne faut-il pas nuancer ? A droite, un grand récit simpliste de l’identité – nous avons toujours été Européens et seule l’Europe a nourri l’Europe – prend le pas sur les théories plus profondes et plus subtiles (comme celles d’Alain de Benoist, Nous et les autres, Krisis, 2007). A gauche, les théories transgenres et les délires de l’intersectionnalité (quel recul par rapport à Marx, mais aussi par rapport à Michel Foucault !) ne sont-elles pas un nouveau grand récit, une « identité de l’anti-identité », le grand récit d’un « homme sans qualités » (Robert Musil) et d’un « homme sans gravité » (Charles Melman), sans déterminations, refusant tous les héritages, toutes les transmissions, dans un monde de la table rase ?
Mais l’abandon des idéaux de la modernité est-il si total dans le peuple lui-même ? Le soutien non négligeable de toute une partie de la population à une politique vaccinale délirante s’agissant d’une maladie covidienne à très faible taux de létalité laisse perplexe. D’autre part, je ne suis sans doute pas le seul à avoir entendu nombre de gens (hors des élites) dire que « nous ne sommes plus au Moyen Age », à propos de telle ou telle évolution sociétale contestable, et être par ailleurs complétement aveugle à la tyrannie croissante de notre pouvoir politique, à son caractère de plus en plus policier, arbitraire et antidémocratique. Or, que sont ces propos aveugles à la tyrannie, et s’enthousiasmant niaisement parce que « nous ne sommes plus au Moyen Age », si ce n’est des formes renouvelées de l’increvable croyance au Progrès ? Je ne demande qu’à croire que la religion du progrès est morte, et à fêter sa disparition, mais est-ce si sûr ? De même, s’il est incontestable que les grands récits politiques sont en voie d’épuisement, ne faut-il pas nuancer ? A droite, un grand récit simpliste de l’identité – nous avons toujours été Européens et seule l’Europe a nourri l’Europe – prend le pas sur les théories plus profondes et plus subtiles (comme celles d’Alain de Benoist, Nous et les autres, Krisis, 2007). A gauche, les théories transgenres et les délires de l’intersectionnalité (quel recul par rapport à Marx, mais aussi par rapport à Michel Foucault !) ne sont-elles pas un nouveau grand récit, une « identité de l’anti-identité », le grand récit d’un « homme sans qualités » (Robert Musil) et d’un « homme sans gravité » (Charles Melman), sans déterminations, refusant tous les héritages, toutes les transmissions, dans un monde de la table rase ? 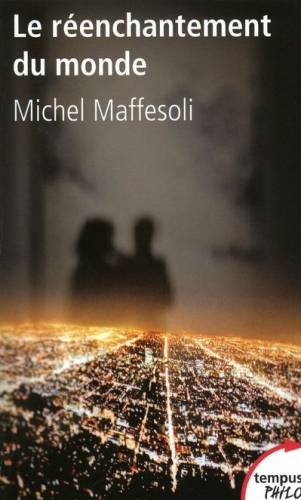 Le présentéisme pose également bien des questions. Il est bon que l’homme ne soit jamais réduit à ce qu’il est comme acteur historique. Mais l’homme est aussi un animal politique et donc historique. Ce qui est public, et ce qui est politique ne doit pas se résumer à ce qui est étatique, mais l’Etat doit être le point de concentration des conflits qui se soldent inévitablement par une décision. Celle-ci doit appartenir au peuple, et celui-ci est forcément le dépassement des tribus. « L’économie, c’est fini », dit souvent Maffesoli. « Nous allons vers le retour du spirituel » (Cnews. Face à l’info, 9 mars 2020). Depuis longtemps, Maffesoli explique que la crise est sociétale plus qu’économique. Il faut comprendre cela comme une divergence entre le sociétal et l’économique. Oui. Mais cela n’implique pas un allègement de la domination de l’économie sur nos vies, mais une tentative du pouvoir, au contraire, d’adapter l’homme à l’économie. C’est en ce sens que l’économisme devient totalitaire. La question de la production et de la répartition des richesses reste centrale dans toutes les sociétés. Elle détermine qui domine dans telle nation et qui domine dans le monde. En fait, quand on dit que nos sociétés sont dominées par l’économie, cela veut dire qu’elles sont dominées par le culte de la croissance et la religion du libre échange mondial. L’économie pourrait être au service d’objectifs d’indépendance économique, et d’autarcie, de solidarité nationale, et cela aurait une toute autre signification. Si sortir de l’économisme, c’est sortir du règne du quantitatif, c’est une bonne chose, mais si c’est sortir de la lucidité quant à l’importance de l’économie pour l’indépendance et la liberté d’une nation et d’un peuple, c’est une catastrophe. Maitriser l’économie pour ne pas être le jouet de fonds de pension, de multinationales ou de puissances étrangères, c’est un impératif. Il est bon de se donner comme objectif de ne pas « perdre sa vie à la gagner », mais l’Etat doit aussi avoir une visée collective, qui est la force et la souveraineté économique de notre nation. Sortir de l’économisme, c’est ne laisser le pouvoir ni aux « experts », ni aux hommes d’argent, c’est reprendre le pouvoir sur l’économie. Le temps libre doit devenir un temps non seulement libéré de la production, mais aussi de la consommation. Le temps libéré ne doit pas être principalement le temps des loisirs marchands, mais celui qui permet de vivre « la présence désintéressée à l’être dans la vibration de l’instant », dit André Gorz dans une belle formule (cité par Catherine Marin, Reporterre, 15 juin 2021). Faire sécession de l’économie, par exemple se contenter d’un revenu universel pour tous, n’est-ce pas laisser le pouvoir aux puissances du Capital ?
Le présentéisme pose également bien des questions. Il est bon que l’homme ne soit jamais réduit à ce qu’il est comme acteur historique. Mais l’homme est aussi un animal politique et donc historique. Ce qui est public, et ce qui est politique ne doit pas se résumer à ce qui est étatique, mais l’Etat doit être le point de concentration des conflits qui se soldent inévitablement par une décision. Celle-ci doit appartenir au peuple, et celui-ci est forcément le dépassement des tribus. « L’économie, c’est fini », dit souvent Maffesoli. « Nous allons vers le retour du spirituel » (Cnews. Face à l’info, 9 mars 2020). Depuis longtemps, Maffesoli explique que la crise est sociétale plus qu’économique. Il faut comprendre cela comme une divergence entre le sociétal et l’économique. Oui. Mais cela n’implique pas un allègement de la domination de l’économie sur nos vies, mais une tentative du pouvoir, au contraire, d’adapter l’homme à l’économie. C’est en ce sens que l’économisme devient totalitaire. La question de la production et de la répartition des richesses reste centrale dans toutes les sociétés. Elle détermine qui domine dans telle nation et qui domine dans le monde. En fait, quand on dit que nos sociétés sont dominées par l’économie, cela veut dire qu’elles sont dominées par le culte de la croissance et la religion du libre échange mondial. L’économie pourrait être au service d’objectifs d’indépendance économique, et d’autarcie, de solidarité nationale, et cela aurait une toute autre signification. Si sortir de l’économisme, c’est sortir du règne du quantitatif, c’est une bonne chose, mais si c’est sortir de la lucidité quant à l’importance de l’économie pour l’indépendance et la liberté d’une nation et d’un peuple, c’est une catastrophe. Maitriser l’économie pour ne pas être le jouet de fonds de pension, de multinationales ou de puissances étrangères, c’est un impératif. Il est bon de se donner comme objectif de ne pas « perdre sa vie à la gagner », mais l’Etat doit aussi avoir une visée collective, qui est la force et la souveraineté économique de notre nation. Sortir de l’économisme, c’est ne laisser le pouvoir ni aux « experts », ni aux hommes d’argent, c’est reprendre le pouvoir sur l’économie. Le temps libre doit devenir un temps non seulement libéré de la production, mais aussi de la consommation. Le temps libéré ne doit pas être principalement le temps des loisirs marchands, mais celui qui permet de vivre « la présence désintéressée à l’être dans la vibration de l’instant », dit André Gorz dans une belle formule (cité par Catherine Marin, Reporterre, 15 juin 2021). Faire sécession de l’économie, par exemple se contenter d’un revenu universel pour tous, n’est-ce pas laisser le pouvoir aux puissances du Capital ? 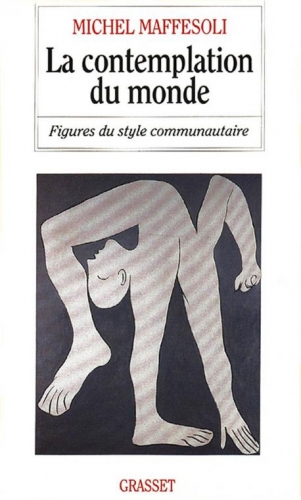 En d’autres termes, l’homogénéisation moderne a débouché sur une « archipellisation » (Jérôme Fourquet) postmoderne de la société française. Trop d’uniformité a amené plus de communautés repliées sur elles-mêmes (l’islam importé devenant trop souvent une religion sans culture car hors sol), plus d’américanisation – le seul « commun » qui se soit développé – et moins de nation. Déconstruite par le bas (baronnies locales et immigration), la France a été en même temps déconstruite par le haut, puisque l’Union européenne a favorisé les régions plutôt que les nations, plus facilement instrumentalisables par la technocratie. Le commun a disparu. Et le commun ce ne sont pas seulement les services publics (qui sont un élement du commun), c’est le sentiment d’être un peuple. La technocratie a creusé un abime entre la vie de l’Etat et la vie des gens. La technocratie ne sait que produire une « rationalisation de l’existence » (Max Weber), qui va au rebours de la vie et l’appauvrit. La technocratie ne connait que ce que Walter Benjamin appelait « le temps homogène et vide des institutions ». L’administration des choses remplace tout rapport vivant entre le politique et le peuple. C’est en ce sens que la révolte des Gilets jaunes, une jacquerie comme nous n’en avions pas connu depuis longtemps, anesthésié que nous étions par le confort moderne, une révolte aussi de la fierté des classes populaires a été à la fois une révolte de classe et une révolte identitaire (non pas au sens où il n’y aurait pas eu d’immigrés de couleur dans les Gilets jaunes, mais au sens où il n’y a eu que des immigrès intégrés, partie prenante du monde du travail, au côté des travailleurs français). Avec l’aspiration à l’intervention directe dans la politique, avec la revendication du référendum d’initiative populaire, la révolte des Gilets jaunes a réconcilié Marx et Rousseau. Marx parce qu’elle relève d’une analyse de classe : la solution aux problèmes des Gilets jaunes est bel et bien la destruction du système capitaliste de propriété privée des grands moyens de production et d’échange. Rousseau parce qu’elle montre un besoin d’être citoyen, un besoin de démocratie directe, un refus du cosmopolitisme qui n’est qu’un autre nom du déracinement, qui est la marotte des élites, mais est un instrument de liquidation du peuple de France.
En d’autres termes, l’homogénéisation moderne a débouché sur une « archipellisation » (Jérôme Fourquet) postmoderne de la société française. Trop d’uniformité a amené plus de communautés repliées sur elles-mêmes (l’islam importé devenant trop souvent une religion sans culture car hors sol), plus d’américanisation – le seul « commun » qui se soit développé – et moins de nation. Déconstruite par le bas (baronnies locales et immigration), la France a été en même temps déconstruite par le haut, puisque l’Union européenne a favorisé les régions plutôt que les nations, plus facilement instrumentalisables par la technocratie. Le commun a disparu. Et le commun ce ne sont pas seulement les services publics (qui sont un élement du commun), c’est le sentiment d’être un peuple. La technocratie a creusé un abime entre la vie de l’Etat et la vie des gens. La technocratie ne sait que produire une « rationalisation de l’existence » (Max Weber), qui va au rebours de la vie et l’appauvrit. La technocratie ne connait que ce que Walter Benjamin appelait « le temps homogène et vide des institutions ». L’administration des choses remplace tout rapport vivant entre le politique et le peuple. C’est en ce sens que la révolte des Gilets jaunes, une jacquerie comme nous n’en avions pas connu depuis longtemps, anesthésié que nous étions par le confort moderne, une révolte aussi de la fierté des classes populaires a été à la fois une révolte de classe et une révolte identitaire (non pas au sens où il n’y aurait pas eu d’immigrés de couleur dans les Gilets jaunes, mais au sens où il n’y a eu que des immigrès intégrés, partie prenante du monde du travail, au côté des travailleurs français). Avec l’aspiration à l’intervention directe dans la politique, avec la revendication du référendum d’initiative populaire, la révolte des Gilets jaunes a réconcilié Marx et Rousseau. Marx parce qu’elle relève d’une analyse de classe : la solution aux problèmes des Gilets jaunes est bel et bien la destruction du système capitaliste de propriété privée des grands moyens de production et d’échange. Rousseau parce qu’elle montre un besoin d’être citoyen, un besoin de démocratie directe, un refus du cosmopolitisme qui n’est qu’un autre nom du déracinement, qui est la marotte des élites, mais est un instrument de liquidation du peuple de France.  Justement, que faut-il pour contrecarrer une diversité ethno-culturelle dispersante ? Nous avons ici un accord, qui n’est pas mince, avec Michel Maffesoli. La laïcité ne peut être une réponse. « Il faut ritualiser le sacré », dit Maffesoli. Mais il faut observer que le sacré d’une partie des immigrès, le sacré musulman, est déjà ritualisé. Cela n’a rien de déplorable, le problème étant simplement une question de nombre (nous n’avons cessé de le dire depuis des décennies et voici que le dit aussi Patrick Buisson dans La fin d’un monde, 2021). « La démographie, c’est le destin », disait Auguste Comte. Pour faire du commun, en France et pour la France, il faut ritualiser un autre sacré que celui d’une communauté. Il faut inventer ou revivifier un imaginaire commun. Un imaginaire trans-tribal. Je dirais volontiers : l’imaginaire continental, eurasiatique, d’un monde au-delà des matérialismes dominants. Ce n’est pas, en tout cas, avec la laïcité que l’on transcendera le sacré des religions non européennes pour produire du commun, du sacré commun, dans les esprits et dans les cœurs. S’il faut garder la laïcité, qui n’est que la conséquence du catholicisme, il faut abandonner le laïcisme et générer un autre sacré, une religiosité (c’est à dire une religion sans interdits mais avec une éthique) qui soit le patrimoine commun du peuple de France. Quelque chose comme ce qui fut « la grande clarté du Moyen Age » (Gustave Cohen). « Toute éducation nécessite un rythme et une vision cosmique », dit Georg Simmel. Toute politique s’inscrit dans une cosmologie. Et toute politique a ses mythes, sans quoi elle n’a pas de grandeur. Mythe, grandeur et passion vont ensemble. « L'exception pense le général avec l'énergie de la passion », dit Carl Schmitt. Il n’y a pas de politique sans une éducation qui intègre cela. C’est pourquoi il faut déconstruire les déconstructeurs. La paideia, c’est la formation. Cela va bien au-delà de l’ingurgitation de connaissances et moins encore des « savoirs-faire », les fameuses « compétences » qui remplacent les diplômes, le « niveau général » et la « culture générale ». Il ne faut pas sous-estimer les aspirations à des exemples plus propres et plus nobles que ceux proposés par la téléréalité ou par nos dirigeants.
Justement, que faut-il pour contrecarrer une diversité ethno-culturelle dispersante ? Nous avons ici un accord, qui n’est pas mince, avec Michel Maffesoli. La laïcité ne peut être une réponse. « Il faut ritualiser le sacré », dit Maffesoli. Mais il faut observer que le sacré d’une partie des immigrès, le sacré musulman, est déjà ritualisé. Cela n’a rien de déplorable, le problème étant simplement une question de nombre (nous n’avons cessé de le dire depuis des décennies et voici que le dit aussi Patrick Buisson dans La fin d’un monde, 2021). « La démographie, c’est le destin », disait Auguste Comte. Pour faire du commun, en France et pour la France, il faut ritualiser un autre sacré que celui d’une communauté. Il faut inventer ou revivifier un imaginaire commun. Un imaginaire trans-tribal. Je dirais volontiers : l’imaginaire continental, eurasiatique, d’un monde au-delà des matérialismes dominants. Ce n’est pas, en tout cas, avec la laïcité que l’on transcendera le sacré des religions non européennes pour produire du commun, du sacré commun, dans les esprits et dans les cœurs. S’il faut garder la laïcité, qui n’est que la conséquence du catholicisme, il faut abandonner le laïcisme et générer un autre sacré, une religiosité (c’est à dire une religion sans interdits mais avec une éthique) qui soit le patrimoine commun du peuple de France. Quelque chose comme ce qui fut « la grande clarté du Moyen Age » (Gustave Cohen). « Toute éducation nécessite un rythme et une vision cosmique », dit Georg Simmel. Toute politique s’inscrit dans une cosmologie. Et toute politique a ses mythes, sans quoi elle n’a pas de grandeur. Mythe, grandeur et passion vont ensemble. « L'exception pense le général avec l'énergie de la passion », dit Carl Schmitt. Il n’y a pas de politique sans une éducation qui intègre cela. C’est pourquoi il faut déconstruire les déconstructeurs. La paideia, c’est la formation. Cela va bien au-delà de l’ingurgitation de connaissances et moins encore des « savoirs-faire », les fameuses « compétences » qui remplacent les diplômes, le « niveau général » et la « culture générale ». Il ne faut pas sous-estimer les aspirations à des exemples plus propres et plus nobles que ceux proposés par la téléréalité ou par nos dirigeants. 
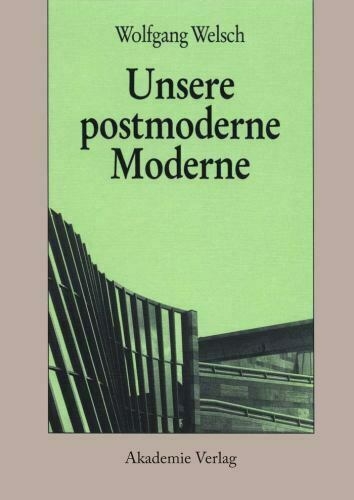 Ces considérations s'appuient sur des éléments véritablement postmodernes et, après avoir longtemps laissé en jachère ce champ de réflexion de la droite, riche mais parfois dérangeant, il est grand temps de réfléchir à son ordonnancement. Les lecteurs ayant une vision du monde conservatrice préconçue et qui reculent devant un tel sujet, moitié par dégoût, moitié par agacement, devraient prendre la précaution de se référer à Armin Mohler, qui a rendu compte du travail du chroniqueur postmoderniste Wolfgang Welsch dans Criticón dès la fin des années 1980 et a exhorté la droite à s'engager dans la "philosophie à la mode" de l'époque ; finalement sans succès (ndt:
Ces considérations s'appuient sur des éléments véritablement postmodernes et, après avoir longtemps laissé en jachère ce champ de réflexion de la droite, riche mais parfois dérangeant, il est grand temps de réfléchir à son ordonnancement. Les lecteurs ayant une vision du monde conservatrice préconçue et qui reculent devant un tel sujet, moitié par dégoût, moitié par agacement, devraient prendre la précaution de se référer à Armin Mohler, qui a rendu compte du travail du chroniqueur postmoderniste Wolfgang Welsch dans Criticón dès la fin des années 1980 et a exhorté la droite à s'engager dans la "philosophie à la mode" de l'époque ; finalement sans succès (ndt:  Lyotard a écrit dans l'ouvrage de référence La condition postmoderne : "En simplifiant à l'extrême, on peut dire que le "postmodernisme" signifie que l'on ne croit plus aux méta-récits." Celles-ci correspondaient à ce que l'on appelle aujourd'hui le "totalitarisme", et qui - aussi oppositionnel qu'il puisse prétendre être - est prêt à porter ce stigmate très spécifique ?
Lyotard a écrit dans l'ouvrage de référence La condition postmoderne : "En simplifiant à l'extrême, on peut dire que le "postmodernisme" signifie que l'on ne croit plus aux méta-récits." Celles-ci correspondaient à ce que l'on appelle aujourd'hui le "totalitarisme", et qui - aussi oppositionnel qu'il puisse prétendre être - est prêt à porter ce stigmate très spécifique ?

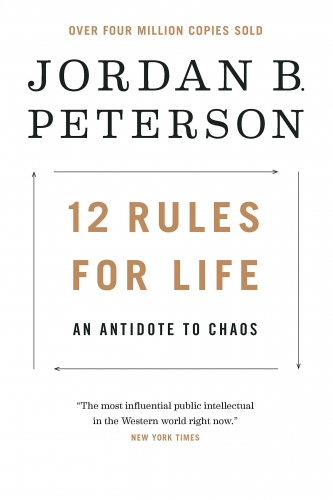



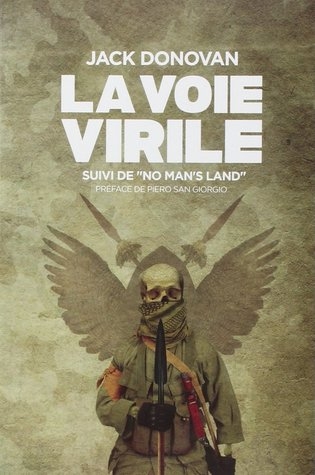



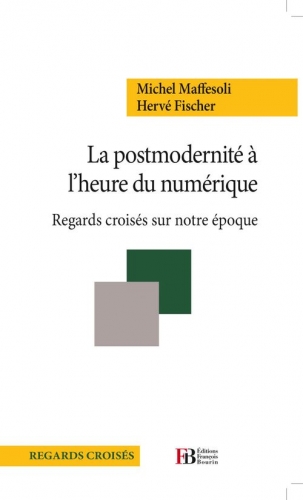

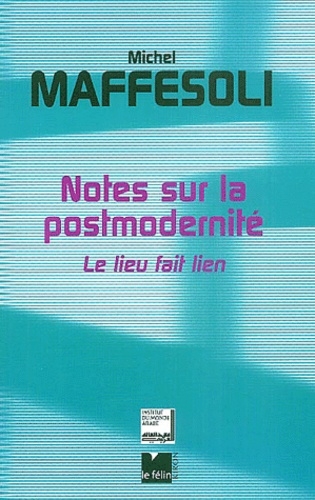
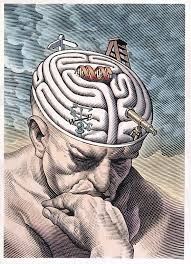
 Toute une sociologie se réjouit du développement de liens horizontaux, du co-voiturage, des co-locations (imposées par les loyers exorbitants), de la vitalité des tribus vestimentaires, sexuelles, comportementales qui irriguent la société française. C’est la France archipel qu’analyse fort bien Jérôme Fourquet. Certes, ces tribus se retirent totalement du politique - c’est le « retrait sur l’Aventin » dont parle Michel Maffesoli - mais elles seraient le lieu d’une éclosion de nouveaux liens, voire d’un nouveau lieu du sacré. Tout cela marquerait la revanche de l’émotion sur la raison, ou le basculement vers une raison sensible, à vrai dire plus sensible, comme les quartiers du même nom, que rationnelle, puisque – on l’oublie trop – la raison suppose une culture, alors que ces tribus postmodernes sont sans culture, autre que le présentisme.
Toute une sociologie se réjouit du développement de liens horizontaux, du co-voiturage, des co-locations (imposées par les loyers exorbitants), de la vitalité des tribus vestimentaires, sexuelles, comportementales qui irriguent la société française. C’est la France archipel qu’analyse fort bien Jérôme Fourquet. Certes, ces tribus se retirent totalement du politique - c’est le « retrait sur l’Aventin » dont parle Michel Maffesoli - mais elles seraient le lieu d’une éclosion de nouveaux liens, voire d’un nouveau lieu du sacré. Tout cela marquerait la revanche de l’émotion sur la raison, ou le basculement vers une raison sensible, à vrai dire plus sensible, comme les quartiers du même nom, que rationnelle, puisque – on l’oublie trop – la raison suppose une culture, alors que ces tribus postmodernes sont sans culture, autre que le présentisme. 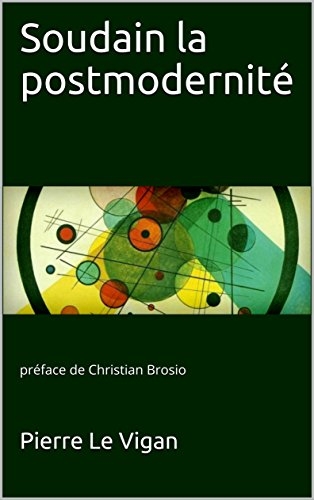 Cette vision, qui se veut un constat, n’est pas neutre. Ces théoriciens de la postmodernité heureuse, tels Michel Maffesoli, ne déplorent pas l’inexistence d’une spiritualité commune aux Français, d’un sacré unificateur ancré dans notre histoire, mais regrettent qu’une place plus grande ne soit pas faite aux autres spiritualités, et il n’y en a qu’une présente en masse, c’est l’islam, à qui une place plus grande devrait être faite (Maffesoli, Atlantico, 18 février 2015). Les djihadistes seraient en somme victimes du laïcisme français.
Cette vision, qui se veut un constat, n’est pas neutre. Ces théoriciens de la postmodernité heureuse, tels Michel Maffesoli, ne déplorent pas l’inexistence d’une spiritualité commune aux Français, d’un sacré unificateur ancré dans notre histoire, mais regrettent qu’une place plus grande ne soit pas faite aux autres spiritualités, et il n’y en a qu’une présente en masse, c’est l’islam, à qui une place plus grande devrait être faite (Maffesoli, Atlantico, 18 février 2015). Les djihadistes seraient en somme victimes du laïcisme français.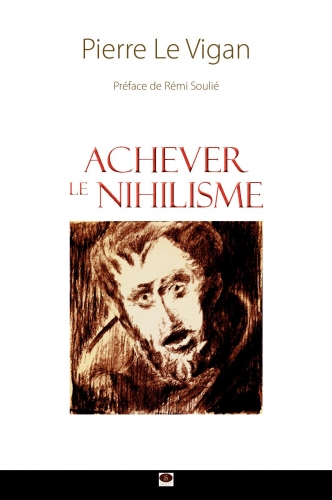 En vérité, il y a aussi de l’émotion du côté des élites, notamment l’émotion homogénéisatrice de l’interchangeabilité de tous les hommes, et l’immigrationnisme de principe, et il y a de la rationalité – les pieds sur terre, c’est rationnel – du côté du peuple. Les élites oligarchiques mettent de l’émotion dans la raison, le peuple, lui, met de l’émotion dans sa révolte rationnelle face à un pouvoir qui nie son droit à l’existence, à la fois matérielle, et c’est la question de la destruction des classes moyennes, et culturelle, et c’est la question de l’identité, et plus largement de la pérennité de soi comme Français. La lutte des classes, qui n’a été inventée par Marx, est toujours aussi une lutte pour déterminer quelles sont les valeurs qui dominent dans une société : l’argent ou la coopération, l’économie ou la pérennité des peuples, le court terme ou le long terme. Le peuple a besoin de la sécurité culturelle, du long terme et de ce qui n’a pas de prix : la patrie et donc la solidarité à l’intérieur de la patrie. Ce qui suppose une juste et nécessaire discrimination excluant tout devoir de solidarité avec les étrangers.
En vérité, il y a aussi de l’émotion du côté des élites, notamment l’émotion homogénéisatrice de l’interchangeabilité de tous les hommes, et l’immigrationnisme de principe, et il y a de la rationalité – les pieds sur terre, c’est rationnel – du côté du peuple. Les élites oligarchiques mettent de l’émotion dans la raison, le peuple, lui, met de l’émotion dans sa révolte rationnelle face à un pouvoir qui nie son droit à l’existence, à la fois matérielle, et c’est la question de la destruction des classes moyennes, et culturelle, et c’est la question de l’identité, et plus largement de la pérennité de soi comme Français. La lutte des classes, qui n’a été inventée par Marx, est toujours aussi une lutte pour déterminer quelles sont les valeurs qui dominent dans une société : l’argent ou la coopération, l’économie ou la pérennité des peuples, le court terme ou le long terme. Le peuple a besoin de la sécurité culturelle, du long terme et de ce qui n’a pas de prix : la patrie et donc la solidarité à l’intérieur de la patrie. Ce qui suppose une juste et nécessaire discrimination excluant tout devoir de solidarité avec les étrangers. 
 On parle de grand remplacement. Comme je l’ai montré avec Don Siegel et ses gentils profanateurs, il s’agit surtout d’un remplacement moral et spirituel. Mais il y a aussi le grand déplacement, qui ne date pas d’hier (voyez mon texte sur Baudelaire et la conspiration géographique). Dans n’importe quel bled la moitié des gens viennent d’ailleurs. Debord :
On parle de grand remplacement. Comme je l’ai montré avec Don Siegel et ses gentils profanateurs, il s’agit surtout d’un remplacement moral et spirituel. Mais il y a aussi le grand déplacement, qui ne date pas d’hier (voyez mon texte sur Baudelaire et la conspiration géographique). Dans n’importe quel bled la moitié des gens viennent d’ailleurs. Debord : J’évoque souvent le problème du logement qui m’a contraint à l’exil. Debord en parle souvent et il cite le jeune Marx. D’un ton magnifique et eschatologique, Marx écrit à la même époque que Tocqueville sur ce logement devenu impossible :
J’évoque souvent le problème du logement qui m’a contraint à l’exil. Debord en parle souvent et il cite le jeune Marx. D’un ton magnifique et eschatologique, Marx écrit à la même époque que Tocqueville sur ce logement devenu impossible :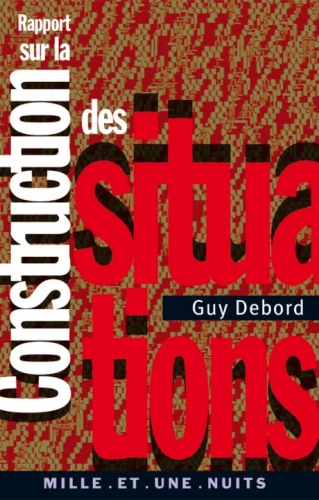


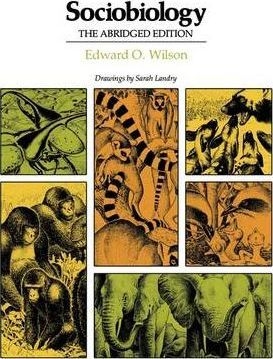 Among such concessions would be that it is unscientific to form a research community around sociobiology, or to explore the possibility that the individual selection model of evolution may not capture all aspects of natural selection, and that group-level fitness may play a role. After all, this remains the official view of mainstream science, which is a testament to the success of the Left-wing Sociobiological Study Group. This scientific research community arose in response to E. O. Wilson’s Harvard-based sociobiological research circle, and it functioned with the sole purpose of preventing sociobiology ever becoming a scientific discipline.
Among such concessions would be that it is unscientific to form a research community around sociobiology, or to explore the possibility that the individual selection model of evolution may not capture all aspects of natural selection, and that group-level fitness may play a role. After all, this remains the official view of mainstream science, which is a testament to the success of the Left-wing Sociobiological Study Group. This scientific research community arose in response to E. O. Wilson’s Harvard-based sociobiological research circle, and it functioned with the sole purpose of preventing sociobiology ever becoming a scientific discipline.
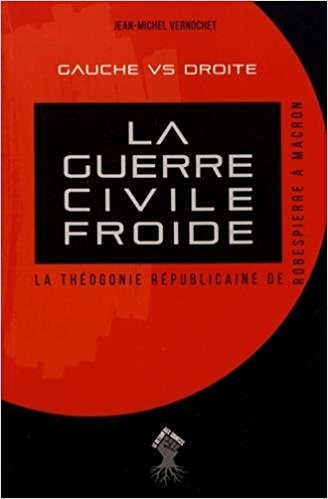 L'idée contemporaine prend toujours l'apparence d'une utopie bienveillante, fraternelle et égalisatrice, pour redresser les torts d'une société jugée encore trop paternelle ou hiérarchique. L'égalité des genres, le hashtag balance-ton-porc ou la discrimination positive sont avant tout des parodies de parodies, c'est-à-dire à la fois des parodies du principe platonicien ET de l'éthique quichottesque. Car c'est ici qu'il faut être précis : notre civilisation s'est d'abord bâtie sur l'affirmation de mythes spirituels et religieux, la cathédrale littéraire du Graal en constituant la dernière occurrence historique. Puis la modernité s'érigea sur la parodie desdits mythes, parfois somptueuses et emplies d'une belle énergie à l'instar du Quichotte.
L'idée contemporaine prend toujours l'apparence d'une utopie bienveillante, fraternelle et égalisatrice, pour redresser les torts d'une société jugée encore trop paternelle ou hiérarchique. L'égalité des genres, le hashtag balance-ton-porc ou la discrimination positive sont avant tout des parodies de parodies, c'est-à-dire à la fois des parodies du principe platonicien ET de l'éthique quichottesque. Car c'est ici qu'il faut être précis : notre civilisation s'est d'abord bâtie sur l'affirmation de mythes spirituels et religieux, la cathédrale littéraire du Graal en constituant la dernière occurrence historique. Puis la modernité s'érigea sur la parodie desdits mythes, parfois somptueuses et emplies d'une belle énergie à l'instar du Quichotte.




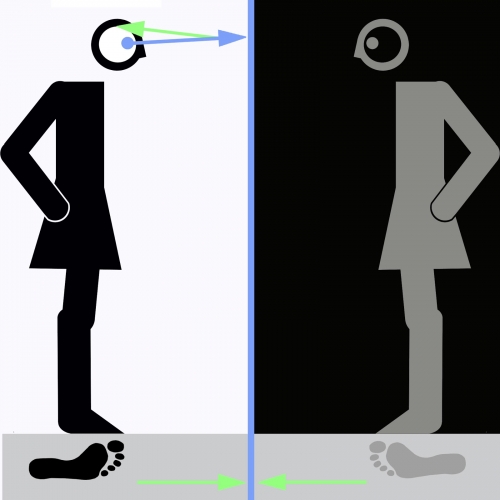








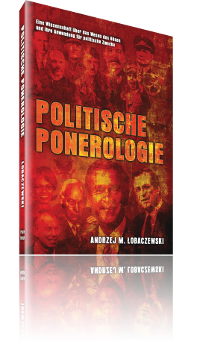

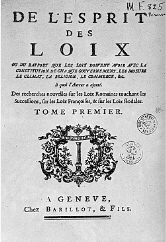 Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie.
Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie.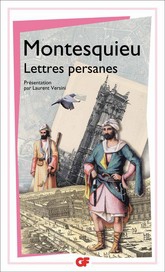 Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :
Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :