vendredi, 03 octobre 2025
Deux lectures douguiniennes de la Révolution conservatrice

Deux lectures douguiniennes de la Révolution conservatrice
Raphael Machado
Source: https://novaresistencia.org/2025/09/27/duas-leituras-dugi...
Parmi les phénomènes politico-philosophiques les plus intéressants du 20ème siècle, notamment pour les critiques non marxistes du libéralisme, la Révolution conservatrice allemande occupe certainement une place de choix.
Sans avoir réellement été un « mouvement » organisé, la Révolution conservatrice – telle qu’elle a été aboprdée dans l’étude thématique d’Armin Mohler, ancien secrétaire d’Ernst Jünger – représente une constellation d’auteurs, de revues et de cercles qui ont fleuri en Allemagne entre 1917 et 1933.
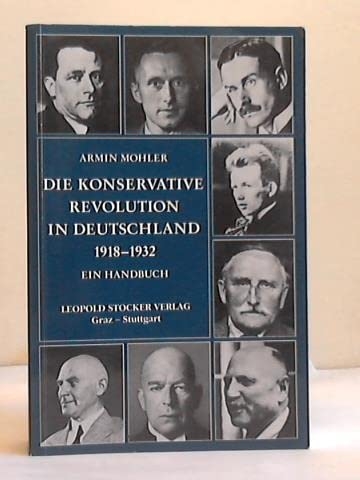
Des figures aussi diverses qu'Ernst Jünger, déjà cité, que Carl Schmitt, Martin Heidegger, Arthur Moeller van den Bruck, Ernst Niekisch, Othmar Spann, Oswald Spengler et des dizaines d’autres cherchaient – avec, naturellement, une immense variété de projets et de perceptions – dans un certain décisionnisme révolutionnaire, enraciné dans des principes antérieurs aux Lumières, une voie de sortie face à la décadence de la République de Weimar.
Ce qui les distinguait des conservateurs réactionnaires, c’est qu’ils ne souhaitaient pas revenir au passé et restaurer d’anciennes institutions, mais renouveler la nation. Les références au passé sont d’un ordre plus mythique et poétique qu’effectivement pratique. De plus, si les conservateurs réactionnaires acceptaient le capitalisme et étaient liés à la bourgeoisie, les conservateurs révolutionnaires étaient antibourgeois et anticapitalistes.
Mais ils n’étaient pas non plus marxistes, et se méfiaient autant de l’internationalisme cosmopolite que du prétendu rôle moteur d’un prolétariat déraciné, sans parler de la place centrale du matérialisme comme vision du monde et outil analytique.
Comme on le sait également, le sort des figures liées à la Révolution conservatrice sous la dictature nationale-socialiste de Hitler fut varié: certains embrassèrent le régime avec enthousiasme et furent absorbés par le système, d’autres tentèrent de collaborer mais finirent marginalisés, d’autres encore partirent en exil, et certains rejoignirent la résistance et furent persécutés ou même tués.
Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart de ces auteurs tombèrent dans l’oubli, à l’exception évidente de Heidegger, et c’est seulement avec l’activisme intellectuel inlassable de la Nouvelle Droite en France et en Allemagne à partir des années 1970 que nombre de ces figures ont pu retrouver, chez les chercheurs et dans le public, une attention intellectuelle.

L’un des penseurs qui s’est penché sur la Révolution conservatrice en tant que phénomène historico-politique est le philosophe russe Alexandre Douguine, qui n’est pas seulement le principal interprète russe de Heidegger, mais véritablement l’auteur russe le plus influencé de façon générale par la Révolution conservatrice dans ses écrits.
Auteur prolifique écrivant depuis le début des années 1990, Douguine a donc abordé à de nombreuses reprises la Révolution conservatrice au fil des ans, mais il est intéressant de remarquer quelques différences importantes entre ses approches successives du sujet.
J’indiquerai ici principalement comme références l’ouvrage « Révolution conservatrice », publié en 1994 (mais comportant des textes rédigés depuis 1991), et « La Quatrième Théorie Politique », publié en 2009.
Dans l’ouvrage éponyme, Douguine aborde la Révolution conservatrice non seulement comme synonyme de "Troisième Position", mais comme l’essence même de la "Troisième Position". La Révolution conservatrice y prend un caractère universel, constituant le fondement intellectuel (Urgrund) à partir duquel émergent les divers mouvements politiques fascistes en Europe et dans le Tiers Monde, des années 1920 aux années 1970.
On peut donc, dans ce sens, parler d’une « Révolution conservatrice » espagnole, qui trouve dans le phalangisme son expression politique; d’une « Révolution conservatrice » roumaine, qui trouve dans le légionnarisme son expression politique. Julius Evola apparaît ici comme un penseur de la Révolution conservatrice italienne.
Techniquement, le terme devient synonyme de "Troisième Position", un descriptif de l’essence de la "Troisième Position" comme synthèse transcendante des positions typiques de la droite et de la gauche.

Quinze ans plus tard, Douguine aborde la Révolution conservatrice d’une manière sensiblement différente, fruit de sa propre évolution intellectuelle.
La principale différence est que la Révolution conservatrice cesse d’être l’essence, ou même le synonyme, de la "Troisième Position" (désormais "Quatrième Théorie Politique") et appartient désormais au domaine de l’hétérodoxie tercériste.
Dans la mesure où Douguine conclut au caractère fondamentalement moderne du fascisme, la formule particulière de la Révolution conservatrice, plus radicale que le fascisme, cesse d’être facilement compatible avec les courants dominants de la Quatrième Théorie Politique.
De même que, dans la pratique, les principaux auteurs de la Révolution conservatrice furent marginalisés, sur le plan théorique, les idées-forces de la Révolution conservatrice apparaissent comme essentiellement marginales, voire impuissantes face à la marche en avant du fascisme.
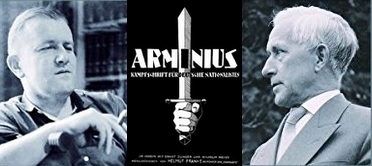
La Révolution conservatrice, dans cette nouvelle perspective, en raison même de son hétérodoxie, devient une préfiguration de la Quatrième Théorie Politique. Elle émerge du même creuset culturel et philosophique que le fascisme et, dans une certaine mesure, fait partie de la construction de l’atmosphère politico-culturelle qui a permis la manifestation historique du fascisme, mais demeure à l’écart, un courant étranger au flux historique dominant.
Et c’est précisément là que la Révolution conservatrice devient plus intéressante. Dans la mesure où les théories politiques passées sont modernes et convergent dans la Modernité, ce qui importe en elles, ce sont précisément les hérésies et les hétérodoxies, car c’est précisément dans les « écarts » et « aberrations » que l’on peut dévoiler la réminiscence d’éléments prémodernes ou antimodernes.
En conclusion, il est évident que le changement dans la lecture de la Révolution conservatrice découle du changement de position de l’auteur, passé d’une position tercériste au début des années 1990 à une position quarto-théoricienne à la fin de la première décennie du nouveau millénaire.
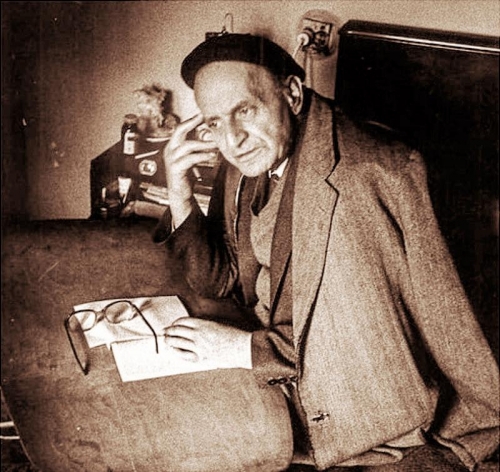
De plus, il est indéniable qu’il est possible d’extrapoler la Révolution conservatrice du contexte allemand à un contexte international, la position de ce phénomène variant selon les pays. En Russie même, la Révolution conservatrice fut totalement étrangère tant au fascisme russe qu’à l’État, mais à partir de Staline, certains aspects de l’eurasisme furent absorbés par le système. En Roumanie, en revanche, Nae Ionesco, Mircea Eliade, Emil Cioran et Constantin Noica (photo) – figures citées par Claudio Mutti comme représentants d’un conservatisme révolutionnaire autochtone – furent intimement liés au fascisme roumain.
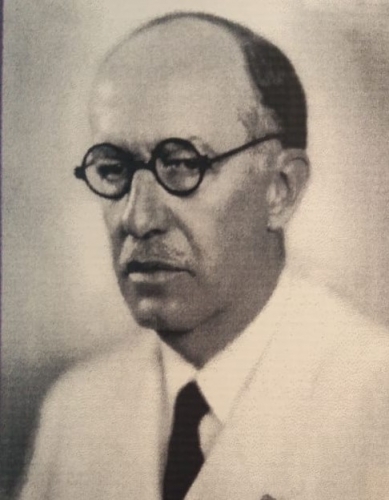
Au Brésil, je crois que l’on peut aussi parler d’une Révolution conservatrice, dont les contours restent encore diffus. Ont certainement fait partie de ce phénomène des figures comme Oliveira Vianna, Francisco Campos, Azevedo Amaral (photo), Otávio de Faria, et d’autres encore, certains plus proches de l’État nouveau, d’autres moins, certains nouant un dialogue avec l’intégralisme, d’autres non.
11:28 Publié dans Nouvelle Droite, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, révolution conservatrice, alexandre douguine, quatrième théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Écrire un commentaire