jeudi, 02 octobre 2025
«De la Méditerranée au Nord Olympien»: entre articles et conférences, l’héritage hyperbolique de Julius Evola

«De la Méditerranée au Nord Olympien»: entre articles et conférences, l’héritage hyperbolique de Julius Evola
Une nouvelle anthologie de textes de l’écrivain traditionaliste qui situe sa production de 1920 à 1945
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/124930-dal-mediterraneo-al-nord...
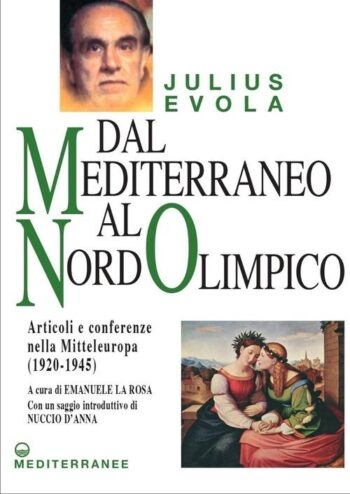 Dal Mediterraneo al Nord olimpico, de Julius Evola
Dal Mediterraneo al Nord olimpico, de Julius Evola
Julius Evola fut un penseur à la production extrêmement vaste. Au cours de son existence, notamment à partir des années vingt du siècle dernier, il entretint de nombreuses relations avec des personnalités éminentes du monde politique et, surtout, culturel, qu'il ait été italien ou européen. Il voyagea beaucoup en Europe centrale, se rendant à plusieurs reprises en Autriche, en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie. Vient de paraître en librairie une anthologie précieuse d’articles et de conférences du penseur traditionaliste, qui permet de faire la lumière sur ses vastes relations internationales autant que sur ses intentions politiques et métapolitiques, lors des années décisives de 1920 à 1945. Il s’agit de Julius Evola, Del Mediterraneo al Nord olimpico; Articoli e conferenze nella Mitteleuropa (1920-1945), paru dans le catalogue des Éditions Mediterranee (pour commander: ordinipv@edizinimediterranee.net, ++39-6/3235433).
Les nouveautés dans ce livre
Les traductions des textes et la direction de l’ouvrage sont dues à Emanuele La Rosa, collaborateur de la Fondation Evola, qui a retrouvé dans les archives et bibliothèques allemandes des articles jusqu’ici inconnus ou jamais traduits en italien.
La Rosa et Nuccio D’Anna, spécialiste de l’histoire des religions et du symbolisme, signent deux essais introductifs, propédeutiques à la compréhension de l’action dite d’« interventionnisme traditionnel » menée par Evola en Europe centre-orientale. Le livre se distingue également par sa troisième partie, qui rassemble des articles consacrés à Evola par la presse germanophone de l’époque, dont beaucoup restent inédits en italien, et par son appendice composée d’une revue de presse dédiée à Evola peintre.

Les voyages, les écrits et les conférences du traditionaliste visaient à la constitution d’un front commun paneuropéen, révolutionnaire et conservateur, destiné, d’une part, à « rectifier » les limites théoriques et pratiques du fascisme et du national-socialisme, et d’autre part, à donner une réponse forte et convaincante à la prégnance du moderne dans tous les domaines de la vie. D’Anna note : « Dans ses interventions, il n’omettait pas d’indiquer des comportements “exemplaires”, des formes de coutume et des modèles existentiels considérés comme importants dans une société qui, à la suite du lourd krach économique de 1929, avait sombré dans une profonde crise d’identité » (p. 9).

À l’avis de l’auteur, la revue la plus prestigieuse dans laquelle écrivit Evola fut la Europäische Revue du prince Rohan (photo). Parmi ses collaborateurs figuraient, entre autres, W. F. Otto, Heidegger, Schmitt, Sombart, C. G. Jung et notre compatriote Ernesto Grassi.
Dans tous les cas, même dans d’autres périodiques: « Evola continuera à avancer […] dans une seule direction dont les caractéristiques fondamentales apparaissent ordonnées autour de traditions sacrées […] symboles et formes du prépolitique qui trouvent sur le plan métahistorique leur véritable raison d’être » (p. 11).

Pour Evola, en effet, l’organisation de l’État de la Tradition était caractérisée par la synthèse de deux puissances, la temporelle et la spirituelle (Melchisédek), que le Moyen Âge gibelin tenta de réintroduire dans l’histoire (cycle du Graal). À la lumière de telles positions, le traditionaliste œuvra à renforcer, dans des termes non seulement politiques, l’alliance italo-allemande. Dans cette anthologie figurent également des écrits dans lesquels Evola critique la version purement biologique du racisme alors prédominante en Allemagne, au nom d’une race de l’esprit, traditionnelle, consciente de la tripartition humaine en esprit, âme et corps.
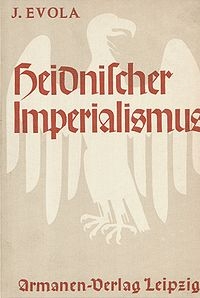 Impérialisme païen en Italie et en Allemagne
Impérialisme païen en Italie et en Allemagne
De certains des textes d’Evola, comme l’observe La Rosa, on relève d’importantes différences entre la version italienne de Impérialisme païen et sa traduction allemande de 1933: dans la première, le penseur « oppose au “danger euro-chrétien” la fonction positive d’une reprise de la tradition méditerranéenne, tandis que dans la version allemande il se fait porte-parole de la tradition nordique-germanique » (p. 31).
Ce changement de perspective s’explique par des raisons biographiques (la rupture avec Reghini, néo-pythagoricien et partisan de la très ancienne sapientia italique de Vico, ayant fini devant les tribunaux) et par des motivations idéales. Certes, comme il ressort de l’essai du directeur de la publication, il y eut chez Evola un choix stratégique, de type « machiavélique », visant à déplacer son influence théorique vers les pays d’Europe centrale, ce qui permet d’interpréter les deux versions d'Impérialisme païen « comme deux programmes politiques différents par leur forme et leur contenu […] comme une proposition (méta)politique offerte tantôt au gouvernement fasciste, tantôt au gouvernement national-socialiste naissant » (p. 32).

Le changement théorique s’explique aussi par des raisons idéales: après la rencontre avec Guénon, Evola changea de perspective sur la civilisation méditerranéenne et porta un autre regard sur la Renaissance italienne. Alors que dans Impérialisme païen, Giordano Bruno et la philosophie de la Renaissance (comme dans ses œuvres philosophiques) jouent un certain rôle, dès le début des années trente, le philosophe de la vicissitude universelle et les néoplatoniciens du Quattrocento ne sont plus cités, sauf négativement. Dans Révolte, le traditionaliste en viendra à affirmer : « La véritable Renaissance (de la Tradition), c’est le Moyen Âge ».
Evola « transpose dans l’idée impériale celle de la réalisation de l’individu […] dont la règle fondamentale est le principe de solidarité entre les éléments d’un organisme » (p. 33). L’Empire devient le modèle métapolitique du philosophe, réponse autant à l’internationalisme marxiste qu’à la ploutocratie américaine. La même inflexion “nordique” se manifeste également au niveau des symboles: du faisceau liturgique on passe à l’aigle impérial. « Evola doit agir “machiavéliquement” en activant des forces motrices, des symboles et des mythes […] capables de fasciner […] le public auquel il s’adresse » (p. 35).

La dimension cruciale de la pensée d’Evola
Cet interventionnisme traditionnel ne produisit ni en Italie, ni en Allemagne, les résultats espérés. Il ressort pourtant, même de ce recueil, le legs hyperbolique du penseur. Sur le plan individuel, il est symbolisé par l’individu absolu, « délié » au sens latin, libéré, même de lui-même, tendu dans la tension existentielle induite par l’incipit vita nova. Son existence est déjà, en soi, exemplaire, elle renvoie, métapolitiquement, au dépassement sublime des organisations politiques contemporaines. Son arbitraire ne saurait être compris par l’œil moderne, éduqué aux distinctions exclusives induites par le logocentrisme.
Del Meditarraneo al Nord olimpico est une œuvre qui apporte une lumière supplémentaire sur la pensée abyssale de Julius Evola, à lire et méditer avec un regard non représentatif, absolu, au-delà de la dichotomie sujet-objet, car pour Evola, phénomène et noumène disent la même chose…
Julius Evola, Del Mediterraneo al Nord olimpico. Articoli e conferenze nella Mitteleuropa (1920-1945), sous la direction d’Emanuele La Rosa, Éditions Mediterranee, 331 pages, 31,50 euros.
16:10 Publié dans Livre, Livre, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, révolution conservatrice, tradition, traditionalisme, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



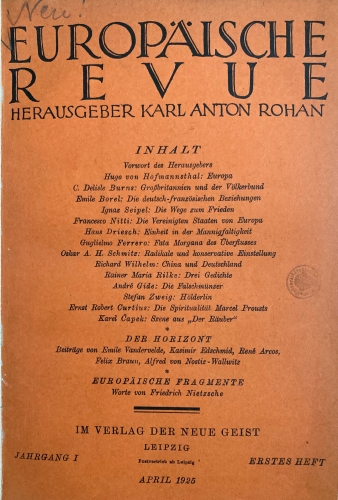
Écrire un commentaire