Très méthodiquement, l’auteur démonte les mécanismes historiques qui ont permis à cette nouvelle classe de “banquiers-commerçants” de s’accaparer le pouvoir. Il aura fallu patiemment détricoter les rouages de l’État moderne à commencer par le droit continental, hérité du droit romain, pour lui substituer un droit anglo-saxon porteur d’une autre philosophie, individualiste, prédatrice. Il aura aussi fallu développer un système bancaire et financier toujours plus complexe et centralisé autour du système des Banques Centrales pour faire circuler l’argent et donc le pouvoir en dehors des États, privant ces derniers et leurs peuples de toute souveraineté jusqu’à faire craindre la destruction de notre civilisation.
Le message est taillé à la serpe et après une 1ère partie à charge où on fait le tour des suspects habituels, FED, BRI, FMI, OMC, paradis fiscaux et des mécanismes mis en place pour permettre cette domination, Valérie Bugault nous propose une autre vison de l’entreprise et donc de la société à travers la redéfinition des rôles des différents acteurs, les apporteurs de travail, les apporteurs de capitaux, les dirigeants et au milieu, dans le rôle d’arbitre, un État régulateur.
Il s’agit d’une reforme en profondeur qui devrait irradier sur la structure même de la société ou se déploierait cette Nouvelle Entreprise, avec la fin de l’anonymat des capitaux et donc des trusts et des paradis fiscaux, la fin de la déresponsabilisation des dirigeants au travers de la personnalité “morale” et donc le retour du droit romain. Valérie Bugault déclare la guerre au monde financier d’origine anglo-saxonne.
Elle décrit longuement les relations qu’elle imagine entre ses différents acteurs, non pas pour faire disparaître par miracle toutes tensions, mais plutôt pour organiser juridiquement le cadre de ce rapport de force pour ne léser ni les travailleurs sans qui aucune richesse ne peut être produite, ni les apporteurs de capitaux, dont les capitaux sont maintenant exclusivement issu d’un travail réalisé et d’un report de consommation pour permettre le développement économique.
Les dirigeants ne seraient plus liés aux capitaux mais l’objet de négociations entre les partis pour développer un projet d’entreprise plus consensuel en lien avec la société civile. L’État retrouverait son rôle d’arbitre, garant des règles et de la sécurité juridiques des acteurs. Il suffit de se lamenter, il existe des solutions comme l’initiative Monnaie Pleine pour le secteur bancaire, Valérie Bugault nous propose un nouveau modèle d’Entreprise, clé en main.
Interview de Valérie Bugault du 23 Septembre 2018
 Valérie Bugault est docteur en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. à l’occasion de sa thèse portant sur le droit de l’entreprise, elle a élaboré une théorie juridique unifiée, qualifiée « d’iconoclaste », de l’entreprise. Elle a travaillé comme avocate fiscaliste dans le domaine des prix de transfert ainsi qu’en droit fiscal interne avant de cesser sa carrière d’avocate pour se consacrer à l’analyse des problématiques de géopolitique économique. Elle a notamment publié, en 2016, sur le site du Saker francophone une série d’études intitulée « décryptage du système économique global ».
Valérie Bugault est docteur en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. à l’occasion de sa thèse portant sur le droit de l’entreprise, elle a élaboré une théorie juridique unifiée, qualifiée « d’iconoclaste », de l’entreprise. Elle a travaillé comme avocate fiscaliste dans le domaine des prix de transfert ainsi qu’en droit fiscal interne avant de cesser sa carrière d’avocate pour se consacrer à l’analyse des problématiques de géopolitique économique. Elle a notamment publié, en 2016, sur le site du Saker francophone une série d’études intitulée « décryptage du système économique global ». SF – Pourquoi un livre sur une nouvelle entreprise, l’entreprise actuelle est-elle si défaillante ? Certaines comme les multinationales se portent très bien ?
VB – Les sociétés commerciales sont, dans leur version moderne, nées en France à l’occasion de la loi du 24 juillet 1867. 1 Toutefois, l’idée même des multinationales que nous connaissons aujourd’hui est bien antérieure, elle remonte à ce que la plupart des pays européens ont connu et développé sous le terme générique de « Compagnie des Indes ». Ces entités, mélanges de capitaux privés et de pouvoir militaire, disposaient de toutes les prérogatives de puissance publique, y compris celles de battre monnaie et d’engagement militaire.
Mon expérience familiale alliée à mon expérience professionnelle, y compris celle acquise dans le domaine des « prix de transfert » m’ont permis de comprendre que la structure de la société par actions était en réalité un instrument de captation du pouvoir économique ; et que cet instrument, derrière les apparences, ne servait en réalité que les plus grands détenteurs de capitaux. Ces structures capitalistiques sont organisées de façon hiérarchique au profit de leurs propriétaires majoritaires. Or, l’évolution et la généralisation de l’utilisation des marchés de capitaux, induit une concurrence, plus ou moins forte en fonction des secteurs d’activité et des époques, qui génère une concentration mécanique des capitaux, les plus gros « avalant » les plus petits. Cette concentration a été d’autant plus insidieuse que les propriétaires dominants, souvent très minoritaires, sont, pour ce qui est des entreprises cotées appartenant à des « groupes », dans une très large mesure, anonymes. Ainsi, la pratique des marchés, largement développée par la libéralisation des flux de capitaux imposée par l’idéologie dominante, a permis une énorme concentration des richesses dans des mains de personnes qui restaient, le plus souvent, anonymes. Ce phénomène a été, bien entendu, très amplifié par l’arrivée d’acteurs anonymes, largement incontrôlés, qui gèrent d’énormes masses de capitaux (fondations, fonds de pension, hedges funds, fonds vautours…) ; ajoutons que les « prix de marchés » ont définitivement fini d’être libres à l’arrivée du High Frequency Trading.
L’entreprise commerciale, à structure capitalistique, a été l’instrument discret d’une prise de pouvoir économique des plus gros détenteurs de capitaux sur les plus petits. Dans cette « pièce de théâtre », que l’on ne distingue réellement qu’une fois l’acte final écrit, les petites et moyennes entreprises, les vrais entrepreneurs, les individus créatifs et volontaires, ont finalement servi de « faire-valoir » aux gros capitalistes qui ont, d’une façon ou d’une autre, asservi les PME et mis sous tutelle toute velléité de création de richesse par des individus indépendants.
Ces principaux capitalistes ont été malins et rusés, ce qui est la caractéristique première des banquiers-commerçants issus des orfèvres changeurs du Moyen-Âge, dont ils sont les descendants directs. Ils ont avancé pas à pas, et surtout masqué, en mettant en avant la liberté du commerce et les immenses possibilités de développement social que procurerait un système fondé sur le financement capitalistique. Ils ont fait en sorte que chaque avancée règlementaire du système soit rendue nécessaire par l’avancée précédente. De fil en aiguille nous en sommes collectivement arrivés au point où personne n’imagine plus possible un autre système de développement social.
Or, décrypter les différentes avancées techniques que ce « système intégré » a suivi permet justement de comprendre pourquoi et comment il fonctionne fondamentalement de façon viciée, autour du seul concept de « domination économique ». Cela permet de comprendre également que ce système est devenu le modèle de fonctionnement de la Société politique moderne. Tous les pays du monde sont aujourd’hui concernés par ce modèle déficient qui a, par capillarité, infecté tous les autres « systèmes politiques » en vigueur. Je précise ici qu’il faudrait parler de « système économique » appliqué à l’ensemble de la collectivité humaine ; parler de « système politique » est impropre dans la mesure où justement le concept politique a totalement disparu, il a été phagocyté par le principe commercial de nature économique.
Le type de travail que j’ai effectué, à partir d’un domaine juridique technique, m’a emmené sur un terrain politique et géopolitique. Il m’a également, par un lien de causalité évident, amené à m’interroger, en tant que juriste sur le phénomène monétaire, qui a été, avec l’entreprise capitalistique, l’autre outil, extrêmement puissant, de la prise du pouvoir politique par la caste des « banquiers-commerçants ». De fil en aiguille, on peut dire que ma théorie juridique de l’entreprise m’a logiquement amenée, de façon naturelle et grâce à ma rencontre de Jean Rémy, à faire une théorie juridique de la monnaie. (2)
Finalement, j’ai pu constater que, d’un point de vue sociétal, la monnaie et l’entreprise ont beaucoup de points communs. Fondamentalement, il s’agit de deux « institutions » qui ont un rôle social fondamental à jouer : celui de permettre et de faciliter les échanges de biens et services entre individus, le tout sous le contrôle politique d’un État, c’est-à-dire, nécessairement, à l’intérieur de frontières clairement définies. Cette assertion rend évidemment nécessaire de s’interroger sur la notion d’État, c’est-à-dire sur les sous-jacents juridico-socio-politique de l’État. J’ai ainsi perçu qu’il existait une nécessité vitale d’expliquer au public ce qu’est un État ; qui n’a – vous l’aurez compris – rien à voir (strictement rien) avec l’État qui nous est vendu, par urnes interposées. Nous vivons une époque de perte total de sens philosophique, politique et sémantique. Il faut, absolument retrouver la véritable signification des choses pour reprendre collectivement le chemin de la civilisation.
 Retrouver le véritable sens politique de l’État permettra au « droit », en tant qu’outil de régulation des comportements socialement toxiques, de reprendre les lettres de noblesse qu’il a lâchement abandonnées au profit des « sciences économiques » chargées de mettre en musique le nouveau modèle de Société, celui de la domination intégrale, sous lequel nous vivons. De technique, mon travail m’a conduite à une réflexion de nature sémantique et quasi philosophique. Cette réflexion, tout à fait vitale, doit être partagée par le plus grand nombre de personne car elle conditionne aujourd’hui et demain la pérennité du genre humain. On en est véritablement et précisément là !
Retrouver le véritable sens politique de l’État permettra au « droit », en tant qu’outil de régulation des comportements socialement toxiques, de reprendre les lettres de noblesse qu’il a lâchement abandonnées au profit des « sciences économiques » chargées de mettre en musique le nouveau modèle de Société, celui de la domination intégrale, sous lequel nous vivons. De technique, mon travail m’a conduite à une réflexion de nature sémantique et quasi philosophique. Cette réflexion, tout à fait vitale, doit être partagée par le plus grand nombre de personne car elle conditionne aujourd’hui et demain la pérennité du genre humain. On en est véritablement et précisément là ! SF – Quelles voies voyez-vous pour mettre ce projet en place ? On voit par expérience que c’est difficile en Russie par exemple avec un État fort et soutenu par son peuple ou en Chine où, sous une autre forme, l’État à la main, les mécanismes du capitalisme “domine” aussi dans des formes assez sauvages.
VB – La première chose à comprendre sont les postulats sous lesquels nous sommes sommés de vivre. Ensuite, ces postulats identifiés, il convient d’identifier les « roues » qui empêchent de sortir de ces postulats idéologiques. En l’état actuel des choses, ce travail collectif n’a pas été fait, il est donc impossible d’agir en vue d’un éventuel changement. Les États forts que vous mentionnez, la Russie et la Chine, ne fonctionnent pas autrement que selon le principe commercial, le principe économique ayant lui-même pris le pas sur le principe politique.
Un combat existe néanmoins dans ces pays, comme d’ailleurs dans la plupart des pays du monde, où certaines personnes commencent à comprendre que le problème ne réside pas dans le faux choix entre « droite-gauche » ou « conservateur-progressiste » mais dans la profonde distinction qui existe entre les partisans du globalisme, qui veulent imposer leur projet de gouvernement mondial, et ceux du nationalisme étatique qui veulent rester maîtres de leurs destins collectifs.
Mon travail ne pourra réellement porter ses fruits que le jour où les gens auront collectivement compris que le problème essentiel réside dans le fait que les collectivités d’individus ont perdu le contrôle de leurs destins collectifs, qui est aujourd’hui largement concentré dans les mains des principaux propriétaires de capitaux. Mes travaux doivent en quelques sorte être considérés comme étant les moyens techniques permettant la mise en place d’un système de remplacement immédiatement opérationnel. Mon travail ne pourra être fonctionnel, opérationnel, que le jour où la collectivité des individus aura décidé de reprendre le contrôle politique de ses institutions ; il restera, par nécessité politique, lettre morte jusqu’à ce que ce jour arrive.
SF – Comment va-t-on organiser cette nouvelle justice qui va avec la nouvelle entreprise ? Ne va-t-on pas assister à de nouvelles concentrations du capital menant à des volontés d’accaparement des rouages de l’État ?
VB – La question de la « justice » est en effet importante, pour ne pas dire « essentielle », elle est intrinsèquement liée au concept politique. Car organiser la vie en commun dans d’acceptables conditions de sérénités, ne peut faire l’économie d’un questionnement sur la « justice ». Sans aller jusqu’à la « justice immanente », sans doute pas de ce monde, l’aspiration à la « justice » est la condition qui permet aux individus de sublimer leurs intérêts individuels ou catégoriels immédiats afin de faire des concessions à d’autres intérêts ou groupe d’intérêts. Ces concessions ne peuvent se faire que si existe un « intérêt commun supérieur » que chaque groupe aura conscience de défendre en faisant les concessions demandées. Cela suppose aussi l’existence d’un « arbitre », chargé de faire appliquer et respecter cet « intérêt commun supérieur ».
L’État, comme la direction des entreprises, existe précisément pour organiser la gestion d’intérêts contradictoire. Le pouvoir politique, tout comme la direction des entreprises, n’ont qu’un seul rôle à jouer : celui d’arbitrer, de faire des choix, entre des intérêts contradictoires. Ce type d’organisation ne peut être mis en œuvre qu’à partir du moment où tous les intérêts présents sont, à un moment où à un autre, pris en considération d’un point de vue social, c’est-à-dire que tous les intérêts ont dument la capacité d’être représentés par les institutions étatiques, qui forment l’organisation de la Société politique.
Ainsi, la mise en œuvre de la justice passe d’abord et avant tout par une juste représentation politique des intérêts en présence ; c’est précisément à cet objectif que répond ma théorie juridique de l’entreprise. Du point de vue « politique », il est parfaitement clair que le principe de séparation des pouvoirs (tels qu’actuellement conçus) allié au modèle parlementaire anglais est tout à fait inapte à répondre à ce besoin. Nos démocraties parlementaires modernes sont disqualifiées pour répondre au besoin de justice dont toute société (au sens de collectivité d’individus) a besoin pour fonctionner de façon satisfaite. Ce modèle d’organisation social qui a été imposé à la suite des Révolutions françaises, américaines etc. est un modèle déficient car il permet justement un accaparement du pouvoir par des groupes anonymes. Ce modèle d’organisation social ne permet pas aux différents groupes d’intérêts en présence de lutter à armes égales car, n’étant pas institutionnellement représentés et contrôlés par un mandat impératif, les décisions sont prises de façon opaques ; les « décisions politiques » font l’objet de tractations plus ou moins douteuses, opérées largement en coulisse, dans le silence et l’anonymat des « cabinets ou des couloirs », et non de façon ouverte et publique avec un médiateur-arbitre pour trancher ouvertement les litiges.
C’est précisément la raison pour laquelle j’ai proposé de revoir l’organisation sociale, politique, autour du concept de « corps intermédiaires ». (3) Là encore, mon travail sur l’entreprise a servi de fil directeur à mon travail institutionnel. C’est aussi la raison pour laquelle j’insiste, dans mon travail sur l’entreprise, pour que les dirigeants prennent la pleine mesure de leur fonction qui est de trancher, d’arbitrer, en toute indépendance et avec l’intérêt social comme ligne directrice, entre les intérêts antagonistes des « apporteurs de capitaux » et des « apporteurs de travail ».
Il faut comprendre que le « pouvoir », qu’il soit « politique » ou, s’agissant d’entreprise, « économique », n’est pas « gratuit » : il correspond fondamentalement à une fonction d’arbitrage et de prise de position entre des intérêts divergents. Ces prises de position ne sont pas sans contrepartie car le « pouvoir » doit être sanctionné si, sur une certaine durée, il s’avère incapable d’œuvrer dans le sens du bien collectif ou, s’agissant d’entreprise, de l’intérêt social. Le pouvoir (et les hommes qui l’incarnent) doit être sanctionné lorsque la collectivité s’aperçoit qu’il a dévié du droit chemin pour emprunter la seule voie de la défense d’un ou plusieurs intérêts catégoriels, au détriment de l’intérêt général.
Qu’il s’agisse de l’entreprise, ou du pouvoir politique, l’essentiel se situe dans le fait d’organiser des institutions capables de représenter tous les intérêts en présence et un pouvoir politique dont le rôle est d’arbitrer entre les intérêts en présence ; ce pouvoir politique doit par ailleurs être, institutionnellement, structurellement, sanctionné s’il dévie du droit chemin de la défense de « l’intérêt commun » pour emprunter celui de la seule défense d’intérêts catégoriels. La politique et le pouvoir se résume finalement à « une entité chargée de défendre l’intérêt du groupe au détriment des intérêts catégoriels ».
SF – Une question plus technique. Comment va se faire la destruction du capital ? Les acteurs ne voudront-t-ils pas en appeler à l’État pour les protéger, les sauver ?
VB – Les acteurs économiques dont vous parlez ont justement phagocyté l’État de telle façon que celui-ci intervienne dans le seul sens de leurs intérêts bien compris. Ce que vous redoutez n’est pas nouveau, cela fait, au bas mot 400 ans que cela dure, depuis globalement, la période dite des Grandes Découvertes, qui a donné le coup d’envoi de l’essor capitalistique avec les différentes Compagnies des Indes. Par ailleurs, parler de « destruction du capital » me gêne en raison de sa connotation idéologique. Il ne s’agit pas tant de détruire le capital que d’empêcher les principaux capitalistes de prendre un pouvoir politique absolu. Il ne s’agit pas de lutter contre un système en soi, il s’agit de lutter contre un système qui est en réalité conçu et utilisé comme une arme de guerre pour s’emparer du pouvoir politique sur les peuples.
En d’autres termes, il ne s’agit pas de lutter contre le pouvoir du capital, il s’agit d’empêcher ce dernier d’être utilisé à des fins de domination. De la même façon, préconiser un juste retour du principe politique n’a pas pour effet de faire disparaître le commerce des activités humaines. Il s’agit, tout au contraire, de remettre les choses à leur juste place en considération de leur utilité sociale ultime : le commerce ne doit pas devenir « principe politique », le commerce ne doit pas devenir le seul moyen de reconnaissance et d’élévation sociale… Pour tourner les choses autrement : je ne prétends pas empêcher les individus créatifs, volontaires, intelligents et honnêtes de s’enrichir mais je prétends, par mes travaux, soumettre la validité des actions de tels individus au jugement collectif, confronter la valeur de leurs apports à l’intérêt collectif, à « l’intérêt social ».
Dans ce nouveau système d’organisation (que je préconise), seuls s’élèveront les hommes et les idées qui apporteront un mieux être à la collectivité, ou à l’entreprise, dans son ensemble. Alors que chacun peut constater que les choses aujourd’hui sont à l’exact opposé : actuellement, seuls s’élèvent dans l’ordre (qui est un réel désordre) social les individus les plus nuisibles, notamment par leur créativité, au groupe, à la Société prise dans son ensemble.
SF – Et à l’international ? Les pays sont plus ou moins bien loti géographiquement ou en termes de ressources, et plus ou moins puissant dans un éventuel rapport de force, comment ce bouleversement va impacter la géopolitique mondiale ?
VB – La question des atouts stratégiques en matière première (énergie, terres arables, terres rares…) reste un véritable sujet. Néanmoins, il ne faut pas voir ce sujet comme un mur infranchissable. Il y a beaucoup d’autres façon d’apprécier la qualité d’un territoire, et notamment en fonction de sa qualité de vie (climat, degré de pollution etc.). Et surtout il existe la possibilité que la créativité humaine contourne ces questions de dotation en matière première par l’innovation et la créativité.
Un des gros problèmes du système de domination sous lequel nous vivons actuellement est justement que la valeur créative des individus peut très difficilement émerger. Il est, par exemple, très difficile pour un individu isolé de déposer et défendre un brevet en raison de la double barrière des coûts et des contraintes administratives.
Dans les projets « d’entreprise », « de monnaie » et « d’État » que je défends, toute personne pourra créer une entreprise innovante en soumettant son projet à 1°) un collectif de personnes qui connaissent le sujet, pour validation et 2°) à l’État – lequel serait à nouveau maître ultime de son principe monétaire, pour financement. Ensuite, une fois lancé, le projet pourra faire appel à l’épargne publique par différents moyens dont, pourquoi pas (?), le système de la blockchain.
Je ne voudrai surtout pas que les gens croient que mon projet d’entreprise rénovée sera un obstacle à l’innovation, il sera, tout au contraire, un catalyseur d’innovations. C’est précisément la raison pour laquelle j’ai expressément mentionné, à l’occasion de ma thèse, que la réalisation d’un bénéfice n’était pas une condition sine qua non de l’entreprise. La première condition de l’entreprise est d’avoir un projet professionnel, qui sera financé en fonction de l’intérêt qu’il présente pour la collectivité.
Vous voyez ainsi que la réforme de l’entreprise telle qu’ici conçue ne pourra voir le jour que si, parallèlement, les États, redevenus des entités politiques, récupèrent leur entière souveraineté monétaire. Car qui détient la monnaie a le pouvoir d’affecter les ressources. Le principe monétaire a aujourd’hui été détourné et subverti par son appropriation par la caste des banquiers-commerçants ; il en résulte, naturellement, que les ressources ne sont pas correctement affectées dans la Société.
SF – On peut aussi voir votre projet comme un énorme coup de frein à la vitesse de rotation des flux de marchandises, une baisse de la quantité pour plus de qualité ? Que fait-on du système économique actuel, des montagnes de dettes ?
Là encore, considérer les choses de cette façon, c’est être victime d’illusion. Car enfin, la multiplication du nombre des entreprises ne suppose en aucune façon un ralentissement des échanges, c’est l’inverse. Plus il y aura d’entreprises viables gérées conformément à leur intérêt propre en fonction du développement de l’intérêt collectif, et plus il y aura d’échanges productifs au sein de la Société. Quant au système économique actuel, il sera peu à peu remplacé, un peu à la façon d’une bonne monnaie qui chasserait la mauvaise.
Concernant les dettes, aujourd’hui contractées par les États sous la pression des principaux détenteurs de capitaux, il conviendrait évidemment d’en faire un audit politique sérieux au regard de leur utilité sociale, qui est également le fondement de leur légitimité. Je rappelle que, de façon fondamentale, un droit qui s’occupe de l’intérêt social du groupe, comme le faisait le droit continental traditionnel, ne fait pas passer l’intérêt catégoriel des créanciers devant l’intérêt général. Il en va, évidemment bien différemment sous la domination actuelle du droit anglo-saxon, qui est fondamentalement un principe de régulation aux mains des plus gros propriétaires de capitaux. La règlementation à l’anglo-saxonne est abusivement qualifié de droit, elle n’est pas un « système juridique » comme l’était le droit continental traditionnel, mais une succession de règlementations utilitaires et opportunistes au bénéfice de la caste capitalistique dominante. C’est précisément dans ce sens que vont les règlementations applicables en comptabilité internationale des entreprises mais c’est également dans ce sens que vont toutes les réformes imposées à la France par les institutions européennes.
SF – Il y a encore d’autres fonctions de la société à remettre debout, l’éducation, l’écologie peut-être, le militaire ? D’autres livres en perspective ?
VB – L’entreprise, et la Société, réformées dans le sens que je préconise peuvent, sinon remédier à tout, du moins produire une organisation sociale viable qui permettra de remédier aux problèmes structurels que nous rencontrons à peu près dans tous les domaines de la vie. Il ne s’agit pas de trouver les clefs du paradis terrestre, mais il s’agit, a minima, de fermer la porte aux paradis artificiels, que sont les paradis fiscaux et de permettre un rééquilibrage des forces institutionnelles en présence au sein d’une collectivité politique. Je n’ai en revanche aucune vocation personnelle à tenter d’améliorer chaque individu, ni à supprimer le mal qui peut, à un moment où à un autre, émerger de tout être humain. Il faut aussi rester modeste et considérer qu’il arrive que des actions ou des règles mues par de bonnes intentions débouchent sur des catastrophes collectives alors qu’à l’inverse, des actions ou des règles justifiées par des intentions plus ou moins honnêtes peuvent aboutir à une amélioration du bien-être collectif.
C’est précisément aux effets pervers des règlementations que « le droit », tel que conçu en Europe continental, était chargé de réfléchir et de répondre. C’est aussi sur la conscience fondamentale que « trop de droit tue le droit » que le droit continental traditionnel fondait ses préoccupations. C’est enfin sur une conception humaniste dans laquelle l’individu était pris en considération dans son contexte collectif (l’intérêt du groupe étant supérieur aux intérêts individuels ou catégoriels) que le droit continental traditionnel était bâti. Précisions ici que c’est à ces préoccupations que répondaient les rédacteurs du Code civil de 1804. Ce Code était conçu dans la droite ligne des anciennes « codifications régionales », sa seule innovation fut dans la centralisation qui s’opérait désormais au niveau de l’État et non plus à celui des régions.
Cette conception du droit est en voie de disparition rapide depuis que le principe de domination capitalistique, notamment représenté par le concept de « propriété économique », inhérente à la règlementation anglo-saxonne est peu à peu venu remplacer le droit continental traditionnel. Aujourd’hui, avec les « modernisations » successives du « droit », nous assistons au phénomène selon lequel les principes du droit civil ne sont plus le « droit commun ». Le Code de commerce conçu en 1807 comme un droit d’exception est aujourd’hui devenu, sans le dire, le véritable droit commun applicable à la collectivité politique. L’inversion du sens des institutions politiques se double d’une inversion profonde des valeurs qui s’imposent à la collectivité.
Quant à l’avenir : mes deux livres (« La nouvelle entreprise » et « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie »), les articles que j’écris (que le Saker Francophone à l’extrême amabilité de diffuser), les émissions et conférences que je donne sont le cœur de mon travail ; je le continuerai dans la mesure du possible. Il reste très important de diffuser ces informations et analyses afin de faire réellement bouger les lignes de force sociales. L’objectif est de réconcilier les habitants, de rétablir une coopération entre les gens qui représentent des tendances idéologiques différentes ou adverses. Car les divisions sociales, savamment entretenues depuis trop longtemps, ont pour effet direct et indirect de pérenniser la domination des banquiers-commerçants.
SF – Merci Mme Bugault
Notes
1-Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_24_juillet_1867_sur_... ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64790264.texteImage ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64790264.texteImage
2-Cf. « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie », co-écrit avec Jean Rémy, publié en juin 2017 aux éditions Sigest
3-cf. http://lesakerfrancophone.fr/de-nouvelles-institutions-po...



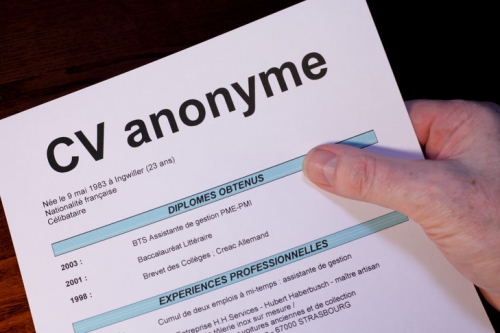


 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg








