samedi, 16 janvier 2021
Les suprémacistes aiment la fiction

Les suprémacistes aiment la fiction
par
Comment trois romans signés Jean Raspail, William L. Pierce et Jack London sont plébiscités par la contre-culture suprémaciste.
COMMENT RAISONNENT-ILS ? Un jour, à la Rhumerie, Roland Barthes, en tirant sur son Petit Corona de chez Freeman & Son, jadis sis à 65 Kingsway, Londres, déclara : « Si un jour tout ça disparaissait et qu’il faudrait choisir entre la Théorie de la relativité et la Recherche du temps perdu, je garderais Proust. Avec la Recherche on pourra retrouver Einstein, mais l’inverse c’est douteux ... » Pour saisir cette saillie, il faut se souvenir que Barthes s’était approprié un mot ancien, remis en selle par Michel Foucault – ce mot ? « Mathésis ».

Par « mathésis », Roland Barthes voulait dire que la littérature a des pouvoirs d’apprentissage et de connaissance qui souvent dépassent, et de loin, ce que la science ou les intellectuels peuvent dire du monde.
Une racine indo-européenne remontant à la nuit des temps. En grec ancien le mot dénote apprentissage, instruction, connaissance. Par « mathésis », Barthes voulait dire que la littérature a des pouvoirs d’apprentissage et de connaissance, et d’intellection, qui souvent dépassent, et de loin, ce que la science ou les intellectuels peuvent dire du monde. Un roman peut parler mieux qu’un bouquin d’historien sur une révolution volée au peuple – L’Éducation sentimentale de Flaubert. Mieux révéler de la (dé)colonisation que des mémoires d’universitaire sur l’Algérie – L’Étranger d’Albert Camus. Etc. Cherchez les exemples. On pourra continuer à produire des thèses sur l’URSS : Soljenitsyne a tout dit, et en mieux.
« Mathésis » a partie liée avec la connaissance divinatoire, la mantique (même souche) : la littérature est une forme de divination, elle fait entrevoir ce qui sera, ou pourrait être, ou ne sera pas. Les œuvres de fiction anticipent et font présager du futur car, dixit Platon : « Le dieu a donné la divination à l’homme pour suppléer à la raison. » La fiction supplée aux idées. D’ailleurs cette citation se trouve dans le Timée qui, avec le récit du Critias, donne une narration à mi-chemin entre la science fiction et la politique, la fameuse description d’une société idéale – l’Atlantide. Platon invente là d’un coup à la fois un genre littéraire (le récit dit utopique) et un genre politique (qu’est-ce une société idéale). « Idéale », bref structurée selon une idée testée, car l’Atlantide a existé, dit Platon. Ce n’est pas une fiction mais une réalité qu’il s’agit, politiquement, de rétablir.
Voilà qui nous mène au cœur du sujet : les récits de politique-fiction raciale. Pas tous, seulement ceux qui sont lus, récités et cités maintenant, et qui ont un effet politique de formation, de « mathésis ».
Deux constatations : un, ceux de l’extérieur ne saisissent pas l’importance formatrice de ces récits ou se contentent de les ridiculiser – comme les adversaires du djihad se moquaient des discours et écrits du Califat de l’État islamique. Deux, si l’internationale blanche peut aligner des récits de politique-fiction forts, la gauche radicale (ou flasque), elle, n’a plus rien, et c’est stupéfiant : aucun roman, aucun récit de fiction qui galvanise les troupes. Car dans les années cinquante et soixante la gauche eut sa grande littérature d’action, à la fois hautainement littéraire et les mains dans le cambouis de la pratique : deux ou trois générations de jeunes ont lu les romans de Sartre, Camus, Beauvoir – et ont cru à la Révolution – politique, sociale, sexuelle. En 1968 ils sont passés à deux doigts de la victoire politique immédiate mais force est d’admettre qu’ils ont alors remporté une victoire sur le long terme : l’idéologie régnante et le discours dominant actuels, même dans leur travesti gestionnaire et leur langage hébété, gardent en effet les traits les plus forts de ce qui fut mis en imagination par ces œuvres littéraires prémonitoires, leur « mathésis ».
Or, en catimini, c’est la droite raciale qui a pris le relais. Il existe une littérature qui forme, qui instruit, qui fait apprendre – une « mathésis » blanche, lue et relue à la fois comme mantique, c’est-à-dire par son pouvoir de prémonition, et comme une pratique, c’est-à-dire de quasi manuels de rébellion. Trois romans : Le Camp des saints de Jean Raspail (1973), Les Carnets de Turner d’Andrew Macdonald (nom de plume de William L. Pierce) (1978) et Le Talon de fer de Jack London (1908). On a là un « dispositif » rhétorique (autre notion de Foucault).
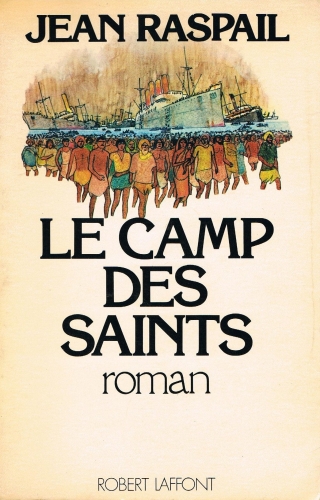
Jean Raspail, une fascination incantatoire
Le Camp des saints est devenu un classique de l’internationale blanche, traduit en de nombreuses langues. C’est un des romans français les plus vendus au monde. Au début des années 1970, Jean Raspail imagina cette invasion de l’Europe depuis l’Inde, et la défaite mondiale de l’Occident, désespérément et inutilement défendue par de rares Justes face à l’holocauste global, et narrée depuis le réduit suisse alors que les « Barbares » montent à l’assaut. En 1972, la loi Pleven contre l’incitation au racisme est votée, le film Avoir vingt ans dans les Aurès sort en salle, le militant maoïste Pierre Overney est assassiné, Le Pen fonde le Front national et la guerre du Viêt-Nam a encore trois ans devant elle avant la déferlante des boat-people (1975-1978). Le roman vient aussi quatre ans après le discours du Britannique Enoch Powell, des « rivières de sang », prémonitoire, selon lui, de la montée de l’immigration du Commonwealth vers le Royaume-Uni et de ses conséquences.
On a dit que c’était une dystopie, mais c’est inexact : contrairement à Orwell dans 1984, Raspail ne décrit pas une société néfaste qui s’installe, un fonctionnement inhumain d’institutions, bref une utopie de malheur, mais l’effondrement d’une société, l’Occident comme on disait alors.
Aucune solution n’est proposée, sauf une, inéluctable, et rapide, celle de la destruction. C’est un livre de politique-fiction, ce n’est pas une utopie politique qui offre la prémonition d’une société idéale à rebâtir. C’est une apocalypse géopolitique sans rachat des péchés – les erreurs politiques ayant conduit à ce génocide des Occidentaux – et sans espoir de renaissance.
Pour les lecteurs de l’internationale blanche actuelle, le roman est lu à travers le calque de la crise récente des réfugiés et de la crise plus ancienne de l’immigration en France. Raspail a pu, adroitement, faire de nouvelles éditions, raboter, expliquer, paraphraser mais une chose est certaine : il ne propose pas un projet politique. Son attrait, général par l’internationale blanche actuelle, est qu’il avertit de ce qui arrivera si aucun « plan » n’est en place pour contrecarrer l’action délétère des gouvernants occidentaux. La fascination qu’exerce le roman est de l’ordre incantatoire : sans « plan », sans préparation, nous sommes perdus – les réseaux suprémacistes parlent de « prepping » : il faut se préparer. Comme l’intrusion au Congrès américain, et toutes ses conséquences, le jour où se tint le vote de certification du scrutin présidentiel (6 et 7 janvier 2021) le réseau Boogaloo sommait ses partisans : « Commencez le maillage, planifiez, préparez-vous. Imprimez des cartes de vos quartiers. Sortez vos kits de survie et entraînez-vous. Ayez des amis sûrs. Au jour fixé vous n’aurez sous votre contrôle que ce que vous aurez préparé. »
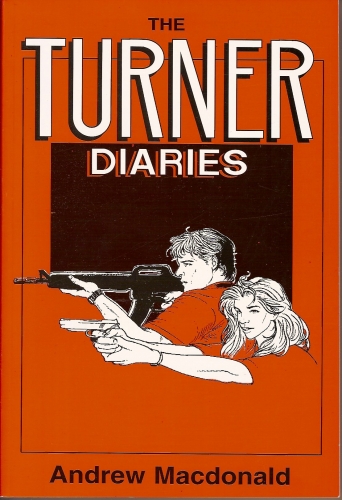
William Luther Pierce III, l’influence suprématiste
Or c’est ici qu’intervient le deuxième roman clef (Roland Barthes parlait de « texte tuteur »), Les Carnets de Turner.
Ce qu’ils offrent est justement un scénario de politique-fiction où ceux qui se sont préparés finissent, après des aventures épiques, par faire triompher leur résistance à la destruction des Blancs par les Noirs téléguidés par les Juifs (le roman fonctionne avec ces trois actants comme on dit en théorie de la narration). Sa structure narrative est cruciale pour comprendre la fascination que ce roman exerce sur la jeune génération des « réalistes raciaux ». Il s’agit de mémoires retrouvés longtemps après le triomphe de l’Organisation (blanche) sur le Système (le gouvernement américain et ses alliés), présentés par un historien de la Grande Révolution – celle-ci fut le résultat de la résistance et de la campagne de terreur menée par l’Organisation et planifiée par son comité central, l’Ordre. Cette insurrection nationaliste blanche, après des revers et des défaites, finira par s’étendre au monde entier, en 2000, par l’éradication de tous les peuples non blancs (Juifs compris). Peu importe son auteur, William Luther Pierce III (1933-2002), un intellectuel et figure éminente du suprématisme blanc américain (l’Alliance nationale), car l’impact intellectuel du roman dépasse le cadre, en réalité assez restreint, de sa propre influence : c’est un cas où les idées passent par une fiction plus que par la propagande de parti, et s’étendent au delà du cercle étroit des fidèles.
Mais les Carnets ne sont pas une utopie : on n’y trouve pratiquement aucune description de l’Organisation et encore moins du fonctionnement de la société née de la Grande Révolution et de l’éradication des races non blanches. Le but du roman est de décrire un processus de « prepping » d’un individu, de sa conscientisation d’homme blanc, de sa préparation à l’action et de son passage à la résistance, y compris avec l’aveu de ses faiblesses : non seulement le roman est centré sur un actant principal, le héros, Turner, mais c’est lui-même qui raconte, à la première personne, ce qu’il a vu et fait. En d’autres termes c’est l’individu en action qui est placé au premier plan, avec forces et défauts, non pas un chef charismatique, mais un fantassin, de base. Le roman, outre qu’il est bien écrit et bien structuré, offre donc à lire l’histoire d’une résistance réussie à l’oppression vue de la base, d’où sa force d’identification et le succès qu’il rencontre depuis.
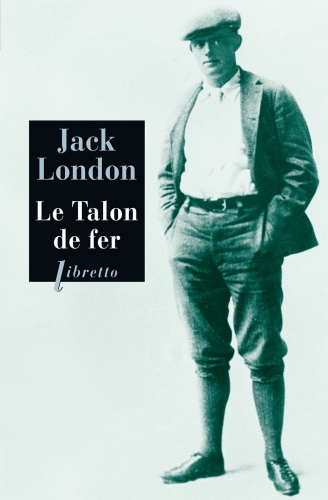
Jack London, le levier anticapitaliste et anti-élites
Mais le Système, l’ennemi des Carnets ? C’est ici qu’intervient le troisième texte tuteur, le roman plus ancien de Jack London, Le Talon de fer. Le livre est le récit, consigné dans un manuscrit miraculeusement retrouvé sept siècles après les évènements, d’une insurrection « fraternelle » suivie de trois autres « Révoltes » étalées sur trois siècles, « toutes noyées dans le sang, avant que le mouvement mondial du travail ne s’épanouisse ». Trotsky en donne ce résumé fulgurant en 1937 : « Dans son tableau de l’avenir il ne laisse absolument rien subsister de la démocratie et du progrès pacifique. Au-dessus de la masse des déshérités s’élèvent les castes de l’aristocratie ouvrière, de l’armée prétorienne, de l’appareil policier omniprésent et, couronnant l’édifice, de l’oligarchie financière. »
Le récit est une dystopie : on y découvre une société « idéale », c’est-à-dire, selon l’idée que décrit assez justement Trotsky, d’une oligarchie financière dans ce qu’il nomme, à tort ou à raison, écrivant en 1937, un régime fasciste. Le héros n’est pas le narrateur mais sa femme, issue de cette oligarchie. En quoi ce récit de politique fiction est-il le troisième élément du dispositif rhétorique ? De quoi est-il persuasif ? Premièrement du fait que, pour les lecteurs de l’internationale blanche, il ne décrit pas une société fasciste, justement, mais la société actuelle. La phrase de Trotsky est aisément traduisible : au dessus de la masse des Blancs dont on a annulé l’héritage s’élèvent les élites, à savoir les syndicats, les forces de l’ordre, un système omniprésent de contrôle et, au sommet, l’oligarchie de la finance. Il manque les médias mais ne font-ils pas partie de l’appareil idéologique de la superstructure, cet Überbau, cet édifice, terme marxiste employé par Trotsky à juste escient ? Or, deuxièmement, la nouvelle idéologie raciale blanche, suprémaciste ou non, est anticapitaliste ou anti-élites car, à ses yeux, elles sont les leviers du « cosmopolitisme » qui opère un gommage forcené des différences culturelles et biologiques entre les races afin d’optimiser les flux marchands et les flux de main d’œuvre de l’internationalisme marchand. Troisièmement, l’« oligarchie » dissimule la dureté de ses opérations sous les labels lénifiants de diversité, proximité, solidarité, vivre ensemble – une rhétorique de l’asservissement consenti de « déshérités ». Ce qu’offre donc Le Talon de fer c’est une description de ce qu’est le « Système » auquel Les Carnets de Turner font allusion, mais ne décrivent pas. Les deux romans s’emboîtent.
Pour résumer, ces trois romans forment une « mathésis », une construction prémonitoire du monde qui anime la jeune génération de « réalistes raciaux », « nationalistes blancs » ou « suprémacistes ». L’influence de ces récits de fiction tient donc à la fois à leur contenu et à la manière dont les trois romans se soutiennent les uns les autres pour former un cadre intellectuel – au sens où la passion qui anime ces récits porte une interprétation des faits et une intelligence des enjeux. Ce sont les trois fictions clefs qui nourrissent, par toutes sortes de réseaux parfois extrêmes, un plan de prise de conscience de l’identité blanche et de préparation à une prise éventuelle du pouvoir. Puissance potentielle de la fiction.
00:45 Publié dans Actualité, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : suprémacistes, fiction, littérature, lettres, lettres françaises, lettres américaines, littérature américaine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


