vendredi, 25 juillet 2025
La fable chrétienne et le mythe

La fable chrétienne et le mythe
Claude Bourrinet
Le christianisme, issu du judaïsme, n'était pas armé conceptuellement, pour comprendre le paganisme. C'est un truisme. Il n'est qu'à lire par exemple La Cité de Dieu, de Saint Augustin, pour constater que l'évêque d'Hippone ne saisissait pas la complexité polysémique et pluridimensionnelle, de la Weltanschauung gréco-romaine. Le lien religieux, au tournant du 5ème siècle, tant du reste chez les chrétiens, que chez les néoplatoniciens, se résolvait en une relation morale entre l’existence et Dieu, relation justifiée par le suprahumain, qui porte sens. Toute la traduction de l'histoire de l'empire romain pivote autour de la question nodale de la vertu – non au sens antique de valeur, de force éthique, mais dans l'acception que le terme a fini par prendre, de probité, d'honnêteté, de décence, de pureté, bref, de convenance avec le Bien en soi. Pour autant, Augustin a beau jeu de souligner combien l'élite romaine usait de cette manière de juger la religion en critiquant l' « immoralité » des dieux du panthéon. Il note ce jugement chez un Pline l'Ancien, par exemple. En vérité, l'épistémè « païenne » correspondait, de facto, à celle des chrétiens, en cette fin du paganisme, c’est-à-dire à partir du triomphe de Constantin. Il existait de nombreux ponts entre le monde nouveau et le monde ancien.

Quoi qu'il en soit, le rationalisme occidental, même quand il fut antichrétien, partagea ce mépris pour les « superstitions » païennes, y voyant, au mieux, un divertissement pour écoliers ahanant sur des exercices latins ou grecs, au pire, des contes pour les paysans arriérés, voire de la sorcellerie. Christianisme et scientisme sont tombés d'accord pour conférer au polythéisme un rang civilisationnel inférieur, puéril, dans la longue marche de l'humanité, qui doit aboutir au nettoyage de toutes les impuretés irrationnelles dans la vie, comme dans la cité. De là, par exemple, la répulsion pour le panthéon fourmillant de dieux grands ou petits de l'Hindouisme, ou bien, paradoxalement, a contrario, l'attirance irrésistible pour lui de la part d'Occidentaux las de trop de rationalisme.
L'accord entre christianisme et rationalisme modernes s'est aussi effectué sur un terrain commun, celui de l'Histoire. Pour les Juifs et les Chrétiens, la Bible, longtemps, a conté des faits datés, et prétendument avérés. On évaluait, sous l'Ancien Régime, l'histoire humaine, à quelque six mille ans. Je passe les détails chronologiques, en ce qui concerne la durée qui était censée nous séparer de la Création, mais le comput très compliqué qui était pratiqué en cette matière était sujet à débats. Toujours est-il que la conception commune avait pour socle la véracité des faits contés. Il ne faisait guère de doute que David eut existé, qu'il fut roi de Jérusalem, et que la Ville sainte fut une cité riche et resplendissante (ce que, maintenant, les archéologues contestent), et que Jésus ressuscita le troisième jour de sa crucifixion.
Il est vrai que l'Eglise actuelle évite de s'appesantir sur les miracles, très nombreux dans le Nouvel Evangile, sauf à y voir des allégories. On ne met pas expressément en doute la transformation de l'eau en vin, mais cette mutation passe pour traduire une métanoïa spirituelle, soit collective, soit individuelle. On se gausse en général qu'une demoiselle se transforme en buisson, ou qu'un gentilhomme malchanceux devienne un cerf dévoré par les chiens de Diane (dont la seule existence supposée suscite le sourire ou la moue méprisante), mais on n'osera pas démentir l'Evangile qui évoque l'exfiltration, par la volonté de Jésus, des démons résidant chez des porcs, ou dans un possédé, et se mettant à galoper comme des lapins.

On ne sortira pas de ces apories si on pose comme postulat l'existence d'un seul et unique mode de perception et d'interprétation, de fait tributaire de la valeur que l'on accorde à des traditions religieuses. Pour un chrétien, que la Vierge lui apparaisse soudainement fait partie des choses possibles. D'innombrables cas de cette espèce en attestent la réalité. En revanche, le païen, qui vivait en adéquation constante, dans sa vie quotidienne ou dans ses actions politiques, avec les dieux de la cité, aurait bien été surpris si Zeus lui fût apparu au détour d'un chemin, bien qu'une telle situation ne fût pas rare dans les mythes.

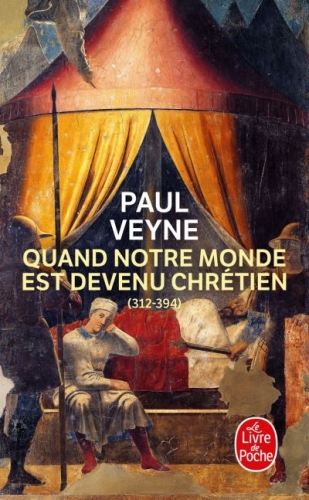
Paul Veyne s'est demandé si les Anciens « croyaient » à leurs mythes. C'est en fait une question qui n'appartient qu'à un monde où la « foi » est devenue le fondement du lien religieux. Les païens n'avaient pas la « foi » (qui est une adhésion toute subjective), mais considéraient que le monde, qui était bien fait, avait été compartimenté en plusieurs domaines, et que les dieux avaient le leur, comme les hommes, ou les animaux, et que, parfois, il pouvait y avoir des passerelles. Mais ce cadre était pour ainsi dire « objectif », et tenait le cosmos, à la suite de quoi les rites étaient bien utiles pour cimenter le tout.
Il se peut en outre que les quatre Evangiles, pour ne pas parler de l’Ancien Testament, qui, somme toute, appartient à la même catégorie littéraire, soit le prototype de tout roman moderne. La fiction contemporaine, dont l’on peut dater la naissance au 12ème siècle, avec les récits de la « matière de Bretagne », passe conventionnellement pour transcrire la réalité (qu’elle soit « réaliste », ou « fantastique », l’essentiel étant qu’elle soit « vraisemblable », c’est-à-dire respectant les codes du genre), et ce, à partir d’un protocole psychologique de lecture, d’un « pacte », selon lesquels il va de soi, durant le procès de lecture, et même après, comme une traînée atmosphérique, que ce qui est raconté est « vrai ». Quand on lit un roman de Chrétien de Troyes, les fées sont aussi chargées de réalité que la locomotive de La Bête humaine, de Zola. La prise de distance critique relève d’une autre dimension de l’existence, comme le monde profane est séparé du monde de la sacralité. Le roman est du « mentir-vrai ». Il arrive même que les faits racontés émeuvent davantage que les faits vécus dans la vie vernaculaire. Julien Sorel est plus vivant que mon voisin.
Or, tout se passe comme si les Evangiles proposaient ce genre de « pacte ». On présente comme une « preuve » de la résurrection du Christ, non seulement le témoignage de femmes, mais aussi, entre autres, le fait que Thomas, le sceptique, soit convaincu (et nous avec) de la réalité christique par l’acte de toucher les plaies de Jésus. Le croyant naïf se satisfait de cette démonstration, et l’Église aussi, en l’érigeant comme l’archétype de l’attestation indiscutable, témoignage pourtant qui ne dépasse pas les bornes de ce qui est raconté-lu, de la « legenda ». Il aurait fallu un témoignage contemporain qui ne fût pas celui d’un chrétien. Et encore ! Tous les historiens actuels d’un temps aussi reculés (et même plus proche de nous) savent combien il est difficile de « prouver » la réalité d’un fait, et même chez les meilleurs historiens de ces époques, comme Tacite, Suétone etc. Ce n’est qu’en recoupant les témoignages que l’on peut donner quelque crédit à une assertion. Bref, le croyant fait du bovarysme, en accordant pleinement, avec tout son coeur, la confiance à un récit qui n’a aucune valeur historique.

Le christianisme, néanmoins, a pu bénéficier d’un doute favorable, parce qu’il est une religion de l’Histoire, et qu’il a appuyé son eschatologie et ses révolutions internes (par exemple, le césaropapisme, ou bien le papisme de Grégoire VII - icône, ci-dessus), sur l’Histoire des hommes. Dans les Evangiles, d’ailleurs, combien de fois se soucie-t-on d’inscrire la geste de Jésus dans la réalité de la société juive de l’époque ! La religion du Christ est une spiritualité qui ne peut que reposer sur des faits qui ne reviennent jamais. Ce qui est fait, est fait. C’est une force, mais aussi une faiblesse, si ces « faits » sont mis en doute.
Mais quand les sciences du temps long, le naturalisme, la zoologie, la paléontologie, la géologie, les sciences de la préhistoire et de la longue durée, au 19ème siècle, se sont imposées, il y eut un conflit violent entre cette vision diachronique de l’évolution des espèces, de la nature, et ce qui est proposé dans la Bible, surtout vétérotestamentaire. En reculant indéfiniment l’âge du monde, et l’apparition de l’homme, on mit en cause les « vérités » bibliques. L’Église anglicane, notamment par la voix de W. Buckland, tenta de faire la part du diable, en récupérant certaines découvertes, comme les fossiles d’animaux plus ou moins géants, enfouis dans les strates profondes de la terre, en affirmant qu’il s’agissait de bêtes noyées par le Déluge. Mais la Genèse ne pouvait être inscrite dans le grand Récit positiviste de la science de la Terre et des espèces. Le singe taquinait Adam et Eve.
Le christianisme, en prétendant être en adéquation avec l’histoire positive, refusait le mythe, contrairement au paganisme. Pour lui, le mythe, la « fable », le « mythos », c’est du mensonge. Qu’Europe soit enlevée par Zeus transformé en Taureau blanc, c’est une fabulation. Qu’Adam et Eve ait croqué le fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, et que le Serpent leur ait suggéré de devenir des dieux, c’est ce qui arriva vraiment. Que Prométhée ait volé le feu à Zeus, et qu’il en ait été puni en étant attaché au mont Caucase, son foie dévoré éternellement par un vautour, c’est de la fable d’ivrogne.

Le mythe, faut-il le rappeler, est un récit (mythos) expliquant pourquoi les choses sont comme cela. En quelque sorte, il fait concurrence à la démonstration scientifique, mais en se déroulant sur un autre mode, celui de l’imaginaire. Il n’en est pas moins aussi efficace. Les hommes, durant un temps immense, peut-être 99 % de leur existence en tant qu’hommes, ont construit leur vie sur des visions mythiques. Ils le font encore. Mais ces mythes, pour autant qu’ils donnaient du sens aux actions, à la vie, se situaient « in illo tempore », en ce temps-là, comme on dit dans les contes. Ils étaient « vrais », mais en même temps, ils appartenaient à une dimension qui était celle des dieux, ou à un âge où ceux-ci étaient très présents.
En refusant la légitimité du mythe, en alléguant une véracité historique pleinement qu’il ne pouvait avoir, le christianisme s’est condamné à entrer violemment et frontalement en conflit avec les sciences du temps. Il n’allait pas en sortir indemne. En revanche, le paganisme, qui a toujours distingué des ordres innombrables de réalité, peut gérer des contradictions, qui n’en sont pas, car elles relèvent de la multiplicité des états d’être. L’unilatéralité, l’intolérance, la réduction du champ d’interprétation de l’histoire humaine ou naturelle, qui marquent le judaïsme et ses avatars, les condamnent au sort du chêne orgueilleux et rigide brisé par la tempête, tandis que le roseau plie, mais ne rompt pas.
12:11 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, religion, christianisme, paganisme, mythologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.