lundi, 21 janvier 2008
Over Oswald Spengler (NL)

TEKOS:
Over de actualiteit van Oswald SPENGLER
De Duitse denker Oswald Spengler (1880-1936) weet al vanaf de Eerste Wereldoorlog conservatieve cultuurcritici te inspireren. Tegenwoordig wordt hij zelfs als "groene" onheilsprofeet omarmd. Het oude Europa is gevoeliger voor cultuurpessimisme dan voor het "vooruitgangsgeloof", schrijft de germanist Jerker Spits.
De oude dame Europa lijkt om de zoveel jaren vatbaar voor de koorts van het cultuurpessimisme. Ook nu weer is er sprake van een herleving. Hedendaagse conservatieve denkers mogen daarbij graag teruggrijpen op de Duitse filosoof Oswald Spengler, die als geen ander verlangde naar een herstel van oude tradities die in de moderne maatschappij verloren waren gegaan.
In zijn jonge jaren was Oswald Spengler een romanticus. Maar zoals veel Duitse dichters en denkers ontwaakte hij aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. "Ik verbaas me er nog steeds over", zou hij later schrijven, "hoe ik tot mijn vijfentwintigste in een droom leefde. Hulpeloos, angstig, maar toch gelukkig. Wat heb ik toen niet allemaal opgeschreven!"
Na de oorlog eiste Spengler van zijn land een radicale en meedogenloze aanpassing aan de rationele, technische tijd. Hij treurde niet langer om wat verloren ging. De mens moest de nieuwe krachten van zijn tijd omarmen. Vanaf zijn dertigste zou hij zijn tijdgenoten provoceren met een loflied op de techniek. "Voor de prachtige, zeer intellectuele vormen van een snel stoomschip of een staalfabriek geef ik alle rommel van de huidige kunstnijverheid inclusief schilderkunst en architectuur weg.”
Spengler leefde als privégeleerde in München. Hij meed de artistieke kringen van de Beierse hoofdstad. Zijn zelfgekozen isolement en afkeer van de Münchense bohémien is opmerkelijk als je bedenkt welke grootheden zich daar in die tijd ophielden: de schrijvers Thomas en Heinrich Mann, de dichters Stefan George en Rainer Maria Rilke, de kunstenaars Alfred Kubin, Franz von Stuck, Wassily Kandinsky, Paul Klee. Maar geen van hen beschouwde Spengler als zijn gelijke. Ook in Thomas Mann zag Spengler een decadente romanticus, een kunstenaar die niet met zijn tijd was meegegaan. Werk ging bij hem sowieso voor vriendschap. In de gedachtenwisseling met artistieke tijdgenoten was hij niet bijzonder geïnteresseerd. Ik spreek nog liever met een meisje dat ik van de straat pluk, dan met die kunstenaarsbende.”
 Spengler vereenzaamde, al wekten verspreid verschenen voorstudies van zijn nieuwe boek "Der Untergang des Abendlandes" veel belangstelling. In dit magnum opus wilde hij alle grote vragen van zijn tijd beantwoorden. Naar eigen zeggen ging het in "Der Untergang" om de natuurlijke, door allen donker voorvoelde filosofie van deze tijd. Wiskunde, oorlog, Rembrandt, poëzie, taal – in Spenglers ogen smolt de wereldgeschiedenis samen. Hij zag daarin een eeuwige Gestaltung en Umgestaltung, een wonderbaarlijk worden en vergaan van organische vormen. Culturen, levende wezens van de hoogste orde, groeien in een verheven doelloosheid op zoals bloemen op een veld. Ze behoren net als planten en dieren tot de levendige natuur.”
Spengler vereenzaamde, al wekten verspreid verschenen voorstudies van zijn nieuwe boek "Der Untergang des Abendlandes" veel belangstelling. In dit magnum opus wilde hij alle grote vragen van zijn tijd beantwoorden. Naar eigen zeggen ging het in "Der Untergang" om de natuurlijke, door allen donker voorvoelde filosofie van deze tijd. Wiskunde, oorlog, Rembrandt, poëzie, taal – in Spenglers ogen smolt de wereldgeschiedenis samen. Hij zag daarin een eeuwige Gestaltung en Umgestaltung, een wonderbaarlijk worden en vergaan van organische vormen. Culturen, levende wezens van de hoogste orde, groeien in een verheven doelloosheid op zoals bloemen op een veld. Ze behoren net als planten en dieren tot de levendige natuur.”
De mens moest volgens hem zijn leven aanpassen aan de ontwikkelingsfase van de cultuur. De belangen van het individu waren ondergeschikt aan het collectief waartoe hij behoorde.
"Der Untergang" gaat uit van het onderscheid tussen Kultur en Zivilisation. Spengler volgde hierin een specifiek Duitse traditie die sinds het einde van de negentiende eeuw vorm had gekregen. In de Eerste Wereldoorlog zagen jonge Duitsers zich als de verdedigers van de "ideeën van 1914" – de cultuur. Zij verdedigden die tegenover de "ideeën van 1789" – de civilisatie. Duitsland moest naast een oorlog ook een geestelijke strijd voeren: tegen Russische barbaren in het Oosten en tegen materialisme en winstdenken in het Westen. Duitsland zou het Westen moeten redden van de Angelsaksische kruideniersgeest en ontspoorde vrijheid. De "civilisatie" van langs elkaar levende individuen stond tegenover de "cultuur" waarin de mens de band met de gemeenschap, het verleden en de eigen natie levend houdt.
Spengler was verklaard tegenstander van de Zivilisation. Kwantiteit zou het daarin afleggen van kwaliteit. De Gemeinschaft zou plaats maken voor de Gesellschaft. De mens zou een "intellectuele nomade" worden, omdat hij niet langer leefde in het besef onderdeel van een gemeenschap te zijn.
Dit wereldbeeld was in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog niet ongewoon. Ook Thomas Mann verklaarde in zijn "Betrachtungen eines Unpolitischen" (1918) dat democratie, politiek zelf "het Duitse wezen" vreemd is. Mann schreef "De Duitse aard, dat is cultuur, ziel, vrijheid en niet civilisatie, maatschappij, stemrecht, literatuur." Later schreef de Nobelprijswinnaar niet zonder ironie: De overwinning van Engeland en Amerika bezegelt en beëindigt het lot van onze ouder wordende cultuur. Wat nu volgt, is de Angelsaksische wereldheerschappij, dat betekent de volmaakte civilisatie. Waarom niet? Men kan er comfortabel in leven.”
Maar niet iedereen kon deze stap nemen. Het Duitse Bildungsbürgertum klampte zich vast aan de Duitse Kultur – en vond in Spengler zijn intellectuele leidsman.
Oswald Spengler was overtuigd van zijn missie. Ik had als kind al het idee dat ik een soort van Messias moest worden. Een nieuwe zonnereligie stichten, een nieuw Duitsland, een nieuwe Weltanschauung.” Van valse bescheidenheid had Spengler geen last: Ik schrijf het beste Duits, dat op dit moment in boeken te lezen is.”
In zijn brieven en dagboekaantekeningen lijkt hij zijn grote voorbeeld Friedrich Nietzsche naar de kroon te willen steken. En net als zijn voornaamste inspirator werd Spengler geplaagd door langdurige depressies. Niemand weet wat het betekent met zulke ideeën te vechten, waarvan de bittere ernst de zelfmoord dichterbij brengt, dagenlang geen woord te spreken, geen ander mens te zien. En dan, in de uiterste terneergeslagenheid, wijn, muziek of een paar schrijvers (Shakespeare, Baudelaire, Hoffmann) te hebben. Wat heb ik door die eenzaamheid niet verloren! Hoeveel energie, die ik anders aan andere dingen had kunnen besteden!”
Toen het eerste deel van "Der Untergang des Abendlandes" in 1918 verscheen, raakte intellectueel Duitsland in Spenglers ban. Alle belangrijke Duitse intellectuelen namen kennis van het boek. Thomas Mann prees het in de hoogste bewoordingen. De filosoof Georg Simmel noemde het de belangrijkste geschiedenis van de filosofie sinds Hegel”. Kritiek was er uit de hoek van egyptologen en oriëntalisten die zich beklaagden over onnauwkeurigheden in Spenglers beschrijving van de wereldgeschiedenis. Maar de honderdduizenden lezers schoven deze professorale kritiek spottend terzijde. Het ging hen niet om de verschillen tussen de vijfde en zesde Egyptische dynastie.
Het Duitse Bildungsbürgertum had omstreeks 1920 het idee dat er na Goethe, Schiller en Nietzsche een verval was ingetreden. In de ogen van veel lezers was er geen andere auteur dan Oswald Spengler die dit zo treffend wist te verwoorden. Al snel werden hem leerstoelen aangeboden. Spengler wees deze handreikingen vriendelijk maar beslist af. Hij wilde geen gewone geleerde zijn. Intellectuele vrijheid ging bij hem boven maatschappelijke status. Bovendien verafschuwde Spengler de academische filosofie van zijn tijd haast net zo hevig als Schopenhauer dit een eeuw voor hem had gedaan. "Filosofische vakwetenschap is filosofische onzin.”
Veel lezers duidden Spenglers boek als een schets van de ondergang van de westerse wereld. Alsof Spengler vol nostalgie zou hebben teruggeblikt op verloren erfgoed. Maar van deze romantische visie wilde Spengler na de Eerste Wereldoorlog juist afscheid nemen.
In de jaren twintig vroeg een rijke Duitse Spengler om raad: waar moest zij, nu de westerse wereld spoedig zou ondergaan, haar aandelen onderbrengen? Al in 1921 klaagde Spengler over het modewoord ’ondergang’ als gevolg van zijn titelkeuze. (Het is veelzeggend dat het woord ontbreekt in de oorspronkelijke titel van het werk: "Konservativ und liberal".) Hij schreef immers niet alleen over wat verdween, maar ook over wat nieuw was en de toekomst zou bepalen.
Spengler zag de wereld om hem heen veranderen. Bildung, geestelijke aristocratie en esthetische fijnzinnigheid verdwenen in een maatschappij die voor de wetten van de markt boog. De mens, het door Goethe en Humboldt geprezen vrije en zelfbewuste individu, ging op in de massa, werd gereduceerd tot consument en arbeidskracht.
Tussen de werkelijkheid van alledag en de idealen van de Duitse gymnasia gaapte volgens Spengler een onoverbrugbare kloof. De opkomst van de massamaatschappij, de groeiende rol van volkse sentimenten baarden hem zorgen. De moderne massamedia zouden de mens een illusie van vrijheid geven, maar hem in werkelijkheid op geraffineerde wijze tot slaaf maken. Eens durfde men niet vrij te denken; nu mag men het, maar kan het niet meer.”
Niet zonder reden wordt Oscar Spengler wel beschouwd als een van de "geestelijke wegbereiders" van het nationaal-socialisme. Daarmee deelde hij immers de afkeer van de slappe Weimarrepubliek en de voorliefde voor het krachtige Pruisendom. Maar vrijwel onmiddellijk na de machtsovername van Hitler in 1933 viel de filosoof in ongenade. En ook Spengler zelf nam al snel afstand van het nieuwe regime, in zijn boek "Jahre der Entscheidung". Wat de nationaal-socialisten bovenal in Spengler hinderde was zijn afwijzing van ieder vooruitgangsidealisme. Het gevolg was dat zijn boeken en denkbeelden niet meer in het openbaar genoemd mochten worden.
Zijn ster verbleekte. Op 8 mei 1936, kort voor zijn 56ste verjaardag, stierf hij aan een hartaanval. Na 1945 raakte de filosoof meer en meer in vergetelheid.
In de optimistische jaren negentig, na de val van het communisme, leek de ondergang van het Avondland verder weg dan ooit. Francis Fukuyama voorspelde in "Het einde van de geschiedenis" de verdere zegetocht van de westerse democratie en het liberalisme.
Na 11 september 2001 kwam hier verandering in. Er bleken andere culturen die de westerse hegemonie betwistten. En in het Avondland zelf ging de aandacht steeds meer uit naar de schaduwzijden van de massademocratie. Mondigheid zou zijn ontaard in brutaliteit en schaamteloosheid, het ter discussie stellen van autoriteit zou burgers hebben wijsgemaakt dat regels altijd en overal moeten worden aangevochten, de "massacultuur" zou de democratie "verzwelgen".
Het werk van Spengler werd langzaam herontdekt. Ook onder hedendaagse cultuurfilosofen leeft kritiek op de massacultuur, op de genivelleerde maatschappij, waarin de meerderheid niet alleen beslist over de zetels in het parlement, maar ook over de collectieve moraal. En je hoeft Spenglers antwoorden – een vlucht naar voren, de "roofdiermens" als de enig mogelijk overgebleven "hogere" vorm van leven – niet te beamen om de geldigheid van zijn tijdsdiagnose te onderkennen.
Een groeiend aantal intellectuelen staat wantrouwend tegenover de wil en de smaak van de massa. Zij richten hun pijlen op de mondiale "gelijkschakeling". Overal verschijnen dezelfde merken, dezelfde levensstijlen, eenzelfde vrijgevochten manier van denken, verdwijnen tradities ten gunste van geldelijk gewin of persoonlijke geldingsdrang.
De Nederlandse filosoof Ad Verbrugge spreekt in zijn bestseller "Tijd van onbehagen" in vergelijkbare termen als Spengler over de schaduwzijden van globalisering en de ongeremde werking van de vrije markt. Soms met nogal overtrokken commentaar. Zo is de huidige liberale consumptiemaatschappij volgens Verbrugge even totalitair als het fascisme en het communisme”.
Ook voor de Franse filosoof Alain Finkielkraut is de moderne massacultuur gespeend van alle grote gedachten – een geestelijk barbarendom, maar burgerlijk en comfortabel ingericht, zoals Spengler het al beschreef. De waarschuwende roep van Spengler is eveneens bij Finkielkraut hoorbaar: nog teert het Westen op zijn rijke verleden, maar eens zal de beschaving, als zij niet door haar culturele elite verdedigd wordt, onder daverend geruis ineenstorten. Dankbaar grijpt Finkielkraut de plunderingen van jonge Arabieren in de Parijse voorsteden aan: de barbaren staan aan de poorten van de stad.
Sommigen zien in deze conservatief geïnspireerde cultuurkritiek een terugkeer naar riskante denkpatronen en een hang naar obscurantisme. Zij bekritiseren de hang naar traditie, naar oude zekerheden, de revitalisering van het christelijk geloof, de terugkeer naar het denken over geschiedenis als "heilsgeschiedenis".
En de affiniteit met Spenglers tijdsdiagnose blijft geenszins beperkt tot conservatieve denkers. Al in 1997 haalde De Groene Amsterdammer Spengler van zolder, om te waarschuwen tegen een "pulpdemocratie" waarin "de emoties van de massa regeren". De banvloek die progressieve intellectuelen na de Tweede Wereldoorlog over Duitse denkers uitspraken, is gebroken. Ook in Duitsland zelf is er sprake van een hernieuwde belangstelling voor Spengler, onder wetenschappers én bij filosofen als Peter Sloterdijk.
De laatste jaren wordt Spengler ook gezien als een ’groene’ onheilsprofeet avant la lettre. Voorzag hij niet al in 1918 de "ondergang" van onze leefomgeving, waarschuwde hij dus eigenlijk niet al voor de opwarming van de aarde en de gekkekoeienziekte? De receptie van zijn werk is daarmee terug bij af. Hij is niet meer dan de leverancier van een trefwoord waaraan je je eigen angsten kunt verbinden.
Toch blijft Spengler een ongemakkelijk denker. Vooral zijn instinctieve afkeer van het verstand is problematisch. Hij enthousiasmeert en vervoert méér dan dat hij overtuigt. Spengler was een metafysicus en zag zichzelf als dichter-filosoof. Hij hechtte meer waarde aan een esthetische blik dan aan strenge logica. Tijdgenoten zagen in hem niet ten onrechte een nieuwe Nietzsche, met alle gevaren van dien.
Als een van de eerste Europese filosofen richtte Spengler zijn blik op niet-westerse culturen en voorspelde hun opkomst. Maar voor de steeds belangrijker rol van Amerika bleef hij blind. Hij voorzag niet dat uitgerekend de door hem zo verafschuwde massademocratie en vrije markt een wereldmacht zou voortbrengen.
Johan Huizinga merkte al op dat het Angelsaksische deel van de wereld slechts in geringe mate gevoelig is voor ondergangsfantasieën. Ook nu lijkt het oude Europa gevoeliger voor een spengleriaans cultuurpessimisme dan voor een vooruitgangsgeloof zoals dit door Fukuyama werd uitgedragen en door de huidige Amerikaanse president wordt gekoesterd. Aan de horizon van George W. Bush gloort een universele civilisatie naar Amerikaans model.
Fukuyama schijnt intussen zijn bekomst te hebben gekregen van het neoconservatieve geloof van zijn president. Zijn verre Duitse voorganger was er al langer van overtuigd dat alleen opkomst en ondergang werkelijk bestaan. Wie een keer over het Forum van Rome heeft gewandeld, moet beseffen dat het geloof in een eeuwig voordurende vooruitgang een waanbeeld is”.
De Nederlandse schrijver en essayist Menno ter Braak (1902-1940) bezocht in maart 1935 een lezing van Oswald Spengler aan de Leidse universiteit. De zaal zat "propvol". Men was dus gekomen om Oswald Spengler te zien, meer nog dan om hem te horen waarschijnlijk. Het zijn vaak de philosophen van de heroische ondergang der cultuur, die het meeste publiek trekken, omdat zij profeteren.” Een briljant spreker was Spengler volgens Ter Braak niet. Hij spreekt zoals zijn gehele uiterlijk is: als een superieure schoolmeester, die zijn publiek iets doceert. Geen enkel effect, ook geen spoor van rhetoriek; bijna onbeweeglijk staat Spengler achter de lessenaar. [...] Even knipperen de oogleden, als er duizend jaar achteloos in de zaal worden geslingerd; een handbeweging is dat niet eens waard.”
Na Spenglers overlijden, een klein jaar later, schrijft Ter Braak: Zijn dood betekent voor Europa het verlies van een onafhankelijke geest, een onverzoenlijke aristocraat van de militaire soort, die zijn verachting voor de massa en de massabijeenkomst [...] eens uitdrukte door de woorden: "Den Neandertaler sieht man in jeder Volksversammlung". Het is dit soort stramme aristocratie, die langzaam maar zeker romantisch wordt en uitsterft. In Spengler beleefde zij een verbintenis met de geest en het aesthetisch raffinement, die vermoedelijk na hem niet vaak meer zal voorkomen.
00:45 Publié dans Hommages, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 20 janvier 2008
Du déclin de l'Europe

Brigitte SOB :
Du déclin de l'Europe : de Nietzsche à Rohrmoser
Les prophètes du déclin restent hautement appréciés. Pour eux, c’est toujours la haute conjoncture. Même les politiciens sont désormais obligés de le concéder : notre culture est frappée d’un processus de décadence inéluctable ; ainsi, par exemple, en Autriche, Jörg Haider avait écrit dans son premier livre politique : la culture, aujourd’hui, sous toutes ses formes, a perdu contenu et limites et chavire dans un « syncrétisme difficile à comprendre ». Haider souffrait-il de voir l’Europe en proie à un déclin culturel, lorsqu’il est devenu un patriote autrichien pétri de conservatisme chrétien (ce qu’il n’était pas auparavant) ?
Le fait est qu’il partage désormais sa souffrance face à la décadence européenne avec un professeur de philosophie allemand, Günter Rohrmoser. Autre fait évident : déjà Nietzsche avait prophétisé l’effondrement de la morale et de la culture. Or, on peut considérer Nietzsche comme le premier représentant de cette « conscience de la crise » au sein de la culture occidentale. Pour Nietzsche, les racines de la crise se situent dans un état de choses clairement observable : l’homme moderne est en face de traditions qui ne cessent de se dissoudre. Par l’irruption dans son quotidien de cultures différentes, cet homme moderne dispose d’une plus vaste marge de manœuvre, peut jouer et composer avec des expériences plus diversifiées, mais, simultanément, cesse d’avoir des liens solides et inébranlables avec sa propre culture, son propre héritage culturel.
Le fondement de l’analyse nietzschéenne du monde contemporain, c’est de constater la dissolution de tous les liens qu’entretenait l’homme avec le monde et son environnement. Nous vivons ainsi dans un « monde en voie d’égalisation », de nivellement : « Comme tous les styles en art se juxtaposent et se répètent, de même tous les degrés et types de morale, de mœurs et de cultures s’alignent les uns à côté des autres. C’est l’ère du nivellement, c’est sa fierté, mais aussi, sa souffrance ». Ce processus est l’avènement d’un relativisme général des valeurs et des cultures, qui, selon Nietzsche, conduit tout droit au nihilisme : les anciennes valeurs culturelles perdent leur fonction liante, la morale s’effondre.
Spengler, plus tard, a partagé cette vision. Après que l’Europe ait accompli ce qu’elle portait en son cœur profond et épuisé toutes ses potentialités, plus aucune avancée n’était possible. Telle est la quintessence de la morphologie culturelle de notre continent. D’après Spengler, une logique de l’histoire est à l’œuvre, qui s’applique à toutes les cultures : toutes subissent la loi organique de la naissance, de la jeunesse, de la maturité et de la mort. Toutes les cultures, sans exception, vivent ces lois de la biologie, explique Spengler. Elles croissent, mûrissent, entrent en déclin et meurent. Vu que la « fin des temps » s’annonce pour l’Occident, l’homo europaeus, selon Spengler, n’a plus qu’une chose à faire : accepter son destin.
Récemment, quelques penseurs chrétiens-conservateurs ont repris cette thématique : dans le débat sur le déclin des valeurs et de la culture, Günter Rohrmoser constate que le christianisme en Europe est entré dans sa phase de crise la plus profonde. Cette crise s’exprime dans le fait que les parents ne sont plus prêts à éduquer leurs enfants selon « les mœurs et les canons chrétiens ». Rohrmoser en déduit le déclin de l’Occident : la crise s’accentuera, l’atomisation interne des sociétés se poursuivra, le déclin de la culture progressera.
Rohrmoser avance la doctrine que la perte de l’éthique chrétienne conduit au déclin de la société et de la culture. Car l’éthique et la morale chrétiennes avaient une signification cardinale non seulement pour la vie de l’individu, mais aussi et surtout constituaient des critères objectifs permettant de mesurer la capacité de survie ou la propension au déclin des peuples, cultures et sociétés. De ce fait, Rohrmoser en appelle à un renouveau spirituel et éthique de facture chrétienne, afin de sauver l’Europe du déclin. Problème : peut-on objectivement mettre sur le même pied le déclin général de l’Europe et le déclin de la foi chrétienne en Europe ? La crise du christianisme est-elle une crise de la culture européenne ? Car, en effet, tout nous permet d’affirmer que, sans le christianisme, l’Europe aurait également connu une éthique constituante de son identité, le terme « éthique » dérivant de la philosophie grecque, païenne et pré-chrétienne.
Cette problématique nous permet de rappeler les thèses de Sigrid Hunke, exprimées dans La vraie religion de l’Europe et dans Vom Untergang des Abendlandes zum Anfang Europas (non traduit ; = «Du déclin de l’Occident à l’avènement de l’Europe »). Sigrid Hunke s’oppose tout aussi bien aux prophètes chrétiens de la fin des temps qu’à l’idéologie américaine du New Age. Pour elle, il faut avant toute chose dépasser la calamité dualiste qui s’est abattue sur l’Europe et que nous ont apporté le christianisme (et la gnose radicale). Le dualisme distingue l’esprit de la matière, l’intelligence et l’émotion, la nature et la raison, introduit une césure radicale entre eux. Alors que l’homme, à l’origine, est essentiellement unité et holicité. Telle est la loi première de l’anthropologie et il faut la restaurer dans tous les domaines de la culture européenne, afin de faire éclore une nouvelle renaissance. C’est dans les ruines des vieilles structures dualistes, au milieu des antagonismes fallacieux et dangereux que le dualisme a provoqués, qu’un développement nouveau germera, dit Hunke, que l’Europe retrouvera son essence et redonnera du sens à l’ensemble de nos peuples.
Qui a raison : Spengler, Hunke, Nietzsche ou Rohrmoser ? Aucun d’eux sans doute. Sans doute la plus grande erreur de la culture européenne a été de se considérer comme absolue. Prétention inimaginable. Hybris ?
Brigitte SOB.
00:20 Publié dans Affaires européennes, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 janvier 2008
Le discours de Peter Sloterdijk à Elmau

Baal MÜLLER:
Une controverse philosophique qui secoue l’Allemagne : le discours de Peter Sloterdijk à Elmau
« Regeln für den Menschenpark » ou « Règle pour le cheptel humain », tel est le titre d’un discours récent du philosophe Peter Sloterdijk. Il a suscité un tollé chez les pleureuses classiques et chez les moralistes auto-proclamés de l’établissement philosophique allemand, qui ont évidemment crié au fascisme. On connaît depuis longtemps l’éthique ( ?) qui sous-tend le discours et le niveau intellectuel ( ?) de ces messieurs-dames et de leurs relais dans les médias. Il faut ajouter que Sloterdijk lui-même avait prévenu ses lecteurs des caquetages et vociférations qu’allaient pousser ces nouvelles oies du Capitole. Il avait préparé ses réponses.
Quoi qu’il en soit, leurs jacassements bruyants et leurs battements d’aile ne suffisent plus, désormais, à clouer le bec et à chasser des médias ceux qui, de temps à autre, ont vraiment quelque chose à dire. Donc, dans l’avenir, quand on évoquera encore le discours tenu en juillet dernier par Sloterdijk à Elmau en Bavière, on ne le fera pas pour contrer les piaillements et jacassements des habituels professeurs de morale, mais pour plonger au cœur de la problématique philosophique qu’il a soulevée.
Déjà, le titre donné par Sloterdijk à son discours est quelque peu trompeur, car il ne nous donne aucune règle à suivre dans le corps de son texte, des règles d’après lesquelles il faudrait organiser le vivre-en-commun de l’humanité. Son objet premier n’est nullement la manipulation du génome humain ; il n’en parle que dans le dernier quart de son allocution. Ensuite, il ne se fait pas du tout le chantre d’un programme de sélection « fasciste » visant à générer un « surhomme », comme croient l’avoir lu quelques-uns de ses adversaires.
Commentaire actuel de la « Lettre sur l’humanisme » de Martin Heidegger
Le discours de Sloterdijk traite de la fonction historique et de l’échec apparent, aujourd’hui, de l’humanisme occidental. Le sous-titre, « Une réponse à la Lettre sur l’humanisme », nous semble plus clair pour préciser son propos. D’une part, il prend position sur la « Lettre sur l’humanisme » que Heidegger avait écrite à Jean Baufret en 1946. Dans ce célèbre écrit, le philosophe de la Forêt Noire constatait l’échec de l’ancien humanisme et énonçait les conditions requises pour le déploiement d’un nouvel humanisme. D’autre part, il prépare ses auditeurs et lecteurs à la métaphore directrice qui traverse l’ensemble de son texte : c’est-à-dire l’idée que les productions de notre tradition culturelle humaniste sont en quelque sorte des lettres, qui, jadis, ont été envoyées à des destinataires inconnus. La connaissance de la teneur de ces « lettres », que chaque génération des castes dirigeantes était appelée à lire, a donné naissance à cette humaniste « république des savants ». La formation progressive des Etats nationaux repose, pour l’essentiel, sur la canonisation de tels textes, visant la production d’un consensus sur ce qui devait être tenu pour important et sur ce qu’il fallait transmettre en priorité aux futures générations, afin de créer une base culturelle pour l’identité nationale : « Outre les auteurs antiques, communs à toute l’Europe, on commence à mobiliser dans cette optique les classiques nationaux et modernes, dont les lettres au public deviennent, via les marchés de livres et les hautes écoles, des leitmotive efficaces dans la création des nations ».
L’utilisation par Sloterdijk du concept de “mobilisation” signale que le processus n’a pas été exempt de certaines contraintes. Certes, les livres sont, d’après Jean-Paul, des lettres simplement plus épaisses que les autres que l’on adresse à des amis encore inconnus ; quant au paradigme de l’amitié, il a été très important pour l’humanisme. Néanmoins, en dépit de ce culte de l’amitié, cette domestication culturelle des peuples est, selon Sloterdijk, quelque peu violente. Les peuples sont organisés comme des « associations d’amitié forcée totalement alphabétisées », qui, « au temps de l’humanité qui est en armes et qui lit ». On proclame simultanément le « service militaire obligatoire » et la « lecture obligatoire des classiques ». Outre cette fondation de l’identité, cette pédagogie a poursuivi un autre but : « L’humanisme en tant que parole et en tant que chose pose toujours une adversité, car il est un engagement qui veut ramener l’homme hors de la barbarie ».
La culture des livres est désormais insuffisante
L’humanisme antique et aussi et surtout les diverses tentatives modernes de forcer sa renaissance sont, pour Sloterdijk, des concepts éducateurs dirigés contre les influences “bestialisantes” et “déchaînantes” des amphithéâtres et des films d’action sanglante, des combats de gladiateurs et des video-clips violents. Pourtant, ce concept éducateur connaît aujourd’hui l’échec. La culture livresque traditionnelle ne peut plus opposer une force suffisamment intégrante et domesticatrice face aux mass-médias et à leur puissance centrifuge : raison pour laquelle, il faut faire des efforts d’un genre nouveau.
La seconde partie du discours de Sloterdijk à Elmau consiste en une réflexion sur le concept heideggerien d’humanisme et conclut que la vision humaniste de l’homme, en tant qu’ anima rationale, est en réalité passée à côté de l’essence spécifique de l’homme ; dès lors, la pédagogie humaniste ne peut plus empêcher l’homme de retomber dans la bestialité et, pire, l’humanisme, quand il dégénère au niveau d’une idéologie à l’emporte-pièce, promeut cette (re)chute de l’homme dans la bestialité.
Sloterdijk, à l’instar de Heidegger, considère que l’homme, est, de par sa constitution, « Lichtung des Seins » (= « Clairière de l’Etre »), ou, pour simplifier, l’homme est le seul être qui peut déployer un rapport de compréhension vis-à-vis du monde, indépendamment de toute formation humaniste. A la différence de Heidegger, pour qui les théories biologiques ou anthropologiques énoncées sur l’homme passent à côté de l’existentialité propre de celui-ci, Sloterdijk croit, en se référant à Platon dans la troisième partie de son discours d’Elmau, à la “pondération” voire à la “circonspection” humaine, qui permet à l’homme, malgré ses origines animales, de se considérer comme le résultat d’une évolution biologique.
Comme « l’éducation, le dressage et l’apaisement de l’homme ne peut à aucun moment s’effectuer par les seuls signes écrits », Sloterdijk soulève la question : l’homme peut-il s’auto-domestiquer via la génétique ? Donc Sloterdijk se place exclusivement dans la perspective de protéger l’homme de lui-même et ne veut nullement fabriquer et dresser des surhommes ; dans cette optique, et dans cette optique seulement, il se demande si, dans l’avenir, il ne serait pas possible de développer une « anthropotechnique » qui optimiserait l’héritage génétique de l’homme ; quoi qu’il en soit, les possibilités scientifiques de le faire existent déjà.
Sloterdijk n’est pas toujours convaincant
On peut penser ce que l’on veut de cette question, mais il me semble qu’il faut en débattre, car cela a du sens et vaut mieux que les sempiternelles rengaines des moralistes et catéchistes habituels. Pour ma part, les assertions de Sloterdijk, prises isolément, ne sont pas toujours convaincantes. Réduire l’humanisme à une lecture des classiques, par exemple, ne m’apparaît pas très sérieux. Ensuite, dire que la pédagogie comme mise en forme et comme instrument du dressage et de la domestication a un statut d’exclusivité, me paraît erroné. Pourquoi diable tous les auteurs “humanistes” n’auraient-ils eu que cela en tête, tandis que seul Heidegger ou Nietzsche se seraient placés en dehors ou au-delà de la tradition humaniste ? Quant à la distinction, opérée par Sloterdijk, entre médias « éducatifs » et médias « déchaînants » me semble par trop schématique, tout comme l’affirmation de ceux qui prétendent par ailleurs que la culture livresque est dépassée tandis que les moyens de communication nouveaux sont l’avenir.
Enfin, on peut mette une autre idée de Sloterdijk en doute : l’éducation de l’homme est-elle vraiment le produit d’une « anthropo-technologie » ? N’est-elle pas plutôt une tâche d’ordre culturel ? On peut dire que certaines caractéristiques humaines souhaitées par la société ne peuvent s’obtenir par des interventions dans l’héritage génétique, car le caractère de l’homme n’est pas l’addition accumulée d’éléments isolés, déterminables génétiquement, mais résulte de l’interaction complexe et imprévisible de facteurs endogènes et exogènes. La plupart des spécificités de l’homme, prises isolément, ne sont en fin de compte ni bonnes ni mauvaises. Au contraire, le contexte de leur substrat génétique, pris dans son ensemble, de même que le déploiement socio-culturel de ce substrat, font en sorte qu’une potentialité caractéristique, d’abord indifférente, se manifeste ultérieurement tantôt comme « conscience de soi » tantôt comme « égoïsme », tantôt comme « adaptabilité » tantôt comme « opportunisme ».
Une réflexion sur la question est nécessaire
Indépendamment du jugement que l’on peut poser sur toute utopie fondée sur les technologies génétiques, sur leur « faisabilité » réelle, sur leur désirabilité ou sur leurs impacts sur les conceptions morales de la société —par exemple nous aurions rapidement de nouvelles interprétations des notions de « prestation » et de « destin »— il nous semble qu’opérer une réflexion, aujourd’hui, sur cette problématique, est nécessaire et légitime. Il nous paraît en revanche totalement aberrant de rejeter ce débat a priori, avec la délicatesse d’un coup de gourdin, et de le réduire à une confrontation entre fascisme et anti-fascisme. Ce ne serait pas une attitude responsable devant la thématique des technologies génétiques. Au contraire, en réduisant le débat à de vulgaires joutes idéologisées et politisées, on laisse le champ libre à toute utilisation irresponsable des technologies génétiques. Il est vrai que la réflexion éthique suit, en clopinant, la technologie nouvelle et ne peut jamais en arrêter le développement ou la prolifération. La seule consolation qui reste, aujourd’hui, à l’éthique, c’est de pouvoir légèrement piloter le déploiement de cette technologie dans la société et d’influencer la conscience de ceux qui l’utilisent. Mais vouloir empêcher avec la véhémence habituelle le débat sur les technologies génétiques est une attitude qui doit être combattue inconditionnellement, surtout si une telle tentative émane des vertueux auto-proclamés qui prétendent incarner la « théorie critique » pour masquer leur autoritarisme patriarcal et entendent fouiner inquisitorialement dans le cerveau de leurs concitoyens.
Baal MÜLLER.
(article paru dans Junge Freiheit, n°39/1999).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 janvier 2008
H. Arendt: l'âge sombre, le paria et le parvenu

Hannah Arendt : l'âge sombre, le paria et le parvenu
par Robert Steuckers
Dans un volume publié par le centre d’études juives « Alte Synagoge », Agnes Heller se penche sur la vision du monde et des hommes qu’a développée Hannah Arendt, au cours de sa longue et mouvementée quête de philosophe. Cette vision évoque tout à la fois un âge sombre (« finster ») et un âge de Lumière, mais les périodes sombres sont plus fréquentes et plus durables que les périodes de Lumière, qui sont, elles, éphémères, marquées par la fulgurance de l’instant et la force de l’intensité. Les périodes sombres, dont la modernité, sont celles où l’homme ne peut plus agir politiquement, ne peut plus façonner la réalité politique : Hannah Arendt se montre là disciple de Hegel, pour qui le zoon politikon grec était justement l’homme qui s’était hissé au-dessus de la banalité existentielle du vécu pré-urbain pour accéder à l’ère lumineuse des cités antiques. Urbaine et non ruraliste (au contraire de Heidegger), Hannah Arendt conçoit l’oikos primordial (la Heimat ou la glèbe/Die Scholle) comme une zone anté-historique d’obscurité tandis que la ville ou la cité est lumière parce qu’elle permet une action politique, permet le plongeon dans l’histoire. Pour cette raison, le totalitarisme est assombrissement total, car il empêche l’accès des citoyens/des hommes à l’agora de la Cité qui est Lumière. L’action politique, tension des hommes vers la Lumière, exige effort, décision, responsabilité, courage, mais la Lumière dans sa plénitude ne survient qu’au moment furtif mais très intense de la libération, moment toujours imprévisible et éphémère. Agnes Heller signale que la philosophie politique de Hannah Arendt réside tout entière dans son ouvrage Vita activa ; Hannah Arendt y perçoit l’histoire, à l’instar d’Alfred Schuler (cf. Robert Steuckers, « Le visionnaire Alfred Schuler (1865-1923), inspirateur du Cercle de Stefan George », in Vouloir n°8/AS :134/136, 1996), comme un long processus de dépérissement des forces vitales et d’assombrissement ; Walter Benjamin, à la suite de Schuler qu’il avait entendu quelques fois à Munich, parlait d’un « déclin de l’aura ». Hannah Arendt est très clairement tributaire, ici, et via Benjamin, des Cosmiques de Schwabing (le quartier de la bohème littéraire de Munich de 1885 à 1919), dont l’impulseur le plus original fut sans conteste Alfred Schuler. Agnes Heller ne signale pas cette filiation, mais explicite très bien la démarche de Hannah Arendt.
L’histoire : un long processus d’assombrissement
L’histoire, depuis les Cités grecques et depuis Rome, est donc un processus continu d’assombrissement. Les cités antiques laissaient à leurs citoyens un vaste espace de liberté pour leur action politique. Depuis lors, depuis l’époque d’Eschyle, ce champ n’a cessé de se restreindre. La liberté d’action a fait place au travail (à la production, à la fabrication sérielle d’objets). Notre époque des jobs, des boulots, du salariat infécond est donc une époque d’assombrissement total pour Hannah Arendt. Son pessimisme ne relève pas de l’idéologie des Lumières ni de la tradition messianique. L’histoire n’est pas, chez Hannah Arendt, progrès mais régression unilinéaire et déclin. La plénitude de la Lumière ne reviendra pas, sauf en quelques instants surprises, inattendus. Ces moments lumineux de libération impliquent un « retournement » (Umkehr) et un « retour » bref à cette fusion originelle de l’action et de la pensée, incarnée par le politique, qui ne se déploie qu’en toute clarté et toute luminosité. Mais dans cette succession ininterrompue de périodes sombres, inintéressantes et inauthentiques, triviales, la pensée agit, se prépare aux rares irruptions de lumière, est quasiment le seul travail préparatoire possible qui permettra la réception de la lumière. Seuls ceux qui pensent se rendent compte de cet assombrissement. Ceux qui ne pensent pas participent, renforcent ou accélèrent l’assombrissement et l’acceptent comme fait accompli. Mais toute forme de pensée n’est pas préparation à la réception de la Lumière. Une pensée obnubilée par la vérité toute faite ou recherchant fébrilement à accumuler du savoir participe aussi au processus d’assombrissement. Le totalitarisme repose et sur cette non-pensée et sur cette pensée accumulante et obsessionnellement « véritiste ».
L’homme ou la femme, pendant un âge sombre, peuvent se profiler sur le plan culturel, comme Rahel Varnhagen, femme de lettres et d’art dans la communauté israélite de Berlin, ou sur le plan historique, comme Benjamin Disraeli, qui a forgé l’empire britannique, écrit Hannah Arendt. Mais, dans un tel contexte de « sombritude », quel est le sort de l’homme et de la femme dans sa propre communauté juive ? Il ou elle s’assimile. Mais cette assimilation est assimilation à la « sombritude ». Les assimilés en souffrent davantage que les non-assimilés. Dans ce processus d’assimilisation-assombrissement, deux figures idéaltypiques apparaissent dans l’œuvre de Hannah Arendt : le paria et le parvenu, deux pistes proposées à suivre pour le Juif en voie d’assimilation à l’ère sombre. A ce propos, Agnes Heller écrit : « Le paria émet d’interminables réflexions et interprète le monde en noir ; il s’isole. Par ailleurs, le parvenu cesse de réfléchir, car il ne pense pas ce qu’il fait ; au lieu de cela, il tente de fusionner avec la masse. La première de ces attitudes est authentique, mais impuissante ; la seconde n’est pas authentique, mais puissante. Mais aucune de ces deux attitudes n’est féconde ».
Ni paria ni parvenu
Dès lors, si on ne veut être ni paria (p. ex. dans la bohème littéraire ou artistique) ni parvenu (dans le monde inauthentique des jobs et des boulots), y a-t-il une troisième option ? « Oui », répond Hannah Arendt. Il faut, dit-elle, construire sa propre personnalité, la façonner dans l’originalité, l’imposer en dépit des conformismes et des routines. Ainsi, Rahel Varnhagen a exprimé sa personnalité en organisant un salon littéraire et artistique très original où se côtoyaient des talents et des individualités exceptionnelles. Pour sa part, Benjamin Disraeli a réalisé une œuvre politique selon les règles d’une mise en scène théâtrale. Enfin, Rosa Luxemburg, dont Hannah Arendt dit ne pas partager les opinions politiques si ce n’est un intérêt pour la démocratie directe, a, elle aussi, représenté une réelle authenticité, car elle est restée fidèle à ses options, a toujours refusé compromissions, corruptions et démissions, ne s’est jamais adaptée aux circonstances, est restée en marge de la « sombritude » routinière, comme sa judéité d’Europe orientale était déjà d’emblée marginale dans les réalités allemandes, y compris dans la diaspora germanisée. L’esthétique de Rahel Varnhagen, le travail politique de Disraeli, la radicalité sans compromission de Rosa Luxemburg, qu’ils aient été succès ou échec, constituent autant de refus de la non-pensée, de la capitulation devant l’assombrissement général du monde, autant de volontés de laisser une trace de soi dans le monde. Hannah Arendt méprisait la recherche du succès à tout prix, tout autant que la capitulation trop rapide devant les combats qu’exige la vie. Ni le geste du paria ni la suffisance du parvenu…
S’élire soi-même
Agnes Heller écrit : « Paria ou parvenu : tels sont les choix pertinents possibles dans la société pour les Juifs émancipés au temps de l’assimilation. Hannah Arendt indique que ces Juifs avaient une troisième option, l’option que Rahel Varnhagen et Disraeli ont prise : s’élire soi-même. Le temps de l’émancipation juive était le temps où a démarré la modernité. Nous vivons aujourd’hui dans une ère moderne (postmoderne), dans une société de masse, dans un monde que Hannah Arendt décrivait comme un monde de détenteurs de jobs ou un monde du labeur. Mais l’ASSIMILATION n’est-elle pas devenue une tendance sociale générale ? Après la dissolution des classes (…), après la tendance inexorable vers l’universalisation de l’ordre social moderne, qui a pris de l’ampleur au cours de ces dernières décennies, n’est-il pas vrai que tous, que chaque personne ou chaque groupe de personnes, doit s’assimiler ? N’y a –t-il pas d’autres choix sociaux pertinents pour les individus que d’être soit paria soit parvenu ? S’insérer dans un monde sans se demander pourquoi ? Pour connaître le succès, pour obtenir des revenus, pour atteindre le bien-être, pour être reconnu comme « modernes » entre les nations et les peuples, la recette n’est-elle pas de prendre l’attitude du parvenu, ce que réclame la modernité aujourd’hui ? Quant à l’attitude qui consiste à refuser l’assimilation, tout en se soûlant de rêves et d’activismes fondamentalistes ou en grognant dans son coin contre la marche de ce monde (moderne) qui ne respecte par nos talents et où nous n’aboutissons à rien, n’est-ce pas l’attitude du paria ? ».
Nous devons tous nous assimiler…
Si les Juifs en voie d’assimilation au XIXième siècle ont été confrontés à ce dilemme —vais-je opter pour la voie du paria ou pour la voie du parvenu ?— aujourd’hui tous les hommes, indépendamment de leur ethnie ou de leur religion sont face à la même problématique : se noyer dans le flux de la modernité ou se marginaliser. Hannah Arendt, en proposant les portraits de Rahel Varnhagen, Benjamin Disraeli ou Rosa Luxemburg, opte pour le « Deviens ce que tu es ! » de nietzschéenne mémoire. Les figures, que Hannah Arendt met en exergue, refusent de choisir l’un ou l’autre des modèles que propose (et impose subrepticement) la modernité. Ils choisissent d’être eux-mêmes, ce qui exige d’eux une forte détermination (Entschlossenheit). Ces hommes et ces femmes restent fidèles à leur option première, une option qu’ils ont librement choisie et déterminée. Mais ils ne tournent pas le dos au monde (le paria !) et n’acceptent pas les carrières dites « normales » (le parvenu !). Ils refusent d’appartenir à une école, à un « isme » (comme Hannah Arendt, par exemple, ne se fera jamais « féministe »). En indiquant cette voie, Hannah Arendt reconnaît sa dette envers son maître Heidegger, et l’exprime dans sa laudatio, prononcée pour le 80ième anniversaire du philosophe de la Forêt Noire. Heidegger, dit-elle, n’a jamais eu d’école (à sa dévotion) et n’a jamais été le gourou d’un « isme ». Ce dégagement des meilleurs hors de la cangue des ismes permet de maintenir, en jachère ou sous le boisseau, la « Lumière de la liberté ».
Robert STEUCKERS.
Agnes HELLER, « Eine Frau in finsteren Zeiten », in Studienreihe der ALTEN SYNAGOGE, Band 5, Hannah Arendt. « Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin », Klartext Verlag, Essen, 1995-96, ISBN 3-88474-374-0, DM 19,80, 127 pages.
00:55 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 15 janvier 2008
Festschrift für Günther Rohrmoser

Dennoch!
Eine bemerkenswerte Festschrift für Günter Rohrmoser
Das Fach Politische Philosophie ist so “umstritten” wie die meisten seiner Vertreter. Günter Rohrmoser hat nichts getan, um diesen Ruf zu verändern. Er ist ständig gegen den “Mainstream” geschwommen und hat sich bei den politischen Parteien, die er vielfach und maßgeblich beriet, mit seinen schonungslosen Analysen nicht immer beliebt gemacht. Umso mehr erstaunt es, in der zu seinem 80. Geburtstag herausgegebenen Festschrift Kardinäle, Bischöfe, Ministerpräsidenten, bekannte Politiker, hohe Militärs, Publizisten und natürlich eine Reihe von namhaften Wissenschaftlern aus so verschiedenen Disziplinen wie Theologie, Philosophie, Geschichte, Literatur, Soziologie, Ethik, Jurisprudenz, Nationalökonomie, Pädagogik und Naturwissenschaften zu finden. Um nur einige Namen ohne Titel zu nennen: Meisner, Mixa, Löwe, Filbinger, Beckstein, Jenninger, Biedenkopf, Rommel, Dohnanyi, Bahro, Schabowski, Buttiligone, Bartoszewski, Daschitschew, Frenkin, Biser, Spaemann, Pannenberg, Marquard, Lübbe, Nolte, Fetscher, Schrenck-Notzing, Wolffsohn. Sie alle vereint der Respekt vor einem Gelehrten, der mit ganz außerordentlicher Überzeugungskraft für die unverzichtbare Verankerung der Politik in der Religion eingetreten ist. Politik ohne Religion mündet in Dekadenz, Lockerung der “Ligaturen” und schließlich Auflösung und Untergang. Für Rohrmoser war es selbverständlich, dass wir doch zumindestens seit Auschwitz begriffen haben sollten, dass Politik nicht mehr möglich ist ohne Ethik; Ethik aber der philosophischen Begründung bedarf; die Aporetik der Philosophie aber nicht zu überwinden ist ohne Religion. Diese Einsicht in die Korrespondenz von Religion, Philosophie, Ethik und Politik verbindet die einzelnen Beiträge, die die Festschrift nicht nur zu einer lehrreichen, sondern zu einer geradezu aufregenden Lektüre machen.
Friedrich Romig
Philipp Jenninger/Rolf W. Peter/Harald Seubert (Hrsg.): Tamen! Gegen den Strom. Günter Rohrmoser zum 80. Geburtstag. 640 Seiten. Geb. Dr. Neinhaus-Verlag, Stuttgart 2007. ISBN 978-3-87575-027-6. EURO 38,-
00:50 Publié dans Hommages, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 janvier 2008
Citation de Jean Giono

La fortune et la gloire ?
« Que faut-il pour réussir ? De la bravoure ? De l’obstination ? De la chance ? Du génie ? Non : de la médiocrité. Quoi que produise le médiocre, c’est un produit qui s’adresse au plus grand nombre. Il est sûr de son affaire, il a les qualités requises par la majorité des individus. S’il s’agit d’un milliard d’hommes, le médiocre est sûr d’être compris et trouvé logique par plus de neuf cent millions. S’il s’agit d’un livre, d’une épingle de nourrice, d’un dentifrice, de n’importe quoi que ce soit qui se vende, même d’un objet tout à fait inutile, et même embêtant, et même comme le diabolo, le yoyo, et cent mille objets médiocres dont les noms sont dans toutes les bouches, neuf cent millions d’individus sur un milliard liront le livre, adopteront l’épingle de nourrice, se laveront les dents avec le dentifrice, ou bêtifieront à qui mieux mieux avec le yoyo, inutile, mais exactement adapté à leur médiocrité personnelle.
Le génie n’est à conseiller à personne ; enfin à personne de ceux qui veulent la fortune et la gloire. On n’atteint à l’unanimité, à l’adhésion des foules et aux sommets des honneurs que par la médiocrité."
Jean Giono, La fortune et la gloire - In "Les terrasses de l’île d’Elbe", Gallimard.
00:45 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 janvier 2008
Les racines du mouvement écologique

Brigitte SOB :
Au-delà de la droite et de la gauche : les racines du mouvement écologique
Le concept d’ « écologie » fut utilisé pour la première fois en 1866 par Ernst Haeckel (1834-1919), qui entendait désigner, par ce terme, « toute la science des rapports de l’organisme avec le milieu extérieur environnant ». Ernst Haeckel était naturaliste et philosophe. Le monde universitaire a reconnu toute sa valeur scientifique grâce aux travaux de recherches qu’il avait accomplis dans le domaine de la biologie marine. Haeckel avait décrit plus de 3500 nouvelles espèces de radiolaires, qui avaient été collationnées lors d’une expédition. Haeckel avait également confectionné quantité de dessins et de tableaux sur le fruit de ses recherches, qui ont tous encore quelque validité scientifique aujourd’hui.
Haeckel avait étudié la médecine au départ, avait reçu le titre de docteur en médecine après une thèse, présentée en 1861, sur l’anatomie comparée. Mais il estimait que l’exercice de l’art médical n’était pas suffisamment intéressant et s’était alors tourné vers la philosophie et la zoologie. En 1865, il obtint le titre de docteur honoris causa en philosophie et un poste de professeur en zoologie à l’Université d’Iéna, dont il devint ultérieurement le vice-recteur.
Haeckel avait une capacité de travail époustouflante : son livre « Die Welträthsel », paru en 1899, fut l’un des best-sellers de son époque, de même que sa « Morphologie générale » de 1866, qui était considérée comme un ouvrage fondamental. Quant à sa « Natürliche Schöpfungsgeschichte » (= « Histoire naturelle de la création ») de 1868, elle connut neuf éditions successives et fut traduite en douze langues. Après sa mort, ses œuvres complètes parurent en six volumes, permettant de jeter un regard synoptique sur ses travaux de vulgarisation scientifique.
Celles-ci ont toutes leur importance car c’est par leur truchement que Haeckel répandit en Allemagne les théories de Charles Darwin. Haeckel défendait la théorie de l’évolution, ce qui l’entraîna dans un conflit avec l’église catholique, alors qu’il était issu d’une famille pieuse. En 1904, Haeckel participa au Congrès international des Libres Penseurs à Rome. Devant le monument érigé en l’honneur du philosophe Giordano Bruno, brûlé comme hérétique, Haeckel déposa une couronne de lauriers, ce que l’église catholique considéra, à l’époque, comme une provocation. A la suite de ce geste, Haeckel s’exposa à de solides inimitiés, qui allèrent jusqu’à mettre en doute le sérieux de ses travaux scientifiques. Dans une réplique, intitulée « Sandalion – Eine offene Antwort auf die Fälschungsanklagen der Jesuiten » (= « Sandalion – Réponse publique aux accusations de falsification des Jésuites »), Haeckel réfuta tous les reproches qu’on lui adressait.
Haeckel avait également des activités politiques : il était membre de l’ « Alldeutscher Verband » (l’association pangermaniste). Pourtant, il m’apparaît difficile aujourd’hui de cataloguer Haeckel quelque part dans le schéma binaire « gauche/droite », difficulté que corrobore notamment l’histoire de la réception des travaux de Haeckel : certes, les nationaux-socialistes ont tenté de l’annexer mais Lénine aussi lui a rendu un vibrant hommage, car le chef de file des bolcheviques voyait en notre naturaliste un « combattant contre la philosophie idéaliste des professeurs » ; quant au socialiste Robert Niemann, il chantait les louanges de Haeckel en le campant comme un « esprit libre post-bourgeois ». Plus tard, les autorités de la RDA socialo-communiste firent de lui un pionnier de l’idéologie socialiste.
Haeckel n’était certes pas une personnalité incontestée : il n’y a pas que l’église catholique qui rejetait ses thèses avec véhémence. On l’accusa de « chauvinisme national-allemand », de même, on lui reprocha aussi d’avoir ouvert la voie à l’ « hygiénisme racialiste ».
Pour être exact, nous devons dire que Haeckel défendait un « monisme biologique », selon lequel la nature -en dépit de sa pluralité- formait une seule et unique totalité, au sein de laquelle tous -y compris l’homme- étaient animés par une seule et même force vitale. Haeckel fut ainsi l’un des premiers à réclamer des droits pour les animaux : il pensait que les animaux, parce qu’ils étaient des êtres dotés de sensibilité, des êtres sociaux et, dans le cas des mammifères supérieurs, des êtres rationnels, devaient bénéficier d’un statut équivalent à celui de l’homme. Haeckel s’insurgeait, dans le cadre de cette défense du statut de l’animal, contre toute interprétation anthropocentrique de la nature. Pour lui, une telle interprétation relevait « de l’arrogance autoproclamée de l’homme, être vaniteux », qui se voulait égal à Dieu et à l’image de celui-ci. Haeckel défendait la thèse que la nature consistait en une substance infinie, sans commencement ni fin. En posant cette « loi de substantialité », Haeckel affirmait que, de cette façon, l’idée, qui veut qu’il y ait un être divin transcendant la nature, était réfutée. Selon la philosophie moniste de Haeckel, il faudrait remplacer le culte chrétien de Dieu par un culte de la nature. D’après Haeckel, le christianisme « n’avait pas seulement contribué à nous aliéner dangereusement de notre merveilleuse mère la Nature mais nous avait aussi conduit à mépriser, de manière fort déplorable, les autres organismes ». Haeckel voulait aussi, dans cette même logique, que l’individualisme égoïste de l’homme soit éliminé au profit d’un nouveau monisme éthique, afin de bien faire voir à l’homme que ses intérêts personnels étaient indéfectiblement liés aux intérêts de sa communauté.
Le monisme de Haeckel a eu, plus tard, des répercussions importantes dans la mesure où il inspira directement le Prix Nobel Konrad Lorenz qui, par ses recherches sur le comportement des animaux, tenta de prouver la validité de la grande intuition de Haeckel, soit que les animaux et leur environnement -y compris l’homme et son environnement- constituaient une unité indissoluble. Le philosophe Ludwig Klages, pour sa part, fut l’auteur d’un petit livre intitulé « Mensch und Erde » (= « L’Homme et la Terre »), où il défendit la thèse suivante : le progrès, comme projet rationaliste de l’Homme, est arrivé au bout de son rouleau. « Comme un feu dévorant, il ravage la Terre entière, et là où il a brûlé un lieu de fond en comble, plus rien ne pousse ni ne croît, tant qu’il y vit des hommes ». D’après Klages, l’homme détruit « par une rage aveugle sa propre mère la Terre… jusqu’à ce que toute vie et, en bout de compte, lui-même, sont livrés au néant ». Klages était tributaire de la philosophie de Nietzsche et porte paroles du mouvement de jeunesse allemand à ses débuts, quand ces jeunes, dont les options étaient hostiles à la technique et à ses répercussions, voulaient retourner au romantisme allemand, opérer un retour à la nature. Lors d’un rassemblement de cette jeunesse néo-romantique sur la montagne du Hoher Meissner, ces options ont été clairement proclamées (ndt : c’est à la suite de ce rassemblement, où Klages prit la parole pour exposer ses visions, que fut rédigé « Mensch und Erde »).
Via Max Scheler, qui avait lu Klages, Martin Heidegger, à son tour, reçut l’influence des idées technophobes de « Mensch und Erde ». Heidegger défendit la thèse que la perte du lien nous unissant à la nature revêtait pour l’homme moderne une perte d’être (« Seinsverlust ») : « A la place de ce qui, jadis, donnait contenance affirmée au monde et aux choses, nous voyons, toujours plus vite, avec de moins en moins de considération et de scrupules, de manière de plus en plus complète, se répandre sur la terre l’objectivisation de la domination de la technique ». Heidegger, critique, nous enseignait que la technique, développée par ce qu’il est convenu d’appeler l’ « Occident », faisait désormais « apparaître tout étant/Seiende comme un étant/Seiende fabricable dans le processus de la production » et, qui plus est, « distribuait les produits de la production via le marché dans le monde entier ». Toujours aussi critique, Heidegger ne cessait de nous rappeler que le « capitalisme technologique dissolvait l’humain dans l’homme et la choséité dans les choses » au profit « d’une valeur marchande calculée par le marché lui-même », afin de créer « un marché mondial qui englobera toute la Terre ». Après avoir décrit ce processus calamiteux, Heidegger nous exhorta à considérer dorénavant l’homme comme l’administrateur de la Terre et non plus comme son dominateur. L’homme, nous enseigne Heidegger, doit apprendre à abandonner à terme la technologie et la pensée consumériste, pour retrouver sa position modeste dans cette unité totalisante qu’est la Nature.
Rudolf Steiner, fondateur de l’école anthroposophique, chercha à développer un mode d’économie biologique/dynamique, où l’agriculture serait un jeu de réciprocité entre l’homme, l’animal, la plante et la Terre.
Dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres, le « mouvement environnementaliste » (« Umweltbewegung ») recevait le soutien de mouvements politiques très divers ; ces courants politiques et idéologiques si divers avaient chacun une conception différente de la nature, depuis le monisme matérialiste jusqu’à un vitalisme biologique et dynamique. Mais tous avaient le même ennemi : l’ « Occident » moderne, technicien, capitaliste. Indépendamment des sentiments et convictions politiques de chacun de ces groupes ou partis ou mouvements, tous les courants du « mouvement environnementaliste » donnaient raison au « national-bolchevique » Ernst Niekisch, quand il écrivait en 1931 : « La technique est viol de la nature ; elle se superpose à la nature. Le progrès technique consiste en ceci : arracher par ruse l’un morceau de sol après l’autre au règne libre de la nature ; ce qui est triomphe pour la technique est profanation pour la nature. Dans la mesure où la technique abat pas à pas les limites que la nature a posées, elle tue la vie ». Même Oswald Spengler et Ernst Jünger, qui célébraient la technique comme partie prenante du nouvel ordre culturel allemand, réclamaient tous deux que la technique soit en permanence remodelée dans une forme « vitaliste ».
Brigitte SOB.
(article paru dans l’hebdomadaire viennois « zur Zeit », n°41/2007, trad. franç. : Robert Steuckers).
00:35 Publié dans Ecologie, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 janvier 2008
Du texte au corps

Du texte au corps
The John Hopkins University Press : Harold B. Segel vient de sortir un ouvrage scientifique fondamental sur la renaissance du culte du corps à partir des premiers Jeux Olympiques de 1896 et à la suite des mouvements de gymnastique allemand (Turnverein) et tchèque (Sokol) et du scoutisme anglais. Les diverses formes d’expression corporelle indiquent une mutation dans l’esprit européen, qui tourne le dos au langage (ou à une culture basée exclusivement sur le langage et l’écrit) pour promouvoir d’autres formes expressives, plus gestuelles, mythiques, chorégraphiques et corporelles, culminant dans l’apologie de la guerre, du sport et de l’aventure. Des manifestations comme le “pantomine” de Max Reinhardt dans The Miracle sont des tentatives de revitaliser la langue littéraire par un appel aux expériences plus directes. Segel explore l’univers littéraire de d’Annunzio, Marinetti, Goumilev, Jünger, Hemingway, Montherlant et Saint-Exupéry, tout en montrant que la spiritualité sous-jacente dans leurs œuvres se démarque des apports du judéo-christianisme.
Harold B. SEGEL, Body Ascendant. Modernism and the Physical Imperative, 1998,ISBN 0-8018-5821-6, 312 pages, £30.00.
00:25 Publié dans Livre, Mouvements de jeunesse, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 janvier 2008
Decrecimiento y Progreso

Decrecimiento y Progreso
Alberto Buela(*)
Hemos sostenido en un artículo reciente que: “La idea de progreso, según nuestra opinión, tiene que estar vinculada a la idea de equilibrio de los efectos. Progreso en la medida en que las consecuencias o efectos del mismo se equilibran de tal forma que puedo realizar nuevos progresos sin anular los efectos del primero”.1
Queremos ahora profundizar en la relación entre decrecimiento y progreso, pues nos encontramos con dos hechos indubitables y evidentes, pero que al mismo tiempo se presentan como contradictorios. Por un lado tenemos la acumulación masiva de datos que muestran el desquiciamiento de los ecosistemas planetarios y el deshilachado del tejido social de la naciones tanto pobres como opulentas. Y por otro, el ansia y la tendencia natural del hombre al progreso. ¿Cómo compaginar estos dos hechos irrecusables por evidentes?.
Si bien la idea de decrecimiento fue manejada por el anarquismo clásico como los ludditas que destruían las máquinas al comienzo de la revolución industrial y reclamaban menos horas de trabajo para el estudio y la formación personal, esta idea fue enunciada por primera vez por el mejicano Ivan Illich por los años 60 cuyo apotegma fue: Vivir de otro modo para vivir mejor. A él le siguieron pensadores como Nicholas Georgescu y su propuesta de límites al crecimiento económico, Jacques Ellul que en 1981 proponía no más de dos horas de trabajo diario, para concluir en nuestros días con los trabajos del reconocido sociólogo Serge Latouche: Por una sociedad del decrecimiento(2004) y del ingeniero mejicano Miguel Valencia Mulkay: La apuesta por el decrecimiento(2007). Acaba en estos días de publicar el pensador Alain de Benoist Demain la décroissance. Penser l’écologie jusqu’a bout (Edite, 2007).
Se parte de la base que el crecimiento económico por el crecimiento mismo lleva en sí el germen de su propia destrucción. El límite del crecimiento económico lo está dando el inminente colapso ecológico. Hoy desaparecen 200 especies vegetales y animales diariamente. De modo tal que el crecimiento económico comienza a encontrar límites ecológicos (el calentamiento de la tierra, el agujero de Ozono, el descongelamiento de los Polos, la desertificación del planeta, etc.)
Es que la sociedad capitalista con su idea de crecimiento económico logró convencer a los agentes políticos, económicos y culturales que el crecimiento económico es la solución para todos los problemas. Así hoy el progresismo político ha rebautizado con los amables nombres de “ecodesarrollo”, “desarrollo sustentable”, “otro crecimiento”, “ecoeficiencia”, “crecimiento con rostro humano” y otros términos, que demuestran que este falso dios está moribundo.2
A contrario sensu de esta tesis el inimputable de George Bush sostuvo el 14/2/2002 en Silver Spring ante las autoridades estadounidenses de meteorología que: “el crecimiento económico es la clave del progreso ecológico”.
En realidad el pensamiento ecológico se va transformando sin quererlo en subversivo al rechazarla tesis de que el motivo central de nuestro destino es aumentar la producción y el consumo. Esto es, aumentar el producto bruto interno-PBI de los Estado-nación.
La idea de decrecimiento nos invita a huir del totalitarismo economicista, desarrollista y progresista, pues muestra que el crecimiento económico no es una necesidad natural del hombre y la sociedad, salvo la sociedad de consumo que ha hecho una elección por el crecimiento económico y que lo ha adoptado como mito fundador.
El asunto es ¿cómo dejar de lado el objetivo insensato del crecimiento por el crecimiento cuando éste se topa con los límites de la biosfera que ponen en riesgo la vida misma del hombre sobre la tierra?. Y ahí, Serge Latuche tiene una respuesta casi genial: avanzar retrocediendo.
Es decir, seguir progresando desactivando paulatinamente esta bomba de tiempo que es la búsqueda del crecimiento económico si límites. Y para ello hay que comenzar por un cambio en la mentalidad del homo consumans como designó nuestro amigo Charles Champetier en el libro homónimo, al hombre de hoy.
Sabemos de antemano que esto es muy difícil pues la sociedad mundial en su conjunto a adoptado la economía del crecimiento y vencer a los muchos se hace cuesta arriba, pues como afirmaba el viejo verso del romancero español: Vinieron los sarracenos
Y nos molieron a palos,
Que Dios protege a los malos
Cuando son más que los buenos.
El establecimiento de una sociedad del decrecimiento no quiere decir que se anule la idea de progreso4 sino que se la entienda de otra manera, tal como propusimos al comienzo de este artículo. Hay que dejar de lado de una vez y para siempre la idea de progreso indefinido tan cara al pensamiento ilustrado de los últimos tres siglos. Porque sus consecuencias nos sumieron en este estado de riesgo vital que estamos viviendo hoy todos los hombres sin excepción.
Debemos superar los aspectos nocivos de la modernidad en este campo, y sólo podemos hacerlo con una respuesta postmoderna que lleve un anclaje premoderno. Por ejemplo, rompiendo el círculo del trabajo para volver a trabajar intentando recuperar, no la pereza, como afirma Lafargue, ni la diversión como afirma Tinelli, sino el ocio= la scholé= la scholae= la escuela, esa capacidad tan profundamente humana y tan creativa que nos hace a los hombres personas.
No es tan difícil reestablecer en economía el principio de reciprocidad de los cambios tanto entre los hombres en el intercambio de mercaderías como entre el hombre y la naturaleza, volviendo a pensar a la naturaleza como amiga. Ese principio de reciprocidad que morigere la salvaje ley de la oferta y al demanda.
Si no lo hacemos se encargará con su fuerza interna de mostrárnoslo la propia realidad de las cosas, con la fuerza cruel que impone la pedagogía de las catástrofes.
(*) arkegueta- CeeS- Fed. del Papel
Casilla 3198 (1000) Buenos Aires
(1) Dos ideas distintas de progreso, en internet, octubre de 2007
(2) Miguel Valencia Mulkay: La apuesta por el decrecimiento (2007)
(3) Serge Latouche: Por una sociedad del decrecimiento (2004)
(4) Tampoco decrecer significa que se niegue el derecho a la vida, sobre todo de los pobres, como sostienen algunos eugenetistas y controladores de la natalidad.
00:50 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nietzsche: affirmation et religion
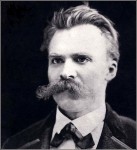
Princeton University Press : Tyler T. Roberts, professeur assistant en études religieuses au Grinnell College, vient de publier un ouvrage intitulé « Contesting Spirit. Nietzsche, Affirmation, Religion » [Esprit contestataire : Nietzsche, Affirmation, Religion]. Roberts conteste la vision courante qui pose Nietzsche comme un penseur farouchement anti-religieux. Au contraire, le caractère résolument affirmatif de la pensée de Nietzsche fait de sa pensée une pensée fondamentalement religieuse, qui conteste seulement l’ambiguïté des positions ascétiques et parfois mystiques. De ce fait, Nietzsche transfigure les tropismes et les pratiques religieuses en rejetant la haine du corps et du monde. Nietzsche n’appartient pas à cette catégorie des philosophes du soupçon qui réduisent tout discours aux platitudes modernes et positivistes, mais un maître qui nous force à aller bien loin au-delà de celles-ci.
Tyler T. ROBERTS, Contesting Spirit. Nietzsche, Affirmation, Religion, O-691-00127-8, 1998, £13.95. Pour l’Europe commander à : John Wiley @ Sons, 1 Oldlands Way, Bognor Regis, West Sussex PO22 9SA. Customer@Wiley.co.uk
00:20 Publié dans Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 04 janvier 2008
E. Jünger: "La Paix" du Guerrier

Max SERCQ :
Ernst Jünger: "La Paix" du Guerrier
«Que pensez-vous des nationalités?». Interrogé par ses traducteurs italiens MM Antonio Gnoli et Franco Volpi dans leur livre Les prochains Titans, paru chez Grasset en 1999, Ernst Jünger répondait: «Les nations sont à mon avis un phénomène de transition (...) Nous assistons à une lutte entre diadoques qui, tôt ou tard, débouchera sur l’Etat universel». Une opinion aujourd’hui corroborée par les faits, mais défendue par l’anarque de Wilflingen depuis 1941, alors qu’en pleine apogée des armées du IIIe Reich, et au cœur de Paris, Jünger écrivait son essai La Paix, qui devait tant influencer Rommel dans sa participation au complot du 20 juillet 1944.
«Ce n’est pas dans l’équilibre bourgeois, mais dans le tonnerre des apocalypses que renaissent les religions» (Walter Schubart, L’Europe et l’Ame de l’Occident ).
On avait failli l’oublier. Submergé par les rééditions chez Bourgois de ses premiers récits guerriers et la parution chez Grasset de son entretien-testament Les prochains Titans, et malgré sa présence à la Table Ronde en collection Vermillon depuis 1994, on avait failli oublier l’existence de La Paix. Pourtant ce petit essai, écrit par Ernst Jünger à l’Hôtel Majestic, en plein Paris occupé par une armée allemande dont il a lui-même revêtu l’uniforme feldgrau, «en somme dans le ventre du Léviathan» (E.J.), La Paix, en rupture avec ses précédents écrits, «peut être (dixit le résumé en quatrième de couverture) considéré comme une contribution théorique à l’attentat manqué de 1944 contre Hitler. La plupart des auteurs du complot trouvèrent la mort; Jünger fut l’un des rares à y échapper». Ironie du sort, il aura fallu en France la publication par Michalon en 1998 du livre La tentation allemande; ramassis hystérique, signé Yvonne Bollmann, de soi-disant preuves des prétentions gouvernementales allemandes à la restauration du Reich, quatrième du nom, pour qu’on redécouvre La Paix. Un phantasme germanophobe bien d’actualité, mais que n’aurait pas désavoué un Déroulède, et immédiatement confondu par F. G. Dreyfus dans Historia.
Que vient faire Jünger dans ce déballage d’inepties? Laissons Mme Bollmann nous le dire: «Un essai comme celui-ci, qui alors était dangereux et à écrire et à lire, peut très bien, aujourd’hui, donner l’impression que le vaincu veut donner une leçon de conduite aux vainqueurs» (E.J.). «Mais, lui rétorque-t-elle, il n’est que la caricature de l’"alliance pacifique", de la "fédération d’Etats libres" voulue par le philosophe. Ce traité illustre bien plutôt l’une des maximes de sophiste, qui guident, selon Kant, le pauvre savoir-faire d’une politique immorale: Fac et excusa - Agis d’abord et excuse-toi ensuite». Au contraire, la lecture posée de ce petit texte limpide, ruisselant de méditations fécondes, dévoile un Jünger européen, homo metaphysicus certes, mais inscrit dans les tumultes de son temps, auxquels il entrevoit peut-être des perspectives grandioses, la paix recouvrée. La Paix du guerrier bien sûr.
Jünger, «intellectuel dégagé»
Si vis pacem, para bellum. De l’acuité de la maxime romaine, Jünger est convaincu, qui lui a sacrifié ses années de jeunesse. Mais à présent que la guerre dégénère en une auto-reproduction du système capitaliste, Jünger, «intellectuel dégagé», pressent que des formes de la cessation des hostilités dépendra la régénérescence de la civilisation, ou sa mort. «Deux voies s’ouvrent aux peuples. L’une est celle de la haine et de la revanche; comment douter qu’elle conduise après un moment de lassitude, à un regain de lutte plus violente encore, pour s’achever dans la destruction générale? La vraie voie, par contre, mène à la civilisation. Les forces qui s’anéantissaient en s’opposant doivent s’unir pour un nouvel Ordre, pour une vie nouvelle. Là seulement se trouvent les sources de la paix véritable, de la richesse, de la sécurité, de la puissance». Il faut être, Mme Bollmann, bien mal intentionné, ou ignorant du personnage, pour prêter aux propos de Jünger des ambitions de «nazisme inversé». Poursuivons. Quel nouvel Ordre Jünger oppose-t-il dès 1941 à l’Ordre nouveau alors à son zénith?
«En d’autres termes, les anciennes frontières ont à céder devant des alliances nouvelles qui uniront les peuples en de nouveaux et plus vastes empires. C’est la seule voie par laquelle puisse se terminer, en équité, et avec profit pour chacun, cette querelle fratricide». Folle utopie, désir insatiable de justice et de fraternité, son incompréhension, ou sa fin de non-recevoir, des conséquences idéologiques est manifeste. «Mais en vérité la déclaration d’indépendance de l’Europe est un acte plus spirituel encore. Elle suppose que ce continent s’affranchisse de ses conceptions pétrifiées, de ses haines invétérées, faisant de la victoire un bienfait pour tous (...) Peu importe le vainqueur: au triomphe des armes il incombe une lourde responsabilité. La logique de la violence pure doit aller jusqu’au bout pour qu’apparaisse la logique supérieure de l’Alliance». Dos au mur, l’Allemagne nazie doit céder pour que rejaillisse l’Allemagne éternelle dont il est, avec Mann, Hesse et quelques autres, disséminés entre la Suisse et les Etats-Unis, l’ultime héritier. Restaurée dans son identité, donc fédérale, impériale, revenue de 1806, l’Allemagne préfigurera l’Europe qu’il appelle de ses vœux. Son premier devoir sera «moins de venger les victimes que de rétablir le droit, et surtout la notion de droit (...)
La volonté de justice doit être dirigée vers l’ordre, vers l’assainissement». Car rien n’est plus distant du droit international qui naîtra des procès de Nuremberg que l’idée jüngerienne du droit: «Or la main qui veut aider l’homme et le tirer de l’aveuglement, doit être elle-même pure de tout crime et de toute violence». «Aussi importe-t-il non seulement pour les vaincus, mais pour les vainqueurs, que la guerre se termine par des traités solides et durables, élaborés non par la passion, mais par la raison». Un appétit métaphysique que ne respecteront nullement les signataires du traité de Yalta. Et pour cause, le document entérinant un déplacement des puissances dominantes contraire aux aspirations formulées dans La Paix: «Or à considérer sans passion l’enjeu de cette guerre, on constate qu’elle soulève presque tous les problèmes qui agitent les hommes (...) La première est celle de l’espace, car il y a des puissances d’agression, ou totalitaires (...) Pour durer, la paix doit donc apaiser ce trouble d’une manière équitable. Encore faut-il que de telles exigences, fondées sur le droit naturel, soient satisfaites sur un plan supérieur, par des alliances, des traités, et non par des conquêtes».
«Car la matière nationale des peuples s’est consumée en d’ultimes sacrifices»
La mobilisation totale et L’état universel annonçaient la dissolution des états. Avec le conflit gigantesque qui s’abat sur le monde, les nations désormais sont promises à pareil destin. «Car la matière des peuples s’est consumée en d’ultimes sacrifices, impossibles à renouveler sous cette forme. Le bienfait de ce drame est qu’il ébranle les vieilles frontières et permet la réalisation de plans spirituels dépassant leurs cadres (...) Dans ce sens, aucune des nations ne sortira de la guerre telle qu’elle y est entrée. La guerre est la grande forge des peuples comme elle est celle des cœurs».
Déterminismes géopolitiques, libération des peuples de leurs entraves stato-nationales, et relativisation postmoderne des certitudes rationalistes sont les trois piliers qui soutiennent son Union Européenne, sa vision prophétique. Prophétique comme l’est son emphase; une emphase qui ne s’emporte jamais sur la vague de la facilité intellectuelle mais rebondit toujours sur une idée nouvelle. Une dialectique parfaite de maîtrise qui nous remémore que le théoricien lucide du totalitarisme technicien fut aussi l’interlocuteur privilégié de Heidegger.
«Et les nations qui naquirent alors des dynasties et des éclats de vieux royaumes sont aujourd’hui en demeure de fonder l’Empire. Les exemples abondent, d’ailleurs, d’Etats où s’amalgament les races, les langues, les peuples les plus divers: que l’on pense à la Suisse, aux Etats-Unis, à l’Union Soviétique, à l’Empire britannique. Ils ont cristallisé, dans leurs territoires, une grande somme d’expériences politiques: il n’est que d’y puiser. En fondant la nouvelle Europe, il s’agit de donner à un espace divisé par l’évolution historique, son unité géopolitique. Les écueils se trouvent dans l’ancienneté des traditions, et dans le particularisme des peuples».
Aussi, comment déborder l’obstacle? Par la constitution, si l’on se souvient de ce qui a été dit précédemment, mais un droit et une constitution de nature sacrale, et non plus seulement contractuelle. «La paix ne saurait se fonder uniquement sur la raison humaine. Simple contrat juridique conclu entre des hommes, elle ne sera durable que si elle représente en même temps un pacte sacré. Il n’est d’ailleurs pas d’autre moyen de remonter à la source la plus profonde du mal, issu du nihilisme».
Ni autoritaire ni libérale, puisque de leur arbitraire a découlé la guerre mondiale, la constitution doit délimiter strictement les attributions étatiques. Un état à dimension européenne donc, soucieux de «satisfaire à deux principes fondamentaux, unité et diversité», sans quoi l’alliance virera à la coercition, à l’indifférenciation mortifère. «Uni dans ses membres, le nouvel empire doit respecter les particularités de chacun».
L’homme nouveau, dépositaire et gardien de l’alliance
«La constitution européenne doit donc être assez habile pour faire la part de la culture et celle de la civilisation». Notons ici que Jünger opère à la manière de Thomas Mann une distinction entre la culture, qui concerne la sphère intérieure propre à tout homme, et la civilisation, qui la prolonge et l’éprouve dans l’action». «L’Etat, symbole suprême de la technique, rassemble les peuples sous son égide, mais ils y vivent dans la liberté. Alors l’histoire se poursuit en s’enrichissant de valeurs nouvelles. L’Europe peut devenir une patrie sans détruire pour autant les pays et les terres natales». L’homme nouveau pressenti par Jünger, dépositaire et gardien de l’alliance, n’est déjà plus la figure du Travailleur, ni encore tout à fait celle de l’anarque. C’est un être complet, étroitement relié aux forces telluriques et cosmiques. Organiciste et patriote, il se sait être la maillon d’une chaîne spatio-temporelle communément appelée communauté. Mystique aussi, l’homme de l’alliance est un moine-soldat pénétré de ses devoirs envers la Cité, serviteur de son Dieu. Croisé d’une ère nouvelle —petite et grande guerres saintes réunies—, sa paix intérieure découle de sa mission chevaleresque. «[c’est pourquoi] l’unité de l’occident, prenant corps pour la première fois depuis l’Empire de Charlemagne, ne saurait se borner à réunir les pays, les peuples et les cultures, mais elle doit aussi ressusciter dans l’Eglise (...) La véritable défaite du nihilisme, condition de la paix, n’est possible qu’avec l’aide de l’Eglise. De même que le loyalisme de l’homme, dans l’Etat nouveau, ne peut reposer sur son internationalisme, mais sur sa fidélité nationale, son éducation doit se fonder sur sa foi et non sur son indifférence. Il faut qu’il soit l’homme d’une patrie, dans l’espace et dans l’infini, dans le temps comme dans l’éternel. Et cette initiation à une vie qui embrasse la totalité de l’homme, doit se fonder sur une certitude supérieure à celle que l’Etat donne dans ses écoles et ses universités.»
Réconciliant science et théologie («la théologie, reine des sciences»), mythos et logos, comme Hesse avant lui dans Le jeu des perles de verre, Jünger insiste sur la nécessité de fonder une élite théologale de kshatriya pratiquant «le culte de l’Univers».
Car le message que nous délivre Jünger est celui-ci: vous ne sauverez l’Occident qu’en sauvant son âme, vous ne sauverez l’Occident qu’en le sauvant de lui-même.
Révolution conservatrice
Libre à chacun aujourd’hui de juger la justesse de son propos, son degré de prescience, les limites de son pacte. Reconnaissons-lui néanmoins, en des temps de cataclysmes, le courage rare, lui le guerrier, d’avoir su se réconcilier avec le monde et, plus encore, avec lui-même.
Et pour Mme Bollmann, qui, manifestement, par engagement antifasciste n’a pas poussé le vice jusqu’à lire l’introduction de La Paix, citons cette courte confession jüngerienne: «Mais un homme qui ne s’était jamais menti, ne connaissant de la passion que ses flammes, non le rayonnement noir de la haine et du ressentiment (...) Cet homme-salamandre, capable de se livrer aux bêtes et aux flammes sans laisser entamer en lui la part divine de l’homme, ne pouvait pas reconnaître dans l’Allemagne hitlérienne, fondée sur le désespoir des masses et la puissance surnaturelle du mensonge d’un névrosé, l’image de ses premières amours viriles».
Noblesse oblige.
Max SERCQ.
La Paix, Ernst Jünger, La Table Ronde, 1994.
Ernst Jünger aux faces multiples, Banine, L’Age d’Homme, 1989.
Les prochains Titans, Antonio Gnoli et Franco Volpi, Grasset, 1999.
La tentation allemande, Yvonne Bollmann, Michalon, 1998.
00:55 Publié dans Littérature, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 30 décembre 2007
Hommage à Sigrid Hunke (1913-1999)

Hommage à Sigrid Hunke (1913-1999)
« Je possède une force en mon âme, totalement et immédiatement réceptive à Dieu » (Maître Eckhart)
Le 15 juin 1999, Sigrid Hunke est retournée à la Grande Unité de la vie et de la mort. Sa vie et son œuvre ont eu et garderont une importance considérable pour notre communauté unitarienne. Nous voulons dès lors nous souvenir d’elle, ici, avec gratitude et respect. Ecoutons ses propres paroles :
Profondément enraciné !
« Lorsque je jette un regard rétrospectif, c’est toujours cette même image qui me revient, qui s’anime, si vivante, devant mes yeux, cette image qui m’a accompagnée si souvent dans la vie : un ciel immense plein de nuages sombres qui chassent, très haut au-dessus de pâturages vallonnés, où se blottissent les fermes entre de puissants châtaigniers, fouettés par la tempête. Chaque jour, je faisais le même chemin et je me pressais contre ce mur de vent invisible et, lentement, je prenais conscience de me trouver là au beau milieu de la lutte des éléments, et j’avançais ainsi sur mon chemin en solitaire… A cette époque-là, … j’ai appris ceci : tout ce qui, —à la façon de ces arbres battus par la tempête et par les averses, se maintient, tout en croissant et en portant des fruits,— doit être solidement enraciné, doit toujours, et sans cesse, puiser ses sèves profondément hors du sol de ses racines, hors de ce sol primordial et divin. Seules les occupations vides de sens, fébriles, sans ancrages solides dans la religiosité finissent lamentablement, sans résistance et dans l’indifférence, par déboucher sur ces platitudes intérieures, ce vide et cet assèchement de l’âme, propre de tout ce qui reste collé à la superficialité du monde matérialiste. Ceux qui veulent aller à l’essentiel, qui veulent créer des valeurs et se réaliser eux-mêmes dans cet acte de création, doivent sans cesse se replonger dans leurs propres profondeurs, pour offrir leur poitrine aux assauts de la vie et puiser dans cette source intérieure les forces pour lancer de nouveaux projets, afin, leur vie durant, de porter et de projeter cet essentiel dans leur vie quotidienne, dans leur profession, dans leur famille et leur communauté ».
Représenter l’unité du monde dans notre communauté, approfondir le sens de cette unité, voilà ce que fut le projet de Sigrid Hunke. Avec les mots simples que nous venons de rappeler ici, elle nous transporte au centre même de sa vision religieuse du monde, qui est aussi la nôtre. En se référant à Wilhelm Hauer et à Friedrich Schöll, elle a été pendant douze ans la vice-présidente de la « Communauté religieuse des Unitariens allemands » ; elle nous a transmis ce qui, à ses yeux, était « l’autre religion de l’Europe », la vraie religion de l’Europe, celle qui allait permettre au divin « de revenir dans sa réalité » (Schöll). Dans de nombreux écrits et discours, elle nous a explicité cette pensée et cette religiosité unitariennes, elle nous a montré son enracinement profond dans la philosophie et la théologie de l’antiquité, du moyen âge et de notre époque contemporaine. Elle nous a expliqué la profondeur et l’ampleur de cette vision unitaire de Dieu et du monde.
Comme par un coup de fanfare, Sigrid Hunke, nous a communiqué, en 1969, à Heide, dans une allocution à l’occasion d’une fête, quelles seraient les thèses fondamentales de son livre La vraie religion de l’Europe. Elle a cité un témoin majeur dans l’histoire de la pensée européenne, Nicolas de Cues : « Qu’est donc le monde sinon la manifestation du Dieu invisible ? Qu’est donc Dieu, sinon l’invisibilité du visible ? N’est-ce pas cet Un, que l’on atteint dans tout ce que l’on peut atteindre ? ».
« Le monde est le déploiement de tout ce que Dieu tient plié en lui. Dieu est le conteneur de tout ce qui se déploie en tout. Il est en tout être, sans pour autant être identique à lui ». En prononçant et en faisant siennes ces paroles de Nicolas de Cues, Sigrid Hunke oppose à la vision du monde chrétienne-dualiste, pour laquelle Dieu et le monde sont fondamentalement différents, la vision unitarienne, où Dieu et le monde sont Un, où ils forment une unitas, la seule unité qui soit.
La vie de Sigrid Hunke
Sigrid Hunke est née en 1913 à Kiel, dans la famille d’un libraire. Elle a étudié dans sa ville natale, puis à Fribourg et à Berlin, les religions comparées, la philosophie et la psychologie, la philologie germanique et l’histoire. Ses maîtres furent notamment Hermann Mandel, Martin Heidegger et Nicolai Hartmann. En 1940, elle passe sa thèse de philosophie avec Eduard Spranger. Elle épouse ensuite le futur diplomate de la RFA, Peter H. Schulze, à qui elle donnera trois enfants : un fils, actuellement professeur d’histoire contemporaine, et deux filles, l’une enseignante, l’autre médecin. Je cite ces éléments biographiques pour montrer que Sigrid Hunke, connue surtout par ses livres, n’a nullement été une philosophe enfermée dans sa tour d’ivoire, mais qu’elle a été une femme complète, épouse et mère, et qu’elle a pu incorporer ces expériences existentielles dans son œuvre. Ecoutons-la :
« Après mon Abitur, j’ai d’abord choisi une formation musicale, pour ensuite me retrouver sur les bancs de l’université et dans mon bureau personnel pour réaliser mon propre travail créatif. A part quelques compositions, j’ai ainsi écrit quelques nouvelles et romans, jusqu’au jour où j’ai été prise d’une véritablement passion pour l’essai scientifique. Chaque fois le désir d’écrire un livre de cette nature était mu par un motif très précis et une nécessité intérieure. Bien que j’ai été une enfant calme et que, très tôt, je me suis sentie attirée par la poésie et les nouvelles poétiques de Storm, Ginskey et Binding, en tant que femme mariée, je me suis sentie interpellée et provoquée par des conceptions générales et stupidement répétées que je tenais pour superficielles et irréfléchies voire pour inexactes : chaque fois, ce fut un défi profond, l’occasion de débattre et de combattre, contre moi-même et contre d’autres. Le résultat fut toujours un livre ».
Reprenons un à un ses principaux ouvrages ; nous nous apercevrons de la diversité et de la variété des intérêts de Sigrid Hunke, et aussi de sa passion pour la vérité et de sa soif de connaissances. Ainsi, en 1955 paraît Am Anfang waren Mann und Frau [= A l’origine, il y avait l’homme et la femme], une psychologie des relations entre les sexes, un livre qui a été lu dans les commissions du Bundestag, quand il s’agissait de codifier les articles assurant l’égalité en droit de l’homme et de la femme. Dans une dédicace qui m’était adressée personnellement, dans la seconde édition de ce livre, en 1987, Sigrid Hunke a écrit : « Dans le mythe germanique, les deux versions confondues, il y avait à l’origine l’Homme et la Femme, non pas comme deux principes opposés, mais comme les deux facettes d’une unité, facettes qui ont émergé en même temps et pourvues toutes deux également par les dieux d’esprit, d’âme et de force vitale ».
Dans Le Soleil d’Allah brille sur l’Occident, paru en 1960, Sigrid Hunke s’est révélée comme une grande spécialiste de la culture arabe. Le livre a été traduit en sept langues. En 1974, Sigrid Hunke est nommée membre d’honneur du « Conseil Supérieur des Questions Islamiques », en tant que femme, qu’étrangère et que non-musulmane ! Dans l’hommage qu’il lui a rendu à l’occasion de ses 70 ans, Gerd-Klaus Kaltenbrunner l’a appelée « l’ambassadrice non officielle de la culture allemande dans les pays arabes ». Son enracinement religieux dans cette vraie religion de l’Europe, l’a conduite à réfléchir sur les origines les plus lointaines des cultures et des peuples de la Terre, à reconnaître leurs spécificités et à les respecter.
Sur la jaquette de son ouvrage Das Reich und das werdende Europa [= Le Reich et l’Europe en devenir], paru en 1965, qui m’a inspiré pour mes cours d’histoire, on pouvait lire : « … seule une Europe mérite nos efforts, sera durable et témoignera d’une vitalité culturelle : celle qui héritera des meilleures traditions, puisées dans la force morale la plus originelle et la plus spécifique, force toute entière contenue dans l’idée d’Empire et dans le principe de la chevalerie ; cet héritage essentiel devra être transposé dans la nouvelle construction politique… ».
Les livres de Sigrid Hunke
Les autres livres de Sigrid Hunke ont également été essentiel pour nous :
◊ Europas andere Religion – Die Überwindung der religiösen Krise (= L’autre religion de l’Europe. Le dépassement de la crise religieuse), 1969. Ce livre fondamental a été réédité in extenso en 1997 sous le titre de Europas eigene Religion (= La religion spécifique de l’Europe) chez l’éditeur Grabert. Il a connu aussi une édition de poche en 1981 : Europas eigene Religion – Der Glaube der Ketzer (= La religion spécifique de l’Europe – La foi des hérétiques) chez Bastei-Lübbe.
◊ En 1971 paraît Das Ende des Zwiespaltes – Zur Diagnose und Therapie einer kranken Gesellschaft (= La fin de la césure dualiste – Diagnostic et thérapie d’une société malade).
◊ En 1979, parution d’un autre ouvrage fondamental, toujours dans la même trajectoire : Glauben und Wissen. Die Einheit europäischer Religion und Naturwissenschaft (= Foi et savoir. L’unité de la religion européenne et des sciences naturelles).
◊ Chez Seewald en 1974 paraît un manifeste : Das nachkommunistische Manifest – Der dialektische Unitarismus als Alternative (= Le manifeste post-communiste – L’unitarisme dialectique comme alternative). L’“Association internationale des femmes-philosophes”, à laquelle appartenait Sigrid Hunke, a été fort enthousiasmé par la parution de ce manifeste et a demandé à l’auteur de le rendre plus accessible au grand public. L’association y voyait l’ébauche d’un monde futur.
◊ En 1986, Sigrid Hunke publie Tod, was ist dein Sinn ?, ouvrage sur le sens de la mort (cf. la recension de Bertrand Eeckhoudt, « Les religions et la mort », in : Vouloir, n°35/36, janv.-févr. 1987).
◊ En 1989, paraît Von Untergang des Abendlandes zum Aufgang Europas – Bewußtseinswandel und Zukunftsperspektiven (= Du déclin de l’Occident à l’avènement de l’Europe – Mutation de conscience et perspectives d’avenir). Sur la jaquette du livre, Sigrid Hunke est décrite comme un « Spengler positif », vu son inébranlable foi en l’avenir : « Dans un processus monstrueux de fusion et de recomposition, l’Occident chrétien est en train de périr inexorablement dans ses valeurs et ses structures, on aperçoit déjà partout, —entre les ruines et les résidus des vieilles structures dualistes, dangereusement hostiles les unes aux autres, se diffamant mutuellement,— poindre les nouveaux développements évolutifs d’une Europe future. Celle-ci reposera sur la loi essentielle d’unicité et d’holicité tapie originellement au fond de l’homo europaeus et se déployant dans tous les domaines humains et culturels. Ceux-ci reviendront à eux-mêmes et, grâce à un ancrage plus profond dans leur propre spécificité, s’élèveront puissamment à un niveau de culture supérieur ».
Les affirmations contenues dans ce livre, l’attitude positive de Sigrid Hunke, nous apparaissent comme un défi, comme un appel que nous avons le devoir de suivre.
Sigrid Hunke a reçu plusieurs prix et distinctions honorifiques pour ses travaux, dont la « Kant-Plakette » en 1981 et le « Prix Schiller du Peuple allemand » en 1985. Elle était aussi la Président de la « Communauté religieuse des Unitariens allemands ».
En tant qu’Unitariens, nous avons été renforcés dans nos convictions par la personnalité et l’œuvre de Sigrid Hunke. Surtout Europas eigene Religion / La vraie religion de l’Europe a été pour nous un guide permanent, un fil d’Ariane dans l’histoire spirituelle de notre continent. Pour nous, Sigrid Hunke demeurera inoubliable et immortelle.
Bernhard BÜHLER,
Au nom de la « Ligue des Unitariens allemands ».
(Hommage paru dans Glauben und Wirken, juillet-août 1999).
00:35 Publié dans Biographie, Hommages, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 décembre 2007
M. Maffesoli et "La violence totalitaire"

Laurent SCHANG :
Un classique à relire: Michel Maffesoli et "La violence totalitaire"
Conférence tenue à l'Université d'été de "Synergies Européennes", 1999, Pérouse/Ombrie
«L’Etat qui se veut le propriétaire de la société en vient à exercer une violence pouvant prendre des formes diverses, mais dont le résultat est identique. En effet, que ce soit à la manière douce de la technostructure, ou brutalement sous les diverses tyrannies, ce qui se veut totalisant tend à devenir totalitaire».
Ces propos, introduction à l’essai d’anthropologie politique La violence totalitaire , illustrent le projet panoramique de sociologie politique du politologue Michel Maffesoli. C’est une œuvre puissante, volontariste, touffue également, qui trouve sa place au côté de son pendant philosophique, Michel Onfray.
Le lecteur y retrouve en filigrane les trois thèmes centraux de sa réflexion protéiforme et engagée, que sont:
-l’opposition ontologique entre puissance et pouvoir;
-la nature fondamentalement totalitaire de toute structure étatique; et
-l’immanence «ouroubore», ou cyclique de tout processus révolutionnaire.
Trois axes d’une pensée vivifiante directement située dans la continuité de ses lectures, à savoir Spengler, Tönnies, Weber, Freund, Schmitt et Durkheim. Des classiques de l’hétérodoxie politique dont Maffesoli s’est non seulement imprégné mais qu’il se réapproprie et réactualise dans une logique de contestation, pondérée par ce qu’on appellera génériquement un conservatisme cynique qui doit plus aux leçons de la sociologie qu’à des convictions personnelles nécessairement idéologiques.
Logique de contestation et conservatisme cynique
Chez Maffesoli, c’est la démarche «para-scientifique» qui fonde la qualité de sa réflexion, plus encore que la pertinence de ses développements et conclusions. «Une démarche proche du poétique pour laquelle il est moins important de changer le monde que daller au plus profond dans l’investigation et la monstration». Selon la formule de l’Ecclésiaste: «Quid novi sub sole? Nihil». Plus précisément, cela consiste, «comme le dit Rainer Maria Rilke, à affronter, à vivre ce problème essentiel qu’est l’existence, dans une "saisie du présent" qui récuse l’historicisme et revendique le droit à l’inutilité. Un existentialisme vitaliste qui puise à la source de Nietzsche et ne craint pas de recourir autant, sinon plus, aux enseignements des grandes plumes littéraires qu’aux cours magistraux des pères de la science politique. Qu’on juge plutôt: Raymond Aron est quasi-absent de La violence totalitaire, bel exploit pour un politologue français.
A l’inverse, ses influences «pirates» témoignent d’une absence d’a priori et d’une aspiration à la connaissance la plus large, qui traduisent un art de penser le monde et les hommes tout de souplesse et de circonvolutions. Livrées en vrac, les références qui parsèment La violence totalitaire, artistiques pour la plupart, parlent d’elles-mêmes: Artaud, Bloch, Breton, Céline, De Man, Hoffmansthal, Jouvenel, Klossowski, Krauss, Lukacs, Maistre, Michels, Orwell, Pareto, Vico, etc. La liste n’est pas exhaustive.
Et de fait, on ne peut rien comprendre au cheminement intellectuel de Michel Maffesoli si l’on n’a pas en tête, page après page, sa lumineuse formule: «Il y a toujours de la vie, et c’est cela qui véritablement pose problème».
Polythéisme des valeurs et néo-tribalisme
Sa réflexion va du nominalisme à l’empathie, et prône le dépassement des frontières dressées entre les divers aspects de la vie sociale et de la vie naturelle. Une nécessité dictée par les signes avant-coureurs d’une mutation de notre civilisation: achèvement du progressisme historique, accentuation a contrario du concept de temps présent, relativisation de la maîtrise bourgeoise du temps et de l’espace, remise en cause de l’exploitation de la nature, de la domination rationalisée de la société.
Une critique des Lumières donc, prémisse d’une révolution dans laquelle Maffesoli discerne le retour au polythéisme des valeurs et l’émergence d’un «néo-tribalisme diffus ne se reconnaissant plus dans les valeurs rationnelles, universelles, mécaniques qui ont marqué la modernité».
Le réveil de la communauté contre la réduction au même, la Spaltung
«En gros le [pouvoir] est l’apanage de l’Etat sous ses diverses modulations. Le pouvoir est de l’ordre de l’institué. Par contre la puissance (...) vient du bas, elle est le fondement même de l’être-ensemble»; elle est force spirituelle «indépendante des facteurs matériels, nombre et ressource» (H. Arendt).
Maffesoli récupère la Freund-Feind-Theorie de Carl Schmitt: il y a pouvoir là où il y a affaiblissement de la puissance (collective), deux facteurs indissociables et antagonistes qui composent toute constitution politique. Il reprend dans la foulée la distinction opérée par Vilfredo Pareto entre la puissance «résidus», constantes de l’activité humaine, et le pouvoir «dérivations», conceptions variables, pôle dynamique. «L’entrecroisement (des deux) constitue la trame sociale» dans un rapport de forces en équilibre toujours instable.
Parler de l’Etat, après Nietzsche, c’est «parler de la mort des peuples», tant sa logique élémentaire consiste à mettre en application l’équation «moi l’Etat, je suis le peuple».
Pour autant, le fantasme totalitaire n’est pas réductible «aux seuls fascisme et stalinisme, mais (...) il a tendance à se capillariser dans l’ensemble du monde par le biais du contrôle, de la sécurisation de l’existence ou du bonheur planifié», tel que l’exprime également l’american way of life.
Le propre du pouvoir réside dans le projet social idéalisé qu’il entend imposer, déniant «la réalité ou l’efficace des différences, des cultures, des mutations» sur la base de son idéologie positiviste.
«Une autre de ses facettes est (...) la laïcisation (...) de l’unicité salvatrice chargée d’assurer des promesses futures», dans une logique mise en évidence par Hobbes d’utilisation «du droit naturel comme substitut de la loi divine.»
Solidarité mécanique contre solidarité organique
L’unicité factice ainsi créée nie la solidarité d’ordre organique pour lui substituer une «solidarité mécanique» dont les rouages ont été mis en avant par les travaux de Durkheim. Pour asseoir sa domination, le pouvoir dispose de multiples ressorts: la lutte contre la faim, le besoin de sécurité, l’organisation du travail; autant de facteurs de déstructuration sociale qui jouent un rôle médiateur entre pouvoir et puissance.
Détenteur de la technique, le pouvoir méconnaît les limitations libérales du pouvoir par le pouvoir, du pouvoir par le savoir. La liberté abstraite véhiculée par l’égalité nie la pluralité de l’action sociale. L’anomie généralisée qu’elle suscite entraîne automatiquement le relâchement du lien communautaire. Son fondement individualiste néglige le fait que la vie individuelle découle de la vie collective, et non l’inverse. L’égalisation par l’économique achève de diluer le sens tragique du rapport désir individuel-nécessité sociétale dans ce que Maffesoli appelle «l’ennui de la sécurisation (...) ce qu’il est convenu d’appeler le progrès de la société.»
Héritage des Lumières et de l’Europe du XIXe siècle, l’idéologie technicienne amorce l’ère de la rationalité totalitaire. «La technique orientée vers une fin» selon les propos de Jürgen Habermas, qui ne manque pas de dénoncer la dérive sacralisante de la technique moderne, incarnée dans sa bureaucratie.
Mais, par bureaucratie, Maffesoli n’entend pas le poids de l’administration sur la société; il nomme «bureaucratie» le jeu démocratique même.
Idéologie technicienne et société du spectacle
«La bureaucratie de l’Etat moderne se reflète dans les partis». La prise de parole contestataire entretient «un état de tension qui lui assure dynamisme et perdurance». C’est d’ailleurs l’étymologie du verbe contester: con-tester, aller avec et non pas contre. L’opposition est avortée dans l’œuf, elle devient adjuvant de l’institution. Un consensus qui mime seulement la socialité participative. La bureaucratie n’écoute pas l’opinion atomisée, elle la met en scène périodiquement par le biais des élections, des sondages médiatisés, des enquêtes journalistiques.
On entre dans la société du spectacle de Guy Debord, qui dit que «Donner la parole, la concéder c’est déjà en empêcher l’irruption violente, c’est la châtrer de sa vertu subversive».
La Gesellschaft a vaincu la Gemeinschaft.
La révolution : «mythe européen» et «catharisme moderne»
A ce stade de son analyse, Michel Maffesoli convient que «tout pouvoir politique est conservateur», parce qu’il incarne une immanence que la circulation des élites ne fait que redynamiser. Ceci au besoin par l’action révolutionnaire, dont il désamorce la charge subversive. Sa définition de la révolution est la suivante: «La révolution est la manifestation d’une archaïque pulsion d’espérance ou d’un irrépressible désir de collectif, et en même temps le moyen par lequel s’expriment la "circulation des élites", le perfectionnement de l’idéologie productiviste et l’affermissement d’un contrôle social généralisé», «le remplacement d’un pouvoir faible par un pouvoir fort, purification sociale qui ne change rien à la structure réelle du pouvoir».
La révolution est un «mythe européen», dont «le monothéisme social» pour reprendre l’expression de Maffesoli est un projet totalitaire, est intégré au projet totalitaire intrinsèque au pouvoir. C’est le mythe prométhéen d’une société parfaite, utopique, un «catharisme moderne» dont le souci est la purification du monde. Sans ironie, on peut considérer la Compagnie de Jésus comme sa représentation la plus aboutie.
Le progressisme linéaire qui prévaut dans l’esprit révolutionnaire moderne rompt avec la présupposition d’un ordre éternel et d’une définition de la révolution comme restauration de cet ordre. Aujourd’hui, la révolution est conçue comme «un renversement violent du pouvoir établi avec l’appui des masses ou du peuple sous l’autorité de groupes animés par un programme idéologique». Cependant il est frappant de constater que, de 1789 à 1968, ce sont les mêmes références issues du passé qui ont mobilisé les énergies révolutionnaires. Chez Rousseau comme chez Marx se dessine la même rémanence d’une restauration d’une nature vraie, et perdue, de l’homme. Il n’y a pas d’épistémé, mais, dixit Bachelard, un «profil», une épaisseur épistémologique, où l’on retrouve dans des arguments divers des éléments semblables supérieurs au messianisme épiphénoménal de chaque période révolutionnaire. En ce sens, Maffesoli rejoint Freund, quand celui-ci dit que «le révolutionnaire authentique est un conservateur». «Une fois [la] fonction [révolutionnaire] accomplie [translatio imperii] sétablit un nouveau pouvoir dont le principal souci sera de juguler la révolte qui lui a donné naissance».
La révolution permanente prônée par les Robespierre, Saint-Just, Trotsky, et aussi d’une certaine manière Ernst Röhm, est une scorie phraséologique qu’il faut dépasser. Le calcul et le quantitatif doivent succéder au charisme et au qualitatif. Ce qui permet à Maffesoli de qualifier la révolution d’invariance du pouvoir et de reproduction du même. «Le révolutionnaire aime vivre dans l’ordre (...) . L’idée n’a rien de paradoxal. «La perspective révolutionnaire est réaction contre un ordre anarchique (...) elle fonctionne sur la nostalgie d’une totalité parfaite (...) où l’égalisation (...) serait le garant du bonheur total.»
La révolution annexe de l’ordre capitaliste industriel
Science, technique, raison et égalité forment autant la colonne vertébrale de la révolution que de la société de domination.
Avec Baechler, il faut mettre en exergue le fait que «le peuple ne fait jamais de révolution, mais participe à une révolution (...) le peuple ne prend jamais le pouvoir, mais aide une élite à le faire». La révolution n’est qu’une «circulation accélérée des élites», pour reprendre les termes de Jules Monnerot, un changement de vitesse et jamais un changement de structure.
On peut dire ainsi tant que l’homme sera homme, qu’à une révolution succédera une autre révolution, elle-même poursuivie par une révolution boutée par une autre révolution, dans un mouvement cyclique infini, puisqu’en finalité chaque révolution se rigidifie au contact du pouvoir, et se grippe.
La révolution est devenue l’annexe de l’ordre capitaliste industriel des XIXe et XXe siècles. Fondées sur l’idéal de «l’activité économique séparée et systématisée, et de l’individu comme personnalité autonomisée et référée comme telle», la révolution et le pouvoir sont les deux actes d’une même pièce, une tragédie appelée totalitarisme.
Le serpent «dont il faut venir à bout»
Pour conclure, et parce que, malgré tout, après la pluie revient le beau temps, je vous soumettrai en note d’espoir les quelques antidotes proposés par Michel Maffesoli pour contrer La violence totalitaire. Lesquels antidotes rejoignent par bien des aspects les positions défendues par Synergies Européennes:
-en premier, un devoir pour nous tous: «désamorcer, ainsi que le démontrait Durkheim, cette superstition d’après laquelle le législateur, doué d’un pouvoir à peu près illimité, serait capable de créer, modifier, supprimer les lois selon son bon plaisir (...) [et redécouvrir que] le droit est issu de nous, c’est-à-dire de la vie elle-même (...)»
-ensuite, restaurer l’authenticité de la question nationale dans son expression communautaire, seule formule historique qui ne cède pas à la «crispation particulariste» mais tend vers un «ailleurs universel».
-enfin, étendre l’idée incarnée dans la germanité nietzschéenne aux niveaux européen puis mondial. Briser la rationalité étriquée du centralisme étatique et bureaucratique par la dynamique de l’enracinement. Une manière d’exprimer le plus harmonieusement le développement individuel et social, et leur rapport à la nature comme nécessité.
Et puisque la révolution et le progrès sont tous deux d’essence mythique, je soulignerai que si l’Ouroubouros est le «gardien de la pérennité ancestrale» du pouvoir dans sa continuité, c’est aussi le serpent «dont il faut venir à bout». Peut-être parmi nous se trouvent déjà, ici même, les Saint-Michel, Saint-Georges, Jason ou Héraklès qui accompliront cette tâche civilisatrice.
Pour que cesse La violence totalitaire.
Laurent SCHANG.
Achevé décrire en 1979, publié chez Klincksieck depuis 1992, La violence totalitaire. Essai d’anthropologie politique de Michel Maffesoli est aussi disponible chez Desclée de Brouwer depuis cette année 1999.
00:25 Publié dans anthropologie, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 27 décembre 2007
Eric Werner: de l'extermination

Eric Werner : de l'extermination
Eric Werner, chargé de cours à l'Université de Genève, a publié plusieurs ouvrages chez L'Age d'Homme. Son dernier livre, paru en 1993, s'intitule De l'extermination et constitue un excellent remède au bourrage de crâne effectué de manière permanente par les médias officiels. Citons un court passage: « Ce qui contribue encore à compliquer le problème, c'est que l'une des dimensions privilégiées de l'extermination n'est autre aujourd'hui que la dénonciation même de l'extermination (ou la propagande dont elle est le prétexte). Car l'extermination est ce qu'elle est, mais il y a aussi ce qu'on dit qu'elle est. Il y a les mots, mais aussi les images. Les images, mais aussi les truquages. Les sens qu'on sidère et les réflexes qu’on conditionne. Les chiffres qui s'alignent et les masses qu'on décervelle. En sorte que lorsqu'on veut aujourd'hui exterminer quelqu'un, le meilleur moyen encore est de le désigner comme exterminateur. Car que mérite un exterminateur, sinon d'être lui-même exterminé? C'est un exterminateur, donc il est à exterminer ». Et voici un passage concernant l'insécurité: « On croit volontiers que l'insécurité est toujours et nécessairement en elle-même une calamité. Mais c'est là une vue par trop étroite du problème. En réalité elle joue un rôle important dans le maintien de la stabilité du système. Elle concourt utilement par exemple à démoraliser les populations, et par là même aussi à les convaincre de la vanité qu'il y aurait à vouloir s'opposer au "sens de l'histoire" (tel que le définissent les autorités). On pourrait dire aussi qu'elle a une fonction rééducative. Elle achève de réduire les individus à l'impuissance et de les mettre dans l'incapacité de ne rien entreprendre contre la nomenklatura en place. Bref, c'est un instrument efficace de contrôle social. On lui est redevable de soustraire les autorités aux désagréments liés à une hypothétique et toujours aléatoire contestation venue de la base. On comprend dès lors le soin tout particulier qu'elles mettent à la laisser se développer comme elle le fait. Elles ne disent naturellement pas qu'elles sont pour l'insécurité (non quand même), mais elles ne s'emploient pas moins à la favoriser discrètement (...). L'insécurité a parallèlement encore une autre fonction pédagogique: celle d’habituer progressivement les populations à l'absence de droit. La croyance en l'existence du droit n'a en effet de sens que dans un Etat de droit. Dans un Etat qui n' est pas de droit ou l'est de moins en moins, parce que les autorités elles-mêmes en prennent de plus en plus à leur aise avec le droit (quand elles n'en viennent pas purement et simplement, comme c'est souvent le cas, à se mettre au-dessus du droit), une telle croyance perd évidemment toute raison d'être. A la limite même, elle pourrait passer pour subversive » (P. MONTHÉLIE).
Eric WERNER, De l'extermination, Editions Thael (Case postale 4102 – CH-1002 Lausanne), 1993, 124 pages.
00:15 Publié dans Définitions, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 19 décembre 2007
El progresismo y su falta de proyecto

El progresismo y su falta de proyecto
Alberto Buela (*)
Al menos en Nuestra América la oleada de gobiernos neoliberales de los años 90 fue seguida por una serie de gobiernos progresistas de corte socialdemócratas quienes son los que hoy nos gobiernan. Y la crítica teórica más escuchada hacia estos gobiernos es que “carecen de proyecto político”. Así, Kirchner gobernó durante cuatro años Argentina sin esbozar o siquiera enunciar cuales eran las tres o cuatro ideas fuerza de su proyecto político. Pasa lo mismo con Vázquez, Bachelet, Lula y tantos otros.[1] Todos gobiernan sobre las circunstancias. Son gobiernos que no resuelven los conflictos sino que más bien los administran.
Y esa crítica a la falta o carencia de proyecto político es lo que pretendemos explicar en esta breve meditación.
Razones filosóficas
El hombre y la mujer progresista, en general, se sitúa siempre en el éxtasis temporal del futuro, ni el presente, ni mucho menos el pasado tiene para él significación alguna, y si la tuviera siempre está en función del futuro. No le interesa el ethos de la Nación histórica, incluso va contra este carácter histórico-cultural. Y esto es así, porque el progresista es su propio proyecto. El se instala siempre en el futuro pues ha adoptado la vanguardia como método. Nadie ni nada puede haber delante de él, de lo contrario dejaría de ser progresista. Así se explica que el progresista no se pueda dar un proyecto de país ni de nación porque éste se ubicaría delante de él, lo cual implica y le crea una contradicción.
Y así como nadie puede dar lo que no tiene, el progresista no puede darse ni darnos un proyecto político porque él mismo es su proyecto político.
Razones políticas
En las época del Estado de Bienestar, allá por la segunda mitad del siglo XX, los proyecto políticos expresados en los planes trienales o quinquenales eran moneda corriente de la política de antaño. Por el contrario, los proyectos han desaparecido de la política hodierna.
Es que en aquella época todavía existía la posibilidad de una política soberana, autónoma respecto de los poderes indirectos, cosa que hoy se presenta como imposible de ahí que se explique que nuestros gobiernos progresistas se transforman en convalidadores de decisiones ajenas. Y por este hecho político, trágico para nuestros pueblos de América, es que nuestros progresistas no se dan políticamente un proyecto de nación, pues tendrían que enfrentar intereses contrapuestos como son los del imperialismo y la multinacionales de la industria, el comercio y la banca. Y eso es imposible porque ellos parten del no conflicto, de la negación de la conflictividad del ser humano y sobre todo de la política como actividad agónica (de lucha). Así, al dejar de lado el carácter agónico de la política los gobiernos progresistas desprecian la política exterior (la única y verdadera política). Su gran mecanismo, entonces, es el del consenso entendido como “mito político al servicio de las oligarquías que se presentan como representantes de la sociedad” [2]. Y cuando se habla de las oligarquías lo son tanto las partidarias (las que integran los partidos políticos), las empresariales, las sindicales, las financieras, de las colectividades, las culturales, etc.
Hace ya muchos años que lo venimos afirmando una y otra vez: “sólo el disenso puede en nuestras sociedades dependientes crear teoría crítica, pues al proponer el disenso como método proponemos buscar “otro sentido”, un sentido diferente portan las cosas y las acciones de los hombres sobre ellas”[3]
Para los partidarios del consenso, los progresistas en general, la opinión pública es la opinión publicada mientas que para los sostenedores del disenso, éste debe funcionar como ruptura con la opinión publicada, para ir a la recuperación de la genuina opinión pública.
Quede pues como conclusión de este breve artículo, que la carencia de proyecto político en los gobiernos progresistas se debe a una incapacidad de la propia índole del progresismo mismo. En una palabra, su falta de proyecto político es su proyecto, siempre dependiente, nunca liberador.
(*) CeeS- Fed. del Papel - alberto.buela@gmail.com
Casilla 3198 - (1000) Buenos Aires[1] Se aplica también a gobiernos europeos del tipo de Zapatero en España, Merkel en Alemania o Prodi en Italia.
[2] Negro Pavón, Dalmacio: Desmitificación del consenso político, en Razón Española N° 145, Madrid, sep-oct 2007, p.152
[3] Buela, Alberto: Teoría del disenso, Ed. Cultura et Labor, Buenos Aires, 2004, p. 10
00:50 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 15 décembre 2007
Impact de Nietzsche sur la gauche et la droite

L'impact de Nietzsche dans les milieux politiques de gauche et de droite
par Robert Steuckers
intervention lors de la 3ième Université d'été de la FACE, Provence, juillet 1995
Analyse:
-Steven E. ASCHHEIM, The Nietzsche Legacy in Germany. 1890-1990, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1992, 337 p., ill., ISBN 0-520-07805-5.
- Giorgio PENZO, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando Editore, Roma, 1987, 359 p., 25.000 Lire.
L'objet de mon exposé n'est pas de faire de la philosophie, d'entrer dans un débat philosophique, de chercher quelle critique adresse Nietzsche, par le biais d'un aphorisme cinglant ou subtil, à Aristote, à Descartes ou à Kant, mais de faire beaucoup plus simplement de l'histoire des idées, de constater qu'il n'existe pas seulement une droite ou un pré-fascisme ou un fascisme tout court qui dérivent de Nietzsche, mais que celui-ci a fécondé tout le discours de la sociale-démocratie allemande, puis des radicaux issus de cette gauche et, enfin, des animateurs de l'Ecole de Francfort. De nos jours, c'est la ³political correctness² qui opère par dichotomies simplètes, cherche à cisailler à l'intérieur même des discours pour trier ce qu'il est licite de penser pour le séparer pudiquement, bigotement, de ce qui serait illicite pour nos cerveaux. C'est à notre sens peine perdue: Nietzsche est présent partout, dans tous les corpus, chez les socialistes, les communistes, les fascistes et les nationaux-socialistes, et, même, certains arguments nietzschéens se retrouvent simultanément sous une forme dans les théories communistes et sous une autre dans les théories fascistes.
La ³political correctness², dans sa mesquinerie, cherche justement à morceler le nietzschéisme, à opposer ses morceaux les uns aux autres, alors que la fusion de toutes les contestations à assises nietzschéennes est un impératif pour le XXIième siècle. La fusion de tous les nietzschéismes est déjà là, dans quelques cerveaux non encore politisés: elle attend son heure pour balayer les résidus d'un monde vétuste et sans foi. Mais pour balayer aussi ceux qui sont incapables de penser, à gauche comme à droite, sans ces vilaines béquilles conventionnelles que sont les manichéismes et les dualismes, opposant binairement, répétitivement, une droite figée à une gauche toute aussi figée.
La caractéristique majeure de cet impact ubiquitaire du nietzschéisme est justement d'être extrêmement diversifiée, très plurielle. L'¦uvre de Nietzsche a tout compénétré. Méthodologiquement, l'impact de la pensée de Nietzsche n'est donc pas simple à étudier, car il faut connaître à fond l'histoire culturelle de l'Allemagne en ce XXième siècle; il faut cesser de parler d'un impact au singulier mais plutôt d'une immense variété d'impulsions nietzschéennes. D'abord Nietzsche lui-même est un personnage qui a évolué, changé, de multiples strates se superposent dans son ¦uvre et en sa personne même. Le Dr. Christian Lannoy, philosophe néerlandais d'avant-guerre, a énuméré les différents stades de la pensée nietzschéenne:
1er stade: Le pessimisme esthétique, comprenant quatre phases qui sont autant de passages: a) du piétisme (familial) au modernisme d'Emerson; b) du modernisme à Schopenhauer; c) de Schopenhauer au pessimisme esthétique proprement dit; d) du pessimisme esthétique à l'humanisme athée (tragédies grecques + Wagner).
2ième stade: Le positivisme intellectuel, comprenant deux phases: a) le rejet du pessimisme esthétique et de Wagner; b) l'adhésion au positivisme intellectuel (phase d'égocentrisme).
3ième stade: Le positivisme anti-intellectuel, comprenant trois phases: a) la phase poétique (Zarathoustra); b) la phase consistant à démasquer l'égocentrisme; c) la phase de la Volonté de Puissance (consistant à se soustraire aux limites des constructions et des constats intellectuels).
4ième stade: Le stade de l'Antéchrist qui est purement existentiel, selon la terminologie catholique de Lannoy; cette phase terminale consiste à se jeter dans le fleuve de la Vie, en abandonnant toute référence à des arrière-mondes, en abandonnant tous les discours consolateurs, en délaissant tout Code (moral, intellectuel, etc.).
Plus récemment, le philosophe allemand Kaulbach, exégète de Nietzsche, voit six types de langage différents se succéder dans l'¦uvre de Nietzsche: 1. Le langage de la puissance plastique; 2. Le langage de la critique démasquante; 3. Le style du langage expérimental; 4. L'autarcie de la raison perspectiviste; 5. La conjugaison de ces quatre premiers langages nietzschéens (1+2+3+4), contribuant à forger l'instrument pour dépasser le nihilisme (soit le fixisme ou le psittacisme) pour affronter les multiples facettes, surprises, imprévus et impondérables du devenir; 6. L'insistance sur le rôle du Maître et sur le langage dionysiaque.
Ces classifications valent ce qu'elles valent. D'autres philosophes pourront déceler d'autres étapes ou d'autres strates mais les classifications de Lannoy et Kaulbach ont le mérite de la clarté, d'orienter l'étudiant qui fait face à la complexité de l'¦uvre de Nietzsche. L'intérêt didactique de telles classifications est de montrer que chacune de ces strates a pu influencer une école, un philosophe particulier, etc. De par la multiplicité des approches nietzschéennes, de multiples catégories d'individus vont recevoir l'influence de Nietzsche ou d'une partie seulement de Nietzsche (au détriment de tous les autres possibles). Aujourd'hui, on constate en effet que la philosophie, la philologie, les sciences sociales, les idéologies politiques ont receptionné des bribes ou des pans entiers de l'¦uvre nietzschéenne, ce qui oblige les chercheurs contemporains à dresser une taxinomie des influences et à écrire une histoire des réceptions, comme l'affirme, à juste titre, Steven E. Aschheim, un historien américain des idées européennes.
Nietzsche: mauvais génie ou héraut impavide?
Aschheim énumère les erreurs de l'historiographie des idées jusqu'à présent:
- Ou bien cette historiographie est moraliste et considère Nietzsche comme le ³mauvais génie² de l'Allemagne et de l'Europe, ³mauvais génie² qui est tour à tour ³athée² pour les catholiques ou les chrétiens, ³pré-fasciste ou pré-nazi² pour les marxistes, etc.
- Ou bien cette historiographie est statique, dans ses variantes apologétiques (où Nietzsche apparaît comme le ³héraut² du national-socialisme ou du fascisme ou du germanisme) comme dans ses variantes démonisantes (où Nietzsche reste constamment le mauvais génie, sans qu'il ne soit tenu compte des variations dans son ¦uvre ou de la diversité de ses réceptions).
Or pour juger la dissémination de Nietzsche dans la culture allemande et européenne, il faut: 1. Saisir des processus donc 2. avoir une approche dynamique de son ¦uvre.
Le bilan de cette historiographie figée, dit Aschheim, se résume parfaitement dans les travaux de Walter Kaufmann et d'Arno J. Mayer. Walter Kaufmann démontre que Nietzsche a été mésinterprété à droite par sa s¦ur, Elisabeth Förster-Nietzsche, par Stefan George, par Ernst Bertram et Karl Jaspers. Mais aussi dans le camp marxiste après 1945, notamment par Georg Lukacs, communiste hongrois, qui a dressé un tableau général de ce qu'il faut abroger dans la pensée européenne, ce qui revient à rédiger un manuel d'inquisition, dont s'inspirent certains tenants actuels de la ³political correctness². Lukacs accuse Nietzsche d'irrationalité et affirme que toute forme d'irrationalité conduit inéluctablement au nazisme, d'où tout retour à Nietzsche équivaut à recommencer un processus ³dangereux². L'erreur de cette interprétation c'est de dire que Nietzsche ne suscite qu'une seule trajectoire et qu'elle est dangereuse. Cette vision est strictement linéaire et refuse de dresser une cartographie des innombrables influences de Nietzsche.
Arno J. Mayer rappelle que Nietzsche a été considéré par certains exégètes marxisants comme le héraut des classes aristocratiques dominantes en Allemagne à la fin du XIXième siècle. L'insolence de Nietzsche aurait séduit les plus turbulents représentants de cette classe sociale. Aschheim estime que cette thèse est une erreur d'ordre historique. En effet, l'aristocratie dominante, à cette époque-là en Allemagne, est un milieu plutôt hostile à Nietzsche. Pourquoi? Parce que l'anti-christianisme de Nietzsche sape les assises de la société qu'elle domine. L'³éthique aristocratique² de Nietzsche est fondamentalement différente de celle des classes dominantes de la noblesse allemande du temps de Bismarck. Par conséquent, Nietzsche est jugé ³subversif, pathologique et dangereux². La ³droite² (en l'occurrence la ³révolution conservatrice²) ne l'utilisera surtout qu'après 1918.
Les ³transvaluateurs²
Hinton Thomas, historien anglais des idées européennes, constate effectivement que Nietzsche est réceptionné essentiellement par des dissidents, des radicaux, des partisans de toutes les formes d'émancipation, des socialistes (actifs dans la social-démocratie), des anarchistes et des libertaires, par certaines féministes. Thomas nomme ces dissidents des ³transvaluateurs². La droite révolutionnaire allemande, post-conservatrice, se posera elle aussi comme ³transvaluatrice² des idéaux bourgeois, présents dans l'Allemagne wilhelmienne et dans la République de Weimar. Hinton Thomas concentre l'essentiel de son étude aux gauches nietzschéennes, en n'oubliant toutefois pas complètement les droites. Son interprétation n'est pas unilatérale, dans le sens où il explore deux filons de droite où Nietzsche n'a peut-être joué qu'un rôle mineur ou, au moins, un rôle de repoussoir: l'Alldeutscher Verband (la Ligue Pangermaniste) et l'univers social-darwiniste, plus particulièrement le groupe des ³eugénistes².
En somme, on peut dire que Nietzsche rejette les systèmes, son anti-socialisme est un anti-grégarisme mais qui est ignoré, n'est pas pris au tragique, par les militants les plus originaux du socialisme allemand de l'époque. Les intellectuels sociaux-démocrates s'enthousiasment au départ pour Nietzsche mais dès qu'ils établissent dans la société allemande leurs structures de pouvoir, ils se détachent de l'anarchisme, du criticisme et de la veine libertaire qu'introduit Nietzsche dans la pensée européenne. La social-démocratie cesse d'être pleinement contestatrice pour participer au pouvoir. Roberto Michels appelera ce glissement dans les conventions la Verbonzung, la ³bonzification², où les chefs socialistes perdent leur charisme révolutionnaire pour devenir les fonctionnaires d'une mécanique partitocratique, d'une structure sociale participant en marge au pouvoir. Seuls les libertaires comme Landauer et Mühsam demeurent fidèles au message nietzschéen. Enfin, au-delà des clivages politiques usuels, Nietzsche introduit dans la pensée européenne un ³style² (qui peut toujours s'exprimer de plusieurs façons possibles) et une notion d'³ouverture², impliquant, pour ceux qui savent reconnaître cette ouverture-au-monde et en tirer profit, une dynamique permanente d'auto-réalisation. L'homme devient ce qu'il est au fond de lui-même dans cette tension constante qui le porte à aller au-devant des défis et des mutations, sans frilosité rédhibitoire, sans nostalgies incapacitantes, sans rêves irréels.
Enfin, Nietzsche a été lu majoritairement par les socialistes avant 1914, par les ³révolutionnaires-conservateurs² (et éventuellement par les fascistes et les nationaux-socialistes) après 1918. Aujourd'hui, il revient à un niveau non politique, notamment dans le ³nietzschéisme français² d'après 1945.
L'impact de Nietzsche sur le discours socialiste avant 1914 en Allemagne
En Allemagne, mais aussi ailleurs, notamment en Italie avec Mussolini, alors fougueux militant socialiste, ou en France, avec Charles Andler, Daniel Halévy et Georges Sorel, la philosophie de Nietzsche séduit principalement les militants de gauche. Mais non ceux qui sont strictement orthodoxes, comme Franz Mehring, que les nietzschéens socialistes considèrent comme le théoricien d'un socialisme craintif et procédurier, fort éloigné de ses tumultueuses origines révolutionnaires. Franz Mehring, gardien à l'époque de l'orthodoxie figée, évoque une stricte filiation philosophie ‹en dehors de laquelle il n'y a point de salut!‹ partant de Hegel pour aboutir à Marx et à la pratique routinière, sociale et parlementariste, de la sociale-démocratie wilhelminienne. Face à ce marxisme conventionnel et frileux, les gauches dissidentes opposent Nietzsche ou l'un ou l'autre linéament de sa philosophie. Ces gauches dissidentes conduisent à un anarchisme (plus ou moins dionysiaque), à l'anarcho-syndicalisme (un des filons du futur fascisme) ou au communisme. Ainsi, Isadora Duncan, une journaliste anglaise qui couvre, avec sympathie, les événements de la Révolution Russe pour L'Humanité, écrit en 1921: "Les prophéties de Beethoven, de Nietzsche, de Walt Whitman sont en train de se réaliser. Tous les hommes seront frères, emportés par la grande vague de libération qui vient de naître en Russie". On remarquera que la journaliste anglaise ne cite aucun grand nom du socialisme ou du marxisme! La gauche radicale voit dans la Révolution Russe la réalisation des idées de Beethoven, de Nietzsche ou de Whitman et non celles de Marx, Engels, Liebknecht (père), Plekhanov, Lénine, etc.
Pourquoi cet engouement? Selon Steven Aschheim, les radicaux maximalistes dans le camp des socialistes se réfèrent plus volontiers à la critique dévastatrice du bourgeoisisme (plus exactement: du philistinisme) de Nietzsche, car cette critique permet de déployer un ³contre-langage², dissolvant pour toutes les conventions sociales et intellectuelles établies, qui permettent aux bourgeoisies de se maintenir à la barre. Ensuite, l'idée de ³devenir² séduit les révolutionnaires permanents, pour qui aucune ³superstructure² ne peut demeurer longtemps en place, pour dominer durablement les forces vives qui jaillissent sans cesse du ³fond-du-peuple².
En fait, dès la fin de la première décennie du XXième siècle, la sociale-démocratie allemande et européenne subit une mutation en profondeur: les radicaux abandonnent les conventions qui se sont incrustées dans la pratique quotidienne du socialisme: en Allemagne, pendant la première guerre mondiale, les militants les plus décidés quittent la SPD pour former d'abord l'USPD puis la KPD (avec Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht); en Italie, une aile anarcho-syndicaliste se détache des socialistes pour fusionner ultérieurement avec les futuristes de Marinetti et les arditi revenus des tranchées, ce qui donne, sous l'impulsion de la personnalité de Mussolini, le syncrétisme fasciste; etc.
le socialisme: une révolte permanente contre les superstructures
Par ailleurs, dès 1926, l'Ecole de Francfort commence à déployer son influence: elle ne rejette pas l'apport de Nietzsche; après les vicissitudes de l'histoire allemande, du nazisme et de l'exil américain de ses principaux protagonistes, cette Ecole de Francfort est à l'origine de l'effervescence de mai 68. Dans toutes ces optiques, le socialisme est avant toutes choses une révolte contre les superstructures, jugées dépassées et archaïques, mais une révolte chaque fois différente dans ses démarches et dans son langage selon le pays où elle explose. A cette révolte socialiste contre les superstructures (y compris les nouvelles superstructures rationnelles et trop figées installées par la sociale-démocratie), s'ajoute toute une série de thématiques, comme celles de l'³énergie² (selon Schiller et surtout Bergson; ce dernier influençant considérablement Mussolini), de la volonté (que l'on oppose chez les dissidents radicaux du socialisme à la doctrine sociale-démocrate et marxiste du déterminisme) et la vitalité (thématique issue de la ³philosophie de la Vie², tant dans ses interprétations laïques que catholiques).
Une question nous semble dès lors légitime: cette évolution est-elle 1) marginale, réduite à des théoriciens ou à des cénacles intellectuels, ou bien 2) est-elle vraiment bien capillarisée dans le parti? Steven Aschheim, en concluant son enquête minutieuse, répond: oui. Il étaye son affirmation sur les résultats d'une enquête ancienne, qu'il a analysée méticuleusement, celle d'Adolf Levenstein en 1914. Levenstein avait procédé en son temps à une étude statistique des livres empruntés aux bibliothèques ouvrières de Leipzig entre 1897 et 1914. Levenstein avait constaté que les livres de Nietzsche étaient beaucoup plus lus que ceux de Marx, Lassalle ou Bebel, figures de proue de la sociale-démocratie officielle. Cette étude prouve que le nietzschéisme socialiste était une réalité dans le c¦ur des ouvriers allemands.
"Die Jungen" de Bruno Wille, "Der Sozialist" de Gustav Landauer
En Allemagne, la première organisation socialiste/nietzschéenne était Die Jungen (Les Jeunes) de Bruno Wille. Celui-ci entendait combattre l'³accomodationnisme² de la sociale-démocratie, son embourgeoisement (rejoignant par là Roberto Michels, analyste de l'oligarchisation des partis), le culte du parlementarisme (rejoignant Sorel et anticipant les deux plus célèbres soréliens allemands d'après 1918: Ernst Jünger et Carl Schmitt), l'ossification du parti et sa bureaucratisation (Michels). Plus précisément, Wille déplore la disparition de tous les réflexes créatifs dans le parti; l'imagination n'est plus au pouvoir dans la sociale-démocratie allemande du début de notre siècle, tout comme aujourd'hui, avec l'accession au pouvoir des anciens soixante-huitards, l'imagination, pourtant bruyamment promise, n'a plus du tout droit au chapitre, ³political correctness² oblige. Ensuite, autre contestataire fondamental dans les rangs socialistes allemands, Gustav Landauer (1870-1919), qui tombera les armes à la main dans Munich investie par les Corps Francs de von Epp, fonde une revue libertaire, socialiste et nietzschéenne, qu'il baptise Der Sozialist. Chose remarquable, son interprétation de Nietzsche ignore le culte nietzschéen de l'égoïté, l'absence de toute forme de solidarité ou de communauté chez le philosophe de Sils-Maria, pour privilégier très fortement sa fantaisie créatrice et sa critique de toutes les pétrifications à l'¦uvre dans les sociétés et les civilisations modernes et bourgeoises.
Max Maurenbrecher et Lily Braun
Max Maurenbrecher (1874-1930), est un pasteur protestant socialiste qui a foi dans le mouvement ouvrier tout en se référant constamment à Nietzsche et à sa critique du christianisme. La première intention de Maurenbrecher a été justement de fusionner socialisme, nietzschéisme et anti-christianisme. Son premier engagement a lieu dans le Nationalsozialer Verein de Naumann en 1903. Son deuxième engagement le conduit dans les rangs de la sociale-démocratie en 1907, au moment où il quitte aussi l'église protestante et s'engage dans le ³mouvement religieux libre². Son troisième engagement est un retour vers son église, un abandon de toute référence à Marx et à la sociale-démocratie, assortis d'une adhésion au message des Deutschnationalen. Maurenbrecher incarne donc un parcours qui va du socialisme au nationalisme.
Lily Braun, dans l'univers des intellectuels socialistes du début du siècle, est une militante féministe, socialiste et nietzschéenne. Elle s'engage dans les rangs sociaux-démocrates, où elle plaide la cause des femmes, réclame leur émancipation et leur droit au suffrage universel. Ce féminisme est complété par une critique systématique de tous les dogmes et par une esthétique nouvelle. Son apport philosophique est d'avoir défendu l'³esprit de négation² (Geist der Verneinung), dans le sens où elle entendait par ³négation², la négation de toute superstructure, des ossifications repérables dans les superstructures sociales. En ce sens, elle annonce certaines démarches de l'Ecole de Francfort. Lily Braun plaidait en faveur d'une juvénilisation permanente de la société et du socialisme. Elle s'opposait aux formes démobilisantes du moralisme kantien. Pendant la première guerre mondiale, elle développe un ³socialisme patriotique² en arguant que l'Allemagne est la patrie de la sociale-démocratie, et qu'en tant que telle, elle lutte contre la France bourgeoise, l'Angleterre capitaliste et marchande et la Russie obscurantiste. Son néo-nationalisme est une sociale-démocratie nietzschéanisée perçue comme nouvelle idéologie allemande. La constante du message de Lily Braun est un anti-christianisme conséquent, dans le sens où l'idéologie chrétienne est le fondement métaphysique des superstructures en Europe et que toute forme de fidélité figée aux idéologèmes chrétiens sert les classes dirigeantes fossilisées à maintenir des superstructures obsolètes.
Contre le socialisme nietzschéen, la riposte des ³bonzes²
Avec Max Maurenbrecher et Lily Braun, nous avons donc deux figures maximalistes du socialisme allemand qui évoluent vers le nationalisme, par nietzschéanisation. Cette évolution, les ³bonzes² du parti l'observent avec grande méfiance. Ils perçoivent le danger d'une mutation du socialisme en un nationalisme populaire et ouvrier, qui rejette les avocats, les intellectuels et les nouveaux prêtres du positivisme sociologique. Les ³bonzes² organisent donc leur riposte intellectuelle, qui sera une réaction anti-nietzschéenne. Le parallèle est facile à tracer avec la France actuelle, où Luc Ferry et Alain Renaut critiquent l'héritage de mai 68 et du nietzschéisme français des Deleuze, Guattari, Foucault, etc. Le mitterrandisme tardif, très ³occidentaliste² dans ses orientations (géo)politiques, s'alignent sur la contre-révolution moraliste américaine et sur ses avatars de droite (Buchanan, Nozick) ou de gauche, en s'attaquant à des linéaments philosophiques capables de ruiner en profondeur ‹et définitivement‹ les assises d'une civilisation moribonde, qui crève de sa superstition idéologique et de son adhésion inconditionnelle aux idéaux fluets et chétifs de l'Aufklärung. L'intention de Ferry et Renaut est sans doute de bloquer le nietzschéisme français, afin qu'il ne se mette pas au service du lepénisme ou d'un nationalisme post-lepéniste. Démarche bizarre. Curieux exercice. Plus politicien-policier que philosophique...
Kurt Eisner: nietzschéen repenti
L'exemple historique le plus significatif de ce type de réaction, nous le trouvons chez Kurt Eisner, Président de cette République des Soviets de Bavière (Räterepublik), qui sera balayée par les Corps Francs en 1919. Avant de connaître cette aventure politique tragique et d'y laisser la vie, Eisner avait écrit un ouvrage orthodoxe et anti-nietzschéen, intitulé Psychopathia Spiritualis, qui a comme plus remarquable caractéristique d'être l'¦uvre d'un ancien nietzschéen repenti! Quels ont été les arguments d'Eisner? Le socialisme est rationnel et pratique, disait-il, tandis que Nietzsche est rêveur, onirique. Il est donc impossible de construire une idéologie socialiste cohérente sur l'égocentrisme de Nietzsche et sur son absence de compassion (ce type d'argument sera plus tard repris par certains nationaux-socialistes!). Ensuite, Eisner constate que l'³impératif nietzschéen² conduit à la dégénérescence des m¦urs et de la politique (même argument que le ³conservateur² Steding). A l'injonction ³devenir dur!² de Nietzsche, Eisner oppose un ³devenir tendre!², pratiquant de la sorte un exorcisme sur lui-même. Eisner dans son texte avoue avoir succombé au ³langage intoxicateur² et au ³style narcotique² de Nietzsche. Contrairement à Lily Braun et polémiquant sans doute avec elle, Eisner s'affirme kantien et explique que son kantisme est paradoxalement ce qui l'a conduit à admirer Nietzsche, car, pour Eisner, Kant, tout comme Nietzsche, met l'accent sur le développement libre et maximal de l'individu, mais, ajoute-t-il, l'impératif nietzschéen doit être collectivisé, de façon à susciter dans la société et la classe ouvrière un pan-aristocratisme (Heinrich Härtle, ancien secrétaire d'Alfred Rosenberg, développera un argumentaire similaire, en décrivant l'idéologie nationale-socialiste comme un mixte d'impératif éthique kantien et d'éthique du surpassement nietzschéenne, le tout dans une perspective non individualiste!).
Si Eisner est le premier nietzschéen à faire machine arrière, à amorcer dans le camp socialiste une critique finalement ³réactionnaire² et ³figeante² de Nietzsche et du socialisme nietzschéen, si Ferry et Renaut sont ses héritiers dans la triste France du mitterrandisme tardif, Georg Lukacs, avec une trilogie inquisitoriale fulminant contre les mutliples formes d'³irrationalisme² conduisant au ³fascisme², demeure la référence la plus classique de cette manie obsessionnelle et récurrente de biffer les innombrables strates de nietzschéisme. Pourtant, Lukacs était vitaliste dans sa jeunesse et cultivait une vision tragique de l'homme, de la vie et de l'histoire inspirée de Nietzsche; après 1945, il rédige cette trilogie contre les irrationalismes qui deviendra la bible de la ³political correctness² de Staline à Andropov et Tchernenko dans les pays du COMECON, chez les marxistes qui se voulaient orthodoxes. Pourtant, les traces du nietzschéisme sont patentes dans la gauche nietzschéenne, chez Bloch et dans l'Ecole de Francfort.
Les gauchistes nietzschéens
Par gauchisme nietzschéen, Aschheim entend l'héritage d'Ernst Bloch et d'une partie de l'Ecole de Francfort. Ernst Bloch a eu une grande influence sur le mouvement étudiant allemand qui a précédé l'effervescence de mai 68. Une amitié fidèle et sincère le liait au leader de ces étudiants contestataires, Rudy Dutschke, apôtre protestant d'un socialisme gauchiste et national. Bloch opère une distinction fondamentale entre ³marxisme froid² et ³marxisme chaud². Ce dernier postule un retour à la religion, ou, plus exactement, à l'utopisme religieux des anabaptistes, mus par le ³principe espérance². Lukacs ne ménagera pas ses critiques, et s'opposera à Bloch, jugeant son ¦uvre comme ³un mélange d'éthique de gauche avec une épistémologie de droite². Bloch est toutefois très critique à l'égard de la vision de Nietzsche qu'avait répandue Ludwig Klages. Bloch la qualifiera de ³dionysisme passéiste², en ajoutant que Nietzsche devait être utilisé dans une perspective ³futuriste², afin de ³modeler l'avenir². Bloch rejette toutefois la notion d'éternel retour car toute idée de ³retour² est profondément statique: Bloch parle d'³archaïsme castrateur². Le dionysisme que Bloch oppose à celui de Klages est un dionysisme de la ³nature inachevée², c'est-à-dire un dionysisme qui doit travailler à l'achèvement de la nature.
Bloch n'appartient pas à l'Ecole de Francfort; il en est proche; il l'a influencée mais ses idées religieuses et son ³principe espérance² l'éloignent des deux chefs de file principaux de cette école, Horkheimer et Adorno. Les puristes de l'Ecole de Francfort ne croient pas à la rédemption par le principe espérance, car, disent-il, ce sont là des affirmations para-religieuses et a-critiques. Dans leurs critiques des idéologies (y compris des idéologies post-marxistes), les principaux protagonistes de l'Ecole de Francfort se réfèrent surtout au ³Nietzsche démasquant², dont ils utilisent les ressources pour démasquer les formes d'oppression dans la modernité tardive. Leur but est de sauver la théorie critique, et même toute critique, pour exercer une action dissolvante sur toutes les superstructures léguées par le passé et jugées obsolètes. Dans ce sens, Nietzsche est celui qui défie au mieux toutes les orthodoxies, celui dont le ³langage démasquant² est le plus caustique; Adorno justifiait ses références à Nietzsche en disant: "Il n'est jamais complice avec le monde". A méditer si l'on ne veut pas être le complice du ³Nouvel Ordre Mondial²...
Marcuse: un nietzschéisme de libération
Quant à Marcuse, souvent associé à l'Ecole de Francfort, que retient-il de Nietzsche? L'historiographie des idées retient souvent deux Marcuse: un Marcuse pessimiste, celui de L'homme unidimensionnel, et un Marcuse optimiste, celui d'Eros et civilisation. Pour Steven Aschheim, c'est ce Marcuse optimiste ‹il met beaucoup d'espoir dans son discours‹ qui est peut-être le plus ³nietzschéen². Son nietzschéisme est dès lors un nietzschéisme de libération, teinté de freudisme, dans le sens où Marcuse développe, au départ de sa double lecture de Nietzsche et de Freud, l'idée d'un ³pouvoir libérateur du souvenir². Jadis, la mémoire servait à se souvenir de devoirs, d'autant de ³tu dois², suscitant tout à la fois l'esprit de péché, la mauvaise conscience, le sens de la culpabilité, sur lesquels le christianisme s'est arcbouté et a imprégné notre civilisation. Cette mémoire-là ³transforme des faits en essences², fige des bribes d'histoire peut-être encore féconds pour en faire des absolus métaphysiques pétrifiés et fermés, qu'on ne peut plus remettre en question; pour Nietzsche, comme pour le Marcuse optimiste d'Eros et civilisation, il faut évacuer les brimades et les idoles qu'a imposées cette mémoire-là, car les instincts de vie (pour Freud: l'aspiration au bonheur total, entravée par la répression et les refoulements), doivent toujours, finalement, avoir le dessus, en rejettant sans hésiter toutes les formes d'³escapismes² et de négation. Pour Marcuse, en cela élève de Nietzsche, la civilisation occidentale et son pendant socialiste soviétique (Nietzsche aurait plutôt parlé du christianisme) sont fondamentalement fallacieux (parce que sur-répressifs) (*) car ils conservent trop d'essences, d'interdits, et étouffent les créativités, l'Eros. On retrouve là les mêmes mécanismes de pensée que chez un Landauer.
La ³science mélancolique² d'Adorno
Adorno, dans Minima Moralia, se réfère à la dialectique négative de Nietzsche et se félicite du fait que cette négation nietzschéenne permanente ne conduit à l'affirmation d'aucune positivité qui, le cas échéant, pourrait se transformer en une nouvelle grande idole figée. Mais, Adorno, contrairement à Nietzsche, ne prône pas l'avènement d'un ³gai savoir² ou d'une ³gaie science², mais espère l'avènement d'une ³science mélancolique², sorte de scepticisme méfiant à l'endroit de toute forme d'affirmation joyeuse. Adorno se démarque ainsi du ³panisme² de Bloch, des idées claires et tranchées d'un Wille ou d'une Lily Braun, du communautarisme socialiste d'un Landauer ou, anticipativement, du ³gai savoir² d'un philosophe nietzschéen français comme Gilles Deleuze. Pour Adorno, la joie ne doit pas tout surplomber.
Pour Aschheim, l'Ecole de Francfort adopte alternativement deux attitudes face à ce que Lukacs, dans sa célèbre polémique pro-rationaliste, a qualifié d'³irrationalisme². Selon les circonstances, l'Ecole de Francfort distingue entre, d'une part, les irrationalismes féconds, qui permettent la critique des superstructures (dans ce qu'elles ont de figé) et/ou des institutions (dans ce qu'elles ont de rigide) et, d'autre part, les irrationalismes réactionnaires qui affirment brutalement des valeurs en dépit de leur obsolescence et de leur fonction au service du maintien de hiérarchies désuètes.
A quoi sert la ³political correctness²?
Aschheim constate que l'idéologie des Lumières introduit et généralise dans la pensée européenne le relativisme, le subjectivisme, etc. qui développent, dans un premier temps, une dynamique critique, puis retournent cette dynamique contre le sujet érigé comme absolu dans la civilisation occidentale par les tenants de l'Aufklärung eux-mêmes. Ce que Ferry a appelé la ³pensée-68² est justement cette idéologie des Lumières qui devient justement sans cesse plus intéressante, en ses stades ultimes, parce qu'elle retourne sa dynamique relativiste et perspectiviste contre l'idole-sujet. Ferry estime que ce retournement est allé trop loin, dans les ¦uvres de philosophes français tels Deleuze, Guattari, Foucault,... La ³pensée-68² sort donc de l'Aufklärung stricto sensu et travaille à dissoudre le sacro-saint sujet, pierre angulaire des régimes libéraux, pseudo-démocratiques, nomocratiques et/ou ploutocratiques, axés sur l'individualisme juridique, sur la méthodologie individualiste en économie et en sociologie. Par conséquent, contre l'avancée de l'Aufklärung jusqu'à ses conséquences ultimes, avancée qui risque de faire voler en éclat des cadres institutionnels vermoulus qui ne peuvent plus se justifier philosophiquement, un personnel composite de journalistes, de censeurs médiatiques, de fonctionnaires, de juristes et de philosophes-mercenaires doit imposer une ³correction politique², afin de restituer le sujet dans sa plénitude et sa ³magnificence² d'idole, afin de promouvoir et de consolider une restauration néo-libérale.
Revenons toutefois à Aschheim, qui cherche à remettre clairement en évidence les linéaments de nietzschéisme dans l'Ecole de Francfort, tout en montrant par quelles portes entrouvertes la correction politique, sur le modèle des Mehring, Eisner, Lukacs, Ferry, etc., peut simultanément s'insinuer dans ce discours. Horkheimer, chef de file de cette Ecole de Francfort et philosophe quasi officiel de la première décennie de la RFA, juge Nietzsche comme suit: le philosophe de Sils-Maria est incapable de reconnaître l'importance de la ³société concrète² (**) dans ses analyses, mais, en dépit de cette lacune, inacceptable pour ceux qui ont été séduits, d'une façon ou d'une autre, par le matérialisme historique de la tradition marxiste, Nietzsche demeure toujours libre de toute illusion et voit et sent parfaitement quand un fait de vie se fige en ³essence² (pour reprendre le vocabulaire de Marcuse). Horkheimer ajoute que Nietzsche ³ne voit pas les origines sociales des déclins². Position évidemment ambivalente, où admiration et crainte se mêlent indissolublement.
Nietzsche, le maître en ³misologie²
En 1969, J. G. Merquior, dans Western Marxism, ouvrage qui analyse les ressorts du ³marxisme occidental², rappelle le rôle joué par les diverses lectures de Nietzsche dans l'émergence de ce phénomène un peu paradoxal de l'histoire des idées; Nietzsche, disait Merquior, est un ³maître en misologie² (néologisme désignant l'opposition radicale des irrationalistes à l'endroit de la raison voire de la logique). Cette misologie transparaît le plus clairement dans la Généalogie de la morale (1887), où Nietzsche dit que ³n'est définissable que ce qui n'a pas d'histoire²; en effet, on ne peut enfermer dans des concepts durables que ce qui n'a plus de potentialités en jachère, car des potentialités insoupçonnées peuvent à tout moment surgir et faire éclater le cadre définitionnel comme une écorce devenue trop étroite.
Notre point de vue dans ce débat sur l'Ecole de Francfort: cette école critique à juste titre l'étroitesse des vieilles institutions, lois, superstructures, qui se maintiennent envers et contre les mouvements de la vie, mais, dans la foulée de sa critique, elle heurte et tente d'effacer des legs de l'histoire qui gardent en jachère des potentialités réelles, en les jugeant a priori obsolètes. Elle n'utilise qu'une panoplie d'armes, celles de la seule critique, en omettant systématiquement de retourner les forces vives et potentielles des héritages historiques contre les fixations superstructurelles, les manifestations institutionnelles reflètant dans toutes leurs rigidités les épuisements vitaux, et les processus de dévitalisation (ou de désenchantement). Bloch, en dépit de ses références aux théologies de libération et aux messianismes révolutionnaires, abandonne au fond lui aussi l'histoire politique, militaire et non religieuse ‹c'est du moins le risque qu'il court délibérément en déployant sa critique contre Klages‹ pour construire dans ses anticipations quasi oniriques un futur somme toute bien artificiel voire fragile. Son recours aux luttes est à l'évidence pleinement acceptable, mais ce recours ne doit pas se limiter aux seules révoltes motivées par des messianismes religieux, il doit s'insinuer dans des combats pluriséculaires à motivations multiples. Adorno et Horkheimer abandonnent eux aussi l'histoire, la notion d'une continuité vitale et historique, au profit du magma informe et purement ³présent², sans profondeur temporelle, de la ³société² (erreur que l'on a vu se répéter récemment au sein de la fameuse ³nouvelle droite² parisienne, où l'histoire est étrangement absente et le pilpoul sociologisant, nettement omniprésent). Le risque de ce saltus pericolosus, d'Adorno et Horkheimer, dit Siegfried Kracauer (in: History: The Last Things Before the Last, New York, OUP, 1969), est de perdre tout point d'appui solide pour capter les plus fortes concrétions en devenir qui seront marquées de durée; pour Kracauer la ³dialectique négative² des deux principaux parrains de l'Ecole de Francfort ³manque de direction et de contenu². Tout comme les ratiocinations jargonnantes et sociologisantes d'Alain de Benoist et de sa bande de jeunes perroquets.
L'entreprise de ³dé-nietzschéanisation² de Habermas
Si Nietzsche a été bel et bien présent, et solidement, dans le corpus de l'Ecole de Francfort, il en a été expulsé par une deuxième vague de ³dialecticiens négatifs² et d'apôtres, sur le tard, de l'idéologie des Lumières. Le chef de file de cette deuxième vague, celle des émules, a été sans conteste Jürgen Habermas. Aschheim résume les objectifs de Habermas dans son travail de ³dé-nietzschéanisation²: a) ¦uvrer pour expurger les legs de l'Ecole de Francfort de tout nietzschéisme; b) rétablir une cohérence rationnelle; c) re-coder (!) (Deleuze et Foucault avaient dissous les codes); d) reconstruire une ³correction politique²; e) réexaminer l'héritage de mai 68, où, pour notre regard, il y a quelques éléments très positifs et féconds, surtout au niveau de ce que Ferry et Renaut appelerons la ³pensée-68²; dans ce réexamen, Habermas part du principe que la critique de la critique de l'Aufklärung, risque fortement de déboucher sur un ³néo-conservatisme²; de ce fait, il entend militer pour le rétablissement de la ³dialectique de l'Aufklärung² dans sa ³pureté² (ou dans ce qu'il veut bien désigner sous ce terme). Pour Habermas, le nietzschéisme français, le néo-heideggerisme, le post-structuralisme de Foucault, le déconstructivisme de Derrida, sont autant de filons de 68 qui ont chaviré dans ³l'irrationalisme bourgeois tardif². Or ces démarches philosophiques non-politiques, ou très peu politisables, ne se posent nullement comme des options militantes en faveur d'un conservatisme ou d'une restauration ³bourgeoise², bien au contraire, on peut conclure que Habermas déclenche une guerre civile à l'intérieur même de la gauche et cherche à émasculer celle-ci, à la repeindre en gris. Dans son combat, Habermas s'attaque explicitement aux notions d'hétérogénité (de pluralité), de jeu (de tragique, de kaïros tel que l'imaginait un Henri Lefebvre), de rire, de contradiction (implicite et incontournable), de désir, de différence. Selon Habermas, toutes ces notions conduisent soit au ³gauchisme radical² soit à l'³anarchisme nihiliste² soit au ³quiétisme conservateur². De telles attitudes, prétend Habermas, sont incapables d'envisager un changement chargé de sens (i. e. un sens progressiste et modéré, évolutionnaire et calculant). D'où Habermas, et à sa suite Ferry et Renaut, estiment être les seuls habilités à énoncer le sens, lequel est alors posé a priori, imposé d'autorité. Le libéralisme ou le démocratisme que habermas, Ferry et Renaut entendent représenter sont dès lors les produits d'une autorité, en l'occurence la leur et celle de ceux qui les relaient dans les médias.
Le libéralisme et le démocratisme autoritaires (sur le plan intellectuel), mais en apparence tolérants sur le plan pratique, constituent en fait le fondement de notre actuelle ³political correctness² qui se marie très bien avec le pouvoir des ³socialistes établis², héritiers du social-démocratisme à la Mehring, et flanqués des orthodoxes marxistes dévitalisés à la Lukacs. Cette alliance vise à remplacer un autoritarisme par un autre, une superstructure par une autre, qui serait le réseau des notables, des mafieux et des fonctionnaires socialistes. Une telle constellation idéologique renonce à émanciper continuellement les masses, les citoyens, les esprits mais entend installer un appareil inamovible (au besoin en noyautant les services de police, comme c'est le cas des socialistes en Belgique qui transforment la gendarmerie, déjà Etat dans l'Etat, en une armée au service du ministère de l'intérieur socialiste, tenu par un ancien gauchiste adepte de la marijuana). Cette constellation idéologique et politique refuse de réceptionner l'innovation, de quelqu'ordre qu'elle soit, et les rénégats de 68, les repentis à la façon d'Eisner, trahissent les intellectuels féconds de leur propre camp de départ, pour déboucher sur un discours sans relief, sans sel.
Donc l'aventure commencée par Die Jungen autour de Wille est un échec au sein de la sociale-démocratie. Ses forces dynamiques vont-elles aller vers un nouveau fascisme? Il semble que la sociale-démocratie n'écoute pas les leçons de l'histoire et qu'en alignant à l'université des Habermas, des Ferry et des Renaut, ou en manipulant des groupes de choc violents, ou en animant des cercles conspirationnistes parallèles comme le CRIDA de ³René Monzat², elle prépare un nouvel autoritarisme, qu'en d'autres temps elle n'aurait pas hésiter à qualifier de ³fascisme². Dans toute tradition politico-intellectuelle, il faut laisser la porte ouverte au dynamisme juvénile, immédiatement réceptif aux innovations. Une telle ouverture est une nécessité voire un impératif de survie. Dans le cas de la sociale-démocratie, si ce dynamisme juvénile ne peut s'exprimer dans des revues, des cercles, des associations, des mouvements de jeunesse liés au parti, il passera forcément ³à droite² (ce qui n'est jamais qu'une convention de langage), parce que la gauche-appareil ne cesse de demeurer sourde à ses revendications légitimes. Aujourd'hui, ce passage ³à droite² est possible dans la mesure où la ³droite² est démonisée au même titre que l'anarchisme au début du siècle. Et les démonisations fascinent les incompris.
Nietzsche et la ³droite²
Avant 1914, la droite allemande la plus bruyante est celle des pangermanistes, qui ne se réfèrent pas à Nietzsche, parce que celui-ci n'évoque ni la race ni la germanité. Lehmann pensait que Nietzsche restait en dehors de la politique et qu'il était dès lors inutile de se préoccuper de sa philosophie. Paul de Lagarde ne marque pas davantage d'intérêt. Quant à Lange, il est férocement anti-nietzschéen, dans la mesure où il affirme que la philosophie de Nietzsche est juste bonne ³pour les névrosés et les littérateurs², ³les artistes et les femmes hystériques². A Nietzsche, il convient d'opposer Gobineau et de parier ainsi pour le sang, valeur sûre et stable, contre l'imagination, valeur déstabilisante et volatile. Otto Bonhard, pour sa part, réfute l'³anarchisme nietzschéen².
C'est sous l'impulsion d'Arthur Moeller van den Bruck que Nietzsche fera son entrée dans les idéologies de la droite allemande. Moeller van den Bruck part d'un premier constat: le défaut majeur du marxisme (i. e. l'appareil social-démocrate) est de ne se référer qu'à un rationalisme abstrait, comme le libéralisme. De ce fait, il est incapable de capter les véritables ³sources de la vie². En 1919, la superstructure officielle de l'empire allemand s'effondre, non pas tant par la révolution, comme en Russie, mais par la défaite et par les réparations imposées par les Alliés occidentaux. L'Armée est hors jeu. Inutile donc de défendre des structures politiques qui n'existent plus. La droite doit entrer dans l'ère des ³re-définitions², estime Moeller van den Bruck, et à sa suite on parlera de ³néo-nationalisme².
Si tout doit être redéfini, le socialisme doit l'être aussi, aux yeux de Moeller. Celui-ci ne saurait plus être une ³analyse objective des rapports entre la superstructure et la base², comme le voulait l'idéologie positiviste de la sociale-démocratie d'après le programme du Gotha, mais une ³volonté d'affirmer la vie². En disant cela, Moeller ne se contente pas d'une déclamation grandiloquente sur la ³vie², de proclamer un slogan vitaliste, mais dévoile les aspects très concrets de cette volonté de vie: une juste redistribution permet un essor démographique. La vie triomphe alors de la récession. Dès lors, ajoute Moeller, les clivages sociaux ne devraient plus passer entre des riches qui dominent et des masses de pauvres. Au contraire, le peuple doit être dirigé par une élite frugale, apte à diriger des masses dont les besoins élémentaires et vitaux sont bien satisfaits. Ce processus doit se dérouler dans des cadres nationaux visibles, assurant une transparence, et, bien entendu, clairement circonscrits dans le temps et l'espace pour que le principe ³nul n'est censé ignorer la loi² soit en vigueur sans contestation ni coercition.
Même raisonnement chez Werner Sombart: le nouveau socialisme s'oppose avec véhémence à l'hédonisme occidental, au progressisme, à l'utilitarisme. Le nouveau socialisme accepte le tragique, il est non-téléologique, il ne s'inscrit pas dans une histoire linéaire, mais fonde un nouvel ³organon², où fusionnent une vox dei et une vox populi, comme au moyen-âge, mais sans féodalisme ni hiérarchie rigide.
Spengler et Shaw
Pour Spengler, on doit évaluer positiviement le socialisme dans la mesure où il est avant toute chose une ³énergie² et, accessoirement, le ³stade ultime du faustisme déclinant². Spengler estime que Nietzsche n'a pas été jusqu'au bout de ses idées sur le plan politique. Ce sera Georges Bernard Shaw, notamment dans Man and Superman et Major Barbara, qui énoncera les méthodes pratiques pour asseoir le socialisme nietzschéen dans les sociétés européennes: mélange d'éducation sans moralisme hypocrite, de darwinisme tourné vers la solidarité (où les communautés les plus solidaires gagnent la compétition), d'ironie et de distance par rapport aux engouements et aux propagandes. Shaw, en annexe de son drame Man and Superman, publie ses Maxims for Revolutionists, rappelle que la ³démocratie remplace la désignation d'une minorité corrompue par l'élection d'un grand nombre d'incompétents², que la ³liberté ne signifie [pas autre chose] que la responsabilité et que, pour cette raison, la plupart des hommes la craignent²; enfin: ³l'homme raisonnable est celui qui s'adapte au monde; l'hommer irraisonnable est celui qui persiste à essayer d'adapter le monde à lui-même. C'est pourquoi le progrès dépend tout entier de l'homme raisonnable. L'homme qui écoute la Raison est perdu: le Raison transforme en esclaves tous ceux dont l'esprit n'est pas assez fort pour la maîtriser². ³Le droit de vivre est une escroquerie chaque fois qu'il n'y a pas de défis constants². ³La civilisation est une maladie provoquée par la pratique de construire des sociétés avec du matériel pourri². ³La décadence ne trouvera ses agents que si elle porte le masque du progrès².
Le socialisme doit donc être forgé par des esprits clairs, dépourvus de tous réflexes hypocrites, de tout ballast moralisant, de toutes ces craintes ³humaines trop humaines². Dans ce cas, conclut Spengler à la suite de sa lecture de Shaw, le ³socialisme ne saurait être un système de compassion, d'humanité, de paix, de petits soins, mais un système de volonté-de-puissance². Toute autre lecture du socialisme serait illusion. Il faut donner à l'homme énergique (celui qui fait passer ses volontés de la puissance à l'acte), la liberté qui lui permettra d'agir, au-delà de tous les obstacles que pourraient constituer la richesse, la naissance ou la tradition. Dans cette optique, liberté et volonté de puissance sont synonymes: en français, le terme ³puissance² ne signifie pas seulement la volonté d'exercer un pouvoir, mais aussi la volonté de faire passer mes potentialités dans le réel, de faire passer à l'acte, ce qui est en puissance en moi. Définition de la puissance qu'il convient de méditer, ‹et pourquoi pas à l'aide des textes ironiques de Shaw?‹ à l'heure où la ³correction politique² constitue un retour des hypocrisies et des moralismes et un verrouillage des énergies innovantes.
Aschheim montre dans son livre le lien direct qui a existé entre la tradition socialiste anglaise, en l'occurence la Fabian Society animée par Shaw, et la redéfinition du socialisme par les premiers tenants de la ³révolution conservatrice² allemande. Dénominateur commun: le refus de conventions stérilisantes qui bloquent l'avancée des hommes ³énergiques².
Nietzsche et le national-socialisme
Au départ, Nietzsche n'avait pas bonne presse dans les milieux proches de la NSDAP, qui reprend à son compte les critiques anti-nietzschéennes des pangermanistes, des eugénistes et des idéologues racialistes. Les intellectuels de la NSDAP poursuivent de préférence les spéculations raciales de Lehmann et se désintéressent de Nietzsche, plus en vogue dans les gauches, chez les littéraires, les féministes et dans les mouvements de jeunesse non politisés. Ainsi, au tout début de l'aventure hitlérienne, Dietrich Eckart, le philosophe folciste (= völkisch) de Schwabing, rejette explicitement et systématiquement Nietzsche, qui est ³un malade par hérédité², qui a médit sans arrêt du peuple allemand; pour Eckart, la légende d'un Nietzsche qui vitupère contre l'Allemagne parce qu'il l'aime au fond passionément est une escroquerie intellectuelle. Enfin, constate-t-il, l'individualisme égoïste de Nietzsche est totalement incompatible avec l'idéal communautaire des nationaux-socialistes. Après avoir édité des exégèses de Nietzsche pourtant bien plus fines, Arthur Drews, théologien folciste inféodé à la NSDAP, s'insurge en 1934 dans Nordische Stimme (n°4/34), contre la thèse d'un Nietzsche qui aime son pays malgré ses vitupérations anti-germaniques et affirme ‹ce qui peut paraître paradoxal‹ que le jeune poète juif Heinrich Heine, lui, critiquait l'Allemagne parce qu'il l'aimait réellement. Nietzsche est ensuite accusé de ³philo-sémitisme²: pour Aschheim et, avant lui, pour Kaufmann, le texte le plus significatif de l'ère nazie en ce sens est celui de Curt von Westernhagen, Nietzsche, Juden, Antijuden (Weimar, Duncker, 1936). Alfred von Martin, critique protestant, revalorise l'humaniste Burckhardt et rejette le négativisme nietzschéen, plus pour son manque d'engagement nationaliste que pour son anti-christianisme (Nietzsche und Burckhardt, Munich, 1941)! Finalement, les deux auteurs pro-nietzschéens sous le Troisième Reich, outre Bäumler que nous analyserons plus en détail, sont Edgar Salin (Jacob Burckhardt und Nietzsche, Bâle, 1938), qui prend le contre-pied des thèses de von Martin, et le nationaliste allemand, liguiste (= bündisch) et juif, Hans-Joachim Schoeps (Gestalten an der Zeitwende: Burckhardt, Nietzsche, Kafka, Berlin, Vortrupp Verlag, 1936). Quant au critique littéraire Kurt Hildebrandt, favorable au national-socialisme, il critique l'interprétation de Nietzsche par Karl Jaspers, comme le feront bon nombre d'exilés politiques et Walter Kaufmann. Jaspers aurait développé un existentialisme sur base des aspects les moins existentialistes de Nietzsche. Tandis que Nietzsche s'opposait à toute transcendance, Jaspers tentait de revenir à une ³transcendance douce², en négligant le Zarathoustra et la Généalogie de la morale. Enfin, plus important, l'apologie de la créativité chez Nietzsche et sa volonté de transvaluer les valeurs en place, de faire éclore une nouvelle table des valeurs, font de lui un philosophe de combat qui vise à normer une nouvelle époque émergeante. Dans ce sens, Nietzsche n'est pas un intellectuel virevoltant (freischwebend) au gré de ses humeurs ou de ses caprices, mais celui qui jette les bases d'un système normatif et d'une communauté positive, dont les assises ne sont plus un ensemble fixe de dogmes ou de commandements (de ³tu dois²), mais un dynamisme bouillonant et effervescent qu'il faut chevaucher et guider en permanence (Kurt Hildebrandt, "Über Deutung und Einordnung von Nietzsches System", Kant-Studien, vol. 41, Nr. 3/4, 1936, pp. 221-293). Ce chevauchement et ce guidage nécessitent une éducation nouvelle, plus attentive aux forces en puissance, prêtes à faire irruption dans la trame du monde.
Plus explicite sur les variations innombrables et contradictoires des interprétations de Nietzsche sous le Troisième Reich, est le livre du philosophe italien Giorgio Penzo (cf. supra), pour qui l'époque nationale-socialiste procède plus généralement à une dé-mythisation de Nietzsche. On ne sollicite plus tant son ¦uvre pour bouleverser des conventions, pour ébranler les assises d'une morale sociale étriquée, mais pour la réinsérer dans l'histoire du droit, ou, plus partiellement, pour faire du surhomme nietzschéen un simple équivalent de l'homme faustien ou, chez Kriek, l'horizon de l'éducation. On assiste également à des démythisations plus totales, où l'on souligne l'infécondité fondamentale de l'anarchisme nietzschéen, dans lequel on décèle une ³pathologie de la culture qui conduit à la dépolitisation². Ce reproche de ³dépolitisation² trouve son apothéose chez Steding. D'autres font du surhomme l'expression d'une simple nostalgie du divin. L'époque connaît bien sûr ses ³lectures fanatiques², dit Penzo, où l'incarnation du surhomme est tout bonnement Hitler (Scheuffler, Oehler, Spethmann, Müller-Rathenow). Seule notable exception, dans ce magma somme toute asses confus, le philosophe Alfred Bäumler.
Bäumler: héroïsme réaliste et héraclitéen
La seule approche féconde de Nietzsche à l'ère nationale-socialiste est donc celle de Bäumler. Pour Bäumler, par ailleurs pétri des thèses de Bachofen, Nietzsche est un ³penseur existentiel², soit un philosophe qui nous invite à nous plonger dans la concrétude sociale, politique et historique. Bäumler ne retient donc pas le reproche de ³dépolitiseur², que d'aucuns, dont Steding, avaient adressé à Nietzsche. Bäumler définit l'³existentialité² comme un ³réalisme héroïque² ou un ³réalisme héraclitéen²; l'homme et le monde, dans cette perspective, l'homme dans le monde et le monde dans l'homme, sont en devenir perpétuel, soumis à un mouvement continu, qui ne connaît ni repos ni quiétude. Le surhomme est dès lors une métaphore pour désigner tout ce qui est héroïque, c'est-à-dire tout ce qui lutte dans la trame en devenir de l'existence terrestre.
On constate que Bäumler donne la priorité au ³Nietzsche agonal² plutôt qu'au ³Nietzsche dionysiaque², qui hérissait Steding, parce qu'il était le principal responsable du refus des formes et des structures politiques. Bäumler estime que Nietzsche inaugure l'ère de la ³Grande Raison des Corps², où la Gebildetheit, ne s'adressant qu'au pur intellect en négligeant les corps, est inauthentique, tandis que la Bildung, reposant sur l'intuition, l'intelligence intuitive, et une valorisation des corps, est la clef de toute véritable authenticité. Notons au passage que Heidegger, ennemi de Bäumler, parlait aussi d'³authenticité² à cette époque. La logique du Corps, qui est une logique esthétique, sauve la pensée, pense Bäumler, car toute la culture occidentale s'est refermée sur un système conceptuel froid qui ne mène plusà rien, système dont la trajectoire a été jalonnée par le christianisme, l'humanisme (basé sur une fausee interprétation, édulcorée et falsifiée, de la civilisation gréco-romaine), le rationalisme scientiste. La notion de Corps (Leib), plus le recours à ce que Bäumler appelle la ³grécité véritable², soit une grécité pré-socratique, de même qu'à une germanité véritable, soit une germanité pré-chrétienne, conduisent à un retour à l'authentique, comme le prouvent, à l'époque, les innovations de la philologie classique. Cette mise en équation entre grécité pré-socratique, germanité pré-chrétienne et authenticité, constitue le saltus periculosus de Bäumler: dénier toute authenticité à ce qui sortait du champs de cette grécité et de cette germanité, a valu à Bäumler d'être ostracisé pendant longtemps, avant d'être timidement réhabilité.
Les impasses philosophiques de la bourgeoisie allemande
Dans un second temps, Bäumler politise cette définition de l'authenticité, en affirmant que le national-socialisme, en tant que Weltanschauung, représente ³une conception de l'Etat gréco-germanique². Bäumler ne se livre pas trop à des rapprochements hasardeux, ni à des sollicitations outrancières. Pourquoi affirme-t-il que l'Etat national-socialiste est grèco-germanique au sens où Nietzsche a défini la corporéité grecque et accepté la valorisation grecque des corps? Pour pouvoir affirmer cela, Bäumler procède à une inteprétation de l'histoire culturelle de la ³bourgeoisie allemande², dont tous les modèles ont été en faillite sous la République de Weimar. L'Aufklärung, première grande idéologie bourgeoise allemande, est une idéologie négative car elle est individualiste, abstraite et ne permet pas de forger des politiques cohérentes. Le romantisme, deuxième grande idéologie de la bourgeoisie allemande, est une tradition positive. Le piétisme, troisième grande idéologie bourgeoise en Allemagne, est rejeté pour les mêmes motifs que l'Aufklärung. Le romantisme est positif parce qu'il permet une ouverture au Volk, au mythe et au passé, donc de dépasser l'individualisme, le positivisme étriqué et la fascination inféconde pour le progrès. Cependant, en gros, la bourgeoisie n'a pas tiré les leçons pratiques qu'il aurait fallu tirer au départ du romantisme. Bäumler reproche à la bourgeoisie allemande d'avoir été ³paresseuse² et d'avoir choisi un expédiant; elle a imité et importé des modèles étrangers (anglais ou français), qu'elle a plaqué sur la réalité allemande.
Parmi les bricolages idéologiques bourgeois, le plus important a été le ³classicisme allemand², sorte de mixte artificiel d'Aufklärung et de romantisme, incapable, selon Bäumler, de générer des institutions, un droit et une constitution authentiquement allemands. En rejetant l'Aufklärung et le piétisme, en renouant avec le filon romantique en jachère, explique et espère Bäumler, le national-socialisme pourra ³travailler à élaborer des institutions et un droit allemands². Mais le nouveau régime n'aura jamais le temps de parfaire cette tâche.
Action, destin et décision
Dans l'interprétation bäumlerienne de Nietzsche, la mort de Dieu est synonyme de mort du Dieu médiéval. Dieu en soi ne peut mourir car il n'est rien d'autre qu'une personnification du Destin (Schicksal). Celui-ci suscite, par le biais de fortes personnalités, des formes politiques plus ou moins éphémères. Ces personnalités ne théorisent pas, elles agissent, le destin parle par elles. L'Action détruit ce qui existe et s'est encroûté. La Décision, c'est l'existence même, parce que décider, c'est être, c'est se muer en une porte qu'enfonce le Destin pour se ruer dans la réalité. Ernst Jünger aurait parlé de l'³irruption de l'élémentaire². Pour Bäumler, le ³sujet² a peu de valeur en soi, il n'en acquiert que par son Action et par ses Décisions historiques. Ce déni de la ³valeur-en-soi² du sujet fonde l'anti-humanisme de Bäumler, que l'on retrouve, finalement, sous une autre forme et dans un langage marxisé, chez Althusser, par exemple, où la ³fonction pratique-sociale² de l'idéologie prend le pas sur la connaissance pure (comme, dans la conception de Bäumler, le plongeon dans la vie réelle se voyait octroyer une bien plus grande importance que la culture livresque de l'idéologie des Lumières ou du classicisme allemand). Pour Althusser, dont la pensée est arrivée à maturité dans un camp de prisonniers en Allemagne pendant la 2ième Guerre mondiale, l'idéologie (la Weltanschauung?), était une instance mouvante, portée par des penseurs en prise sur les concrétudes, qui permettait de mettre en exergue les rapports de l'homme avec les conditions de son existence, de l'aider dans un combat contre les ³autorités figées², qui l'obligeaient à répéter sans cesse, ‹³sisyphiquement² serait-on tenter de dire‹, les mêmes gestes en dépit des mutations s'opérant dans le réel. Pour Althusser, l'idéologie ne peut donc jamais se muer en une science rigide et fermée, ne peut devenir pur discours de représentation, et, en tant que conceptualisation permanente et dynamique des faits concrets, elle conteste toujours le primat de l'autorité politique ou politico-économique installée et établie, tout comme l'³anarchisme² gauchiste et nietzschéen de Landauer refusait les rigidifications conventionnelles, car elles étaient autant de barrages à l'irruption des potentialités en germe dans les communautés concrètes. Enfin, il ne nous paraît pas illégitime de comparer les notions d'³authenticité² chez Bäumler (et Heidegger) et de ³concrétude² chez Althusser, et de procéder à une ³fertilisation croisée² entre elles.
L'anti-humanisme de Bäumler repose, quant à lui, sur trois piliers, sur trois ¦uvres: celles de Winckelmann, de Hölderlin et de Nietzsche. Winckelmann a brisé l'image toute faite que les ³humanités² avaient donné de l'antiquité grecque à des générations et des générations d'Européens. Winckelmann a revalorisé Homère et Eschyle plutôt que Virgile et Sénèque. Hölderlin a souligné le rapport entre la grécité fondamentale et la germanité. Mais l'anti-humanisme de Bäumler est une ³révolution tranquille², plutôt ³métapolitique², elle avance silencieusem
00:25 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 10 décembre 2007
Comment la folie d'Erasme sauva notre civilisation

Karel VEREYCKEN
Comment la folie d'Erasme sauva notre civilisation
00:10 Publié dans Affaires européennes, Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 07 décembre 2007
Tyranny of Individualism in a Liberal Democratic Society

The Tyranny of Individualism in a Liberal Democratic Society
by Welf Herfurth
Found on: http://majorityrights.com/
(This article contains one sick photo. I included it in the article to show how perverted society has become, at least in my opinion - Welf Herfurth)
1. Introduction
This is an article divided up, roughly, into two halves. The first concerns liberalism, or what liberalism has become. It details a transition in liberalism – from a cult of elections and parliaments, to a cult of doing your own thing (even if that involves sexual and other debauchery). The second half outlines what I consider to be the New Right antidote to the poison of modern liberalism, and explores some of the ideas of a liberal democratic anti-intellectual, Karl Löwenstein, who, in 1937, wrote a paper describing some of the political techniques used by the fascist political movements of the time. Some of those techniques are still being used by nationalists around the world (Hungary, Sweden, Russia, Britain, etc.), and, in my opinion, we in Australia can apply them equally as successfully here.
2. What is liberalism really?
Nowadays, one can read, in the Western liberal democratic press, daily denunciations of General Musharaff of Pakistan and the Burmese Junta. The two dictatorships have attracted media attention recently because of their flagrant crackdowns on ‘liberal democratic’ political opponents (or at least, opponents who the Western media assumes are liberal democratic).
Now and then, other dictatorships and/or authoritarian regimes will occupy the spotlight. One recent case is Georgia, which is led by an American-backed liberal democrat, Mikhail Saakashvili, who came to power through an ‘Orange Revolution’-type coup (nicknamed the ‘Rose Revolution’) in 2003, but is now in danger of being overthrown, and now, as a result, has declared a state of emergency and is using state repression – including tear gas and rubber bullets – to subdue the populace.
A perennial target of the Western media is Vladimir Putin. Despite his massive support among the Russian people, and massive election results in his favor, the Western media still considers him to be ‘undemocratic’ and ‘illiberal’, and upholds his critics – small groups of ‘liberal democratic’ dissidents, who have no popular support, and no agenda beyond being anti-Putin – as being more ‘democratic’, and certainly more morally worthy.
So we have a collection of countries – Burma, Pakistan, Fiji, Russia and others – which are manifestly illiberal and democratic in the eyes of Western liberal democrats. But what is it, exactly, that makes our liberal democracies so good? Why are they preferable to these dictatorships and authoritarian regimes? The answer is, simply, that people in liberal democracies are ‘more free’ – in fact, they are ‘free to do their own thing’.
To explain. One of the objections the Western liberals have against Iran is that supposedly Iran (along with other conservative Islamic States) imposes a strict dress code upon women. Women are allowed to dress freely in the West, as well as engage in nude sunbathing and the like: part of that, in my view, is because of the Western cultural heritage (particularly in the northern European countries) which traditionally has given more freedom to women compared to, for instance, the Mediterranean cultures of North Africa and the Middle East. But according to the liberals, this freedom has nothing to do with the West and its cultural heritage, but is, or at least should be, universal. What is more, that freedom should be forced on to countries with a low regard for the freedom of women, and even on ones (like South Africa or Papua New Guinea) with a high incidence of rape. Israel is held up as a model to other Arab nations – ‘the only democracy in the Middle East’ – because of, among other reasons, its high degree of personal freedom (which translates into a thriving gay and ecstasy culture). Such a level of freedom is ‘Western’. Consistent liberals, however, will acknowledge that liberal freedom cuts both ways: a recent article in the British Guardian newspaper denounces the fact that the secularist regime in Tunisia encourages harassment of women wearing the hijab and men wearing beards.
A country needs more than a high level of personal freedom to qualify as a ‘democracy’ in the eyes of the West, of course. For one thing, there must be a separation of powers: the executive, judiciary and legislature must be separate. And, as Carl Schmitt would say, there must be debate: all legislatures must go through the farcical process of debating the pros and cons of each piece of legislation before the members vote on it (even though the passage of each bill is determined, well in advance, along party lines). The Israeli parliament, the Knesset, allows plenty of debate, all right – mostly on the topic of how best to kill, starve or drive out the Palestinians, or who to bomb first (Iran or Lebanon or Syria?). Because of the daily debates in the Knesset, Israel qualifies as a ‘liberal democracy’.
On top of that, there are other requirements: elections, a multi-party system…
These days, however, there are many countries which do have elections, and an ostensible multi-party system, which are still condemned as ‘un-free’ and ‘un-democratic’: Russia, Belarus, Iran, Syria, Egypt, Tunisia, Venezuela. The Western liberals claim that the governments of these respective countries repress the political opposition, fail to hold elections which are completely, a 100% ‘free and fair’ (that is, meeting the Jimmy Carter electoral observer-standard), reduce the legislature to a rubber stamp, and censor journalists. The worst thing about these countries is that they do not see changes of government: an opposition party is rarely, if ever, voted in: so they are de facto single party States. So, then, these countries are situated in the hazy no-man’s land between complete dictatorship and complete liberal democracy. (And even pro-Western countries like Singapore and Malaysia fit into this category). Some are worse (or better) on the liberal democratic scorecard than others: Russia and Syria tolerate opposition political parties more than Syria and Iran – just barely. In many cases, e.g. Russia, Belarus and Iran, a real opposition exists. In other cases, e.g., Venezuela and Egypt, there is a political opposition which does win seats in parliament, but suffers from repression.
Again, though, we have to ask: what is all this freedom for? Surely elections, multi-party systems, frequent changes of government, the freedom of the press to snipe and criticise the government of the day, parliamentary debates, cannot be an end in themselves? Was Iraq invaded to give the Iraqis these dubious blessings? No: the answer is that the Iraqis were not free, as the Israelis are (or as Americans are) – not free to be gay, for instance, or drop ecstasy pills, or consume pornography, or to cross-dress. The Iraqis, and the Iranians, must reach the lofty status of Israel, which sent a transvestite singer to the Eurovision song contest – and won. Ahmedinejad attracted much Western condemnation for his insistence that ‘There are no gays in Iran’ (a mistranslation: he really said that there is no gay culture in Iran like there is in the West). The most strident criticisms against the Iranian political system is that it is run by Mullahs (democratically elected or not) who ‘repress the rights of women’ and repress gays.
This freedom occurs within a context, a structure, of course: in the West, and in Israel, the consumption of drugs like ecstasy is not legal, or de facto legal. It is merely widespread and socially acceptable – the outcome of a liberal society. (Whereas the consumption of heroin and ice, on the other hand, is not socially acceptable). It is fine to use drugs like ecstasy, marijuana and cocaine, or be a homosexual, or dress as a Goth or an Emo, or for a man to dress as a woman, so long as it does not harm others (to the extent that the consumption of ice and heroin does). If women are to be allowed to dress immodestly (immodestly in comparison to Iranian standards), this does not stem from traditional Western freedoms granted to women, and to tolerance of nudity, but to a woman’s universal right to freedom of self-expression.
Some countries are more socially conformist than others: Japan springs to mind. Ironically, America, up until the 1960s, used to be a very conformist country. One only has to look at the films from that time, the fashion magazines, newsreel footage, to see this. Francis Parker Yockey wrote on this topic in Imperium (in the chapter ‘America’, under the heading ‘World outlook’). The passage is lengthy, but is worth reproducing here in its entirety:
Every American has been made to dress alike, live alike, talk alike, behave alike, and think alike. The principle of uniformity regards personality as a danger and also as a burden. This great principle has been applied to every sphere of life. Advertising of a kind and on a scale unknown to Europe is part of the method of stamping out individualism. Everywhere is seen the same empty, smiling, face. The principle has above all been applied to the American woman, and in her dress, cosmetics, and behaviour, she has been deprived of all individuality. A literature, vast and inclusive, has grown up on mechanizing and uniformizing all the problems and situations of life. Books are sold by the million to tell the American “How to Make Friends.” Other books tell him how to write letters, how to behave in public, how to make love, how to play games, how to uniformize his inner life, how many children to have, how to dress, even how to think. The same principle has been extended to higher learning, and the viewpoint is nowhere disputed that every American boy and girl is entitled to a “college-education.”… A contest was recently held in America to find “Mr. Average Man.” General statistics were employed to find the centre of population, marital distribution of the population, family- numbers, rural and urban distribution, and so forth. Finally a man and wife with two children in a medium-sized town were chosen as the “Average Family.” They were then given a trip to New York, were interviewed by the press, feted, solicited to endorse commercial products, and held up for the admiration of all those who fell short in any way of the desirable quality of averageness. Their habits at home, their life- adjustments generally were the subject of investigation, and then of generalizing. Having found the average man from the top down, his ideas and feelings were then generalized as the imperative-average thoughts and feelings. In the American “universities” husbands and wives attend lecture courses on marriage adjustment. Individualism must not even be countenanced in anything so personal as marriage… The men change from felt hats to straw hats on one certain day of the year and on another certain day discard the straw hats. The civilian uniform is as rigorous— for each type of occasion— as the strictest military or liturgical garb. Departures from it are the subject of sneers, or interrogation [...]
All one can say is: how things have changed. America is now the land of the non-conformist, in every way in which Europe was supposed to be. In Europe in the twentieth century, the cultivation of one’s personality – i.e., emphasising one’s differences from the rest, one’s eccentricities – was always tolerated, if not encouraged. (The one exception? Nationalism: if you are a nationalist, and against multi-cultism, you are a Nazi, fascist, racist, bigot, etc., etc).
Non-conformism was part and parcel of the European aesthetic and intellectual tradition. America, though, had always resisted this – being the land of the conformist, the ‘square’, the ‘average man’. That was until the 1960s. I would hazard that the main cause was the shift in American popular culture. In the fields of music and film, the role of the individual genius, in revolt against society’s norms, came to the forefront. Even the films like Top Gun and Flashdance, which embody the ethos of the conservative 1980s – supposedly a return to traditional ‘American values’ – celebrate the heroic, non-conformist individual. There are still plenty of ‘average Joes’ depicted in American popular culture, but the protagonists of television shows like Desperate Housewives and House are eccentrics – the ‘average Americans’ are background characters.
The odd thing is that this attitude of individualism, eccentricity and non-conformity has filtered through to the American (and Western) population at large, and, in the end, has become a new kind of conformity. Everyone has to be different: the subsumption of oneself to a group, or a higher ideal, or to anything besides one’s own individual desires and preferences is an offence against the liberal spirit of the age. And it is this individualism which lies at the heart of modern liberal democracy. A country like Germany may be only barely liberal democratic – with its State control of the media, its repression of nationalists and Holocaust deniers, its thousands of political prisoners. In this, it is not so different from a country like Egypt or Tunisia. But where Germany is genuinely liberal democratic is its parliamentary debates, its multi-party system – and its tolerance of ethical hedonism and individualism. One cannot wear a ‘fascist’-style political uniform: that would be ‘Nazi’. But one can prance around, high on drugs, in a strange costume, at the Berlin ‘Love Parade’, a kind of annual Mardi Gras event where the attendants openly consume party drugs like ecstasy – while the police turn a blind eye. (In Singapore, or Belarus, it would be a different story).
3. Freedom and degradation
My own views on this are as follows. Freedom to take drugs in public, or for gays to marry one another, or to dress ‘differently’ (i.e., dress like Paris Hilton, Britney Spears or Lindsay Lohan) are low on my list of priorities. Freedom to take a revisionist view of German history, and the history of the Second World War, or to criticise immigration, are, on the other hand, very high. My view is that if that freedom is not possible, then other freedoms are not worth having at all. From my perspective, Russia is more free than the West. Russia, like the West, makes the Allied-Communist interpretation of the Second World War, part of its State ideology; but, unlike the West, it is indifferent to those who disagree with the government’s line on those subjects. Russia does not persecute people who take an alternative view of the history of WWII; and it could not care less if Russian nationalists oppose immigration. A German with a long history of nationalist activism, like myself, can walk the streets of Moscow a free man; but is in danger of arrest if he visits his own country.
Regarding the other freedoms – which my liberal democratic countrymen prize so highly – I am largely indifferent: the consumption of drugs, liquor, pornography, etc., have been part of civilisation ever since it existed; likewise, individualism, the right to act ‘crazy’ or different’, is part of European culture and history. (One only has to look at the Weimar Republic, with its cult of drugs and individualism. Because of the lack of individual identification with the community and the State, the Republic fell apart; out of the ashes arose the Third Reich).
But a recent incident has forced me to reconsider my views. Recently, I took a holiday in the United States, and, while in San Francisco, happened to be in a main street where a local, American version of the German ‘Love Parade’ was passing through. As in Germany, the revellers were high on drugs, prancing around to music, and wearing outlandish clothes. Being a good tourist, I started taking photos on my digital camera. I then saw, out of the corner of my eye, a grossly overweight, middle-aged bearded man, entirely naked except for a pair of sneakers. He had shaved all the hairs off his body (except for the hairs on his face), and, judging by his even tan, must have been a frequently-practicing nudist. I then became aware that he was masturbating – openly, in front of everyone. I must admit I was completely taken aback. Thinking that no-one back home would believe me, I took photos of the man. He looked up, saw me, and continued to masturbate – and even struck poses. Finally, he finished doing what he was doing. Another of the attendees – another overweight person, this time a woman, dressed in strange attire (somewhat reminiscent of a Viking costume) – came up and hugged him.
The man clearly must have been on drugs: ecstasy, fantasy, ice, goodness knows what. The essential thing is, it dawned on me that: this is the ‘freedom’ that George W. Bush speaks of; that he defends; that he insists on imposing on other countries through the unilateral use of military force. Liberalism has changed: from a doctrine of pluralism (manifested through a multi-party electoral system, parliamentary debates, a free press giving dissenting views) to a doctrine of complete individualism free of any restraints.
The liberal argument now is that individuals should be given the maximum amount of freedom, and be allowed to do what they like, so long as those people are not ‘hurting others’. With this principle in mind, the Netherlands allows the smoking of marijuana; it also allows gay men to organise sex parties. Unfortunately for the Dutch liberals, the principle was challenged recently, when it was revealed that gay men, infected with AIDS, would lure young men to these parties, drug them with a date rape drug (called, appropriately, ‘Easy Lay’) and inject them AIDS-infected blood. This caused a scandal.
But, presumably, the liberal position is: organising sex parties is OK; gays should be allowed to do what they like; they only cross the boundary between right and wrong when they hurt others – and injecting men with AIDS-infected blood is ‘hurting others’. The same principle applies to the revellers in the San Francisco Love Parade: the revellers high on drugs, masturbating publicly in the nude, were not ‘hurting others’. There may be laws on the books against indecent exposure, and the consumption of party drugs, but these are written by prudes, moralists, ‘wowsers’ (as the Australians like to call them). It’s OK for people to let their hair down once in a while and break those minor laws. Why not let people be free individuals and do their own thing? What is wrong with that?
4. Freedom and Tradition
The answer is long and complex. I will give it as follows.
Evola, in his work, gives an outline of the various kinds of spiritualities, as they have appeared in human civilisations: he identifies, following Nietzsche, a ‘Dionysian’ spirituality, which is a spirituality of shamanism - achieving altered states of consciousness through the use of drugs, alcohol and revelry. Evola has ambivalent views towards ‘Dionysianism’: on the one hand, he believes that it is an attempt to reach a mystical state of being which is truly ‘Traditionalist’; on the other hand, he thinks that is a mindless, debased spirituality, which breaks down all barriers, all hierarchies – between the sexes, between the classes, between all ethnic groups. What is more, ‘Dionysianism’ is a feminine spirituality – which explains the frequent association of the god Dionysos with female worshippers and revellers. Evola, of course, has nothing against femininity: merely the feminisation of men. Evola’s preference, as his readers know, is for the ‘Olympian’, ‘Solar’, ‘Apollinian’ spirituality, which is ‘virile’ (from the word viros, meaning male).
Now, all this is rather metaphysical: but Evola was a nationalist philosopher, or at least a philosopher of a kind of nationalism which many nationalists today are sympathetic with. Certainly they reject ‘Dionysianism’, or at least, the debased elements. And clearly, in my view, the phenomena of the Love Parade, and the behaviour I saw there, fits into the category of ‘Dionysianism’. As a New Rightist, then, I must reject it. Evola writes of the ‘lunar’ spirituality, which rejects hierarchy and authority, and regards all men as ‘one’ – no matter their race or social position. Certainly, the self-debasement of the Love Parade fits into that category too.
And it is a small leap from the ‘lunar’ spirituality of the Love Parade to the ideology of the Antifa. The Antifa objects to nationalism because that ideology draws distinction between races, and refuses to acknowledge the non-Western immigrant as being the equal, and deserving equal rights, as the indigenous Westerner. The Antifa accepts the immigrant, and the gay, as ‘brothers’. The stereotype of the ‘Lefty’ or ‘Crusty’ is someone who wears his hair in dreadlocks, Rastafarian-style, to show his affinity with the Negro, and smokes marijuana, which, as anyone who has tried it knows, is a notoriously egalitarian drug (which makes one accepting of all people and all things).
All rather complex and metaphysical, true: but Evola’s descriptions get right to the heart of things. He was an eloquent man; not surprisingly, he was a poet as well as a philosopher, and could be described as the ‘poet of fascism’. No-one managed to put the tenets of that ideology in clearer terms than he did.
5. New Rightism in action
All of this raises one question: what is that we from the New Right offer, precisely, which is in contrast to the individualism of the Love Parade and George W. Bush’s America? It is all very fine to talk of he nationalist’s affinity for ‘Olympian’ spirituality – one can be as ‘spiritual’ as one wants – but how does it manifest itself in our actions?
As part of the research for this article, I have been looking at a number of film clips of nationalist rallies on YouTube, from Hungary, Rumania, Russia, Italy, Sweden, Britain, Greece. Despite the national differences, a number of similarities emerged. (These similarities were even present in the film clips from different times: I watched one of National Front demonstration in the 1970s, and one in 2007).
One writer who identified those core elements is an American political scientist, Karl Löwenstein, who wrote a classic article, ‘Militant democracy and fundamental rights’, in the ‘American political science review’, volume 31/no. 3, 1937. The article is one of the most influential ever written: it consists mainly of recommendations for a series of ‘anti-racist’, ‘anti-fascist’ laws (against wearing uniforms, ‘defaming ethnic groups’, etc.) which have been put into practice by Germany, France and a number of other Western countries which have sought to clamp down on resurgent ‘fascism’ and ‘Neo-Nazism’ in their midst. It ought to rank as the holy scripture of the Antifa movement: except that Löwenstein preaches the state repression of nationalism, not in the name of multi-cultism, but of liberal democracy. But I will not dwell on this side of the Löwenstein doctrine, important as it is, here. I will instead quote a number of things he has to say on the subject of ‘fascism’ (loosely defined). In my view, he could almost be speaking of nationalism today. He remarks on the surprisingly international character of fascism:
A closer transnational alignment or “bloc” of fascist nations, a “Union of Europe’s Regenerated Nations”, a fascist International of the multi-colored shirts, is clearly under way, transcending national borders and cutting deeply across historical diversities of traditionally disjoined nationalisms. The modern crusaders for saving Western civilization from Bolshevik “chaos” – a battle-cry which in all countries gone fascist has proved invaluable – for the time being sink their differences and operate jointly according to a common plan. Under this missionary urge, which is one of the most astounding contradictions of a political system based on the superiority complex of each individual nation, what exists of distinguishing marks in program, ideology, and nationally conditioned premises of Realpolitik shrinks to insignificance [...]
He writes, disparagingly, that:
Fascism is not a philosophy – not even a realistic constructive program – but the most effective political technique in modern history. The vagueness of the fascist offerings hardens into concrete invective only if manifest deficiencies of the democratic system are singled out for attack. Leadership, order, and discipline are set over against parliamentary corruption, chaos, and selfishness; which a cryptic corporativism is substituted for political representation. General discontent is focussed on palpable objectives (Jews, freemasons, bankers, chain stores).... In brief, to arouse, to guide, and to use emotionalism in its crudest and its most refined forms is the essence of the fascist technique for which movement and emotion are not only linguistically identical [...]
So how precisely does the ‘fascist technique’ work? Löwenstein writes:
Concomitantly, the movement organizes itself in the form of a semi-military corps, the party militia or private army of the party. Under the pretence of self-protection, the original nucleus of the personal bodyguard of the leaders, and of the stewards for the maintenance of order in meetings, is developed into a large fighting body of high efficiency equipped with the fullest outfit of military paraphernalia, such as military hierarchy, uniforms and other symbols, and if possible arms. Again, this technique has strong emotional values and purposes. In the first place, mere demonstration of military force, even without actual violence, does not fail deeply to impress the peaceful and law-abiding bourgeois. Its manifestation, so alien to the normal expressions of party life, is, as such, a source of intimidation and of emotional strain for the citizens. On the other hand, while democratic parties are characterized by the looseness of their spiritual allegiance, the military organization of the fascist parties emphasizes the irrevocable nature of the political bond. It creates and maintains that sense of mystical comradeship of all for each and each for all, that exclusiveness of political obsession in comparison to which the usual party allegiance is only one among many pluralistic loyalties. When party allegiance finally transcends allegiance to the state, the dangerous atmosphere of double legality is created. The military routine, because it is directed against despised democracy, is ethically glorified as party of party symbolism which in turn is part of the emotional domination. Disobedience towards the constituted authorities naturally grows into violence, and violence becomes a new source of disciplined emotionalism. The conflicts with the state – unavoidable when this phase of active aggressiveness is reached – increase the common sentiment of persecution, martyrdom, heroism, and dangerous life so closely akin to legalized violence during war. In addition, the movement is, within its own confines, genuinely democratic. A successful roughneck forwith rises to distinction in its hierarchy [...]
The quasi-military structure and attributes of fascism are one of its distinguishing features:
The uniform has a mystical attraction also in avowedly non-militaristic countries. The effect of military display on the “soft” bourgeois is all the more last because he contrasts the firmness of purpose of accumulated force in fascism with the uncontrolled fluctuations of normal political life. In politics, the only criterion of success is success. Fascism has been irresistably successful in other countries; thus far, it has never met with a reverse. In any democratic country, be it traditionally ever so sober and balanced, the existence of a political movement organized as military force makes the average citizen uneasy and creates the feeling of restiveness which emotional politics needs [...]
He then goes on to list a few more of the ‘essential techniques’, and lists means of combating fascism through legislation:
All democratic states have enacted legislation against the formation of private para-military armies of political parties and against the wearing of political uniforms or parts thereof (badges, armlets) and the bearing of any other symbols (flags, banners, emblems, streamers and pennants) which serve to denote the political opinion of the person in public. These provisions – too light-heartedly and facetiously called “bills against indoctrinary haberdashery” – strike at the roots of the fascist technique of propaganda, namely, self-advertisement and intimidation of others. The military garb symbolizes and crystallizes the mystical comradeship of arms so essential to the emotional needs of fascism [...]
That ‘militarism’ is applied, by the fascist, as follows:
Political strife carried by the fascists to the extreme of organized hooliganism made the fundamental right of assembly more or less a sham. Creating disturbances in or wrecking meetings of opposing or constitutional parties not only proved a favorite test of the fighting spirit of militarized parties ((“meeting-hall-battles” – “Saalschlacht”), but also deterred peaceable citizens from attending meetings of their own selection. The task of the police to keep peace and order at meetings and public processions became increasingly difficult. The ordinary criminal codes being wholly insufficient to curb the deliberate tactics of extremist parties, more stringent legislation was introduced in Czechoslovakia, Great Britain, and proposed in Switzerland [...]
Löwenstein describes the method of the ‘provocative march’:
A different problem arose when it became obvious that fascist demonstrations, processions, and meetings were held in districts where they could be considered only as a deliberate provocation because of the hostility of the bulk of the people living in these quarters. If, in such cases, disturbances occurred, they were actually created by the opponents. Exploiting this situation was one of the favorite methods of rising fascist methods whereby they could stand on the constitutional right of free processions and assembly [...]
He details, interestingly, the use of the weapon of ‘political abuse’:
Overt acts of incitement to armed sedition can easily be squashed, but the vast armory of fascist technique includes the more subtle weapons of vilifying, defaming, slandering, and last but not least, ridiculing, the democratic state itself, its political institutions and leading personalities. For a long time, in the Action Française, the finesse of noted authors like Daudet and Maurras developed political invective into both an art and a science. Democratic fundamentalism acquiesced, because freedom of public opinion evidently included also freedom of political abuse, and even malignant criticism was sheltered. Redress had to be sought by the person affected through the ordinary procedure of libel, thereby affording a welcome opportunity for advertising the political intentions of the offender [...]
In an unintentionally amusing passage, he takes note of the distinctly fascist method of using martyrs to exalt one’s cause – and dubious martyrs at that:
More patently subversive is fascism’s habit of publicly exalting political criminals and offenders against the existing laws – a practice which serves the twofold purpose of building up the revolutionary symbolism of martyrs and heroes and of defying, with impunity, the existing order. It is still remembered that Herr Hitler, in August, 1933, when the rowdies of his party murdered, under particularly revolting circumstances, a political adversary in Potempa and were sentenced to death by the court, proclaimed his “spiritual unity” with them. Only Czechoslovakia and Finland have provided against this practice of morally aiding and abetting the political criminal [...]
6. Fascism as technique?
At first, when I read Löwenstein’s article, I was somewhat offended by it – in particular, by his characterisation of fascism as being mere ‘technique’, not a real ideology. After all, fascism attracted many intellectuals who gave fascism a well thought-out philosophy, an intellectual basis. And certainly, the post-war ‘neo-fascist’ writers – Yockey, Thiriart, Evola – gave fascism a real intellectual grounding. But, the more I thought about it, the more I saw that Löwenstein’s contention was true. After all, it has to be admitted that nationalism – which Löwenstein would classify, rightly or wrongly, as ‘fascist’ (and certainly his followers in the Bundesrepublik do) – is vague. What the liberal democratic media calls ‘policy detail’ has never been our strong suit. We are not used to contesting in elections, like the mainstream liberal democratic parties, and, when we do, we do not produce budgeted, carefully-crafted plans to improve children’s health care, combat global warming, fix petrol-price gouging, etc., like the Labor and Liberal parties are doing at this Australian federal election. Part of this is sheer lack of experience and money – whereas the mainstream liberal democratic parties have plenty of both, and are very good at organising the logistics of elections.
New Rightism, more than anything else, is an ‘action’ movement, not a ‘talking’ movement, and the heart of our policy, if not worldview, lies in our day to day living: living in community, working in the community, transforming it through our actions.
Nationalism, of course, does tend to elevate people who have fallen in battle – either through actual military conflict, or in the context of a political struggle – into martyrs. Of the film clips I saw, one was a commemoration of a Swedish nationalist martyr – Daniel Wretström, a 17 year old Swedish nationalist killed by immigrants; the other, a wreath-laying ceremony in Hungary commemorating the country’s servicemen who had fallen in WWII.
The ultimate historical fascist martyr figure is, of course, Horst Wessel. There is a scene in ‘Triumph of the Will’ where assembled National Socialist personages sing the Horst Wessel Lied, accompanied by the inevitable salutes and giant banners: the camera focuses on Göring for a few moments, and one can see the beginnings of a tear forming in the hard man’s eye. Without a doubt, nationalists – whether today in Greece or Hungary or Russia, or in yesterday in France or Germany – rely heavily on emotion. These emotions are: indignation, against our liberal democratic and communist enemies; a feeling of the rightness of the cause; self-sacrifice; self-abnegation (which comes from service to a higher goal)… All of this is transmitted through formalities and ceremonies: the Swedish nationalists, for instance, put on a candle-lit vigil and procession for the young Wretström. (Swedish nationalists have set up a site, outlining the rules for the annual march, and meeting points. Click here).Whereas, in a liberal democracy, the Berlin Love Parade has replaced the torchlight processions of the SS: individuality takes the place of community as an object of veneration in the Bundesrepublik.
Even liberal democrats have to admit that, compared to the political street theatre of nationalism, their brand of conventional politics is mundane. There is nothing in mainstream conservatism, social democracy, environmentalism, liberalism, etc., to compare with it. There is a real pleasure in being part of a crowd of demonstrators, marching past communists who are swearing, spitting, jeering, singing communist anthems, who are being held by mounted police (as in one of the old National Front film clips). It is a peculiar pleasure, to be sure, and not for everyone. But once one has a taste of it, one becomes addicted. I am often chastised by liberal democratic friends, and I have plenty of them, for being part of the so-called ‘Neo-Nazi’ nationalist scene: I retort to them, ‘What am I meant to do? Join the Liberal Party, attend boozy functions, sit among fat, middle-aged men in suits, and listen to speakers like Tony Abbott and Peter Costello drone on about the unions?’ The mainstream liberal democratic parties do not give anyone much of a scope for real political activism. What they are about is power to political parties but not the people they claim to represent. New Rightism, on the other hand, is activist-based: and it has the potential to encompass nearly all spheres of life.
One other advantage of nationalism is that it is virtually indestructible. The National Front imploded after reaching a peak in the late 1970s: but it is still in action, albeit with reduced numbers, and this time demonstrating against Islamic immigration and gay marriage. Certain of the problems afflicting Britain have changed, but others remain the same. The prime example of nationalist indestructibility, though, is Germany and Eastern Europe. The Allies and the Soviets embarked on a campaign of unprecedented genocide against Germany and its Allies – with the intention of eliminating ‘fascism’. But nationalism has grown back. Part of the reason for nationalism’s success is that, being a technique, it is easy to apply in all manner of times and places.
So why do some nationalist movements in some countries grow and others do not? I am biased on this. My belief is that, if the British nationalists, for instance, invested as much time and effort in constant, round the clock demonstrations – and taking the ‘war’ to the enemy, the communists and Antifa – as they do in trying to win council seats, they would achieve better results (and certainly earn themselves more media notoriety that way). The Internet has proven to be a boon to nationalism, but it has also made nationalists stay at homes – preventing them from going out, mixing with other nationalists on group activities (like hiking trips), meetings, conferences and the like, and engaging in demonstrations and rallies.
The demonstration is really at the heart of nationalist ‘technique’. Demonstrations are a public show of power: they are political street theatre. What matters in a demonstration is force, strength. Large numbers are required – and flags on poles to make the nationalist crowd look bigger than it really is. Loudhailers, loudspeakers mounted on cars, whistles, drums (the National Front in the 1970s made effective use of drums), ect, are all important for drowning out the hateful cries of the enemy (with their inevitable boring chant of ‘Nazis out!’). It becomes a pitched battle between the nationalist and the communist counter-demonstrators: and the biggest and loudest crowd wins.
I myself recognise the supreme importance of this: and the importance of getting as many nationalists and New Rightists as possible to attend a demonstration, and take the blows directed at them by the communist enemy. But nationalists, it has to be said, spend too much time on doctrinal disputes. On the National-Anarchist and New Right mailing lists, for example, there was a recent debate on whether or not ‘New Right’ and ‘National-Anarchism’ were appropriate names for our ideas. Should we not look for alternative names? Alternatives were suggested: e.g., ’New Left” (the affiliate of the New Right in Portugal actually calls itself ‘New Left’), ‘New Reason’ instead of ‘New Right’. One of the objections to the use of the term ‘New Right’ was that it may be confused with the Anglo-Saxon neo-liberal movement of the same name from the 1980s (as if the average man can remember back that far). As for ‘National-Anarchism’, are not nationalism and anarchism mutually exclusive concepts?
All of this is somewhat missing the point. The early fascist activists cobbled together an ideology which was ‘Left’ as well as being ‘nationalist’: no doubt it confused a good many people. A typical response would have been: ‘I can’t tell if you people are Left or Right: your ideology is an incoherent mish-mash’. (Some commentators characterised German National Socialism, when it first appeared, as ‘conservative Marxism’). I am sure that Mussolini’s movement started off without a name: and that finally, at some point, someone felt that they had to give their rather loose collection of ideas a proper name, and someone came up with ‘fascism’. But what is in a name? And why do political ideas have to be consistently ‘Left’ or ‘Right’? Political theories, in my view, are not mathematical proofs, where every step proceeds logically from the other. The essential thing is to go out and do. The trouble is that the liberal democratic system wants the Left and Right to fight one another; it is happy with the Left-Right divide; it likes the simplicity of the concepts; it does not want people to think; rather, it wants them to be conditioned, to categorise themselves as green or socialist or conservative. That way, a person only sees himself in terms of that category: the ideology does the thinking for him. Which is why Greens feel that they have to fight nationalists, despite their similarities: Bob Brown and the Green Party have ordained that nationalism is evil, racist, and has nothing to do with environmentalism; so the individual ends up not thinking for himself, and instead obeys his party leaders and the dictates of the mainstream political consensus.
7. What to do
Sometimes, when I look at the hostility nationalism generates – from the ‘militant democratic’ governments of Germany and France, in particular – I wonder why it is these governments are so afraid. Look at the footage of any nationalist march, and all you will see – in the last analysis – is a large group of men and women carrying flags and banners, walking along a road. But, from the way the liberal democrats and communists behave, such activities are heinous, and must be stopped by any means necessary. Nationalism will lead to a second Holocaust, etc., etc. (even when the marchers are British or Russian). My pragmatic response, though, is: so what? A bunch of people are marching down the street, waving flags with old Teutonic and Celtic symbols on them – what harm does it do? I wonder what would happen if the German government banned the prohibition of uniforms or Holocaust literature. Would mass riots and discord ensue? Would the Bundesrepublik cease to exist overnight? Simply because ‘fascism’ in the 1920s and 1930s became a Europe-wide movement, embracing millions of men and women, is no reason to believe that it will happen again. The pettiness and stupidity of the ‘militant’ liberal democrats expresses itself in actions like the withholding of two years worth of mail to Ernst Zündel, for example.
Having said that: laws come, and laws go (Holocaust denial in Spain has just recently been legalised again) and there is no body of legislation in existence anywhere which has succeeded in shutting down nationalism completely. The Russian nationalists wear masks and uniforms at their rallies, and use the Roman salute; they also engage in paramilitary training, and even own their own Kalashnikovs. The Italians, on the other hand, labour under the same restrictions as the Germans: but that does not stop them from putting on large demonstrations. It is all a matter of working around the Löwenstein-style laws.
The main strength of our movement is our organisation – our ability to mobilise large numbers of people for mass action. This, of course, occurs only under optimal circumstances – we waste a good deal of time debating doctrinal differences among ourselves, instead of going and doing what we do best. No doubt the demonstrators in Sweden, Hungary, Russia and other countries have, as individuals, a number of doctrinal differences with one another: but the main thing is that they were sufficiently united, and organised, to take to the streets in defiance of communism and militant anti-racism. Ideally, I would like political activists from all over Europe to converge on London – in particular, the financial district (the City of London) – for an annual pan-European anti-capitalist march. And if police and the media, and the communist enemy, descend en masse upon the march, all well and good. That will garner the attention that we need. Because of the location, we would be sure to get worldwide English media coverage, which is considerable.
The main thing which is holding us back is wrong thinking – and lack of courage, or at least, an unwillingness to offend bourgeois proprieties. One German poster, at a mailing list I frequent, wrote recently:
The so-called “free nationalists” are only free from responsible behaviours. They mimic American dress codes and copy antifa strategies which basically makes them appear as dangerous, violence-prone hooded hoodlums. If you disguise your face you not only have something to hide - you also won’t garner any sympathies from the populace...”
That is a common fallacy among some nationalists. The fact of the matter is that the German populace have been trained to hate all forms of German nationalism; the same goes, to a milder extent, for the rest of the world. They are conditioned, Pavlov-style, to react with disgust. Non-German nationalism in the West is fast going the same way – that is, our liberal democratic masters in the media, the church, the parliament, the trade union leadership, the university, are training the Western masses to find it equally as abhorrent. The notion, then, that this hatred (and that is what it is) can be done away with by aping bourgeois manners, is wrong.
Related to this is the fact that many people – especially young people – like outlaws and rebels. You can appeal to more people by trying not to appeal to anyone at all, by being yourself and by making your own values in contrast to the norms of the society you live. In popular culture, this fact has been known at least since the 1950s: James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley, were marketed, deliberately, as moody, dangerous rebels – and all three of them made fortunes as a result. Many rock bands nowadays are still being marketed as being as rebellious as the Rolling Stones or the Sex Pistols. Although rock and roll rebellion has now become something of a tired old cliché, the youngsters never seem to get tired of it, as we see with the continuing popularity of likes of the EMO cult. Almost everyone understands this, except for the nationalists who are desperately trying to look respectable and liberal-democratic. Instead of acting independently and doing what has to be done, they are more concerned about what the apolitical consumer-orientated Zombies thinks about, and trying to appease them.
Other nationalists have described their reluctance to refer to the Antifa enemy as precisely that: the Antifa. Why? Because if the Antifa are anti-fascist, it implies that their enemies – us – are ‘fascist’. And we can’t have that. I am surprised that Australians, of all people – a people who wrested this country from the Aborigines, and built a country and a State literally from the dirt, facing great personal hardship and struggle – are afraid of a mere word.
To conclude: what we in the New Right offer is an alternative. Löwenstein is quite right when he says that ‘fascism’ is a method, of confrontation – and investing the political struggle with an honour, dignity and nobility (although he would not use those words). At the risk of sounding ‘irrationalist’ or ‘anti-intellectual’, we New Rightists have to make use of the method (and I am stressing the word method) and get to work – the time for talking is over. We have to show the world our anti-liberal alternative – our alternative to the tyranny of individualism in a liberal democratic society.
Welf Herfurth is a political activist who lives in Sydney / Australia. He was born and raised in Germany. He can be contacted here.
00:35 Publié dans Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 06 décembre 2007
Perfectibilité infinie

L'idée de perfectibilité infinie: noyau de la pensée révolutionnaire et libérale
Robert Steuckers
Le Professeur Ernst Behler, qui enseigne à Seattle aux Etats-Unis, grand spécialiste de Friedrich Schlegel, sommité interna-tio-nale, vient de se pencher sur ce rêve optimiste de la perfecti-bi-lité absolue du genre humain, rêve sous-tendant toute l'aven-ture illuministe et révolutionnaire qui s'est enclenchée au XVIIIiè-me siècle. Ce rêve, qui est le noyau de la modernité, se repère dès la fameuse "querelle des anciens et des modernes", dans l'Aufklärung allemand, chez l'Anglais Godwin, chez Con-dorcet (de loin le plus représentatif de la version "illuministe" de ce rêve), Mme de Staël, Constant, les Roman-tiques anglais (Words-worth, Coleridge) et aux débuts du roman-tisme allemand (Novalis, Schlegel). L'évolution de cette pensée de la perfecti-bi-lité, aux sinuosités multiples depuis l'Aufklärung jusqu'au ro-man-tisme de Novalis et Schlegel, a été appréhendée en trois éta-pes, nous explique Ernst Behler dans son livre
Ernst BEHLER, Unendliche Perfektibilität. Euro-päische Romantik und Französische Revolution, Fer-dinand Schöningh, Paderborn, 1989, 320 S., DM 48,- (ISBN-3-506-70707-8).
La première étape s'étend de 1850 à 1870, et constitue une réac-tion négative à l'endroit du romantisme. La deuxième étape, de 1920 à 1950, est marquée par trois personnalités: Carl Schmitt, Alfred Bäumler et Georg Lukacs. La troisième étape, non encore close, est celle des interprétations contemporaines du complexe Aufklärung/Romantisme. A nos yeux, il est évident que les in-terprétations de la deuxième étape sont les plus denses tout en étant les plus claires. Pour Carl Schmitt, le romantisme, par son subjectivisme, est délétère par essence, même si, en sa phase tar-dive, avec un Adam Müller, il adhère partiellement à la poli-tique de restauration metternichienne. Face à ce romantisme ger-ma-nique dissolvant, aux discours chavirant rapidement dans l'in-signifiance, Carl Schmitt oppose les philosophes politiques Bo-nald, de Maistre et Donoso Cortés, dont les idées permettent des décisions concrètes, tranchées et nettes. A l'occasionalisme (ter-mi-nologie reprise à Malebranche) des Romantiques et à leur frei-schwebende Intelligenz (leur intellect vagabond et planant), Schmitt oppose l'ancrage dans les traditions politiques données.
Alfred Bäumler, le célèbre adversaire de Heidegger, l'apologiste de Hitler et le grand spécialiste de Bachofen, pour sa part, dis-tingue une Frühromantik dissolvante (romantisme d'Iéna) qui se-rait l'"euthanasie du rococo", le suicide des idées du XVIIIiè-me. Cette mort était nécessaire pour déblayer le terrain et inau-gurer le XIXième, avec le romantisme véritable, fondateur de la philologie germanique, rénovateur des sciences de l'Antiquité, pro-moteur de l'historiographie rankienne, avec des figures com-me Görres, les frères Grimm et Ranke. Avec ces deux phases du romantisme, se pose la problématique de l'irrationalisme, affirme Bäumler. L'irrationalisme procède du constat de faillite des grands systèmes de la Raison et de l'Aufklärung. Cette faillite est suivie d'un engouement pour l'esthétisme, où, au monde réel de chair et de sang, la pensée op-pose un monde parfait "de bon goût", échappant par là même à toute responsabilité historique. Nous pourrions dire qu'en cette phase, il s'agit d'une irrationalité timide, soft, irresponsable, désincarnée: le modèle de cette na-tu-re, qui n'est plus tout à fait rationnelle mais n'est pas du tout charnelle, c'est celui que sug-gère Schelling. Parallèlement à cette nature parfaite, à laquelle doit finir par correspondre l'homme, lequel est donc perfectible à l'infini, se développe via le Sturm und Drang, puis le roman-tisme de Heidelberg, une appréhension graduelle des valeurs tel-luriques, somatiques, charnelles. A la théo-rie de la perfectibilité succède une théorie de la fécondi-té/fé-condation (Theorie der Zeu-gung). A l'âge "des idées et de l'humanité" succède l'âge "de la Terre et des nationalités". La Nature n'est plus esthétisée et su-blimée: elle apparaît comme une mère, comme un giron fécond, grouillant, "enfanteur". Et Bäumler de trouver la formule: "C'est la femme (das Weib) qui peut enfan-ter, pas l'"Homme" (der Mensch); mieux: l'"Homme" (der Mensch) pense, mais l'homme (der Mann) féconde".
Georg Lukacs, pourfendeur au nom du marxisme des irrationa-lismes (in Der Zerstörung der Vernunft), voit dans la Frühro-mantik d'Iéna, non pas comme Bäumler l'"euthanasie du ro-coco", mais l'enterrement, la mise en terre de la Raison, l'ou-verture de la fosse commune, où iront se décomposer la rai-son et les valeurs qu'elle propage. Comme Schmitt, qui voit dans tous les romantismes des ferments de décomposition, et contrairement à Bäumler, qui opère une distinction entre les Romantismes d'Ié-na et de Heidelberg, Lukacs juge l'ère roman-tique comme dangereusement délétère. Schmitt pose son affirma-tion au nom du conservatisme. Lukacs la pose au nom du marxisme. Mais leurs jugements se rejoignent encore pour dire, qu'au moment où s'effondre la Prusse frédéricienne à Iéna en 1806, les intellectuels allemands, pourris par l'irresponsabilité propre aux romantismes, sont incapables de justifier une action cohérente. Le conservateur et le marxiste admettent que le sub-jectivisme exclut toute forme de décision politique. Cette triple lecture, conservatrice, natio-na-liste et marxiste, suggérée par Beh-ler, permet une appréhension plus complète de l'histoire des idées et, surtout, une historio-gra-phie nouvelle qui procèdera dorénavant par combinaison d'élé-ments issus de corpus considérés jusqu'ici comme antagonistes.
Dans le livre de Behler, il faut lire aussi les pages qu'il consacre à la vision du monde de Condorcet (très bonne exposition de l'idée même de "perfectibilité infinie") et aux linéaments de per-fec-ti-bilité infinie chez les Romantiques anglais Wordsworth et Coleridge. Un travail qu'il faudra lire en même temps que ceux, magistraux, de ce grand Alsacien biculturel (allemand/français) qu'est Georges Gusdorf, spécialiste et des Lumières et du Romantisme.
[Synergies Européennes, Vouloir, Septembre, 1995]
00:55 Publié dans Définitions, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 04 décembre 2007
Un site consacré à Cioran
00:20 Publié dans Blog, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 03 décembre 2007
J.J. Esparza: Curso General de Disidencia

José Javier Esparza:
Curso General de Disidencia
Apuntes para una visión del mundo alternativa
00:05 Publié dans Définitions, Livre, Nouvelle Droite, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 20 novembre 2007
Sur l'oeuvre de Benedetto Croce

Sur l'oeuvre de Benedetto Croce
20 novembre 1952: Mort du grand philosophe italien Benedetto Croce. Né dans une vieille famille napolitaine le 25 février 1866, il perd ses parents et sa sœur lors d’un tremblement de terre en 1883. Il s’inscrit intellectuellement dans la tradition de Labriola, qui l’initiera à Hegel, au néo-idéalisme et au marxisme. En 1903, il fonde la revue « La Critica », qui sera ensuite reprise par l’éditeur Laterza. Sénateur en 1919, il sera par la suite ministre de l’instruction publique dans le cinquième et dernier gouvernement Giolitti, en 1920-21, avant la Marche sur Rome des fascistes.
Croce n’acceptera jamais ce coup de force d’octobre 1922. Il rompra avec le régime après l’assassinat de Matteotti en 1924. De même, il coupera les ponts avec son disciple le plus brillant, Giovanni Gentile, qui, lui, adhèrera entièrement au régime nouveau. Cette rupture a dû être particulièrement douloureuse, car Gentile fut l’un des tout premiers collaborateurs de « La Critica ». En 1925, Gentile publie un « manifeste des intellectuels fascistes » auquel Croce répond immédiatement par un « manifeste des intellectuels anti-fascistes ». Après la publication de cette déclaration de principes, Croce disparaît complètement de la vie politique italienne, pour revenir en 1944, dans le gouvernement Badoglio, où il sert de « monsieur-bons-offices » pour tenter de réconcilier l’ensemble très disparate des formations politiques se proclamant, sur fond de défaite allemande, « anti-fascistes ».
Tâche qui fut manifestement ingrate, car il donne sa démission dès le 27 juillet. Il dirige ensuite le nouveau « Parti Libéral » italien, mais, déçu, s’en retire dès 1946. Que retenir aujourd’hui de la philosophie de Benedetto Croce ? Elle est essentiellement un prolongement, mais un prolongement critique, de la philosophie de Hegel. Croce, comme Hegel, voit en l’ « esprit » la force motrice de l’univers et de l’histoire. L’esprit produit des idées, qui mûrissent, qui génèrent des projets pratiques ; ceux-ci modifient le cours de l’histoire. Pour Hegel, la dialectique est duale : la thèse règne, l’anti-thèse émerge ; le choc entre les deux produit une synthèse. Cette synthèse devient nouvelle thèse, qui, à terme, sera challengée par une nouvelle anti-thèse ; conflit qui débouchera sur une nouvelle synthèse, et ainsi de suite. Croce estime cette dialectique hégélienne trop réductrice. Il affine la notion de dialectique en évoquant les « distinctions » ou « différences » qui innervent la réalité, s’entrechoquent, mais non de manière binaire et générale, mais d’innombrables façons à d’innombrables niveaux dans la complexité infinie du réel. Croce doit ce correctif qu’il apporte à la dialectique de Hegel, en ultime instance, au philosophe italien du 18ième siècle, Gianbattista Vico. Seule une bonne connaissance de l’histoire, de l’histoire d’une discipline ou d’une activité humaine, comme le droit ou l’économie, permet de saisir les chocs, conflits et différences qui forment le mouvement dialectique du monde.
L’histoire éclaire donc la genèse des faits. Elle est indispensable à la connaissance de l’homme politique. C’est pourquoi Croce critique le libéralisme issu de la philosophie des Lumières, car celui-ci ne table que sur des idées générales, dépouillées de toute profondeur historique, ce qui les rend inopérantes pour saisir l’infinie prolixité du réel. Giovanni Gentile, partant des mêmes postulats philosophiques, entendait épouser cette prolixité par des actes volontaires précis, interventionnistes, directs et rapides. Pour lui, le fascisme représentait un mode de ce volontarisme. Benedetto Croce estimait que seule la notion libérale de liberté pouvait harmoniser conflits et différences et amortir les chocs entre ces dernières. Tous deux estimaient toutefois que l’histoire est à la fois pensée et action. Giovanni Gentile sera assassiné en 1943. Benedetto Croce meurt à Naples le 20 novembre 1952 (Robert Steuckers).
01:00 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Karl F. Eichhorn

Eichhorn: juriste et historien du droit
20 novembre 1781: Naissance à Iéna du grand juriste et historien du droit allemand Karl Friedrich Eichhorn. Sa carrière sera essentiellement universitaire. Formé en droit et en histoire, Eichhorn deviendra l’un des principaux historiens du droit germanique, en même temps que son ami et collègue Friedrich Carl von Savigny.
Eichhorn avait brigué la carrière d’un jurisconsulte du Saint Empire, dissous en 1806 par l’illégitimité bonapartiste. Secrètement, puis ouvertement, il adhère au « Tugendbund » (à la « Ligue de Vertu »), qui prépare, en Allemagne, l’insurrection contre la tyrannie française. Il sera l’un des premiers universitaires, avec le philosophe Fichte, à se porter volontaire lors de la guerre de libération, où, officier d’une troupe, il se distinguera au combat. Après la disparition du bonapartisme, Eichhorn et Savigny s’attèleront tous deux à la rédaction d’une revue d’histoire du droit, fondant par là même une méthodologie historique, où tout droit légitime puise dans un passé, dans un droit antérieur, et, par voie de conséquence, et a contrario, tout droit rupturaliste, visant l’éradication des legs du passé et la politique de la « table rase », est foncièrement illégitime.
L’idée de « droits naturels », tombés du ciel, de l’empyrée des idées pures, n’est pas tenable en pratique, selon Eichhorn. Sur le plan politique, Eichhorn sera tout à la fois un défenseur des combattants de la libération de 1813-14, un critique des mesures restauratrices en Prusse, mais aussi un adversaire des modèles constitutionnels tout faits, décrétés prêts à l’emploi, abstraits et sans profondeur temporelle que certains révolutionnaires entendaient appliquer tout de suite. Bon orateur et bon pédagogue, Eichhorn attirait un public impressionnant à l’université, où l’on venait l’écouter avec respect et passion. Malheureusement, son état de santé a rapidement décliné, contrairement à celui de Savigny, homme robuste, et ses activités professorales ont dû d’abord se réduire à partir de 1818, pour cesser définitivement en 1824.
Il demeure une référence, dans la mesure où il fonde une méthodologie historique en droit, qui sera ensuite étendue à l’économie par l’école historique allemande de Rodbertus et Schmoller, et récapitulée par le philosophe Dilthey. Eichhorn, dont la santé reviendra partiellement, fera encore une carrière comme membre du Conseil d’Etat prussien et du Tribunal Suprême du Royaume de Prusse. Il meurt à Cologne le 4 juillet 1854 (Robert Steuckers).
00:25 Publié dans Biographie, Droit / Constitutions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 19 novembre 2007
Souffrance à distance

« La souffrance à distance »
Par Luc Boltanski
Pendant la guerre qui déchirait l'ex-Yougoslavie, au cœur d'une Europe impuissante à interrompre les massacres, l'auteur s'efforça d'analyser les contradictions de l'action humanitaire. Ce livre fut d'abord publié en 1993. La réédition de cet ouvrage est accompagnée d'un chapitre supplémentaire intitulé « La présence des absents ». Elle est prolongée par une postface où l'auteur précise les enjeux de ce travail dans sa biographie intellectuelle et explicite l'importance du contexte historique dans lequel l'ouvrage fut conçu. Ces ajouts donnent plus de clarté aux complexes et érudites analyses de la sociologie historique.
Précisons que le lecteur ne trouvera pas d'analyse des développements contemporains de la politique humanitaire. Pas d'analyse, non plus, de la division du travail humanitaire, des rapports entre médias et ONG, des évolutions du droit international, de la délégation de pans entiers de la politique sociale aux associations humanitaires, de ses effets sur les publics concernés.
Parce que l'action humanitaire ne parvient pas à faire émerger une solidarité planétaire, parce qu'elle favorise l'apparition d'agaçantes individualités narcissiques (cf. B. Kouchner) qui semblent privilégier la réalisation de soi aux dépens de l'engagement altruiste, de nombreux critiques dénoncent dans le développement de l'humanitaire une impuissante célébration d'un retour de la bonté ou charité, cache-sexe de l'inaction politique, ou moquent le cynisme des belles carrières publiques de certaines figures du secteur.
La position du sociologue est différente. Il utilise un cadre d'analyse dit « pragmatique », qui consiste à suivre les acteurs, à éclairer les principes de leur action et à s'attacher aux contradictions dans lesquelles cette action se déploie. Par là, il espère donner de nouveaux moyens pour l'action, des accroches originales pour une critique qui serait interne et se montrerait finalement bien plus efficace que les dénonciations externes, désamorcées par leur arrogante extériorité. L'auteur affirme : « Pour une politique de la pitié, l'urgence de l'action à mener pour faire cesser les souffrances invoquées l'emporte toujours sur la configuration de la justice. » Notre espace public démocratique, qui est né au XVIIIe siècle, mobilise et fédère les citoyens par l'émotion plus que par la délibération. C'est pour cette raison qu'il importe de comprendre en quoi le discours sur la souffrance du monde est aussi une parole agissante et à quelle condition cette parole peut entrer en crise, comme c'est le cas aujourd'hui.
Le sociologue distingue trois formes de représentation de la souffrance qui constituent, depuis le XVIIIe siècle, les principaux modes d'engagement moral du spectateur : la dénonciation, où est conduit le procès d'un persécuteur ; le sentiment, où s'organise une équivalence émotionnelle entre le spectateur et le bienfaiteur ; enfin, l'esthétique, où le spectateur s'identifie au peintre plutôt qu'à l'horrible situation du malheureux.
Enfin, pour l'auteur, la « crise de la pitié » et ses formes contemporaines ne doit pas justifier un cynisme généralisé qui déboucherait sur un renoncement à toute action politique par la morale. Malgré la suspicion croissante qui pèse sur les médias, nourrie d'ailleurs par certains travaux de sciences humaines, la politique de la pitié apparaîtrait comme « indépassable ».
Quelles sont donc ces incertitudes qui ont déstabilisé l'action sur la « souffrance à distance » ? Pour l'auteur, c'est d'abord le brouillage de la distinction entre victimes et persécuteurs (c'est l'effet du stalinisme sur le mouvement social) ; c'est ensuite la critique des manipulations sensationnalistes des médias (c'est l'exemple de la première guerre du Golfe) ; c'est enfin la crise du cadre national face à l'expansion de l'action humanitaire.
Georges Lenormand
© Polémia
07/09/07
Luc Boltanski, « La souffrance à distance », folio essais, 2007, 520 pages, 7,79 euros.
00:55 Publié dans Définitions, Manipulations médiatiques, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 17 novembre 2007
Ph. Muray: "Après l'histoire"

« Après l’histoire »
Par Philippe Muray
http://www.polemia.com/contenu.php?cat_id=43&iddoc=1510
Pour la première fois dans l’histoire du genre humain, c’est à l’assaut des citadelles de la subversion subventionnée, et contre les pitres qui en occupent les créneaux, qu’il convient de se lancer. Sabre au clair, l’auteur part à l’assaut contre la modernité et le « festivisme » de notre société globale dont l’ « homo festivus » est le représentant achevé et dont le dernier mot est : Tout finit par la fête. Ce livre est un impitoyable jeu de massacre.
Au fil des pages, nombre de soufflets et d’horions sont distribués. Les colères, les désespoirs et les prophéties de l’auteur sont salutaires. Dans cette espèce de journal tenu de janvier 1998 à janvier 2000, tout y passe : le développement obligatoire de la fête, les rollers, les rave-parties, les pique-niques de quartier, la Gay Pride, l’indifférenciation sexuelle, le tourisme citoyen, la tendresse en littérature et ailleurs, l’hédonisme, la rebellocratie… de Halloween à la Love Parade en passant par l’art contemporain, rien de ce qui est « moderne» ne trouve grâce aux yeux de l’auteur. A ceux que le souvenir des bouffonneries du passage à l’an 2000 révulse encore, à ceux chez qui le Printemps des Poètes déclenche d’irrépressibles bouffées d’antipoésisme ou qui résistent à la lobotomisation télévisuelle, on adressera ce message d’espoir : vous n’êtes plus seuls.
Auteur prolifique, à l’esprit critique développé, Philippe Muray, décédé en 2006, se voulait le chroniqueur et le contempteur du désastre contemporain. Romancier, pamphlétaire, il se distingua aussi dans de nombreuses chroniques, parues dans journaux et revues, où son style se caractérisait par le rire, la dérision et l’outrance. Créateur de nombreux néologismes, comme « artistocrate » (artiste qui prête allégeance aux politiciens et aux fonctionnaires), « mutin de Panurge » (rebelle factice en accord avec l’air du temps) et « maton de Panurge » (gardien du politiquement correct), il fut un merveilleux peintre de notre société enfermée dans son conformisme consensuel.
Guillaume Leroy
© Polémia
07/09/07
Philippe Muray, « Après l’histoire », Gallimard, 2007, 686 pages, 16 euros.
00:50 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



