samedi, 30 janvier 2010
Manu as a weapon against egalitarianism: Nietzsche and Hindu political philosophy
Manu as a weapon against egalitarianism:
Nietzsche and Hindu political philosophyDr. Koenraad Elst
Introduction
Friedrich Nietzsche greatly preferred the ‘healthier, higher, wider world’ of the Hindu social code Mânava-Dharma-Shâstra (‘Code of Human Ethics’), also known as Manu-Smrti (‘Manu’s Classic’), to ‘the Christian sick-house and dungeon atmosphere’ (TI Improvers 3). We want to raise two questions about his eager use of this ancient text:
Firstly, a question of historical fact, viz. how correct was Nietzsche’s understanding of the text and the society it tried to regulate? The translation used by him suffers from some significant philological flaws as well as from interpretative bias, to which he added an agenda-driven reading of his own.
Secondly, to what extent did Nietzsche’s understanding of Hindu society play a role in his socio-political views? At first sight, its importance is quite limited, viz. as just an extra illustration of pre-Christian civilization favoured by him, as principally represented by Greece. Crucial pieces of Manu’s worldview, such as the centrality of a priestly Brahmin class and the notion of ritual purity, seem irrelevant to or in contradiction with Nietzsche’s essentially modern philosophical anthropology. To others he didn’t pay due attention, e.g. Manu’s respect for asceticism as a positive force in society, seemingly so in conflict with the Nietzschean contempt for ‘otherworldiness’, resonates with subtler pro-ascetic elements in Nietzsche’s conception of the Übermensch. Yet, a few specifically Indian elements did have a wider impact on his worldview, especially the notion of Chandâla (untouchable), to which however he gave an erroneous expansion unrelated to Manu.
1. What is the Manu-Smrti?
Friedrich Nietzsche greatly preferred the ‘healthier, higher, wider world’ of the Hindu social code Mânava-Dharma-Shâstra, the ‘Textbook of Human Ethics’, also known as Manu-Smrti, ‘Manu’s Classic’, to what he called ‘the Christian sick-house and dungeon atmosphere’ (TI Improvers 3). In a letter to his friend Peter Gast, he wrote:
This absolutely Aryan testimony, a priestly codex of morality based on the Vedas, of a presentation of caste and of ancient provenance – not pessimistic eventhough priestly – completes my conceptions of religion in the most remarkable manner. (KSA 14.420)
To his mind, the contrast between Manu’s classic and the Bible was so diametrical that ‘mentioning it in one breath with the Bible would be a sin against the spirit’ (AC 56). So, at first sight, he was very enthusiastic about this founding text of caste doctrine, though we shall have to qualify that impression. We want to raise two questions about his use of this ancient text, one of historical accuracy and one of the meaning Nietzsche accorded to this acknowledged source of inspiration in his view of society. But first of all, a few data about the Manu-Smrti must necessarily be stated before we can understand what role it could play in Friedrich Nietzsche’s thinking.
1.1. Manu, the patriarch
There is no indication that Nietzsche had much of an idea about who this Manu was after whom India’s ancient ethical code had been named. In Hindu tradition as related in the Veda and in the Itihâsa-Purâna literature (‘history’, comparable to Homer or to the Sagas, and ‘antiquities’, i.e. mythohistory comparable to Hesiod or the Edda), Manu was, through his numerous sons, the ancestor of all the known pre-Buddhist Indian dynasties. He himself is often described as a ‘son of Brahma’, though his full name, Manu Vaivasvata, implies that he was one of the ten surviving sons of Vivasvat, himself a son of Sûrya, the sun.
During the Flood, Manu had led a party of survivors by boat up the Gangâ to the foothills of the Himâlaya, then founded his capital in Ayodhyâ. His son Ikshvâku founded the ‘solar dynasty’ which retained the city of Ayodhyâ. Ikshvâku’s descendent Râma, hero of the Râmâyana epic, ruled there. The Buddha belonged to a minor branch of the same lineage, the Shakya clan which was so jealous of its noble ancestry that it practised the strictest endogamy. The later Gupta dynasty, presiding over India’s ‘golden age’, likewise claimed to be a branch of the solar dynasty. Another of Manu’s sons, Sudyumna, or alternatively his daughter Ilâ, founded the ‘lunar dynasty’ with capital at the Gangâ-Yamunâ confluence in Prayâga. His descendent Yayâti established himself to the west in the Saraswatî basin, present-day Haryânâ, where his five sons founded the ‘five nations’, the ethnic horizon of the Vedas.
Yayâti’s anointed heir was Puru, whose Paurava nation was to compose the Rg-Veda, the foundational collection of hymns to the gods. The Vedic age started with the Paurava king Bharata, after whom India has been named Bhâratavarsha or just Bhârat (as on India’s post stamps). In his clan, dozens of generations later, an internal quarrel developed into a full-scale war, the subject-matter of the Mahâbhârata, the ‘great (epic) of the Bhârata-s’. A key role in this war, which marked the end of the Vedic age, was played by the fighting brothers’ distant cousin Krishna, a descendent of Yayâti’s son Yadu. Yet another son of Yayâti’s, Anu, is said to be the ancestor of the Asura-worshippers, i.e. the Iranians, who were at times the enemies of the Deva-worshipping Vedic people..
So, Manu is known as the ancestor of all the Ârya people (vide §1.2), preceding all the quasi-historical events reported in Sanskrit literature. The account by Seleucid Greek ambassador Megasthenes of Hindu royal genealogy, where Manu is identified with Dionysos, times his enthronement at 6776 BC (Arrian: Indica 9.9, Pliny: Naturalis Historia 6.59, in Majumdar 1960 223 and 340), an intractable point of chronology that we must leave undecided for now.
The Vedic seers repeatedly call Manu ‘father’ (1.80.16, 1.114.2, 8.63.1) and ‘our father’ (2.33.13), and otherwise mention him over a hundred times. They pray to the gods: ‘May you not lead us far from the ancestral path of Manu’ (8.30.3). They address the fire-god Agni thus: ‘Manu established you as a light for the people’ (1.36.19). The Vedic worship of ‘33 great gods’ (often mistranslated as ‘330,000,000 gods’, koti meaning ‘great’ but later acquiring the mathematical sense of ‘ten million’), mostly enumerated as earth, heaven, eight earthly, eleven atmospheric and twelve heavenly gods, is said to have been instituted by Manu (8.30.2). Moreover, one common term for ‘human being’ is manushya, ‘progeny of Manu’.
Because of his name’s prestige, the ancient patriarch is also anachronistically credited with the authorship of the Manu-Smrti (‘Manu’s Recollection-Classic’) or Mânava-Dharma-Shâstra (translatable as both ‘Manu’s Ethical Code’ and ‘Human Ethical Code’), a text edited from slightly older versions in probably the 1st century CE. Friedrich Nietzsche exclusively refers to Manu as the author of the Mânava-Dharma-Shâstra, seemingly unaware of his legendary status as the progenitor of the Ârya-s.
1.2. The Code of the Ârya-s
For at least two thousand years, the word Ârya has meant: ‘noble’, ‘gentleman’, ‘civilized’, and in particular ‘member of the Vedic civilization’. The Manu Smrti uses it in this sense and emphatically not in either of the two meanings which ‘Aryan’ received in 19th century Europe, viz. the linguistic sense of ‘Indo-European’ and the racial sense of ‘white’ or ‘Nordic’. Thus, MS 10.45 says that those outside the caste system, ‘whether they speak barbarian languages or Ârya languages, are regarded as aliens’, indicating that some people spoke the same language as the Ârya-s but didn’t have their status of Ârya. As for race, the Manu Smrti (10.43f.) claims that the Greeks and the Chinese had originally been Ârya-s too but that they had lapsed from Ârya standards and therefore lost the status of Ârya. So, non-Indians and non-whites could be Ârya, on condition of observing certain cultural standards, viz. those laid down in the MS itself. The term Ârya was culturally defined: conforming to Vedic tradition.
But at least in the two millennia since the Manu Smrti, the only ones fulfilling this requirement of living by Vedic norms were Indians. When, during India’s freedom struggle, philosopher and freedom fighter Sri Aurobindo Ghose (1872-1950) wrote in English about ‘the Aryan race’, he meant very precisely ‘the Hindu nation’, nothing else. In 1914-21, together with a French-Jewish admirer, Mirra Richard-Alfassa, he also published a monthly devoted to the cause of India’s self-rediscovery and emancipation, the Ârya. In 1875, a socially progressive but religiously fundamentalist movement (‘back to the Vedas’, i.e. before the ‘degeneracy’ of the ‘casteist’ Shâstra-s and the ‘superstitious’ mythopoetic Purâna-s) had been founded under the name Ârya Samâj, in effect the ‘Vedicist society’. If the word Ârya had not become tainted by the colonial and racist use of its Europeanized form Aryan/Arier, chances are that by now it would have replaced the word Hindu (which many Hindus resent as a Persian exonym unknown to Hindu scripture) as the standard term of Hindu self-reference.
Against the association of the anglicised form ‘Aryan’ with colonial and Nazi racism, modern Hindus always insist that the term only means ‘Vedic’ or ‘noble’ and has no racial or ethnic connotation. This purely moral, non-ethnic meaning is in evidence in the Buddhist notions of the ‘four noble truths’ (chatvâri-ârya-satyâni) and the ‘noble eightfold path’ (ârya-ashtângika-mârga). So, the meaning ‘noble’ applies for recent centuries and as far back as the Buddha’s age (ca.500 BC), but not for the Vedic age (beyond 1000 BC), especially its earliest phase. Back then, against a background of struggle between the Vedic Indians and the proto-Iranian tribes, the Dâsa-s and Dasyu-s, we see the Indians referring to themselves, but not to the Iranians, as Ârya; and conversely, the Iranians referring to themselves, but not to the Indians, as Airya (whence Airyânâm Xshathra, ‘empire of the Aryans’, i.e. Iran). And if we look more closely, we see the Vedic Indians, i.e. the Paurava nation, refer to themselves but not to other Indians as Ârya. So at that point it did have a self-referential ethnic meaning (Talageri 2000 154 ff.).
Possibly this can be explained with the etymology of the word, but this is still heavily under dispute. Köbler (2000 48 ff.) gives a range of possibilities. It has been analysed as stemming from the root *ar-, ‘plough, cultivate’ (cfr. Latin arare, aratrum), which would make them the sedentary people as opposed to the nomads and hunter-gatherers; and lends itself to a figurative meaning of ‘cultivated, civilized’. Or from a root *ar-, ‘to fit; orderly, correct’ (cfr. Greek artios, ‘fitting, perfect’) and hence ‘skilled, able’ (cfr. Latin ars, ‘art, dexterity’; Greek arête, ‘virtue’, aristos, ‘best’), which may in turn be the same root as in the central Vedic concept rta, ‘order, regularity’, whence rtu, ‘season’ (cfr. Greek ham-artè, ‘at the same time’). Or from a root *ar, ‘possess, acquire, share’ (cfr. Greek aresthai, ‘acquire’), an interpretation beloved of Marxist scholars who interpret the Ârya class as the owner class. Or, surprisingly, from a root *al-, ‘other’ (cfr. Greek allos and Latin alius, ‘other’), hence ‘inclined towards the other/stranger’, hence ‘hospitable’, like in the name of the god Aryaman, whose attribute is hospitality. It is the latter sense from which the ethnic meaning is tentatively derived: ‘we, the hospitable ones’, ‘we, your hosts’, hence ‘we, the lords of this country’. The linguists are far from reaching a consensus on this, and for now, we must leave it as speculative.
At any rate, the form Ârya, though probably indirectly related with words in European languages, exists as such only in the Indo-Iranian branch of the Indo-European language family. The common belief that Eire as ethnonym of the westernmost branch of the Indo-European speech community is equivalent with Ârya, is etymologically incorrect, as is the eager linkage of either with German Ehre, ‘honour’. This is one reason why the use of the English word ‘Aryan’ for the whole Indo-European language family was misconceived and has rightly been abandoned.
The main point for now is that the legendary Manu was the patriarch and founder of Vedic or Ârya civilization. His name carried an aura, so the naming of a far more recent book after him was merely a classic attempt to confer more authority on the book. The name of the book’s real author or final editor is unknown, but he must have lived at the very beginning of the Christian age. Older versions of the Dharma-Shâstra-s have been referred to in the literature of the preceding centuries, citing injunctions no longer extant in the classical versions. This confirms to us moderns, though not to the disappearing breed of traditionalist Hindus, that the law codes including Manu’s are products of history, moments in a continuous evolution, rather than an immutable divine law laid down at the time of creation.
1.3. Is the Manu Smrti a law book?
In 1794, Bengal Supreme Court judge Sir William Jones (1746-94), discoverer or at least herald of the kinship of the Indo-European languages in 1786, translated the Manu Smrti in English. Soon the British East India Company made the Manu Smrti the basis of the Code of Hindu Law in its domains, parallel with the Shari’a for Muslim Law. Colonial practice was to avoid trouble with the natives by respecting their customs, so British or British-appointed judges consulted the MS to decide in disputes between Hindus. But this was the first time in history that the book had any force of law.
It is an important feature of the Manu Smrti that it explicitly recognizes that laws are changeable. That doesn’t mean that anything goes, for the right to amend the laws is strictly confined to Brahmins well-versed in the existing law codes (12.108), so that they will preserve the spirit of the law even while changing its letter. Nonetheless, this provision for change helps to explain why Hindus have been far more receptive to social reform than their Muslim compatriots, for whom Islamic law is a ‘seamless garment’: pull out one thread and the whole fabric comes apart. On the other hand, this openness to reform never led to serious changes in social practice until the pressure from outside became immense, viz. under British colonial rule with its modernizing impact. But at least the principle that the Manu Smrti was perfectible and changeable was understood from the start and is implied in its classification as a Smrti, a man-made ‘memorized text’ or ‘classic’, or Shâstra, a man-made ‘rule book’, in contrast with the Shruti literature (‘glory’, often mistranslated as ‘heard text’ in the sense of ‘divinely revealed text’, like the Qur’ân), i.e. the Vedas, which had by then been exalted to divine status, and which don’t have the character of rule books but of hymns addressed to the gods.
Manu (as we shall call the anonymous author) explicitly acknowledges the validity of customary law: ‘He must consider as law that which the people’s religion sanctions’ (7:203). Much of what he describes was nothing but existing practice. Until the enactment of modern laws by the British and the incipient Indian republic, the final authority for intra-caste disputes was the caste pañchâyat (‘council of five’), for inter-caste disputes the village pañchâyat, in which each local caste was represented and had a veto right. These councils were sovereign and not formally bound by the Manu Smrti or any other Shâstra-s, though these could be cited in the deliberations by way of advice.
Apart from Manu’s own Shâstra, there were quite a few rival texts written with the same purpose. In anti-Hindu polemics arguing for the utter inhumanity of the caste system, Manu is often accused of laying down the rule that ‘if an untouchable listens attentively to Veda recitation, molten lead must be poured into his ears’ (because his unclean person would pollute the Vedic vibration, with detrimental consequences for the whole of society…). This rule is nowhere to be found in Manu. Yet it is authentic, but it is from the less prestigious Gautama-Dharma-Sûtra (12.4). The most famous Dharma-Shâstra apart from Manu’s is probably the one credited to Yajñavalkya, the Vedic philosopher who introduced the crucial notion of the Self (âtman) in the Brhadâranyakopanishad. But here again, the extant text, more streamlined and contradiction-free than Manu’s, is a number of centuries younger than its purported author.
Though not law books stricto sensu, these Shâstra-s (presented exhaustively in Kane 1930 ff.) do communicate a legal philosophy and directive principles for how people should conduct themselves in society and how rulers should organize it. Their most striking feature when compared with modern law, though not dissimilar to most pre-modern law systems even in West Asia and Europe, is that they allot different rights, prohibitions and punishments to different classes of people. In particular, and to Nietzsche’s great enthusiasm, it thinks of the social order in terms of the varna-vyavasthâ, approximatively translated as the ‘caste system’.
Thus, the murder of a Brahmin is punished more heavily than the murder of a low-caste person. For theft, a high-caste person received a heavier punishment than a low-caste person (Gopal 1959 190). And in a rule to which Friedrich Nietzsche alludes (14[176] 13.362), a labourer is not punished for drunkenness, but a Brahmin is, because according to Nietzsche, ‘drunkenness makes him sink to the level of the Shudra’. From the Hindu viewpoint, the rationale for the latter rule was more probably that a drunken Brahmin might desecrate the Vedas by reciting them in a jocular or mocking manner, which would be highly inauspicious, whereas a labourer’s loss of self-control is less consequential. So, while Manu is unabashedly non-egalitarian, Nietzsche overdoes this focus on inequality because he doesn’t empathize with other, religious considerations that were crucial to Manu.
In Manu’s view, everyone has to do his swadharma, ‘own duty’, which implies distinctive rules as well as privileges. This is not conceived in an individualistic sense (as in Nietzsche’s Zarathustra calling to ‘walk the one road no one can walk but you’) but as one’s caste duty. It is mostly because of its casteism that the Manu-Smrti is abhorred by Indian and Western egalitarians, and that it was admired by pro-aristocratic thinkers such as Nietzsche.
1.4. Reconciling Vedic theory with Hindu practice
In his letter to Peter Gast of 31 May 1888, Nietzsche called the Manu-Smrti ‘a priestly codex of morality based on the Vedas’ (KSA 14.420). Manu’s understanding of ‘Vedic’, like that of modern Hindus, and like Nietzsche’s borrowed idea, is not certified by scholars as historically Vedic. More than a thousand years had elapsed between the final edition of the Vedas and the composition of the Manu-Smrti, and society had evolved considerably. One of Manu’s self-imposed tasks was to offer justification from the Veda-s, then already an old and little-understood corpus, for the mores and social ideals of his own day.
Nietzsche thought these ancient laws, Manu’s as much as Moses’, were endowed with authority through the pious lie of divine sanction. In fact, Manu does not claim a divine origin for his code the way Moses did, but the distinction is only technical; the attribution of the MS to the ancient patriarch and the mere fact of its use of the sacred Sanskrit language gave it a religious aura. Manu was a great trend-setter for the later and current Hindu tendency to back-project all later Hindu practices (e.g. idol-worship, astrology) and beliefs (e.g. in reincarnation, inviolability of the cow) unhistorically onto the Vedas. In particular, Manu’s account of caste relations has no precedent in the Vedic corpus, which apparently reflects the simpler social structure of a simpler age.
The Rg-Veda, and then only its youngest book, mentions the four varna-s (castes) as springing from the different body-parts of the Cosmic Man: the Brâhmana from his face, the Kshatriya from his upper body, the Vaishya from his lower body, the Shûdra from his feet (RV 10.90.12). It is thus literally a corporatist explanation of society, with the social classes united in purpose as the limbs of a single body, similar to the corporatism found in Titus Livius’ account of Menenius Agrippa’s speech against class struggle, and in Saint Paul (1 Corinthians 12). This founding text is of course quoted approvingly by Manu (1:93).
However, the Rg-Veda doesn’t yet mention the really operative units of Hindu society, the thousands of jâti-s, or endogamous groups. Nor does it link the varna-s to hereditary profession, another important feature of caste. It is merely stated that these four functions exist in late-Vedic society, as they do in most developed societies. Presumably, just as the relation between the sexes was demonstrably more flexible in the Vedic as compared with the classical Hindu period (Altekar 1959), the relations between the social strata was likewise not as rigid yet. The Manu Smrti marks the phase of crystallization of the system of caste segregation.
The notion of inborn ritual uncleanness or untouchability (asprshyatâ) doesn’t figure in the Rg-Veda either. That is why modern Hindu social reformers could appeal to the Rg-Veda as scriptural justification for abolishing untouchability. The first apparent mention of untouchables is probably in the Chândogya Upanishad (5.3-10), where the Brahmins Uddâlaka Gautama Aruni and his son Shvetaketu find that they don’t know the answer to questions about life after death on which a prince has quizzed them. They go to the king who tells them that his own Kshatriya caste wields power thanks to the secret knowledge which until then they never shared with the Brahmins, viz. that man reincarnates. At once he adds the retributive understanding of reincarnation: ‘Those who are of pleasant conduct here, the prospect is, indeed, that they will enter a pleasant womb, either the womb of a Brahmin, the womb of a Kshatriya, or the womb of a Vaishya. But those who are of stinking conduct here, the prospect is, indeed, that they will enter a stinking womb, either the womb of a dog, or the womb of a swine, or the womb of a Chandâla’ (5.10.7).
In theory, the meaning of Chandâla in this early context is open, it could be an ethnonym for some feared or despised foreign tribe (arguably the Kandaloi mentioned in Ptolemy’s Treatise on Geography 7.1.66) which got incorporated only later as a lowly caste. However, the term’s appearance in contrast with the explicitly named upper castes indicates that it already refers to an unclean or untouchable caste. By Manu’s time, the Chandâla’s or ‘fierce’ untouchables (possibly a folk etymology for what was originally a non-Sanskritic ethnonym) were an established feature of Hindu society. They were also called avarna, ‘colourless’, ‘without caste pride’. But it would be wrong to translate this as ‘casteless’, for they too live in endogamous jâti communities.
Nowadays, jâti is often infelicitously translated as ‘subcaste’, but ‘caste’ would be more accurate, i.e. endogamous group. The British colonizers initially translated this term as ‘tribe’ (as in ‘the Brahmin tribe’), which inadvertently held the key to the jâti-s’ historical origin. As a general rule, jâti-s originated as independent tribes that got integrated into the expanding Vedic society, whose heartland was limited to the region around present-day Delhi. It was part of the Brahminical genius to let them keep or even strengthen their separate identities, founded in their endogamy, all while ‘sanskritizing’ them, i.e. bringing them into the Vedic ritual order (somewhat like the Catholic Church facilitated the christianization of the Pagans in the Roman Empire by integrating some of their customs and institutions). Secondarily, some specific jâti-s originated by division (or, in the modern age, fusion through intermarriage) of pre-existing jâti-s.
The four varna’s were originally not endogamous by definition. They were hereditary, but only through the paternal line, as we see in a number of inter-varna couples in the Vedic literature and the epics. A man could marry a woman from any caste (though preferably not from a higher caste), she would move into his house and his varna community, and their children would naturally become part of their father’s varna. However, intermarriage between varna-s also went out of use, and Manu reports the practice but expresses his disapproval. The effective unit of endogamy was the jâti, not the varna, but since most jâti-s were classified under one of the varna-s, any inter-varna marriage would be an inter-jâti marriage and hence forbidden. While a hypergamous marriage between a higher-born man and a lower-born woman would be frowned upon but often tolerated (though least so in the Brahmin caste), a hypogamous union was strictly out of bounds: ‘If a young girl likes a man of a class higher than her own, the king should not make her pay the slightest fine; but if she unites herself with a man of inferior birth, she should be imprisoned in her house and placed under guard. A man of low origin who makes love to a maiden of high birth deserves a corporal or capital punishment’ (MS 8.365f.).
Hindu reformists often claim that caste was never hereditary, and that the Bhagavad-Gîtâ, the most authoritative source in everyday Hinduism, edited in about the same era as the MS, defines a person’s varna by his guna, ‘quality, aptitude’ and karma, ‘work’ (4.13). But those criteria are not given in opposition to heredity, on the contrary: in terms of work and aptitude, people in pre-modern societies tended to follow in their parents’ footsteps, statistically speaking. Moreover, the Gîtâ itself is explicit enough about the understanding of caste identity as hereditary and implying endogamy. When its hero Arjuna shies away from battle and displays a failing in the martial quality (guna) befitting a warrior, his adviser Krshna does not tell him that by guna he clearly isn’t a Kshatriya and hence free from military duty, but instead tells him to overcome his doubts and do his Kshatriya duty, for regardless of his personal traits he just happens (viz. by birth) to be a member of the Kshatriya caste.
When the two argue opposing positions regarding the justice of waging the fraternal war, they do so with reference to the same concern, viz. the need to avoid varna-sankara, roughly ‘mixing of castes’. Both say that the other’s proposed line of action, viz. fighting c.q. avoiding the war, would lead to the ‘immorality of women’ and thence to breaches of caste endogamy. (BG 1.41-43, 3.24). When in a society two opposing arguments are based on the same value, you know that that value is deeply entrenched in that society,-- i.c. caste as an hereditary communal identity guarded by endogamy.
2. Nietzsche’s understanding of the text
Friedrich Nietzsche didn’t share the enthusiasm for all things Indian evinced by many of his contemporaries. Thinkers critical of Christianity from Voltaire to Arthur Schopenhauer and Ernest Renan had been using the glory of Indian civilization as a counterweight against the ideological influence which Christianity still wielded even among nominal unbelievers. Indology had been arousing a lot of interest in its own right, but was also instrumentalized in Europe’s self-discovery and self-glorification through the study of the Indo-European language family and the presumed civilization underlying its original expansion. Moreover, there was always the titillating element in India’s exotic features, charming or horrifying, such as the much-discussed custom of widows’ self-immolation (satî). All this seems to have left Nietzsche cold. At any rate none of it figures in his published works, except for his references to Manu’s thinking on caste.
The extant literature on the understanding of Manu in Nietzsche’s work is limited in quantity. This is logical, given that Nietzsche’s own discussion of Manu amounts to only a few pages in total. In a short but important paper, Annemarie Etter (1987, further built upon by Berkovitz 2003 and 2006, Smith 2006, Bonfiglio 2006; while Lincoln 1999 101-120 seems to have worked independently on the same theme) draws attention to the poor quality of the Manu Smrti translation which Nietzsche used, viz. the one included in Louis Jacolliot’s book Les Législateurs Religieux: Manou, Moïse, Mahomet (1876), to be discussed here in §2.4. But apart from flaws in the text version used by Nietzsche, there are three more sources of distortion in his understanding of caste society, viz. Manu himself, Jacolliot’s personal additions to his translation of the received text, and Nietzsche himself.
2.1. Errors in Manu
The Manu Smrti is usually referred to, especially by its modern leftist critics in India, as the casteist manifesto pure and simple. This is fair enough in the sense that there is no unjustly disregarded anti-caste element tucked away somewhere in Manu’s vision of society; the text is indeed casteist through and through. However, the scope of the Manu Smrti is broader, dealing with intra-family matters, the punishment of crime, the king’s (in the sense of: the state’s) duties, money-lending and usury, et al. Matters are further complicated by the fact that the text itself contains contradictions, e.g. allowing niyoga or levirate marriage (9.59-63) only to disallow it in the next paragraph (9.64-69, as pointed out by Kane 1930.I.331); recommending meat-eating on certain ceremonial occasions (5.31-41) yet imposing strict vegetarianism elsewhere (5.48-50); describing the father as equal to a hundred Vedic teachers, then reversing this by calling the teacher superior to the father (2.145f.).
Part of the treatise’s self-imposed mission was to reconcile ancient Vedic injunctions, then already obsolete, with social mores actually existing in India around the turn of the Christian era. This seriously muddles Manu’s account of caste, e.g. first allowing a Brahmin man to marry a Shûdra woman (2.16, 3.12f.), as was clearly the case in the Vedic age, then prohibiting the same (3.14-19).
In order to fit the observed reality of numerous jâti-s into the simple Vedic scheme of four varna-s, Manu develops a completely far-fetched theory that each jâti originated from a particular combination of varna-s through inter-varna marriage. This makes no historical or logical sense. In fact, many jâti-s were tribes whose existence as distinct endogamous groups predated the Vedic age, let alone the MS’s age, and even the more recently originated jâti-s didn’t come into being the way Manu suggested.
Manu despises the lowest jâti-s not on account of race, nor ostensibly because of unclean occupations, but because they were born from sinful unions. Most of all he condemns the marriage uniting people from the varna-s at opposing ends of the varna hierarchy and thus most contrary to the ideal of varna endogamy. Not always consistently, but the general thrust of his teaching on endogamy is clear enough. And as if in punishment for their parents’ sins, the children of inter-caste unions became the people performing the lowliest and most unclean tasks.
The Dharma-Shâstra–s give a completely far-fetched theory of the origins of the castes, e.g. the Gautama-Dharma-Shâstra (4.17) relays the view that the union of a Shûdra woman with a Brâhmana, a Kshatriya or a Vaishya man brings forth the Pârashava c.q. the Yavana (‘Ionian’, Greek or West-Asian) and the Karana jâti. Likewise, Manu claims that ‘the Chandâla-s, the worst of men’ are the progeny of a servant father and a priestly mother (10.12). Clearly, the Chandâla-s were looked down upon already, mainly because of their unclean labour (any work involving decomposing living substances, esp. funeral work, sweeping, garbage-collecting, leather-work), possibly also because of a memory of them as originally being subjugated enemy tribes, decried for having first terrorized the Ârya-s and thus ‘deserving’ their reduction to the lowliest occupations. Manu then used this existing contempt in his plea against caste-mixing, by depicting the latter as the cause of the well-known degraded state of the Chandâla-s.
Here, Manu gives in to a typically Brahminical (or intellectuals’) tendency of subjugating reality to neat little models, in this case also with a moralistic dimension. Practice of course is both simpler and more complicated than Manu’s model of caste relations. Low-castes are typically the children of low-castes, not of mixed unions between people of different higher castes. And children of mixed unions do not form new castes, they are accepted into one (usually the lower) of the two parental castes. But Nietzsche is not known to have taken an interest in such historical and sociological detail, neither for its own sake nor for the purpose of giving a verified groundwork to his Manu-based speculations.
2.2. Manu and race
In one respect, Manu’s idea of blaming social disorder on intermarriage seemed attractive to Western readers in the late 19th century, for it agreed with one of the tenets of the flourishing race theories, viz. that race-mixing has a negative effect on the individuals born from such unions. Better a negro than a mulatto, for the latter may have inherited a share of ‘superior’ Caucasian genes, but he will be plagued by an internal conflict between the diverging ‘natures’ of the two parent races. Likewise, the promiscuous servant woman described by Manu may have felt flattered by the interest her Brahmin lover took in her, but for her offspring it would have been better if she had restricted her favours to someone of her own caste. So, a pure low-caste ends up superior to a mixed offspring of high and low castes. While it remains absurd to posit that sweepers and funeral workers (the lowest castes) came into being as children of unions between priests and maidservants, or between the princess and the miller’s son, Manu’s little idea resonated with a cherished belief of Nietzsche’s contemporaries.
In another respect, though, this contrived idea of Manu’s, and Nietzsche’s injudicious acceptance of it, conflicts with 19th -century racial thought. It was then generally believed that the ‘Aryan race’ had invaded India, bringing the Sanskrit language and proto-Vedic religion with them, then subjugated the natives and locked them into the lower rungs of the newly-invented caste system, a kind of apartheid system designed to preserve the Aryan upper castes’ racial purity. (For a critical review of this theory, vide Elst 2007).
In that connection, the reading of varna, ‘colour, social class’, as referring to skin colour, was upheld as proof of the racial basis of caste. To put this false trail of 19th -century race theory to rest, let us observe here that neither the Rg-Veda nor the Manu Smrti connects varna to skin colour. The term varna, ‘colour’, is used here in the sense of ‘one in a spectrum’, just as the alphabet is called varna-mâla, ‘rosary of colours’, metaphor for ‘spectrum (of sounds)’. So, the varna-vyavasthâ is the ‘colour system’, i.e. the ‘spectrum’ of social functions, the role division in society. Just as the existence of social classes in our society doesn’t imply their endogamous separateness, the Vedic varna-s were not defined as endogamous castes.
Physical anthropology has refuted the thesis of caste as racial apartheid long ago (Ghurye 1932), refuted at least according to the scientific standards of the day. Today the science of genetics is fast deepening our knowledge of the biological basis of caste, including the migration history involved in it. As the jury is still out on the genetic verdict, we cannot use that fledgling body of evidence as an argument in either sense here. But the use of colours as a purely symbolical, non-racial marker of social class is attested in several other Indo-European-speaking societies, the closely related Iranian society but also the distant and all-white Nordic class society of jarl (nobleman) with colour white, karl (freeman) red, and thraell (serf) black, as described in the Edda chapter Rigsthula.
In the predominant racialist view of the 19th century, the lowest castes were the pure natives, the highest the pure Aryan invaders, and the intermediate castes the mixed offspring of both. But Manu’s view, though often decried as ‘racist’ in pamphlets, is irreconcilable with this, for it classifies the lowest castes as partially the offspring, even if the sinful offspring, of the highest castes. The caste hierarchy as conceived by him is not a racial apartheid system. As an aspiring historian of caste society, Manu may have been seriously mistaken; but if read properly and not judged from simplifying hearsay, he was not an ideologue of racial hierarchy.
However, though the castes may not have originated as genetically distinct groups, their biological and social separation by endogamy over a number of generations was bound to promote distinctive traits in each. Nietzsche sees Manu’s proposed task as one of ‘breeding no fewer than four races at once’ (TI Improvers 3), each with distinct qualities. As a classicist, Nietzsche was certainly aware of the eugenicist element in Plato’s vision of society and he hints at the similarity with Manu: ‘[…] but even Plato seems to me to be in all main points only a Brahmin’s good pupil’ (letter to Peter Gast, KSA 14.420). As for the medieval European society with its division in endogamous nobility and commoners: ‘The Germanic Middle Ages was geared towards the restoration of the Aryan caste order’ (14[204] 13.386). Indeed:
Medieval organisation looks like a strange groping for winning back those conceptions on which the ancient Indian-Aryan society rested,- but with pessimistic values stemming from racial decadence. (letter to Peter Gast, KSA 14.420)
It was mainly European nostalgics of the ancien régime who got enamoured of the caste system. Yet, the rising tide of modern racism also managed to incorporate its own analysis, unsupported by the Hindu sources, of the Hindu caste ‘apartheid’ as a design to preserve the ‘Aryan race’. Nietzsche remained aloof from that line of discourse.
2.3. Manu, priest-craft and legislation
One element in Manu which isn’t easy to fit into Nietzsche’s viewpoint, is his pro-Brahmin bias. On the one hand, Nietzsche couldn’t fail to appreciate the determination of a whole society to set aside resources for a separate caste fully devoted to spiritual and intellectual work. Could a non-caste society have achieved the Brahminical feat of transmitting the Vedas and the ancillary texts and sciences through several thousands of years’ worth of all manner of turmoil? On the other hand, he couldn’t muster much enthusiasm for a system placing the priestly class on top.
Manu is candid and explicit about this: ‘The priest is the lord of the classes because he is pre-eminent, because he is the best by nature, because he maintains the restraints, and because of the pre-eminence of his transformative rituals’ (10.3). In theory, and because it was Brahmins who did all the writing, the Brahmins were the highest caste, and Nietzsche doesn’t seem to question this. But the tangible power in Hindu society lay with the Kshatriya-s, the counterpart of the European aristocracy, which enjoyed Nietzsche’s sympathy far more than any priestly group. For all his sympathy with Manu’s vision, Nietzsche had to criticize Manu’s ‘priest-craft’, debunking it as just a ploy for wresting power:
Critique of Manu’s law-book. The whole book rests on a holy lie: […] Bettering man – whence is this purpose inspired? Whence the concept of the better? We find this type of man, the priestly type that feels itself to be the norm, the peak, the highest expression of humanity: out of itself it takes the concept of the ‘better’. It believes in its superiority, and wants it in fact: the cause of the holy lie is the will to power. (15[45] 13.439)
Nietzsche, however, fails to question Manu’s implicit and explicit claims for Brahminical legislative authority. Through the format of his book, Manu creates an impression (which Nietzsche swallowed whole) that he is laying down a law, but when read more closely, his work proves in fact to be more descriptive than normative, not a law book but rather a treatise on existing social norms and values. ‘Manu prohibits X’ should in most cases be replaced with ‘Manu disapproves of X’ or ‘Manu notes that X is prohibited’. The many contradictions are also quite misplaced in a law book, but perfectly normal in a treatise dealing with the sometimes irregular or conflicting customs in a living society and with ideals versus realities. Moreover, Manu enjoins the ruler to restrain his zeal for law-making and instead respect existing customs in civil society. Manu’s treatise is antirevolutionary, holding off all revolutionary changes whether imposed from above or from below.
Therefore, it bears repeating that Manu with his limited ambitions was not a law-giver gate-crashing into society to impose his own designs. Once caste went out of favour, Manu and the Brahmins were often blamed for having created and imposed the caste system. Yet in fact, as B.R. Ambedkar, a born untouchable who became independent India’s first Law Minister, observed, it was quite outside their power to impose it:
One thing I want to impress upon you is that Manu did not give the law of caste and that he could not do so. Caste existed long before Manu. He was an upholder of it and therefore philosophized about it, but certainly he did not and could not ordain the present order of Hindu Society […] The spread and growth of the caste system is too gigantic a task to be achieved by the power or cunning of an individual or of a class […] The Brahmins may have been guilty of many things, and I dare say they were, but the imposing of the caste system on the non-Brahmin population was beyond their mettle. (Ambedkar 1916 16)
Ambedkar held that castes had evolved from tribes, self-contained communities that maintained their endogamy and distinctness after integrating into a larger more complex society. This continuity has been confirmed from the angle of anthropological research (Ghurye 1959). Nietzsche speaks of the caste system as a grand project of breeding four different nations, but the system simply didn’t come about as the result of a project. Then again, Manu’s choice to preserve and fortify a system already in existence, was also a ‘project’, the alternative being to allow for negligence in caste mores ending in the mixing of castes, of the kind that in the 19th and 20th century started drowning the distinctive identity of the European nobility through intermarriage with the bourgeoisie.
Yet, in other places, Nietzsche drops the idea of a ‘project’ and acknowledges that Manu’s caste scheme is little more than an explicitation and perhaps a radicalization of an entirely natural and spontaneous condition. Like seeks like, people avoid intermarriage with foreigners or with people located much higher or much lower in the social hierarchy, so there is a natural tendency towards endogamy (jâti). Even more natural is the differentiation of social classes (varna) in duties, rights and privileges, i.e social inequality:
The order of castes, the highest and dominant law, is only the sanction of a natural order, a law of nature of the first rank, over which no arbitrariness and no ‘modern idea’ has any power. (AC 57).
In Nietzsche’s books, this counts as a plus for Manu: the Hindu lawgiver didn’t go against the way of the world, whereas Christianity intrinsically militates against nature.
2.4. Jacolliot’s errors
When Nietzsche quotes Manu in his Antichrist and Twilight of the Idols, and in loose notes from the same period (Spring 1888), it is from the French translation by Louis Jacolliot, included in his book Les législateurs religieux, Manou, Moïse, Mahomet (Paris 1876). He says so himself in his letter to Peter Gast. Colli and Montinari remark that ‘the book of Jacolliot about the Indian Law of Manu made a big, indeed exaggerated impression on him’ (6.667).
Jacolliot had served as a magistrate in Chandernagor, a small French colony in Bengal (later he also served in Tahiti), and claimed to have travelled ‘all over India’ in the 27 months he spent in the country. In his attempts at scholarship, he was an amateur and inclined to far-fetched speculations, especially tending to derive any and every philosophy and religion in the world from Indian sources. In his own account, he made his translation with the help of South-Indian pandits. The text from which they worked (and which is apparently lost) was fairly deviant, missing more than half of the standard version, and was apparently already a Tamil translation from Sanskrit. Though his travel stories were very popular among the greater reading public, Jacolliot was not taken seriously by the philologists, finding himself openly denounced as a crackpot by such leading lights as Friedrich Max Müller.
Some parts of Jacolliot’s rendering, including two passages quoted by Nietzsche, do not appear in the standard version of the text. Moreover, in his list of ‘protective measures of Indian morality’ (in TI Improvers 3), Nietzsche makes the additional mistake of quoting as Manu’s text what is in fact a footnote by Jacolliot. This faulty reading is so significant for Nietzsche’s thought that we will consider it separately in §2.5.
Etter notes that until 1987, for a whole century, no Indologist seems to have noticed the textual errors in Nietzsche’s quotations from Manu, though at least Nietzsche’s friend Paul Deussen and later Winternitz (1920) did care to mention Nietzsche’s enthusiasm for Manu. Doniger (1991 xxii), though unaware of Etter’s work, does note a faulty quotation (in Antichrist 56) from Manu 5.130-133, where Nietzsche cites Jacolliot’s non-Manu phrase: ‘Only in the case of a girl is the whole body pure’, as illustration of Manu’s sympathy for women. However, she doesn’t look in a systematic way into the problem of Nietzsche’s source text. This indicates that the eye of the Indologists had not been struck by any serious injustice done to Manu’s message by Nietzsche. Even if the letter of his text was flawed, it did nevertheless carry the gist of Manu’s social vision.
So we shouldn’t make too much of his reliance on a distorted text version, at least in so far as he deals with Manu’s ideology of caste. Indeed, as we shall see, Nietzsche’s faulty understanding of a particularly strange claim made by Jacolliot does not pertain to Manu’s own subject-matter, the caste system, but to a subject entirely outside Manu’s horizon, viz. a supposed role of emigrated Chandâla-s in the genesis of West-Asian religions.
One reason why, in spite of relying on Jacolliot’s flawed translation for quotation purposes, Nietzsche doesn’t do injustice to Manu’s thought, is that he must have been familiar with Manu’s outlook through indirect sources. Indo-European philology was a hot item in 19th century Germany, partly because it had ideological ramifications deemed useful in the political struggles of the day. Indocentrism was most strongly in evidence in Arthur Schopenhauer, a principal influence on Nietzsche. Johann Wolfgang von Goethe had propagated Kâlidâsa’s play Shakuntalâ in Germany. Even G.W.F. Hegel (1826), by no means an Orient-lover, had written a comment on the Bhagavad-Gîtâ, including reflections on the caste system.
So, it is likely that Nietzsche had had a certain exposure to the then-available knowledge of the caste system as outlined by Manu. In particular, he may have already been exposed to Johann Hüttner’s German translation (Die Gesetze des Manu, Weimar 1797, based on William Jones’s English translation, 1796), at least indirectly. If only through his Indologist acquaintances and through general reading, he must have acquired a broad outline of Manu’s caste philosophy.
Nietzsche’s preference for Jacolliot’s over more scholarly Western editions of the MS is a bit of a mystery. He had sufficient training in and practice of philology, as well as philologist acquaintances, to see through Jacolliot’s amateurism. This strange error of judgment remains unexplained, short of the rather sweeping solution of seeing it as a prodrome of his loss of sanity, which befell him only a year later.
2.5. Jacolliot and the Jews
There is one very serious mistake in Jacolliot that seems to have made an important difference to Nietzsche’s thought: his far-fetched speculation that the Chandâla-s left India in 4000 BC (Jacolliot dates the Manu-Smrti itself to 13,300 BC!) and became the Semites. The point here is not the eccentrically early chronology. The exact age of the Vedas was a much-discussed topic, still not entirely resolved, and dating at least the Rg-Veda to beyond 4000 BC, as against Max Müller’s estimate of 1500 to 1200 BC, was not uncommon even among serious scholars like Hermann Jacobi (1894). The point is the alleged Indian and low-caste origin of the ‘Semites’.
Nietzsche hesitates whether to believe Jacolliot on this:
I cannot oversee whether the Semites have not already in very ancient times been in the terrible service of the Hindus: as Chandalas, so that then already certain properties took root in them that belong to the subdued and despised type (like later in Egypt). Later they ennobled themselves, to the extent that they become warriors […] and conquer their own lands and own gods. The Semitic creation of gods coincides historically with their entry into history. (14[190] 13.377f.)
To the ignorant reader, this hypothesis is strengthened considerably by Jacolliot’s additional claim, uncritically quoted in full by Nietzsche (TI Improvers 3, referring to the demeaning features of Chandâla existence enumerated in Manu 10.52), that the Chandâla-s were circumcised. This is based on a mistranslation of daushcharmyam in a verse (MS 11:49) which strictly isn’t about Chandâla-s but about the karmic punishment for the student who has slept with his guru’s wife, either in this or a former lifetime. The mistranslation first appeared in a commentary on Manu by Kullûka from the 13th century, when Northern India had been conquered by Muslims. The word means ‘having a skin defect’ but was reinterpreted as ‘missing skin (on the penis)’, hence ‘circumcised’. The medieval Hindu commentator’s purpose clearly was to classify Muslims as contemptible Chandâla-s. Some Hindu scribes were very conscientious in rendering texts unaltered, others felt it would be helpful for the reader if they updated the old texts a bit, which seems to have happened in this case.
An anomaly in Nietzsche’s reference to male circumcision as an alleged link between the Chandâla-s and the Jews is that he extends the alleged Chandâla observance of ‘the law of the knife’ to ‘the removal of the labia in female children’ (TI Improvers 3). Female circumcision, in origin a pre-Islamic African tradition, is a common practice in some Muslim communities. Among South-Asian Muslims, it is rare but not non-existent. However, it is not a Jewish practice, certainly not among the Ashkenazi Jewish communities Nietzsche knew in Germany, and it is not part of the commandments in Moses’ law. So, his own assumption that the Chandâla-s (with whom Kullûka associated the Muslims) practised female circumcision should have put him on guard against the deduction of a connection with the Jews.
At one point in his unpublished speculations about Manu’s caste rules, Nietzsche actually uses the term ‘circumcised one’ where the context indicates that he means someone at the bottom end of the caste hierarchy:
The killer of a cow should cover himself for three months with the skin of this cow and then spend three months in the service of a cowherd. After that he should make a gift to the Brahmin of ten cows and a bull, or better even, all he possesses: then his fault will have been evened off. He who kills a circumcised one, purifies himself with a simple sacrifice (whereas even killing a mere animal demands a penitence of six months in the forest, unshaven). (14[178] 13.363)
Through Jacolliot’s clumsy translation, this seems to refer to the authentic passage listing the different punishments for killing people belonging to different social classes, as well as for killing different categories of animals (MS 11.109-146). There, for instance, the punishment for killing a member of the servant class is candidly evaluated as rather unimportant: it is fixed at one-sixteenth of the punishment for killing a priest (11.127). Nietzsche’s information that a cow-killer should cover himself with the cow’s skin as part of his penance is also correct (MS 11.109). That killers doing penance should live in the forest unkempt and with matted hair is stipulated in MS 11.129. So, in broad outline, Nietzsche is conveying a genuine tradition. However, this passage from Manu doesn’t specify any particular level of punishment for the case of untouchables, the lowliest subset within the ‘servant’ class. Even conceding that Nietzsche correctly renders Manu’s general intention in allotting only a minimal punishment for the killing of people with minimal standing in the caste hierarchy, the fact remains that the authentic passage contains no reference to ‘skin-defective’ people, let alone to Kullûka’s and Jacolliot’s interpretation of that term, viz. ‘circumcised ones’. But Nietzsche had genuinely interiorized the notion that Indian low-castes in the first century CE were circumcised. In calling them ‘circumcised ones’ off-hand, he treats the alleged circumcision of the Chandâla-s as a given.
Compounding this important mistake, Nietzsche (TI Improvers 3) further quotes from Jacolliot’s Manu version an insertion by the medieval commentator to the effect that the Chandâla-s used a right-to-left script, allegedly because writing from left to right like in the Sanskritic script, and even the use of the right hand, was forbidden to them. Like circumcision, the leftward script is a feature of Muslim culture. But to confuse matters further for Nietzsche, both features are also in evidence among the Jews, whose alphabet has a common origin with the Arabic one. Joining the dots, Nietzsche concludes that: ‘The Jews appear in this context as a Chandala race’, and explains the Jewish people’s alleged priestly leanings from their supposed origins as a class of underlings of the Hindu priestly caste, ‘which learns from its masters the principles by which a priesthood becomes master and organizes society’ (letter to Peter Gast, KSA 14.420).
As an exercise in genealogy, this hypothesis of Nietzsche’s is highly unconvincing. If something is to be explained about the Jews by their purported provenance from specific Indian low-castes, wouldn’t it be more logical, and certainly simpler, to let them continue the cultural features of low-caste life, as is effectively the case with the Gypsies? Conversely, if the Jews had to be of Indian origin and if they were suspected of ‘priest-craft’, shouldn’t they rather be descendents of the Brahmin caste?
The question is all the more poignant when we consider that the idea of a Jewish-Brahmin connection was already quite ancient. In his plea Contra Apionem (1.179) the Jewish-Roman historian Flavius Josephus quotes Aristotle’s pupil Clearchos of Soli as having claimed that Aristotle had been very impressed once with the discourses of a Jewish visitor, and more so with the steadfastness of his dietary discipline, and had concluded that in origin the Jews had been Indian philosophers. A similar claim is found in the Hellenistic-Jewish philosopher Aristoboulos. So, two millennia before Nietzsche, an Indian origin was already ascribed to the Jews. (A Brahminical connection is still attributed to the Jews in today’s India, both by Hindu nationalists who believe everything of value originates in India and invoke the superficial phonetic similarity between ‘Brahma/Saraswati’ and ‘Abraham/Sarah’, and by low-caste activists whose anti-Brahminism borrows the rhetoric of international anti-Semitism, attacking the Brahmins as ‘Jews of India’, e.g. Rajshekar 1983 2.)
Unlike Jacolliot, Nietzsche was interested in Judaism and its purported Chandâla origin mainly as an angle from which to attack Christianity. As Lincoln (1999 110) observes,
he came to be infinitely more critical of Christianity than of Judaism, and he saved some of his most scathing contempt for those (like Wagner, Bernhard Förster, and others of the Bayreuth circle) who were only anti-Semites in the narrowest sense, that is, Christians who failed to realize that everything wrong in Judaism was amplified and exacerbated in Christianity.
So, in Nietzsche’s view, the alleged Chandâla traits, especially resentment against the noble and the successful, though carried over by Judaism, were in fact at their most powerful and noxious in Christianity:
Christianity, which has sprung from Jewish roots and can only be understood as a plant that has come from this soil, represents the counter-movement to every morality of breeding, race or privilege:- it is the anti-Aryan religion par excellence: Christianity the transvaluation of all Aryan values, the victory of Chandala values. (TI Improvers 4)
Though not very important in quantity, the Chandâla statements in Nietzsche’s work have made a mark on his whole anthropology, with the Chandâla as the lowest extreme in the range of human diversity. Sentences like the one just quoted corroborated the emerging dichotomy of ‘Jewish’ and ‘Aryan’, which was by no means intrinsic to the concept of ‘Aryan’ even after its somewhat distortive adoption into European languages from Sanskrit. They also helped make Nietzsche’s image as an incorrigible anti-egalitarian who burdened the lower classes with a caste-like inborn inferiority. Even if his anti-egalitarianism was not of the racist or anti-Semitic kind, it was nonetheless in sharp conflict with the rising tide of liberalism and socialism. Any ‘leftist Nietzscheanism’ was thereby forever doomed to a contrived denial or uneasy management of this contradiction between the freedom-loving element in Nietzsche and his condemnation of certain communities to a permanent position of contempt. That is one reason why Monville (2007) speaks of ‘the misery of leftist Nietzscheanism’. As his book’s reviewer in the Belgian Communist Party paper Le Drapeau Rouge (Oct. 2007) sums it up: ‘This German philosopher was openly racist and endowed with a remarkable and odious contempt for the social condition of the losers in the caste struggle.’
2.6. Nietzsche’s errors
Nietzsche has been accused of being very selective in what he retained and quoted from the Manu Smrti, especially its most un-Christian pieces of praise for the female sex, e.g. that all good things including access to heaven ‘depend upon a wife’ (MS 9:28). On that basis, he waxes eloquent about the woman-friendliness of the Hindu sages:
I know no book in which so many gentle and nice things are said to women as in Manu’s law book; these old greybeards and saints have a manner of being kind to women that has perhaps not been outdone. (AC 56)
The quotations are by and large genuine, but ought to be counterbalanced by far less flattering quotations from the same text. Wendy Doniger (1991.xxi) chides Nietzsche for this one-sided representation and quotes Manu (9.17): ‘The bed and the seat, jewellery, lust, anger, crookedness, a malicious nature and bad conduct are what Manu assigned to women.’
However, Nietzsche’s selectiveness doesn’t really misrepresent Manu’s attitude in what was to him the relevant issue, for this much remains true, that Manu genuinely values the role of women as wives and mothers. They were not equal with men (‘It is because a wife obeys her husband that she is exalted in heaven’, 5.155), just like in most other cultures, and Manu too considered them fickle and untrustworthy and what not, but fundamentally they were a very auspicious part of the cosmic order. The good thing about women was not their equality with men, which would have been a ridiculous notion to Manu just as it was to Nietzsche, but that they provided pleasure in life and perpetuated the species. For the same reason, sex is treated in a matter-of-fact manner because even if a delicate subject with problematic ramifications in day-to-day human relations, in essence it is an auspicious cornerstone of the cosmic order. Nietzsche contrasts this with an alleged woman-hating and anti-sexual tendency in Christianity as well as in Buddhism.
On the whole, Nietzsche does justice to Manu’s view of man and society. His main error does not consist in false or mistaken assertions about Manu’s position, only in a limited grasp of the Indian historical context. He was too much in a hurry to enlist Manu in his own ideological agenda to familiarize himself with the actual reality as well as with the philosophical background of caste society.
3. Nietzsche’s use of Manu
To what extent did Nietzsche’s idealized view of Hindu caste society play a role in his views of socio-political matters and of religion?
3.1. Favourable contrasts with Christianity
For Nietzsche, Manu’s vision contrasts favourably with Christianity in several specific respects. Firstly, its goal is not to deform mankind and clip its wings, but to ‘breed’ it, to direct its natural growth and evolution in a certain direction. Consistently with this difference in goals, there is a different approach: while Christianity ‘tames’, Manu ‘breeds’, i.e. he manipulates natural tendencies in a chosen direction. He does not destroy but shapes up. He shows no resentment against the existing order but tries to preserve and ‘improve’ it (AC 56f.).
Secondly, Nietzsche applauds Manu’s candid acceptance and promotion of inequality, which follows naturally from an acceptance of life:
And do not forget the central point, the fundamental difference between it and every type of Bible: it lets the noble classes, the philosophers and warriors, stand above the crowd; noble values everywhere, a feeling of perfection, saying yes to life,- the sun shines over the entire book. All the things that Christianity treated with its unfavourable meanness, procreation for instance, women, marriage, are here treated with seriousness, with respect, with love and trust. How can you really put a book into the hands of children and women when it contains that mean-spirited passage: ‘To avoid fornication, let every man have his own wife and every woman her own husband: it is better to marry than to burn.’ [Paul: 1 Cor.6:2-9 - KE] (AC 56)
Thirdly, he welcomes Manu’s intolerance towards pessimism: even the ugly and lowly are part of the world’s perfection. There is no need to ‘cure’ the world of their presence, they are given a place somewhere in the system.
Fourthly, asceticism is present in Brahmanism as much as in Christianity, but its outlook and motivation is radically different. It does not stem from nor aim at life-denial, it is the joy of the strong who thereby feel and enjoy their strength of character. It is significant that the ascetic tradition originated in the martial Kshatriya caste, to which the Buddha and Mahâvîra Jîna, founders of the surviving ascetic sects of Buddhism and Jainism, belonged by birth. The Indian ascetic’s striving is of the heroic type, seeking to achieve liberation by conquest of the self, not by imprecating divine favours. His celibacy is not a matter of prudery or distrust of sexuality, but of preserving one’s sexual energy and of not diluting masculine standards by symbiosis with women and children.
And whereas these ascetic traditions would still fail to earn Nietzsche’s full approbation because of their hostility to the worldly vale of tears (though their assumption of suffering as the profound nature of all experience might also resonate with the sceptical-pessimist streak in Nietzsche), the Brahminical ascetic tradition as expressed in the Upanishads bases its inner quest on the perception of joy as the intrinsic nature of all experience. According to the Taittiriya Upanishad (2.5), the innermost level of consciousness, underneath the physical, energetic, mental and intellectual ‘sheaths’ covering the Self (âtman), is the sheath consisting of bliss (ânandamaya kosha):
Verily, other than and within that one that consists of understanding [= the intellect – KE] is a self that consists of bliss. […] Pleasure is its head; delight, the right side; great delight, the left side; bliss, the body; Brahma, the lower part, the foundation.
So, the level of consciousness into which the yogi sinks when he stills his thought processes, is one of natural bliss. This illustrates how asceticism as a practice of profound self-mastery need not be based on a sense of tiredness and loathing of the world. The focus in this case is not on the painful experiences from which yoga delivers us, but on the joy which is ever-present and can be awakened further by yoga. To complete this more positive conception of asceticism, Manu does not define the ascetic as one who rejects family and society (the way the Buddha did, or the way Christian monks do), nor as one who spurns normal life for the ascetic life; but as one who completes normal life with an ascetic phase, one who fulfils his social duties first and then, in middle age, crowns his career with the promotion to the ascetic’s lifestyle:
When a man has studied the Veda in accordance with the rules, and begotten sons in accordance with his duty, and sacrificed with sacrifices according to his ability, he may set his mind-and-heart on freedom. (MS 6.36)
Eventually, Nietzsche never got farther than a mere glimpse of this alternative view of asceticism, which contrasts so promisingly with the Christian one of self-punishment. He was locked in his European freethinker’s struggle with the Christian heritage. In the brief months of mental clarity that remained, he didn’t find the time or the appetite to explore the potential help that Hindu thought could have offered him in resolving his very European questions.
3.2. Goddamn this priest-craft
Anything good that may have sprung from Manu has come about thanks to the cunning schemes of Hindu priest-craft, for Nietzsche invariably a vector of the ‘lie’. Given Nietzsche’s views on ‘the uses and drawbacks of truth for life’, the use of this despised priest-craft becomes acceptable because it ends up serving the aims of life rather well. That’s better than the alleged life-denying impact of the Christian lie, but it’s still a lie. Only with that limitation can we say Nietzsche was enthusiastic about Manu.
While Christianity keeps its flock in check with promises and threats of the consequences in the afterlife, Manu achieves the same control with promises and threats of the karmic results in the next incarnations. That at least was and is the common view, and Nietzsche was not sufficiently versed in the subject to know and point out that among Hindu classics, Manu stands out by making only a limited use of the reincarnation doctrine and actually making much more reference to the promise of achieving, or the threat of withholding, access to swarga, ‘heaven’. Numerous times heaven is held up as reward, hell as punishment, only rarely is karma invoked, e.g. an unfaithful wife will be reborn as a jackal (9.30). This afterlife with heaven and hell is the old view of the Vedas, where the heroes go to some kind of exuberant paradise, the way the Greek warriors went to the Elysean Fields, the Germanic ones to the Walhalla, or the Islamic jihâd fighters to Jannat where numerous houri-s (nymphs) shower them with their attentions. By contrast, the notion of reincarnation was a later Upanishadic and Shramanic (i.e. monastic, principally Jain and Buddhist) innovation. Both views of the hereafter get mixed up in Manu, e.g. the punishment for perjury is that the culprit is ‘helplessly bound fast by Varuna’s ropes for a hundred births’ (8.82, meaning he will suffer dropsy during that many incarnations, vide Doniger 1991 160), but also that he ‘goes headlong to hell in blind darkness’ (8.94).
From Nietzsche’s distant viewpoint, however, this made little difference, for either way, priests were exploiting supernatural beliefs about people’s invisible fate after death to impose their law on their people: ‘Reduction of human motives to fear of punishment and hope for reward: viz. for the law that has both in its hand’ (14[203] 13.385).
In this respect, Nietzsche classifies Manu along with Moses, Confucius, Plato, Mohammed as just another religious law-giver, i.e. an immoral liar who tricked his society into a certain morality by means of a pious fantasy. They were all the same, e.g.: ‘Mohammedanism has learned it again from the Christians: the use of the hereafter as organ of punishment’ (14[204] 13.386).
It is the way of priests to present the mos maiorum, or whichever innovation they wanted to introduce into it, as divinely revealed:
A law book like that of Manu comes about in the same way as every book of law: it summarizes the experience, shrewdness and experiments in morality of many centuries, it draws a conclusion, nothing more. (AC 57)
To prevent further experimentation by communities affirming their human autonomy,
a double wall is set up […]: first, revelation, that is the claim that the reason behind the law is not of human provenance, has not been slowly and painstakingly looked for and discovered, but instead has a divine origin, [arriving] whole, complete, without history, a gift, a miracle, simply communicated… And second tradition, that is the claim that the law has existed from time immemorial, that it is irreverent to cast doubt on it, a crime against the ancestors. The authority of the law is founded upon the theses: God gave it, the ancestors lived it. (AC 57)
Therefore, Nietzsche rejects a certain anti-Semitic rhetoric then common in ex-Christian circles, and pleads that in this respect, the Aryan Manu is no better than the Semitic Bible, whose priestly vision actually had Aryan origins:
There is a lot of talk nowadays about the Semitic spirit of the New Testament: but what one calls by that name is merely priestly,- and in the Aryan law book of the purest kind, in Manu, this type of ‘Semitism’, i.e. priestly spirit, is worse than anywhere. The development of the Jewish priestly state is not original: they got to know the blueprint in Babylon: the blueprint is Aryan. If the same returned to dominate again in Europe, under the impact of the Germanic blood, then it was in conformity with the spirit of the ruling race: a great atavism. (14[204] 13.386)
Once, in an unpublished note, Nietzsche expresses a healthy modern scepticism towards the pious caste order with its touch-me-not-ism:
[…] the Chandala-s must have had the intelligence and the more interesting side of things to themselves. They were the only ones who had access to the true source of knowledge, the empirical. Add to this the inbreeding of the castes. (14[203] 13.386)
So, to the modern man Nietzsche, the uptight purity rules against inter-caste contact and the distance which the upper castes kept from activities that would get their hands dirty, remains too stifling for comfort. While generally inclined towards the aristocratic system, he did not want to spend his energies campaigning against class- or race-mixing, unlike many Europeans and Americans during the century preceding 1945. Indeed, his ‘genealogical’ speculations largely aimed at disentangling the different components of Europe’s culture and value system, for he was fully aware of the mixed character of the European civilization and nations. In the caste system, he admired the elitist spirit, but not to the extend of trying to uphold its obsessive purity rules in modern society. And while caste ensured stability, a condition cherished by priestly types, Nietzsche was temperamentally more favourable to scenarios of upheaval. In that respect, the modern world was more congenial to him than medieval European or ancient Indian hierarchies, which he preferred to admire from a comfortable distance.
3.3. The racism Nietzsche didn’t borrow from Manu
In Nietzsche’s day, racism was a fully accepted and even dominant paradigm. Nietzsche himself was not its champion or its mastermind, but neither did he stand as a rock against the racially-inclined spirit of the times. The term ‘race’ had a wider range of meanings then, from ‘family’, ‘clan’ and ‘nation’ to phenotypical ‘race’ to the ‘human race’ (exactly the range of meaning that jâti has in colloquial Hindi). In Nietzsche’s case, it only rarely seems to have the fully biological sense that was gaining ground then:
His not infrequent use of the expressions ‘classes’ and ‘estates’ along with ‘races’ strengthens the suspicion that Nietzsche saw the ‘Aryans’ and ‘Semites’ in the first place as social units, rather as ‘peoples’ or societal ranks, less as ‘races’ in the modern sense. They are what they are because they have lived in specific ‘environments’ for a long time. (Schank 2000 60)
Nietzsche shows some knowledge of the findings of Indo-European philology, especially the theories about the wanderings of the ‘Aryans’ and the resultant substratum effect of pre-Indo-European native languages on the language of the Indo-European settlers (Schank 2000 54). Thus, non-Indo-European roots borrowed from lost substratum languages account for nearly 30% of the core vocabulary in Germanic and nearly 40% in Greek, and the differentiation of Proto-Indo-European into its daughter languages is partly due to the respective impact of different substratum languages on its dialects. Nietzsche fully accepted the then-common view that the native Europeans had adopted their Indo-European languages from tribes immigrating from the East, an Urheimat located anywhere between Ukraine and Afghanistan.
Early in the 19th century, this line of research originally had a fairly Indocentric focus, with India itself being the favourite Urheimat, but as India’s status declined from a mystical wonderland to just another colony, the preferred homeland moved westward. The quest for the early history of Indo-European was interdisciplinary avant la lettre in that it brought proto-sociological insights into its historical-linguistic speculations. Thus, what is now called the ‘elite dominance’ model of language spread, in which the dominant Indo-Europeans imparted their language to the substratum populations, included considerations of the caste system.
The Hindu caste system was widely interpreted in racial terms, viz. apartheid between Aryan conquerors and pre-Aryan natives. Likewise, the situation of the Greeks in Greece, with a vocabulary including numerous pre-Indo-European loanwords and the coexistence of free Greeks with a lower class of helots and slaves, was commonly understood as reflecting the subjugation of a native race by the superior invading Aryan race. Nietzsche accepted this racial scenario to an extent in the case of Europe, but most remarkably did not apply this paradigm to Indian society. Adopting Manu’s view, he saw the difference between high and low castes as not being one between superior and inferior races, but between pure and mixed lineages: ‘good proper marriages bring forth good children; a bad one, bad ones’ (14[202] 13.385). To Manu, good marriages are endogamous marriages, e.g. a marriage between two low-caste people is good.
It is only in a very loose sense of the term that Manu could still be described as a racist, viz. in the sense that he did derive people’s rights from the kinship group to which they belonged. These groups need not be distinguished by phenotypical traits, as races in the modern conception are, but just like races they are communities to which one belongs through birth. That is why recent UN campaigns against racism have tended to include casteism as a peculiar case of racism.
Where Nietzsche did (unsystematically) espouse ideas that were later incorporated in the prevalent racist discourse, he definitely didn’t get them from Manu. Thus, the notion of the ‘blonde Bestie’, which, according to Lincoln (1999 104 ff.), cannot be uncoupled from racial thought, has nothing whatsoever in common with Manu’s view of mankind. Firstly, Nietzsche goes along with the then-common identification of ‘Aryan’ with ‘blond’, as when he speaks of ‘the blond, that is Aryan, conqueror-race’ (GM I 5). This idea was totally unknown to Manu, who may well never have seen a blond person in his life yet lived in the centre of what he called Ârya society. But let us add that Nietzsche doesn’t go all the way in this identification of blondness with superiority, for in the same paragraph he goes on to include the warrior aristocracies from Arabia and Japan.
Secondly, Nietzsche’s glorification of the unbridled norm-breaking wildness as a privilege of the conquerors and ruling class, personified as the ‘blond beast’, is without parallel in Manu or the other masterminds of Hindu civilization. In Nietzschean terms, Manu stands for the ‘Apollinian’ values of order, balance, clarity and stability, not at all for the disruptive ‘Dionysian’ exuberance of the ‘blond beast’.
3.4. The antisemitism Nietzsche didn’t borrow from Manu
Nietzsche did not posit a simple division of the world’s religions in two categories, such as ‘Abrahamic’ vs. ‘Pagan’. Even in typologically similar and genealogically related religions, he sees the opposition between deeper psychological tendencies. Thus, both the ‘Aryan’ and the ‘Semitic’ religions show the same division in ‘yes-saying’ and ‘no-saying’ attitudes:
What a yes-saying Aryan religion, born from the ruling classes, looks like: Manu’s law-book. What a yes-saying Semitic religion, born from the ruling classes, looks like: Mohammed’s law-book, the Old Testament in its older parts. What a no-saying Semitic religion, born from the oppressed classes, looks like: the New Testament, in Indian-Aryan terms a Chandala religion. What a no-saying Aryan religion, grown up among the ruling classes, looks like: Buddhism. It is perfectly in order that we have no religion of oppressed Aryan races, for that would be a contradiction: a lordly race is either on top on going extinct. (14[195] 13.380f.)
Note that his judgment of the Jewish Old Testament, with its wars and love stories, is less negative than that of the Christian New Testament. Not that he failed to share some of the common opinions about the Jews, e.g. that they are only middlemen, not creators: ‘The Jews here also seem to me merely “intermediaries”/“middlemen”, – they don’t invent anything’ (KSA 14.420). He also seems to have seconded the ancient view that the Jews were motivated by hatred of the rest of mankind:
These measures are instructive enough: in them we have at once the Aryan humanity, wholly pure, wholly original,- we learn that the concept of ‘pure blood’ is the opposite of a harmless concept. On the other hand, it is clear in which people this hatred, the Chandâla-hatred of this ‘humanity’, has been eternalized, where this hatred had become a religion, where it has become genius. (TI Improvers 4)
And though Judaism was less harmful to man than Christianity, the latter’s Chandâla resentment has ‘sprung from Jewish roots and is only understandable as a plant from that soil’ (TI Improvers 4).
Yet, it bears repeating here that Nietzsche refused to conclude from these common opinions that an anti-Jewish mobilization as envisaged by the rising (self-described) anti-Semitic movement was necessary or even desirable. In a letter to Theodor Fritsch, a declared anti-Semite, he stated:
Believe me: this terrible eagerness by tedious dilettantes to speak up in the debate on the value of people and races, this subjugation to “authorities” which are rejected with cold contempt by every thinking mind […], these continuous absurd falsifications and applications of the vague concepts ‘Germanic’, ‘Semitic’, ‘Aryan’, ‘Christian’, ‘German’ -- all this could end up seriously infuriating me and bringing me out of the ironic benevolence with which I have so far watched the virtuous velleities and phariseisms of the contemporary Germans. -- And finally, what do you think I experience when the name Zarathustra is uttered by anti-Semites? (KSA 14.420f.)
On the other hand, Nietzsche’s linking the Jews with the lowly Chandâla-s, though borrowed from Jacolliot (and unknown to Manu), remains largely his own original contribution to modern anti-Jewish thought. Many things had been said against the Jews, but that one was quite new. It is simply counter-intuitive. If at all Jews, with their distinctive dress and hairdo and cumbersome ritual observances, had to be linked with any Hindu castes, then the purity-conscious and ritual-centred Brahmins (apart from the money-savvy Vaishyas) would seem a more logical choice.
Chandâla-s are the people who do deeply unclean work involving intimate contact with decomposing substances. While notions of clean and unclean exist in many cultures, the specific institution of untouchability is peculiar and is foreign to most societies, probably including the ancient Vedic society of North India. Its origin arguably lay in the Dravidian-speaking society of South India, where the lowest caste is called the Paraiya-s, famously anglicised as Pariah. According to Hart (1983 117):
Before the coming of the Aryans […] the Tamils believed that any taking of life was dangerous, as it released the spirits of the things that were killed. Likewise, all who dealt with the dead or with dead substances from the body were considered to be charged with the power of death and were thought to be dangerous. Thus, long before the coming of the Aryans with their notion of varna, the Tamils had groups that were considered low and dangerous and with whom contact was closely regulated.
The Jews, far from seeing themselves as similarly unclean, had their own set of cleanliness rules protecting their religious personnel from polluting contacts. Thus, the hereditary priestly clan, the Kohanim, have to stay away from funerals to protect their religious charisma from the uncleanness of death. Nor are they allowed to marry converts to Judaism, let alone non-Jews. There is nothing Chandâla-like about this pattern, which closely resembles the Brahmanical attitude. Conversely, orthodox Judaism practises a certain discrimination, though nothing quite as deep and permanent as with the Indian untouchables, against people doing unclean work.
Thus, it has been argued that Saint Paul, who made his living as a tent-maker working for the Roman army and frequently using animal skins, became so eager to renounce Jewish law precisely because by occupation he was unclean under that law (Wilson 1999 43). Even today, missionaries recruiting converts among the Dalit-s (‘broken’, oppressed, the current self-designation of militant ex-untouchables) and trying to make the Gospel relevant to their situation, typically tell them that the shepherds tending the cattle that was to be sent for sacrifice to the temple in Jerusalem, the ones who came to praise Christ in His cradle, were themselves barred from entering the temple. This way, they establish a parallel between Christianity’s superseding Moses’ law with the Indian convert’s emancipation from Manu’s law.
3.6. The politics Nietzsche doesn’t discuss
Nietzsche discourses in general terms about a system of law but doesn’t pay the least attention to the actual laws (or proposals of law, or law-recipes) enumerated in the Manu Smrti or implemented by rulers who took inspiration from this classic. Worse, he pays no attention to the institutions that make caste society possible, e.g. the authority vested in caste pañchâyat or intra-caste council governing caste matters and internal disputes; or in the village pañchâyat, the inter-caste council in which each caste, even the lowest, had a veto right. A consensus had to be reached between the castes, which meant in practice that the harshest discriminations were somewhat mitigated. (Likewise, the ruling council of ancient India’s ‘republics’, composed exclusively of Kshatriyas, had to decide by consensus.)
Conversely, Nietzsche was apparently also unaware of the attempts to reform or abolish the caste system by the Ârya Samâj and other contemporaneous movements. In his own day, the institution of caste was under attack, both from low-caste rebels and from high-caste nationalists who sought to unite their nation across caste divisions. This led to a whole pamphlet literature by reformers and also by defenders of the old system, to court cases and legislative initiatives in British India. In short, for a student of the pros and cons of caste, there were plenty of revealing polemics with freshly mustered data for the taking. And there was an implicit appeal to take sides in that social struggle.
In spite of this, Nietzsche never discussed the actual politics of the caste system. In the ongoing debate on whether he was a political or a non-political thinker, his treatment of Manu weighs in on the side of the second position. His fondness for Manu was a purely theoretical position, less concerned with India’s quaint social divisions as with the underlying spirit of elitism and of accepting the inequality that nature has imposed on mankind.
3.7. The Übermensch connection
With his merely incipient knowledge of Hindu tradition, Nietzsche missed a number of links between his own philosophy and Hindu tradition. His friend Paul Deussen saw a resemblance between the notion of ‘eternal return’ and the Hindu cyclical view of the universe. He rejected Nietzsche’s ‘eternal return’, though, on grounds that are not specifically Hindu. Whereas Nietzsche deduced the inevitability of eternal return from the finiteness of the number of possible combinations of all particles in the universe, Deussen in his Erinnerungen an Friedrich Nietzsche (1901) argues against this that, on the contrary, ‘the game of evolution of the world will have infinite variations’ (quoted in Smith 2005 147).
Likewise, others have seen the potential conceptual kinship between Nietzsche’s notion of the Übermensch and the ‘awakened’ yogi:
Both understand human being as an ever-changing flux of multiple psychophysical forces, and within this flux there is no autonomous or unchanging subject (“ego”, “soul”). Both emphasise the hierarchy that exists or can exist not only among individuals but among the plurality of forces that compose us. For Nietzsche the pinnacle of that hierarchy is the Übermensch, a goal not yet achieved although a potential at least for some; for Buddhism that potential was attained by Shakyamuni Buddha, and at least to some degree by many after him, for it is a potential all human beings are able to realise. (Loy 1998 129)
In Hindu tradition, the sannyâsin or ascetic stands outside the caste order. In spite of all his regulations for a caste-based society, Manu provided for a position outside the caste order. Upon being initiated, the sannyâsin performs his own funeral rites, gives up his name and caste and family ties, and becomes free. That is the job of the Hindu ascetic: to be free. The only ‘work’ he is expected to do, is to subdue in himself all his weaknesses and attachments. The royal road to achieve this is yoga, i.e. quieting the mind, disciplining the monkeys of our thoughts.
The common denominator with Nietzsche’s ideal is self-overcoming, in combination with a spurning of the comforts and certainties of ordinary life. Nietzsche did not explore or develop this connection: ‘To use [the concepts of Übermensch and eternal return - KE] the way he did shows Nietzsche to have been oblivious of the obvious Indian parallels’ (Smith 2005 147). It could have saved him a lot of misinterpretation by admirers who conceived of the Übermensch in eugenic terms.
3.8. Missed opportunities regarding God
Deconstructing God and rethinking the universe as godless were among Nietzsche’s central projects. From Voltaire onwards, many European freethinkers had used India in their personal freedom-struggle as a reference for counterbalancing Christianity. In that light, it is surprising how Nietzsche failed to exploit data from the history of Hindu philosophy in his anti-Christian crusade.
In the period of the late-Vedic handbooks of ritual, the Brâhmana-s, i.e. the apogee of Brahmanical ritualism, the idea dawned on the ritualists that the gods they invoked weren’t really heavenly persons who were listening at the other end of the line and then responded to the human imprecations by granting the hoped-for boon, but mere name-tags for the unseen phases of the magical mechanism which led from the performance of the ritual to the materialization of the requested boon (Clooney 1997). This idea was theorized further by the Mîmânsâ school of philosophy. Likewise, the subsequent shift from ritualism to asceticism (tapas, ‘heat’) proclaimed man’s supreme power to subject the gods to his own will.
The point is illustrated in the life-story of many ascetics including the Buddha, where Indra and Brahma and the other gods come and congratulate him for achieving his awakening (bodhi). In many stories, the gods are afraid of the increasing power of the ascetic and send seductresses to make him abandon his practice. Tapas or asceticism is a Promethean exercise, in which man steals the gods’ thunder. The ascetic schools in the pre-Christian centuries were mostly inclined towards atheism. In the philosophical schools of Sâmkhyâ and early Vaisheshika, and in the non-Vedic school of Jainism, the gods disappear from sight. The Manu-Smrti obliquely testifies to this climate of theism’s lowest ebb. That gods are worshipped is a fact which Manu acknowledges as part of the human landscape, but he hardly concedes any agency to them. The envisioned rewards and punishments for good or evil conduct are not conceived as handed out by a heavenly person, but rather as mechanical (karmic) results of one’s own actions.
Though Nietzsche never published any reflections on this genesis of a kind of atheism within the late-Vedic tradition, his Nachlass indicates he was summarily aware of it:
‘With God, nothing is impossible’, the Christian thinks. But the Indian says: ‘With piety [for] and knowledge of the Veda, nothing is impossible: the gods are submissive and obedient to them. Where is the god who can resist the pious earnestness and prayer of a renouncing ascetic in the forest?’ (14[198] 13.382)
Or, more forcefully: ‘The Brahmin is an object of worship for the gods’ (14[178] 13.363). Like modern man, the sages of India believed in themselves rather than in God.
However, in dealing with ancient Hindu atheism, Nietzsche would also have had to face the subsequent resurgence of theism. Not just in popular religion did theistic devotion (Bhakti) gain an all-India upper hand in the course of the first millennium CE, it also conquered philosophical systems which had started out as atheistic. Consider the increasing impact of a doctrine of a supreme God in the successively emerging schools of Sâmkhyâ (‘enumeration’ of the universe’s components), Vaisheshika (‘distinction-making’, atomism) and Nyâya (‘judgment’, logic):
It hardly had any access into the classical Sâmkhyâ system which at that time was already paralysing and declining. And the branch of the school which accepted the notion of a supreme God, did not attain any great importance. […] In [Vaisheshika - KE] we see clearly how the doctrine of a supreme God gradually forced its way and became established. […] The matter is again quite different with the youngest of these systems, the Nyâyah. In it the concept of God appears in the sûtras themselves and quickly gains importance. (Frauwallner 1955.35-36)
Likewise, in Patañjali’s Yoga Sûtra, the non-theistic core text which describes yoga practice as a purely human endeavour, is overlaid with theistic additions to the extent that modern teachers of Hindu philosophy classify Yoga as a theistic system. Even Buddhism often ended up replacing its original emphasis on individual effort with devotional surrender to a quasi-deity like the Amitabha Buddha (‘of the infinite light’). The monistic Vedânta philosophy initially rejected the distinction between sentient beings down here and a supreme being up there, but in the Middle Ages, it developed theistic variants which are now completely dominant in numerical terms.
Modern Hindus who want to flaunt the liberal virtues of their religion, like to say that ‘a Hindu can even be an atheist’. That may be true in theory, but today, a Hindu is typically a devotional theist. So, in the polemic over the death of God, religious people could take heart from the Hindu precedent of God’s resurrection.
Conclusion
At first sight, the importance of Nietzsche’s discovery of the Manu-Smrti is quite limited, viz. as a collateral illustration of pre-Christian civilization glorified by him, principally represented by Greece but now also found to have flowered in the outlying Indian branch of the Indo-European world. Crucial pieces of Manu’s worldview, such as the centrality of a priestly class (Nietzsche’s sympathy being more with the martial aristocracy) and the notion of ritual purity, seem irrelevant to Nietzsche’s ultimately very modern philosophical anthropology. They are sometimes mentioned disparagingly, while other Hindu ideas are not given due attention, e.g. dharma as caste-specific duty. In particular, the transparently priestly character of Manu’s code, with its dangling of supernatural rewards (c.q. punishments) after death in order to keep people in line, is dismissed as but a variation on similar ‘tricks’ in the much-maligned Judeo-Christian tradition. Yet, a few specifically Indian notions did have a wider impact on Nietzsche’s worldview.
Principally, the notion of Chandâla became a cornerstone in Nietzsche’s view of mankind, representing the most lowly and contemptible type of man, who broods on revenge against superior types. In a far-fetched departure from Manu’s use of the term, he relates the concept of Chandâla to the psycho-sociological origin of the Jewish national character and thence to the psychology of resentment allegedly underlying Christianity. Secondly, Manu’s strict opposition to caste-mixing tallied with Nietzsche’s aristocratism, which values people’s genealogy and encourages the differentiation of mankind into specialized classes. In the spirit of the times, however, it was also susceptible to co-optation into the then-emerging racialist reading of human reality as well as of Nietzsche’s own work. But the philosopher never committed himself to any Manu-inspired politics.
Finally, Manu’s respect for asceticism as a positive force in society (though best left to a class of specialists, not a norm for all), seemingly so in conflict with Nietzsche’s contempt for ‘otherworldliness’, resonates with subtler pro-ascetic elements in Nietzsche’s philosophy, especially in his conception of the Übermensch. But this, along with the budding atheism in ancient Hinduism, was to remain one of the potential Hindu sources of inspiration that Nietzsche left unexplored.
Bibliography
Altekar, A.S., 1959, The Position of Women in Hindu Civilisation, 2nd ed., Delhi: Motilal Banarsidass (reprint 1995).
Ambedkar, ‘Babasaheb’ Bhimrao Ramji, 1916, ‘Castes in India. Their Mechanism, Genesis and Development’, in: Writings and Speeches, Bombay: Government of Maharashtra, 1989, pp.3-22.
Berkowitz, Roger, 2003, ‘Friedrich Nietzsche, the Code of Manu, and the Art of Legislation’, in: Cardozo Law Review, 24:3, pp.1131-1149.
Berkowitz, Roger, 2006, ‘Friedrich Nietzsche, the Code of Manu, and the Art of Legislation’, in: New Nietzsche Studies, 6:3/4 & 7:1/2, pp.155-169.
Bonfiglio, Thomas Paul, 2006, ‘Toward a Genealogy of Aryan Morality: Nietzsche and
Jacolliot’, in: New Nietzsche Studies, 6:3/4 & 7:1/2, pp.170-186.
Clooney, Francis, 1997, ‘What’s a god? The quest for the right understanding of devatâ in Brâhmanical ritual theory’, in: International Journal for Hindu Studies, Aug. 1997, pp.337-385.
Daniélou, Alain, 1975, Les Quatre Sens de la Vie. Structure Sociale de l’Inde Traditionnelle, Paris: Buchet-Chastel (reprint 1984).
Doniger, Wendy, 1991, The Laws of Manu, London: Penguin.
Elst, Koenraad, 2007, Asterisk in Bhâropîyasthân. Minor Writings on the Aryan Invasion Debate, Delhi: Voice of India.
Etter, Annemarie, 1987, ‘Nietzsche und das Gesetzbuch des Manu’, in: Nietzsche-Studien, 16, Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Frauwallner, Erich, 1955, ‘The original beginning of the Vaisheshika Sûtras’, in: Posthumous Essays, Delhi: Aditya Prakashan 1994, pp.35-41.
Ghurye, Govind Sadashiv, 1932, Caste and Race in India, Bombay: Popular Prakashan (reprint 1986).
Ghurye, Govind Sadashiv, 1959 (2nd ed.), The Scheduled Tribes, Bombay: Popular Prakashan (reprint 1995; first published as The Adivasis – So-Called, and Their Future, 1943).
Gopal, Ram, 1959, India of Vedic Kalpasûtras, Delhi: Motilal Banarsidass (reprint 1983).
Hart, George L., III, 1980, ‘The Theory of Reincarnation among the Tamils’, in Wendy Doniger (ed.), 1983, Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Indian reprint Delhi: Motilal Banarsidass.
Hegel, G.W.F., 1826, Ueber die unter dem Namen Bhagavad-Gita bekannte Episode des Mahabharata von Wilhelm von Humboldt, Berlin (tr. Herbert Herring, On the Episode of the Mahâbhârata known by the Name of Bhagavad-Gîtâ by Wilhelm von Humboldt, Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1925).
Jacobi, Hermann, 1894, ‘On the date of the Rgveda’, reproduced in K.C. Verma et al., eds., 1986, Rtambhara: Studies in Indology, Ghaziabad: Society for Indic Studies, pp.91-99.
Kane, Pandurang Vaman, 1930, History of Dharma Shâstra, vol.1, Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute (reprint, 1990).
Köbler, Gerhard, 2000, Indogermanisches Wörterbuch, 3rd ed., Innsbruck: Internationale Germanistische Etymologische Lexikothek (online).
Loy, David R., 1998, review of Robert G. Morison, Nietzsche and Buddhism (OUP 1997), in: Asian Philosophy, 8/2, pp.129-131.
Majumdar, Ramesh Chandra, 1960, The Classical Accounts of India, Calcutta: Firma KLM reprint 1981.
Monville, Aymeric, 2007, Misère du nietzschéisme de gauche: de Georges Bataille à Michel Onfray, Brussels: Éd. Aden.
Rajshekar, Vontibettu Thimmappa, 1983, Why Godse Killed Gandhi, Dalit Sahitya Akademy, Bangalore.
Ridley, Aaron / Norman, Judith, (eds.), 2005, Nietzsche, Friedrich: The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, and Other Writings; Cambridge University Press.
Schank, Gerd, 2000, ‘Rasse’ und ‘Züchtung’ bei Nietzsche, Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Sharma, R.N. (ed.), 1998, Manusmrti, Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratishthan.
Singh, Kumar Suresh, 1999, The Scheduled Castes, 2nd ed., Delhi: OUP.
Smith, David, 2006, ‘Nietzsche’s Hinduism, Nietzsche’s India’, in: New Nietzsche Studies, 6:3/4 & 7:1/2, pp.131-154.
Wilson, Andrew Norman, 1997, Paul: the Mind of the Apostle, New York: W.W. Norton (Dutch tr.: Paulus, de Geest van de Apostel, Amsterdam: Prometheus, 1999).
Winternitz, Moriz, 1907, Geschichte der indischen Literatur (English tr. 1920, Motilal Banarsidass; reprint, Delhi 1987).
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nietzsche, hindouisme, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 janvier 2010
La décense commune contre l'égoïsme libéral
| La décence commune contre l'égoïsme libéral |
| « Un noir pessimisme imprègne la conception libérale de la nature humaine. L’homme est un loup pour l’homme. L’égoïsme constitue le fond de son caractère. A la suite des sanglantes guerres de religion, les penseurs qui furent plus tard rangés sous la bannière libérale en sont sûrs : tout homme est une canaille irrécupérable. […] La vision pessimiste de la nature humaine est-elle absolument correcte ? Nous voudrions montrer que, comme le dit Chamfort, la vérité est au milieu, un peu au-dessus de ces deux erreurs symétriques que sont l’optimisme et le pessimisme.
Pour s’en tenir au domaine politique, on se fiera à George Orwell. Socialiste monarchiste, anarchiste conservateur, il a insisté sur la notion de common decency que les traducteurs nomment en français décence ou honnêteté communes. La décence commune résume un certain nombre de règles que presque tout le monde (à part les enfants-rois et les intellectuels post-modernes) connaît et pratique : on ne dénonce personne, on ne triche pas, on ne frappe pas un homme à terre, on ne s’attaque pas à un plus faible que soi, surtout pas en bande, on est galant avec les dames, on respecte les vieillards, on est spontanément bienveillant, on aide ses proches, etc. Dans une société où règne la décence commune, le don est premier. Chaque enfant reçoit de ses parents la vie et le langage. L’anthropologie montre que la triple obligation de “donner, recevoir, rendre” fonde l’ordre interne de maintes communautés. Les milieux “avancés” semblent vouloir échapper au cycle du don et lui substituer la devise du Figaro de Beaumarchais, valet malin, désireux de grimper dans le monde et de devenir maître : “demander, recevoir, prendre”. C’est la mentalité d’aujourd’hui, minoritaire mais insidieuse, qui unit dans la même attitude le prédateur et la victime. Dans les sociétés bien réglées, “ça ne se fait pas de demander”. Dans un régime de prédateur-victime, je demande parce que j’ai droit à tout, je reçois ce qui m’est dû, je le prends en chassant de mon esprit toute idée de dette, puis je recommence jusqu’à plus soif. Par aveuglement idéologique, certains veulent conformer la nature humaine à un modèle libéral, efficace seulement à courte échéance, l’encourager à l’égoïsme, à la compétition pour la compétition, à faire carrière plutôt qu’à exercer un métier, le soumettre à une concurrence illimitée et à une consommation obligatoire, jusqu’à créer ce que les psychologues appellent des addictions. C’est rendre le monde invivable. »
Jacques Perrin, “Le bien, banal et fragile”, La Nation, 15 janvier 2010 |
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, libéralisme, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 janvier 2010
Sobre el disenso como método
Sobre el disenso como método
Alberto Buela (*)
 Los filósofos como los científicos más que probar teorías, disponen de teorías para explicitar lo implícito en el caso de la filosofía y para ampliar los alcances de la ciencia en el caso de los científicos.
Los filósofos como los científicos más que probar teorías, disponen de teorías para explicitar lo implícito en el caso de la filosofía y para ampliar los alcances de la ciencia en el caso de los científicos.
Esta verdad que resulta una verdad a plomo, que cae por su propio peso, que es evidente por sí misma ha sido y es de difícil aceptación pues, en general, se dice que se tienen teorías o se quiere probar una teoría. Lo cual no es correcto.
El hecho de darse cuenta, que uno puede disponer de una teoría facilita el trabajo de investigación pues la teoría se transforma allí en un medio de acceso a la verdad y no un fin en sí misma como erróneamente es tomada.
La realidad, los entes para hablar filosóficamente, son la consecuencia del proceso de investigación y las prácticas científicas que vienen a convalidar la teoría. Así, si esa teoría es verdadera confirma esa realidad, esos entes.
La atribución de verdad, de realidad, de coherencia, de consistencia, de adecuación es lo que permite avanzar en el camino del conocimiento. En una palabra, no se avanza justificando teorías sino que se avanza disponiendo de teorías que las prácticas científicas en el caso de la ciencia o las prácticas fenomenológicas en el caso de la filosofía pueden atribuir verdad .
La ciencia, y la filosofía lo es, puede ser pensada en este sentido como un conjunto de representaciones que se manifiestan como teorías (Aristóteles), paradigmas (Kuhn), programas (Lakatos), modelos (Popper), tradiciones (MaIntayre) que se confirman en las prácticas y no meramente en la representación.
Nosotros, en nuestro caso, hemos dispuesto de una teoría: La teoría del disenso a partir de la cual intentamos explicar al hombre, el mundo y sus problemas desde una mirada no conformista y alejada del pensamiento único, típico de nuestra época.
El disenso entendido como otro sentido al dado y establecido nos ha permitido crear teoría verdaderamente crítica y no “nominalmente crítica” como ha sucedido en definitiva con la Escuela neomarxista de Frankfurt.
Recuerdo a Conrado Eggers Lan lo enojado que estaba cuando en Estados Unidos lo recibió Marcuse del otro lado de un soberbio escritorio judicial, cómodamente apoltronado y criticando al capitalismo, siendo que era un satisfecho del sistema capitalista como pocos.
La producción de teoría crítica desde el disenso exige un compromiso no solo político sino existencial. Es que el otro para la teoría del disenso no es el del ómnibus, colectivo o subte es aquel que me opugna y disiente y al que “localizo” existencialmente. En este sentido el
disenso rompe el simulacro de la mentalidad ilustrada de “hacer como si tengo en cuenta al otro” por una exigencia civilizada cuando en realidad lo que busco es distanciarme sin que se de cuenta. La filantropía, como alejada ocupación del otro (por ej. con un cheque un filántropo salva su conciencia, aun cuando ese dinero termine en los bolsillos de un sátrapa en compra de armas para matar a quienes se dice ayudar) reemplazó en la modernidad a la caridad que es la ocupación gratuita del otro, pero entendido como singular y concreto. Por ello se habla en el catolicismo de “las caridades concretas” y nuestros viejos padres criollos nos exigían incluso “tocar físicamente” aquel a quien se auxilia.
Es sabido que todo método es un camino para llegar a alguna parte, en este sentido el disenso como método no se agota en el fenómeno como la fenomenología sino que además privilegia la preferencia de nosotros mismos. Parte del acto valorativo como un mentís profundo a la neutralidad metodológica, que es la primera gran falsedad del objetivismo científico, sea el propuesto por el materialismo dialéctico sea el del cientificismo tecnocrático. Rompe con el progresismo del marxismo para quien toda negación lleva en sí una superación progresiva y constante. Por el contrario, el disenso no es omnisciente, pues puede decir “no sé” y así se transforma en un método también del saber popular, que se caracteriza por no negar la existencia de algo que es o existe sino que cuando niega, sólo niega la vigencia de ese algo.
En cuanto a la preferencia de uno mismo siempre se realiza a partir de una situación dada, un locus histórico, político, económico, social y cultural determinado. En nuestro caso el dado por la ecúmene iberoamericana. Esto obliga a pensar el disenso como un pensamiento situado que tiene como petición de principio el hic Rhodus, hic saltus (aquí está Rodas, aquí hay que bailar) de Hegel al comienzo nomás de su Filosofía del Derecho.
Esto nos ha permitido establecer un pensamiento de ruptura con la opinión pública, que hoy no es otra que la opinión publicada.
Este pensamiento de ruptura, o mejor, pensamientos de rupturas, nos ha permitido dar respuestas breves a esa multiplicidad de imágenes truncas que nos brinda la postmodernidad respecto de la vida hoy. A esos analfabetos culturales locuaces (Fayerabend) que son los periodistas y locutores que hablan de todo sin decir que nada es verdadero o falso o, peor aun, cuando lo hacen siempre se encuentran del lado de la falsedad. Ello es así, porque son simples voceros del pensamiento único y políticamente correcto. De esta forma de ver y pensar las cosas y los problemas que nace desde los grandes gestores culturales (los famosos en cada disciplina) que no buscan otra cosa que la consolidación del estado de cosas tal como está. Es que la realidad tal como se da en todos los órdenes es la que les permitió ser lo que son, y la metafísica enseña que todo ente busca perseverar en su ser.
La ruptura por parte del disidente, en general rebelde y marginado, de este círculo hermenéutico (de interpretación de lo que es) se ha transformado así en una masa compacta e impenetrable pues si se atacan las teorías de los famosos (en filosofía el humanismo, en ciencia el objetivismo, en arte el subjetivismo caprichoso y arbitrario, en religión el ecumenismo de todos por igual, en política el progresismo democrático) sale uno del mundo, queda marginado, alienado, cuando no demonizado.
Sin embargo, la única posibilidad que se vislumbra es la creación de teoría crítica a partir del disenso como método que es quien rompe el consenso de los satisfechos del sistema tanto en las sociedades opulentas como en las otras.
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, argentine, amérique latine, amérique du sud, dissidence, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 janvier 2010
Kapital als Aberglaube
Kapital als Aberglaube
 Das Kapital ist ein Glaube, und das Schlimme an diesem Glauben ist, dass es ein unethischer Glaube ist, - dass es ein Glaube ist, der nur regiert wird von einem einzigen Instinkt des Menschen, von seinem unmittelbaren, atavistischen, vom Egoismus, und dass dieser Egoismus nur gehemmt wird durch die Furcht vor dem Egoismus der anderen. Wie ein wildes Tier arbeitet eine Firma gegen die andere, rücksichtslos bedrängt der Fiskus den Bürger, und verschlagen und rücksichtslos versucht der Bürger, der Steuer zu entgehen. Wunderschöne Namen sind dafür erfunden worden. Eine ganze Wissenschaft hat sich aufgebaut aus dem Wunsch des Bürgers, dem Staat nur so wenig Steuern bezahlen zu müssen, als es irgendwie geht, und grosse Büros mit vornehm klingenden Namen leben von diesem Wunsch. Ein Spiel um Worte, denn dass der Staat Geld braucht, das ist ja klar, und dass er eigentlich gerecht besteuern müsste, müssten wir nach allem, was wir in der Schule von Ethik gelernt haben, wohl voraussetzen. Die Praxis beweist das Gegenteil. Der Staat wird als Feind betrachtet, und der Staat betrachtet seinen Bürger, der ihm Steuern zahlt, zunächst als Betrüger.
Das Kapital ist ein Glaube, und das Schlimme an diesem Glauben ist, dass es ein unethischer Glaube ist, - dass es ein Glaube ist, der nur regiert wird von einem einzigen Instinkt des Menschen, von seinem unmittelbaren, atavistischen, vom Egoismus, und dass dieser Egoismus nur gehemmt wird durch die Furcht vor dem Egoismus der anderen. Wie ein wildes Tier arbeitet eine Firma gegen die andere, rücksichtslos bedrängt der Fiskus den Bürger, und verschlagen und rücksichtslos versucht der Bürger, der Steuer zu entgehen. Wunderschöne Namen sind dafür erfunden worden. Eine ganze Wissenschaft hat sich aufgebaut aus dem Wunsch des Bürgers, dem Staat nur so wenig Steuern bezahlen zu müssen, als es irgendwie geht, und grosse Büros mit vornehm klingenden Namen leben von diesem Wunsch. Ein Spiel um Worte, denn dass der Staat Geld braucht, das ist ja klar, und dass er eigentlich gerecht besteuern müsste, müssten wir nach allem, was wir in der Schule von Ethik gelernt haben, wohl voraussetzen. Die Praxis beweist das Gegenteil. Der Staat wird als Feind betrachtet, und der Staat betrachtet seinen Bürger, der ihm Steuern zahlt, zunächst als Betrüger.Der Kapitalismus ist ein unmoralischer Glaube, besser gesagt, er ist ein amoralischer. Aber der erste Schritt ist bereits getan, wenn man weiss, dass der Kapitalismus eigentlich ein Aberglaube ist, ein Aberglaube, wie die Astrologie, die ja auch amoralisch ist und sich jetzt mit einem Mäntelchen der Moral umkleidet.
Der Kapitalismus ähnelt überhaupt sehr stark der Astrologie. Denn ebenso blind, wie diese Pseudowissenschaft, begünstigt und vernichtet er die Individualität des einzelnen.
Wolfgang Forell, Kapital als Aberglaube. Betrachtung über einige aktuelle Fragen in der heutigen Zeit. In: Gegner, Heft 3, 15. August 1931, S. 15-17.
00:17 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie, théorie politique, politologie, économie, sciences politiques, politique, capitalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Anarchici "di destra"
Anarchici “di destra”
Anarchico era Papini, quando si firmava Gianfalco e nei primi anni del Novecento progettava una filosofia della trasgressione violenta: «Noi dobbiamo ricercare, esaltare e realizzare la vita piena, completa, ricca, esuberante, traboccante, tropicale, ascendente e dobbiamo perciò perseguitare, esiliare, sopprimere tutto quello che tende a impoverire, ad abbassare, a limitare, a imprigionare la vita». Lo scrisse nel 1905, con circa un trentennio di vantaggio sull’Arbeiter di Jünger, gettando le prime basi di quella saldatura tra individualismo “faustiano” e comunitarismo gerarchico che si chiamò poi fascismo. Il Papini giovane si definì anarchico a chiare lettere, ma di un anarchismo anti-nichilista, neopagano feroce, futurista, superomista, nietzscheano. E anarchico era Lorenzo Viani, il pittore viareggino che scriveva anche racconti sulla povera gente rivierasca, marinai taciturni, a contatto con la morte. Progettò Viani una “repubblica sociale” alla maniera anarchica insieme con Riccardo Roccatagliata Ceccardi, bizzarrissima figura di sregolato genialoide: doveva essere la “Repubblica Apuana”. Viani, amico del vecchio libertario Errico Malatesta, fu poi squadrista e negli anni trenta collaborò al Popolo d’Italia, ma da povero, da schivo e riservato. Come Marcello Gallian, altro anarchico alternativo, anti-borghese viscerale, uno che non smise di crederci per tutta la vita, che come tanti della “sinistra” vide nel fascismo della prima ora e in Mussolini capo dinamico la risposta rivoluzionaria, innovatrice, sbrigliata, ai conformismi di “destra” e di “sinistra”. Gallian rimase fedele al suo ideale anche di fronte a tante sfasature del regime. E, come pochi altri, ingenui e nobili, finì povero, anzi poverissimo. E anarchico era Berto Ricci, grande ammiratore di Stirner, instancabile stimolatore di idee, vero uomo libero che mise la sua intelligenza al servizio di una volontà di rinnovamento direi antropologico del tipo d’uomo all’italiana. E lo stesso Mussolini, negli anni precedenti la prima guerra mondiale, fece i conti con Stirner, la cui figura dell’Unico dominatore voleva fondere con il solidarismo comunitario. Al contrario di Evola che, da posizioni individualiste, tratteggiò un algido Autarca fatto di echi stirneriani, ma lontano da ogni risvolto popolare.
Tutto questo fu “anarchismo di destra”, perché, a differenza dell’altro, non era egualitario, ma anzi convintamene differenzialista. Credeva nella forza del genio, nella potenza dell’individuo d’eccezione, il fuorilegge ribaltatore degli strati sociali, il titano che con la sua volontà rovescia i mondi filosofici ma, all’occorrenza, sa fare e disfare la storia. Anarchismo con venature alla Plechanov, molto Nietzsche, poca utopia libertaria, più concretezza, più realismo, tanto sangue ribellistico, buone dosi di Stirner, ma dello Stirner profondo, quello che riservò un paragrafo del suo libro sull’Unico alla “gerarchia” e alla celebrazione, quasi razziale, della superiorità della stirpe caucasica: la migliore, quella che rifarà il mondo.
A destra troviamo dunque questo anarchismo, diciamo così, culturale, sul quale si arrovellarono in parecchi. Anarchismo di istinti, di carne. Poi ce ne fu uno più propriamente politico, ideologico, militante. Al capolinea dell’interventismo, nel 1914, intrecciarono i loro destini la rivolta sociale e il mito della liberazione nazionale. Ci furono avanguardie che incontrarono altre avanguardie. L’anarco-interventismo si trovò a fianco del sindacalismo rivoluzionario, e i Corridoni e i Mussolini a loro volta si unirono ai d’Annunzio, ai Locchi, ai Corradini, agli Slataper, i poeti della patria libera. Quando poi, nel dopoguerra, si videro bande nere ribelli, quando si sentì parlare di repubblica, di liberazione dalle vecchie ipoteche conservatrici e clericali, si lessero programmi, come quello sansepolcrista, che parlavano di consigli del lavoro, di espropriazione delle ricchezze, di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa etc., la saldatura si fece da sola. Gli anarchici di “destra”, anti-utopisti, politici realisti, come erano divenuti interventisti capendo la portata rinnovatrice della guerra, così si fusero col fascismo, intuendone la portata destabilizzatrice della decrepita Italia monarchico-liberal-giolittiana. Il filone anarchico che confluì nel fascismo, sposandone in pieno il progetto politico, non fu poca cosa. E fu anche evento naturale, che combaciò con posizioni ribellistiche come l’arditismo e lo squadrismo.Ci furono adesioni singole di base. Ma ci furono anche uomini che, provenendo direttamente dall’anarchismo, ne continuarono l’attitudine anti-sistema dai vertici del fascismo-movimento e anche da quelli del fascismo-regime. Da Leandro Arpinati, poi gerarca potente e infine emarginato, a Massimo Rocca, elemento influente nei primi anni venti, a Mario Gioda, primo segretario del Fascio torinese e grande avversario del monarchico De Vecchi, che immancabilmente finirà col surclassarlo. Fino a Edoardo Malusardi, punta di diamante del primo fascismo veronese, una realtà nata molto inclinata a “sinistra”. Malusardi, sindacalista-integralista, corridoniano, operaista, rimase nelle seconde file del fascismo, fedele ai suoi ideali di “lotta contro la proprietà e il capitale improduttivo e contro la burocrazia parassitaria”.
Bisogna dire che proprio in questo anarco-fascismo militante si celava a volte una contraddizione singolare, che è poi quella stessa che rende le ideologie non di rado pieghevoli e sinuose, fino a produrre connubi impensabili. Nato individualista, l’anarchismo reca in sé un’anima “liberale”. Stirner, non a caso, si formò su Hobbes. Arpinati, amico di Torquato Nanni, chiuse la carriera da perfetto liberale. Rocca, al tempo della sua idea élitaria sui “gruppi di competenza”, aveva in mente un’idea di gerarchia tecnocratica che potrebbe essere benissimo definita liberale. L’anarco-libertaria Maria Rygier, divenuta fascista e poi andata in esilio, finì nel dopoguerra con l’iscriversi al PLI. Cosa succedeva? L’accento sull’individuo, se esce dalla filosofia “faustiana” ed entra in società, può produrre guasti: anarco-capitalismo è il nome di un recente rampollo nato da incroci ideologici, per i quali non si è ancora trovata alcuna profilassi.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anarchisme de droite, philosophie, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 janvier 2010
Erik M. Ritter von Kuehnelt-Leddihn: Garantiert unmodern
Garantiert unmodern
Ex: http://www.deutsche-stimme.de/
Immer noch lesenswert: Randnotizen zum 100. Geburtstag von Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn
 |
| Rechts, aber nicht unbedingt »konservativ«: Kuehnelt- Leddihn (1909 – 1999) |
Der am 31. Juli 1909 geborene Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn zählt zu den beinahe vergessenen Geistesgrößen des vergangenen Jahrhunderts – Grund genug, sich seiner zum 100. Geburtstag wieder zu erinnern.
Gebürtiger Steirer, studierte Kuehnelt-Leddihn, schon in jungen Jahren tiefkatholische Anhänger der Reichsidee altösterreichischer Prägung, in Wien und Budapest, unternahm 1930 im Alter von 21 Jahren seine erste Rußlandreise, über die er für eine konservative ungarische Zeitung berichtete, und lehrte von 1937 bis 1947 an verschiedenen Kollegs in den USA.
Zu dieser Zeit hatte er auch bereits seine ersten zeitkritischen Romane veröffentlicht, die stets den Glauben einbezogen. Kuehnelt-Leddihn betrachtete sich als Mann der äußersten Rechten und war ein Gegner der modernen, sich von der Französischen Revolution herleitenden kollektivistischen Ideologien; die Französische Revolution stellte für ihn überhaupt die Urkatastrophe der neueren Geschichte dar. In ihrem Gefolge griff sowohl die Demokratie mit ihren – für Kuehnelt weder theologisch, philosophisch noch anderweitig begründbaren – Prinzipien der Gleichheit aller Menschen und der Richtigkeit von Mehrheitsentsåcheidungen und ihrer Neigung zur Unterdrückung von völkischen und sozialen Minderheiten sowie Eliten Platz als auch der logisch an die Demokratie anknüpfende egalitäre Sozialismus und der ebenfalls auf der Demokratie gründende »identitäre«, d.h. gleichmacherische Nationalismus.
Den Nationalsozialismus betrachtete er als Synthese beider und verortete auch ihn auf der »linken« Seite des politischen Spektrums. Hier ist der bei Kuehnelt-Leddihn zuweilen besondere Gebrauch der Begriffe zu beachten: »Identitär« bedeutet ihm so viel wie »übereinstimmend«; einem solchen Prinzip stellte er das »diversitäre« gegenüber, d.h. ein die gewachsene Vielfalt achtendes. Den »Nationalismus« betrachtete er als »identitär«, der Gewachsenes in ein Prokustesbett zwängen möchte, wie es beispielsweise auch in der Französischen Revolution der Fall war.
Demokratische Sentimentalisierung
Die Ursache für die Katastrophen der Moderne sah der Ritter, der sich nach seiner Rückkehr Ende der vierziger Jahre in Tirol niederließ, im großen Abfall vom Christentum seit dem 18. Jahrhundert und im damit verbundenen Machbarkeitswahn eines sich selbst überschätzenden Menschentums. Er gab einem übervölkischen, traditionalen Reichsgedanken den Vorzug, einem nicht auf »Blut«, sondern »Boden« bezogenen Patriotismus sowie dem freiheitlichen Rechtsstaat und wandte sich gegen die demokratische Sentimentalisierung und Unsachlichkeit, die er in den Wahlkämpfen mit ihrem Stimmenfang und im parlamentarischen Betrieb ausmachte.
In seinem 1953 erschienenen Werk »Freiheit oder Gleichheit« vertrat Kuehnelt unter Bezug auf zahlreiche Denker des 19. Jahrhunderts die These, Freiheit und Gleichheit seien unvereinbar, und beschäftigte sich ausführlich mit den Grundideen von Monarchie und Demokratie und mit politischen Prinzipien. Er unterschied vier Phasen des Liberalismus, wobei er die dritte Phase – den relativistischen Altliberalismus – nicht als im wirklichen Sinne liberal betrachtete, während er für den entstehenden Neuliberalismus, für den u.a. Röpke und Müller-Armack standen, Sympathien hegte.
Als Alternative zur Liberaldemokratie, die an ihrem inneren Gegensatz scheitern und zu Chaos oder totalitärer Tyrannei führen müsse, wie mehrfach geschehen, plädierte Kuehnelt für ein unparteiisches, professionelles Beamtentum, einen unabhängigen Gerichtshof, dem auch Theologen angehören sollten, und eine monarchische Spitze samt Kronrat. Ständische und regionale Volksvertretungen sah sein grober Entwurf ebenfalls vor.
Aktuelle Warnung vor der Linken
Zeitlebens warb Kuehnelt, der 1957 mit alljährlichen ausgedehnten Weltreisen begann, für die Formulierung einer konservativen oder rechten Ideologie, die theistisch und transzendental ausgerichtet und »personalistisch« sein, Vernunft und Gefühl in Einklang bringen, Tradition und Erfahrung achten, die gewachsene Vielfalt des Menschengeschlechts wertschätzen und Staat und Kirche in ein geordnetes Verhältnis bringen solle.
Vorrangig war für ihn die Wahrung von Freiheit, Recht und Ordnung. Er war überzeugt, daß die Rechte ohne eine solche zusammenhängende Schau und nur mit reinem Pragmatismus der Linken – der östlichen wie der westlichen oder auch einer möglichen Neuauflage des Nationalsozialismus – und ihren profilierten Ideologien nicht entgegentreten könne, worin er sich beispielsweise mit Gerd-Klaus Kaltenbrunner einig sah.
Mit diesem Thema befaßte sich Kuehnelt u. a. in den Aufsätzen »Der Anti-Ideologismus« (Criticon 120, 1973), »Ideologie und Utopie« (in: »Rechts, wo das Herz schlägt«, Graz, 1980) und »Die Krise der Rechten« (in: »Die recht gestellten Weichen«, Wien, 1989). Seine Vorstellungen einer Rechtsideologie stellte er ausführlich im 1982 in den USA erschienenen »Portland-Manifest« dar.
Die Selbstverortung vieler Konservativer als in der Mitte stehend erschien Kuehnelt als mutlos, den Begriff »konservativ« lehnte er ab, da dieser nicht besage, was zu erhalten sei. 1985 erschien eine Generalabrechnung mit der Moderne, »Die falsch gestellten Weichen. Der rote Faden 1789-1984«, in welcher Kuehnelt-Leddihn die neue Geschichte seit der Französischen Revolution aus seiner Sicht kenntnisreich, zuweilen, wie es ihm oft beliebte, im guten Sinne polemisch, darstellte, »eine Anti-Festschrift, die es in sich hat«, wie sich Caspar von Schrenck-Notzing in seiner Besprechung in Criticon ausdrückte.
Trotz der Ereignisse der Jahre 1989-1991 besteht auch heute noch, wenngleich vielleicht in geschwächter Form, das von Kuehnelt festgestellte Ideologiemonopol der Linken. Die Vormachtstellung der Linken bedeutete für Kuehnelt die Herrschaft der Halbgebildeten über die Ungebildeten in Medien und Schulen, Die wahrhaft großen Geister hätten stets rechts gestanden, äußerte er in einem Criticon-Aufsatz 1991.
1995 warnte er unter dem Titel »Die Linke ist noch nicht am Ende« in »Theologisches« die Rechte vor der Unterschätzung der vermeintlich geschwächten Linken. Diese sei »ihre zwei größten Hypotheken losgeworden: den Köhlerglauben an den Staatskapitalismus (der richtige Name für den Sozialismus) und die friedensbedrohende UdSSR mit ihren Gulags und anderen Greueltaten.«
»Panoptikum für unmoderne Menschen«
Sie sei gegen Bindungen und wende sich nun neben der Kirche vor allem gegen die Familie, ihr Programm sei »nicht mehr die Götterdämmerung marxistisch-leninistischen Charakters [...] sondern die Verschweinung der Völker, die zum Schluß womöglich nur mehr aus Hurenböcken, Dirnen, Urningen, verwahrlosten Kindern, Drogensüchtigen und Aids-Kranken bestehen, eine wahrhaft ›marcusische‹ Vision!« An der Richtigkeit dieser Anmerkungen kann heute kaum noch ein Zweifel bestehen. Die nach 1990 aufkeimende Hoffnung, mit linker Utopie und daraus hervorgehenden, von Lüge begeleiteten Experimenten sei es vorbei, hat sich noch nicht erfüllt.
Seinen Lebensabend verbrachte Kuehnelt-Leddihn weiterhin studierend, schreibend und lehrend. Über Kindheit und Jugend sowie seine ausgedehnten Bildungs- und Vortragsreisen schrieb er sein letztes, erst posthum im Jahre 2000 erschienenes Buch »Weltweite Kirche«. Die Theologie hatte er immer als Kern seiner Beschäftigung betrachtet. Am 26. Mai 1999 starb Erik von Kuehnelt-Leddihn in Lans/Tirol.
Manfred Müller hatte schon 1981 in Nation & Europa in seiner Besprechung des bereits erwähnten Aufsatzbandes »Rechts, wo das Herz schlägt. Ein Panoptikum für garantiert unmoderne Menschen« geäußert, man treffe »heute selten auf einen so belesenen und weitgereisten Schriftsteller wie Kuehnelt-Leddihn«, und er biete »auch Nationalisten vielfältige Anregung zu fruchtbarer geistiger Auseinandersetzung.« Und der im Januar dieses Jahres verstorbene Freiherr von Schrenck-Notzing, welcher den Ritter gut gekannt hatte, bezeichnete ihn 2006 als »Fundgrube, die noch der Erschließung harrt.«
Über Erik von Kuhnelt-Leddihn erscheint voraussichtlich Ende des Jahres eine von Marco Reese, Marius Augustin und Martin Möller herausgegebene Monographie.
Marco Reese
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, conservatisme, idéologie, antimodernité, modernité, allemagne, autriche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 janvier 2010
In necessariis diversitas
In necessariis diversitas
 Vergelijkbare discussies vinden ook plaats wanneer het erom gaat de rol van de Europese Unie en die van de lidstaten te beoordelen.
Vergelijkbare discussies vinden ook plaats wanneer het erom gaat de rol van de Europese Unie en die van de lidstaten te beoordelen.Wat is de waarde van het argument en het tegenargument ?
Wel, op de eerste plaats zijn er zaken waarvoor noch het ene argument noch het andere erg relevant zijn. Als het gaat over bevoegdheidsverdeling, gaat het over zaken waarin verschillen beslecht moeten worden door een regel of een beleidsbeslissing. Zaken als vriendschappen horen daar gelukkig nog niet onder. Wanneer zaken aan de markt of de samenleving kunnen worden overgelaten, zou men dit ook kunnen betogen. Evenwel is de vraag of dat moet gebeuren natuurlijk al een politieke keuze, waarover men van mening kan verschillen. Kortom, het gaat natuurlijk over de vraag op welk niveau het best bepaalde politieke keuzes worden gemaakt. En over de vraag of het iets uitmaakt dat die meningsverschillen zich niet alleen voordoen tussen de meerderheid van de ene en de andere Gemeenschap of lidstaat, maar ook binnen die gemeenschap of lidstaat.
In wezen dezelfde vraag rijst in bijna elke discussie over zgn. mensenrechten (1).
Mensenrechten pretenderen universeel te zijn, maar over de invulling ervan zijn er zeer verschillende opvattingen; die invulling houdt dus ook een politieke keuze in, en opnieuw rijst de vraag of die keuze dan moet gemaakt worden op meer bepaald europees niveau (met daarbij ook de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) of moet worden overgelaten aan de lidstaten of hun deelstaten of kantons, of nog lokalere niveaus. Moet de betekenis van een kruisbeeld in de klas overal op dezelfde manier ingeschat worden en de regel dus overal dezelfde zijn ? Moeten het "recht op" huwelijk en echtscheiding of het "recht op" abortus of euthanasie overal in Europa hetzelfde zijn omdat het over mensenrechten zou gaan ? Moet de regel over het dragen van hoofddoekjes op school in heel Europa dezelfde zijn omdat het over mensenrechten zou gaan, is dat een zaak van elke staat of deelstaat, of zelfs van elke school apart ? Aanhangers van het democratisch centralisme zoals de Belgische grootinquisiteur vinden natuurlijk het eerste (2). In zulke materies in diversiteit blijkbaar opeens geen waarde meer.
Welnu, er zijn zeer goede redenen om precies in die zaken waarin er fundamenteel verschillende opvattingen bestaan, de beslissing aan het lagere niveau over te laten, zelfs wanneer men ook op dat niveau sterk verdeeld is. Dat laatste is met andere woorden geen goed argument. Hoe meer zo'n vragen gecentraliseerd worden, hoe scherper de tegenstellingen worden, hoe meer ideologische groepen tegen elkaar worden opgezet, hoe absolutistischer de kampen gaan denken.
Wat het voorbeeld abortus betreft, werd dit zeer scherpzinnig opgemerkt in een afwijkende opinie van de Amerikaanse opperrechter Scalia (in de zaak Planned Parenthood (3)): abortus is in Amerika een nationaal probleem geworden dat de Amerikaanse samenleving dieper verdeelt dan ooit tevoren, precies omdat de opperrechters ooit beslist hebben dat dezelfde regel moest gelden in heel de VS (nl. recht op abortus tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap). Voordien bleven deze conflicten lokale conflicten.
Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel - dus de zaak overlaten aan het lagere niveau - heeft precies in materies die in wezen gecontesteerd zijn ("essentially contested") (4) omzeggens enkel voordelen. Op de eerste plaats zijn er meer mensen tevreden met de geldende regel: in elke (deel)staat zal wellicht de regel gelden waarvoor men aldaar een meerderheid vindt, en die zal juist verschillen. Wie daar echt niet mee kan leven, kan overigens over de grens trekken, wat niet leuk is, maar nog veel minder leuk is wanneer een opvatting niet slechts in sommige landen, maar in heel Europa wordt opgelegd. Bij schoolreglementen die verschillen kan men naar een andere school trekken. En inwoners van Vlaanderen die echt niet zouden kunnen leven met hervormingen die de Vlaamse meerderheid zou beslissen na een defederalisering en toch zo'n schrik hebben van Vlaams cryptofascisme kunnen Tony Mary volgen naar Frankrijk - het fiscaal stelsel zal daar sowieso vaak gunstiger zijn.
Het in verschillende streken naast elkaar bestaan van uiteenlopende regels leert vele zaken ook wat relativeren en vermijdt dus de totalitaire mentaliteit die dreigt wanneer er maar één politiek correcte oplossing (want opgelegd door de mensenrechten") geldt. En ze maakt het mogelijk te leren van de ervaringen van de buren met andere regels.
Een goed voorbeeld van een domein om dit op toe te passen is justitie: zijn de verschillen in de "Vlaamse" en "Waalse" opvatting van justitie geen verschillen waarover ook de betrokkenen in Vlaanderen zelf en Wallonië zelf niet grondig verdeeld zijn ? Inderdaad, maar dat is dus veeleer een reden voor opsplitsing dan ertegen.
(verkort in Doorbraak januari 2010 als "Diversiteit of centralisme?")
(1) Zie hierover mijn "Tegendraadse bedenkingen betreffende de invulling van de mensenrechten", lezing UA-reeks 60 jaar UVRM, in Steven Dewulf & Didier Pacquée (red.), 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 1948-2008, Intersentia Antwerpen 2008, p. 53-59; ook gepubliceerd in september 2008 op onder meer http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/09/tegendraadse-bedenkingen-betreffende-de.html
(2) Zie Jozef de Witte in De Morgen van 26 juni 2009: "Laat scholen niet zelf beslissen over hoofddoek"
(3) In zijn dissenting opinion reageert hij als volgt op de idee dat de beslissing om abortusbeperkingen in alle staten van de VS ongrondwettig te verklaren in de zaak Roe v. Wade pacificerend werkte:
"The Court's description of the place of Roe in the social history of the United States is unrecognizable. Not only did Roe not, as the Court suggests, resolve the deeply divisive issue of abortion; it did more than anything else to nourish it, by elevating it to the national level, where it is infinitely more difficult to resolve. National politics were not plagued by abortion protests, national abortion lobbying, or abortion marches on Congress before Roe v. Wade was decided. Profound disagreement existed among our citizens over the issue - as it does over other issues, such as the death penalty - but that disagreement was being worked out at the state level. As with many other issues, the division of sentiment within each State was not as closely balanced as it was among the population of the Nation as a whole, meaning not only that more people would be satisfied with the results of state-by-state resolution, but also that those results would be more stable. Pre-Roe, moreover, political compromise was possible.
Roe's mandate for abortion on demand destroyed the compromises of the past, rendered compromise impossible for the future, and required the entire issue to be resolved uniformly, at the national level"
(uit "U.S. Supreme Court, PLANNED PARENTHOOD OF SOUTHEASTERN PA. v. CASEY, 505 U.S. 833 (1992), http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=505&invol=833)
(4) Het begrip "essentially contested concept" werd ontwikkeld door de amerikaanse filosoof Walter B. Gallie, met name in een lezing uit 1956. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Essentially_contested_concept
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, réflexions personnelles, flandre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 janvier 2010
Capitalisme libéral et socialisme, les deux faces de Janus
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992
CAPITALISME LIBERAL ET SOCIALISME,
LES DEUX FACES DE JANUS
par Pierre Maugué
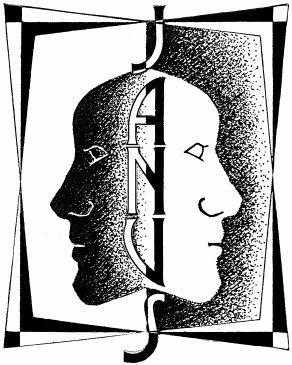 L'effondrement des régimes marxistes, en Union soviétique et en Europe orientale, et le triomphe du modèle capitaliste occidental sont généralement présentés comme l'issue d'un conflit qui opposait depuis des décennies deux conceptions du monde fondamentalement antagonistes. Cette vision manichéenne, sur laquelle se fondent les démocraties occidentales pour réaffirmer leur légitimité, mérite néanmoins d'être mise en question. En effet, l'opposition entre les deux systèmes qui se partageaient le monde sous la direction des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique était-elle si essentielle, et ne masquait-elle pas d'étranges convergences, voire même d'inavouables connivences?
L'effondrement des régimes marxistes, en Union soviétique et en Europe orientale, et le triomphe du modèle capitaliste occidental sont généralement présentés comme l'issue d'un conflit qui opposait depuis des décennies deux conceptions du monde fondamentalement antagonistes. Cette vision manichéenne, sur laquelle se fondent les démocraties occidentales pour réaffirmer leur légitimité, mérite néanmoins d'être mise en question. En effet, l'opposition entre les deux systèmes qui se partageaient le monde sous la direction des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique était-elle si essentielle, et ne masquait-elle pas d'étranges convergences, voire même d'inavouables connivences?
En 1952, dans son "Introduction à la métaphysique" , Heidegger écrivait : "L'Europe se trouve dans un étau entre la Russie et l'Amérique, qui reviennent métaphysiquement au même quant à leur appartenance au monde et à leur rapport à l'esprit". Si, pour lui, notre époque se caractérisait par un "obscurcissement du monde" marqué par "la fuite des dieux, la destruction de la terre, la grégarisation de l'homme, la prépondérance du médiocre", et si cet obscurcissement du monde provenait de l'Europe elle-même et avait commencé par "l'effondrement de l'idéalisme allemand", ce n'en est pas moins en Amérique et en Russie qu'il avait atteint son paroxysme.
L'affirmation de Heidegger, qui pose comme équivalentes, au plan de leur rapport à l'être, deux nations porteuses d'idéologies généralement pensées comme antinomiques peut paraître provocatrice. Elle ne fait pourtant que reconnaître, au plan métaphysique, la parenté certaine qui existe, au plan historique, entre capitalisme et socialisme (dont le marxisme n'est que la forme la plus élaborée et la plus absolue).
Capitalisme et socialisme sont aussi intimement liés que les deux faces de Janus. Tous deux sont issus de la philosophie du XVIIIe siècle, marguée par la trilogie : raison, égalité, progrès, et de la Révolution industrielle du XIXe siècle, caractérisée par le culte de la technique, du productivisme et du profit, et s'ils s'opposent, c'est beaucoup plus sur les méthodes que sur les objectifs.
L'émergence du socialisme moderne tient au fait gue non seulement la proclamation de l'égalité des droits par la Révolution de 1789 laissa subsister les inégalités sociales, mais que furent supprimées toutes les institutions communautaires (gérées par l'Eglise, les corporations, les communes) gui créaient un réseau de solidarité entre les différents ordres de la société, Quant à la Révolution industrielle, si elle marqua un prodigieux essor économique, elle provoqua également une détérioration considérable des conditions de vie des classes populaires, de sorte que ce qui avait été théoriquement gagné sur le plan politique fut perdu sur le plan social, La protestation socialiste tendit alors à démontrer qu'une centralisation et une planification de la production des richesses était tout-à-fait capable de remplacer la libre initiative des entrepreneurs et de parvenir, au plan économique, à l'égalité qui avait été conquise au plan juridique.
Bien que divergeant sur les méthodes (économie de libre entreprise ou économie dirigée), libéraux et socialistes n'en continuaient pas moins à s'accorder sur la primauté des valeurs économiques, et partageaient la même foi dans le progrès technique, le développement industriel illimité, et l'avènement d'un homme nouveau, libéré du poids des traditions. En fait, tant les libéraux que les socialistes pouvaient se reconnaître dans les idées des Saints-Simoniens, qui ne voyaient dans la politique que la science de la production, et pour lesquels la société nouvelle n'aurait pas besoin d'être gouvernée, mais seulement d'être administrée.
La même négation de l'autonomie du politique se retrouve ainsi chez les libéraux et les socialites de toute obédience. A l'anti-étatisme des libéraux, qui ne concèdent à l'Etat qu'un pouvoir de police propre à protéger leurs intérêts économiques, et la mission de créer les infrastructures nécessaires au développement de la libre entreprise, répond, chez les sociaux-démocrates, le rêve d'un Etat qui aurait abandonné toute prérogative régalienne et dont le rôle essentiel serait celui de dispensateur d'avantages sociaux. On trouve même chez les socialistes proudhoniens un attrait non dissimulé pour un certaine forme d'anarchie. Quant aux marxistes, bien qu'ils préconisent un renforcement du pouvoir étatique dans la phase de dictature du prolétariat, leur objectif final demeure, du moins en théorie, le dépérissement de l'Etat. Le totalitarisme vers lequel ont en fait évolué les régimes mar~istes constitue d'ailleurs aussi, à sa manière, une négation de l'autonomie du politique.
La pensée de Marx, nourrie de la doctrine des théoriciens de l'économie classique, Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill et Jean-Baptiste Say, est toujours restée tributaire de l'idéologie qui domine depuis les débuts de l'ère industrielle . Le matérialisme bourgeois, l'économisme w lgaire se retrouvent ainsi dans le socialisme marxiste. Marx rêve en effet d'une société assurant l'abondance de biens matériels et, négligeant les autres facteurs socio-historiques, il voit dans l'économie le seul destin véritable de l'homme et l'unique possibilité de réalisation sociale.
Mais ce qui crée les liens les plus forts est l'existence d'ennemis communs. Or, depuis l'origine, libéraux et marxistes partagent la même hostilité à l'égard des civilisations traditionnelles fondées sur des valeurs spirituelles, aristocratiques et communautaires.
Le Manifeste communiste de 1868 est à cet égard révélateur. Loin de stigmatiser l'oeuvre de la bourgeoisie (c'est-à-dire, au sens marxiste du terme, le grand capital), il fait en quelque sorte l'éloge du rôle éminemment révolutionnaire qu'elle a joué. "Partout où elle (la bourgeoisie) est parvenue à dominer", écrit Marx, "elle a détruit toutes les conditions féodales, patriarcales, idylliques. Impitoyable, elle a déchiré les liens multicolores qui attachaient l'homme à son supérieur naturel, pour ne laisser subsister entre l'homme et l'homme que l'intérêt tout nu, le froid 'paiement comptant'... Elle a dissous la dignité de la personne dans la valeur d'échange, et aux innombrables franchises garanties et bien acquises, elle a substitué une liberté unique et sans vergogne : le libre-échange".
Prenant acte de cette destruction des valeurs traditionnelles opérée par la bourgeoisie capitaliste, Marx se félicite que celle-ci ait "dépouillé de leur sainte auréole toutes les activités jusque là vénérables et considérées avec un pieux respect" et qu'elle ait "changé en salariés à ses gages le médecin, le juriste, le prêtre, le poête, l'homme de science".
La haine du monde rural et l'apologie des mégapoles s'expriment également sans détours chez Marx, qui juge positifs les effets démographiques du développement capitaliste. "La bourgeoisie", écrit-il, "a soumis la campagne à la domination de la ville. Elle a fait surgir d'immenses cités, elle a prodigieusement augmenté la population des villes aux dépens des campagnes, arrachant ainsi une importante partie de la population à l'abrutissement de l'existence campagnarde". Il n'hésite pas non plus à faire l'éloge du colonialisme, se félicitant que "la bourgeoisie, de même qu'elle a subordonné la campagne à la ville ... a assujetti les pays barbares et demi-barbares aux pays civilisés, les nations paysannes aux nations bourgeoises, l'Orient à l'Occident". Cette domination sans partage de la fonction économique est magnifiée par Marx, de même que l'instabilité qui en résulte. C'est en effet avec satisfaction qu'il constate que "ce qui distingue l'époque bourgeoise de toutes les précédentes, c'est le bouleversement incessant de la production, l'ébranlement continuel de toutes les institutions sociales, bref la permanence de l'instabilité et du mouvement... Tout ce qui était établi se volatilise, tout ce qui était sacré se trouve profané".
Mais la bourgeoisie capitaliste n'en a pas moins souvent cherché à faire croire qu'elle défendait les valeurs traditionnelles contre les marxistes et autres socialistes, ce qui amène Marx à rappeler, non sans une certaine ironie, que les marsistes ne peuvent être accusés de détruire des valeurs que le capitalisme a déjà détruit ou est en voie de détruire. Vous nous reprochez, dit Mars, de détruire la propriété, la liberté, la culture, le droit, l'individualité, la famille, la patrie, la morale, la religion, comme si les développements du capitalisme ne l'avait pas déjà accompli.
«Détruire la propriété?" "Mais" dit Mars, "s'il s'agit de la propriété du petit-bourgeois, du petit paysan, nous n'avons pas à l'abolir, le développement de l'industrie l'a abolie et l'abolit tous les jours". "Détruire la liberté, l'individualité?" "Mais l'individu qui travaille dans la société bourgeoise n'a ni indépendance, ni personnalité". "Détruire la famille?" "Mais par suite de la grande industrie, tous les liens de famille sont déchirés de plus en plus".
Tous ces arguments de Marx ne relèvent pas seulement de la polémique. En effet, les sociétés capitalistes présentent bien des traits conformes aux idéaux marxistes. Ainsi, à l'athéisme doctrinal professé par les marxistes répond le matérialisme de fait des sociétés capitalistes, où toute religion structurée a tendance à disparaître pour faire place à un athéisme pratique ou à une vague religiosité qui, sous l'influence du protestantisme, tend à se réduire à un simple moralisme aux contours indécis, dont tout aspect métaphysique, tout symbolisme, tout rite, toute autorité traditionnelle est banni.
De même, au collectivisme tant reproché à l'idéologie marxiste (collectivisme qui ne se réduit pas à l'appropriation par l'Etat des moyens de production, mais consiste également en une forme de vie sociale où la personne est soumise à la masse) répond le grégarisme des sociétés capitalistes. Comme le note André Siegfried, c'est aux Etats-Unis qu'est né le grégarisme qui tend aujourd'hui à gagner l'Europe. "L'être humain, devenu moyen plutôt que but accepte ce rôle de rouage dans l'immense machine, sans penser un instant qu'il puisse en être diminué", "d'où un collectivisme de fait, voulu des élites et allègrement accepté de la masse, qui, subrepticement, mine la liberté de l'homme et canalise si étroitement son action que, sans en souffrir et sans même le savoir, il confirme lui-même son abdication". Curieusement, marxisme et libéralisme produisent ainsi des phénomèmes sociaux de même nature, qui sont incompatibles avec toute conception organique et communautaire de la société.
L'idéologie mondialiste est également commune au marxisme et au capitalisme libéral. Pour Lénine, qui soutient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la libération complète de toutes les nations opprimées n'est en effet qu'un instrument au service de la Révolution et ne peut constituer qu'une "phase de transition", la finalité étant "la fusion de toutes les nations". Or, cette fusion de toutes les nations est également l'objectif du capitalisme libéral qui, tout en ayant utilisé les nationalismes des peuples de l'Est pour détruire l'Union soviétique, vise en fait à établir un marché mondial dans lequel toutes les nations sont appelées finalement à se dissoudre. Toutes les identités nationales sont ainsi destinées à disparaître pour être remplacées par un modèle uniforme, américanomorphe, au service duquel une intense propagande est organisée, modèle dont les traits caractéristiques sont le métissage, la culture rock, les jeans, le coca-cola, les chaînes de restaurant fast-food et le "basic English", le tout étant couronné par l'idéologie des droits de l'homme dont les articles de foi sont dogmatiquement décrétés par les grands-prêtres d'une intelligentsia qui n'a d'autre légitimité que celle qu'elle s'est elle-même octroyée.
En fait, tant le marxisme que le capitalisme libéral approuvent sans réserves toutes les conséquences économiques et sociales de la Révolution industrielle, qui se traduisent par la destruction de tous les liens communautaires, familiaux ou nationaux, le déracinement et la grégarisation. Une telle évolution est en effet nécessaire aussi bien à l'établissement d'un véritable marché mondial, rêve ultime du capitalisme libéral, qu'à l'avènement de l'homme nouveau, libéré de toute aliénation, qui constitue l'objectif du marxisme. Pour ce dernier, le prolétariat était d'ailleurs appelé à jouer un rôle messianique et à porter plus loin le flambeau de la Révolution, afin de mener à son terme la destruction de toutes les valeurs traditionnelles.
Pour le philosophe chrétien et traditionnaliste Berdiaev, capitalisme libéral et marxisme ne sont pas seulement liés au plan des sources idéologiques, mais ils sont également les agents d'une véritable subversion. "Tant la bourgeoisie que le prolétariat", écrit Berdiaev, "représentent une trahison et un rejet des fondements spirituels de la vie. La bourgeoisie a été la première à trahir et à abdiquer le sacré, le prolétariat lui a emboîté le pas." Soulignant les affinités qui existent entre la mentalité du bourgeois et celle du prolétaire, il déclare : "Le socialisme est bourgeois jusque dans sa profondeur et il ne s'élève jamais au-dessus du sentiment des idéaux bourgeois de l'existence. Il veut seulement que l'esprit bourgeois soit étendu à tous, qu'il devienne universel, et fixé dans les siècles des siècles, définitivement rationalisé, stabilisé, guéri des maladies qui la minent."
Si, pour Berdiaev, l'avènement de la bourgeoisie en tant gue classe dominante a correspondu à un rejet des fondements spirituels de la vie, Max Weber voit, pour sa part, une relation étroite entre l'éthique protestante et le développement du capitalisme moderne. Ces deux points de vue ne sont pas aussi contradictoires qu'ils peuvent paraître de prime abord. En effet, outre que la spiritualité ne se réduit pas à l'éthique, l'éthique protestante a tendu à devenir une simple morale utilitariste qui s'apparente en fait à la morale laïgue, et qui n'est plus sous-tendue par une vision spirituelle du monde. Max Weber relève d'ailleurs que "l'élimination radicale du problème de la théodicée et de toute espèce de questions sur le sens de l'univers et de l'existence, sur quoi tant d'hommes avaient peiné, cette élimination allait de soi pour les puritains ..." °
L'utilitarisme de l'éthique protestante apparaît d'ailleurs clairement dans sa conception de l'amour du prochain. En effet, selon celle-ci, comme le rappelle Max Weber, "Dieu veut l'efficacite sociale du chrétien" et "l'amour du prochain ... s'exprime en premier lieu dans l'accomplissement des tâches professionnelles données par la "lex naturae" revêtant ainsi "l'aspect proprement objectif et impersonnel d'un service effectué dans l'organisation rationnelle de l'univers social qui nous entoure." C'est d'ailleurs par la promotion de cette conception éthique dans le monde chrétien que le protestantisme a pu créer un contexte favorable au développement du capitalisme moderne.
Mais l'état d'esprit qui en est résulté, et qui s'est développé sans entraves aux Etats-Unis d'Amérique, paraît bien éloigné de toute sorte d'éthique. Comme l'a relevé Karl Marx à propos des "habitants religieux et politiquement libres de la Nouvelle Angleterre", "Mammon est leur idole qu'ils adorent non seulement des lèvres, mais de toutes les forces de leur corps et de leur esprit. La terre n'est à leurs yeux qu'une Bourse, et ils sont persuadés qu'il n'est ici-bas d'autre destinée que de devenir plus riches que leurs vo;sins".
Etudiant les liens qui existent entre l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante, Max Weber avait souligné la "bibliocratie" du calvinisme, qui tenait les principes moraux de l'Ancien Testament dans la même estime que ceux du Nouveau, l'utilitarisme de l'éthique protestante rejoignant l'utilitarisme du judaïsme. Avant lui, Marx avait d'ailleurs déjà relevé les affinités qui existent entre l'esprit du capitalisme et le judaïsme même si cette analyse était peu conforme aux principes du matérialisme historique. Considérant que "le fond profane du judaïsme" c'est "le besoin pratique, l'utilité personnelle", Marx estimait ainsi que, grâce aux Juifs et par les Juifs, "l'argent est devenu une puissance mondiale et l'esprit pratique des Juifs, l'esprit pratique des peuples chrétiens", concluant que "les Juifs se sont émancipés dans la mesure même où les chrétiens sont devenus Juifs".
Ignorant délibérément la complexité des origines de l'idéologie socialiste, Berdiaev privilégiait quant à lui les affinités entre socialisme et judaïsme. Selon Berdiaev, le socialisme constitue en effet une "manifestation du judaïsme en terreau chrétien", et "la confusion et l'identification du christianisme avec le socialisme, avec le royaume et le confort terrestre sont dues à une flambée d'apocalyptique hébraïque", au "chiliasme hébreu, qui espère le Royaume de Dieu ici-bas" et "il n'était pas fortuit que Marx fût juif" . Cioran rejoint sur ce point Berdiaev lorsqu'il écrit : "Quand le Christ assurait que le "royaume de Dieu" n'était ni "ici ni "là", mais au-dedans de nous, il condamnait d'avance les constructions utopiques pour lesquelles tout "royaume" est nécessairement extérieur, sans rapport aucun avec notre moi profond ou notre salut individuel. 5
De différents points de vue, capitalisme libéral et socialisme moderne paraissent ainsi liés, non seulement au plan historique, mais également par leurs racines idéologiques, et ce n'est probablement pas un hasard si leur émergence a coïncidé avec l'effondrement du système de valeurs qui, pendant des siècles, avait prévalu en Europe, et qui affirmait, du moins dans son principe originel, la primauté de l'autorité spirituelle sur le pouvoir temporel, et la subordination de la fonction économique au pouvoir temporel.
L'écroulement des régimes marxistes, incapables d'atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, n'aura donc pas changé fondamentalement le cours de l'Histoire, puisque la "Weltanschauung" commune au marxisme et au capitalisme continue toujours à constituer le point de référence de nos sociétés. Se trouvent en effet toujours mis au premier plan : le matérialisme philosophique et pratique, le règne sans partage de l'économie, l'égalitarisme idéologique (qui se conjugue curieusement avec l'extension des inégalités sociales), la destruction des valeurs familiales et communautaires, la collectivisation des modes de vie et le mondialisme. C'est peut-être d'ailleurs ce qui permet d'expliquer pourquoi les socialistes occidentaux et la majeure partie des marxistes de l'Est se sont aussi facilement convertis au capitalisme libéral, qui paraît aujourd'hui le mieux à même de réaliser leur idéal.
Mais la chute des régimes marxistes a l'Est nombre de valeurs qui, bien qu'ayant été niées pendant des décennies, n'avaient pu être détruites. On voit ainsi, dans des sociétés en pleine décomposition qui redécouvrent les réalités d'un capitalisme sauvage, s'affirmer à nouveau religions, nations et traditions.
Toutes ces valeurs qui refont surface, et dont l'affirmation avait été jugée utile par les Etats occidentaux, dans la mesure où elle pouvait contribuer au renversement des régimes marxistes, sont toutefois loin d'être vues avec la même complaisance dès lors que cet objectif a été atteint.
L'idéologie matérialiste des sociétés occidentales s'accommode en effet assez mal de tout système de valeurs qui met en question sa prétention à l'universalité et qui n'est pas inconditionnellement soumis aux impératifs du marché mondial. Tout véritable réveil religieux, toute affirmation nationale ou communautaire, ou toute revendication écologiste ne peuvent ainsi être perc,us que comme autant d'obstacles à la domination sans partage des valeurs marchandes, obstacles qu'il s'agit d'abattre ou de contourner.
Ainsi, l'établissement d'un véritable marché mondial qui puisse permettre aux stratégies des multinationales de se développer sans entraves étant devenu l'objectif prioritaire, des pressions sont exercées au sein du GATT - par le lobby américain - pour que les pays d'Europe acceptent le démantèlement de leur agriculture, quelles que puissent en être les conséquences sur l'équilibre démographique et social de ces pays, sur l'enracinement de leur identité nationale et sur leur équilibre écologique.
De même, les cultures et les langues nationales doivent de plus en plus se plier aux lois du marché mondial et céder le pas à des "produits culturels" standardisés de niveau médiocre, utilisant le "basic English" comme langue véhiculaire, et aptes ainsi à satisfaire le plus grand nombre de consommateurs du plus grand nombre de pays. Quant aux religions, elles ne sont tolérées gue dans la mesure où elles délivrent un message compatible avec l'idéologie du capitalisme libéral, et si elles s'accommodent avec les orientations fondamentales de la société permissive, qui ne sont en fait que l'application, au domaine des moeurs, des principes du libre-échange.
L'écologie, enfin, n'est prise en compte que si elle ne s'affirme pas comme une idéologie ayant la prétention d'imposer des limites à la libre entreprise. Les valeurs néo-païennes qu'elle véhicule (que le veuillent ou non ses adeptes) sont par ailleurs vivement dénoncées. Ainsi, Alfred Grosser se plaît à relever que "ce n'est pas un hasard si l'écologie a démarré si fort en Allemagne où la nature ("die Natur") tient une place tout autre qu'en France. La forêt ("der Wald") y est fortement chargée de symbole. La tradition allemande ... c'est l'homme mêlé, confondu à la nature". Ne reculant pas devant les amalgames les plus grossiers, il n'hésite pas à écrire : "La liaison entre les hommes et la nature, le sol et le sang, cette solide tradition conservatrice allemande a été reprise récemment par Valéry Giscard d'Estaing à propos des immigrés. C'était la théorie d'Hitler;". Et Grosser de conclure avec autant de naïveté que de grandiloquence : "La grandeur de la civilisation judéo-chrétienne est d'avoir forgé un homme non soumis à la nature".
L'idéologie capitaliste libérale, actuellement dominante, entre ainsi en conflit avec d'autres ordres de valeur, et ces nouveau~ conflits, dont nous ne voyons que les prémisses, pourraient bien reléguer au rang des utopies la croyance en une "fin de l'histoire". En effet, ces conflits n'opposent plus, comme c'était le cas depuis deux siècles, deux idéologies jumelles qui, tout en se combattant, partaqeaient pour l'essentiel les mêmes idéaux fondamentaux et ne s'opposaient que sur les moyens de les réaliser. Les sociétés fondées sur le capitalisme libéral vont en effet avoir désormais à affronter des adversaires dont l'idéologie est irréductible à une vision purement économiste du monde. L'antithèse fondamentale ne se situe pas en effet entre capitalisme et marxisme, mais entre un système où l'économie est souveraine, quelle que soit sa forme, et un système où elle se trouve subordonnée à des facteurs extra-économiques.
On voit ainsi reparaître l'idée d'une hiérarchie des valeurs qui n'est pas sans analogies avec l'idéologie des peuples indo-européens et celle de l'Europe médiévale, où la fonction économique, et notamment les valeurs marchandes, occupait un rang subordonné aux valeurs spirituelles et au pouvoir politique (au sens originel de pouvoir régulateur de la vie sociale et des fonctions économiques). Bien que, dans cet ordre ancien, la dignité de la fonction de production des biens matériels fût généralement reconnue , il était toutefois exclu que les détenteurs de cette fonction puissent usurper des compétences pour l'exercice desquelles ils n'avaient aucune qualification. L'économie se trouvait ainsi incorporée dans un système qui ne considérait pas l'homme uniquement comme producteur ou consommateur, et l'organisation corporative des professions mettait beaucoup plus l'accent sur l'aspect qualitatif du travail que sur l'aspect quantitatif de la production, donnant une dimension spirituelle à l'accomplissement de toutes les tâches, même des plus humbles. Quant à la spéculation, au profit détaché de tout travail productif, ils n'étaient non seulement pas valorisés, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils étaient profondément méprisés, tant par la noblesse que par le peuple, et ceux qui s'y adonnaient étaient généralement considérés comme des parias.
Ce n'est en fait que depuis deux siècles que les valeurs marchandes ont pris une place prépondérante dans la société occidentale, et que s'est instituée cette véritable subversion que Roger Garaudy qualifie de "monothéisme du marché, c'est-à-dire de l'argent, inhérent à toute société dont le seul régulateur est la concurrence, une guerre de tous contre tous". Un champion de l'ultra-libéralisme, comme Hayek, reconnaît d'ailleurs lui-même que "le concept de justice sociale est totalement vide de sens dans une économie de marché".
Cette subversion des valeurs est particulièrement sensible dans le capitalisme de type anglo-saxon que Michel Albert oppose au capitalisme de type rhénan ou nippon : le premier pariant sur le profit à court terme, négligeant outrancièrement les secteurs non-marchands de la société, l'éducation et la formation des hommes, et préférant les spéculations en bourse à la patience du capitaine d'industrie ou de l'ingénieur qui construisent et consolident jour après jour une structure industrielle; le second planifiant à long terme, respectant davantage les secteurs non-marchands, accordant de l'importance à l'éducation et à la formation et se fondant sur le développement des structures industrielles plutôt que sur les spéculations boursières.
Il est d'ailleurs intéressant de relever gue c'est le capitalisme de type rhénan ou nippon, qui conserve un certain nombre de valeurs des sociétés pré-industrielles et s'enracine dans une communauté ethno-culturelle, qui se révèle être plus performant que le capitalisme de type anglo-saxon, qui ne reconnaît pas d'autres valeurs que les valeurs marchandes, même s'il aime souvent se draper dans les plis de la morale et de la religion.
Mais le meileur équilibre auquel sont parvenues les sociétés où règne un capitalisme de type rhénan ou nippon n'en demeure pas moins fragile, et ces sociétés sont loin d'être exemptes des tares inhérentes à toutes les formes de capitalisme libéral. On peut d'ailleurs se demander si le capitalisme de type rhénan ou nippon, qui s'appuie sur les restes de structures traditionnelles, n'est pas condamné à disparaître par la logique même du capitalisme libéral qui finira par en détruire les fondements dans le cadre d'un marché mondial.
Par delà ces oppositions de nature éphémère qui existent au sein du capitalisme libéral, la question est finalement de savoir si celui-ci parviendra à établir de manière durable son pouvoir absolu et universel, marquant ainsi en quelque sorte la fin de l'histoire, ou s'il subira, à plus ou moins longue échéance, un sort analogue à celui de marxisme. En d'autres termes, une société ne se rattachant plus à aucun principe d'ordre supérieur et dénuée de tout lien communautaire est-elle viable, ou cette tentative de réduire l'homme aux simples fonctions de producteur et de consommateur, sans dimension spirituelle et sans racines, est-elle condamnée à l'échec, disqualifiant par là-même l'idéologie (ou plutôt l'anti-idéologie) sur laquelle elle était fondée?
Pierre Maugué
Novembre 1992
NOTES
1) Cf. Martin Heideqger, "Introduction à la métaphysique", page 56, Gallimard, Paris 1967.
2) Cf. Werner Sombart, "Le Socialisme allemand", Editions Pardès, 45390 Puiseaux.
3) Cf. Karl Marx, "Le manifeste communiste" in "oeuvres complètes", La Pléïade, Gallimard, Paris 1963.
4) René Guénon fait la même constatation gue Rarl Marx, mais, loin d'y voir l'annonce d'un monde nouveau, supérieur à l'ancien, il y voit au contraire une déchéance, la fin d'un cycle. Il relève ainsi que "partout dans le monde occidental, la bourgeoisie est parvenue à s'emparer du pouvoir", que le résultat en est "le triomphe de l'économique, sa suprématie proclamée ouvertement" et qu'"à mesure qu'on s'enfonce dans la matérialité, l'instabilité s'accroît, les changements se produisent de plus en plus rapidement". Cf. René Guénon, "Autorité spirituelle et pouvoir temporel", page 91, Les Editions Vega, Paris, 1964.
5) Cf. André Siegfried, "Les Etats-Unis d'aujourd'hui", pages 346, 349
et 350, Paris 1927.
6) Cf. Lénine, "Oeuvres", tome 22, page 159, Editions sociales, Paris 1960.
7) Comme le relève Régis Debray, "Nous avions eu Dieu, la Raison, la Nation, le Progrès, le Prolétariat. Il fallait aux sauveteurs un radeau de sauvetage. Voilà donc pour les aventuriers de l'Arche Perdue, les Droits de l'Homme come progressisme de substitution. Cf. Régis Debray, "Que vive la République", Editions Odile Jacob, Paris 1989.
8) Cf. Nicolas Berdiaev, "De l'inégalité", pages 150 et 152, Editions l'Age
d'Homme, Genève 1976.
9) Cf. Nicolas Berdiaev, op. cité, page 150. Dans le style qui lui est propre, Louis-Ferdinand Céline avait relevé la même analogie entre esprit bourgeois et esprit prolétaire. "Vous ne rêvez que d'être lui, à sa place, rien d'autre, être lui, le Bourgeois! encore plus que lui, toujours plus bourgeois! C'est tout. L'idéal ouvrier c'est deux fois plus de jouissances bourgeoises pur lui tout seul. Une super bourgeoisie encore plus tripailleuse, plus motorisée, beaucoup plus avantageuse, plus dédaigneuse, plus conservatrice, plus idiote, plus hypocrite, plus stérile que l'espèce actuelle". Cf. Louis-Ferdinand-Céline, "L'école des cadavres", Editions Denoël, Paris.
10) Cf. Max Weber, "L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme", page 129, Librairie Plon, Paris 1964.
11) Cf. Max Weber, op cité, pages 128 et 129.
12) Cf. Rarl Marx, "La question juive", pages 50 et 55, collection 10/18, Union générale d'éditions, Paris 1968.
13) Cf. Karl Marx, op cité, pages 49 et 50.
14) Cf. Nicolas Berdiaev, op cité, page 154
15) Cf. Cioran, "Histoire et Utopie", Gallimard, Paris 1960.
16) C'est ainsi que le modèle de la société libérale avancée, qui s'est imposé en Occident, correspond parfaitement à certains objectifs qu'Engels avait fixés au 21e point de son avant-projet pour le Manifeste du Parti communiste. Il écrivait ainsi : "(L'avènement du communisme) transformera les rapports entre les sexes en rapport purement privés, ne concernant que les personnes qui y participent et où la société n'aura pas à intervenir. Cette transformation sera possible du moment que ... les enfants seront élevés en commun, et que seront détruites les deux bases principales du mariage actuel, à savoir la dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme, et celle des enfants vis-à-vis des parents".
17) Cf. Alfred Grosser, interview paru dans "Le Nouveau Quotidien" (Lausanne) du vendredi 24 janvier 1992 sous le titre : "Après le dieu Lénine des communistes, voici la déesse Gaia des écologistes".
18) Dans l'Inde traditionnelle, les "vaishya", représentants de la troisième fonction, ont la qualité d'"arya". Toutefois, dans le monde méditerranéen, chez les Romains et les Grecs de l'époque classique, on constate une dépréciation du travail manuel, qui n'existe pas en revanche dans les sociétés celtiques et germaniques, où l'esclavage tenait une place beaucoup moins importante.
19) Cf. Roger Garaudy "Algérie, un nouvel avertissement pour l'Europe", in "Nationalisme et République", No 7.
20) Cf. Michel Albert, "Capitalisme contre capitalisme", Editions du Seuil, collection "L'histoire immédiate", Paris 1991.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : philosophie, socialisme, libéralisme, capitalisme, théorie politique, sciences politiques, politologie, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 janvier 2010
Camus, con Jünger e la Arendt sta a pieno titolo nel "nostro" pantheon
 Camus, con Jünger e la Arendt sta a pieno titolo nel "nostro" pantheon
Camus, con Jünger e la Arendt sta a pieno titolo nel "nostro" pantheon
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, littérature française, littérature, lettres, lettres françaises, lettres allemandes, littérature allemande, italie, camus, sarkozy, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 janvier 2010
Ende der Geschichtlichkeit
 Ende der Geschichtlichkeit
Ende der Geschichtlichkeit
Ernst Nolte, Brief an François Furet vom 11. Dezember 1996, in: "Feindliche Nähe". Kommunismus und Faschismus im 20. Jahrhundert. Ein Briefwechsel, München 1998.
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, histoire, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 janvier 2010
Slavoj Zizek, un fascista di sinistra dei nostri giorni
Slavoj Zizek, un fascista di sinistra dei nostri giorni
di Luciano Lanna
Ex: http://robertoalfattiappetiti.blogspot.com/
 Luciano Lanna, laureato in filosofia, giornalista professionista dal 1992 e scrittore (autore, con Filippo Rossi, del saggio dizionario Fascisti immaginari. Tutto quello che c'è da sapere sulla destra, Vallecchi 2004), oltre ad aver lavorato in quotidiani e riviste, si è occupato di comunicazione politica e ha collaborato con trasmissioni radiofoniche e televisive della Rai. Già caporedattore del bimestrale di cultura politica Ideazione e vice direttore del quotidiano L'Indipendente, è direttore responsabile del Secolo d'Italia.
Luciano Lanna, laureato in filosofia, giornalista professionista dal 1992 e scrittore (autore, con Filippo Rossi, del saggio dizionario Fascisti immaginari. Tutto quello che c'è da sapere sulla destra, Vallecchi 2004), oltre ad aver lavorato in quotidiani e riviste, si è occupato di comunicazione politica e ha collaborato con trasmissioni radiofoniche e televisive della Rai. Già caporedattore del bimestrale di cultura politica Ideazione e vice direttore del quotidiano L'Indipendente, è direttore responsabile del Secolo d'Italia.L'articolo è anche sul sito web del Secolo d'Italia: QUI
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, slovénie, théorie politique, politologie, sciences politiques, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 janvier 2010
Démocratie américaine et dialectique de la liberté
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Démocratie américaine et dialectique
de la liberté
à propos d'un livre de Gottfried Dietze
par Hans-Dietrich SANDER
Parmi les livres dignes d'intérêt récemment parus, et soumis à la conspiration du silence, il y a l'ouvrage sur l'Amérique de Gottfried Dietze:
Gottfried Dietze, Amerikanische Demokratie — Wesen des praktischen Liberalismus, Olzog Verlag, München, 1988, 297 S., DM 42.
Depuis longtemps déjà, l'auteur n'avait plus publié d'articles dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung et dans Die Welt (Bonn). Il n'est plus membre de la Mount Pelerin Society. Il s'en est retiré, parce qu'il ne lui a pas été permis de prononcer son discours sur Kant en langue allemande lors d'une diète de la dite société à Berlin! Mais personne en revanche n'a pu le traiter de «terroriste intellectuel». Gottfried Dietze est professeur ordinaire de «théorie comparée des pouvoirs» à la John Hopkins University de Baltimore, l'une des cinq universités les plus cotées aux Etats-Unis (sa faculté occupe d'ailleurs la première place en son domaine). Ses travaux, il les publie en Allemagne chez J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) et chez Duncker & Humblot, c'est-à-dire chez les meilleurs éditeurs de matières politologiques. La maison Olzog, qu'il a choisie pour éditer son livre sur l'Amérique, ouvrage destiné à un public plus vaste, ne suscite pas davantage les colères des professionnels hystériques qui entendent façonner l'opinion publique selon leurs seuls critères. La démocratie ouest-allemande vient manifestement d'atteindre un seuil critique, où, désormais, ceux qui prononcent des paroles libres, claires, transparentes, passent pour des excentriques. Et, «notre démocratie», pour reprendre les mots de son Président Richard v. Weizsäcker, ne peut pas se permettre des excentriques politiques.
Critique du libéralisme pur et réminiscences tocquevilliennes
Dietze passe depuis longtemps déjà pour un excentrique dans notre bonne république. Pour être exact, depuis que le Spiegel a découvert, jadis, qu'il servait de conseiller au candidat à la Présidence américaine Barry Goldwater, et cela, au moment où la guerre du Vietnam atteignait son point culminant. Toute évocation de son nom, à l'époque, suscitait la suspicion. Il a tenté de revenir en Allemagne, en y postulant un poste universitaire. Sans succès. Le dernier des grands théoriciens du libéralisme politique n'est pas le bienvenu dans la République fédérale, acquise pourtant aux principes du libéralisme. Cette situation n'est pas incompréhensible. Elle découle, d'une part, du rapport même que Dietze entretient avec l'idéologie libérale et, d'autre part, de son engagement politique aux côtés de Goldwater. La modestie de Dietze est telle, qu'il n'a pas osé paraphraser Kant dans les sous-titres de ses ouvrages majeurs, Reiner Liberalismus (Le libéralisme pur) et Amerikanische Demokratie (La démocratie américaine). Au premier, il aurait parfaitement pu donner le titre de Kritik des reinen Liberalismus (Critique du libéralisme pur); au second, Kritik des praktischen Liberalismus (Critique du libéralisme pratique). Il aurait ainsi imité le grand penseur de Königsberg, avec sa Critique de la raison pure et sa Critique de la raison pratique.
Le titre du livre qui me préoccupe ici, Amerikanische Demokratie, paraphrase pourtant un autre grand théoricien politique, Alexis de Tocqueville, auteur de La démocratie en Amérique. Mais Dietze adopte une perspective critique à l'endroit des idées de Tocqueville. Il cherche à donner d'autres définitions aux concepts. Contrairement à Tocqueville, qui, il y a 150 ans, voulait explorer l'essence de la démocratie à la lumière de la démocratie américaine, Dietze cerne la démocratie américaine en soi, qui, dans la forme qu'elle connaît aujourd'hui, n'existait pas encore vers 1830-40, sa transformation radicale par Andrew Jackson n'en étant qu'à ses premiers balbutiements. La démocratie américaine, explique Dietze, est fondamentalement différente des autres démocraties, ce qui la rend précaire quand elle est imposée à d'autres pays.
La néomanie américaine
Dietze approche son sujet en analysant les phénomènes et les discours de la quotidienneté américaine, de la banalité quotidienne de l'American Way of Life, qui, soutenu par cette bonne conscience typique du «Nouveau Monde», se présente comme une poussée incessante vers la nouveauté (Drang nach dem Neuen), vers tout ce qui est nouveau. Le concept américain de liberté repose sur un fondement problématique: en l'occurrence sur la volonté d'être toujours prêt à réceptionner cette nouveauté. Ensuite, ce concept trouve son apogée dans la notion de Manifest Destiny, du destin et de la mission de l'Amérique, qui est d'apporter cette liberté à tous les autres peuples. Dans la foulée de ses possibilités illimitées, la démocratie américaine n'a pas créé une forme spécifique de libéralisme politique mais des variations libérales toujours changeantes.
Ce type de démocratie a très fortement marqué le peuple américain et, à l'inverse, le peuple a marqué la démocratie américaine. Les origines des Etats-Unis, faites d'émigrations et d'immigrations, se sont transformées en migrations et en vagabondages, en manifestations et en agitations. Le résultat: une absence permanente de racines, qui trouve un parallèle saisissant dans le monde juif toujours dé-localisé (ent-ortet). Cette absence de racines est la condition première de la symbiose actuellement dominante. Contrairement aux symbioses d'antan, cette symbiose actuelle ne présente pas une panoplie de négations qui se combinent utilement à des positions données, mais une gamme de négations qui s'imposent sur la scène publique en se créant du tort les unes aux autres.
Une pulsion jamais assouvie de liberté jouissive
Le pouvoir du peuple en Amérique oscille ainsi de la démocratie élitaire à la démocratie égalitaire, de la démocratie représentative à la démocratie directe, de la démocratie limitée à la démocratie illimitée. Quelle vue d'ensemble cela donne-t-il? Celle d'un «pot-pourri dans le melting pot»; par «melting pot», nous n'entendons pas, ici, le seul mélange des races et des ethnies. Ce jeu chaotique dérive précisément de cette pulsion incessante vers la nouveauté et se maintient par la force intrinsèque dégagée par cette pulsion. Il dérive des droits inaliénables à jouir de la triade life, liberty and pursuit of happiness, d'une liberté toujours plus grande qui se mesure surtout à la possession de biens matériels et à leur jouissance. Dans une telle optique, le pays n'est rien, l'individu est tout.
Ce serait bien là le perpetuum mobile d'un monde totalement immanent, si la pulsion de liberté n'était pas pluri-signifiante et à strates multiples. Dans son analyse, Gottfried Dietze déploie une dialectique de la liberté, où sa position vis-à-vis du libéralisme prend des formes socratiques. En effet, le livre, en de longs passages, se lit comme un dialogue, où chaque facette est opposée à son contraire (son négatif), si bien qu'à la fin, on débouche sur des questions ouvertes.
La pulsion de liberté du libéralisme pur n'est pas seulement dirigée contre les tyrans: elle s'épuise dans la lutte interne de concurrences diverses aux frais des autres. Cela ne nous mène pas seulement à la lutte hobbesienne de tous contre tous, lutte où apparaîtrait juste la crainte de Hegel de voir l'homme considérer qu'une telle liberté autorise et prône le vol, le meurtre et le désordre, mais aussi à une exploitation despotique de la minorité par la majorité, ce qui serait parfaitement conciliable avec le libéralisme, parce qu'il exige plus de liberté pour l'individu sans regard pour les autres.
La transposition de cette émancipation dans le domaine de la libido, comme on a pu l'observer au cours de ces dernières décennies en Amérique, fait que cette pulsion, sans regard pour autrui, qui poursuit sa quête insatiable de bonheur conduit à une «jungle sexuelle» que Hobbes n'avait pas pu imaginer.
Une symbiose entre
Jefferson et Freund
La permissivité engendrée par la lutte concurrentielle outrancière et la multiplication des contacts sexuels, où la question du bien et du mal n'est plus posée, a forgé une symbiose entre Jefferson et Freud, dont les conséquences excessives ne peuvent surgir qu'en Amérique: «Les idées de Freud, telles qu'elles ont été prises en compte et perçues par les Américains, ont complété celles de Jefferson —du moins dans les interprétations qu'elles avaient acquises au cours du temps; elles les ont complétées de façon telle que le pensée libérale ancrée dans ce peuple s'est vue considérablement élargie, s'est apurée à l'extrême et s'est détachée de tout contexte axiologique».
Sur le plan de la liberté, nous apercevons très vite la différence essentielle entre Tocqueville et Dietze. Tocqueville voyait une démocratie américaine liée à l'idée d'égalité, suscitant une tendance générale et progressive à expulser toute notion de liberté. Dietze, au contraire, voit dans la liberté le pôle adverse de la démocratie et de l'égalité; et, pour lui, la liberté est tout aussi illusoire que la démocratie et l'égalité. Ce que Tocqueville craignait jadis, soit de voir advenir une dictature égalitaire de la démocratie, n'a pas eu lieu: la pulsion de liberté s'y est sans cesse heurtée et en a émoussé les contours.
La pulsion de liberté, en tant que fondement ultime du libéralisme à l'américaine, s'est toujours mise en travers de toutes les mesures de contrôle, d'équilibrage et de conservation. Sans ces mesures, le libéralisme devient un mouvement anti-autoritaire. De ce fait, le despotisme de la majorité et le mouvement anti-autoritaire sont les extrêmes du libéralisme pratique, extrêmes qui se rejoignent dans le libéralisme pur. Prenons deux exemples.
Une presse libre qui censure
ce qui ne lui plaît pas
Le premier montre comment l'expression «presse populaire» a acquis un sens ambigu. La presse, qui, à l'origine, était un instrument servant à presser des lettres sur du papier, a fini très vite par presser ses vues dans les cerveaux du peuple, à la manière la plus libérale qui soit: «L'ancienne liberté de presse, soit la liberté de la presse vis-à-vis de toute censure étatique, s'est transformée radicalement: elle est devenue liberté pour la presse de censurer, dénoncer et vilipender l'Etat, des citoyens individuels et des groupes précis de la société d'une manière éhontée, nuisant aux cibles infortunées et profitant à ceux qui usent et abusent de cette liberté. Cette situation s'observe dans tous les pays où la presse est libre mais elle est plus frappante encore aux Etats-Unis, écrit Dietze, le plus libéral des pays».
Le deuxième exemple nous montre les possibilités illimitées que laisse entrevoir le jeu de mot democracy/democrazy, où le «pouvoir du peuple» apparaît comme l'«enfollement du peuple». Dietze souligne à plusieurs reprises que la quintessence de la démocratie américaine ne permet pas de percevoir cet «enfollement» comme une dégénérescence. Car la quintessence de la démocratie américaine, c'est que son libéralisme est réellement sans principes, dépourvu de tout point de référence éthique et de toute forme de responsabilité.
Les déceptions des Européens face à l'extrême versatilité américaine ne sont dès lors pas convaincantes: «Vu d'Amérique, vu du lieu où se bousculent toutes les variantes et variations du libéralisme, il ne peut guère y avoir de déceptions nées du spectacle et du constat de comportements instables, du va-et-vient de la politique américaine. On ne peut être déçu que lorsque quelque chose évolue d'une façon autre, pire, que ce que l'on avait prévu. Mais, dans la démocratie américaine, qui se rapproche plus du libéralisme pur que n'importe quelle autre démocratie, on ne doit guère s'attendre à une politique constante. Toute constance y disparaît sous la pression des souhaits et des désirs des individus et du peuple, mus par l'humeur du moment».
Anarchie et volonté de simplification outrancière
Au point culminant de ses analyses enjouées et sans pitié, qui rappellent celles de Machiavel, Dietze cite le poète irlandais William Butler Yeats: «Things fall apart; the center cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world» («Les choses se disloquent; le centre ne maintient plus rien; une anarchie brute envahit le monde»). Pour Dietze, Yeats, dans cette phrase résume l'essence du libéralisme pur. Quand cette situation d'anarchie est atteinte, toute dialectique de liberté prend fin.
Dietze explique ensuite le processus dans son moteur intime et profond: «Bien des signes nous l'indiquent: la complexité croissante de la vie a éveillé une nostalgie du simple, du pur, avec des simplifications outrancières, si bien que la démocratie n'apparaît même plus comme une forme politique dans le sens où l'entendaient Locke ou Rousseau mais bien plutôt comme l'entendait Bakounine». La démocratie à l'américaine est le catalyseur de ce courant sous-jacent fondamental: «Sans doute, très probablement, les évolutions du Nouveau Monde, avec la pulsion constante de changement qui règne là-bas, ont accéléré le processus. Car l'américanisation du monde est un fait que l'on ne saurait ignorer en ce siècle, que les Américains déclarent être le leur, même si le rêve d'une pax americana est passé depuis longtemps».
La question finale que pose le livre de Dietze est la suivante: «Qu'adviendra-t-il de l'Amérique et de l'américanisme? Il faut attendre. L'avenir nous le dira». Question rhétorique ou question macabre? Dietze prononce des vérités que l'on n'aime guère entendre dans la République de Bonn, où l'on considère la démocratie à l'américaine comme une sotériologie, pour ne pas dire comme une vache sacrée, alors que cette démocratie a été instaurée en RFA comme un système provisoire mais qu'on s'est habitué à considérer comme définitif. Ce sont des vérités que l'on n'aime guère entendre parce qu'elles sonnent justes. On préfère se boucher les oreilles.
Après la révolution populaire allemande de RDA, qui fait apparaître la démocratie de Bonn pour ce qu'elle est vraiment, soit un système provisoire, et la remet en question, il n'est pourtant plus possible de se boucher les oreilles. Les Allemands devront, en opérant la synthèse de leurs divers systèmes politiques actuels, trouver une réponse adéquate, adaptée à leur histoire, pour dépasser le système de la démocratie à l'américaine.
Hans-Dietrich SANDER.
(recension parue dans Staatsbriefe 1/1990; adresse: Castel del Monte Verlag, Türkenstr. 57, D-8000 München 40).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, liberté, théorie politique, sciences politiques, politologie, histoire, etats-unis, amérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 décembre 2009
L'autre signification de l'Etre
 Archives des SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Archives des SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
L'autre signification de l'Etre
Dr. Angelika WILLIG
De qui un homme comme Ernst Jünger se sent-il compris? Certainement pas par ses adversaires qui ne combattent en lui que sa seule projection élitaire et militariste. Mais il ne doit pas se sentir davantage compris de ses épigones, qui sont incapables de le suivre dans les méandres difficiles de sa pensée et qui, au contraire, cherchent la facilité en vouant un culte simpliste à leur idole. Que reste-t-il dès lors, sinon la “grande conversation des esprits” dont a parlé Nietzsche et qui, à travers les siècles, n'est animée que par des hommes isolés, importants et significatifs.
Il est très rare que de tels isolés engagent un dialogue. Ainsi, Ernst Jünger s'est adressé à Martin Heidegger, à l'occasion des 60 ans de ce philosophe de la Forêt Noire, en écrivant à son intention Über die Linie, un opuscule qui aborde “le grand thème de ces cent dernières années”: le nihilisme. Heidegger s'est senti tellement interpellé par ce texte qu'à son tour, il a consacré à l'écrivain un opuscule, également intitulé Über' die Linie, à l'occasion des 60 ans de l'auteur du Travailleur en 1955. Cette rencontre a été très prometteuse, on s'en doute. Mais elle n'a pas promis plus qu'elle ne pouvait tenir, surtout à ceux qui s'en faisaient des idées fausses. Et totalement fausse aurait été l'idée, par exemple, que Jünger et Heidegger avaient pris délibérément la résolution d'écrire à deux un manifeste commun, fondateur d'une “révolution conservatrice” à laquelle nous pourrions encore adhérer aujourd'hui. Telle n'était pas l'intention de Jünger et de Heidegger: ils sont trop intelligents et trop prudents pour oser de tels exercices.
Métaphysique
Jünger part du principe que le nihilisme constitue un défi pour l'individu. L'individu, ici, est bien l'individu et non pas une classe particulière, ou une race, un parti ou un mouvement. En d'autres termes: le nihilisme n'est pas un problème politique mais un problème métaphysique. C'est là la raison essentielle qui motive Jünger quand il s'adresse à Heidegger car celui-ci a vu que la question décisive réside dans la métaphysique et non pas dans l'économie, la biologie ou la psychologie. Dans ce domaine, Jünger est bien sur la même longueur d'onde que le philosophe de la Forêt Noire: tous deux acceptent le fait que l'évolution historique bute contre une limite et qu'il n'est plus possible d'aller au-delà. Telle est la signification de l'image de la “ligne”, que Heidegger reprend à son compte, sans doute en la transformant: tel est bien le diagnostic du nihilisme. Jünger nous en livre une description qui culmine dans cette phrase: . Le nihilisme est dès lors la perte de toute assise solide et de toute durée, sur lesquelles on pourrait encore construire ou reconstruire quelque chose.
On songe tout de suite aux “idées” et aux “valeurs”. Mais Jünger pense sans nul doute aux attaques en règle qui sont perpétrées contre une “base ultime”, une assise primordiale, que nous pourrions parfaitement interpréter dans un sens écologique aujourd'hui. Jünger nous parle du “moment où la rotation d'un moteur devient plus forte, plus significative, que la répétion, des millions de fois, des formules d'une prière”. Ce “moment”, qui pourrait bien durer cent ans ou plus, désigne l'illusion qui veut que toute perfection technique ne peut réussir que sur base de biens donnés par Dieu ou par la nature, biens dont nous dépendons existentiellement et surtout dont nous sommes nous-mêmes une partie. Le “néant” que la modernité nihiliste semble répandre autour d'elle, n'est donc pas néant, rien, mais est en vérité le sol, sur lequel nous nous trouvons, le pain que nous mangeons, et l'âme qui vit en nous. Si nous nous trouvons dans des “paysages arides, gris ou brûlés” (Jünger), il peut nous sembler que rien n'y poussera ni n'y fleurira jamais. Mais plus nos souvenirs des temps d'abondance s'amenuisent, plus forts seront le besoin et le désir de ce dont nous avons réellement besoin et de ce dont nous manquons. Heidegger ne songe à rien d'autre quand il définit la disparition, l'absence, par la présence, ou quand il voit dans la Verborgenheit (l'obscurité, l'occultement) une sorte de “dépôt de ce qui n'est pas encore dévoilé (dés-occulté)”. Car si nous considérons l'homme dans son existentialité, son Dasein, soit sa détermination par son environnement (Umwelt), alors son Etre (Sein) ne peut jamais être mis entièrement à disposition; dès lors, plus le danger le menace, plus grande est la chance d'une nouvelle appropriation. Heidegger appelle cela l'“autre commencement”.
Refus de la conception linéaire de l'histoire
Tous deux s'opposent donc à la conception linéaire de l'histoire, à la conception qui voit l'histoire comme une ligne droite, sur laquelle on ne peut qu'avancer ou reculer, partageant du même coup les esprits en “esprits progressistes” et en “esprits conservateurs”. Pour Heidegger comme pour Jünger la ligne est transversale. “Le franchissement de la ligne, le passage du point zéro”, écrit Jünger, “partage le jeu; elle indique le milieu, mais non pas la fin”. Comme dans un cercle, elle recommence sa trajectoire après une rotation, mais à un autre niveau. Heidegger parle ici de la nécessité d'un "retour” ou d'un “retournement” et non pas d'un “recul vers des temps déjà morts, rafraîchis à titre d'expérimentation par le truchement de formes bricolées”. Jünger, lui aussi, a toujours évité ce fourvoiement, ce que l'on ne peut pas dire de tous ses contemporains! “Le retour”, signifie pour Heidegger, le lieu ou la pensée et l'écriture “ont toujours déjà été d'une certaine façon”.
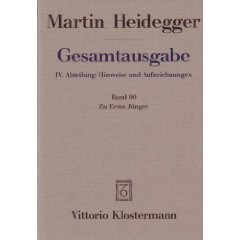 Heidegger estime aussi que “les idées s'embrasent” face à “cette image d'un sens unique”, impliquée par la ligne: c'est là que surgit la problématique du nihilisme —aujourd'hui nous parlerions plutôt de la problématique de la société de consommation ou de la société du throw away. Pourtant le philosophe émet une objection, qui est déjà perceptible dans une toute petite, mais très significative, transformation du titre: chez Jünger, ce titre est Über die Linie, et il veut désigner le franchissement de la ligne; chez Heidegger, c'est Über' die Linie. Il veut par l'adjonction de cette minuscule apostrophe expliciter à fond ce qu'est la zone, le lieu, de cette ligne. Ce qui chez Jünger est invite à l'action, demeure chez Heidegger contemplation. Il est clair que l'objet de la philosophie n'est pas de lancer des appels, mais d'analyser. Et Heidegger, bien qu'il critique fortement les positions de l'idéalisme platonicien, est assez philosophe pour ne pas laisser passer sans sourciller la volonté activiste de participation de l'écrivain, son vœu et sa volonté de dépasser aussi rapidement que possible le nihilisme.
Heidegger estime aussi que “les idées s'embrasent” face à “cette image d'un sens unique”, impliquée par la ligne: c'est là que surgit la problématique du nihilisme —aujourd'hui nous parlerions plutôt de la problématique de la société de consommation ou de la société du throw away. Pourtant le philosophe émet une objection, qui est déjà perceptible dans une toute petite, mais très significative, transformation du titre: chez Jünger, ce titre est Über die Linie, et il veut désigner le franchissement de la ligne; chez Heidegger, c'est Über' die Linie. Il veut par l'adjonction de cette minuscule apostrophe expliciter à fond ce qu'est la zone, le lieu, de cette ligne. Ce qui chez Jünger est invite à l'action, demeure chez Heidegger contemplation. Il est clair que l'objet de la philosophie n'est pas de lancer des appels, mais d'analyser. Et Heidegger, bien qu'il critique fortement les positions de l'idéalisme platonicien, est assez philosophe pour ne pas laisser passer sans sourciller la volonté activiste de participation de l'écrivain, son vœu et sa volonté de dépasser aussi rapidement que possible le nihilisme.
Sujet & Objet
Heidegger admoneste Jünger, et cette admonestation se justifie théoriquement. A juste titre, Heidegger pense: «L'homme non seulement se trouve dans la zone critique de la ligne, mais il est lui-même, non pas pour soi et certainement pas par soi seulement, cette zone et ainsi cette ligne. En aucun cas cette ligne est... telle qu'elle serait un tracé franchissable placé devant l'homme». En écrivant cette phrase, Heidegger se rapporte à une idée fondamentale de Sein und Zeit, jamais abandonnée, selon laquelle l'homme n'est pas un “sujet”, placé devant un “objet”, mais est soumis à une détermination existant déjà avant tout rapport sujet/objet. L', tel qu'évoqué ici, acquiert une signification si différente de celle que lui conférait la métaphysique traditionnelle, que Heidegger, dans son essai, biffe toujours le mot (Sein), afin qu'on ne puisse plus le lire dans le sens usuel.
Pour le philosophe, une telle précision dans les termes est absolument indispensable, mais, quand on lit l'écrivain, cette précision conduit à des mécompréhensions ou des quiproquos. Jünger, en effet, ne s'en tient pas à la terminologie forgée par Heidegger, mais raisonne avec des mots tels “valeur”, “concept”, “puissance”, “morale”, “décision” et reste de ce fait dans le “langage de la métaphysique” et surtout dans celui du “métaphycisien inversé” que fut Nietzsche. Pourtant, l'écrivain ne peut pas être jugé à l'aune d'une philosophie du sujet, manifestement dépassée. C'est cependant ce que Heidegger tente de faire. Mais son jugement pose problème quand on repère le passage où Jünger se rapproche le plus de cet “autre” dans sa formulation: . Une fois de plus, Heidegger, après avoir lu cette phrase, pose une question très précise: l'Etre peut-il être quelque chose pour soi? Et le philosophe de la Forêt Noire corrige: .
Jünger complète Heidegger
De telles remarques nous aident à mieux comprendre Heidegger, mais ne sont presque d'aucune utilité quand nous interprétons l'écriture de Jünger. Le philosophe nous dit bien que “de tels doutes ne peuvent nullement égratigner la force éclairante des images”, mais cela ne le conduit pas à un examen plus précis du langage de Jünger. Par coquetterie, Heidegger évoque la confusion et l'imprécision de Jünger mais reste, lui, ferme sur sa propre voie, dans sa propre logique de penser, et ne cherche pas à comprendre les autres possibles. Quand Heidegger constate: “Votre jugement sur la situation trans lineam et mon explication de linea sont liés l'un à l'autre”, il reste finalement assez laconique.
Quoi qu'il en soit, la position de Jünger complète la pensée de Heidegger. Nous avons dit, en début d'exposé, que le nihilisme était une attitude de l'individu: en effet, toute question métaphysique ne concerne que chaque individu personnellement. Aucun ordre socio-politique ne peut changer quoi que ce soit au fait que chacun d'entre nous soit exposé aux dangers du monde, soit soumis à l'angoisse que cette exposition, cette Ausgesetzheit, suscite. Voilà pourquoi cela ne fait pas une grosse différence —à ce sujet Jünger et Heidegger sont d'accord— si le nihilisme se présente à nous sous la forme ou l'expression d'une dictature fasciste, ou sous celle d'un socialisme réel ou d'une démocratie de masse. Dans de tels contextes, la démarche de Heidegger a été la suivante: Heidegger a travaillé sur l'isolement de l'homme avec une précision jusqu'alors inégalée, en utilisant tout spécialement les ressorts de la critique du langage; ensuite, sa philosophie a constitué une tentative de transposer l'angoissante dépendance du moi, soi-disant “libre”, dans une sorte de “sécurité” (Geborgenheit), site d'apaisement des tensions, site de sérénité, où s'épanouit enfin la vraie liberté. En opérant ce retournement, il nous semble, que Heidegger perçoit l'homme comme sur le point de disparaître, écrasé sous le poids d'un sombre destin planétaire, et donne l'impression de devenir fataliste.
Mais cela, Heidegger ne l'a pas voulu, et ne l'a pas dit de cette façon. Et c'est pourquoi, nous apprécions ce discours post-idéaliste de Jünger insistant sur la “force chevaleresque de l'individu”, sur sa “décision” et sur la volonté de l'homme libre de se maintenir envers et contre tout. Car si le moi n'est même plus autorisé à formuler des projets, il est contraint de résister à son propre “empêtrement”, résistance qui, seule, appelera le démarrage d'un nouveau mouvement historique.
“Le poète et le penseur habitent des sommets voisins”, a dit un jour Heidegger. Leurs demeures sont haut perchées mais séparées par un gouffre. C'est bien ce que nous avons pu constater en comparant les positions de Jünger et de Heidegger. Mais ne se pourrait-il pas que ce soit précisément ce gouffre qui fait tout l'intérêt de la rencontre Jünger/Heidegger. l'on délibère, dit Jünger dans Le recours aux forêts, un ouvrage très proche d'Über die Linie, .
Dr. Angelika WILLIG.
(article paru dans Junge Freiheit, n°12/1995; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:09 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, ernst jünger, heidegger, métaphysique, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 décembre 2009
L'insolente Cioran
 L'insolente Cioran
L'insolente Cioran
A sei anni dalla scomparsa di questo affascinante esponente della cultura europea del Novecento, arrivano nelle librerie italiane i Quaderni 1957 - 1972. L’opera raccoglie il prezioso contenuto di trentaquattro taccuini, ritrovati dopo la sua morte, ora pubblicati da Adelphi in un ponderoso tomo di oltre mille pagine, per la delizia di noi lettori. Si tratta degli appunti più intimi di uno sferzante fustigatore della modernità, «scettico di servizio in un mondo alla fine», scritti nel lungo arco di tempo che va dal giugno 1957 al novembre 1972. Vi si trovano, tenuti insieme da una scrittura iperbolica e densa di suggestioni incantatrici, riflessioni, sentenze fulminanti, ritratti strabilianti, descrizioni minuziose di significativi episodi vissuti, aneddoti e paradossi. Soprattutto emerge, tra le righe, l’animo inquieto di un artista affamato d’assoluto, di uno spirito religioso senza religione, di uno scrittore lucido e delirante al tempo stesso, che per la sua natura contraddittoria sfugge ad ogni classificazione, tanto da definirsi egli stesso un «idolatra del dubbio, un dubitatore in ebollizione, un dubitatore in trance, un fanatico senza culto, un eroe dell’ondeggiamento».
Francese d’adozione, Cioran rimane uno scrittore di stirpe rumena e sentimenti balcanici. Nasce a Rasinari (Sibiu) in Transilvania l’8 aprile del 1911 e i Carpazi sono i compagni della sua adolescenza. Rimane sempre legato alla «madre patria immersa nella bruma» anche quando nel 1937 decide di lasciare l’insegnamento nei licei e accettare una borsa di studio a Parigi, «piccola Bucarest […] la sola città del mondo dove si poteva essere poveri senza vergogna, senza complicazioni, senza drammi, la città ideale per essere un fallito». Ed infatti la sua vita parigina è caratterizzata da quel modus vivendi studentesco che Robert Brasillach definiva «l’eminente dignità del provvisorio», ben descritto da Mario Bernardi Guardi nella monografia che il mensile Diorama Letterario ha dedicato nel maggio 1991 (n.148) a Cioran, profeta della decadenza: «Provinciale d’ingegno e studente ribaldo, legge e scrive, ma va anche in giro in bicicletta per i Pirenei e la Bretagna. E vive, fino a quarant’anni, da avventuroso adolescente: ha in tasca pochi soldi, dorme negli ostelli, abita nelle soffitte, alloggia negli albergucci, mangia alla mensa universitaria».
Con sofferenza matura la decisione di rinunciare alla sua lingua d’origine per scrivere in francese. «Ho scritto in rumeno fino al ’47. Quell’anno mi trovavo in una casetta a Dieppe, e traducevo Mallarmé in rumeno. Di colpo, mi son detto: Che assurdità! Che senso ha tradurre Mallarmé in una lingua che nessuno conosce? Allora ho rinunciato alla mia lingua. Mi sono messo a scrivere in francese, ed è stato difficilissimo, perché, per temperamento, la lingua francese non mi si addice. Io ho bisogno di una lingua selvaggia, di una lingua da ubriaco. Il francese è stato per me una camicia di forza».
Sono invece in rumeno, questa «mistura di slavo e latino, idioma privo di eleganza ma poetico», le sue opere giovanili. A soli ventitre anni scrive un saggio di «sfida al mondo», Al culmine della disperazione (Adelphi 1998), che riscuote un certo successo e viene premiato.
Nel 1937 pubblica Ascesa della Romania. Vi si scorge un Cioran ancora attento all’attualità politico culturale, persino interventista nel dibattito del suo paese: «Nessuno può dirsi nazionalista se non soffre infinitamente del fatto che la Romania non possiede la missione storica di una grande cultura e che un imperialismo culturale e politico come quello delle grandi nazioni non possa appartenerle; non è nazionalista chi non può credere con fanatismo alla repentina sublimazione della nostra storia». Nello stesso periodo scrive: «La cultura rumena vive attualmente il suo momento decisivo: abbandonare dietro di sé la tragedia di una cultura su piccola scala e, attraverso le sue imprese in materia di teorie, d’arte, di politica e di spiritualità, compiere un destino specificamente aggressivo da grande cultura. Lo sforzo dei rumeni deve dunque mirare a strappare il loro paese dalla periferia della storia per condurlo sul proscenio…».
Insieme a numerose personalità della cultura, come lo storico delle religioni Mircea Eliade, si schiera a fianco della Legione dell’Arcangelo Michele. E’ una stagione brevissima, prevale presto lo scetticismo e la sfiducia in ogni rivoluzione. Anni dopo scriverà: «Ogni progetto è una forma di schiavitù». E anche: «Mi basta sentire qualcuno parlare sinceramente di ideale, di avvenire, di filosofia, sentirlo dire noi con tono risoluto, invocare gli altri e ritenersene l’interprete, perché io lo consideri mio nemico».
Prima di partire per la Francia pubblica a sue spese Lacrime e Santi (Adelphi 1990) e qualche anno dopo il suo ultimo libro in lingua rumena, Il tramonto dei pensieri. Si appassiona a Shakespeare e Baudelaire, a Dostoevskij, agli antichi gnostici, a Buddha e Pascal.
Lo influenzano soprattutto Spengler e Schopenhauer, suo «grande Patrono, boicottato dalla tromba degli utopisti, senza parlare di quella dei filosofi» e Nietzsche. Sono in molti a paragonarlo al grande tedesco, dal filosofo spagnolo Fernando Savater, allievo ed amico di Cioran nonché traduttore delle sue opere e autore della biografia Cioran, un angelo sterminatore (Frassinetti 1998), a Jean François Revel che lo definisce «il solo rappresentante letterariamente riuscito dell’arte dell’aforisma dopo Nietzsche».
Termina presto l’idillio con la filosofia, («ha vinto l’incantesimo della filosofia», scrisse Alain De Benoist), che abbandona per abbracciare «l’esperienza, le cose vissute, la follia quotidiana». Preferisce finire «prima in una fogna che su un piedistallo». Detesta la pedanteria dei filosofi, piuttosto che sposare dogmi vuole demolirne. Ritiene l’erudizione un pericolo mortale per l’umanità. «Il sapere […] ci condurrà inesorabilmente alla rovina», avverte.
Soprattutto Cioran non vuole rinunciare al suo «dilettantismo»: «Se fossi costretto a rinunciarvi è nell’urlo che vorrei specializzarmi». Le sue opere, in effetti, gridano, nell’intento di svegliare le coscienze dal torpore morale: «scuotendole, le preservo dallo snervamento in cui le sommerge il conformismo». In esse vibra un’energia baldanzosa e vitale che stride, solo apparentemente, con la sfiducia di Cioran.
La sua critica pungente si rivolge all’uomo contemporaneo, capace solo di «secernere disastro», alla ragione, «la ruggine della nostra civiltà», alla storia, «indecente miscela di banalità e apocalisse», al progresso, «l’ingiustizia che ogni generazione commette nei confronti di quella che l’ha preceduta» e al colonialismo occidentale nel Terzo Mondo, «l’interesse degli uomini civili per i popoli che vengono chiamati arretrati è molto sospetto, incapace di sopportarsi ancora, l’uomo civilizzato scarica su questi popoli l’eccedenza dei mali che lo opprimono, li incita a condividere le proprie miserie, li scongiura di affrontare un destino che ormai non può più affrontare da solo».
Eppure, pur esprimendo un inconfutabile pessimismo, Cioran non può essere ritenuto semplicisticamente un nichilista. Non si limita ad annunciare la catastrofica fine dell’occidente, ma invita tutti ad una vera e propria rivolta morale. Come ha scritto Bernardi Guardi il suo è comunque un messaggio positivo: «C’è da indietreggiare davanti a tanta copia d’angoscia. Eppure l’umor nero di Cioran, mettendoci in guardia contro tutto, paradossalmente ci insegna a riscoprire tutto, a fare carne e sangue di ogni esperienza, prima fra tutte quella del dolore, della religione, della morte».
C’è in lui, infatti, una robusta vena di sensibilità sociale, scevra di ogni forma di retorica, scarna e proprio per questo più sincera. E’ singolare come tale sentimento conviva con l’aristocratico distacco rispetto alle sorti del mondo che caratterizza questo autore solitario e metafisico.
La sua insofferente misantropia lo porta a scrivere feroci battute come queste: «appena si esce nella strada, alla vista della gente, sterminio è la prima parola che viene in mente […] quando passo giorni e giorni in mezzo a testi in cui si tratta unicamente di serenità, di contemplazione, di spoliazione, mi viene voglia di uscire per la strada e spaccare il muso al primo che incontro». La tolleranza diventa «una civetteria da agonizzanti». Malgrado affermazioni così temerarie Cioran non ha dubbi: «Ci si deve schierare con gli oppressi in ogni circostanza, anche quando hanno torto, senza tuttavia dimenticare che sono impastati con lo stesso fango dei loro oppressori». L’auspicio è quello di un mondo liberato dal lavoro, dove la gente possa «uscire in strada e non fare più nulla. Tutta questa gente abbrutita, che sgobba senza sapere perché, o si illude di contribuire al bene dell’umanità, che fatica per le generazioni future sotto l’impulso della più sinistra delle illusioni, si vendicherebbe allora di tutta la mediocrità di una vita vana e sterile, di tutto questo spreco di energia privo dell’eccellenza delle grandi trasfigurazione».
Per Cioran la scrittura non è un mestiere, ma un atto liberatorio. Si domanda: «Cosa sarei diventato senza la facoltà di riempire delle pagine. Scrivere significa distrarsi dei propri rimorsi e dei propri rancori, vomitare i propri segreti. Lo scrittore è uno squilibrato che si serve di quelle finzioni che sono le parole per guarirsi». Chiamato in numerose università a tenere dei corsi, rifiuta asserendo che ne è incapace, perché «ogni idea mi ripugna nel giro di un quarto d’ora».
In Italia, negli anni del più ortodosso fondamentalismo marxista, i suoi libri sono stati a lungo ignorati, in quanto ritenuti politicamente scorretti. Solo le edizioni del Borghese dettero alla luce due sue opere, Storia e Utopia (1969) e I nuovi Dei (1971), libro, quest’ultimo, ristampato successivamente anche dall’editore Ciarrapico nella bella collana de I classici della controinformazione, diretta da Marcello Veneziani.
Solo diverso tempo dopo ed in Italia soprattutto grazie ad Adelphi, che ne ha tradotto, nel corso degli ultimi quindici anni, quasi tutta l’opera, il grande pubblico ha potuto godere di buona parte dei suoi scritti, tra i quali la stessa Storia e Utopia (ovviamente trascurando di fare riferimenti alle precedenti edizioni), Il funesto demiurgo, L’inconveniente di essere nati, La caduta nel tempo, La tentazione di esistere, Sommario di decomposizione, Sillogismi dell’amarezza, Squartamento e Esercizi di ammirazione.
In questo libro, in particolare, conosciamo un Cioran anomalo, non più sarcastico ma, al contrario, persino generoso nel giudicare alcuni personaggi della cultura suoi contemporanei, tra i quali gli amati Eliade, Borges e De Maistre.
Sul futuro delle sue opere Cioran ha dichiarato: «Il destino dei miei libri mi lascia indifferente. Credo però che qualcuna delle mie insolenze resterà». Noi invece siamo convinti che la sua opera rimarrà di assoluta attualità, così come la sua figura di provocatore “insolente”.
A tal proposito la definizione che Cioran ha dato del grande pensatore reazionario Joseph de Maistre, è per noi, lettori devoti, la più adatta a descrivere proprio il grande rumeno: «Senza le sue contraddizioni, senza i malintesi che, per istinto o calcolo, alimentò sul proprio conto, il suo caso sarebbe stato liquidato da tempo, ed oggi soffrirebbe la disgrazia di essere capito, la peggiore che possa abbattersi su un autore».
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, roumanie, france, lettres roumaines, littérature roumaine, lettres françaises, littérature française, lettres, littérature, pessimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 décembre 2009
Abel Posse y la policia del pensamiento

Abel Posse y la policía del pensamiento
Alberto Buela (*)
El nombramiento de Abelardo Parentini, alias Abel Posse, como ministro de educación de la ciudad de Buenos Aires puso en funcionamiento una vez más a la policía del pensamiento de lo política y culturalmente correcto.
Saltaron como leche hervida en primer lugar el jefe del gabinete nacional, equivalente al primer ministro en Europa, quien en el mayor diario de la clase media argentina, La Nación, escribió: Posse miente y lo hace adrede. Tergiversa, oculta, engaña. Con lenguaje pomposo y edulcorado, intenta una y otra vez la prédica autoritaria”(11-12-09). También el senador de la ciudad de Buenos Aires por “la colectividad”, Daniel Firmus, como un nuevo Catón afirmó: Su trayectoria en defensa de la dictadura militar, sus declaraciones contra los derechos humanos y su intolerancia con los docentes. lo hace inepto para el cargo. El ignoto ministro de educación de la Nación, un tal Sileoni(en dos años nunca apareció su nombre en los diarios) afirmó: tiene un pensamiento anacrónico situado a la derecha. Claudio Pressman, legislador radical dijo: es un apologista de la dictadura militar. Finalmente los gremios, no los dieciséis de educadores que hay en la Capital Federal pero sí tres o cuatro afirman: que no puede ser ministro de educación quien llama cobardes a los que defienden la educación. Nenna, ahora legislador de la ciudad y antes sindicalista de Ctera afirmó: Fue funcionario de la dictadura militar. A partir de estas acusaciones los medios de comunicación se sumaron a la intriga, preguntándole al propio interesado como era su relación con la Dictadura militar y cosas por el estilo. Y si bien no quedó ninguna acusación pendiente, Posse tuvo que responder y eso ya es grave, porque tuvo que responder por lo que no es. Y este es el mecanismo perverso de la policía del pensamiento: Nos obliga a responder por lo que no somos.
De estas reacciones algunas más virulentas que otras podemos sumar una veintena más. Pero para muestra alcanza con este botón.
Cualquier persona con dos dedos de frente no puede creer ni de lejos lo que se dice de Posse. Estas son mentiras a designio, como confesó Sarmiento cuando escribió el Facundo contra Rosas.
Es que Posse es un escritor y ensayista reconocido como brillante, por amigos y enemigos, tanto en nuestro medio como en el exterior, y además él por sí es un representante genuino de aquello que se llamó en el siglo XVIII, la República de las Letras, hombres que tenían trompada libre para decir lo que querían sin ser molestados por el poder.
A Posse, hablando en criollo, no se le pueden tocar el culo ni con una caña y no es un estulto para cometer los errores y deslices como dicen que cometió. El tema es que Posse piensa distinto, diferente a lo que piensan los ideólogos de la educación (la FLACSO e tutti li quanti) quienes son los grandes responsables desde la restauración democrática (1983) para acá del fracaso más absoluto y rotundo en la educación de los niños y jóvenes de Argentina.[1]
El es un pensador alternativo, no conformista que encuentra las razones de las sinrazones que pasan desapercibidas para la mayoría de los llamados intelectuales.
Los policías del pensamiento son antes que nada pseudos intelectuales orgánicos del sistema democrático de partidos, de la denominada partidocracia. Último eslabón en la decadencia democrática. Su reacción es siempre producto de la defensa de sus intereses económicos y profesionales, nunca el bien común y ni por asomo el bien del otro, del próximo, del prójimo, de conciudadano, del vecino.
Los policías del pensamiento reaccionan demonizando de oficio a todo aquel que ose inmiscuirse en algunos de los ámbitos de sus intereses profesionales. En el caso de la educación la policía del pensamiento funciona de una manera solidaria, monolítica y completa.
Solidaria porque convergen ante una irrupción como la de Posse (un pato en el gallinero diría Castellani) sin distinción de banderías políticas, de liberales a marxistas. Monolítica porque lo hacen desde los gremios de ordenanzas hasta el de los investigadores y completa porque lo agraden a quien irrumpió por todos los costados, aspectos y matices de su personalidad y de su historia personal y profesional, hasta destruirlo por completo.
Este tarea de demolición de los policías del pensamiento nunca deja heridos siempre muertos, obviamente muertos intelectuales, que sino los pueden matar, los corrompen.
El caso emblemático de funcionamiento de la policía del pensamiento dentro de la educación argentina fue el de Osvaldo Magnasco(1864-1920) ministro de educación de Roca y creador del proyecto de enseñanza secundaria en la Argentina moderna, a quien el diario La Nación le negó hasta su aviso fúnebre porque tuvo la osadía de confrontar intelectualmente con Mitre con motivo de su traducción de la Divina Comedia. [2] Su figura ha sido silenciada hasta nuestros días.
Hace un par de años la CGT me propuso en forma manuscrita y con la firma del secretario general para ser director de la Biblioteca Nacional, al mencionarlo públicamente el secretario de cultura Di Tella, fueron, al otro día, miembros de “la colectividad” a decirle a Moyano que yo no era peronista sino de extrema derecha. Un día después el director nacional de música, también paisano, me llamó para decirme que si bajaba las pretensiones podían ubicarme en otro cargo, pues el de director ya estaba, por ellos, pensado para otro.
Quiere decir que si les permitía actuar a piacere y hacer sus planes dejaba de ser de extrema derecha para volver a ser peronista, y además rentado.
Así actúa la policía del pensamiento.
Hace tres meses lo echaron al excelente y honesto profesor Moreno como director del Archivo Nacional porque se negó a firmar un crédito para poder decidir sin trabas por 21 millones de pesos cuando con un poco más de 100.000 dólares se arreglaba el problema del Archivo. Claro está, los policías del pensamiento siempre tienen funcionarios ejecutores a mano como en este caso el Secretario de Interior Marcio Barbosa o el mismo ministro conocido desde hace años como “el valijero de Mércuri”, quienes prontamente liquidan al disidente (y a mi que lo defendì).
También así actúa la policía del pensamiento.
Ante la policía del pensamiento la mejor defensa es llevar a cabo políticas públicas abiertas y transparentes, pues la claridad, la luz, la transparencia, la honestidad son la mejor defensa ante el juego de las logias y los poderes indirectos a los que sirve la policía del pensamiento, pues estos poderes actúan de forma tal que la decisión se toma antes que la deliberación, y es por ello que los ideólogos de la educación tienen como metodología la realización de congresos donde se lleva a cabo la parodia de la deliberación, el simulacro de deliberar, pues en dichos congresos siempre las decisiones se toman antes.
Repetimos, la única posibilidad de desarmar este mecanismo perverso es actuar públicamente con claridad de pensamiento y acción, pues a la mentira sistemática solo la verdad dicha en forma clara y precisa se opone.
(*) arkegueta, aprendiz constante, mejor que filósofo
[1] Los integrantes del grupo "Bremen" que tenemos 49 años en el sistema educativo, conocemos a esos paladines del "relativismo vacío", que vaciaron de contenidos a la educación, que alguna vez fue orgullo y ejemplo para el mundo.(Jorge Jurado, educador)
“Comparto plenamente las aseveraciones sobre la mafia educativa de los alcahuetes de la pedagogía vernácula, conducidas desde ese antro que es la Flacso. Podemos citar muchos nombres de esa entente, como ser: Filmus, Sileoni, Oporto, Tedesco, Puiggros, etc. Que desde 1984 hasta la fecha vienen destruyendo la educación copiando y mal, ideas desdeñadas en otras regiones del orbe, chupándole las medias a cuanto organismo internacional sugiere fórmulas para mejorar la educación”.(Ricardo Micheli, educador)
[2] Se sabe que Mitre no era descendiente de italianos sino de macedonios, mitrovski era su apellido, que nació en Montevideo y su padre no hablaba una sola palabra en italiano y muy mal es castellano. De modo que su traducción es ad sensu. Al respecto existe una anécdota que dice que en una ocasión la va a visitar Lucio V. Mansilla, quien le pregunta: ¿qué está haciendo General?. Ya lo ve m´hijo, he dejado la espada y he tomado la pluma para traducir la Divina Comedia del Dante. A lo que respondió el chispeante Masilla: Hace muy bien General, hay que joderlos a estos gringos.
00:22 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : argentine, amérique latine, amérique du sud, pensée politique, police de la pensée, manipulations médiatiques, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 décembre 2009
Citation de Claude Lévy-Strauss
Claude Levi-Strauss, prophète identitaire et visionnaire
|
« Les Mbaya étaient divisés en trois castes ; chacune était dominée par des préoccupations d’étiquette. Pour les nobles et jusqu’à un certain degré pour les guerriers, le problème essentiel était celui du prestige. Les descriptions anciennes nous les montrent paralysés par le souci de garder la face, de ne pas déroger et surtout de ne pas se mésallier. Une telle société se trouvait donc menacée par la ségrégation. Soit par volonté, soit par nécessité, chaque caste tendait à se replier sur elle-même aux dépens de la cohésion du corps social tout entier. En particulier, l’endogamie des castes et la multiplication des nuances de la hiérarchie devaient compromettre les possibilités d’unions conformes aux nécessités concrètes de la vie collective. Ainsi, seulement s’explique le paradoxe d’une société rétive à la procréation, qui, pour se protéger des risques de la mésalliance interne, en vient à pratiquer ce racisme à l’envers que constitue l’adoption systématique d’ennemis ou d’étrangers ».
Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris : Plon, p.224. |
00:25 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sociologie, ethnologie, anthropologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Guillaume Faye: Pour en finir avec le nihilisme
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES
Guillaume FAYE:
POUR EN FINIR AVEC LE NIHILISME
I. METTRE LA PENSÉE EN ROUTE
Pour bon nombre de ses commentateurs, à l'exception notable de Jean-Michel Pahnier (1), Heidegger fut un métaphysicien donc l'ouvrage essentiel, Sein und Zeit (traduit en français par L'être et le temps), aurait tenté, en construisant une “phénoménologie de 1'òntologie” (2), de réfuter la tradition métaphysique par le langage métaphysique lui-mente et, partant, ne se serait pas exclu lui-même de la métaphysique. Dernier métaphysicien peut-être, mais métaphysicien quand même. Henri Arvon, de son été, écrit: “Le premier souci de Heidegger est moins l'établissement d'une ontologie formelle et matérielle que l'élaboration d'une ontologie fondamentale qui, à travers l'existence humaine, cherche à percer jusqu'à l'étre”. Il ajoute: “L'édifice doctrinal qu'il élève (..) constante une réponse de portée exceptionnelle à l'appréhension d'une époque éprise de rigueur scientifique qui, désespérée de voir s'estomper l'être, voudrait ramener celui-ci en pleine lumière” (3). Ce langage, en apparente si obscur, n'a certes pas servi Heidegger dans les milieux positivistes et rationalistes, qui ne voient en lui qu'un philosophe abscons ou, dans le meilleur des cas, un poète...
En fait, il semble bien qu'il y avait plusieurs lectures possibles de Heidegger. Dans Sein und Zeit, ouvrage où culmine la première étape de sa pensée, Heidegger nous dévoile les clés de son vocabulaire et l'orientation de sa réflexion. Mais, on le sait, celle étape a été suivie d'une seconde, à la suite d'un célèbre “tournant” (Kehre), qui a commencé de se manifester dans le courant des années trente. Notre lecture sera surtout rentrée sur ce “second” Heidegger, dont les préoccupations apparaissent dans tonte leur ampleur avec les écrits sur Hölderlin et sur Nietzsche. Toutefois, celle lecture ne sera pas purement “philosophique” - au sens classique de ce terme -, tant les horizons que nous dévoile Heidegger en appellent à tous les aspects de la vie et, mieux encore, à ce qu'il conviens de nommer notre destin. Heidegger, plus précisément, sera considéré par nous comme le penseur de la modernité. L'auteur des Holzwege s'est en effet attaché à penser l'essence des temps modernes, en partant du mot de Nietzsche: “Dieu est mort”. Or, la mort de Dieu, c'est la mort des valeurs. En sorte que l'on peut avancer que Heidegger termine la pensée métaphysique. La portée fondamentale de son oeuvre vient, en partie au moins, de ce qu'au XXème siècle, il a été le seul à poser et à répondre à la question capitale : “Quelle est l'essence des temps modernes?” (4). Qu'est-ce en effet que la “modernité”? D'où venons-nous? Que sommes nous advenus? Où pouvons-nous aller, nous, hommes et peuples du XXème siècle ? Telle nous semble être la problématique centrale posée par le “penseur-bûcheron”. Elle sente nous éclaire et nous permet d'expliquer quelques uns de ses thèmes et de ses idées que l'hypothèse métaphysique masque complètement.
Dans cette perspective, L'être et le temps, publié en 1927, ne constitue pas un ouvrage centrai ni définitif, mais un travail préliminaire, nécessaire à la compréhension de la suite de ouvre, une sorte de bilan introductif méthodologique à un “message” qui n'existait encore qu'à l'état de projet et de virtualité en 1927, alors que Heidegger n'avait que trente-neuf ans. En d'autres termes, L'être et le temps forme, non pas une somme de “phénoménologie existentielle”, somme 1'Université l'enseigne encore trop souvent (5), mais un exposé de concepts, de modes de pensée et d'un langage, qui ne prendront tout leur sens et leur portée qu'avec les ouvrages essentielles que sont, de notre point de vue, et dans un ordre d'importante croissante, les deux volumes consacrés à Nietzsche, publiés en 1961, le recueil intitulé Holzwege (“sentes de bûcheron”, traduit en français, en 1962, sous le titre Chemins qui ne mènent nulle part), paru en 1950, les textes divers, établis à partir de cours et de conférence, rassemblés en 1954 sous le titre Vorträge und Aufsätze (traduction en 1958, dans le volume Essais et conférences), enfin Die Frage nach der Technik, publié en 1962.
Dans L'être et le temps, livre qui fit grand bruit à l'époque, Heidegger pose les fondements de son langage et établit son champ conceptuel, les deux ne faisant d'ailleurs qu'un et constituant les deux faces d'un même outil intellectuel. Pour Heidegger, la pensée et le langage existent en effet en symbiose: qui saisit la clé de la langue peut de ce fait pénétrer dans son content ; la forme est déjà le fond. L'être et le temps nous initie dans au style heideggérien, qui se caractérise par trois traits principaux: le recours au langage poétique, l'utilisation de la philologie et de l'étymologie grecque, et le retour (le “retournement”, comme un laboureur retourne sa terre et de ce fait la redécouvre et la rend plus féconde) au sens originel de la langue allemande. Torturant, questionnant les mots, Heidegger s'offre comme un poète, dans l'acception hellénique du terme, c'est-à-dire comme un créateur de formes. L'effet de surprise et d'illumination, né du choc de ce langage étymologique” germano-grec et d'un style d'une modernité sans réserve, ne doit rien à une gratuité d'esthète: la langue heideggérienne est belle parce que dense; elle est signifiante parce que poétique, c'est-à-dire créatrice (6). Heidegger est de ceux qui, au détour d'un raisonnement difficile, l'interrompt pour l'illuminer d'une phrase telle que celle-ci: “Debout sur le roc, l'œuvre qu'est le tempe ouvre un monde et, en même temps, le réinstalle sur la terre qui, alors seulement, fait apparition comme le sol natal” (Chemins qui ne mènent nulle part, op. cit., p. 32). Voilà donc ce à quel nous accoutume L'être et le temps: à une parole aristocratique, qui ne se contente pas de nous expliquer une idée par la raison intellectuelle (Geist), mais entend nous la faine éprouver par la sensibilité poétique (Seele).
Le recours à l'étymologie indo-européenne, actualisée dans les langues grecque et allemande, n'est pas neutre: cette méthode renvoie à la volonté de Heidegger de réenraciner l'histoire moderne dans l'aurore grecque. Le verbe heideggérien, expérimenté dans L'être et le temps, est censé provoquer un “choc culturel” dans le lecteur.
Heidegger entend renouer avec un style et, au-delà, avec une vue du monde qui formerait le prélude a une régénération, sous une autre forme, d'un mode d'être et de périr “grec”, c'est-à-dire non-socratique et a-chrétien. Après Nietzsche, Heidegger se pensait comme un Dichter (poète, “in-dicateur”), annonçant un monde à venir, un monde virtuel, qui renouerait, sous une nouvelle forme “historienne”, avec ce qui constitue, pour nous Européens, notte aube : la vue du monde grecque, aujourd'hui paradoxalement “présente mais tombée dans l'oubli”. La Dichtung (le dict, la parole) de Heidegger nous provoque (provocare, en latin, signifie “appeler”) à “sortir de I'oubli”, à faire ressurgir au niveau de l'autoconscience, une vue du monde que nous avons héritée des Anciens et à l'asseoir au sein même du monde moderne. De cette rencontre, “quelque chose” naîtra.
En dehors de la présentation de la “parole grecque”, L' être et le temps présente un corps conceptuel qui restera inchangé tout au long de I'œuvre du penseur, et qui nous indique quel sens il nous faudra donner - et ne pas donner - à la “question de l'être” (Seinsfrage), qui est l'un des thèmes centraux de la pensée heideggérìenne. L'être et le temps expose que cette “question” est demeurée dans 1'oubli, qu'elle est tombée en déchéance (Verfall) depuis l'aube grecque de la pensée occidentale. Toute la métaphysique occidentale depuis Platon, Plotin, Aristote et Thomas d'Aquin, a envisagé la “question de l'être” comme un acquis. Elle a cru que l'être existait “en soi” et a cherché à révéler set “être en soi” comme une essence absolue en partant, selon l'induction platonicienne, de ses modalités “inférieures”, c'est-à-dire de l'étant. Ce faisant, l'étant, autrement dire le réel, demeure méconnu. “Il y a une invasion de l'étant non pensé en son essence”, écrit Heidegger. Le penseur se dégage ainsi de la vision du monde liée à la métaphysique monothéiste et impose une “anti-métaphysique” où la question de l'être est recentrée sur le Dasein, 1' “être-là” - renouant par là avec la conception des Grecs présocratiques pour qui, face au destin (Moïra), l'homme était la “loi du monde” (anthropos o nomos tou kosmou). Ainsi l'“oubli de l’être” est-il l'oubli de la réalité du monde, de “la différenciation ontologique, ce qui sépare l'étant de l'être”. La métaphysique platonicienne, puis chrétienne, est une “pensée déchue” qui se réfugie dans la philosophie des valeurs, qui élève une morale absolutiste, une idée au-dessus de l'être, autrement dit, qui dévalue la vie en “inventant”, au-dessus du réel, des catégories absolues, fallacieusement appelées “être”. Nietzsche, lui aussi, parte de la “séparation socratique de la pensée et de la vie”. Mais, grâce à la méthode phénoménologique, Heidegger va plus loin. Il démonte la mécanique de la métaphysique occidentale et prépare un dessein “scandaleux”, impensable pour l'humanisme traditionnel embué de “transcendantalisme moral”, consistant à valoriser le Dasein et à apporter de la spiritualité au sein de l'immanence du monde, selon le vieux projet inachevé du paganisme grec et présocratique.
L'être et le temps se contente donc de poser cette problématique. Nous voyons la preuve de la justesse de cette interprétation dans les explications fournies plus tard par Heidegger lui-même dans sa Lettre sur l’humanisme (op. cit.). Il nous semble donc impossible de ne voir, dans L'être et le temps, à l'instar d'Emmanuel Levinas (En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, 1949), qu'une continuation de la pensée de Husserl ou qu'une tentative de “retrouver l'être” et d'établir une “métaphysique épurée”, comme l'imagine en général la tradition universitaire française. (On n'encense d'ailleurs bien souvent, dans l'Université, œuvres de Heidegger que pour en occulter radicalement la signification).
Plus que Husserl, qui ne lui a fourni que des outils conceptuels, utilisés d'ailleurs au rebours des principes du vertueux phénoménologue, le vrai “maître” de Heidegger est Nietzsche. Heidegger s'impose, non comme le “disciple”, mais comme le continuateur de Nietzsche, ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de faire une critique, parfois vive, de la pensée de l'auteur du Zarathoustra. Heidegger, en fait, reprend la question des valeurs là où Nietzsche I'avait laissée, mais il la “traite” avec des outils plus raffinés, qui sont précisément ceux dont L’ être et le temps a jeté les bases. Désormais, on ne pourra plus lire Nietzsche sans recourir ensuite à Heidegger, ni entendre Heidegger sans s'être d'abord familiarisé avec le projet de l'homme de Síls-Maria. (Le philosophe néochrétien Maurice Clavel ne s'y était d'ailleurs pas trompé).
Deux oeuvres de Heidegger sont ici surtout concernées: le livre sur Nietzsche, déjà cité, et surtout l'essai intitulé Nietzsche Wort “Gott ist tot” (traduit sous le titre Le mort de Nietzsche: “Dieu est mort”) (7), texte étable après la seconde Guerre mondiale à partir du content des cours sur Nietzsche prononcés à l'université de Fribourgen-Brisgau entre 1936 et 1940.
Arrêtons-nous d'abord à une métaphore empruntée à l'introduction du recuiel intitulé Holzwege (op. cit.). Heidegger y écrit énigmatiquement: “... Dans la forêt, il y a des chemins qui, le plus souvent, se perdent soudain, recouverts d'herbes, dans le non-frayé. On les appelle Holzwege (8). Chacun suit son propre chemin, mais dans la même forêt. Souvent, il semble que l'un ressemble à l'autre. Mais ce n'est qu'une apparente. Bucherons et gardes s'y connaissent en chemins. Ils savent ce que veut dire s'engager sur un Holzweg”. En effet, ceux qui se soucient de la forêt, ceux qui 1'habitent, ceux qui ont rebours à elle, ne s'égarent pas quand ils empruntent un tel sentier; celui-ci les conduit tout droit au lieu de leur travail. Par contre, tous ceux à qui la forêt est étrangeté, tous ceux pour qui elle est un obstacle, les marchands, par exemple, qui doivent la contourner en allant de ville en ville, ceux-là craignent par-dessus tout de s'engager sur un Holzweg, où ils ne pourraient que s'égarer. Cette métaphore de la forêt nous semble essentielle pour comprendre le processus d'élaboration de la conception du monde inaugurée par Nietzsche, continuée par Heidegger, et toujours ouverte aujourd'hui du faire même de son inachèvement. Nietzsche, dirons-nous, est celui qui a compris que l'on ne doit ni contourner la forêt ni la traverser de part en part, mais au contraire s'y perdre par une sente de bûcheron, afin de s'y retrouver dans la clairière où s'accomplit le “travail”, Heidegger nous disant, lui, quel sentier prendre.
II. L'APOGÉE DU NIHILISME
« Dio è morto. Muette est devenue la confiance dans les lois éternelles des dieux. Les statues sont maintenant des cadavres dont l’âme s'est enfuie, les hymnes sont des morts que la fin a quittes » (Hegel, Phénoménologie de l'esprit).
D'après Heidegger, l'œuvre de Nietzsche clôt la métaphysique occidentale. Le mot fondamental de Nietzsche, "Dieu est mort", nomine la destinée de vingt siècles d'histoire occidentale. Cette destinée doit être interprétée somme la lente et inexorable montée du nihilisme, c'est-à-dire la mort de toute valeur. On petit discuter sur la question de savoir si Heidegger a eu ou non raison de voir en Nietzsche le dernier des métaphysiciens (9).
Mais ce qui importe, c'est de reconnaître que la lecture heideggérienne de Nietzsche, la reconnaissance de la signification historienne de son oeuvre, sont les seules possibles.
Dans Le gai savoir, au paragr. 125, intitulé “Le forcené”, Nietzsche signe l'un de ses textes les plus importants. Il y reconnaît, le premier, l'événement considérable qui termine un processus entamé avec Platon: le meurtre de Dieu. “Où est allé Dieu? Je vais vous le dire, hurle le forcené. Nous l'avons tué”. Il poursuit: “Ne sentons nous toujours rien de la décomposition divine? Car les dieux aussi se décomposent (...) Quels jeux sacrés nous faudra-t-il désormais inventer ? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux? (...) Il n'y eut jamais acte plus grandiose, et ceux qui pourront naître après nous appartiendront, à cause de cet acte, à une histoire plus élevée que ne le fut jamais tonte histoire”.
Nietzsche est ici l'annonciateur de cette autre histoire, qui peut s'interpréter comme la virtualité d'un surhumanité. Heidegger, lui, est le premier philosophe à pénétrer dans cette autre histoire, le premier, après la découverte du cadavre de Dieu, à en tirer les conséquences. “Je viens trop tôt, disait le forcené. Mon temps n'est pas encore advenu. Cet événement est encore en route. 11 n'est pas encore parvenu jusqu'aux oreilles des hommes”. La mort de Dieu doit ainsi se comprendre, non comme un “événement philosophique”, mais comme un phénomène historique qui pénètre l'ensemble des sociétés occidentales, un événement qui transformera la vie au sens le plus authentique du terme. La mort de Dieu, processus d'achèvement, d'arrivée à terme d'une vue du monde, doit s'interpréter comme “la fin du monde suprasensible, du domaine des idées et des idéaux”. Heidegger précise: “Depuis Platon, et plus exactement depuis l'interprétation hellénistique et chrétienne de la philosophie platonicienne, ce monde suprasensible est considéré comme le vrai monde, le monde proprement réel. Le monde sensible, au contraire, ne sera plus qu'un ici-bas, un monde changeant, donc purement apparent et irréel. L'ici-bas est une vallée de larmes. (...). Ainsi, le mot “Dieu est mort” signifie: le monde suprasensible est sans pouvoir efficient. Il ne prodigue aucune vie. La métaphysique, c'est-à-dire la philosophie occidentale comprise comme platonisme, est à son terme”.
La mort de Dieu désigne aussi l'impossibilité de croire aux idéaux absolus, que ceux-ci soient ou non liés à une “divinité”. Elle ne peut donc s'interpréter sous l'angle restreint d'un déclin des sentiments religieux. Elle sedia en fait la phase ultime du nihilisme. “Le nihilisme, le plus inquiétant de tous les hôtes, est devant la porte”, dit Heidegger. Le nihilisme marque la fin de la possibilité de toute valeur. L'humain est placé face au néant, privé “d'un monde suprasensible à pouvoir d'obligation”. “Le nihilisme est un mouvement historique. Il meut l'histoire à la manière d'un processus fondamental à peine reconnu dans la destinée des peuples d'Occident (...) Ni phénomène historique parmi d'autres, ni courant spirituel qui se rencontrerait à côté d'autres courants spirituels (...) le nihilisme est bien plutôt, pensé en son essence, le mouvement fondamental de l'histoire en Occident. Il manifeste une telle importance de profondeur que son déploiement ne saurait entraîner d’autre chose que des catastrophes mondiales. Le nihilisme est le mouvement universel des peuples de la terre engloutis dans la sphère de puissance des temps modernes (...) I1 appartient au caractère inquiétant de ce plus inquiétant des hôtes de ne pas pouvoir nommer sa propre origine (...) Il est la destination de notre propre histoire” (10). Heidegger reconnaît dans Nietzsche celui qui a mis au jour ce processus historique en acte depuis des millénaires: l'agonie des valeurs, la lente perte de sens des idéaux spirituels.
Il ne faut surtout pas croire, comme on l'enseigne dans nos facultés de philosophie, que Heidegger condamne le nihilisme. Heidegger semble au contraire se féliciter de cette remontre des temps modernes et du nihilisme, d'où seule pourra natter un nouveau projet. I1 accepte pleinement les temps modernes comme nihilistes: “Nietzsche se rend compte que, malgré la dévalorisation des plus hautes valeurs pour le monde, ce monde lui-même continue, et que, ainsi dépourvu de valeurs, il tend inévitablement à une nouvelle institution de valeurs (...) Pour fonder la nouvelle institution de valeurs en tant que mouvement contre les anciennes valeurs, Nietzsche donne également le nom de nihilisme (...) Ainsi, le terme de nihilisme désigne d'abord le processus de dévalorisation des anciennes valeurs, mais, en même temps aussi, le mouvement inconditionnel contre la dévalorisation (...) Nietzsche alors accepte le nihilisme et le professe comme inversion de la valeur de toutes les valeurs antérieures”. Nietzsche se place à la charnière de deux mouvements historiens, l'un en achèvement, l'autre virtuel. Il annonce l'apogée, donc le mouvement terminal du nihilisme, tandis que Heidegger, par son oeuvre, inaugure l'après-nihilisme.
Le nihilisme ne peut se limiter à l'affaissement de la foi chrétienne ou à la généralisation d'un vulgaire athéisme. Le christianisme lui-même, dans tonte l'explosion de sa foi triomphante, fut une phase du nihilisme. Ce dernier est l'engeance de la métaphysique platonicienne et chrétienne, où il résidait, virtuellement présent, dès sa fondation. Toute la métaphysique occidentale portait avec elle, sans s'en douter, le nihilisme. Ainsi, si l'opinion chrétienne (ou humaniste) ne prend pas conscience du nihilisme dont elle est porteuse - en tant que devenir (Werden) -, elle ne saisit pas non plus que ce principe nihiliste, qui constitue son essence, sera celui-là même qui permettra d'en finir avec la métaphysique chrétienne ou les valeurs athées de l'humanisme qui sont, au fond, une seul et même chose. Les “valeurs” christiano-platoniciennes, mortes-vivantes aujourd'hui, ont porte en élis leur propre principe de mort (11). Pourquoi ? Ecoutons la réponse de Heidegger: “Les valeurs suprêmes se dévalorisent déjà, dans la mesure où l'on commence à entrevoir que le monde idéal n'est guère susceptible d'être jamais réalisé dans le monde réel et sensible”. La conception du monde qui, en rupture avec l'aurore grecque, a séparé la pensée (noésis) de la nature vivante (physis), et celle-ci de l'action (poiésis), a virtuellement dévalorisé les principes qu'elle posait. Ces principes (Dieu, le Beau, le Vrai, le Bien), qui, de la théologie à l'humanisme socialiste, représentent des principes fixes et supérieurs, d'essence suprasensible, ont été depuis toujours condamnés à périr, dans la mesure même où ils se dé-réalisaient en se présentant comme des essences. Avec quelle jubilation, alors, ne doit-on pas constater ce mouvement historique du nihilisme, principe en acte contre lui-même, antidote posé par la vie contre la métaphysique et la morale qui, à leur insu, vont mourir de ce combat qu'elles ont voulu livrée contre le monde sensible! Ce monde sensible des passions et des guerres, ce “théâtre” de la “folie humaine” que Platon nous décrit comme une “caverne d'ombres” (aggalmata), finira par avoir raison des principes et des universaux, figés dans i'absolutisme de pseudo-valeurs qui n'ont pas su se conformer à la vie et qui, de ce fait, sont devenues, elles, des ombres.
Le nihilisme doit être ainsi considéré avec un sentiment à la fois triomphal et tragique. Il n'a rien d'une décadence. Il est la « loi même de notre histoire ». Même si nous savons que nous devons le dépasser, une telle entreprise surhumaniste a besoin que la mort de toutes les valeurs arrive à son terme. Heidegger s'engage déjà, en éclaireur - c'est-à-dire par la pensée, avant que n'advienne la phase “épochale” de l'action -, sur les sentes de l'après-nihilisme, alors que les temps modernes, toujours en apparence attachés aux principes traditionnels, accomplissent, dans les faits, la période ultime du nihilisme. Les principes et les valeurs, devenus résidus, sont bien morts puisqu'on n'y croit plus, mais personne n'ose encore aller enterrer le cadavre.
Heidegger s'oppose donc à l'humanisme traditionnel, non seulement sous la forme rationaliste et optimiste que les XVIIIème et XIXème siècles lui ont donnée, mais à jamais sous sa forme dogmatique d'affirmation de valeurs stabilisées. La norme des valeurs ne devrait pas relever d'une essence, mais de “l'inachèvement de l'existence humaine”, de son “dévoilement créateur”. C'est le Dasein humain qui doit se reconquérir comme mâitre des valeurs, indépendamment des “vérités” universelles exposées par les religions monothéistes et la métaphysique de Platon. A la suite de Nietzsche, Heidegger ne volt en fait, dans l'humanisme, que la présence d'une morale absolutiste où l'homme, pensé comme norme suprême, ne recèle aucune valeur mobilisatrice. Métaphysique déchue dans l'ici-bas, mais métaphysique tout de même, l'humanisme qui a cours en Europe depuis le XVIIIème siècle, avec sa cohorte de bons sentiments, marque le début de l'apogée du nihilisme. Cet humanisme, dit Heidegger, nous trompe, car il occulte le tragique de tonte existence; consolateur, il nie l'angoisse et, par la, rend impossible “le courage, l'audace et la lucidité”. “L'angoisse de l'audacieux, écrit Heidegger dans Qu'est-ce que la métaphysique?, ne souffre pas qu'on l'oppose à la joie, ni même à la jouissance facile d'une activité paisible”. Sentis un désirs d'éthique, issu d'une re-création volontaire de valeurs serait adapté à notre époque technique.
“L'homme de la technique, écrit Heidegger à Jean Beaufret, livré à l'être de masse (Massenwesen), ne peut plus être ramené à une continuité star et stable que s'il rassemble et coordonne la totalité de ses plans et de ses actes conformément aux exigences de cette technique”. Il faut rétablir un “tien éthique” entre l'aire humain pris dans son essence (Menschenwesen) et son monde, non plus selon des principes d'ordre universel et des absolus moraux, mais à partir d'une véritable “planification” de valeurs en rapport étroit avec le monde technique. Ces valeurs “éthiques” seront ouvertes, déplaçables, conformément aux qualités de l'existence humaine : l'inachèvement, qui caractérise le Dasein, et le dévoilement créateur de toute action, aujourd'hui porte par la technique.
“Comme Sein und Zeit s'élève contre l'humanisme, explique Heidegger, certains craignent que ce livre ne soit une défense de l'inhumain et une glorification de la brutalité barbare (...) Mais la pensée opposée aux valeurs n'affirme pas que toutes les valeurs habituellement professées comme telles, la “culture”, “l'art” (...) la “dignité humaine” et “Dieu” sont dépourvues de valeur. Il s'agit au contraire de comprendre enfin que c'est le faire même d'être qualifiées de valeurs qui dévalorise les objets de cette évaluation”. Autrement dit, en é-valuant les valeurs, on les ravale au rang de “logique”; on ne les vit plus. L'humanisme fait alors disparaître tonte valeur, selon un processus inauguré par les métaphysiciens: il proclame Dieu ou la dignité humaine comme valeur suprême incréé dans une hiérarchie rationnelle absolue, enferme l'humain dans un carcan et dévalorise tout sacré comme vécu. “Etre contre les valeurs, ajoute Heidegger, ne signifie pas être pour l'absence de valeurs et la nullité (Wertlosigkeit und Nichtigkeit) de l'étant, mais être contre la subjectivisation de l'étant qui ravale ce dernier au rang de single objet”.
Plutôt que de construire, par le logos, une morale reposant sur un systèm de valeurs comprises comme impératifs absolus, sans aucun “lien” avec l'“essence du monde”, il s'agit de planifier, d'organiser et de vivre une éthique volontariste. Le sacre et l'affectivité mobilisatrice du muyhos - opposée au logos des métaphysiciens - se retrouveront, parce que les valeurs implicites ne seront plus des mots, mais des comportements. Ceux-là devront s'enraciner dans un projet, en accord avec le monde et l'histoire. Un tel mouvement marquerait le passage de l'humanisme à ce que l'on pourrait qualifier de surhumanisme. Les valeurs seraient désormais vécues comme existence et non plus comme essence. Das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz, écrit Heidegger - phrase difficilement traduisible, car calquée sur le grue, mais que t'on peut rendre par “la spécificité fondamentale de l'être et du devenir humain, son essence, réside dans son existence” (12). Au plus profond de lui-même, l'humain est envol, transgression. L'homme est le transgresseur des normes: l'Existenz, ou, selon les conventions du traducteur, l'existence, traduit le concept latin exister, “vivre en se dégageant”. Les valeurs d'existence doivent être comprises, non plus comme des normes intellectuelles, mais comme des formes de vie (Lebensformen), jamais figées, perpétuellement évolutives, rigoureuses parce que volontairement instaurées et susceptibles à tout moment d'être dépassées. L'éthique de la transgression (de l'homme par lui-même) succède à la morale de la transcendance (de l'homme par des principes). Le terme nietzschéen de “surhurnanisme” peut alors se comprendre comme le moment “épochal” où l'homme se reconnaît, enfin, comme un transgressant. Et c'est dans cette perspective qu'il faut entendre le meurtre de Dieu, annoncé par le “forcené” du Gai savoir.
La mort de Dieu coïncide avec le “commencement du néant”, c'est-à-dire “l'absence d'un monde suprasensible à pouvoir d'obligation”. Partir Heidegger, l'autorité disparue de Dieu succède celle du rationalisme et de la morale. Mais ceux-qui ne savent donner de sens à 1'existence. Le christianisme, surtout dans sa version humaniste, dévoile alors - événement considérable - qu'il n'était qu'un athéisme déguisé. C'est le platonisme qui a fini par avoir .raison du sacré: en repoussant celui-ci hors de la nature, dans le lointain d'une métaphysique hautaine, il a épuisé ce sentiment de lien religieux que les peuples préechrétiens éprouvaient au contact du monde. “Le but d'une félicité éternelle dans l'au-delà, écrit Heidegger (13), se change en celui du bonheur pour tous, dans l’ici-bas”. Or, ce nihilisme recèle aussi la virtualité de son propre dépassement, puisque “1'acte créateur - autrefois, le propre du Dieu biblique -; devient la masque distinctive de l'activité humaine”. Ce ne fut pas le christianisme qui donna l'impulsion originelle au nihilisme: ce fut la vision du monde métaphysique platonicienne. Les historiens corroborent cette analyse: le platonisme constitua le “filtre” philosophique qui fit admettre un certain monothéisme biblique et conforma les structures mentales du christianisme occidental. “Le christianisme lui-même fut une conséquence et une forme du nihilisme”. Dans le christianisme, le suprasensible suit un processus de décomposition (Verwesung) et les “Idées, Dieu, l'Impératif Moral, le Progrès, le Bonheur pour tous, la Culture et la Civilisation perdent successivement leur pouvoir constructif pour tomber dans le nihilisme”. Le fait de poser ces valeurs en tant qu'abstractions, et le fait de poser Dieu comme valeur suprême les dévalorise déjà. Aussi, ne doit-on pas comprendre le nihilisme comme le résultat du seul monothéisme hébraïque (14), mais plutôt comme le refus de tout panthéisme manifesté par le platonisme comme par l’hébraïsme le sacré relégué loin du monde “naturel” et humain.
Heidegger essaie alors de répondre à la question de Nietzsche: quelles nouvelles tables de valeurs instituer? Mais avant de formuler une réponse, il lui a fallu préciser ce que nous devions entendre par cette tâche à entreprendre “1'inversion de la valeur de toutes les valeurs” (Umwertung aller Werte). Il ne s’agita pas en effet d'instituer de “nouvelles idoles”, de nouvelles valeurs abstraites. Le nihilisme actuel devra être accompli jusqu'à son terme pour que les nouvelles tables de valeurs naissent précisément là où les canons moraux contemporains voient le pire danger. Cette attitude est qualifiée par Nietzsche de pessimisme de la force. Nous entrons alors dans une période transitoire, ainsi décrite par Heidegger: “C'est le commencement d'une situation intermédiaire, où il devient manifeste que, d’une part, la réalisation des valeurs jusqu'ici reconnues comme suprêmes ne s'accomplit pas. Le monde semble dépourvu de toutes valeurs. D'autre part, cette prise de conscience dirige l'intelligente vers la source d'une nouvelle instauration de valeurs sans que, pour cela, le monde recouvre sa valeur”. Nous vivons ainsi dans l'interrègne, celui de la double conscience et de I'apogée du nihilisme les hommes de la première forme de conscience s'attachent toujours à leurs idéaux décomposés ; ceux de la sur conscience. héritiers lucides du nihilisme, annoncent une aube encore non advenue.
Cette aube sera-t-elle celle d'un nouveau dieu? L'originalité de Nietzsche est de répondre négativement. Dieu est mort: non seulement son trône est vide, mais l'idée même de trône est dévalorisée. Il ne s'agit pas tant de remplacer des valeurs que de trouver un autre lieu éthique où elles puissent s'exprimer. Ce lieu, on ne pourra le trouver que là où la métaphysique et la morale, là où le christianisme et l'humanisme voient une dévalorisation absolue. “Là”, c'est-à-dire au bout de ce que Nietzsche appelait le nihilisme complet, en ce lieu même où le néant est devenu absolu. Se contenter de “renouveler” les valeurs relève du nihilisme incomplet, ainsi comme par Heidegger: « Le nihilisme incomplet remplace les valeurs anciennes par des valeurs nouvelles, mais il continue à les placer au vieil endroit, qu'on réserve en quelque sorte comme région idéale du suprasensible. Un nihilisme complet, par contre, doit supprimer le lieu même des valeurs, le suprasensible en tant que région et, par conséquente, poser les valeurs autrement, c'est-à-dire inverser leur valeur », Ce nihilisme complet qui apparaîtra tel aux hommes de la conscience métaphysique et humaniste, sera déjà, pour ceux de la “sur conscience”, un anti-nihilisme. Ce qui, du point de vue de la première conscience, est néant, sera très exactement fondement de valeur pour la deuxième conscience. Mais où réside ce néant? Autrement dit, où résidera ce lieu de 1'inversion de la valeur des valeurs? Autrement dit encore, quel est le fondement du nouvel endroit des valeurs, qui est Aussi l'aboutissement du nihilisme complet? Répondre à cette question ne nous amènera pas non plus à parler de nouvelles valeurs. Lorsque, plus loin, nous les évoquerons, nous nous garderons de les nommer. Il s'agira bien plutôt d'inciter à les vivre, car, nous le verrons, ces valeurs-là ne sont pas intellectuellement nommables, puisqu'elles ne sont pas d'essence abstraites et suprasensibles.
Quel est donc l'endroit des nouvelles valeurs virtuelles? Avant de donner une réponse, il convient d'écouter la formulation que Heidegger a donné à cette question, non plus à la suite de Nietzsche, mais de Hölderlin.
Commentant l'hymne inachevé intitulé Mnémosyne, Heidegger en donne l'interprétation suivante dans Pour- Quoi des poètes ? “Long est le chemin de détresse de la nuit du monde. Celle-ci doit d'abord, longuement, accéder à son propre milieu”. (Cette nuit est celle de la progression historique du nihilisme). Il poursuit: “Au milieu de la nuit, la détresse du temps est la plus grande”. (Il s'agit de notre époque). “Alors l'époque indigente ne ressent même plus sa indigente”. (C'est là “l'oubli”, - (Vergessenheit) -, qui constitue la plus grande détresse de toutes les détresses). “La nuit du monde reste néanmoins à penser comme un destin qui nous advient endenté à du pessimisme et de l'optimisme, Peut-être la nuit du monde va-t-elle maintenant vers sa mi-nuit”. (C'est -a-dire vers le creux le plus profond, qui sera à la fois une cassure historique et un “départ”, - Aufbruch -, vers le post-nihilisme). “Peut-être cet âge va-t-il devenir pleinement temps de détresse”.
C’est donc à notre époque que se sine l'instant de la mi-nuit. De cet instant, s'il est reconnu, peut surgir la fondation de nouvelles valeurs. Hölderlin, comme Nietzsche, nous pose la question: où, à quelle croisée des chemins - pour reprendre le mythème de l'Oedipe de Sophocle à la poursuite de son destin -, en quel endroit historien de détresse absolue ou de nihilisme complet, trouverons-nous le chemin de la sortie? Où la nuit va-t-elle basculer vers le matin? Quelle est cette nuit du monde? La “minuit” recouvre ce que Nietzsche désigna pax fois, par antithèse, sous le nom de Grand Midi: la Volenté de puissance, et avec elle la Vie. Cette Vie qui cherchait précisément à fuir, au temps de sa jeunesse, de son non-accomplissement, le judéo-christianisrne. Cette vie, comme violente et comme volonté, qui explose dans les temps modernes : la non-valeur absolue, mais en mémé temps la table de nouvelles valeurs.
La métaphysique, anti-vitale sur le pian intellectuel, dès qu'elle posa des valeurs, fut soumise au devenir du vivant. Nietzsche et Heidegger comprennent ainsi ce processus de retournement dialectique: la métaphysique, bien que ses valeurs aient dévalorisé la Volonté de puissance et la vie, en constituait à sa insu une manifestation. Elle devait alors déboucher concrètement sur ce qu'elle refusait intellectuellement. La Volonté de puissance, comme nouvelle institution de valeurs, doit être comprise à la fois comme produit et comme inversion absolue de la métaphysique. Heidegger précise: “Le devenir, c'est, pour Nietzsche, la Volonté de puissance (...) qui est le trait fondamental de la vie (...) Le vivant se concentre en diverses formes, à chaque fois durables, de la Volonté de puissance”. Par suite, ces concentrations sont des “centrales de domination (...) La Volonté de puissance se dévoile comme ce qui pose des points de vue (...) Les valeurs sont les conditions de la Volonté de puissance, posées par la Volonté de puissance elle-même (...) La Volonté de puissance, en tant que principe reconnu est donc voulu, devient en même temps le principe d'une nouvelle institution de valeurs”. C'est la Volonté de puissance voulue, comme telle, conscience d'elle-même, qui constitue le nouveau fondement d'un mouvement historique de valorisation. Dans la mesure où cette Volonté de puissance coïncide avec le trait fondamental de la vie - le devenir risqué et changeant -, elle constitue pour la métaphysique un repoussoir intellectuel et correspond, dans la perspective christiano-humaniste, au néant. Cependant, cette même métaphysique, par sa recherche de valeurs essentialistes - indépassables et immuables - a charrié sans le vouloir la Volonté de Puissance, préparant inexorablement, selon ce processus du devenir vital qu'elle prétendait nier mais auquel elle se conformait, son destin, c'est-à-dire sa mort. La Volonté de puissance, ajouterons-nous, avant d'être voulue (condition pour de nouvelles tables de valeur), doit accéder à l'auto conscience. Or, nous le verrons plus loin, il ne suffit pas que la Volonté de puissance soit consciente pour qu'elle soit voulue. Depuis Heidegger, certains ont accédé à cette prise de conscience, mais ont reculé devant le stade du vouloir. Le chrétien, l'humaniste sincère, le socialiste moral, qui n'en sont qu'au “nihilisme incomplet”, n'ont pas atteint le niveau de conscience “historial” où ils reconnaîtraient la présence, en eux, comme dans les temps modernes sous une autre forme, de la Volonté de puissance.
Ainsi les anciennes valeurs manifestaient une Volonté de puissance inconsciente, qui les avait fondées, puis menées au nihilisme. Les “nouvelles institutions” de valeur seront radicalement autres, puisque, cette fois, elles procéderont d'une Volonté de puissance voulue et consciente. Cette nouvelle typologie de valeurs mènera-t-elle aussi à un nouveau nihilisme? C’est probable, et c'est ce qui fait la grandeur de l'Eternel retour de l'identique. Nietzsche et Heidegger, fidèles à la vue héraclitéenne du monde, ne prétendent pas se soustraire définitivement au nihilisme. Le devenir est perpétuel: après le nouveau “matin”, la conscience historiale trouvera le destin d'un autre “soir”, puis d'une nouvelle “nuit”. Mais nous ne pouvons en imaginer les modalités. Perpétuel est le processus de retournement dialectique (Umkehrung) des valeurs, non pas selon l'inapparente et peu paradoxale linéarité d'un cercle, mais à la manière inquiétante d'une spirale. (“Inquiétante”, car nous ne savons pas si la spirale est ascendante ou plongeante) (15).
Inquiétant aussi est le fondement voulu des nouvelles valeurs: la Volonté de puissance. Comme la Vie, elle s'ordonne constamment vers plus de puissance. Rien ne limite sa tension vers l'auto-croissance. Comme Oedipe, elle ira jusqu'au bout du destin. “Elle est ordre, écrit Heidegger, et, en tant qu'ordre, se donne le plein pouvoir pour dépasser dans la puissance tout niveau de puissance atteint (...) La Volonté de puissance est l'essence de la puissance (...) et l'essence de la Volonté de puissance est, en tant qu'essence de la volonté, le trait fondamental de l'ensemble du réel (...) La Volonté de puissance n'a pas sa fondement dans la sensation d'un manque: elle est elle-même le fondement de la vie la plus riche”.
La question qui se pose aux temps modernes, dès qu'une telle volonté est “historiquement” reconnue somme telle, est de savoir où elle réside. Où trouver cette Volonté de puissance qui marquera l'achèvement de la métaphysique, fondera une typologie de valeurs absolument contraire à celles de I'humanisme contemporain et sera, à ce titre, porteuse de sens? La réponse est simple. Ce sera là où réside le plus haut nihilisme, où la valorisation intellectuelle et métaphysique du monde a été poussée jusqu'à son terme, non seulement jusqu'a le nommer, mais jusqu'a se donner la possibilité de le détruire et de le métamorphoser matériellement: dans le règne scientifique de la puissance technique.
III. A LA RECHERCHE DE L'ESSENCE DE LA TECHNIQUE
Il ne faut donc plus chercher Dieu, ni substituer, à cette vaine quête des valeurs dans le suprasensible, une glorification de la raison ou de la morale, Ces chemins qu'emprunte l'humanisme ne nous ont mené qu'au nihilisme, et ils ne sauraient conduire plus loin les temps modernes. Notre époque est appelée par Heidegger à abandonner le “chemin des marchands” qui, “raisonnablement”, mène quelque part, c’est-à-dire vers ce que nous pouvons métaphoriquement qualifier de bourg, Le “chemin qui mène quelque part”, qui ne fait que contourner ou traverser, en l'ignorant, l'inquiétante forêt, nous ne savons que trop où il nous conduit: vers l’auberge du bourg où l'on se repose, où l'on dérobe à la vie quelques instants de bonheur, c'est à dire précisément vers le type (anti-)historique bourgeois. Nietzsche nous a dit, au contraire, qu'il fallait emprunter un de ses « chemins qui ne mènent nulle part » et qui sont aventureux, c'est-à-dire à la fois chargés de sacré et d'advenant - d'avenir -, un de ces Holzwege qui nous conduiront au cœur de la forêt, où nous attend, non pas le repos et le bonheur du bourgeois, mais notre travail. Nietzsche n'a pas indiqué quelle sente emprunter, parmi toutes celles qui sont possible Il a posé la question “Quelle valeur pour de nouvelles valeurs?” C'est-à-dire: quel type d’ « aventure » pour les temps modernes? Mais Nietzsche n'était pas, au stade de la culture européenne où il se trouvait, en état de répondre.
Heidegger, lui, inaugure la réponse. Il indique quelle sente emprunter et s'y engage lui-même. Mais le choc de sa réponse est si fort que peu, pour l'instant, ont su ou ont voulu en dévoiler et en reconnaître la portée.
Nous avons dit que la forêt appelait au travail, celai du bûcheron, dont la figure fascinante traverse l'oeuvre de Heidegger. A quoi renvoie le travail, en ces temps modernes ? Certainement pas à la vision réactionnaire, et donc nihiliste elle aussi, du modèle de l'artisan, mais à la technique moderne. Où trouver une nouvelle table des valeurs, interroge Nietzsche. Dans la technique moderne, répond Heidegger.
Pour comprendre comment la technique peut constituer un élément fondamental de réponse à la question des valeurs, Heidegger nous invite à méditer sur l'essence de la technique (“essence” étant entendue ici dans l'acception de “sens cache”). L'essence de la technique, précise-t-i1, n'a rien de technique. Nous, hommes des temps modernes, sommes “enchaînés” à la technique et, faussement, nous la croyons “neutre”. Alors nous demeurons aveugles face à la nature de notre civilisation technique: “Nous lui sommes livrés de la pire façon”. Nous ne saisissons de la technique moderne que son “aspect instrumental”, nous n'y voyons qu'un “ensemble de moyens réunis pour des fins”. Pour Heidegger, il s'agit là d'une conception vulgaire, “exacte mais non vraie” de la technique. Ce n'est donc pas la civilisation technique en elle-même que déplore Heidegger, mais cette perception que 1'on s'en fait, perception à cause de laquelle la technique nous aliène et nous “échappe”, en se retournant contre nous, en nous mécanisant et en nous réifiant. Il nous appartient donc de nous réapproprier la technique, d'en réinsérer la richesse dans notre monde. Et pour cela, une fois encore, il nous faut “retourner” aux Grecs.
Dans la Grèce antique, écrit Heidegger, téchnè ne désigne pas seulement le “faire” de l'artisan, mais aussi l'art au sens élevé du mot. La téchnè fait partie du pro-duire, de la poiésìs. Une “production technique” n'est pas seulement, alors, un processus instrumental et trivial. La pro-duction est l'acte par lequel le technicien-poète “fait voir au jour” (produire, producere : “faire venir”) un sens. La poiésis technique, que ce soit celle du savetier ou du sculpteur, se trouve en conformité avec la nature, avec la physis, qui, elle aussi, est une “production”. “La fleur, dit Heidegger, s'ouvre dans la floraison”. “Produire” signifies donc bien “faire venir” (veranlassen), “faire avancer du non-présent dans la présence” (hervorbringen). De son côté, la poiésis est marquée par la physis, en ce sens qu'en grec ancien, physein signifie aussi “se rendre présent”. La production technique doit donc aussi être interprétée comme l'art de cueillir, dans la matière, un non-sens pour le faire advenir en tant que sens: pro-duire, c'est recueillir, et aussi se recueillir. Enfin, pro-duire (her-vorbringen), revient à accomplir un acte qui présente (bringt vor) un “état caché” du monde et le dévoile. La production technique des Grecs doit donc s'entendre finalement comme dévoilement. “Les Grecs, écrit Heidegger, ont pour dévoilement le nom d'aléthéia, que les Romains ont traduit par veritas (...) Nous demandions ce qu'est la technique et sommes maintenant arrivés devant l'aléthéia, devant le dévoilement. En quoi l'essence de la technique a-t-elle affaire avec le dévoilement? Réponse: en tout. Car tout “produire” se fonde dans le dévoilement (...) Ainsi, la technique n'est pas seulement un moyen, elle est un mode de dévoilement, c'est-à-dire de la vérité” (Wahrheit).
Arrêtons-nous un instant. Heidegger nous invite à comprendre que les mots traduisent une vue du monde. Pour les anciens Grecs, le mot veritas, au sens universaliste de “certitude” que nous entendons aujourd'hui, était inconcevable. Le vrai, c'était, dans une perspective déjà “nominaliste”, le dévoilement par l’homme. L'aléthéia désigne ce qui est “tiré de l'oubli”. (Souvenons-nous du Léthé, le fleuve Oubli). Heidegger écrit: “La téchnè est un mode de l'alétheuein”. Il ajoute cette proposition fondamentale: “Elle dévoile ce qui ne se produit pas soi-même”. Qu'est-ce que cela veut dire? Alétheuein, verbe qui caractérise l'activité technique, signifie à la fois “faire apparaître comme vérité”, “être vrai” et “faire advenir au jour par dévoilement”. La technique est donc ici pensée comme vérité du-monde. Pour les Grecs, le monde n'est pas “vrai” hors de l'activité productrice. La “vérité du monde” ne réside pas dans son “essence”, mais dans l'acte pro-ductif de la technique qui crée et dévoile un sens. Nous saisissons alors ce que Heidegger entend par: “La technique dévoile ce qui ne se pro-duit pas soi-même”. De lui-même, le monde ne pro-duit, ne dévoile, ne révèle aucune valeur. Une telle vue du monde s'oppose radicalement à celle qui prévaudra plus tard et qui, à la suite de la métaphysique, mettra la valeur, le sens, la vérité, dans le monde en soi. L'activité technique sera alors dépouillée de sa connotation créatrice et poétique. Elle sombrera dans la pure instrumenta lité, et le mot “technique” ne sera plus synonyme d'art. La vérité, en passant de l'“art technique”, conçu par les Grecs comme dévoilement volontaire du monde, dont de sens, au “monde en soi” de la métaphysique occidentale, contribuera à la dévalorisation du réel - de l'étant - au profit du suprasensible, et à la vulgarisation du travail technique sur lequel pèsera la chappe de la mauvaise conscience.
Chez les Grecs, l'acte humain de production technique était seul porteur de vérité: il était seul “porteur de lumière” (lucem ferre). La technique était religieuse dans le paganisme grec: 1'àme et la spiritualité ne résidaient pas dans l'intellectualisme métaphysique, mais, plus fortement, au cœur du monde, dans le marbre « charnel » des temples ou dans l'évocation “érotique” de la statuaire. C'est que la technique était pensée, nous l'avons dit, comme profondément reliée à la nature, à la physis, source religieuse de tonte vie. L'acte technique était vécu comme une transposition du devenir-de-la-nature. Aujourd'hui encore, la floraison, les saisons, nous montrent qu'il n'y a pas d’ « être » naturel, mais un dévoilement et une production de formes (16). La technique est à la fois continuation de la nature et combat contre elle: d'où son caractère religieux. Elle s'envisage comme un mode de la nature et une meta-nature. La physis dévoile une forme, la poiésis de la technique dévoile de surcroît un sens. Le degré de “vérité”, par la technique, s'accroît. Il est frappant de constater à quel point cette conception du monde s’apparente à ce que nous enseigne la physique moderne sur 1'inanité de tonte “vérité du cosmos” ou sur l'illusion de pouvoir percer le secret d'une “essence du réel”, ce dernier n'étant lisible qu'en fonction de points-de-vue, de niveaux d'interprétations de projets techniques différents (17).
Heidegger nous insiste donc à tirer de l'oubli cette conception de la technique et à en revenir aux sources grecques, afin de comprendre à nouveau la vérité comme un acte de dévoilement du monde, de “désabritement (Entbergen) risqué”. Que les temps modernes se réinspirent de cette conception à la fois nominaliste et religieuse de la technique, et celle-ci pourra redevenir ce qu'elle fut à l'origine: poésie. Or, l'humanisme occidental, même à travers le rationalisme “scientiste”, aujourd'hui révolu, n'a évidemment jamais pensé de la sorte la technique. Dans le scientisme, cette dernière n'est perçue que comme un instrument du “progrès”, lequel s'apparente à la recherche humanitaire du bonheur - et notre époque se réfère toujours, plus ou moins consciemment, à certe conception dévalorisante de la nature, et donc de la technique. La nature comme réel (l'étant) est rejetée au profit d'un “monde” conçu comme loi, comme principe - métaphysique ou moral - trouvant la réalité de son essence indépendamment de la vie et de 1'action humaine. “L'Ancien Testament, qui rejette tonte philosophie, ne connaît pas la “nature”, remarque Daniel Bell (...) La religion biblique est basée sur la révélation, non sur la nature, et la morale sur la Halakha, c'est-à-dire sur la Loi” (18). Toute la conception “occidentale” de la technique, fondée sur cette lecture de la Bible, concevra à sa suite l'activité technique comme profane. On “subira” la technique; le travail technique sera conçu comme une souffrance, une obligation pénible (mais aussi rédemptrice), tandis que, dans la pensée grecque, ajoute Daniel Bell, “la nature (physis) est antérieure à la loi formelle (nomos). La nature est cachée et il faut la découvrir ; la loi doit prendre la nature pour guide”.
“Découvrir” la nature, la “dévoiler”, telle nous apparaît donc la mission de la technique. Mais “dévoiler” la nature, faire sortir de l'abri sa “vérité”, qu'est-ce que cela peut signifier, puisqu’aucune lui suprême, aucune vérité, aucun “bonheur” ne peuvent être mécaniquement découverts? La technique, en produisant à partir de la nature, va-t-elle en extraire quelque chose ? Quel sens la volonté technique va-t-elle créer et faine surgir? A ces questions, la notion de force va permettre de répondre.
Nous devons alors quitter les Grecs, et abandonner le domaine de la technè, pour entrer dans celui, beaucoup plus inquiétant, de la technique moderne, celle que Jünger avait appelé la technique planétaire. En effet, l'essence de la technique ne réside pas tout entière dans la «poiésis de la production dévoilant». Elle comporte les qualité de la téchnè, mais elle cache en elle bien plus encore. Et alors que les Grecs, dont la technique était quantitativement moindre que la nôtre, savaient la vivre, nous, hommes des temps modernes, qui détenons cette «technique motorisée», nous la profanons, nous la subissons comme un poids, nous passons à côté de sa richesse et de son mystère.
«C'est elle, précisément, la technique moderne, et elle seule, écrit Heidegger, qui est l'élément inquiétant qui nous pousse à demander ce qu'est la technique. On dit que la technique moderne est différente de toutes celles d'autrefois, parce qu'elle est fondée sur la science moderne, exacte, de la nature». Or, ajoute-t-il, «qu'est-ce que la technique moderne? Elle aussi est un dévoilement. Le dévoilement, cependant, qui régit la technique moderne ne se déploie pas en une pro-duction au sens de la poiésis. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une pro-vocation (Heraus-fordern) par laquelle la nature est mise en mesure de livrer une énergie qui puisse, comme telle, être extraite (heraus-gefördert) et accumulée». Heidegger énonce ainsi l'idée d'un passage «historique» de la domestication de la «matière vivante» à la «matière-énergie». Le moulin à vent, l'éleveur ou l'agriculteur confient, par la technique, une production aux forces croissantes de la nature. Ils ne la pro-voquent pas, ne s'approprient pas son énergie. La technique moderne, au contraire, prend la nature dans «le mouvement aspirant d'un mode de culture (Bestellen) différent, qui requiert (stellt) la nature (…) Le «requérir» qui provoque les énergies naturelles est un avancement (ein Fördern). La technique moderne imprime à la nature un mouvement, dans lequel se lit le projet d'une volonté: l'énergie, dispersée à l'état naturel, est extraite, puis stockée, puis encore enfermée, pour se voir commise». Ainsi, la centrale électrique mise en place sur le Rhin. Ce dernier somme de livrer sa pression hydraulique, qui, à son tour, somme les turbines de tourner. «Le fleuve Rhin apparaît, lui aussi, comme quelque chose de commis. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale d'énergie. Ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, il l'est de par l'essence de la centrale».
Afin de voir et de mesurer, ne fût-ce que de loin, l'élément qui domine ici, arrêtons-nous un instant sur l'opposition qui apparaît entre ces deux intitulés: «le Rhin mûré dans l'usine d'énergie» et «le Rhin», titre d'un hymne de Hölderlin. Heidegger signifie clairement ici que la technique moderne, parce qu'elle commet - plus que «domestique» - l'énergie naturelle, acquiert la prévalence sur la nature. Il s'agit là d'un événement d'une portée considérable, d'une rupture «historiale» (Zeit-Umbruch) que notre époque n'a pas encore comprise et admise. La force énergétique de la nature devient en effet de la volonté humaine. Inversement, la nature est transformée en technique. Le Rhin, comme l'électron, se confond avec la machine qui le commet. La technique ne «domestique» pas la matière-énergie naturelle, mais, bien plus, elle la fait advenir et se l'approprie jusqu’a se confondre avec elle. L'instrument mécanique se confond avec son objet «naturel». Dans la bombe atomique, ce qui, comme un soleil artificiel, explose, ce n'est pas l'uranium 235, mais bien l'hybride uranium-machine, cette machine qui finit par devenir l'énergie naturelle elle-même. Nous dirons alors que la technique moderne est devenue l'essence de la nature. Pour la première fois dans I'histoire, la poiésis (au sens d'action) s'est faite physis. La nature est rendue par la technique. Mais elle n'est pas rendue «transparente», car elle nous demeure toujours aussi obscurément mystérieuse. Elle n'est pas non plus «vaincue», comme le croit un scientisme vulgaire, car sa force est inépuisable. Elle est rendue plus présente. La présence de la nature «se rapproche» de nous et, avec elle, sa connotation sacrée. Paradoxe de la technique moderne: semblant nous «couper» de la nature, elle nous en rapproche, car elle nous rapproche de son énergie. En grec ancien, energeia voulait d'ailleurs dire «présence». L'énergie cachée dans la nature est «libérée, transformée, accumulée, répartie et commuée». La technique analysée comme un dévoilement qui provoque, est placée sous le signe de la «direction» et de l'assurance.
Mais ce «dévoilement de l'énergie», quelle est son essence? Que va receler, en son abîme, cette pro-vocation accomplie par la technique? Ce qui va apparaître, ce qui va sourdre, sous des déguisements divers, au cœur de cette «requête assurée» du monde naturel à laquelle se livre la technique moderne, n'est-ce pas ce qui, depuis des siècles, attendait d'apparaître, ce qui, à travers la métaphysique, s'était manifesté de manière refoulée et codée, ce que les Grecs eux-mêmes n'avaient pas su faire ad-venir à la présence, pour cause de limitation matérielle de leur propre téchnè? N'est-ce pas ce que Nietzsche avait découvert, exhumé de I'obscurité des siècles chrétiens, ce qu'il avait décelé dans la tragédie sous la forme mythique de Dionysos gouverné par Apollon, et qui, maintenant, pour la première fois dans 1'«ordre du temps» (tou chronou taxis), surgit physiquement et non plus symboliquement? N'est-ce pas la Volonté de puissance ?
Nous devons, dès à présent, nous demander comment la pensée de Heidegger en est arrivée à reconnaître, au cœur de la technique moderne, la Volonté de puissance. Répondre à cette question revient en effet à montrer ce qu'il ne faut pas entendre par «Volonté de puissance», à savoir une domination brutale ou une volonté d'asservissement. La technique, dit Heidegger, stabilise le monde qu'elle commet. Elle le place dans la position stable d'un fond (Bestand), d'un objet qui se tient «comme au garde à vous» face à l'ordre technique (Gegenstand). Hegel, en son temps, voyait dans la machine un «instrument indépendant», à l'instar d'un instrument artisanal. Heidegger, parlant de l'avion, en constate au contraire 1'«absolue dépendance» l'avion «tient son être uniquement d'une commission donne à du commissible». La nature se conçoit comme pourvoyeuse de capital. Ce qui signifie que, pour «donner du sens« et conférer de la valeur à la nature, voire du sacré, nous devons le faire selon des types de valeur radicalement nouveaux. Or, la nature a été désacralisée. Notre époque n'a pas su inventer une nouvelle forme de sacré, accordée à l'essence de la technique. La technique n'a pourtant rien d'une substance autonome. «Qui accomplit, demande Heidegger, l'interpellation pro-vocante, par laquelle ce qu'on appelle le réel est dévoilé somme fond? L'homme, manifestement». Mais l'homme, lui aussi, est objet de pro-vocation: «Ne fait-il pas aussi partie du fond, et d'une manière plus originelle que la nature ? La façon dont on parle couramment de «matériel humain» le laisserait penser (...) Le garde forestier est commis par l'industrie du bois. Il est commis à faire que la cellulose puisse être commise et celle-ci, de son côté, est provoquée par les demandes de papier pour les journaux et les magazines illustrés. Ceux-ci, à leur tour, interpellent l'opinion publique pour qu'elle absorbe les choses imprimées, afin qu'elle-même puisse être commise à une formation d'opinion dont on a reçu la commande. Mais justement, parce que l'homme est pro-voqué d'une façon plus originelle que les énergies naturelles, à savoir au commettre, il ne devient jamais pur fond».
L'homme est donc à la fois fond et non-fond. Comment cela est-il possible ? L'homme, à l'ère technique, serait-il coupé en deux, en même temps sujet et objet de la technique ? Mais s'agit-il du même homme? Rapprochons la dernière phrase citée de Heidegger de 1'énoneé suivant: «Le dévoilement (du réel parla technique) n'est pas le simple fait de l'homme (...) mais d'une parole à lui adressée, et cela d'une façon si décidée qu'il ne peut jamais être homme, si ce n’est comme celui auquel cette parole s'adresse (...) Il ne fait que répondre à un appel». Nous commençons alors d'entrevoir quelque chose d'« inhumain» pour l'opinion courante. Heidegger scinde l'humain en deux: en tant qu'objet d'un appel, d'une commission, 1'humain est un fond pour la technique. Mais il est aussi celai qui formule cet appel. La phrase «il ne peut jamais être homme si ce n'est comme celui auquel cette parole s'adresse» signifie: le propre de l'humain est d'obéir, et plus aujourd'hui qu'avant. Mais quelle est cette commission, cette parole, à laquelle il faut obéir? C'est le Surhumain, Et c'est ainsi qu'il faut lire la phrase de Heidegger : «La technique moderne, en tant que dévoilement qui commet, n'est pas un acte purement humain». L'humain, par la technique moderne, s'appelle lui-même à se dépasser, et se commet lui-même comme fond à commettre le réel. L'appel vient de sa nature, et c'est ce qui confère à la civilisation technique son ambivalence, son risque. Notre époque, dit Heidegger, rend l'homme esclave de lui-même par l'intermediaire de la technique et inaugure deux nouvelles classes d'hommes : les «commis », assimilés à un fond, et les personnalités commettantes. Dès lors, soit l'on «refuse» cet état de fait, et l'on régresse dans l'infra-humain; soit l'on se refuse simplement à l’admettre - attitude humaniste -, et la civilisation technique est réellement vécue comme esclavage, comme soumission à la «dictature de l'an-organique», soit encore, troisième voie, on l'accepte au prix d'un changement auto-conscient de l'humain et des valeur «humaines«, et à cette condition, la civilisation technique ne doit pas plus représenter un «esclavage» pour l'homme moderne que, dans le passé, la révolution néolithique n'en a impliqué un pour les peuples européens.
Bien entendu, c'est cette troisième hypothèse qui, nous le verrons, peut se déduire de la pensée de Heidegger. Mais avant d'aborder cette question, il nous faut chercher à percer la nature de ce que nous voyons surgir dans et par la technique moderne : cette «pro-vocation qui met l'homme en demeure de commettre le réel comme fond». Quelle est la nature de cette pro-vocation? Heidegger répond : «Cet appel provocant qui rassemble l'homme autour de la tâche de commettre somme fond ce qui se dévoile, nous l’appelons I'arraisonnement (Gestel)». Et c'est dans ce mot que réside l'essence de la technique moderne.
«L'arraisonnement, expose Heidegger, n'est rien de technique, il n'a rien d'une machine. Il est le mode suivant lequel le réel se dévoile comme fond». il n'est pas assimilable à un acte humain ni à un acte situé hors de l'humain. Sa place est du côté du Surhumain, c'est à dire d'un nouveau mode «historial» d'être-au-monde, accompli grâce à la technique moderne et dont les hommes de ce temps n'ont pas encore pris conscience. Cette «inconscience» est d'ailleurs la cause du malaise de la civilisation technique, qui ne pense l'humain, dans l'humanisme, qu'au travers des modalités d'être-au-monde de l'époque pré technique.
Avec l'arraisonnement, le Dasein change de nature. Pour comprendre le processus de l'arraisonnement, on doit observer que, dans le mot Gestell, on trouve l'idée de rassemblement: la volonté rassemble le fond humain et naturel des commis. Mais si le radical Ge indique cette idée de rassemblement, inspirée du terme jüngerien de Mobilmachung, Heidegger va plus loin que Jünger. L'arraisonnement par la technique est plus qu'une «mobilisation». Le verbe stellen nous indique l'idée d'arrêter quelqu'un ou quelque chose pour lui demander des comptes, pour lui faire rendre raison, pour l'obliger à rationem reddere. D'où, en français, le recours au terme d'«arraisonnement», grâce auquel on comprend parfaitement que la volonté technique prend d'assaut (aspect à la fois guerrier et dionysiaque) et metà la raison le réel (aspect apollinien). Jean Beaufret écrit d'ailleurs: «La technique arraisonne la nature, elle l'arrête et l'inspecte, et elle l'arraisonne, c'est-à-dire la met à la raison (...) Elle exige de tonte chose qu'elle rende raison. Au caractère impérieux et conquérant de la technique s'opposeront la modicité et la docilité de la «chose»...» Cet imperium surhumain, lisible dans l'arraisonnement, nous rapproche de la valeur qu'il recèle: la Volonté de puissance en acte. Aussi, previent Heidegger, la conception purement instrumentale, purement anthropologique de la technique devient-elle caduque dans son principe. La technique est en effet et bien devenue le lieu d'un appel: elle est ce «mode» par lequel et dans lequel l'humain est appelé, pro-voqué, commis par sa nature à devenir surhumain, c'est-à-dire à commettre à son tour, à «appeler» la nature et à se pro-voquer lui-même, ou plutôt à pro-voquer cette part de lui-même qui en est restée au niveau de l'humain.
Nous devons alors découvrir ce que recèle «l’appel pro-vocant» et où il va entraîner l'humain. Bien que la technique moderne doive utiliser la science exacte de la nature, elle n'a rien de commun avec «de la science naturelle appliquée», écrit Heidegger. Ce ne sont pas ici les lois de la nature qui sont utilisées, mais bien les lois des machines et des instruments. «Le réel, partout, devient fond, ajoute Heidegger (...) L'essence de la technique met l'homme sur le chemin du dévoilement (...) Mettre sur le chemin se dit, dans notre langue, «envoyer». Cet envoi (schicken) qui rassemble et qui, seul, peut mettre I'homme sur le chemin du dévoilement, nous le nommons destin (Geschiek). C'est à partir de lui que la substance en devenir (Wesen) de toute histoire se détermine».
Ainsi, l'essence de la technique, qui, répétons-le, n'a rien de technique par elle-même, non seulement n'apparaît pas forcément au moment «épochal» de la civilisation technique moderne, mais provient de racines historiques antérieures. L'essence de la technique est un devenir «historial», un destin, un devenir au monde collectif, et non pas seulement une réalité sociologique contemporaine et synchronique. Pour Heidegger, la poiesis de la production technique des Anciens constituait aussi un destin. C'est donc toute l'histoire des mentalités inconscientes et de l'être-au-monde d'une civilisation qui se trouve charriée par I'arraisonnement de la technique. Celui-ci était déjà en oeuvre avant «l'électrotechnique et la technique de I'atome», dans cet esprit de recherche décelable en Europe dès les mathématiciens grecs. Il n'adviendra cependant au dévoilement, à la prise de conscience qu'après 1'époque de la jeunesse de la civilisation moderne.
L'arraisonnement traduit alors une vue du monde en rupture complète avec la métaphysique. Le monde objectif n'existe pas. La nature n'est pas considérée dans sa nature mais seule compte, pour I'homme de la technique européenne, I'extraction d'une énergie qu'il transforme en puissance humaine. Contrairement à ce qui se dit couramment, la science est au service de la technique, et cette dernière constitue un destin historique, dont I'objet n'est pas la connaissance mais l'action. Par l'essence de la technique, se manifeste un trait «historial» de la civilisation européenne : dominer est plus important que connaître.
Heidegger ne succombe toutefois à aucun déterminisme historique. Le «destin» peut à tout moment se refuser. Nous ne lui sommes pas enchaînés. Heidegger promise: «Ce n'est jamais la fatalité d'une contrainte. Car l'homme, justement, ne devient libre que pour autant qu'il est inclus dans le domaine du destin et qu'ainsi, il devient un homme qui écoute, non un serf que l'on commande (ein H6render nidi/ aberein Hóriger) (...) L'arraisonnement nous apparaît dans un destin de dévoilement (...) Il est un élément libre du destin qui ne nous enferme aucunement dans une moindre contrainte, qui nous forcerait à nous jeter tête baissée dans la technique ou, ce qui reviendrait au mente, à nous révolter inutilement contre elle et à la condamner comme oeuvre diabolique».
Que l'on accepte - et c'est ce que propose Heidegger - ou que l'un refuse la technique, il faudra le faire consciemment, après avoir perçu son essence d'arraisonnement du monde et après l'avoir envisagée comme destin. Le refus ou l'acceptation seront alors des actes historiques accomplis par une conscience ««historiale» en situation (geschichtliches Dasein), une sur-conscience. Mais les adversaires primaires de la technique, tout somme ceux qui s'y précipitent tête baissée, sont incapables de parvenir à une telle conscience historique. Ils en sont incapables parce qu'ils ne sont pas libres. La «liberté», pour Heidegger, n'est «ni la licence ni l'arbitraire», ni «la soumission à de simples lois», mais «le domaine du destin», c'est-à-dire un choix volontaire éclairé par la perception du destin.
Perçue comme destin de dévoilement du monde, la technique devient un danger voulu et désiré comme tel : «La puissance de la technique fait partie du destin. Placé entre ces deux possibilités (accepter ou refuser le danger), l'homme est exposé à une menace partant du destin». Déjà, quand le Dieu des chrétiens avait été «dévoilé» par ceux qui le nommaient comme causa efficients du monde, il avait perdu son mystère et était devenu le Dieu des philosophes. Dès lors, le nihiliste commençait. Le dévoilement de la nature par l'arraisonnement semble autrement plus considérable pour la bonne raison que la nature, elle, est notre milieu, et que nous ne doutons pas d'elle comme des dieux.
«Le danger, poursuit Heidegger, se montre à nous de deux côtés différents (...) L'homme suit son chemin à l'extrême bord du précipice, il va vers le point où lui-même ne doit plus être pris que comme fond (...) Tout ce que l'un rencontre ne subsiste qu'en tant qu'il est le fait de l'homme (...) Il nous semble que partout l'homme ne se rencontre plus lui-même». Heidegger, qui s'inspire ici des vues de Werner Heisenberg, veut dire que «si l'homme ne rencontre plus rien à travers l'arraisonnement du monde, c'est qu'il ne se rencontre plus lui-même en vérité nulle part, c'est-à-dire qu'il ne rencontre plus nulle part son être-devenir (Wesen)». Quant au second danger, il tient au fait que l'arraisonnement, en nous plongeant dans l'immédiateté de la puissance mécanisée, risque, non seulement d'occulter le pro-duire (mode précédent de dévoilement du monde), mais aussi de s'occulter lui-même comme destin. La technique risque en effet de nous cacher ce que nous sommes et ce qu'elle est, de nous voiler qu'elle se donne comme destin et que nous pouvons exister en tant qu’êtres doués de destin.
Autrement dit, la technique moderne, dont l'essence est l'arraisonnement qui pro-voque le monde avec une puissance inouïe, peut nous faire perdre, dans ce tourbillon même, dans set «envoi» (schicken) par lequel nous sommes jetés sur la terre, la conscience de notre destin (Geschick). «L'homme se conforme d'une façon si décidée a la pro-vocation de l'arraisonnement qu'il ne perçoit pas celai ci comme un appel exigeant, qu'il ne se voit pas lui-même comme celui auquel cet appel s'adresse». La contrepartie de ce risque, impliqué par la liberté humaine, est que l'homme peut aussi prendre conscience de l'arraisonnement et l'assumer: «Il faut que ce soit justement l'essence de la technique qui abrite en elle la croissance de ce qui sauve».
L'arraisonnement, en effet, constitue à la fois 1'«extrême péril» et 1'«acte qui accorde». Heidegger, dans La question de la technique, précise: «L'arraisonnement pousse l'homme vers le danger qu'il abandonne son être libre ; (mais) e'est précisément dans cet extrême danger que se manifeste l'appartenance la plus intime, indestructible, de 1'homme à «ce qui accorde..» Il ajoute: «Contrairement à tonte attente, l'être de la technique recèle en lui la possibilité que ce qui sauve se lève à notre horizon (...) Aussi longtemps que nous nous represénterons la technique comme instrument, nous resterons pris dans la volonté de la maîtriser». Cet accord dont parte Heidegger, opposé diamétralement au «discord» qui sépare l'existence de la conscience, la pensée de la vie, les valeurs nommées des valeurs vécues, sera trouvé lorsque nous ne considérerons plus la technique comme une instrumentalité rationnelle, lorsque nous ne chercherons plus à la «dominer» au sens où le potier des temps anciens dominait son tour. Ce qu'il faut, c'est nous «donner» à la technique, en tant qu'elle s'avère porteuse de notre propre Volonté de puissance. C'est au sein même du dévoilement que la technique moderne opère sur le monde, qu'elle fondera sa propre justification éthique, qu'elle se posera comme vérité - au sens grec d'aléthéia.
La technique pourrait alors retrouver, selon un sens diffèrent de celui que lui donnaient les Grecs, la force de mobilisation de ce que l'on nomine improprement un art. En Grèce, on le sait, la technique était un dévoilement pro-ducteur. Aujourd'hui, pour reprendre un sens, elle doit devenir un dévoilement pro-vocant. Entre les deux, la matérialité de l'arraisonnement est apparie, mais le dévoilement, lui, reste identique. L'homme, en soulevant le voile du monde, retrouve, par ce geste que ne guide aucun pragmatisme, du sens. Le dévoilement nous jette, loin de la quotidienneté insipide et programmée della «technique confortable», vers l'aventure. Cette «aventure», nous n'en prendrons toute la mesure que lorsque nous aurons bien saisi, pour nous en stimuler ou nous en effrayer, en quelle époque nous vivons. Cette aventure sera celle des temps modernes, que la conscience occidentale n'a pas encore intégrés et qui n'en sont qu'à leur aurore, qu'à l'orée de leurs possibles.
IV. L'AURORE DES TEMPS MODERNES
Heidegger tient un double discours sur la métaphysique et la technique. C'est ce qui rend sa lecture difficile. La métaphysique apparaît d'abord comme étant l'histoire occidentale elle-même, atteinte à ce titre par la mors dont parlait Nietzsche, ce qui nous incite à penser que nous vivons une fin de l'histoire. Mais la métaphysique se présente aussi sous l'aspect d'un fleuve qui viendrait mourir dans l'océan de la technique moderne, et dont ce dernier procèderait. Quant à la technique, elle est pensée comme apogée de ce nihilisme que lui aurait légué la métaphysique mourante, mais aussi comme rupture radicale avec elle, et comme l'aube d'un «salut». Comment débrouiller cet écheveau?
Pour Heidegger, la métaphysique ne se confond pas avec l’œuvre de ce que l'on a coutume de norme les «métaphysiciens». La métaphysique englobe cette vue-du-monde, exprimée par l'ensemble des philosophes, qui pénétra les sociétés occidentale depuis Platon et les débuts du christianisme et selon laquelle le monde réel de la vie se doublerait d'un univers supérieur des essences qu'il serait donné à l'homme de pouvoir connaître. Cette vue-du-monde comporte un double destin, contradictoire: d'une part elle fut marquée, dès le départ, du sceau du nihilisme, c'est-à-dire de la dévalorisation de ses propres valeurs; mais ce nihilisme ne vint au jour que lentement. D'autre part, la vue-du-monde métaphysique fut porteuse, sans le savoir, de la Volonté de puissance: penser le monde sous le rapport de l'universalisme des essences, c'était manifester une prodigieuse volonté de l'arraisonner et de le dominer; toutefois, cette volonté ne parvenait au clair entendement que dans la mesure où l'homme ne s'avouait pas comme 1'élément dominateur et conférait cette qualité à Dieu ou à un tout autre que lui.
Avec 1'arrivée de la technique moderne, un «passage de relais» s'effectue. La technique moderne recueille l'héritage - déjà contradictoire - de la Volonté de puissance et du nihilisme. Elle marque en ce sens une rupture, puisque le nihilisme éprouve la technique de manière matérialiste, qu'il est vécu comme une détresse consciente, alors que la civilisation de l’âge métaphysique ne prenait pas consciente de la montée sourde de ce nihilisme, dont le processus était philosophique. En d'autres termes, la technique a hérité de la métaphysique, car la Volonté de puissance, dont cette dernière était grosse, a été l'élément provocateur de la science et de la technique moderne. Mais cette Volonté de puissance qui, par la technique, est passée du stade psychique au stade matériel, n'est toujours pas complètement consciente d'elle-même. Ou plutôt, elle commence seulement à le devenir, et c'est pourquoi nous vivons une époque de crise.
 Notre époque est celle de I'apogée du nihilisme, ce que Heidegger, empruntant à Hölderlin, nomme «la minuit du monde». Ce nihilisme provient d'abord de la déchéance de la métaphysique, commencée des Platon et qui a trouvé son achèvement dans la morale humaniste, le christianisme laic et d'autres avatars; c'est que Heidegger appelle l'athéisme. Ce nihilisme qui aboutit à la dévalorisation du monde et qui se confond avec I'époque du «dernier homme» annoncée par Zarathoustra, est, d'autre part, renforcé par le fait que la technique moderne a, elle aussi, hérité du nihilisme de la vue-du-monde métaphysique.
Notre époque est celle de I'apogée du nihilisme, ce que Heidegger, empruntant à Hölderlin, nomme «la minuit du monde». Ce nihilisme provient d'abord de la déchéance de la métaphysique, commencée des Platon et qui a trouvé son achèvement dans la morale humaniste, le christianisme laic et d'autres avatars; c'est que Heidegger appelle l'athéisme. Ce nihilisme qui aboutit à la dévalorisation du monde et qui se confond avec I'époque du «dernier homme» annoncée par Zarathoustra, est, d'autre part, renforcé par le fait que la technique moderne a, elle aussi, hérité du nihilisme de la vue-du-monde métaphysique.
C'est là où la lecture de Heidegger devient extrêmement complexe. Ce dernier exprime, par allégorie, l'idée suivante : la technique est la continuation de la métaphysique, car elle vise à satisfaire la même pulsion, la Volonté de puissance. Or, puisque le nihilisme vécu du monde technique est le successeur du nihilisme philosophique de la vue-du-monde métaphysique, c'est bien la Volonté de puissance elle-même, philosophique, puis matérialisée, qui est «responsable» de ce nihilisme. Comment, alors, cette Volonté de puissance peut-elle constituer un élément salvateur, comment peut-elle. après avoir porté le nihilisme, le combattre, dans un nouveau cycle «historial»? Heidegger répond: en devenant autoconsciente. La Volonté de puissance changerait alors de nature; de dévalorisante, elle deviendrait valorisante. C'est pourquoi, il ne faut voir chez Heidegger aucun rationalisme logique, mais une pensée a-logique, conforme à la vie, où l'on n'est jamais acculé à se prononcer contre (la métaphysique, le nihilisme, etc.), mais au-delà: post-nihiliste, post-chrétien etc. Heidegger renoue ainsi avec la pensée du devenir des présocratiques, selon cette parole de Hölderlin qui constitue une clé: «Mais là où est le danger; là aussi croit ce qui sauve». (Cette forme de pensée avait été incomplètement retrouvée par Hegel. Celui-ci, en effet, ne concevait le devenir que comme l'antécédent provisoire d'un arrêt de l'histoire par advenance de la raison à la conscience).
C'est donc bien par l'essence même de la technique, par l'arraisonnement, qui exprime la Volonté de puissance dont l'ascension dans 1'histoíre fut conjointe de celle du nihilisme, que ce dernier pourra se voir dépassé. La venue à la consciente de la Volonté de puissance, qui, seule, serait susceptible d'affirmer d'autres typologies de valeurs, ne peut s'accomplir que dans la civilisation de la fusée et de l'électron. Pourquoi? Parce que la Volonté de puissance trouve dans la technique moderne et planétaire un meilleur support que dans la métaphysique : vécue, éprouvée, elle est «au bord» de la conscience. La manifestation de l'Eternel retour de l'identique apparaît clairement: ce qui, à la fin du «monde grec», avait inauguré le nihilisme, c'est-à-dire le fait de «nommer les valeurs», de désigner l'ètre, le logos, est aussi appelé a devenir, mais sous une autre forme historiale, celle, apollinienne, de la conscience, ce qui inaugurera un autre cycle des valeurs, un «après-nihilisme».
Notre époque se caractérise donc par la séparation, le discord («nous sommes à l'ère de 1'assomption du discorde, avait coutume de dire Heidegger), entre une métaphysique déchue, privée du principe vital de Volonté de puissance, et une technique qui a recueilli cette dernière sans le savoir. La morale et la civilisation sont en contradiction. Les valeurs affirmées par l'ancienne conception du monde commune sont mortes par rapport à la nature profonde de la civilisation technique. Il existe deux moyens de résoudre cette contradiction : le premier, préconisé par Heidegger, est de faire assumer consciemment, par la civilisation technique, cette Volonté de puissance - comme un «orgueil». C'est par un projet «orgueilleux» de monde hyper technicisé et se voulant tel, et non par la régression vers une civilisation non technique, que l'Europe, pour Heidegger, redonnera un sens à son existence «historiale». Une spiritualité immanente prendra alors le relais d'une spiritualité transcendante devenue impossible parce qu'épuisée. Mais un autre chemin est également possible, en notre époque de rupture : celui d'un refus conscíent de la Volonté de puissance. Un certain nombre d'auteurs 1'expriment aujourd'hui fort bien dans le courant de ce qu'il est convenu d'appeler la «nouvelle gauche», notamment à propos du débat sur l'idéologie du travail, lorsque celui-ci est interprété intrinsèquement comme aliénation, alors que le marxisme classique ne posait comme aliénantes que les conditions (capitalistes) du travail. La technique est alors perçue comme le lieu de cette aliénation. On retrouve là une transposition du thème biblique du travail-punition.
On commence donc à percevoir que la technique moderne, même si son projet formulé est le «bonheur», exprime en son essence cette même Volonté de puissance que n'a jamais admise, depuis le mythe de la tour de Babel, la vue-du-monde biblique. C'est pourquoi les héritiers de cette vue-du-monde refusent si souvent la technique. Eux aussi ont vécu l'événement colossal qu'est la prise de consciente de la technique moderne comme réceptacle de la Volonté de puissance; eux aussi y ont vu une contradiction totale avec la conception du monde héritée de l' humanisme occidental et de la métaphysique platonicienne de la «recherche du souverain bien» (agathos). Si le stade de la sur-consciente peut conduire à vouloir la technique, il peut donc aussi amener à la refuser avec angoisse. Naît ainsi un nouveau clivage, issu de conceptions du monde opposées. La guerre des dieux, prédite par Nietzsche, est commencée.
La Volonté de puissance, lorsqu'elle s'exprimait dans la métaphysique, demeurait «innocente». Elle n'avait pas atteint la maturité de l'âge d'homme. Les temps modernes, au contraire, créent la première configuration «historiale» où, dans l'essence de la technique, le vieux rêve helléno-européen de désenchaîner Prométhée devient possible. Les temps modernes inaugurent, entre deux minorités conscientes, une guerre fondamentale: les humanistes universalistes, adeptes d'une opinion «chrétienne avancée» qui n'a plus rien de religieux, s'opposent au surhumanisme tel que Nietzsche I'avait inauguré. C'est la lutte du «vieux monde» contre les temps modernes ; des Occidentaux contre la «nouvelle Grèce de l'Hespérial»; de 1'idée de bonheur, que soutient le principe de raison, contro 1'idée de puissance comme spiritualité immanente. Il s'agit bien de la même guerre qui, sous une autre forme, opposa le monothéisme chrétien aux dieux grecs. Aujourd'hui, le retour d'Apollon s'accomplit sous une forme bien différente de celle des cultes pythiens, des superstitions delphiques ou même des beaux-arts. Apollon est (peut-être) de retour, mais pas sous une forme innocente et rassurante. Il est de retour au sein même de l'inquiétance de la technique moderne. Dans le tonnerre des moteurs, dans la sorcellerie des laboratoires et des cyclotrons, dans l'ascension profanatrice des fusées spatiales, se creuse le tombeau de la Raison.
Cette «déclaration de guerre», nul doute que Heidegger en eut une claire conscience. La fin du texte sur Le mot de Nietzsche «Dieu est Mort » s'achève ainsi: «La pensée ne commencera que lorsque nous aurons appris nette chose tant magnifiée depuis des siècles: la raison est la contradiction la plus acharnée de la pensée». Heidegger apparaît donc bien comme l'authentique fossoyeur (et le successeur) de la métaphysique. A la volonté de puissance noétique (nous, «esprit») de la métaphysique, il oppose le chemin vers une volonté de puissance poiétique. Parvenir à la spiritualisation consciente et organisée, apollinienne, de la volonté de puissance dionysiaque en oeuvre dans la technique, tel est très exactement le sens du chemin qu'il nous indique chemin qui «ne mène nulle part», en ce sens qu'il ne conduit à aucun repos, à aucune fin de l'histoire dans le «bonheur», mais débouche sur un combat en perpétuel devenir. Le. sens de la «civilisation hespériale» redevient grec dans l'acception héraclitéenne: le destin historique voulu comme guerre en éternel inachèvement.
Le combat entre les tenants de cette philosophie de l'existence et les «derniers hommes» de la morale et de la raison, tout aussi conscients Ies uns que les autres, ressemblera, paradoxalement, à un affrontement entre la religiosité et la non-religiosité. Les «hommes du bonheur» ne peuvent en effet que se choisir un destin non religieux: leurs normes humanistes et leurs universaux ont été une fois pour toutes dé spiritualisés. Ils se privent par ailleurs de la seule forme virtuelle de spiritualité moderne la Volonté de puissance en acte dans I'arraisonnement technique. Ils savent, bien qu'ils soient encore peu à le formuler, qu'une «technique sans volonté de puissance» n'est pas envisageable. Déjà, plusieurs tenants de l'Ecole de Francfort, ainsi qu'un Ivan Illich, ont formulé le refus, motivé et conscient, de la technique comme «tentation de puissance». Leurs thèses ne sont pas intellectuellement critiquables : ils font une lecture correcte de Nietzsche et de Heidegger. La «guerre» se passe, en fait, à un niveau beaucoup plus fondamental. Elle oppose des valeurs existentielles. Elle porte sur cette question capitale: comment vivre, et selon quel sens ?
Ainsi, le paysage des temps modernes s'éclaire. Trois types d'humanité coexistent. Viennent d'abord les hommes de la simple conscience, qui vivent encore innocemment la technique sans la percevoir en contradiction avec leur morale, et qui constituent un «fond» pour les deux autres types. Viennent ensuite les «derniers hommes», les humanistes qui ont pris conscience du nihilisme de leur vue-du-monde, mais qui n'entendent pas s'en défaire, car l'«après»» les terrorise. Ceux-là se réfugient dans une sorte de morale du plaisir. Leur «subversion» est paradoxalement placée sous le signe de la douceur bourgeoise. Ils n'ont pas abandonné leur quête de la raison, mais ils savent maintenant que toute raison est incompatible avec la technique, c'est-à-dire que la technique, au-delà de ses aspects superficiels, est porteuse de dé-raison. Dès lors, ils refusent tonte spiritualité qui équivaudrait à une glorification de la puissance, et, poussant le rationalisme jusqu'a son terme, redécouvrent la morale, après avoir constaté le divorce de la technique et de la raison. Enfin, on trouve les hommes du «troisième type»: ceux qui entendent soumettre les forces matérialistes de la technicité moderne à l'irrationalité «sage» - au sens grec de sophia, «clarté volontaire de l'entendement» - de nouvelles valeurs. Et c'est à la pensée de Heidegger qu'ils se rattachent..
Dans L 'époque des conceptions du monde, texte d'une conférence prononcée en 1938 sous le titre de Die Begriindung des neuzeitlichen Weltbildes dureh die Metaphysík («Le fondement de la conception du monde des temps modernes à travers la métaphysique»), Heidegger précise, comme nulle part ailleurs, son analyse de la modernité. Il y pose, en particulier, la question de l'essence des temps modernes.
Cinq phénomènes caractérisent les temps modernes. Le premier, nous l'avons vu, touche à l'envahissement de la «technique mécanisée comme prolongement de la métaphysique». On doit entendre par là, quoique Heidegger ne l'ait jamais formulé clairement, que la technique prolonge la métaphysique, dans la mesure où elle reprend à son compte la pulsion de la Volonté de puissance. Deuxième caractéristique des temps modernes: l'art (Kunst) cesse de se confondre avec la téchné pour «entrer dans l'horizon de l'esthétique» et de ce fait, s'objective Troisième caractéristique: le fait que l'activité humaine soit désormais comprise et accomplie en tant que «civilisation » (Kultur). La civilisation, écrit Heidegger, prend conscience d’elle-même, en tant que mitre des préoccupations détrônant les querelles religieuses». Quatrième caractéristique: le «dépouillement des dieux, (Entgötterung), par lequel, précise Heidegger, «d'un côté l'idée générale du monde (Weltbild) se christianise, et de l'autre, le christianisme transforme son idéal de vie en une vision du monde (la vision chrétienne du monde)». Le dépouillement des dieux, ajoute Heidegger, c'est l'état d'indécision par rapport à Dieu (...) Le christianisme est le principal responsable de son avènement (...) Quand les choses en viennent là, les dieux disparaissent.. Le vide qui en résulte est alors comblé par l'exploration historique et psychologique des mythes». Le christianisme, en d'autres termes, même s'il doit être abandonné et dépassé, a eu, dans notre destin, cette fonction fondamentale (et inconsciente) de donner à l'homme la possibilité de se doter d'une conception du monde planifiée et cohérente. Heidegger, plus qu'un antichrétien ou un non chrétien, s'affirme ici comme un post-chrétien, qui entend, à ce titre, en finir avec la tradition chrétienne afin de la dépasser.
La cinquième caractéristique des temps modernes est sans doute la plus fondamentale: elle constitue, précisément, ce qui, dans un mouvement dialectique de «contradiction-depassement», permettrait d'établir consciemment une conception du monde post-chrétienne. Il s'agit de la perception du monde à travers la science. Heidegger demande: «Sur quoi repose l'essence de la science moderne?» Il écrit aussi qu '«il est possible d'entrevoir l'essence propre de tous les temps modernes». Outre L'époque des conceptions du monde, un autre texte doit être interrogé pour formuler une réponse. C'est celai de la conférence Science et méditation, prononcée à Munich en 1953. Levons tout d'abord quelques équivoques. «Pas plus que l'art, la science ne se réduit à une activité culturelle de l'homme», dit Heidegger. Il ajoute: «La science est un mode, à vrai dire décisif, dans lequel tout ce qui est s'expose devant nous». Plus qu'un trait culturel, la science doit être interprétée comme le regard même, par lequel les temps modernes, et pas seulement «les scientifiques», s'approprient le monde et te font devenir comme réel. La perception scientifique du monde n'est pas «le monde perdra comme exactitude»: elle se confond avec la réalité du monde. Ainsi que le vit aussi Werner Heisenberg, le point de vue scientifique sur le monde, que partage, comme un destin sur lequel on ne revient pas, tonte notre civilisation, n'apporte aucune «certitude» sur une illusoire objectivité du réel; ce point de vue fait lui-même partie, tout simplement, de « notre monde». Autrement dit, la science moderne ne se caractérise pas, par rapport à la doctrina médiévale ou à l'épistémè grecque, par sa plus grande exactitude, mais par son projet. «L'essence de ce qu'on nomme aujourd'hui science, c'est la recherche», dit encore Heidegger, qui précise «L'essence de la recherche consiste en ce que la connaissance s'installe elle-même, en tant qu’investigation, dans un domaine de l'étant, la nature ou l' histoire (...) Le processus de la recherche s'accomplit par la projection d'un plan déterminé (...) d'un projet (Entwurf) de reconnaissance investigatrice».
Les sciences, par exemple, utilisent les mathématiques, qui pénètrent d'ailleurs aujourd'hui dans toutes tes activités sociales. Or, ta mathèmata, en grec, signifiait: «les choses connues d'avance». La science, en effet, anticipe à sa façon ce qu'elle découvrira dans la nature. Elle ne vise pas à en dé-celer les secrets; elle sait d'avance ce qu'elle y trouvera: non pas le «réel », mais un projet technique de mobilisation. L'aérodynamicien ne «recherche» pas les arcanes des flux aériens ; il ne vise même pas, à proprement parler, à les «comprendre», mais à formuler mathématiquement «quelque chose à propos d'eux», afin de parvenir à un objectif qu'il connaît déjà: faire manœuvrer de façon optimale un chasseur à réaction à haute vitesse. De même, les mathématiques ne «décrivent» rien de la nature, mais sont l'expression d'une visée humaine sur la nature. La science procède par «détermination anticipée» d'un projet de ce qui sera désormais la nature. La rigueur et l'exactitude ne se trouvent pas dans les sciences, ni dans le regard que celles-ci jettent sur la nature, mais dans la détermination du projet lui-même. La science peut alors se définir comme «recherche par le projet qui s'assure lui-même dans la rigueur de l'investigation». La méthode expérimentale découle, non de la «raison», mais de cette psychologie de la recherche combative. «Ni la doctrina médiévale, ni l'épistémè grecque ne sont des sciences au sens de recherche, il n'y a pas piace en elles pour une expérience scientifique», souligne Heidegger.
Plus précisément, Heidegger distingue trois «niveaux» historiques d'expérience «exploratrice». Le plus bas, celui des chrétiens, est l'argumentum ex verbo: «la discussion des paroles et doctrines des différentes autorités» a transformé les philosophies antiques, ouvertes (Platon et Aristote eux-mêmes n'étaient pas dogmatiques), en dogmes fermés et en dialectiques scolastiques, «La possession de la vérité a été proprement transportée dans la foi, c'est-à-dire dans le fait de tenir pour vrai la parole de l'Ecriture et le dogme de I'Eglise». La recherche se ramène alors à l'exégèse. L'humain est dépossédé de tout projet. Le deuxième palier de la recherche est celui de l'antiquité païenne, remis en honneur par Roger Bacon au XIVeme siècle: « La discussion des doctrines est remplacée par 1'observation des choses elles-mêmes (argutnentum ex re}, c'est-à-dire l'empeira aristotelicienne ». Enfin, le troisième stade de la recherche, celai de la science moderne, perd toute «humilité» devant les choses. La nature devient dans sa corporalité - le lieu du projet planifié, et non plus le but d'investigation pour la connaissance. La science moderne prend pour visée la technique, et non plus l'être de la nature.
La spécialisation scientifique n'est pas la conséquence, mais la raison du progrès de la recherche. C'est parce que la nature a été, des le départ, conçue comme «spécialisée » à l'image de la spécialisation du mouvement technique, que la recherche a été possible. La science moderne est elle-même déterminé par le «mouvement de l'exploration organisée» (der Betrieb). En procédant, métabiologiquement, par accumulation organisé de ses propres résultats, elle suit la vie de l'investigation progressante. De ce fait, le «procédé» acquiert la primauté sur l'étant, c'est a dire sur la nature et l’histoire.
« Ce déploiement de la recherche, prévient Heidegger, est {...) le signe lointain et encore incompris, indiquant que la science moderne commence à entrer dans la phase décisive de son avènement». Par le procédé scientifique, le réel tombe sous le coup de la sécurisation (Sicherstellung), c'est-à-dire de l'objectivation maximale. Pour Heidegger, le savant, le littérateur, le professeur, sont aujourd'hui relayes par le chercheur engagé dans des programmes. L'Université, en tant qu'institution fixe de recel du savoir, s'efface devant les centres de recherches dont les projets tombent sous le coup du devenir. «Le chercheur, écrit Heidegger, n'a plus besoin de bibliothèque, il est en routa. Et de fait, les «banques de données» ne sont plus des bibliothèques, puisqu'elles évoluent constamment, non pas à la façon de stocks remis à jour périodiquement, mais en tant qu'instruments cammis par un projet impérieux, qui les «saccage » et les re-compose sans cesse.
«L'organisation de l'exploitation scientifique», mobile, spécialisée, ne tolère pas les recherches hors programme. «projet et rigueur, procédé et organisation des diverses centres, constituent, dans leur interaction continuelle, l'essence de la science moderne». Nous pouvons alors parler d'objectivation de l'étant: la nature est «forcée», 1'histoire arrêtée», l‘« être de l'étant» perd tout attrait. Seul compte le fait que nature et histoire nous deviennent objets. «La vérité est devenue, précise Heidegger, certitude de la représentation». Depuis que Descartes osa douter de la nature et la déduire de son entendement, c'est-à-dire la subordonner à sa perception, la conception scientifique du monde est née.
Avec les temps modernes, le monde devient dont pour la première fois une «image conçue». «L'essence de l'homme change dans la mesure où l'homme devient sujet ». Le cosmos, la nature et l'histoire n'existent plus qu'en référence avec le «sujet central». L'étant (ou le monde) se transforme en un monde-conçue, plus exactement en une Weltbild, c'est-à-dire en une image conçue du monde ou, plus simplement, en une «conception du monde». Telle est la caractéristique «historiale» de notre époque, qui la sépare de toutes les précédentes. Heidegger écrit, en résumé: «Les locutions comme conception du monde des temps modernes et conception moderne du monde disent deux fois la même chose, et supposent ce qui n'a jamais été possible auparavant, à savoir une conception du monde médiévale et une conception du monde antique (...) Que le monde comme tel devienne une image conçue, voilà qui caractérise et distingue le règne des temps modernes.
L'étant et le monde n'existent aujourd'hui que pour autant qu'ils sont l'objet d'une visée, qu'ils sont «arrêtés pour l’homme dans la repréntation et la production». Pour le Moyen Age chrétien, au contraire, ils ne tiraient lette existence que du fait d'une «production divine»: le monde était l’ens creatum, «ce qui est créé». Pour les Grecs, le monde était le contenant de l’homme. L'homme grec est l'«entendeur de l'étant», «le monde de l’hellénité ne saurait devenir mage conçue», Heidegger ajoute: «L'homme est regarde par l'étant, par ce qui s'ou re a la mesure de la présente autour de lui rassemblée ».
La pensée de Heidegger nous force ainsi à sortir de la logique rationnelle. Heidegger entend à la fois revenir au monde grec et avaliser la Weltbild moderne - après avoir montré que cette dernière ne procède pas de l'hellénité, puisque l'homme grec se pensait « partie du monde» et ne se l'appropriait pas comme une «image» extérieur. Rappelons-nous que le déterminisme linéaire de la causalité n'entre pas dans la conception heideggerìenne da temps; ce monde envisagé comme visée, donc comme non-monde, marque en mense temps l'apogée d'un processus de dévalorisant nihiliste et une virtualité de re-valorisation.
Nous disions plus haut que c'était le christianisme, par l'intermédiaire de la métaphysique platonicienne, qui avait inauguré cette possibilité de représentation eidétique du monde: en effet, «pour Platon, écrit Heidegger, l’etantité de l’étant se détermine comme eidos (ad-spect, «vue »). Voilà la condition lointaine, historiale, souveraine, dans le retrait d'une secrète méditation, pour que le monde (Welt) ait pu devenir image conçue (Bild) ». Nous sommes les héritiers de cette repraesentatio. Re-presenter signifie ici: faire venir devant sol, en tant qu'obstant (entgegenstehendes). Le paradoxe peut alors se formuler ainsi: quoique nous entendions le dépasser, l'héritage platonicien doit être assumé. Dévalorisant une valeur, le monde, devenu « image» métaphysique, théologique, puis scientifique, en crée virtuellement une outre: le sujet, qui devient par là la «mesure de toutes choses ». Cotte re-création virtuelle d'une autre typologie de valeurs s'opère aussi bien dans le platonisme que dans le christianisme. Quoique Heidegger ne le précise pas, c'est la Volonté de puissance qu'il faut voir à l’œuvre à travers ce processus de représentation du monde. Celle-ci porte en elle un double mouvement: accouplée la métaphysique, elle produit, par dévalorisation du monde, le nihilisme. Mais, dès que l'époque technique s'inaugure, cette volonté de concevoir le monde, jusque-là intellectuelle, se dévoile crinale réalité : l'humain prend alors la mesure de sa force et peut se poser en valeur.
De nouvelles valeurs apparaissent par le fait que l'homme «se met lui-même en scène». De ce fait, deux possibilités se présentent ou bien, de ce nihilisme «sauverain», va surgir l'inauthentique, ou bien, procédant exactement du même processus, va pouvoir s'opérer un mouvement «historia.», radicalement opposé, de re-valorisation. De la situation de l'homme (Stellung) peuvent aussi bien naître l'humanisme dévalorisant que le surhumanisme re-valorisant, qui scellera un retour (mais sous une autre forme, celle précisément d'une « conception du monde») à l'hellénité.
Comment ce «monde devenu image conçue pour l'homme» peut-il donner lieu à deux phénomènes divergents, l'un de déclin, l'autre de renaissance? C'est que l'homme moderne, en se re-présentant le monde, l'amène devant lui, «se» le ramène (vor sieh hin und zu sich her Stellen). A partir de là, deux virtualités se dressent, parfaitement repérées par Heidegger dans cette proposition fondamentale: «Ce n'est que là où l'homme est déjà, par essence, sujet qu'est donnée la possibilité de l'aberration dans l'inessentiel, du subjectivisme au sens de l'individualisme». Telle est la première possibilité, celle qui, jusqu'a présent, l'a emporté. Le règne du sujet débouche sur le «subjectivisme» et le règne de l'homme sur l'humanisme moral et individuel. Mais écoutons la deuxième partie de la phrase: «C'est également là où l'homme reste sujet que la lutte contre l'individualisme et pour la communauté, en tant que champ et but de tout effort et de toute espèce d'utilité, a seulement un sens». Reprenons maintenant les deux hypothèses. Première possibilité: l'humanisme moral, qualifié de «repli dans l'anhistorial», utilise le règne de l'homme pour construire une «anthropologie esthético-morale» centrée sur l'idéal social individuel, la «théorie du monde» de la métaphysique s'étant changée, à partir des XVIIème et XVIIIème siècles, en «théorie de 1'homme» (19), exactement de la même façon que l'égalitarisme religieux s'était métamorphosé en égalitarisme social à la même période. Deuxième possibilité: toujours dans le cadre de ce «processus fondamental des temps modernes de conquête du monde en tant qu'image conçue», une autre conception du monde se fait jour, radicalement opposée, bien qu'héritée de la même prise de conscience «historiale». Contrairement à l'humanisme moral, qui conserve des valeurs métaphysiques désacralisées, elle pose des valeurs immanentes sacralisées, et brise le nihilisme.
Le contraste entre l'humanisme moral et ce que nous appelons le surhumanisme, est alors saisissant: Heidegger parle de «lutte entre visions du monde». Cette lutte «par laquelle les temps modernes entrent dans la phase décisive de leur avènement» et que Heidegger estime à son début, opposera en effet deux types d'hommes, qui donneront à la même question, au même appel du destin, deux réponses bien différentes. Heidegger, lapidairement, formule le dilemme: «Ce n'est pas parce que - et dans la mesure où - l'homme est devenu, de façon insigne et essentielle, sujet, que par la suite doit se poser pour lui la question expresse de savoir s'il veut et doit être un moi réduit à sa gratuité et lâché dans son arbitraire, ou bien un nous de la société; s'il veut et doit être seul ou bien faire partie d'une communauté». Les deux possibles sont donc «entrelacés». Dans le premier cas, l'individualisme, attitude «inauthentíque», se réfugiera dans la reconstruction de pseudo-valeurs, imitations des noumènes métaphysiques; l'homme, isolé dans l'individu, «existera comme humanité». Dans le deuxième cas, il existera comme «Etat, nation et peuple».
La nouvelle typologie des valeurs commence alors à se préciser. Le cadavre de Dieu peut être enterré, et les idoles, pour reprendre l'expression de Nietzsche, c'est-à-dire les idéaux dévalués de l'humanisme, «entrent dans leur époque crépusculaire». Les temps modernes peuvent éprouver du même coup, en tant que valeurs, et non plus seulement comme réalité sociétaire ou comme sous-valeurs déduites d'idéaux supra-sensibles, la destinée humaine sous sa forme la plus concrète: le devenir dans l'histoire des peuples vécus comme communautés de destin. L'humain est placé, au même titre que dans la tradition hellénique, mais sous un mode différent, au sommet de la pyramide des valeurs, alors que, dans l'humanisme, l'humain était toujours soumis à des abstractions: la morale, le bonheur individuel, les principes humanitaires, les normes du «bien» et du «mal» de la société bourgeoise, normes inauthentiques parce que dépourvues de sacré. Ces valeurs humaines ne se réclament d'aucun sens ultime. La communauté historique du peuple, affirmée par Heidegger comme nouvelle typologie de valeurs, ne trouve d'autre justification qu'elle-même. De cette manière s'opère un retour aux Grecs: dans la mesure où la communauté s'enracine dans l'éue-au-monde «physiologique» du peuple, la nature est retrouvée du même coup, la séparation entre la conscience et la nature, entre la pensée et la vie, se trouve surmontée. Les temps modernes, par la science et la technique qui les innervent et Ies pénétrant d'une Volonté de puissance effective, matérielle, sont susceptibles de conférer aux valeurs de la communauté historique du peuple Ieur auto-justification. Par la puissance matérielle mise à notre disposition, le «gigantisme», dit Heidegger, «fait son apparition». Ce gigantisme ne conduit pas nécessairement au quantitativisme ni, pour employer 1'expression de Georg Lukàcs, à la «réification». «On pense trop court, souligne Heidegger, quand on s'imagine avoir expliqué le phénomène du gigantisme à laide du seul mot d'américanisme. Car le gigantisme est bien plutôt ce par quoi le quantitatif devient une qualité propre, et ainsi un mode insigne du Grand (...) Le gigantisme devient 1'Incalculable». Autrement dit, c'est du nihilisme calculateur et de la finitude quantitative que surgit la valorisation in-calculable.
On peut dire de cette époque qu'elle est incontestablement «ombreuse», dans la mesure où te quantitativisme y provoque l'esprit de calcul et le matérialisme, mais aussi qu' « elle annonce autre chose, dont la connaissance nous est présentement refusée». Heidegger vilipende ici ceux qui en restent, comme son «disciple» Marcuse, au refus réactionnaire de la modernité technique : «Le repli sur la tradition, frelatée d'humilité et de présomption, n'est capable de rien par lui-même, sinon de fuite et d'aveuglement devant l'instant historial». Les valeurs de peuple et de communauté ne sont admissibles que si elles sont reliées au «gigantisme» que nous apporte la puissance scientifique et technique; elles n'apparaissent susceptibles de modifier les mentalités qu'au travers de la grandeur décelable dans la modernité. La «tradition», l'«enracinement», s'ils sont entendus en opposition avec celle modernité, s'ils se conçoivent indépendamment de la volonté de puissance technique, constitueront des pseudo-valeurs, porteuses d'un nihilisme absolu.
Le peuple et la modernité technique constituent ainsi deux sens de vie fondamentaux. La mort des anciennes valeurs, provoquée par l'objectivation métaphysique puis scientifique du monde. se trouve dépassée. Là où gisait la fin de tout espoir de redonner un sens à l'existence, dans « l’oubli de l'être», dans la dévalorisation quantitative (intellectuelle, puis matérielle) de toutes choses, en ce lieu même surgit ce que Heidegger nomine un questionnement créateur. Les peuples peuvent alors créer une valeur par ce même processus qui a anéanti l'ancienne typologie des valeurs: «l'objectivation de l’étant». Cette objectivation, poussée jusqu'a son paroxysme par I'arraisonnement technique, débouche - comme par exemple la physique nucléaire - sur la perfection du monde, non plus comme objet, mais comme rien. Ce rien ne se confond en aucune façon avec le «nul» du nihilisme: il change l'humain de sens, et confère au sujet agissant le monopole de la valeur. Devenu « rien», le monde retrouve son mystère, non «par lui-même», mais en tant que lieu inconnaissable d'un combat de l'homme contre lui-même, de la Volonté de puissance contre toute limitation de cotte puissance. Concrètement, il est alors donné aux peuples la possibilité d'accomplir leur destin «historial» par la Volonté de puissance scientifique et technique. Le sens de l'existence est retrouvé; Heidegger le propose à ceux qui auront la force et le courage de le supporter. Il écrit, annonçant en quelque sorte un «troisième homme» : «L'homme futur est transposé dans cet Entre-Deux (...) Ce n'est que là où la perfection des temps modernes les fait atteindre à la radicalité de leur propre grandeur, que l'histoire future se prépare». Reconnaître et assumer pour nous, en tant que peuples doués de Volonté de puissance, notre grandeur dans la grandeur de notre modernité : c'est accomplir le désenchaînement de Prométhée. Et pour que nul ne se trompe sur ses intentions, Heidegger cite, à la fin de son essai sur l'époque des conceptions du monde, ce poème de Hôlderlin intitulé Aux Allemands :
«Bien étroitement limité est le temps de notre vie
Nous voyons et comptons le nombre de nos ans
Mais les années des peuples,
Oeil morte les vit-il jamais ?»
V. VERS L 'AGE APOLLINIEN
«Comment quelqu'un peut-il se cacher devant ce qui ne sombre jamais?» (Héraclite, Fragments).
Parmi les nouvelles valeurs inaugurées à mots couverts par Heidegger, on trouve, nous l'avons vu, l'idée d'un dédoublement de l'humain entre une humanité connue comme fond au même titre que la phusis, et une « surhumanité», pour reprendre l'expression de Nietzsche, qui ne se différencierait absolument pas de la première sur le plan physique, anthropologique ou social, mais sur celui de la conscience et de la fonetion historique, et dont les représentants ne seraient commis par nul autre qu'eux-mêmes. Ces derniers seraient les «diseurs de parole», les ordonnateurs de la Volonté de puissance technique. Heidegger n'a évidemment jamais imaginé, sur le pian politique, les implications de ce nouvel état historique des valeurs. I1 ne cherche toutefois pas à en dissiper l'inquiétude - lui qui pense précisément le monde contre royaume de l'inquiétante, et I'homme comme l'inquiétant par excellence. Mais, d'autre part, il nous indique aussi d'autres chemins à suivre, en particulier ceux qui ont trait à sa conception de l'histoire. Le premier après Nietzsche, Heidegger a en effet proposé une conception non segmentaire de l'histoire, notamment dans son Introduction à la métaphysique. Cette conception débouche sur une «indication de valeur» : la recherche pour l'homme d'une communauté de destin impliquant la re-création de liens de nature spirituelle entre I'individu et son peuple, entre le Dasein et le Volk. C'est cette démarche intellectuelle que nous voudrions examiner maintenant.
L'existence (Dasein) nous fait «être dans le monde» (in der Welt sein) ; elle nous fait, par là, «sortir de nous mêmes». Le monde, en effet, n'est pas seulement déchiffrable comme «monde objet» (Dingwelt) ou comme monde utilitaire (le Zeugwelt des scientistes). Heidegger regarde le monde-pour-l'homme comme «monde-avec-soi» (Mitwelt). Exister, c'est être dans le monde, et donc d'abord vivre avec autrui (Dasein ist Insein-Mitsein). Mais comment être-avec-autrui ? Certainement pas en considérant autrui comme l'humanité. Dans L'être et le temps, le Mitsein s'accomplit dans le travail pour la communauté. Dans Les commentaires sur la poésie de Hölderlin, publiés en 1944, le Mitsein prend une connotation irrationnelle: il est fonde sur la «révélation affective» (Befindlichkeit). Celle-ci ne peut naître qu'entre des individus qu'unissent un même passé et un même projet historique. L'intelligence rationnelle apparaît donc inapte à réaliser le Dasein humain. Mais ce dernier, que seul peut combler la «révélation affective», se trouve face à un autre problème, tenant au fait que la «révélation affective», parce qu'elle est plus réaliste que la raison, nous met en face du tragique et nous fait prendre conscience de notre déréliction (Geworfenheit). Trois voies s'ouvrent alors: soit l’ivresse consolante de la facticité, et c'est le nihilisme du monde moderne; soit l'angoisse poignante de celui qui a cru et ne serait plus, parce qu'il a pris conscience de la réalité des choses; soit enfin l'attitude guerrière et volontaire du Dasein qui «se prend en charge», qui se saisit de lui-même comme projet (Entwurf).
Ce «projet» ne doit pas se comprendre comme une visée personnelle, mais comme la participation à un Dasein collectif et historique, nécessairement lié à un peuple. «Habiter» et «bâtir» constituent pour Heidegger deux fonctions-clés du Dasein, qui entend assumer son destin d'avoir été «jeté au monde» et qui decide d'échapper à la «déchéance» (Verfallen). Notre civilisation souffre de cette déchéance. Elle est soumise à la domination du « on» (Man)». An-historique, elle poursuit une nouveauté superficielle ; atteinte de néophilie pathologique, elle est rétive au devenir. La soif de sécurité n'est pas une antidote contre l'angoisse. Cette angoisse apporte à I'homme contemporain l'expérience du «nul», qui ne porte pas seulement sur le monde, mais sur lui-même. Il éprouve sa propre nullité. Heidegger estime que notre civilisation expérimente le néantissement (Nichtung). Mais il y a pire: étrangere à tout sentiment tragique, cette civilisation ne comprend pas l’angoisse qu'elle ressent. Au lieu de l'assumer et de la sublimer dans un projet, elle tente de la fuir. Nihiliste et humaniste, elle refuse le tragique et son «étrangeté inquiétante» (Unheimlichkeit). Elle se réfugie alors dans le pire des refuges : le petit familier, le bonheur de l'immédiateté individuelle. Le Dasein, appauvri, mutilé, ne meurt mémé plus d'angoisse ou de déréliction, mais il se recroqueville et s’évanouit. Le destin se résorbe dans la subjectivité de l'atomisation individuelle. Les peuples s'endorment, puis meurent. Cette déchéance repose sur une conception inauthentique de la temporalité (Zeitlichkeii), provoquée par la métaphysique déchue de l'humanisme. L'homme refuse d'erre ce qu'il est, un être-pour-la-mort (Sein zum Tode), et s'étourdit dans l'illusion d'un désir d'éternité qu'il croit trouver dans la mondanité quotidienne. Une telle conception du temps repose sur une vulgarisation de la temporalité, et sur des idées de «fin de la mort» et de fin linéaire de 1'histotre comparables à celles que I'on trouve dans les philosophies du «progrès». Tout projet historique de devenir est alors rejeté comme «angoissant», pare qu'il implique que l'homme regarde la mort en face.
 Rejetant la conception segmentaire du temps qui précipite l'homme vers le «repos» et la fin de tonte angoisse, Heidegger présente un autre type humain. Ce type caractérise l'homme qui, consentant à la mort, «prend une décision anticipante» résolue et va «au devant de la mort sans pour autant renoncer à son projet d'existence. L'existence (Dasein) est alors acceptés tragiquement mais sans équivoque comme souci (Sorge); l'activité humaine est assumée comme «vie soucieuse» (Fürsorge). L'authenticité de l'existence individuelle consiste à dépasser la mort individuelle, à admettre que l'avenir se confond avec l'advenir à soi, c'est-à-dire l'avancée vers sa propre mort. Or, seule la mobilisation du Dasein dans une communauté, dans un peuple, seul l'altruiste affectif trouvé par le don de soi à l'Autre est susceptible de surmonter le tragique de l'existence individuelle. Heidegger n'hésite d'ailleurs pas à parler d'«amour», mais en un sens autrement plus concret, plus réel que l'amour chrétien, où 1'on est seulement sommé d'aimer tout le monde - c'est-à-dire personne.
Rejetant la conception segmentaire du temps qui précipite l'homme vers le «repos» et la fin de tonte angoisse, Heidegger présente un autre type humain. Ce type caractérise l'homme qui, consentant à la mort, «prend une décision anticipante» résolue et va «au devant de la mort sans pour autant renoncer à son projet d'existence. L'existence (Dasein) est alors acceptés tragiquement mais sans équivoque comme souci (Sorge); l'activité humaine est assumée comme «vie soucieuse» (Fürsorge). L'authenticité de l'existence individuelle consiste à dépasser la mort individuelle, à admettre que l'avenir se confond avec l'advenir à soi, c'est-à-dire l'avancée vers sa propre mort. Or, seule la mobilisation du Dasein dans une communauté, dans un peuple, seul l'altruiste affectif trouvé par le don de soi à l'Autre est susceptible de surmonter le tragique de l'existence individuelle. Heidegger n'hésite d'ailleurs pas à parler d'«amour», mais en un sens autrement plus concret, plus réel que l'amour chrétien, où 1'on est seulement sommé d'aimer tout le monde - c'est-à-dire personne.
Le Dasein, chez Heidegger, est entraîné sur le fleuve du devenir. Toute illusion sur un arrêt des temps, sur une immobilisation des instants, sur une récompense finale, est dissipée. Bien supérieur au modèle chrétien d'existence, le Dasein n'a pas besoin du mythe mensonger de la victoire sur la mort pour agir. Il est d'une nouvelle façon pleinement et authentiquement humain, c'est-à-dire, par rapport à la conscience chrétienne qu'il dépasse comme la dépassait déjà en humanité la conscience grecque, qu'il se pose comme sur-humain.
La conception heideggérienne de la temporalité historique apparaît alors en toute clarté. L'homme-existant, le Dasein, totalise dans son présent t'«ayant-été» (Gewesenheit), qu'il assume, et !e «projet» (Entwurf) dont il participe en lien avec les siens. La conjonction du passé et du projet «ad-venir» rend présent le passé. Celui-ci, comme l'avenir, est rendu présent dans le maintenant. L'existence individuelle confond sa temporalité «subjective» avec l'histoire de sa communauté. La temporalité, qui est toujours vécue au niveau de la conscience individuelle, devient historicité. L 'avenir, la dimension ca pitale, incite le Dasein à faire retour au passé, rendant par là signifiant le maintenant qui se confond avec l'existence humaine. Heidegger qualifie lui-même cette conception du temps, que l'on trouve exposée notamment dans l'Introduction à la métaphysique, de «tridimensionnelle», par opposition aux conceptions uni- ou bidimensionnelles du temps linéaire, cyclique ou segmentaire. Cette conception est héritée, non pas de Nietzsche, mais de Sophocle et des poètes tragiques grecs, auprès desquels Nietzsche était d'ailleurs allé la puiser.
Pour Heidegger, Nietzsche a scellé la fin de la métaphysique, mais sa pensée elle-même appartienne encore à la métaphysique. «Que Nietzsche, écrit Heidegger, ait interprété et perçu sa pensée la plus abyssale à partir du dionysiaque tend à prouver qu'il a dû encore la penser métaphysiquement et qu'il ne pouvait la penser autrement. Mais (...) cette pensée la plus abyssale cache en elle quelque chose d'impensé, qui est en même temps fermé à la pensée métaphysique». Heidegger, nous l'avons dit, dépasse Nietzsche, exactement au sens où Zarathoustra appelait ses disciples, pour le suivre, à «dépasser jusqu'aux Grecs». Nietzsche ayant constitué l'intermède dionysiaque de la pensée occidentale, Heidegger inaugure l'ère apollinienne de ceste pensée, elle-même prélude annonciateur d'une ère apollinienne de l'action.
En quoi Heidegger ouvre-t-il la possibilité d'un âge apollinien - terme qui, reconnaissons - le, ne se trouve pas dans son œuvre? La position de Heidegger sur la métaphysique et la technique est trompeuse. Elle abuse les exégètes qui ne savent voir en lui qu'un adversaire de la technicité et un «chercheur de l'être». Le fait qu'il se lamente sur l'uniformité «diabolique» du monde moderne n'est pas, nous l'avons vu, contradictoire avec sa glorification de l'essence de la technique. C'est ainsi que, dans son essai sur Le dépassement de la métaphysique, il écrit: «L'usure de toutes les matières, y compris la matière première homme, au bénéfice de la production technique (...) est déterminé par le vide total où 1'étant, où les étoffes du réel, sont suspendues». Par ces mots, la civilisation de l'économie et de la marchandise se trouve analysée, bien plus profondément que ne le feront plus tard les «situationnistes», comme la «mise-en-ordre entendue comme la forme sous laquelle l'action sans but est mise en sécurité». L'étant, c'est-à-dire le monde réel, se trouvant dévalorisé au terme du processus métaphysique du nihilisme qui s'achève dans l'humanisme, il ne reste plus aux hommes qu'à l'organiser mécaniquement. La technique, envisagée comme technique-pour-l'économie, comme instrument d'ordre heureux, n'est plus que le moyen de «mise à sac de la terre». «Ce cercle de l'usure pour la consommation, écrit encore Heidegger, est l'unique processus qui caractérise l'histoire d'un monde devenu non-monde (Unwelt)». Ce monde de la dévalorisation du réel et du mésemploi de la technique, c'est-à-dire son emploi nihiliste humaniste, son emploi absurde comme l'instrument d'une métaphysique dévaluée (la recherche de la morale du bonheur), aboutit «à I'exclusion de ce facteur essentiel, les distinction de nations et de peuples». Heidegger ajoute: «De mémé que la distinction de la guerre et de la paix est devenue caduque, de même s'efface aussi la distinction du national et de l'international. Qui pense, aujourd'hui, en "Européen" n'a plus à craindre qu'on lui reproche d'être un internationaliste. Mais il est vrai aussi qu'il n'est plus un "nationaliste" puisqu'il n'a pas moins d'égard au bien des autres "nations" qu'au sien propre».
Cette usure de l'étant, selon Heidegger, doit s'entendre, non pas tant comme 1'àge de l'égalitarisme que comme le règne de l'uniformité: «Avant toutes les différences nationales, cette uniformité de l'étant entraine l'uniformité de la direction, pour laquelle toutes les formes politiques ne sont plus qu'un instrument de direction parmi d'autres. La réalité consistant dans l'uniformité d'un calcul traduisible par des plans, il faut que l'homme, lui aussi, entre dans cette uniformité s'il veut rester en contact avec le réel. Un homme sans "uni-forme", aujourd'hui, donne déjà une impression d'irréalité, tel un corps étranger dans notre monde. L'étant s'étend dans une absence de différence qui n'est plus maîtrisée que par une action et une organisation régies par le "principe de productivité". Ce dernier parait entraîner un ordre hiérarchique, mais, en réalité, il est fondé sur 1'absence de toute hiérarchie (...) vu que le but de la production n'est rien de plus que le vide uniforme (...) l'absence de différence qui accompagne l'usure totale provient d'une "volonté positive" de n'admettre aucune hiérarchie, conformément au primat du vide de toutes les visées».
Heidegger oppose donc la volonté positive de 1'àge nihiliste à la Volonté de puissance, qui, elle, est salut, parce qu'elle comporte un projet et un dessein hiérarchisant. La simple volonté qui gouverne, rationnellement, economiquement, notre monde appartient au domaine de l'inauthentique recherche d'une stabilité heureuse. La Volonté de puissance relève au contraire du devenir. Heidegger précise: «La terre apparaît comme le non-monde de l'errante. Du point de vue de l'histoire de l'être, elle est l’astre errante ». Or, c'est ici qu'il est aisé de se faire un contresens. Car Heidegger condamne et glorifie en mente temps la technique - de mente qu'il oppose la Volonté de puissance à la volonté positive, appelée aussi «volonté sans visée». Comparons, pour aliène comprendre, deux citations de Heidegger. La première est celle-ci: «Le bouleau ne dépasse jamais la ligne de son possible. Le peuple des abeilles habite dans son possible. La volonté seuls, de tour cotés s'installant dans la technique, secoue la terre et l'engage dans les grandes fatigues, dans l'usure de l'artificiel (...) Les pratiques qui organisent cette contrainte et la maintiennent dominante, naissent de l'essence de la technique qui n'est autre chose que la métaphysique en train de s'achever. L'uniformité complète de toutes les choses humaines de la terre, sous la domination de la volonté de volonté, fait ressortir le non-sens d'une action humaine posée comme absolue». Nous sommes parti, apparemment, devant une condamnation, un rejet de la technique. Et de fait, pour ceux qui, dans leur lecture, en restent à ce stade, il semble bien que Heidegger s'inquiète de cette époque de domination de la terre où, comme le disait Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit, «la conscience absolue de soi même devient principe de la pensée». Mais voyons maintenant notre deuxième citation. Dans La question de la technique, Heidegger déclare : «La technique n'est pas ce qui est dangereux. Il n'y a rien de démoniaque dans la technique, mais il y a le mystère de son essence. C'est l'essence de la technique, en tant qu'elle est un destin de dévoilement, qui est le danger (...) La menace qui pèse sur l'homme ne provient pas des rnachines». L'idée, cette fois, est tout-à-fait différente. Le danger, entendu par Heidegger à la tois criminel un péril et une noblesse, provenaient en effet du processus historique de l'arraisonnement. C'est pourquoi Heidegger ajoute, citant Hölderlin: «Mais là où il y a le danger, là aussi croît ce qui sauve».
Ce qui «sauve» est donc aussi ce qui constance le «danger». L 'élément salvateur, tout comme l'élément menaçant réside dans l'essence de la technique, autrement dit dans la volonté de puissance devenue conscience voulue. «Là où il y a le danger...», c'est-à-dire au cœur du processus technique de l'arraisonnement de l'humain et de la terre, «là aussi...», c'est-à-dire en ce lieu même où se déchante la technique, «croit ce qui sauve», c'est à dire s'observe, en devenir virtuel, ce qui imposera des nouvelles valeurs. La Volonté de puissance, latente et «inconsciente» dans la technique, présente mais occultée dans l'arraisonnement, peut devenir auto-conscience et prendre en charge l'arraisonnement. A la volonté-sans-visée peut succéder la volonté douée de projet. Et puisque l'essence de la technique, l'arraisonnement, se confond avec le déclin de la métaphysique, cette essence a nécessairement hérité de ce qui gisait, de ce qui serpentait souterrainement dans la métaphysique occidentale, à savoir la Volonté de puissance. Le troisième âge sera alors celui où la Volonté de puissance pourra éclore, éclater au plein jour de la claire conscience. Occulte, métaphysicienne ou chrétienne, dans son premier âge, la Volonté de puissance ne s'exprimait que dans le logos. Dionysiaque dans son deuxième âge, celui de la technique moderne de l'époque nihiliste actuelle, elle peut désormais s'assumer comme tel, se reconnaître comme acte planifié de puissance, dans ce que nous avons appelé l'age apollinien. (Car Apollon est celui qui maîtrise, par l'ordonnance planifiée et rigoureuse de t'entendement, mais qui, en métro temps, donne sens et valeur, qui rend religieux le monde organisé).
Du nihilisme lui-même renaissent ainsi des valeurs. Comment la parole cité plus haut de Hölderlin, Heidegger écrit dans La question de la technique: «Sauver (retten) est reconduire dans l'essence (au sens de "nature profonde") afin de faire apparaître celle-ci pour la première fois, de la façon qui lui est propre. Si l'essence de la technique, l’arraisonnement, est le péril suprême (...) alors, il faut que ce soit justement l'essence de la technique qui abrite en elle la croissance de ce qui sauve».
Quelles valeurs la Volonté de puissance devenue consciente va-t-elle alors «présenter»? Pour répondre à cette question, Heidegger procède par allusions poétiques et mythiques. Enfermer les nouvelles valeurs dans une définition «rationnelle», ce serait en effet, par avance, les dé-florer, les tuer «dans l'œuf» et, déjà, jeter les bases d'un autre nihilisme. Aussi Heidegger se borne-t-il, retrouvant un geste de souveraineté immémoriale, à designer le chemin, en nous disant que la sente des nouvelles valeurs conduit vers une nouvelle Grèce, à laquelle il donne le beau nom d'Abend-Land, terme qu'on ne saurait traduire par «Occident» et que l'on a remarquablement rendu par le néologisme franco-grec d'«Hespérie» (du grec hespera «le soir»), dans lequel nonne le Leitmotiv de l'espérance. Dans le texte Pourquoi des poètes, Heidegger écrit: «Ceux qui risquent le plus... ils apportent aux mortels la trace». Ceux qui risquent : nous avons vu que le risque était de subire le chemin de l'arraisonnement technique en le rendant conscient de la Volonté de puissance. La trace c'est la sente forestière où nous pouvons choisir de nous enfoncer. Mais où mène cette trace? Qui donc y poursuivons-nous? Vers quel monde nous porte-t-elle ? Heidegger répond: «Ceux qui risquent le plus... ils apportent aux mortels la trace. La trace des dieux enfuis dans l'opacité de la nuit du monde».
VI . L'HESPERIAL
«Aucune méditation sur ce qui est aujourd'hui ne peut germer et se développer, à moins qu'elle n'enfonce ses racines dans le sol de notre existence historique par un dialogue avec les penseurs grecs (...) Ce qui à l'aube grecque a été pensé ou dit, vient sur nous. Pour éprouver cette présence de l'histoire, nous devons nous détacher de la représentation historique de l'histoire» (Heidegger, Science et méditation).
Aussi gênant que cela puisse paraître aux yeux de certains, c'est bien aux dieux grecs que pense Heidegger lorsqu'il évoque la « trace » de ce qui doit être retrouvé et que la Volonté de puissance doit pouvoir restituer comme valeurs aux Européens. C'est donc bel et bien une sorte de «paganisme» que Heidegger assigne aux temps modernes. Au monde désespéré de l'humanisme rationnel, il oppose l'ad-venance, au cœur de la civilisation technique moderne, du sacre (das Heilige). Il l'appelle de ses voeux en puisant dans les ouvres de Hölderlin et de Rilke, poètes de l'essence et du retour des dieux. Les textes sont clairs: le salut, pour Heidegger, procédera d'un recommencement grec, c'est-à-dire des retrouvailles, de l'accord, sous une forme historiale différente, du sacre et de la technique, exactement comme à l'aube des temps helléniques. Ainsi pourra s'accomplir l'Eternel retour de l'identique, que Nietzsche avait pressenti sans pouvoir lui conférer un contenu. Accoupler l'irrationnel du sacré et l'immanente matérielle de l'arraisonnement technique, la rationalité planifiée de la mobilisation de la terre et l'inspiration «romantique» que peut susciter la renaissance du sentiment religieux grec, voilà quelle visée Heidegger entend donner à la Volonté de puissance.
L'Hespérie, la «terre du couchant» (Abend-Land), marque alors ce que doit devenir l'Occident, ce vers quoi il doit se nier et se dépasser en se niant, pour reproduire, sous une autre forme, celle de l'immanence sacrée des valeurs terrestres et techniques, la vue du monde de cette aurore que constitua J'hellénisme pré-platonicien. Ainsi cette même Grèce qui, à la suite du platonisme, acclimata en Europe la métaphysique et le judéo-christianisme, est-elle destinée, dans notre présent, à en surmonter la mémoire. C'est en poursuivant, à la trace, les dieux grecs, que nous avions oubliés en tant que passe, mais qui sont appelés maintenant à surgir dans nutre avenir, métamorphosés, que nous régénèrerons notre histoire.
Dans Pourquoi des poètes, Heidegger cite l'Hymne des titans de Hölderlin :
«... et pourquoi des poètes en temps de détresse ?
«Mais ils sont, dis-tu, comme les prêtres sacrés de Bacchus
«Qui de pays en pays, errent dans la nuit sacrée».
Le poète, comme le penseur, au milieu de la nuit, à l'apogée du nihilisme et de l'oubli, annonce le matin. «Dieu est mort», disait Nietzsche. «Il faut retrouver les dieux», répond Heidegger, mais en donnant à ce terme un sens bien différent de celui qu'entendaient les Grecs. Les dieux, ici, signifient la ré-advenance du sacré, à la fois mythique et conscient, destiné à fonder une régénération de l'histoire. Heidegger est contraint de s'exprimer par allégorie puisque, à ce degré de la pensée, il sort du logos et donne à sa propre parole le statut de mythe fondateur: «Le dieu du cep (Dionysos) sauvegarde (...) le lieu férial de l'union des dieux et des hommes. Ce n'est que dans la région d'un tel lieu, si tant est qu'il y en ait un, que peuvent rester des traces des dieux enfuis, pour les hommes dépouillés de dieux (...) Les poètes ressentent la trace des dieux enfuis et tracent aux mortels, leurs frères, le chemin du revirement (...) voilà pourquoi, au temps de la nuit du monde, le poète dit le sacré (...) A nous autres d'apprendre à écouter le dire de ces poètes».
Cette régénération de l'histoire, à laquelle Hölderlin, à travers Heidegger, nous appelle, est risquée. Mais ce risque va de pair avec le caractère inquiétant (unheimlich) de l'humain. Or, pour les Grecs, l'humain n'est pas seulement inquiétant (deinon); il tend vers le surhumain, et c'est en cela qu'il est «le plus inquiétant» (to deinotaton). Heidegger cite le fragment 52 de Héraclite: «Le temps du monde est un enfant, jouant au tris-trac; d'un jeu d'enfant, il est le règne». Il le commente en les termes : «Au risque appartient le projet dans le péril». C'est que le retour des dieux ne doit pas se comprendre comme une «fuite vers les dieux de la Grèce antique», paganisme de pacotille dont se moque Heidegger, en l'assimilant à l'inanité contemporaine des «croyances religieuses». Ce «retour» sera le recommencement grec, la réconciliation entre la «science» et la «philosophie», entre la technique planétaire et la «poésie», entre l'instrumentalité et la spiritualité, entre la subjectivité aux prises avec la matière et le sacré. Cetre réconciliation, opérée au sens de la Volonté de puissance, nous remettra dans une situation destinale identique à celle de l'aurore fondatrice grecque (mais non dans une situation semblable, puisque, entre-temps, la conscience européenne a accédé au stade épochal de la conception du monde).
La trace des dieux enfuis, inquiétante poursuite, nous mène donc à un recommencement qui n'a rien d'un retour en arrière vers le passé connu, mais qui s'enfonce résolument vers ce qu'il y a de plus risqué dans la modernité. Dans une de ses conférences, Heidegger précise quel pourrait être l'augure de ce recommencement: utilisant le terme de volonté, il place celle-ci, par l'intermédiaire de la «science», comme «gardienne du destin du peuple», comme «volonté d'une mission spirituelle et historique de notre peuple». Ainsi, le recommencement grec peut-il inaugurer la présence (Anwesenheit) du sacré dans la conscience historique et l'advenance du peuple - et non plus de l'atome individuel - comme mode de la subjectivité. Le surgissement «hespérial» de cette «nouvelle Grèce» est pensé comme une rupture historique (Aufbruch), comme une sortie violente (Ausbruch) de la modernité inauthentique du nihilisme humaniste, mais aussi cormme irruption (Einbruch) de l'avenir risqué dans notre présent confortable où la science est voulue comme «instrument du bonheur». Cette irruption ne peut s'accomplir que sous les traits de la violence, d'un «brisement» (Zerbrechen) inquiétant et non paisible, et c'est ainsi qu'elle nous fera rentrer dans l'histoire dont nous sommes sortis. Portée par le fleuve du devenir, la conscience qui aura vécu ce recommencement grec, devra comprendre le monde comme «défrichement» (Umbruch), comme travail d'abattage.
Nous retrouvons ainsi la métaphore mythique de la forêt et le bûcheron. Déjà, nous avons dit que suivre le Holzweg nous mènerait dans la forêt, «au cœur de notre travail». Et c'est bien d'un travail de bûcheron qu'il s'agit. Le risque de l'histoire se compare au labeur des bûcherons: rompre (brechen) les arbres et survivre au danger de leur chute. Où nous mène la sente forestière? Elle nous mène à la cité des bûcherons, qui vit sous le signe de la «mixture» (Bruch). Rappelons-nous alors la sentence héraclitiennee panta rei (tout coule en rythme, tout coule en se brisant), dont la véritable signification n'est autre que: «Le monde s'écoule par ruptures successive».
Mais quel sera le premier travail du bûcheron, celui qui accompagnera le défrichement? Ce sera la dislocation (Auseinanderbrechen) du monde ancien. Cette destruction visera une certaine vision que nous avions de notre passé. Le recommencement grec suppose en effet d'abord la destruction d'un passé et le choix d'un autre. Mais ce «nouveau passé» ne saurait étre considéré dans une temporalité antécédente, située derrière nous, comme picuse «mémoire»; son caractère de nouveauté provient de ce qu'il surgit, par notre volonté, devant nous. « Devant », c'est-à-dire qu'il doit être compris sous le mode du «faire-surgir» (er-springen) (somme la «cité des bûcheron» surgit devant les pas de 1'aventureux marcheur forestier) et du «pro-venir» (geschehen). Ainsi seulement, le passé grec sera «histoire», c'est-à-dire provenance advenance (Geschichte).
Dans l'une de ses conférences, Heidegger déclare: «Le commencement est encore là. il n'est pas derrière nous somme ce qui a été il y a longtemps, mais il se tient devant nous. Le commencement a fait irruption (Einbruch) dans notre avenir, il dresse au loin, comme une disposition lointaine à travers nous, sa grandeur qu'il nous faut rejoindre (...) Nous nous voulons nous-mêmes. Car la force jeune du peuple, sa force la plus jeune qui est au-delà de nous, s'empare de la route, celle-là en a décidé déjà. La splendeur et la grandeur de ce départ qui est rupture, nous le comprenons pleinement si nous portons en nous le sang-froid profond et vaste que l'antique sagesse grecque a exprimé par cette parole: Toute grandeur est dans l'assaut».
La conscience contemporaine et ses philosophies ne sont pas encore parvenues à en finir avec l'humanisme. Son cadavre se décompose en humanitarisme. Mais le lancinant discours moral de notre temps, son conformisme carcéral, sonne comme un discours crépusculaire. Nous somme loin des claironnements optimistes des idéologies humanitaires du progrès. Les idéologies et les intellectuels, toujours attachés aux problématiques de l'idéal moral, sont à la fois conscients de s'y trouver enfermés et qu'en sortir leur serait insupportable (car cela es obligerait à suivre l'angoissante ruée de la philosophie nietzschéenne par-delà le bien et le mal). L'attachement à la morale humanitaire, en philosophie des valeurs comme en politique, prend alors tout son sens : celui d'une conscience malheureuse, déçue, geignante, spectatrice coléreuse et larmoyante de l'évaporation de ses utopies. En termes heideggériens, cette attitude de la conscience contemporaine peut être analysée somme une incapacité «historiale» à franchir un nouveau palier d'existence. Au contraire, écrit Heidegger, «l'homme dont l’essence est celle qui est voulue à partir de la Volonté de puissance, voilà le surhomme (Uebermensch), celui qui doit détenir l'irrésistible puissance (Uebermacht) pâtir accomplir sa souveraineté» (Chemins qui ne mènent nulle part, op. cit.). La conscience humaniste est condamnée à vivre avec son inessentielle (Unwesen), qui provient du fait qu'elle gît en déphase par rapport au devenir «historial» des temps modernes, lequel dévoile l'essence de la Volonté de puissance.
La nécessite se déploie, écrit encore Heidegger, d'aller au-delà de nomine ancien, de le surpasser (...) L'homme ancien voudrait continuer d'être 1'homme ancien ; en même temps, il est déjà le consentant de l'étant, de cette étant dont l'être commence à se manifester comme Volonté de puissance» (ibid.) - c'est-à-dire de ce monde rend conscience d'elle-même la Volonté de puissance comme principe de son devenir. L’homme ancien se subit lui-même ; il est comme atteint de schizophrénie. Refusant de renoncer à la modernité, il n'entend pas admettre pour autant l'installation de la Volonté de puissance. Sa position est intenable. La physique nucléaire ou I'ingénierie génétique heurtent sa conscience, mais il n'a ni la force ni la volonté de les abandonner. Alors, ces techniques le dirigent. Ils devient leur commis. Il se place lui-même plus bus que les machines et les techniques.
Heidegger installe donc dans une subjectivité entendue somme destin d'un peuple et d'une communauté le «lieu du vouloir du surhomme». Ces deux éléments, la Volonté de puissance et la définition de son lieu d'accomplissernent, ne sont toutefois jamais présentés en même temps, et c'est en comparant les textes que 1'on obtient la clé de la pensée de Heidegger : le nouveau lieu des valeurs sera l'ordre conscient d'une Volonté de puissance utilisant la science et la technique à travers un autre niveau «historial» de la conscient humaine.
La lutte pour le «règne de la terre» est désormais seul susceptible de fonder de nouvelles tables de valeurs et de redonner un sens sacré à l'existence de la conscience. Suprême ironie de l'histoire en reléguant le sacré hors du monde, la métaphysique a dévalué le lieu où elle posait et nommait ses valeurs - le supra-sensible. Du même coup, elle a, sans le vouloir, contribué à libérer dans le monde la Volonté de puissance et à faire revenir, avec une force virtuelle bien plus considérable qu'aux temps païens, le sacré à son lieu d'origine: la conscience humaine comme partie indétachable de la nature. Commentant ce processus, Heidegger peut écrire: «La terre devient le centre de toute position et de tout débat, objet d'un assaut permanent» - ce qui corrobore la prédiction faille dans le Gai savoir : «Le temps viendra où la lutte pour le règne de la terre sera menée, et elle le sera au nom de doctrines philosophiques fondamentales».
Le surhomme, l'homme de l'auto-conscience qui a objectivé le monde, ne devient surhomme que s'il veut cet acte comme tel, que s'il prend la responsabilité du meurtre de Dieu, que s'il l'assume «historialement». «Par cette mise à mort», précise Heidegger, «l'homme devient autre. Il devient celui qui supprime l'étant (das Seiende) au sens de 1'étant en soi (das Seiend)». Et il ajoute, ce qui n'est compréhensible que si l'on saisit la double signification, dialectique et «hístoriale», du nihilisme «L'essence du nihilisme réside en l’histoire (...) Si la métaphysique est le fond historial de l'histoire mondiale déterminée occidentalement et européennem ent, alors cette histoire est nihiliste en un sens tout nouveau (...) Ni les perspectives politiques, ni les perspectives économiques, ni les perspectives sociologiques, techniques ou scientifiques, pas mense les perspectives religieuses et métaphysiques, ne suffisent pour penser ce qui advient en ce siècle du monde (...) Dans quelle mesure l'homme est-il forcené? Il est for-cené, c'est-à-dire hors du sens. Car il est sorti du plan de i'homme ancien. Cet homme, de la sorte déplacé, n'a pour cette raison rien de commun avec le genre des voyous publics, avec ceux qui ne croient pas en Dieu».
Que ceux qui ont des oreilles entendent.
1 Jean-Michel Palmier, Les écrits politiques de Heiddeger, L’Herne, 1968.
2 C’est-à-dire une description phénoménale de la pensée de l’être.
3 Henri Arvon, La philosophie allemande, Seghers, 1970.
4 Lettre sur l'humanisme, Aubier, 1964. Heidegger précise, jetant un regard en arrière sur son œuvre, que son dessein n'est pas de «philosopher» au sens habituel du terme, mais, par un travail de la pensée qui n'a rien d'«intellectualiste», de répondre aux questions historiques touchant au sens de notre époque. La «question de l’être» ne doit donc pas se comprendre comme un problème philosophique, mais comme une question historique qui concerne l'ensemble de la civilisation «occidentale» devenue planétaire.
5 Hussert estimait que L 'être et le temps avait trahi la méthode phénoménologique, et reprochait à Heidegger de faire de I'anthropologie.
6 La poiésis grecque désigne à la fois ce que nous entendons par poésie et l'activité créatrice des «métiers» les plus divers..
7 La traduction figure dans Chemins qui ne mènent nulle part (Gallimard, 1962).
8 Il s'agit des sentes tracées par les bûcheron qui reviennent de la clairière de coupe. Elles ne traversent pas la forêt, mais constituent les Seuls sentiers conduisant «au cœur des boss».
9 Cf. la conférence Qui est le Zarathoustra de Nietzsche?, publiée dans le recarci Essais et conférences (Gallimard, 1958).
10 «Le plus inquiétant» (o deinotatos) : c'est ainsi que les poètes désignaient l'homme. Il faut entendre «le plus inquiétant de tous les hôtes de la terre», par opposition aux animaux qui, eux, n'ont rien d'inquiétant.
11 Dans le tome II de son Nietzche, Heidegger commente l'idée selon laquelle, si «le christianisme ne fut qu'un platonisme pour le peuple», de nos jours, les noumènes platoniciens n'étant plus portés par les mythèmes chrétiens, toute métaphysique «a perdu sa force historialement structurante.
12 Les valeurs «vécues comme existence» recouvrent ce que Ernst Jünger, dans Der Arbeiter (1932), désignait comme Lebenstand, «classe-de-vie». Le «travail» était alors appelé à devenir la classe-de-vie des temps moderne. Heidegger dépassera ce point de vue, mais conservera l'idée d'une intégration des valeurs à l'existence vécue. Il récusera toutefois le terme de «travail», préférant ne pas enfermer les valeurs vécues dans une dénomination unique. Nommer le «travail» comme classe-de-vie, n'est ce pas déjà, d'ailleurs, l'objectiver et le dévaloriser ?
13 Chemins qui ne mènent nulle part, op. cit.
14 Le monothéisme peut être aussi un paganisme non dualiste. C'est parce que le judéo-christianisme fut à la fois un monothéisme et un dualisme métaphysique qu'il dévalorisa le sacré et finir en morale.
15 On peut rapprocher cette conception heideggérienne de l'histoire de celle de la physique moderne: le temps «de la conscience humaine», néguentropique et porteur d'information, pourrait se comparer à une spirale ascendante, mais qui serait infléchie vers le bas par la spirale descendante du temps «physique», entropique et «désinformant». Voir, sui- cette question: Joël de Rosnay, Le macroscope (Seuil, 1975); Oliver Costa de Beauregard, La notion de temps (Hermann, 1963) et Le second principe de la s cience du temps (Seuil, 1963), où sont exposées les conceptions modernes du temps «non-segmentaire».
16 Cette idée de la «non-neutralité» de la technique se retrouve intégralement chez Jünger.
17 Cf., avec certaines réserves, le livre de Bernard d'Espagnat, A la recherche du réel (Gauthier-Villars, 1979), qui expose les idées modernes des physiciens sur la nature du «réel».
18 Les contradictions culturelles du capitalisme, PUF, 1979.
19 Notamment avec Descartes, puis avec Kant. Dans La Critique de la raison pure, de Kant, le primat du sujet est affirmé comme sujet percevant, ce qui fait suite à la conquète cartésienne de la subjective intellectuelle.
00:07 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, heidegger, nouvelle droite, guillaume faye |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 décembre 2009
L'identité entre devenir individuel et devenir collectif
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
L’identité entre devenir individuel et devenir collectif
Les racines finissent toujours par surgir du passé, là et au moment où on les attend le moins, au détour d'une identité qui s'affermit et consolide ses linéaments culturels, philosophiques et esthétiques. Les racines constituent le socle "gaïen" dans lequel viennent s'ancrer les identités individuelles, plurales, locales, ethniques, régionales et nationales. Ces mêmes racines fondent le "nomos" de nos origines, sa limite spatiale et territoriale, et le cadre ontologique des devenirs collectifs. Les racines, lesquelles sont à la base de nos communautés charnelles de sang et de sol, ont un langage holiste, unilatéral et statique. Tout autre est le devenir individuel des identités qui prend corps dans les matrices du nomos de nos racines. Le devenir des identités individuelles s'inscrit dans un langage dynamique, transversal et constructiviste. En effet, si les racines s'emploient à enfanter biophysiquement à l'état brut une identité, il importe à chaque être humain de façonner, mûrir et affirmer une identité propre. Là se situe la frontière entre le déterminisme de nos origines naturelles et la liberté personnelle qui n'est autre que volonté de puissance. Car nous n’affirmons une identité que dans la mesure ou nous sommes pleinement libres, ç'est à dire capables de générer et d'affirmer dans le présent des valeurs propres, voir selon un schéma heideggerien d'actualiser des actes en puissance.
L'identité individuelle serait en quelque sorte une puissance de flux intégrationiste, qui reçoit, conquiert et digère. C'est pourquoi, la logique des identités individuelles peut parfois être paradoxalement centrifuge à l'endroit même où leurs racines demeurent immuables. Les identités individuelles culminent dans le voyage intérieur, virtuel, et ont pour terrain d'élection l'inconnu multiforme. Elles disposent de capacités d'appréhension et d'attraction inépuisables, et cultivent le goût d'une curiosité insatiable et à bon escient. Dans le cadre d'une perspective deleuzienne, le devenir des identités individuelles progresse dans le temps présent en traçant des lignes de fuite, qui partent toujours du milieu où elles s'affirment instantanément. C'est au cœur de cette perpétuelle gestation de lignes de fuites d'un présent à un autre que peut se produire la rencontre d’une amitié ou d'un amour inestimable entre deux identités authentiques et intrinsèquement différentes. Ce devenir se caractérise par la conquête d'espaces idéologiques et la fermentation d'une pensée vive, d’un savoir libéré des inhibitions morales et sociales. Au carrefour du devenir individuel d'une identité en gestation, peut surgir le devenir collectif et centripète de ses racines.
Alors de la croisée de ses deux routes distinctes pourra naître une navigation existentielle commune, si le dialogue s'instaure organiquement, sans mutilations, blocages et préjugés. Le devenir individuel de l’identité se retrempera progressivement dans le fleuve nourricier du devenir collectif des racines si ce dernier se fait le réceptacle et la brèche ouverte à la maturation et l'épanouissement du premier. Le recentrage au présent de ces deux devenirs complémentaires se fera au prix d'un parallélisme tolérant des formes et du contenu, en évitant les dysfonctionnements toujours possibles. Le réancrage de l’identité individuelle au cœur des racines communautaires fournira à la stabilité d'un socle "gaïen" les denrées d'une pensée éclectique que génère chaque devenir identitaire. Les dimensions architectoniques d'une identité peuvent être profondément urbaines et imbriquées dans les ramifications bétonnées d'une ville qui constitue son champ d'expérimentation et d'expression comme elle représente sa première ligne de front. Son essence originellement tellurique et élémentaire s'encrassera dans l’artificialité des constructions théoriques, comme dans une mélasse confuse d'apocryphes citadins, et participera à ce que Schauwecker écrivait, "le ruissellement des sources souterraines en regardant pourrir et grandir l'époque, dans le creuset d'âmes et d’excréments qui est au cœur de toute ville" .
Retrouver ses racines démétriennes supposera alors de briser les chaînes envoûtantes des rhytmes cinétiques, de la fébrilité et de l’anonymat quantitatif, et de se libérer de l’asservissement du langage individualiste abstrait et autocentrée pour renouer avec le langage élémentaire et polymorphe de la nature, en sachant l'écouter puis communier dans la simplicité en apprenant lentement à comprendre l'arbre de la vie, lequel est vert et florissant alors que toute théorie est grise (pour citer Goethe). Se libérer des circuits de bitume qui convergent vers un centre épidermique et fictif, supposera de déplacer son individualité vers son propre centre spirituel dans les dédales de notre labyrinthe intérieur. Les devenirs collectifs appartiennent à l'ordre de l'immanence et sont versés dans l’historicité comme Dieu reste à l'intérieur du monde comme “causa immanenta”, ainsi que Spinoza l'a si bien enseigné; les devenirs individuels quant à eux s’expriment grâce à la transcendance et appartiennent à la sphère de « l’être possible et global » pour reprendre une catégorie de Jaspers. Elles ont les potentialités pour dépasser le domaine du naturel, de la pure expérience, pour parvenir aux frontières kantiennes du « méconnaissable». Devenir collectifs et devenirs individuels, l'immanence et la transcendance sont sur le chemin rectiligne d’un ciseau qui "ne coupe pas”, pour reprendre une métaphore jüngerienne. Les ciseaux évoluent dans un monde ouvert et fermé; l’effet réside dans la coupure.
Pour des ciseaux qui ne coupent pas, le chemin ne s’est pas encore ouvert, et la souffrance reste secondaire. Dans ce sens, le chemin ne se s'est pas confronté à la qualité (abgespalten), et c'est ainsi que le chemin est plus significatif que le but. Avec cette métaphore, Jünger nous enseigne que les mondes de l’immanence et de la transcendance ne se recouvrent pas, et gardent entre eux une distance comme une certaine tension. La même tension oppose les devenirs collectifs aux devenirs individuels. C’est pourquoi le retour inopiné d'un enfant arrivé à sa maturation identitaire au sein de sa communauté charnelle, peut ressembler au commencement d'une nouvelle ligne de fuite se situant à l’intercession de deux devenirs, entre immanence et transcendance, dont on peut penser que la rencontre est le fruit du destin.
Maître Jure VUJIC.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réflexions personnelles, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 décembre 2009
Kapuscinski, demolitore di luoghi comuni
Roberto Alfatti Appetiti / http://robertoalfattiappetiti.blogspot.com/
Kapuscinski, demolitore di luoghi comuni
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, manipulations, manipulations médiatiques, sociologie, problèmes contemporains, pologne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 03 décembre 2009
Le cauchemar de Marx
| Le cauchemar de Marx |
|
« Au cours des trois ou quatre dernières décennies a dominé une idéologie du dépérissement de l’État, partagée aussi bien par les libéraux que par les sociaux-démocrates. Et ce n’était pas qu’une idéologie. On a tenté et on tente encore de mettre en place des institutions supra-étatiques pour une "gouvernance mondiale", sous l’égide cependant de l’État le plus fort, les USA. On prétendait passer ainsi du "gouvernement des hommes à l’administration des choses", selon une formule de Saint-Simon reprise par Marx et Engels… Mais la crise remet les choses à l’endroit : on retourne aux États-nations, les seules réalités effectives. La "gestion" de la crise par les puissances européennes le montre à l’envi. […]
Il y a des mouvements de résistance anti-systémiques qui entraînent des fractions de toutes les classes de la société, à partir de motivations différentes mais qui peuvent converger vers un communisme non utopique. […] Le communisme dans sa seconde phase, tel que le définissent Marx en 1875 et la tradition marxiste, c’est le développement illimité des forces productives, l’abondance et la fin du travail (à chacun selon ses besoins), l’extinction de l’État. En fait, ce communisme-là, c’est du pur christianisme millénariste. Le développement des forces productives est limité par la capacité de la planète (et nous n’en avons pas d’autre accessible). L’abondance est, pour cette raison, une rêverie creuse. Et la fin de l’État supposerait que les deux précédentes utopies soient réalisables. Mais une fois ces utopies abandonnées, il reste pas mal de choses à faire et des transformations sociales radicales sont possibles, qui ne feront pas de ce monde un paradis mais éviteront qu’il ne se transforme en enfer. »
Denis Collin, auteur de Le Cauchemar de Marx : Le Capitalisme est-il une Histoire sans Fin ? (Editions Max Milo, 2009), entretien accordé à Lettres Françaises, 5 septembre 2009 |
00:25 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, marxisme, socialisme, libéralisme, sociologie, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 30 novembre 2009
Edward Abbey, Conservative Anarchist
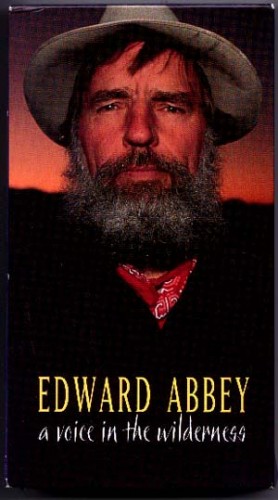 Edward Abbey, Conservative Anarchist
Edward Abbey, Conservative Anarchist
http://spectator.org/archives/2009/03/13/edward-abbey-conservative-anar
Cactus Ed (a nickname he liked) is dead, lo these twenty years (March 14, 1989). He was a less controversial figure in his time than he is today, and certainly has more readers. I recently attended a lecture/book discussion on the author's Desert Solitaire at my local public library, and wasn't surprised by what I heard. Small town book clubs tend to be the pet projects of liberals bent on "promoting literacy," and attract likeminded people. The discussion was moderated by a local Abbey fan, a woman of some academic credentials, and roughly twenty people took part. I've read Desert Solitaire twice, but went to the lecture on a whim, only flipping through my paperback copy shortly beforehand, intending to just listen. The group chewed over the book for 90 minutes, and the takeaway for me was that most people there thought Abbey to be a larger-than-life iconic character, the life transcending the work. And they mostly agreed with his severe critique of the management of the public lands, his ambiguous views on the national parks, and his anarchic thoughts concerning humankind's history and place on the planet, in general. An amusing evening.
Edward Abbey's posthumous fame lies mostly with the Green Left, especially in the West. He's attained that iconic cult status as a man who embodied equal parts Henry David Thoreau (Larry McMurtry once called him "The Thoreau of the American West") and John Muir, with an added dash of Mikhail Bakunin. Somebody who thought and wrote, but also acted, and influenced others to act, however indirectly. All this begs an old question: Does a writer pushing an agenda in his work compromise the artistic integrity of that work? In Abbey's case the answer is both yes and no, because he was much more a polemicist than an artist.
Edward Paul Abbey was born on January 29, 1927, in Indiana, Pennsylvania, the son of a farmer and logger. After a 1944 hitchhiking trip west at 17, he served in the U.S. Army late in World War II and afterwards, then enrolled at the University of New Mexico in 1948 on the G.I. Bill, eventually earning a Master's Degree in philosophy. During this time Abbey started to write as he began concurrently to explore the backcountry of the Southwest in his spare time, specifically the Four Corners area (where Utah, Colorado, Arizona, and New Mexico meet), otherwise known as the Colorado Plateau because it's drained by that great river.
It was among the last of Western regions to be surveyed and mapped. In 1869, John Wesley Powell was its primary explorer when he led a party in dories down the rapids-ravaged canyons of the Green and Colorado Rivers from Green River, Wyoming, all the way through the Grand Canyon. It's an unforgiving region of deserts and mountains, much of it federal land, and home to a half dozen national parks. Here Abbey found the subject that was the focus of his four decades as a writer.
Abbey started as a novelist with a run into the 1960s with series of competently executed but forgettable books such as Jonathan Troy (1954), The Brave Cowboy (1956), and Fire on the Mountain (1962). The Brave Cowboy was made into Lonely Are the Brave (1962), a film starring Kirk Douglas, thus earning Abbey some much-needed Hollywood money. During this time he also churned out essays and journalism about his wanderings in "the back of beyond."
Money was tight, though, and Abbey also worked odd jobs through the 1950s and '60s. His most noteworthy employment was as a seasonal ranger at Arches National Monument (now Arches National Park) near Moab, Utah, in 1959. This experience (along with others) culminated in the 1968 publication of Desert Solitaire, the book that made his reputation. After that, Cactus Ed became the Thoreau of the West.
 The book is in some ways an episodic pastiche. Abbey alternates vividly written chapters describing the multi-hued landscapes of Arches and elsewhere with others featuring cranky polemics about Bureau of Reclamation river dams and "Industrial Tourism." But those sharp landscape renderings are some of the finest writing extant about the desert Southwest. Here he is in Glen Canyon before the eponymous dam was built (1963) that created Lake Powell:
The book is in some ways an episodic pastiche. Abbey alternates vividly written chapters describing the multi-hued landscapes of Arches and elsewhere with others featuring cranky polemics about Bureau of Reclamation river dams and "Industrial Tourism." But those sharp landscape renderings are some of the finest writing extant about the desert Southwest. Here he is in Glen Canyon before the eponymous dam was built (1963) that created Lake Powell:The sandstone walls rise higher than ever before, rounding off on top as half-domes and capitols, golden and glowing in the sunlight, a deep radiant red in the shade.
And this from the same trip:
Beyond the side canyon the walls rise again, slick and monolithic, in color a blend of pink, buff, yellow, orange, overlaid in part with a glaze of "desert varnish" (iron oxide) or streaked in certain places with vertical draperies of black organic stains, the residue from plant life beyond the rim and from the hanging gardens that flourish in the deep grottoes high on the walls. Some of those alcoves are like great amphitheatres, large as the Hollywood Bowl, big enough for God's own symphony orchestra.
Companions to Desert Solitaire are the essays found in such collections as The Journey Home (1977), Abbey's Road (1979), Down the River (1982), Beyond the Wall (1984), and One Life at a Time, Please (1988). The subjects of the essays (the form being possibly Abbey's greatest strength as a writer) vary from detailed accounts of his wanderings -- rafting the Colorado, exploring such landscape oddities as the San Rafael Swell or Big Bend National Park -- to passionate polemics against national park infrastructure development or Bureau of Land Management (BLM) policies on leasing grazing land to ranchers. The latter type showed that Abbey would have done well as an 18th-century pamphleteer. In an essay entitled "Eco-Defense," he writes: "Eco-defense is risky but sporting; unauthorized but fun; illegal but ethically imperative…Spike those trees; you won't hurt them; they'll be grateful for the protection; and you may save the forest. Loggers hate nails."

Abbey's most controversial role was only obliquely related to his work. In 1975 he published his novel The Monkey Wrench Gang, a book that alongside Desert Solitaire enhanced his reputation as an environmentalist, but unlike the latter tome it has prose as purple as an Arizona sunset. The plot involves four anarchic enviros who conspire to blow up Glen Canyon Dam. In a case of life imitates art, the book inspired the establishment of a notorious radical green group in 1980 known as Earth First!, with Abbey as a charter member. Other noteworthy members were activist/writer Doug Peacock, and Dave Foreman, an ex-Goldwater Republican. Earth First! "membership" was and remains (to the extent that it even exists today) anonymous and shadowy, as it's known for acts of "monkey wrenching" of earthmoving and logging equipment, spiking trees, stealing survey stakes, cutting wire fences, and so on. "Earth First!" has spawned ancillary groups such as the Earth Liberation Front (ELF), which before its downfall at the hands of the FBI in 2006 burned down a Colorado ski lodge, and destroyed a number of vehicles at an SUV dealership in Eugene, Oregon, among other acts of domestic terrorism.
Cactus Ed was a prickly sort; a conservative anarchist, if you will, who on one hand could support eco-terrorism (a favorite motto was: "Keep America Beautiful -- Burn a Billboard!"), and on the other supported the National Rifle Association (NRA), and restrictions on immigration. When he died of natural causes, some of his Earth First! compatriots famously and illegally absconded with his body, and buried it in a secret place in remote desert outside of Tucson. And there he lies to this day, pushing up cactus.
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, conservatisme, anarchisme de droite, anarchisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 novembre 2009
Lévy-Strauss fut-il un progressiste?
 Lévi-Strauss fut-il un progressiste ?
Lévi-Strauss fut-il un progressiste ?
À entendre les éloges funèbres, Claude Lévi-Strauss, aujourd’hui unanimement encensé, aurait été le plus politiquement correct des philosophes : antiraciste avant l’heure, anticolonialiste, promoteur des civilisations « premières », quelle meilleure référence ?
Il est certes incontestable qu’il défendit l’idée, fondamentale dans son œuvre, que les cultures dites primitives sont aussi complexes que les cultures modernes.
À cette figure d’hagiographie, les fines bouches objectent cependant tel ou tel propos de jeunesse sur l’inégalité des races ou paraissant hostile à l’islam. Mais avant 1945 — cela est complètement oublié aujourd’hui —, dans presque toutes les familles politiques et pas seulement les pro-nazis, il était naturel de parler de race et de s’interroger sur leur éventuelle inégalité. C’est à partir de la catastrophe hitlérienne que les mentalités changèrent et encore très progressivement. Lévi-Strauss était d’ailleurs resté plutôt discret sur ces questions.
Ce n’est en tous les cas pas pour cela mais pour une toute autre raison qu’il fut considéré dans les années soixante comme un fieffé réactionnaire.
La mode du « structuralisme »
Connu seulement des spécialistes, Claude Lévi-Strauss a passé la rampe de la célébrité, au moins dans le grand public cultivé, quand fut lancée, vers 1966, la mode du « structuralisme ». Il s’agissait au départ d’une expression journalistique, comme plus tard les « nouveaux philosophes » regroupant de manière approximative des penseurs qui ne se connaissaient pratiquement pas et dont les préoccupations étaient en réalité fort différentes.
Lévi-Strauss avait tiré de la linguistique de Ferdinand de Saussure (Cours de linguistique générale, 1916) l’idée que les phénomènes humains sont organisés comme des systèmes (structures), de telle manière que si on bouge tel élément — d’une langue pour Saussure, d’un système de parenté ou de représentations mythologiques pour Lévi-Strauss (les Structures élémentaires de la parenté, 1949) —, c’est tout le système qui est affecté et pas seulement la pièce que l’on a bougée. Cela parce que les différents aspects de telle ou telle réalité humaine sont reliés par des logiques invisibles qui expliquent ce genre d’effets, dits « effets de structure » : un peu comme quand on modifie l’un des quatre angles d’un parallélépipède, les trois autres en sont automatiquement affectés.
À Saussure et Lévi-Strauss, furent rattachés le psychanalyste Jacques Lacan, qui lui aussi travaillait depuis longtemps mais n’était pas encore très connu, lequel allait répétant que « l’inconscient est structuré comme un langage », et Michel Foucault qui montra dans les Mots et les Choses (1966) comment des éléments apparemment étrangers d’une même période de la culture (son analyse du XVIIe siècle français fut exemplaire) étaient reliés par des analogies secrètes qu’on pouvait aussi qualifier de structures. Théorisant le structuralisme, Foucault dit également que l’étude de l’homme passe désormais par différents sciences humaines dont chacune construit son objet à sa manière, produisant un éclatement de la notion d’ « homme », désormais dépourvue de sens.
Il n’y eut pas d’économiste structuraliste, mais l’économie de marché fonctionne de manière si évidente selon une logique structurale que personne ne ressentit alors le besoin de le relever.
La critique marxiste
Tout cela était-il de nature à provoquer la controverse, voire la haine ? Oui, parce que les marxistes — dont on a oublié l’hégémonie idéologique au cours des années soixante, mai 68 compris, supérieure peut-être à ce qu’elle avait été au sortir de la guerre — virent dans le lancement du structuralisme un nouvel artifice inventé par la bourgeoisie pour contrer le marxisme. Pourquoi ?
Parce que le marxisme-léninisme standard reposait sur l’idée d’une infinie plasticité de la nature humaine : sinon comment prétendre sculpter l’homme nouveau du communisme ? Ce dogme avait conduit Staline à soutenir, contre toute raison, les biologistes anti-mendéliens et anti-darwiniens Mitchourine et Lyssenko. Lié à cette plasticité, le primat de l’histoire sur la structure : c’est dans un processus historique concret que l’homme se produit lui-même sans être entravé par des structures prédéterminées. Or, personne n’avait osé le dire explicitement, tant cela eut paru une grossièreté (seul, un peu plus tard, Edgar Morin s’y risqua dans le Paradigme perdu, 1973) : le structuralisme ressuscitait l’idée de quelque chose comme une nature humaine.
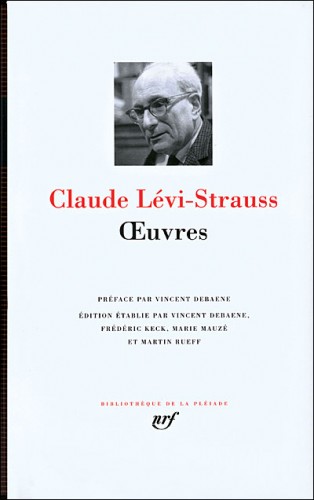 Pour Lévi-Strauss, il n’y avait certes pas un seul système de parenté, de type monogamique occidental (c’est en cela qu’il était « tiers mondiste ») mais tous les systèmes de parenté n’étaient pas pour autant possibles. L’humanité a dressé de manière inconsciente une sorte de tableau de Mendeleieff des systèmes de parenté et il est condamné à aller de l’un à l’autre, sans échappatoire. Même chose pour Lacan : la castration du désir œdipien primitif est une constante de l’homme, un destin originel auquel nul n’échappe. Le pessimisme de Lacan — prolongement de celui de Freud — était exprimé en termes suffisamment cryptés pour qu’un public soixante-huitard avide de nouveautés mais ne comprenant pas bien ce qu’il disait lui fasse une ovation.
Pour Lévi-Strauss, il n’y avait certes pas un seul système de parenté, de type monogamique occidental (c’est en cela qu’il était « tiers mondiste ») mais tous les systèmes de parenté n’étaient pas pour autant possibles. L’humanité a dressé de manière inconsciente une sorte de tableau de Mendeleieff des systèmes de parenté et il est condamné à aller de l’un à l’autre, sans échappatoire. Même chose pour Lacan : la castration du désir œdipien primitif est une constante de l’homme, un destin originel auquel nul n’échappe. Le pessimisme de Lacan — prolongement de celui de Freud — était exprimé en termes suffisamment cryptés pour qu’un public soixante-huitard avide de nouveautés mais ne comprenant pas bien ce qu’il disait lui fasse une ovation.
Seul Gilles Deleuze (l’Anti-Œdipe, 1972) saisit combien cette pensée pouvait être « réactionnaire » car désespérante pour toute idée de progrès. Les linguistes découvrent eux aussi des règles permanentes qui régissent l’évolution des langues. La pensée de Foucault est en revanche moins nette sur ce sujet : on n’a jamais su le statut épistémologique des concordances qu’il mettait au jour à telle ou telle époque.
Tentatives de synthèse
Tandis que les intellectuels communistes officiels se déchaînaient conte la vague structuraliste, il y eut des tentatives de synthèse entre le marxisme et le structuralisme. Un anthropologue aujourd’hui oublié, disciple de Lévi-Strauss et soigné par Lacan, Lucien Sebag, s’y essaya dans un brillant essai justement appelé Marxisme et Structuralisme (1964). Peut-être conscient d’une impasse, il se suicida l’année suivante.
Mais l’homme qui se trouva, bien malgré lui, au carrefour des deux courants de pensée fut Louis Althusser. Il était à la vérité plus marxiste que structuraliste et surtout influencé par Bachelard, mais en considérant qu’une configuration économique et sociale donnée était une réalité globale dont toutes les parties étaient solidaires, il a paru faire une lecture structuraliste du marxisme. Cela lui valut une solide méfiance du Parti communiste. Il fut en revanche le maître à penser des premiers maoïstes mais pour une tout autre raison : Althusser considérait que le mode de pensée idéologique (par opposition au mode de pensée scientifique) ne s’arrêtait pas avec la révolution mais que dans une première phase, le pouvoir « prolétarien » avait besoin d’une idéologie pour se consolider , une théorie qui justifiait à bon compte tous les délires, tant staliniens que maoïstes, à un moment où le parti communiste dénonçait au contraire le « culte de la personnalité ».
Claude Lévi-Strauss, dont le nom fut utilisé bien malgré lui dans ces querelles germanopratines, se tint largement sur la réserve. D’abord parce qu’il était souvent sur le terrain, ensuite parce que son tempérament distant et le souci de la rigueur scientifique le tenaient naturellement éloigné des tumultes de l’agora.
Source : Liberté Politique [1]
Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info
URL to article: http://qc.novopress.info/7116/levi-strauss-fut-il-un-progressiste/
URLs in this post:
[1] Liberté Politique: http://www.libertepolitique.com/culture-et-societe/5662-levi-strauss-fut-il-un-progressiste
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, anthropologie, ethnologie, psychologie, psychanalyse, structuralisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Hommage à Panajotis Kondylis
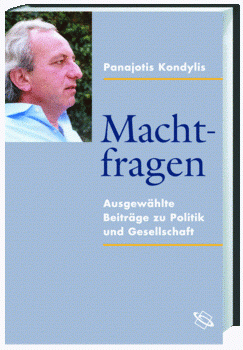 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Hommage à Panajotis Kondylis
(1943-1998)
Toute fama passe. C’est un adage que Panjotis Kondylis, philosophe grec né en 1943, a médité calmement. Il savait que si son œuvre était publiée d’abord en langue grecque, elle n’aurait guère d’impact. Kondylis s’est demandé s’il devait publier en anglais, en allemand ou en français. Finalement, il s’est décidé pour l’allemand. Aussi, dès cette décision prise, il a passé chaque année de sa vie six mois dans les bibliothèques de Heidelberg, six mois dans sa patrie hellénique.
La vie de Kondylis était celle d’un savant isolé, espèce en voie de totale disparition aujourd’hui. Kondylis était indépendant sur le plan matériel car il était issu d’une famille fortunée. Cette indépendance matérielle garantissait son indépendance d’esprit.
Son premier ouvrage, publié en 1979 et épais de 700 pages était la continuation d’études entamées à Heidelberg (Die Entstehung der Dialektik - Eine Analyse der geistigen Entwicklung von Hölderlin, Schelling und Hegel bis 1802; = La naissance de la dialectique. Analyse d’une évolution intellectuelle de Hölderlin, Schelling et Hegel jusqu’en 1802). Ensuite, il a publié Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus en 1981 (= L’idéologie des Lumières dans le cadre du rationalisme moderne). Kondylis n’interprétait pas les Lumières comme une idéologie découlant des principes de la rationalité (sapere aude) mais comme une réhabilitation de la sensualité. Le livre témoigne d’une immense culture livresque, même s’il apparaît un peu sec dans sa volonté opiniâtre de démontrer une thèse unique. Kondylis n’aimait pas les gris. Son ouvrage le plus connu, édité en 1991, Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform - Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne (Le déclin de la forme de pensée et de vie bourgeoise - La modernité libérale et la postmodernité démocratique de masse), était en fait une analyse du phénomène de la masse, de la société et de la démocratie des masses.
En 1992, parait Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg (= Politique planétaire après la Guerre Froide). En 1996, Montesquieu und der Geist der Gesetze (= Montesquieu et l’esprit des lois). Mais dans les rangs des divers conservatismes, deux livres ont surtout mobilisé les attentions: Macht und Entscheidung (1984; = Pouvoir et Décision) et Konservativismus - Geschichtlicher Gehalt und Untergang (1986; = La conservatisme: contenu historique et déclin). Effectivement, sur le conservatisme, peu de livres ont donné une description aussi fouillée du phénomène. La conclusion de Kondylis, contenue déjà tout entière dans le sous-titre de l’ouvrage, a suscité pas mal de critiques. Kondylis affirmait effectivement: «Le conservatisme est mort. Il est historiquement lié à une époque, celle de la noblesse. Tout ce qui, ultérieurement, s’est donné le nom de “conservatisme”, devrait plus être qualifié de “vieux-libéralisme”, car une telle appelation serait plus exacte. Car ces conservatismes sont dorénavant soumis aux conditionnements de la modernité...». Mais c’est surtout sa thèse principale qui a été rejetée comme trop “mécanique”, malgré l’admiration de toute sa corporation pour une certaine pertinence de sa démonstration et pour son enquête à travers toutes les sphères culturelles de l’Europe: Kondylis affirmait qu’avec la dissolution des restes de la société civile médiévale, c’est-à-dire avec l’abandon de la féodalité et l’élimination des avantages juridiques et publiques de la noblesse, le conservatisme politique avait factuellement cessé d’exister.
Enfin, au moment de sa mort, Kondylis, le réaliste qui méprisait la “lourdeur moralisante”, travaillait à un ouvrage en trois volumes sur la “socio-ontologie”. Hélas, la Grande Faucheuse l’a emporté le 10 juillet, quelques heures avant qu’il ne quitte Athènes pour se rendre à Heidelberg.
Hans B. von SOTHEN.
(hommage paru dans Junge Freiheit, n°30/1998).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, hommages |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 novembre 2009
Panajotis Kondylis: Pouvoir et décision
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Panajotis Kondylis: Pouvoir et décision
Les livres les plus intéressants de Panajotis Kondylis, décédé en juillet dernier, sont: Geschichte des Konservativismus, Theorie des Krieges, Der Niedergang der bürgerlichen Lebensform et Macht und Entscheidung (= Histoire du conservatisme, Théorie de la guerre, Le déclin de la forme vitale bourgeoise et Pouvoir et décision). Dans Pouvoir et décision, Kondylis plaide pour une forme de la pensée qui a été copieusement décriée au cours des dernières décennies, et qui est le fondement de la démarche philosophique de Carl Schmitt. Kondylis justifie l’option de Schmitt en défendant le décisionnisme, tombé dans le discrédit depuis que les penseurs “héroïques” de la “révolution conservatrice” s’en sont emparé. Dans son ouvrage sur la décision, Kondylis démontre, appuyé sur ses innombrables connaissances, que toutes nos identités collectives et individuelles, y compris leurs expressions philosophiques ou rationnelles les plus élevées, reposent sur un fondement inaliénable qui est toujours une décision initiale, irrationnelle en dernière instance, révélant un rapport ami/ennemi.
Les idées sont dès lors des armes, qui servent l’objectif biologique de la lutte pour la survie ou pour l’accroissement de ses propres forces. La croissance et l’augmentation volontaire de ses potentialités dépendent étroitement, en fin de compte, de l’impératif de survie, auquel on ne peut se soustraire. Justement, c’est dans les périodes de crise que les individualités et les collectivités reviennent aux racines de leur propre identité, pour se renforcer et maintenir leurs forces. De ce fait, dans la formation des systèmes de pensée identitaires, la logique est un moyen parmi d’autres moyens, mais auquel on peut finalement renoncer.
Dans les systèmes théologiques, les principes de l’homme-créé-àl’image-de-Dieu et la faillibilité humaine constituent des contradictions sur le plan logique; de même, dans l’anthropologie de l’émancipation (Aufklärung), on trouve une contradiction: l’homme est une fraction de la nature, et, en même temps, les normes culturelles conditionnent le libre exercice de la volonté. Mais ces contradictions s’évanouissent dès qu’on les considèrent comme l’expression d’une volonté de pouvoir légitime. Les idées et les formes du savoir ne cherchent pas à “reflèter” la réalité: elles sont bien plutôt des constructions et des interprétations qui servent d’armes dans la confrontation ami/ennemi.
Comme Odo Marquard l’a remarqué: vouloir exprimer des vérités éternelles soustraites au temps est l’illusion majeure de la classe bourgeoise, qui pense qu’elle est au-dessus de toutes les autres classes. Les mythes, les religions et les idéologies sont donc des décisions au niveau de la Weltanschauung, qui assurent la permanence et la stabilité des identités. Souvent, la situation historique fait qu’il devient nécessaire de faire subir aux identités des mutations complètes, parce que la communauté politique ou nationale doit survivre. Le maintien de l’identité est un impératif existentiel que l’on ne peut toutefois pas détacher des circonstances spatio-temporelles. Même si l’identité est une fiction, elle demeure un impératif inaliénable. Si une individualité se rencontrait elle-même en temps que personne, mais dans un état antérieur à celui qu’elle revêt aujourd’hui, elle ne s’identifierait pas nécessairement à elle.
Holger von DOBENECK.
(article paru dans Junge Freiheit, n°34/1998; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, pouvoir, décision |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 novembre 2009
Imaginaire et réinformation
Imaginaire et réinformation
Deuxième journée d'études sur la réinformation, organisée le 24 octobre 2009 par la Fondation Polémia
Communication de Grégoire Gambier / Ex: http://polemia.com/
L’imaginaire recèle de nombreuses définitions, renvoyant pour l’essentiel à ce qui est irréel, fictif, fabuleux ou encore, de façon plus majorative, au monde des légendes et du mythe. Sans renier cette dernière approche, nous retiendrons dans le cadre du présent exposé la définition du substantif proposée par Le Petit Robert (1987) : « Produit, domaine de l’imagination ». Etant entendu et espéré avec Gide, aussi singulièrement que brusquement remis dans l’actualité à propos de « l’affaire Mitterrand » par Gérard Longuet (décidément très pince-sans-rire)», que « quantité de gens sont plus sensibles à l’imaginaire qu’au réel »…
Livrer une définition de la « réinformation » est plus complexe encore, s’agissant autant d’un état d’esprit que d’une panoplie de modes opératoires. Retenons l’essentiel, à savoir son objectif, tel que défini dans la présentation de ce séminaire : « Contribuer à réveiller le sens critique : rappeler en permanence qu’une "monstration n’est pas une démonstration" ; que tout ce qui nous est montré n’est pas vrai ; et que bien des faits, bien des évènements, restent cachés surtout lorsqu’ils sont essentiels ».
« De quoi s’agit-il ? »1
Face au règne de Big Mother, qui nous surveille moins qu’elle ne nous aveugle et prétend nous nourrir, et qui peut constituer un assez juste représentation du système actuel d’« information », la problématique posée tient dans cette relation toute dialectique entre « imaginaire » et « réinformation ».
Il y a a priori opposition entre les deux termes : l’imaginaire renvoie au domaine de l’imagination, quand la réinformation entend opérer un retour au réel, au principe de réalité, derrière l’écume des faits, l’illusion informationnelle, les dits et surtout les non dits de la médiasphère.
Cette opposition n’est qu’apparente.
Notre thèse est qu’au contraire l’imaginaire, du fait même de sa relation aux mythes, au monde sensible, est une voie d’accès et d’écriture de la réalité. Mieux : que le recours à l’imaginaire est un moyen de « subversion métaphysique » contre l’emprise du système informationnel. Comme l’affirme le romancier francophone d’origine haïtienne Dany Lafferrière : « La réalité imaginaire est aussi vraie, aussi réelle, que celle du quotidien », ajoutant : « Ce que je rêve est encore plus nécessaire pour ma vie que ce que je vis ».2
Il s’agira ici de privilégier l’illustration, la suggestion, plutôt que la démonstration.
Proposer des pistes comme autant de chemins de traverse contournant les « autoroutes de l’information », renouant les fils nous reliant à notre « plus longue mémoire » (Nietzsche), disant la continuité sans laquelle la solidarité n’est qu’un mot, à rebours des « déliaisons de la société de la concurrence » justement décriées par Régis Debray, à savoir : « tout-à-l’égo ; sacre de l’instant ; idolâtrie de la compétitivité ; nihilisme institutionnel ; dévoration par l’info ; (…) amnésie satisfaite et congélation des héritages ».3
Car c’est bien dans la geste médiologique chère à Debray qu’il s’agit d’inscrire ce propos, cette geste qui abat « la cloison entre l’examen du monde des choses et celui des âmes, entre la technosphère d’un côté et la "noosphère" de l’autre », celle qui entend, « contre la dégradation symbolique, sauvegarder la saveur et l’irréductibilité des cultures, toutes ces continuités cumulatives, ces singularités têtues qui rendent humaine notre espèce ».4
Mais contrairement à Régis Debray, nous estimons certes qu’il y a urgence, mais pas détresse. Car subsistent précisément des voies de passage, des points d’appui et des leviers d’action face au diktat de la Communication, « qui a dompté l’espace », pour un retour à la Transmission, donc à l’imagination, « qui lutte avec et contre le temps ».5
Temps biologique, temps culturel : l’imagination transpire d’abord par tous les sens primaires (vue, odorat, toucher…) avant d’utiliser tous les vecteurs de l’intelligence (lecture, musique, image – celle véhiculée par le cinéma comme par Internet).
L’imagination par les sens : « le recours aux forêts »
Héraclite, qui justifie et inspire les travaux de POLEMIA, le notait déjà : « La nature aime les contraires : c’est avec elle qu’elle produit l’harmonie ».
La première voie nous permettant de renouer avec l’imaginaire et toutes ses potentialités nous est fournie par notre environnement primal, de mammifère mal dégrossi : à savoir la nature.
Et en son sein, c’est sans conteste la forêt qui parle le mieux à nos âmes de Vieux Européens. Profondément enracinée, tendant vers les étoiles, ambivalente et mystérieuse, passage obligé de tous les contes et récits initiatiques de notre culture populaire, elle est l’une des plus puissantes manifestations de la vie, autant que la plus évidente représentation de notre inconscient.
Pas en tant que représentation de nos terreurs et paniques enfouies, comme le pensait Jung et avec lui l’école psychanalyste, mais comme le sanctuaire par excellence de nos valeurs les plus intimes et les plus sacrées.
Dans son « Traité du Rebelle », Ernst Jünger a réaffirmé la possibilité - et même la nécessité - du recours aux forêts. Non comme une fuite, mais comme un ressourcement. Un retour à l’essentiel.
Comme de juste, Dominique Venner lui emboîte le pas, estimant que la promenade familiale et dominicale en forêt est à même de constituer, face à la grisaille utilitariste du quotidien, un véritable acte de foi.6
Ainsi, jusque dans son sacrifice symbolique lors des solstices d’été, la forêt, et au-delà la nature dans son ensemble, attestent de la possibilité d’une réalité toute autre que celle décrite dans les éditoriaux du « Figaro madame » ou les chroniques hebdomadaires de BHL.
L’imagination par le texte : les valeurs subversives du roman
Nous disposons dans ce domaine de nombreux exemples particulièrement propices à l’évocation de notre monde « en dormition », qui nous susurrent qu’il existe d’autres religions que celles des droits-de-l’homme, d’autres valeurs que celles qui s’échangent « à la Corbeille », d’autres passions que celles de l’égalité, du confort et de la marchandise.
Comme l’affirme l’universitaire et journaliste Jean-Paul Picaper : « Cela passe par des mots. Qui crée le langage, dicte des idées ».7
Et pour les besoins du raisonnement, autant citer des auteurs à succès, voire pour certains institutionnellement établis.
C’est le cas de Michel Déon, sans doute le plus grand romancier français de l’Après-Guerre. Dans une œuvre prolifique, toujours marquée par la recherche du Beau, et donc empreinte d’une légitime mélancolie, retenons « Les Poneys sauvages » (Prix Interallié en 1970), une ode déjà crépusculaire, mais encore pleine de bruit et de fureur, en hommage à un monde dominé par les « mâles blancs » aujourd’hui si décriés : leurs rêves, leurs volontés, leur éthique de l’amour et du combat - bref leurs valeurs.
Une autre grande figure du roman français est Pierre Schoendoerffer. L'auteur et cinéaste rescapé des camps de redressement du Viet-minh a été primé à de multiples reprises, notamment pour « La 317e Section » (1963, prix de l'Académie de Bretagne), « L'Adieu au Roi » (1969, prix Interallié), « Le Crabe Tambour » (1976, grand prix du roman de l'Académie française) ou encore « Là-Haut » (1981). Ses auto-adaptations cinématographiques ont pour l’essentiel connu le même succès, alors que Schoendoerffer aborde dans son œuvre des thèmes aussi proprement réactionnaires que le sens de l’honneur, l’amitié et la fidélité viriles, le goût du risque et de l’engagement, la soif de sacré… Citons simplement « L’aile du papillon » (Grasset, 2003), dans la mesure où Polemia en a fait une critique raisonnée en y voyant, à l’image de l’œuvre de Schoendoerffer dans son entier, « une allégorie brutale et poétique du devenir d'une humanité en déshérence, mais dont une minorité peut encore retrouver un sens à son destin, en puisant au fond d'elle-même les raisons et les ressorts de sa sur-vie ».9
Plus récent et dans un style de fait un peu plus débraillé, voire quasi-« houellebecquien », Olivier Maulin est une valeur sûre, qui a obtenu le prix Ouest France / Etonnants voyageurs en 2006 pour son premier roman, « En attendant le roi du monde », truffé de citations de Nietzsche et de José Antonio. Il a depuis publié « Les Evangiles du Lac » et « Petit monarque et catacombes », confirmant un talent indéniable de conteur pour mieux dynamiter le nihilisme d’une société, la nôtre, désertée par le sacré. Dans ce dernier ouvrage, paru en octobre 2009 dans la collection L’Esprit des péninsules des éditions Balland, il fait déclamer à l’un de ses personnages : « Le monde est un grand symbole parce qu’il présente sous une forme sensible des réalités invisibles. C’est la clé de tout. Mais le problème, c’est précisément que ces formes sensibles ont dégénéré et cessé de représenter les réalités invisibles. Bilan : le grand symbole s’est fané ».10
Ce choix trinitaire d’auteurs certes connus est par nature excessivement sélectif, et beaucoup de romanciers mériteraient d’être ici signalés. En particulier Jean Raspail bien sûr, dont les « mondes imaginaires », éternellement gardés par la dynastie des Pikkendorf, constituent autant de digues face à « la montée du soir » - pour paraphraser Déon.
Il convient cependant de signaler dans un registre différent, toujours à titre d’illustration, « Le Cercle de la Croix ». Ce succès mondial de l’Anglais Iain Pears constitue, sur la base d’un roman à clé construit autour d’une enquête de nature policière dans l’Angleterre du XVIIe siècle, l’une des charges les plus totales, brutales et définitives, contre le puritanisme protestant, et fait écho à la dénonciation tout aussi virulente de la Révolution par les Français HubertMonteilhet, sous un mode des plus caustiques avec « Les Bouffons » (Le Livre de Poche 2006), et Pierre Bordage, dans le domaine de la littérature fantastique, avec la trilogie de « L’Ejomineur » (L’Atalante, 2004-2006).
Dans le registre fantastique se développe d’ailleurs toute une littérature dont le style, les valeurs et le propos sont autant d’actes de défiance à l’égard de la « société officielle ». Dans une production bouillonnante, et pour tout dire de qualité inégale, il convient de signaler le cycle du « Trône de Fer » de l’Américain Georges R. R. Martin, où transparaît l’âpre mélancolie d’un monde de feu et de fer - justement.
Et dans le domaine de la littérature pour enfants et adolescents enfin, où le meilleur côtoie là aussi le pire, surnagent les livres déjà nombreux d’Erik L’Homme, dont le succès commercial s’accompagne d’une vision du monde sans concession vis-à-vis des ravages de la modernité triomphante.
L’imagination par la musique, âme d’un peuple
Ce seul thème justifierait une étude en soi : « Sans musique, la vie serait une erreur » (Nietzsche).
A des fins d’illustration toujours, signalons seulement deux exemples significatifs, dans la mesure où il s’agit d’artistes extrêmement populaires dans leur pays, réunissant des dizaines de milliers de spectateurs à chaque concert, et qu’ils sont connus en France essentiellement par le buzz internet assuré par les militants identitaires.
A savoir :
- Le groupe « néo-trad » québecois Mes Aïeux, dont le nom constitue déjà tout un programme, et sa chanson phare « Dégénérations » (www.youtube.com/watch?v=Z1eUMVjwuAE), qui dénonce de façon festive et éloquente l’avènement de la société de facilité, moderne, urbaine, jouisseuse - mais finalement désenchantée. Ce morceau a été désigné « Chanson francophone de l'année 2006 » par les auditeurs de Radio Energie lors du plus important vote radiophonique annuel au Canada, et l’album « En famille », dont il est extrait, a été certifié double platine en décembre 2006 (soit 200.000 exemplaires vendus). Et ce, alors que le groupe était ignoré depuis 10 ans, bien sûr, par les radiodiffuseurs institutionnels. Tandis que plus de 100.000 internautes ont déjà visionné, sur YouTube, le clip de cette chanson « en live » lors de la Fête nationale du Québec de 2006.
- Le chanteur pop afrikaner Bok van Blerk, dont l’un des titres les plus connus dans le monde (et lui aussi disque de platine en 2007) est tout bonnement dédié au général boer Koos De La Rey, et se veut une ode à la fierté et à la résistance de la nation afrikaner (www.youtube.com/watch?v=nlHqKJyo3GQ). Lors d’un concert donné par Bok van Blerk au stade de Pretoria en 2006, plus de 22.000 spectateurs en ont entonné le refrain avec le chanteur. Ce chant est désormais régulièrement repris par les jeunes Afrikaners lors des concerts et des rencontres sportives, et joue quasiment le rôle d’un nouvel hymne national afrikaner. Une nation devenue souterraine, mais qui continue de vivre à travers son peuple.
L’imagination par l’image : le cinéma
Restons dans l’art populaire pour signaler encore une fois quelques exemples parmi les plus significatifs :
- « Excalibur » de John Boorman (1981), directement et pour ainsi dire religieusement inspiré de « La morte d'Arthur » de Thomas Malory, qui reste à ce jour la vision la plus pénétrante et la mieux aboutie du mythe arthurien jamais portée à l’écran.
- La trilogie du « Seigneur des Anneaux » de Peter Jackson (2001-2003), qui constitue également un summum dans l’adaptation au cinéma d’un monument de la littérature européenne, et qui a captivé des millions de spectateurs dans le monde.
- « Gladiator », de Ridley Scott (2000), porté par l’acteur Russel Crowe : c’est une évocation historique, dure et flamboyante, de la grandeur de Rome, et des hommes qui en ont fait, par la force et l’honneur, la capitale du premier empire européen.
Et dans le domaine de l’anticipation, propice par objet à l’extension du domaine de l’imaginaire : « Blade Runner », encore de Ridley Scott (1982), qui se déroule en 2019, dans une Los Angeles des plus cosmopolites, et où Rutger Hauer incarne de façon tout à fait convaincante un androïde (ou « réplicant ») nietzschéen, découvrant la dimension tragique de la vie, à savoir sa propre finitude, alors qu’il en avait fait « un poème » (Mishima). Son monologue à cet instant précis est en soi un manifeste :
« J’ai vu tant de choses, que vous, humains, ne pourriez pas croire...
De grands navires en feu surgissant de l’épaule d’Orion…
J’ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l’ombre de la Porte de Tannhaüser.
Tous ces moments se perdront dans l’oubli,
comme les larmes dans la pluie…
Il est temps de mourir. »
Evidemment, il est préférable de visualiser la scène, sous la pluie, accompagnée par la musique de Vangelis, mais cela donne une idée du ton – et des boulevards métaphysiques ainsi ouverts à des millions d’adolescents pré-pubères qui ont fait, à l’époque, de ce film une œuvre culte.
« Les Fils de l’homme » enfin, film britannique réalisé par le mexicain Alfonso Cuarón (2006), reste dans le domaine de l’anticipation, décrivant un monde, là encore, étonnamment, submergé de flux migratoires incontrôlés – et nous sommes loin des publicités Benneton des années 80 ! Adapté du roman homonyme à succès de P.D. James (1992), ce petit chef d’œuvre dépeint une humanité agonisante à force d’individualisme, devenue littéralement stérile : condamnée à vivre dans des lieux où ne résonnent plus de rires d’enfants. Un véritable choc, notamment visuel avec l’usage de longs plans-séquence, dont une scène de guérilla urbaine particulièrement spectaculaire.
Nous sommes ici dans un cas assez typique de « réinformation par l’imaginaire » : le film développe un propos, certes ambigu, mais vaguement de gauche, tandis que ce qu’il donne à voir dénonce cruellement les impasses à venir, si loin de la démocratie de marché, des progrès technologiques et de la mondialisation heureuse…
Quand la « blogosphère » contribue au réenchantement du monde
Avec la diffusion d’Internet, et même sa tendance croissante à supplanter les mass médias en termes d’usage, et de temps d’usage, toutes ces visions alternatives aux discours et aux images autorisés dans les émissions télévisées, par exemple, ont trouvé de nouveaux espaces d’expression.
Le recours à Internet ne permet pas seulement d’acquérir, et bientôt de lire intégralement, des ouvrages devenus introuvables, voire sulfureux. Ou d’écouter des rythmes et des chansons également « maudites » - et en tout cas interdites des « bacs de la Fnac ». Il permet également, cette fois au plus grand nombre, de découvrir ou plus exactement re-découvrir une iconographie que l’on croyait disparue, remisée dans les combles des musées ou réservées à quelques cercles militants initiés.
La blogosphère est particulièrement féconde en la matière.
Signalons simplement l’un des blogs les plus visités de la Toile, François de souche (www.fdesouche.com), dont le bandeau en page d’accueil constitue en soi un manifeste nationaliste. Et pour les sites classiques, celui de Dominique Venner (www.dominiquevenner.fr) constitue un modèle, par sa sobriété même, d’esthétique « vieille européenne », où se dégage, là aussi en bandeau, le grand cerf de nos forêts sauvages, symbole de la fécondité, des rythmes cosmiques et donc de toutes les renaissances.
L’esthétique est sans conteste porteuse d’éthique.
En guise de conclusion…
Le recours à l’imaginaire, au domaine du sensible, de l’évasion, n’est pas un moyen d’échapper au monde, de fuir le réel : c’est une autre façon de l’ensemencer, de s’en affranchir pour mieux le dominer, bref de « chevaucher le Tigre » (Julius Evola).
L’imagination ne nous porte pas à travailler contre le monde moderne, mais dans ses interstices : « Etre dans ce monde sans être de ce monde », comme l’a théorisé Guillaume Faye.
Et, dans sa virtualité même, par ses mensonges les plus grossiers, par les tabous dont il s’entoure et entend corseter la pensée, rien n’indique que le système informationnel, en tant que représentation du monde actuel, soit, en soi, porteur de réalité - ou soit tout simplement réel.
Ce n’est qu’un système de représentation parmi d’autres.
Certes, il dispose de l’apparence et des attributs du pouvoir.
Et nos valeurs, notre propre vision du monde, sont aujourd’hui sans conteste « en dormition ».
Mais rien ne nous empêche d’estimer et mieux encore de croire :
qu’Yggdrasil est bien l’axe du monde ; qu’Excalibur incarne la quintessence de l’esprit européen ; que le réveil de l’Europe, l’affranchissement de nos peuples et le retour du Roi sont davantage que des hypothèses portées par l’urgence ou la nécessité, voire des espérances trop facilement désolées, mais bel et bien des possibilités.
Il ne s’agit plus que de contribuer, à notre niveau mais à chaque instant, à rendre évidents, et accessibles, tous les possibles.
Rester prêts pour l’aventure.
© POLEMIA
24.10.2009
Notes :
1 Précision utile aux amateurs d’exactitude et de vérité qui se reconnaissent dans Polemia : attribuée à Foch, cette célèbre formule a en fait été empruntée par le maréchal français au général von Verdy du Vernois, l’un des principaux conseillers du stratège prussien von Moltke (source : Pascal VALENTIN, in « La pensée stratégique : une vocation pour l’Ecole militaire », n° hors-série de Défense nationale et sécurité collective, juillet 2009, p. 191,
2 Cité par Le Monde des Livres du 6 octobre 2009, p. 25.
3 « Relier ». Editorial de la revue Médium n°1, Automne 2004, Editions Babylone, Paris, p.3. www.mediologie.org/medium/medium.html et www.regisdebray.com/content.php?pgid=medium
4 Ibid., pp. 5-6.
5 Ibid., p. 6.
6 Cf. notamment Dominique VENNER, « Dictionnaire amoureux de la chasse », Plon, octobre 2000, http://www.amazon.fr/Dictionnaire-amoureux-chasse-Dominique-Venner/dp/2259191983/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1257008264&sr=1-1-spell
7 Jean-Paul PICAPER, « Crise du langage : la guerre des mots – Quelques procédés de la propagande », Eurbag n°19, janvier 2009, www.eurbag.eu/archives.htm
10 Olivier MAULIN, « Petit monarque et catacombes », L’esprit des péninsules, 2009, p. 189., http://www.amazon.fr/Petit-monarque-catacombes-Olivier-Maulin/dp/2353150667/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1257008485&sr=1-1-fkmr0. Pour être exhaustif, il convient de signaler du même auteur « Derrière l’horizon » (mars 2009), mais où l’imaginaire tient une place nettement plus secondaie, tant dans l’intrigue que dans le cractère des personnages.
Grégoire Gambier
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, mythes, mythologie, sociologie, médias, manipulations, information, psychologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




 Le bien, c’est ce qui existe. Chaque jour, à chaque heure, en tout lieu, des personnes tiennent les promesses qu’elles ont faites ; des enfants naissent d’amours réelles ; des parents élèvent leurs enfants ; des couples demeurent fidèles, des familles restent unies ; des écoliers apprennent quelque chose à l’école ; nombreux sont ceux qui se lèvent le matin en vue de bien faire leur travail ; des artistes se perfectionnent et produisent de belles œuvres ; des vieillards quittent ce monde dans la sérénité. […]
Le bien, c’est ce qui existe. Chaque jour, à chaque heure, en tout lieu, des personnes tiennent les promesses qu’elles ont faites ; des enfants naissent d’amours réelles ; des parents élèvent leurs enfants ; des couples demeurent fidèles, des familles restent unies ; des écoliers apprennent quelque chose à l’école ; nombreux sont ceux qui se lèvent le matin en vue de bien faire leur travail ; des artistes se perfectionnent et produisent de belles œuvres ; des vieillards quittent ce monde dans la sérénité. […]



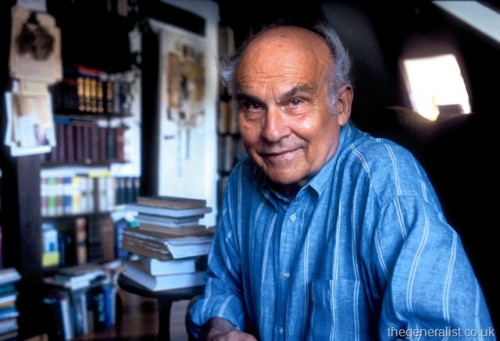
 Chez Marx, dans Le Capital, le véritable sujet de la révolution sociale, c’est-à-dire de "l’expropriation des expropriateurs", ce sont les "producteurs associés", c’est-à-dire tous ceux qui jouent un rôle nécessaire dans la production, et cela va de l’agent d’entretien au directeur. L’idée de Marx était que le détenteur de capital était de plus en plus en dehors du procès de production et de plus en plus parasitaire, puisque son travail d’organisation et de direction était effectué par des salariés fonctionnaires du capital. Ensuite, à partir de la social-démocratie s’est inventé autre chose : l’idée que la classe ouvrière devenait la classe rédemptrice. Mais ça, ça ne découle pas de la théorie de Marx. C’est une nouvelle religion pour classes dominées… et qui doivent le rester, comme le dit très bien mon ami Costanzo Preve. Le vrai problème, c’est qu’une classe dominée transformée en classe dominante est une contradiction dans les termes ! Le prolétariat est défini pas sa soumission à la domination. La dictature du prolétariat est aussi impossible à concevoir qu’un cercle carré. […]
Chez Marx, dans Le Capital, le véritable sujet de la révolution sociale, c’est-à-dire de "l’expropriation des expropriateurs", ce sont les "producteurs associés", c’est-à-dire tous ceux qui jouent un rôle nécessaire dans la production, et cela va de l’agent d’entretien au directeur. L’idée de Marx était que le détenteur de capital était de plus en plus en dehors du procès de production et de plus en plus parasitaire, puisque son travail d’organisation et de direction était effectué par des salariés fonctionnaires du capital. Ensuite, à partir de la social-démocratie s’est inventé autre chose : l’idée que la classe ouvrière devenait la classe rédemptrice. Mais ça, ça ne découle pas de la théorie de Marx. C’est une nouvelle religion pour classes dominées… et qui doivent le rester, comme le dit très bien mon ami Costanzo Preve. Le vrai problème, c’est qu’une classe dominée transformée en classe dominante est une contradiction dans les termes ! Le prolétariat est défini pas sa soumission à la domination. La dictature du prolétariat est aussi impossible à concevoir qu’un cercle carré. […]