dimanche, 01 juin 2008
Heidegger et son temps
CONCEPTION DE L’HOMME ET REVOLUTION CONSERVATRICE : HEIDEGGER ET SON TEMPS
Source : Robert STEUCKERS, revue Nouvelle Ecole n°37 (printemps 1982).

Dans l’œuvre de Heidegger, 2 types de vocabulaires se juxtaposent. D’une part, il y a celui, très concret, qui exalte la glèbe, le sol, la forêt, le travail du bûcheron, et, d’autre part, le plus apparemment rébarbatif des jargons philosophiques. Heidegger réalise donc ce tour de force d’être à la fois un doux poète bucolique et un philosophe universitaire excessivement rigoureux, auquel aucun concept n’échappe. Comment ces 2 attitudes ont-elles pu cohabiter dans un seul individu ? Y aurait-il 2 Heidegger ? L’article qui suit entend répondre à ces questions.
Il peut paraître banal de dire que Martin Heidegger est né le 26 septembre 1889 à Messkirch. C’est qu'une appréciable part de son œuvre sera déterminée par ce "quelque part". Heidegger reste, en effet, très attaché à son enracinement alémanique. L'enracinement, pour lui, est une des conditions essentielles de l'être-homme. "L'homme véridique ne sera pas enraciné par accident et provisoirement (en attendant mieux) ; il l’est essentiellement. L'homme qui perd ses racines se perd en même temps" [1]. Il ne serait pas arbitraire de résumer la pensée anthropologique de Heidegger en quelques mots : être homme, c'est bâtir (fonder) et habiter un monde (s'y enraciner). De fait, toute l’œuvre de Heidegger porte l’empreinte du terroir natal, de cette Souabe qui vit naître Schiller, Schelling, Hegel et Hölderlin. Le murmure, les palpitations de ce pays de forêts, silencieusement présents dans la philosophie heideggérienne, différencieront Heidegger de Sartre, le disciple parisien qui s'est efforcé d'utiliser à son profit le même outillage conceptuel. Sartre, a remarqué Jean-Paul Resweber, subira toujours l’influence anonyme ou frénétique des cités bourdonnantes, où il est impossible de saisir la densité et l’unité originelles des choses et de la nature [2].
le jeu de l’enracinement et de la désinstallation
La terre, lieu de notre séjour, est aussi le miroir de notre finitude, le signe d’un impossible dépassement. Elle rappelle à l'homme qu'il est irrémédiablement situé dans le monde de l’existant. Elle est le sol même sur lequel prend pied (Bodennehmen) notre liberté. L’acte libre, poursuit Resweber, n’est pas un pur jaillissement créateur ; le dépassement qu'il inaugure est, en fait, une reprise de notre être enraciné dans le monde, à la manière de possibilités nouvellement découvertes. Toute œuvre d’art est un resurgissement, une transfiguration de la terre ; celle-ci est l’élément primordial à partir duquel toute création (Schaffen) devient un "puiser" (Schöpfen). Dans L’origine de l’œuvre d’art (texte repris dans le recueil intitulé Holzwege) [3], Heidegger écrit que l’art fait jaillir la vérité. Si l’œuvre sauvegarde une vérité, c’est celle de l’étant : l’art est la "conclusion" de l’étant. Mais l’art ne se manifeste aussi que par la médiation de l’artiste, c-à-d. de l'homme. "L'existence humaine, ce lieu de ressourcement poétique, est essentiellement tragique, parce qu’elle est tendue entre un donné irréductible (la terre) et une exigence de dépassement jamais satisfaite, déchirée entre l'appel de la terre et celui du monde… L'homme humanise la terre avant de la dominer, et l'horizon qu'il déploie pour la pénétrer, c’est le monde. La réflexion philosophique est précisément la mise en dialogue de ces 2 pôles complémentaires de l’existence qui, dans une expérience unique, se découvre à la fois enracinée dans la terre et dépassée vers le monde" (Resweber, op. cit.).
C’est ce double jeu de l’enracinement et de la désinstallation que Heidegger nomme la transcendance. Le rôle de l’homme sera d’amener sa terre à l’éclosion d’un monde. Ce geste, cette tâche sont éminemment poétiques parce que le mystère profond de la terre reste toujours inépuisable et présent, parce qu'il s’exprime en mythes et en images, mais surtout parce que c’est l’homme, par son intelligence et son action, qui fait surgir (poïeïn) le monde. Avec un vocabulaire différent, on dira que l’homme est un être qui inaugure la dimension culturelle tout en restant lié à la nature. La tension qu’implique cette tâche de construire un monde est tragique, car jamais il n’y aura totale adéquation entre l’origine tellurique et le monde instauré par la geste humaine. La finitude que nous assigne la terre nous condamne à rester "inachevé". A nous d’accepter joyeusement cette destinée !
Si, pour Heidegger, l’enracinement dans le pays de la Forêt noire constitue la dimension spatiale primordiale, nous devons aussi nous intéresser au contexte historique de son œuvre de philosophe, réponse aux interrogations de ses contemporains. Heidegger - nous l’avons vu - est indubitablement l’homme d’un espace ; il est également l’homme d’une époque. Un grand nombre des questions que se posent les philosophes trouvent leur origine dans l’œuvre d’Aristote. Heidegger lui-même reconnaît cette dette [4]. Au Gymnasium de Constance et à celui de Fribourg, où il étudia de 1903 à 1909, le futur archevêque de Fribourg, le Dr Conrad Gröber, l’incita à lire la dissertation de Franz Brentano, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, publiée en 1862 et consacrée aux multiples significations du mot "étant" chez Aristote. Cette 1ère initiation à la philosophie produisit, dans l’esprit du jeune étudiant, une interrogation encore imprécise : si l’étant a tant de significations, qu’est-ce qui en fait l’unité ? A partir de cette interrogation, Heidegger apprit à manier les concepts du langage philosophique et put percevoir toutes les potentialités de la méthode scolastique.
La période qui va de 1916 à 1927 constitue, dans la biographie de Heidegger, un silence de maturation. Rien, pendant ces 11 années, n’est très clair. On tâchera néanmoins de repérer quels furent les contacts personnels et intellectuels qui influeront sur l’élaboration de Sein und Zeit (L’être et le temps, 1927) d’abord, des cours, des essais et des conférences ensuite. C’est à cette époque, notamment, que Heidegger a travaillé avec Edmund Husserl (1859-1938), ce qui lui a permis d’acquérir complètement la discipline mentale et le vocabulaire de la phénoménologie. Cette discipline philosophique avait été investie, au XIXe siècle, d’un sens nouveau. Auparavant, elle désignait la simple description des phénomènes. Husserl, lui, eut la volonté de faire de la phénoménologie une science philosophique universelle. Le principe fondamental de cette "science" était ce que Husserl a appelé la réduction phénoménologique ou eïdétique. Cette réduction a pour but de concentrer l’attention du philosophe sur les expériences fondamentales qui n’ont jamais reçu d’interprétation, sur la description des vécus de conscience, sur la découverte des racines des idées logiques et sur la nécessité de rechercher les essences des choses. Husserl partira donc de ces idées logiques pour montrer leur enracinement dans la conscience vécue et, ensuite, découvrir dans l’ego transcendantal le fondement ultime du réel. L’influence de cette démarche philosophique se retrouvera dans le vocabulaire de Heidegger.
Husserl a commis le péché du géomètre
Pourtant, la 1ère œuvre magistrale de Heidegger, Sein und Zeit, marque un tournant radical par rapport à l’héritage husserlien. Heidegger reproche à son maître de réinstituer une métaphysique dégagée de tout vécu. L’ego transcendantal, à l’instar du modèle cartésien, se pense objectivement en face du monde. Ce face-à-face implique un arrachement du sujet au non-sens du monde. L’humanité réelle, seul sujet historique, devient l’ego trans-cendantal. Vicissitudes, événements, enracine-ments, histoire se voient donc dépouillés de tou-te validité. Pour échapper à cet idéalisme ratio-naliste, Heidegger propose une phénoménologie postulant qu’il n’y a pas, à la racine des phénomènes, une réalité dont ils dérivent. Il écrit : "Au-dessus de la réalité, il y a la possibilité. Comprendre la phénoménologie veut dire saisir ses possibilités". Ces possibilités présentes dans l’immanence, c’est ce que Heidegger appelle l’être de l’étant. Pour lui, ontologie et phénoménologie ne sont pas 2 disciplines différentes : il est impossible de sortir du plan des phénomènes, car ce serait s’exclure de la sphère de la révélation de l’être. En d’autres termes, refuser de tenir compte des phénomènes, c’est s’interdire l’accès à l’essentiel. Heidegger renverse la perspective de la philosophie traditionnelle : il voit l’essentiel dans l’intervention sur la trame des phénomènes et non dans une position de distance prise vis-à-vis d’eux.
Le moi transcendantal, chez Husserl, s’érige contre la phénoménalité des phénomènes, exactement comme dans la plupart des perspectives philosophiques classiques. II est la cause qui explique les phénomènes, le lieu à partir duquel ceux-ci sont dominés et justifiés. L’homme, dans une telle perspective, est un découvreur et non un créateur de sens. Sa position est contemplative et non active. Pour Heidegger, au contraire, la réflexion philosophique ne doit pas se borner à expliquer (à décrire ou à recenser) la réalité statique des phénomènes, mais elle doit en expliquer, par le moyen de l’herméneutique, les possibilités, c-à-d. ce qui, en eux, est susceptible de se développer, d’évoluer vers la production de nouveauté. On ne décrit complètement et avec assurance que ce qui est statique, figé, sûr. De ces choses statiques, les philosophes avaient déduit les essences. Hélas pour eux, les essences étaient rarement adéquates aux existences. De cette inadéquation naissent tant le pessimisme, qui s’en désole, que bon nombre de totalitarismes qui veulent, coûte que coûte, réaliser l’adéquation définitive. Heidegger pense que la possibilité est le mode d’être propre à l’existant parce qu’on ne peut reconnaître aucune entité métaphysique comme fondement de l’existence, et parce qu’il faut ré-enraciner l’être dans les phénomènes, dans la "facticité" [5]. Résolument, Heidegger affirme que c’est le néant qui sous-tend l’existence. Il ne remet rien à la place des anciens absolus métaphysiques.
Husserl, avec son moi transcendantal, a fini par commettre le péché du géomètre : la nature qu’il postule est préalablement posée, en dehors de toute limitation spatiale et temporelle, derrière l’écran des contingences et des particularités. Cette nature est comme créée ex nihilo. Où faut-il alors placer le travail de l’homme ? Le moi transcendantal travaille-t-il ? Le moi transcendantal produit-il ce que recèlent les possibilités ? Ces questions, Heidegger y répond dans son œuvre, en une sorte de dialogue inavoué avec Husserl.
Le monde de l'existence, ce chantier où œuvre l'homme, est, sans pour autant être nié, mis "entre parenthèses" par Husserl. L'herméneutique heideggérienne voudra, elle, décrire la facticité pour, ensuite, la retourner vers son sens ontologique, ce sens qui annonce l’être dans le monde. La description ne vise ici qu’à repérer ce qui peut être actualisé - ce qui peut se manifester dans le monde, ce que nous pouvons faire surgir. Le savoir a toujours été conçu comme un "voir" passif ; un tel point de départ trahit un platonisme tenace. Or Heidegger veut dépasser toute les attitudes passives qu'impliquent les enseignements des vieux philosophes. C’est pourquoi il juge que l'ego (le moi) transcendantal de Husserl reste, lui aussi, "un pur regard, assuré de son immortalité, glissant à travers l'éther du sens pur" [6]. Husserl n'a pas perçu que toute présence, jetée au regard de l’observateur, montre au philosophe attentif une temporalité dissimulée, oubliée ou déformée. Toute présence est à la fois spatiale (l’opposition de l’absence) et temporelle (son caractère d’instant). L’être et le temps sont liés dans la présence, et la reconnaissance de cette naïve évidence est la condition sine qua non pour échapper à l’illusion métaphysique.
Cette découverte de l’imbrication être-temps, Heidegger la doit à l’intérêt qu’il porte à la théologie depuis 1923. Cet intérêt a de multiples aspects. Sa rencontre avec l’œuvre de Rudolf Bultmann (1884-1976), philosophe connu pour s’être assigné la tâche de "dé-mythologiser" le Nouveau Testament en l’interprétant à la lumière de l’existentialisme, est, sur ce plan, capitale [7]. Bultmann a voulu dégager le message du Nouveau Testament en expliquant le contenu éthique des expressions mythiques employées dans la rédaction des textes évangéliques. Pour la Bible, l’homme est, d’une certaine manière (et de façon provisoire), historicité. Heidegger a scruté, avec la plus grande attention, la tradition chrétienne pour comprendre le rôle que joue la temporalité dans le phénomène humain. Il a médité Kierkegaard et, selon Bultmann, "ne s’est jamais caché d’avoir été influencé par le Nouveau Testament, spécialement par Paul, ainsi que par Augustin et particulièrement par Luther" [8]. "L’homme, écrit Bultmann, existant historiquement dans le souci de lui-même, sur le fond de l’angoisse, est chaque fois, dans l’instant de la décision, entre le passé et le futur : veut-il se perdre dans le monde du donné, du "on" ou veut-il atteindre son authenticité dans l’abandon de toute assurance et dans le don sans réserve au futur ?" (Kerygma und Mythos, I, 33).
Chez Paul, le terme kosmos ou monde n’est pas un état de choses cosmique, mais l’état et la situation de l’être humain, la façon dont celui-ci prend position envers le cosmos, la façon dont il en apprécie les biens. Chez Augustin, mundus signifie la totalité du créé, mais aussi, et surtout, habitatores mundi ou encore, plus péjorativement, dilectores mundi (ceux qui chérissent le monde), impii (les impies) ou carnales (les charnels) [9]. Au Moyen Age, Thomas d’Aquin reprendra cette distinction et fera du terme mundanus l’antonyme de spiritualis. Pourtant, malgré cette perception post-évangélique du monde, où celui-ci n’est pas appréhendé dans sa stabilité ontique, la tradition occidentale est restée prisonnière du vieux substantialisme immobiliste platonicien. Le protestantisme luthérien, toutefois, a eu le mérite de ré-actualiser le dynamisme propre à la saisie existentielle du Nouveau Testament. En ce sens, la révolution noologique amorcée par la Réforme constitue une 1ère étape dans la sortie hors de ce que Heidegger appelle l’oubli de l’être. L’homme ne vit authentiquement que s’il projette des possibilités, s’il s’extrait du monde de la banalité quotidienne.
L’existence, selon Heidegger, ne doit plus se comprendre à partir de l’étant, mais de l’être. Or, écrit André Malet [10], l’être n’est jamais une possession ; il est un destin historique qui rencontre l’homme d’une manière toujours nouvelle. L’homme est en définitive sa propre œuvre. En cela, Heidegger dépasse et refuse l’eschatologie vétérotestamentaire : il ne reconnaît pas la totale impuissance de l’homme à l’endroit de son ipséité.
chaque génération doit réécrire l’histoire
Pour l’historien grec Thucydide, l'élément permanent de l’histoire, c’est l’ambition et la recherche du pouvoir, dont le but est de donner des instructions utiles pour les décideurs à venir. Thucydide perçoit le mouvement de l’histoire comme analogue à celui du cosmos, de la nature. Plus tard, Giambattista Vico (1668-1744) a repris le thème antique du mouvement cyclique de l'histoire en le complétant : il y inclut l'idée d’une progression en spirale, grâce à laquelle la phase première du cycle I est autre que la phase première du cycle II. En Allemagne, Herder relativisera aussi l’histoire grâce au thème romantique du Volksgeist : chaque peuple, chaque époque a son éthique propre, ce qui implique en corollaire que ce ne sont ni la permanence ni l’éternité des choses qui importent, mais l’Erlebnis (le vécu).
 Au XXe siècle, enfin, Oswald Spengler systématisera cette perspective organique de l’histoire. Les civilisations, pour lui, seront isolées les unes des autres et leurs productions (scientifiques, mathématiques, philosophiques, théologiques, etc.) leur seront absolument propres. De Thucydide à Spengler, on a donc interprété l'histoire sur le modèle des faits naturels ; l’événement historique est considéré, selon cette perspective, comme une réalité finie, comme une chose. Nul ne songerait, bien évidemment, a nier la validité épistémologique de cette démarche. Mais Heidegger nous exhorte à ne pas en rester là. Il veut nous faire saisir l’événement historique comme un événement qui n’est jamais achevé. Dans la perspective antérieure, l’invasion des Gaules par César ou l'acte de rébellion de Luther étaient des faits définitivement morts. En fait, ils ne l’étaient que du strict point de vue spatio-temporel. Leur sens, lui, n’est nullement "mort". Il n'a pas été encore déployé dans toute son étendue ni toute sa profondeur. Ces sens subsistent à l’état de latence et restent susceptibles de se manifester dans notre existence. Les conséquences d’un événement constituent le futur de l’acte jadis posé tout autant que le présent qui appelle nos décisions pour forger l’avenir.
Au XXe siècle, enfin, Oswald Spengler systématisera cette perspective organique de l’histoire. Les civilisations, pour lui, seront isolées les unes des autres et leurs productions (scientifiques, mathématiques, philosophiques, théologiques, etc.) leur seront absolument propres. De Thucydide à Spengler, on a donc interprété l'histoire sur le modèle des faits naturels ; l’événement historique est considéré, selon cette perspective, comme une réalité finie, comme une chose. Nul ne songerait, bien évidemment, a nier la validité épistémologique de cette démarche. Mais Heidegger nous exhorte à ne pas en rester là. Il veut nous faire saisir l’événement historique comme un événement qui n’est jamais achevé. Dans la perspective antérieure, l’invasion des Gaules par César ou l'acte de rébellion de Luther étaient des faits définitivement morts. En fait, ils ne l’étaient que du strict point de vue spatio-temporel. Leur sens, lui, n’est nullement "mort". Il n'a pas été encore déployé dans toute son étendue ni toute sa profondeur. Ces sens subsistent à l’état de latence et restent susceptibles de se manifester dans notre existence. Les conséquences d’un événement constituent le futur de l’acte jadis posé tout autant que le présent qui appelle nos décisions pour forger l’avenir.
Bultmann écrit à ce propos : "Les phénomènes historiques ne sont pas ce qu’ils sont dans leur pur isolement individuel, mais seulement dans leur relation au futur pour lequel ils ont une importance". L'être se voit ainsi historicisé, et les hommes se retrouvent responsables de l'à-venir du passé. Les hommes, autrement dit, doivent décider hic et nunc de la signification de leur "avant" et de leur "après". (Malheureusement, la plupart des hommes s'attachent aux soucis du monde et, quand ils sont appelés à la décision, ils s'y refusent).
Faisant abstraction des idéologèmes misérabilistes et intéressés du christianisme, d’autres penseurs tels que Dilthey, Croce, Jaspers et Collingwood, se sont également efforcés de souligner l'originalité des faits historiques par rapport aux faits naturels, et, ipso facto, celle de l’histoire au regard des sciences de la nature. Heidegger a beaucoup réfléchi, en particulier, sur la tentative de Dilthey de définir les relations véritables entre la conscience humaine et les faits historiques. C’est de Dilthey, par ex., qu'il tire sa distinction fondamentale entre les vérités techniques (ontiques), propres aux sciences exactes et appliquées, et les intuitions authentiques, visées par les sciences historiques et humaines (Geisteswissenschaften). Sein und Zeit reprend d’ailleurs le contenu de la dispute philosophique entre Dilthey et Yorck von Wartenburg. Ce dernier reprochait à Dilthey de ne pas rejeter de manière suffisamment radicale une vision de l’histoire basée sur l’enchaînement causal. Heidegger insiste, lui aussi, sur la détermination temporelle de l’homme : l’identité humaine, dit-il, se découvre dans l’histoire. George Steiner, dans le bref ouvrage qu’il a consacré à Heidegger [11], rapproche cette position de celle du marxisme hégélien et révolutionnaire. De fait, comme le philosophe marxiste hongrois Georg Lukàcs, Heidegger insiste sur l’engagement des actes humains dans l’existence historique et concrète. Cette perspective conduit à adopter une attitude strictement immanentiste.
Pour le Britannique R.G. Collingwood (1889-1943), chaque génération doit réécrire l’histoire, chaque nouvel historien doit donner des réponses originales à de vieilles questions et réviser les problèmes eux-mêmes. Cette pensée est résolument anti-substantialiste. Elle pose la pensée comme effort réfléchi, comme réalisation d’une chose dont nous avons une conception préalable. La pensée, pour Collingwood, est intention et volonté. Elle doit être perçue comme une décision qui met en jeu tout l’être [12]. La plupart des conceptions de l’histoire jusqu’ici, fait fausse route. La raison de ces échecs réside dans une mauvaise compréhension de ce que on entendait autrefois par "science de la nature humaine" ou "sciences des affaires humaines". Au XVIIIe siècle, l’étude de la "nature humaine" s’est bornée à élaborer une série de types, s’apparentant ainsi à une recherche de caractère statique et analytique. Au XIXe siècle, l’étude des "affaires" humaines a provoqué la naissance des "sciences humaines", que Herbert Spencer appela plus justement social statics ; on catalogua alors toutes les forces irrationnelles à l’œuvre dans la société [13].
Mais la nature humaine, qui, selon Collingwood, est historique, ne peut s’appréhender à la manière d’un donné, par perception empirique. L’historien n’est jamais le témoin oculaire de l’événement qu’il souhaite connaître. La connaissance du passé ne peut être que médiat : Comment la connaissance historique est-elle alors possible ? La réponse de Collingwood est simple : l’historien doit ré-actualiser le passé dans son propre esprit [14]. Cette attitude a d’importantes conséquences. Lorsqu’un homme pense historique-ment, il a devant lui des documents ou des reliques du passé. Il doit re-découvrir la démarche qui a abouti à la création de ces documents. L’étude historique n’est possible que parce qu’il reste des survivances de l’époque où les documents ont été fabriqués ou rédigés. Dès lors, le passé qu’étudie un historien n’est jamais un passé complètement mort. L’histoire, écrit Collingwood, ne doit donc pas se préoccuper d’ "événements" mais de "processus". Se préoccuper de processus fait découvrir que les choses n’ont ni commencement ni fin, mais qu’elles "glissent" d’un stade à un autre. Ainsi, si le processus P1 se mue en processus P2, on ne pourra pas déceler de ligne séparant l’endroit, le moment où P1 finit et où P2 commence. P1 ne s’arrête pas, il se perpétue sous la forme de P2 - et P2 ne débute jamais, car il a été en gestation dans P1. L’historien qui vit dans le processus P2 devra savoir que P2 n’est pas un événement clos sur lui-même, pur et simple, mais un P2 mâtiné des survivances de P1.
Comme Collingwood, Heidegger sait que les gestes passés persistent, soit en tant que structures établies (avec le danger de sclérose), soit, après un échec, en tant que possibilités refoulées. Penser les événements historiques comme finis, comme confinés dans un "espace" temporel limité, revient, selon lui, à "objectiver" l’histoire à la manière dont les platoniciens et les scolastiques avaient "objectivé" la nature. Par opposition aux métaphysiciens, Heidegger entend donc expérimenter la vie dans son historicité, c-à-d. la vie non pas figée dans le "présent-constant", mais bien plutôt comme essentiellement "kaïrologique", ce qui signifie à la façon d’une mise en jeu, d’un engagement, d’une "folie". Ce jeu d’engagement et de "folie" constitue l’authenticité, dans la mesure même où il échappe aux petits aménagements de ceux qui souhaitent que le monde corresponde a leurs calculs. Les hommes qui souhaitent un tel monde sont déclarés inauthentiques. L’homme intégral ou celui qui vise l’intégralité est toujours menacé par les mystifications idéologiques et doit toujours demeurer vigilant pour se maintenir dans une attitude de liberté et d’ouverture véritables. Les mystifications idéologiques pétrifient le temps - ce temps toujours susceptible d’ébranler leurs certitudes réconfortantes. La "réalité" n’est pas, chez Heidegger, donnée une fois pour toutes, depuis toujours et de toute éternité. Elle est "question" & "jeu" ; elle "joue" à ouvrir et à relancer sans fin le jeu inépuisable de l’être et du temps, de la présence et de l’ "ouvert", de l’enracinement et de la désinstallation. Le jeu de l’être est sans justification ni raison, il se déploie à travers le destin, l’errance et les combats du temps. II est sans origine ni fin(s), sans référence aucune à un centre fixe et substantiel qui commanderait et garantirait son déploiement [15]. Ce rejet de toute pensée figée implique l’acceptation joyeuse de la pluri-dimensionnalité du cosmos, une pluri-dimensionnalité que le "penser" et le "dire" n’auront jamais fini d’explorer et de célébrer en toutes ses dimensions.
L’attitude de celui qui a fait sienne cette conception du monde est la Gelassenheit : impassibilité, sang-froid, sérénité. La Gelassenheit permet de supporter une existence privée de totalité rassurante. La finitude de l’homme nous place en effet dans (et non devant) un mystère inépuisable, qui ne cesse d’interpeller la pensée pour l’empêcher de se clore sur ses représentations.
un remplacement radical de toutes les ontologies
Heidegger nous propose donc son histoire de la philosophie, sa perspective sur l’œuvre des philosophes qui se sont succédés depuis Platon jusqu’à Nietzsche. Platon est celui qui a inauguré le règne de la métaphysique. Tandis que les Présocratiques concevaient l’être comme une unité harmonieuse qui conjugue stabilité, mouvance et jaillissement, Platon, brisant l’harmonie originelle de la nature, distingue la pensée de la réalité. Désormais, seul l’être saisissable par la pensée se verra attribuer la qualité d’être. Seul ce qui est non devenu, ce que le devenir ne corrode pas, ce qui est stable, limité dans l’espace, qui ne change pas, qui persiste, est. Tout ce qui est polymorphe, saisissable par les sens, tout ce qui devient et s’évanouit dans la temporalité et la spatialité, tout cela n’est, pour la tradition platonicienne, que du paraître. Cette radicale césure implique que l’esprit (noûs) ne fasse plus un avec la phusis. Au domaine de la vérité dé-limité par le champ de vision de l’esprit, Platon oppose le règne du sensible atteint par la perception (aïsthêsis). Chez les Présocratiques, le langage exprimait le surgissement de la réalité. Après Socrate et Platon, le langage devra ajuster la pensée à l’expression d’une proposition logique, "épurée" sémantiquement de toute trace de devenir. La démarche logique qui résulte de cette involution produit également la naissance de l’axiologie, de la morale. En effet, s’il faut rechercher toujours l’ajustement, il est évident que l’on finira par postuler un Ajustement suprême, que l’on nommera le Souverain Bien, l’Agathon. Sous l’influence de théologèmes pro-che-orientaux, ce divorce platonicien entre l’in-complétude du monde immanent et la complé-tude du monde des idées, recevra progressi-vement la coloration morale du bien et du mal.
Le monde a mis longtemps à triompher de la maladie dualiste. Heidegger le constate en interrogeant les grands philosophes qui l’ont précédé : Aristote, qui nuance, par sa théorie de l’acte et de la puissance, la pensée de Platon, mais qui ne le dépasse pas ; Thomas d’Aquin, qui personnalise le moteur premier sous les traits d’un Dieu chrétien déjà différent du Iahvé biblique ; Descartes, qui cherche une garantie en Dieu et n’analyse que les rapports "logiques" entre l’homme, coupé de la phusis, et cette même phusis, conçue comme étendue (res extensa) ; Leibniz et Kant, qui tentent difficilement de sortir de l’impasse ; Hegel, qui ne réhabilite que très partiellement le devenir, et enfin Nietzsche. De ce dernier Heidegger dit qu’il est le plus débridé des platoniciens, parce qu’à la place du trône désormais vacant de Dieu, il hisse la Volonté de puissance. Ce renversement (Umkehrung) n’est pas, pour Heidegger, un dépassement (Ueberwindung). La puissance remplace seulement la raison. Nietzsche, autrement dit, n’a pas suffisamment réfléchi à la façon d’extirper les illusions qui rejettent l’homme dans le règne du "on". Nietzsche a été un pionnier. Il faut le continuer et le compléter.
La Fundamentalontologie (ontologie fondamentale) de Heidegger se veut, elle, un remplacement radical de toutes les ontologies. Elle veut répondre à la question : Was ist das Seiende in seinem Sein ? (Qu’est-ce que l’étant en son être ?) Das Seiende, c’est l’agrégat "ontique", c-à-d. l’agrégat des étants, des phénomènes constituant le fond-de-monde. Un seul de ces étants est manifestement privilégié : l’homme. L’homme cherche l’être, la signification fondamentale de cet étant qui rassemble tous les étants. C’est pourquoi l’homme, seul étant a poser cette cruciale question de l’être, est un Da-Sein, un "être-là". Qu’est-ce que ce "là" ? La métaphysique occidentale avait placé l’essence de l’homme en dehors de la vie - alors que Heidegger veut remettre cette essence "là", c’est-à-dire replonger la vie dans l’immanence, dans le monde des expériences existentielles. Le résultat concret de cette "négligence" de la métaphysique occidentale avait été d’abandonner l’étude de l’homme aux social statics évoqués par Spencer. L’homme, objet d’investigations utiles et pratiques, s’était alors vu "compartimenté". Sa perception faisait l’objet de la psychologie ; son comportement faisait réfléchir la morale ou la sociologie ; enfin, la politique et l’histoire abordaient sa condition de citoyen, de membre d’une communauté organisée. Aucune de ces disciplines ne prenait en compte l’homme complet, intégral. Le "là" impliqué dans le Dasein, c’est au contraire le monde réel, actuel. Être humain, c’est être immergé, implanté, enraciné dans la terre. (Dans homo, "homme" en latin, il y a humus, "la terre").
In-der-Welt-Sein : telle est l’expression par laquelle Heidegger exprime la radicale nouveauté de sa philosophie. Depuis Platon, il s’agit, pour la 1ère fois, d’être vraiment dans ce monde. Nous sommes jetés (geworfen) dans le monde, proclame Heidegger. Notre être-au-monde est une Geworfenheit, un être-jeté-là, une déréliction. Cette banalité primordiale nous est imposée sans choix personnel, sans connaissance préalable. Elle était là avant que nous n’y soyons ; elle y sera après nous. Notre Dasein est inséparable de cette déréliction. Nous ne savons pas quel en est le but - si toutefois but il y a. La seule chose dont nous soyons sûrs, c’est qu’au bout, il y a, inéluctable, la mort. Dès lors, notre tâche est d’assumer la Faktizität (facticité) au milieu de laquelle nous avons été jetés. Si l’angoisse est bien ce qui manifeste le lien entre la dimension de l’être-jeté et le projet, le Dasein doit le reprendre dans l’horizon de sa finitude, ouvert sur l’avenir.
La philosophie traditionnelle s’est bornée à considérer le monde comme Vorhandenes, comme être-objet. La pierre, par exemple, est un être-objet pour le géologue : la pierre est jetée devant lui et il la décrit ; il reste détaché d’elle. La science de la nature détermine d’avance, a priori, ce que l’étant doit être pour être objet de savoir. Mais l’homme est plus qu’un spectateur-descripteur. En tant qu’être-au-monde, il sollicite les choses relevant, de prime abord, du Vorhandensein : l’ouvrage projeté oriente la découverte de l’outil et l’inclut en un complexe ustensilier. En les sollicitant, il les inclut dans son Dasein, il en fait des outils (Werkzeuge). Devenant "outils", ces choses acquièrent la qualité de Zuhandensein, d’être-en-tant-qu’objet-fonctionnant. Tout artiste, tout artisan, tout sportif saura ce que Heidegger veut dire : que l’homme, grâce à l’outil qu’il s’est approprié, devient un plus, ajoute "quelque chose" au "là", façonne ce "là" ; dans cette perspective, l’outil fait moins sens par son utilité que par son inscription dans un complexe de relations qui le rend bon pour tel usage, renvoyant en définitive à ce quoi le Dasein aspire. La vision strictement théorique de la philosophie platonicienne et post-platonicienne (Heidegger étant, lui, plutôt "transplatonicien", car il dépasse radicalement cet ensemble de prémisses) se concentrait sur l’élaboration de méthodes, sans percevoir ou sans vouloir percevoir le type immédiat de relation aux choses que constitue le Vorhandensein. Le Vorhandensein implique qu’il y ait d’infinies manières d’agir dans le monde. Quand il n’y a pas un modèle unique, tous les modèles peuvent être jetés dans le monde. L’homme devient créateur de formes et le nombre de formes qu’il peut créer n’est pas limité.
Jeté dans un monde qui était là avant lui et qui subsistera après lui, l’homme se trouve donc face à une sorte de "stabilité", face à ce que les philosophes classiques nommaient l’être, le stable, le non-devenu et le non-devenant. Heidegger, nous l’avons vu, reproche à cette démarche de ne pas percevoir la temporalité sous-jacente au sein même de tout phénomène. Vouloir "sortir" du temps est, de ce fait, une aberration. L’ontologie fondamentale postule que l’être est inséparable de la temporalité (Zeitlichkeit). L’être sans temporalité ne peut être expérimenté. Le souci (Sorge), qui est ce mode existentiel dans et par lequel l’être saisit son propre lieu et sa propre imbrication dans le monde comme être-en-avant-de-soi, devant utiliser le temps pour aborder les étants, car ce n’est que dans l’horizon du temps qu’une signification peut être attribuée aux réalités ontiques, aux choses de la quotidienneté. Heidegger dit : "La temporalité constitue la signification primordiale de l’être du Dasein". C’est là une position résolument anti-platonicienne et anti-cartésienne, car, tant chez Platon que chez Descartes, le temps et l’espace sont idéalisés, géométrisés. En revanche, cette position semble évoquer l’idée chrétienne d’incarnation de Dieu dans le temps. Dans un texte contemporain de Sein und Zeit, écrit lui aussi en 1927 et intitulé Phänomenologie und Theologie, Heidegger explique effectivement l’intérêt de la théologie pour comprendre ce qu’est le temps [16].
Mais l’imperfection humaine posée dans la théologie augustinienne se mue, chez lui, en une incomplétude, en un "pas-encore" (noch-nicht) qui oblige à vivre mobilisé, comme pour une croyance. L’homme doit se construire dans une perpétuelle tension, à l’instar du croyant qui vit pour mériter son salut. Mais ici, il n’y a pas de récompense au bout de cet effort ; il n’y a que la mort. Heidegger refuse donc totalement les espoirs consolateurs de la praxis chrétienne. L’augustinisme postulait que l’homme devait vivre de manière irréprochable, morale, dans l’histoire momentanée. Pour Heidegger, l’histoire s’écoule, mais cet écoulement n’est pas momentané. L’écoulement (panta rhei) s’écoulait avant nous et s’écoulera après nous. L’intérêt que porte Heidegger au temps des théologiens n’est pas du christianisme. Il est resté disciple d’Héraclite : son temps "coule", mais nullement pour, un jour, s’arrêter. Quel intérêt, d’ailleurs, y aurait-il à vivre hors de cette tension qu’implique la temporalité ? Le souci est antérieur à toute détermination biologique et rompt avec la définition de l’homme comme animal rationale car la conscience de réalité n’est jamais qu’une modalité de l’être-au-monde et non un complexe hétérogène d’âme et de corps.
les trois modes d’être selon Heidegger
Penchons-nous maintenant sur la "déréliction" personnelle de Heidegger. Né en 1889, Heidegger passe son enfance et son adolescence dans ce que l’écrivain Robert Musil, parlant de l’Autriche-Hongrie de la Belle époque, appelait la "Cacanie" (Kakanien). Qu’entendait-il par là ? Simplement l’incarnation de la décadence : une société affectée par un bourgeoisisme à bout de souffle. Pour Musil, l’Autriche-Hongrie du début du siècle incarnait la fin de toutes les valeurs. Le philosophe Max Scheler, plus optimiste, écrivait : "Là où il n’y a pas de place pour les valeurs, il n’y a pas de tragédie. Ce n’est qu’où il y a du "haut" et du "bas", du "noble" et du "vulgaire", qu’existe quelque chose qui laisse deviner des événements tragiques" [17]. C’est dans un climat analogue que Nietzsche avait placé ces mots lourds de signification dans la bouche de son Zarathoustra : "Inféconds êtes-vous ! C’est pourquoi il vous manque de la foi". Par là, il voulait signifier que le manque de foi menait à la stérilité des connaissances et de la création. Mais de quelle foi s’agissait-il ? Heidegger nous apprend que la foi post-chrétienne ou, pour être plus précis, l’intérêt pour le temps (valorisé par les chrétiens dans la mesure où il conduit à Dieu) et pour l’histoire (eschatologique chez les chrétiens) doit se retrouver demain dans la philosophie après la longue éclipse que fut l’oubli de l’être en tant qu’imbrication de la terre et du temps. Dans la mesure où les espoirs eschatologiques déçoivent, où l’objectivation implique une norme immuable, les sociétés sombrent dans le nihilisme. Les hommes, pour paraphraser le titre du roman de Robert Musil (Der Mann ohne Eigenschaften), deviennent sans qualités.
Dans quel monde vit alors l’homme sans qualités ? Comment Heidegger va-t-il cerner, par son propre langage philosophique, ce monde où gisent les cadavres des valeurs ? Dans quel paysage idéologique Sein und Zeit va-t-il éclore ? Quels rapports sommes-nous autorisés à découvrir entre Sein und Zeit et le Zeitgeist (l’esprit du temps) qui échappe, dans le tourbillon des événements et des défis, à la rigueur philosophique et au regard pénétrant de cet éveilleur que fut Martin Heidegger ?
La philosophie heideggérienne de l’existence se veut une ontologie. Mais une ontologie qui a pour particularité de poser la question de l’être après plusieurs siècles d’ "oubli". La métaphysique, on l’a vu, a été l’expression de cet oubli depuis Platon. L’oubli est la racine même du nihilisme qui afflige la société européenne, et notamment la société allemande après la première Guerre mondiale. Or, tout le mouvement de ce que l’on a dénommé Konservative Révolution (Révolution Conservatrice) est marqué par une recherche de la totalité, de la globalité perdue. L’essayiste anglais Peter Gay parle de Hunger for wholeness [18], ce que nous traduirons par "soif de totalité", une soif qui implique un jugement très sévère à l’encontre de la modernité. Le chaos social et spirituel provoque alors une recherche fébrile de "substantialité" ou, plutôt, d’ "intensité". Cette volonté de donner une réponse à la quiddité est corrélative d’un questionnement sur le "comment", sur le mode d’être qui se traduira dans la réalité tangible.
Il y a, pour Heidegger, 3 modes d’être : l’être-objet (Vorhandenes), l’être-en-tant-qu’objet-fonctionnant (Zuhandenes), l’être comme Dasein, c-à-d. comme être-conscient, être-qui-s’autodétermine, être-homme. Or, on ne peut parler de "substantialité" pour les 2 premiers de ces modes. Seul l’homme en tant que Dasein est susceptible d’acquérir de la "substantialité". Sa spécificité l’oblige à être ce qu’il est de manière complète, effective et totale. Cependant, le Dasein en tant qu’existence court toujours le risque de sombrer dans le non-spécifique (Uneigentlichkeit), c-à-d. dans un type de situation caractérisée par l’ "anodinité" de ce que Heidegger appelle l’Alltäglichkeit (la banalité quotidienne).
De telles situations évacuent de l’existence des hommes et des communautés politiques l’impératif des décisions, nécessaires pour répondre aux défis qui surgissent. La banalité quotidienne est fuite dans le règne du "on" (Man-Sein). L’homme, souvent inconsciemment, se perçoit alors comme objet soumis à des règles banalement générales. Il trahit sa véritable spécificité, dans la mesure où il refuse d’admettre ce qui, d’emblée, le jette dans une situation. Comme un navire privé de gouvernail, il n’est plus maître de la situation, mais se laisse entraîner par elle. Heidegger distingue ici deux aspects dans le mode d’être qu’il attribue au concept d’existence : l’aspect individuel (propre à un seul homme ou à une seule communauté politique) et l’aspect ontologique stricto sensu qui est l’être-effectif, l’être-qui-n’est-pas-que-pensé. Ces 2 aspects diffèrent de ce que la philosophie occidentale qualifiait du concept d’essentia. L’essence, depuis le platonisme, était perçue comme ce qui est au-delà des particularités et des spécificités. Cette volonté d’ "alignement" sur des normes non nécessairement dites, constituait précisément la structure mentale qui a permis l’avènement du nihilisme, où les personnalités individuelles et collectives se noient dans le règne du "on". Nier les particularités, c’est oublier l’être qui est fait de potentialités. Le culte métaphysique de l’essentia chasse l’être du monde. Le monde dont l’être est banni vit à l’heure du nihilisme. Et c’est un tel monde que les contemporains de Heidegger observaient dans l’Allemagne de Weimar.
La révolution philosophique du XXe siècle se réalisera lorsque les Européens s’apercevront que l’être n’est pas, mais qu’il devient. Heidegger, pour exprimer cette idée, recourt à la vieille racine allemande wesen, dont il rappelle qu’elle a donné naissance à un verbe. II écrit : Das Sein an sich "ist" nicht, es "west". L’être est pure potentialité et non pure présence. Il est toujours à appeler. L’homme doit travailler pour que quelque chose de lui se manifeste dans le prisme des phénomènes. Une telle vocation constitue son destin, et c’est seulement en l’acceptant qu’il sortira de ce que Kant nommait son "immaturité". L’impératif catégorique ne sera plus alors la simple constatation des phénomènes figés dans leur présence (en tant que non-absence), la reconnaissance pure et simple des objets et/ou des choses produits par la création "divine" des monothéistes. Il sera le travail qui fait surgir les phénomènes. L’attitude de demain, si l’on veut trouver des mots pour la définir, sera le réalisme héroïque [19], sorte de philosophie de la vigilance qui nous exhorte à éviter tout "déraillement" de l’ "être" dans l’Alltäglichkeit.
seul l’homme authentique opère des choix décisifs
Si une règle, une norme s’applique impérativement à tous les hommes, à toutes les collectivités, dans tous les lieux et en tous les temps, l’homme ne peut qu’être empêché de poser de nouveaux choix, d’élaborer de nouveaux projets (Entwürfe), de faire face à des défis auxquels ces normes (qui ne prévoient, dans la plupart des cas, que la plus générale des normalités) ne peuvent répondre. Pour Heidegger, la possibilité de choisir - et donc de faire aussi des non-choix - se voit donc investie d’une valorisation positive. La marque du temps se perçoit très clairement dans ces réflexions. L’Allemagne, en effet, se trouve alors devant un choix. Par ce choix, elle doit clarifier sa situation et rendre possible le "projeter" (Entwerfen) et le "déterminer" (Bestimmen) d’une nouvelle "facticité".
On a qualifié cette démarche heideggérienne de philosophie de Berserker, ces personnages de la mythologie scandinave, compagnons d’Odin, qui avaient le pouvoir de commettre des actes habituellement défendus. De fait, les détracteurs de la conception heideggérienne de l’existence prétendent souvent qu’elle constitue une justification de tous les excès du subjectivisme. A cette abusive simplification, on peut répondre en constatant que la volonté de légitimer l’éternité des normes traduit un simple "désir" de régner sur une humanité dégagée de toute responsabilité, sur une humanité noyée dans le monde du "on".
Pour Heidegger, l’homme, en réalité, ne choisit pas d’agir pour ses propres intérêts ou pour ses caprices, mais choisit, dans le cadre de la situation où il est jeté ou enraciné, ce que l’urgence commande. Une action ainsi absoluisée n’a rien d’égoïste ; elle a vocation d’exemplarité. Qualifier une telle conception de l’existence d’ "ontologique", comme le fit Heidegger, a peut-être constitué un défi philosophique. Il n’empêche qu’une telle conception de la décision représente un dépassement radical du fixisme métaphysique issu du platonisme. On a alors raison de faire de Heidegger le philosophe par excellence de la Révolution Conservatrice. Loin d'être une fuite dans le pathétique, la philosophie de Heidegger cherche à comprendre sereinement l'ensemble des potentialités qui s'offrent à l'existence humaine. Cette philosophie est révolutionnaire, parce qu'elle cherche à fuir le monde du "on", marqué par le répétitif et l’uniformité. Elle est conservatrice, parce qu’elle refuse d’exclure la totalité des potentialités qui restent à l’état de latence. Autrement dit, ce que la pensée heideggérienne conserve, ce sont précisément les possibilités de révolution, que l’ontologie traditionnelle avait refoulées.
Les contemporains ont fortement perçus ce que cette philosophie leur proposait. Sans apporter de remèdes consolateurs, Heidegger affirme que l'inéluctabilité finale de la mort oblige les hommes à agir pour ne pas simplement passer du "on" au néant. La mort nous commande l'action. En cela, réside un dépassement du nietzschéisme. Chez Nietzsche, en effet, la "vie" reste quelque chose en quoi l'on peut se dissoudre ; la "puissance", quelque chose par quoi l’on peut se laisser emporter. La décision face au néant est totalement non-objet, non-substance, non-produit. Elle est pure attitude jetée dans le néant, pure attitude privée de sens objectif. Dans une telle perspective, l’adversaire n’est jamais absolu. Néanmoins, l'ennemi désigné est le monde bourgeois du "on". L'idéologie conservatrice acquiert ainsi, avec Heidegger, la tâche de gérer l'aventureux. Elle prend en charge le dynamisme qu’auparavant on attribuait aux seuls négateurs. La négativité n'est plus l'apanage des penseurs de l'École de Francfort.
La négativité heideggérienne se fixe pour objectif de mettre un terme au déclin des valeurs, résultat de l’ "oubli de l’être". Face au monde banal qui s’offre à nos regards, Heidegger affirme que la mise en doute constitue un moyen pour tirer l’humanité de l’indolence dans laquelle elle se trouve, et pour lui dire qu’il y a urgence. Heidegger est aussi l’héritier de la tradition pessimiste allemande, mais il se rend parfaitement compte que le pessimisme constitue une attitude insuffisante. "La décadence spirituelle de la terre, écrit-il, est déjà si avancée que les peuples sont menacés de perdre la dernière force spirituelle, celle qui leur permettrait du moins de voir et d’estimer comme telle cette décadence (conçue dans sa relation au destin de l’ "être"). Cette simple constatation n’a rien à voir avec un pessimisme concernant la civilisation, rien non plus, bien sûr, avec un optimisme ; car l’obscurcissement du monde, la fuite des dieux, la destruction de la terre, la grégarisation de l’homme, la suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre, tout cela a déjà atteint, sur toute la terre, de telles proportions, que des catégories aussi enfantines que pessimisme et optimisme sont depuis longtemps devenues ridicules" [20].
Pour Heidegger, il n'y a pas évolution historique, mais involution. Ce sont les origines des mondes culturels qui sont les plus riches, les plus mystérieuses, les plus enthousiasmantes. L’être-homme, aux âges primordiaux, connaît son intensité maximale. Cet être-homme consiste à être sur la brèche, là où l’être fait irruption dans le monde de l’immanence. Mais c’est bien l’homme qui reste le maître du processus. Les époques de décadence sont à cet égard capitales, car elles appellent les hommes à remonter sur la brèche, à ressortir de l’abîme où l’oubli de l’être les a conduits. Dans cette perspective, le succès ou l’échec sont secondaires. Le héros qui échoue peut être quand même exemplaire. Rien n’est réellement définitif. Rien n’arrête la nécessité de l’action. Rien ne démobilise définitivement - car une démobilisation définitive impliquerait de retomber dans le nihilisme.
Cette conception heideggérienne de l’existence renoue avec une éthique présente dans la vieille mythologie nordique. Évoquant la claire perception de sa situation éprouvée par le héros de l’épopée germanique, Hans Naumann (Germanische Schicksalsglaube) a montré, par ex., que celui-ci est très conscient de sa propre déréliction. Le héros sait qu’il est jeté dans une appartenance temporelle, spatiale, sociale, politique et familiale ; il sait qu’il appartient à un peuple. La figure d’Odhinn-Wotan est l’exemple divinisé de l’attitude qu’adopte celui qui n’hésite pas à affronter son destin. Le concept heideggérien de Sorge (repris de Kierkegaard), voire celui d’Entschlossenheit (détermination, résolution), correspond au contenu psycho-éthique investi dans le personnage d’Odhinn. Naumann perçoit même, dans cette "danse avec le destin" un élément d’esthétisme, de "dandysme" qui échappe à Heidegger, malgré son indéniable présence dans les cercles de la Konservative Revolution et surtout chez Ernst Jünger [21].
De son côté, le professeur G. Srinivasan, de l’université de Mysore, en Inde, a publié un ouvrage (The Existentialist Concepts and The Hindu Philosophical Systems, Udayana, Allahabad, 1967) dans lequel il souligne les analogies existant entre la religion indienne et les traditions existentialistes européennes du XXe siècle. L’analyse existentialiste du choix, notamment, peut être comparée au récit d’Arjuna dans la Bhagavad-Gîta, ou encore à celui de Sri Rama dans le Ramayana. La mystique indienne permet aux hommes, elle aussi, de choisir entre une existence monotone et mondaine et une saisie plus "héroïque" du monde. Le mode de vie nommé dukha est l’équivalent indien de l’Alltäglichkeit heideggérienne. Le sage est invité à ne pas se laisser emporter par les séductions sécurisantes de cette situation et à "contrôler", à "transcender" l’existentialité inauthentique. Comme chez Heidegger, l’inévitabilité de la mort ne saurait empêcher l’homme authentique d’opérer, en cas d’urgence, un choix décisif. Une étude approfondie des analogies existant entre l’éthique indienne et celle de l’Edda d’une part, les enseignements de la philosophie heideggérienne d’autre part, serait d’ailleurs, probablement, des plus enrichissantes. Un trait commun est certainement la saisie unitaire (non dualiste) de l’existence.
Heidegger se trouve donc en rupture avec la conception dualiste du monde liée à l’idée biblique du péché originel et à la façon dont certains Grecs assignaient des limites au cosmos, posant ainsi, dans l’histoire des idées, l’avènement du substantialisme. Cette Grèce-là était elle-même en rupture avec une saisie de l’univers conçu comme épiphanie du divin. Pour Thalès de Milet, par ex., l’élément primordial "eau" est l’Urbild de tout ce qui s’écoule, de tout ce qui se transforme inlassablement, de tout ce qui ne cesse de vivre, de tout ce qui crée et maintient la vie. "Tout est plein de dieux" : cette sentence de Thalès constitue l’affirmation de l’unité totale cosmique. L’apeiron d’Anaximandre, qui est l’ "illimité", la solitude tragique de Héraclite, cherchant à tirer ses contemporains d’un sommeil qui les rendait aveugles à l'unité du monde, comptent aussi parmi les 1ères manifestations conscientes de la "vraie religion de l’Europe" et elles ne s'embarrassent d'aucun dualisme [22].
La lecture de ces Présocratiques, conjuguée à celle du poète romantique Friedrich Hölderlin, a fait comprendre à Heidegger quelle nostalgie est demeurée sous-jacente dans toutes les interrogations philosophiques, y compris celle de la tradition substantialiste occidentale : un désir d’unité à la totalité cosmique. "Être un avec le tout, voilà la vie du divin, voilà le ciel de l’homme, écrit Hölderlin. Être un avec tout ce qui vit, dans un saint oubli de soi, retourner au sein de la totalité de la nature, voilà le sommet des idées et de la joie, voilà les saintes cimes, le lieu du repos éternel où la chaleur de midi n’accable plus et où l’orage perd sa voix, où le tumulte de la mer ressemble au bruissement du vent dans les champs de blé... Mais hélas, j’ai appris à me différencier de tout ce qui m’environne, je suis isolé au sein du monde si beau, je suis exclu du jardin de la nature où je croîs, fleuris et dessèche au soleil de midi" (Hypérion). Ce texte ne doit toutefois pas faire passer Hölderlin pour le chantre d’un idéal d’harmonie ou d’une unité cosmique qui se résumerait dans un pastoralisme douceâtre. Les souffrances que Hölderlin a endurées ont permis chez lui l’éclosion d’une terrible volonté, qui refuse de fermer les yeux devant les réalités. La force de l’âme qui dit "oui" au monde, même devant l’abîme où aucune idéologie sécurisante ne saurait être un recours, est bien évidemment déterminante pour les réflexions ultérieures de Heidegger, dont l’anthropologie dynamique et tragique restitue de façon radicale une religiosité que l’Europe, depuis 3 millénaires, n’avait jamais vraiment perdue.
le "réalisme héroïque" de la Révolution conservatrice
En 1922, sous la direction de Moeller van den Bruck, paraissait un ouvrage collectif intitulé Die neue Front, dans lequel il était fait mention d’une attitude héroïco-tragique nécessaire au dépassement de la situation qui régnait alors en Allemagne. L’idée heideggérienne de connaissance claire de la situation y était déjà présente. L’expression "réalisme héroïque" ne faisant pas encore partie du vocabulaire, on y employait l’expression d’ "enthousiasme sceptique". Toutefois, s’il y avait convergence, dans l’analyse de la situation politico-culturelle, entre les amis de Moeller van den Bruck et Heidegger, en qui germaient alors les concepts de Sein und Zeit, les 1ers avaient le désir affiché d’intervenir dans le fonctionnement de la cité, tandis que Heidegger se préparait seulement à scruter les textes philosophiques traditionnels afin d’offrir au monde une philosophie de l’urgence - la philosophie d’un "être" qui se confondrait avec l’intensité du vécu. Le discours de Moeller van den Bruck et de ses amis, plus politisé, désignait le libéralisme comme l’idéologie incarnant le plus parfaitement l’Alltäglichkeit, postulée par ce que, quelques années plus tard, Heidegger nommera le monde hypothético-répétitif. Ernst Bertram, auteur de Michaelsberg, estimait, lui, que l’esthétique du monde à venir ressemblerait à l’architecture romane, avec sa clarté, sa sobriété, sa formalité sans luxuriance. De son côté, le poète Rainer Maria Rilke déplorait que le monde moderne ne possédât plus cette simplicité toute tangible qui offrait à l’esprit (Geist, équivalent, dans le langage de Rilke, à l’Être de Heidegger) une assise stable.
(A SUIVRE...)
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, heidegger, existentialisme, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
El desencantamiento del mundo

SINERGIAS EUROPEAS – BRUXELLES / BUENOS AIRES – MARZO de 2004
Chers amis,
Le Prof. Buela, spécialiste de philosophie grecque antique à Buenos Aires en Argentine est l’un de nos amis de longue date. Le texte qu’il nous a envoyé aujourd’hui est CAPITAL et mérite une lecture très attentive. Il est également idéal pour les travaux des cellules de l’école des cadres,dans la mesure où la clarté limpide (et hispanique) des arguments et des thèses de Buela nous permet de cerner une notion aussi capitale que celle de “désenchantement”, théorisée en son temps par Max Weber. Bon travail !
Liebe Freunde,
Dieser Text ueber den Weberschen Begriff der “Entzauberung” scheint uns aeusserst wichtig, weil glasklar formuliert und deshalb fantastisch didaktisch, und verdient eine deutsche Uebersetzung. Er stammt von Prof. Dr. Alberto Buela, Dozent altgriechischer Philosophie in Argentinien. Wir fragen deshalb an unseren deutschen Korrespondenten, alles in Bewegung zu setzen, diese Uebersetzungsarbeit zu erledigen. Wir danken Ihnen im voraus !
El desencantamiento del mundo
Prof. Dr. Alberto Buela (Buenos Aires)
La idea de desencanto ha sido utilizada modernamente en sociología por Max Weber y Ernst Troeltsch para interpretar el paso de una etapa a otra en el proceso socio-cultural de la historia del mundo.
El término contiene en sí la idea de “encanto”, bajo su forma negativa y está vinculado a las categorías de secularización o “desdivinización”.
No hay que olvidar al respecto que mundo se dice en griego cosmos (kosmoV) que significa primariamente “limpio o bello”. En nuestros días quedó la cosmética como la ciencia del embellecimiento. Las mujeres la utilizan sobre todo para “encantar a los hombres”. Las ideas de mundano y mundanal nos indican una inserción extralimitada en el mundo. Una sobrecarga de cosméticos, para seguir con el ejemplo, que termina, en general desencantando.
Por otra parte la idea de “encanto” que viene de incanto y que significa en latín pronunciar fórmulas mágicas, hechizar, someter a poderes mágicos indica con el sufijo in aquello que está dentro del canto que en latín significaba cantar para ensalzar acompañándose de un instrumento musical. La idea de encanto tiene dos vertientes, una compuesta por el sometimiento a poderes mágicos, donde el mito está detrás y otra por el sometimiento de los sentidos a la hermosura, la gracia, la simpatía o el talento. Pero además, no debemos olvidar que el encanto encierra también, y este es su aspecto negativo, la idea de aducir razones aparentes y engañosas, pues encanto también significa vender en pública subasta, que como es sabido por todos, es el lugar propicio para el engaño.
Y el mundo, nuestro mundo, es todo esto, el lugar donde nos gozamos y también donde nos padecemos unos a otros.
Observamos, al menos etimológicamente, como la idea de encanto está estrechamente vinculada a la de mundo.
Nosotros vemos cuatro etapas en el desencantamiento del mundo, que marcan a su vez cuatro períodos bien determinados de nuestra historia socio-político-cultural.
1.- El desencantamiento del mundo arcaico
El mundo hasta el surgimiento de la filosofía griega en Mileto hacia el siglo VI a.C. estaba considerado por las cosmologías de los pueblos antiguos – India, Egipto, Caldea, Grecia – como un conjunto de fuerzas de la naturaleza que se personificaban en divinidades.
El salto cualitativo, y nunca acabado de estudiar sobre qué produjo el surgimiento de la filosofía griega, consistió en que ésta reemplazó esas divinidades por elementos naturales- agua, aire, fuego, tierra- y por explicaciones racionales de condensación-dilatación, frío y calor.
Los primeros filósofos buscaron, dentro del mundo y no fuera de él, un principio, un arjé, como causa primera de todas las cosas y a la que debían retornar. Todo salía de los elementos y volvía a ellos en un proceso cíclico de cierta duración (el gran año). Anaximandro (610-546 a.C.)el tercero de los milesios, en el texto más antiguo de la filosofía occidental nos dice: “De donde los entes (toiV ousi)tienen su origen, hacia allí tienen también su perecer según la necesidad. Pues se pagan pena y castigo unos a otros por su injusticia según el orden del tiempo” Y agrega Teofrastro de quién nos llega el fragmento: “diciendo estas cosas con palabras un tanto poéticas”.
Los dioses siguieron formando parte del mundo pero ya no lo explican, son los distintos principios y sus combinaciones los que lo hacen.
El mundo antiguo, aquel de la sabiduría primordial, sufre el primer desencanto: El mundo puede ser explicado no ya por los dioses sino por los hombres, a través del estudio de las causas y los principios de las cosas.
Se ha producido el paso del mito al logos, aún cuando perduran en los presocráticos, sobre todo en Empédocles y Pitágoras, muchos elementos de las antiguas cosmogonías.
2.- El desencantamiento del mundo pagano
La plenitud de la filosofía griega lograda con Platón y Aristóteles comienza a descender en nuevas y limitadas escuelas filosóficas como el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo y el eclecticismo. Roma recibe así sólo retazos de la gran filosofía griega. El hombre que para el griego es “ánthropos= anqrwpoV”, que proviene de “anathrón ha hopopé= anaqron a opwph”, investigador de lo que ha visto, es decir, el que contempla, pasa, en el mundo romano, a ser considerado como “homo” que proviene de “humus”, esto es, aquél que tiene los pies en la tierra porque con ella está constituido. La filosofía termina limitándose al derecho y a su arte supremo la eloquentia u oratoria ciceroniana.
Es en este momento que aparece el cristianismo, con la “novedad histórica” de un Dios único y trascendente al mundo y con ello produce el segundo gran desencantamiento del mundo. Éste deja de estar habitado por dioses de todo tipo y espíritus de todo pelaje, para ser considerado como otra cosa distinta de Dios, incluso lo opuesto a Él.
El cristianismo primitivo no sólo rompe con la cohabitación en el mundo pagano entre hombres, dioses y espíritus, sino que incluso rechaza por boca de San Pablo la filosofía como acceso al saber: “Mirad que nadie os engañe con filosofías falaces y vanas, fundadas en tradiciones humanas, en elementos del mundo y no en Cristo”(Col.2,8)
Así, la única vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra filosofía es bajo un acepción negativa.
Ahora bien, la ruptura de la unidad dioses-mundo producida por el cristianismo con su propuesta de un Dios trascendente al mundo y su consecuente desencantamiento, la intenta salvar con un nuevo “encantamiento”. Esto es, poblando la distancia que hay entre Dios y el mundo con seres espirituales, ángeles, arcángeles y criaturas espirituales que median entre unos y otros. Ejemplo de ello nos dejó San Dionisio Areopagita en su tratado Sobre la Jerarquía Celeste.
El cristianismo posterior recupera la gran tradición de la filosofía griega y vuelca en sus categorías la teología cristiana. Las figuras emblemáticas de Platón y Aristóteles son asumidas respectivamente por San Agustín y Santo Tomás que son los grandes expositores teológico-filosóficos del misterio teándrico, del Dios hecho hombre.
3.- El desencantamiento del mundo cristiano
El mundo cristiano se desarrolla sin sobresaltos hasta finales del siglo XVII en que aparece un nuevo orden de cosas. Finis saeculi novam rerum faciem aperuit, afirmará Leibniz, el último filósofo que concentró en sí todo el saber de su tiempo(1). Comenzaba, pues, la entronización del culto a la “diosa razón”. Hasta ese momento se sucede un período, casi mil años, de gran expansión misional y, al mismo tiempo, de gran acumulación del saber antiguo. Caballeros, misioneros y monjes realizan el trabajo más pesado de la Alta edad media, también denominado peyorativamente período oscuro. Viene luego la denominada Baja edad media que tiene su plenitud en el siglo XIII, siglo de las grandes Summas –Alberto Magno, Tomás de Aquino, San Buenaventura, Duns Escoto, etc.-. Nace, en el siglo siguiente con el nominalismo, lo que justamente se denominó la vía moderna, que es proseguida por el Renacimiento en el XV, la Reforma en el XVI y el Racionalismo del siglo XVII. Estos grandes movimientos aún son y pertenecen mutatis mutandi al mundo cristiano. El desencantamiento de éste mundo se produce en el siglo XVIII con la propuesta del racionalismo, ahora, Iluminista y con el movimiento de la Ilustración enciclopédica.
Se inaugura la época de la razón calculadora como acertadamente la denominó Heidegger. Dios deja de ser el centro del universo, el productor de sentido para convertirse en un capítulo de la filosofía denominado teodicea. Aún cuando ya hace dos siglos que los métodos han cambiado, se privilegia el método experimental al especulativo, el desancantamiento del mundo se produce cuando, al decir de Hegel, el bosque sagrado de toda la tradición medieval y premoderna se transforma en “mera leña”. El objeto ya no es lo bello sino que degradándose a objeto material es sólo lo calculable, lo mensurable, lo dominable por la razón.
Sin embargo la razón iluminista intenta su propio “encantamiento” del mundo a través de cinco o seis relatos universales: el progreso indefinido, el poder omnímodo de la razón, la democracia como forma de vida, la subjetivización del cristianismo, la manipulación de la naturaleza por la técnica, la libertad como capricho subjetivo.
4.- El desencantamiento del mundo moderno
La modernidad que a través de otro de sus relatos, el igualitarismo, creyó construir un mundo igual para todos y con validez universal se fue percatando poco a poco que aquellos principios sobre los cuales había sido edificada se derrumbaban irremisiblemente.
Ahora bien, el fracaso estruendoso de estos principios sagrados de la modernidad ilustrada – el progreso fue en muchos aspectos un retroceso; la razón no pudo explicar todo; la democracia ha sido sólo porcedimental o formal, el cristianismo subjetivado se partió en infinitas sectas, la técnica terminó en Hiroshima y la libertad en un mito. Todas estas contradicciones hicieron de la conciencia postmoderna, conciencia desencantada de la modernidad.
Y aquí llegamos a nuestros días en donde observamos que la postmodernidad pasa a ser en definitiva mera conciencia desilusionada de la modernidad. El publicitado filósofo J. Habermas sostiene, en síntesis, que estamos mal porque no acabó de plasmarse el proyecto moderno. Con esta afirmación el filósofo de la Escuela de Frankfurt sigue manteniendo el enfoque particular propio de la modernidad y su propuesta política en una visión aggiornada de la socialdemocracia europea. Y en estos términos no hay salida posible que no sea el desencanto, el nihilismo, el pensamiento débil, lo políticamente correcto. En el fondo el hombre resignado y en desazón, como gustaba decir Gonzalo Fernández de la Mora.
El desencantado nihilismo se expresa, en los mejores, como un crítica ácida de la situación en que vivimos. Ejemplo de ello es Emile Ciorán. Pero en una crítica simplemente fenomenológica, descriptiva, y no metafísica como debiera ser. Porque nuestros mejores hombres hoy son, también ellos, producto de la modernidad. Hace casi un siglo el filósofo alemán Georg Simmel (1858-1918) en Philosophie des Geldes decía que la causa de nuestro estado era: “La falta de algo nítido en el núcleo del espíritu, y es ello lo que nos impulsa a buscar la satisfacción momentánea en estímulos, sensaciones y actividades siempre nuevas. Así es como nos enmarañamos en los tumultos de las metrópolis, en la manía de viajar, en la salvaje competencia y en la típicamente moderna infidelidad con respecto a los gustos, estilos, opiniones y a las relaciones personales”. Esta carencia de algo nítido en el núcleo del espíritu, de convicciones profundas, arraigadas y permanentes es la marca a fuego de la postmodernidad.
Llegamos así al final de los distintos desencantamientos del mundo. Hoy éste no es otra cosa que una sucesión de imágenes truncas, una especie de zapping político-cultural en donde todo vale y nada tiene valor, y entonces nos preguntamos:
¿Es otro mundo posible o diferente?
Nosotros consideramos que la única crítica válida, total, eficaz y superadora de la modernidad es la crítica premoderna. Así, es desde las ecúmenes premodernas como la eslava, la iberoamericana o la china desde donde se puede llevar a cabo más genuinamente esta crítica, porque aún habemos términos de comparación. Fuimos menos zapados por la modernidad porque la nuestra fue una tardomodernidad.En cuanto al método optamos por el disenso como el único capaz de crear teoría crítica, pues pensar, y sobre todo pensar desde América, es disentir. Disentir ante el pensamiento único y políticamente correcto, pero disentir también ante la normalidad filosófica impuesta por el pensamiento europeo.
El disenso consiste, desde nuestro genius locci en expresar la opinión de los menos, de los diferentes ante el discurso homogeneizador de la ética discursiva o comunicativa de los Habermas y los Apel, que solo otorga valor moral al consenso.
Es que la ética comunicativa viene, en definitiva, a fundamentar el mensaje globalizante y homogeneizador de los productores de sentido que son siempre los dueños del poder.
Esta ética discursiva e ilustrada viene en tanto que “discursiva”, como un nuevo nominalismo a zanjar las diferencias con palabras i.e. la democracia discursiva(Bohman-Avritzer) de las asambleas populares, y no a través de la preferencia o postergación de valores. Y en cuanto “ilustrada” sólo permite la crítica de aquellas situaciones sociales que no encarnen los ideales ilustrados de igualdad y postilustrados de democracia. Así su crítica nunca va dirigida a los regímenes socialdemocratas sino a los que decididamente no lo son, como en Iberoamérica, Castro o Chávez.
La ética de la comunicación es así heredera directa de las sociedades de ideas de la Revolución Francesa y estas sociedades – corazón del jacobinismo- por definición no pensaban sino hablaban. La ideología no se piensa porque puede correr el riesgo de ser criticada, sino que ella habla a través de su intérpretes como verdad socializada a través del asambleísmo y se expresa en la religión del consenso (2).
En realidad, este modelo discursivo, que en criollo debería denominarse modelo conversado, muestra la gran contradicción del pensamiento progresista de estos primeros años del siglo XXI, que consiste en creer que se puede reformar la sociedad recurriendo a los mismos instrumentos que la han llevado a su situación actual.
Hoy el dios monoteísta del libre mercado ha llegado a privatizar la opinión pública ya que sólo existe la opinión publicada. Los agentes mediáticos se han quedado hoy día con la representación exclusiva del pueblo que ellos han transformado en “gente”. La patria locutora y escribidora viene reemplazando a los políticos quienes ante la furia privatizadora de los activos fijos estatales se han quedado sin aparatos del Estado para ejercer el poder y han cedido su iniciativa al periodismo y los tecnócratas.
Así como la imagen televisiva ha reemplazado al concepto escrito, de la misma manera los massmedia han desplazado a los partidos políticos en el manejo del poder. No es ya el Estado quien tiene el monopolio del poder como gustaba decir Max Weber, sino que el poder ha deslizado su centralidad hacia un ciberespacio inasible y siempre cambiante como lo es el mundo de las redes informáticas que son la que determinan que países como el en caso de Malasia, México, Brasil o Argentina entren, de la noche a la mañana, en crisis financieras tremendas, gestadas por operadores anónimos que especulan desde terminales a miles de kilómetros de distancia.
Unos pocos políticos y escasísimos pensadores se dan cuenta que esto no va más. Y si nosotros y nuestras sociedades están mal no es porque el proyecto moderno no se completó como piensa Habermas, sino porque doscientos años de pertinaz liberalismo nos ha llevado a tal extremo.
Sin un cambio en los grandes campos de actividad del hombre en sociedad, todo no será otra cosa que gatopardismo, cambiar algo para que nada cambie.
Nosotros debemos reinventar una nueva representación política, la democracia postmoderna no propone valores a intentar sino que en tanto conciencia política desengañada ha quedado reducida a democracia procedimental. Y si bien hoy , se ha extendido a casi todo el mundo, lo ha hecho sin profundidad, como en el caso de las democracias africanas o sudcentroamericanas. La modificación de régimen de representatividad política de la democracia liberal implica el dejar de lado de una vez para siempre la falsa ecuación “un hombre un voto”, pues el hombre es más que un voto y tiene, por respeto a su propia dignidad, que ser representado en la totalidad de lo que es. Hay que intentar una democracia de carácter participativo donde el hombre se manifieste también como trabajador, profesional, comerciante, docente, cura o milico.
En el campo económico modificar el régimen de propiedad de la economía liberal, que entiende a aquella como valor absoluto en sí misma. Debemos pasar del sentido de propiedad, hoy reducido a cada vez menos propietarios, para ir a la difusión de la propiedad al mayor número posible de ciudadanos. Así mismo se debe quebrar el monopolio de la ley de la oferta y la demanda, recuperando la vieja ley de la reciprocidad de los cambios de la que ya hablara el viejo Aristóteles en la Etica Nicomaquea (1132b 33) nos dice: “la reciprocidad debe ser según la proporción y no según la igualdad”. Lo justo en las transacciones económicas es que uno de “proporcionalmente” a lo que recibe y no “igualmente”. No se trasmuta una casa por un zapato. La proporción del cambio de un producto por otro, más allá de la razón de necesidad, está dada por la diversidad de trabajo(la acción) que uno u otro ha requerido. La cuestión del justo precio se ubica aquí.
En el ámbito de la cultura dejar de lado la versión liberal de la misma que nos viene desde la época de la Enciclopedia francesa con su idea del valor universal de la cultura racional-occidental e ir al rescate del principio de identidad, no solo como afirmación de nosotros mismos sino también como defensa de la diversidad cultural, que se expresa en el reconocimiento del otro, del diferente a nosotros. Rechazar la nefasta teoría del multiculturalismo y proponer el pluralismo intercultural. Esto es, un pluralismo sin relativismo que hace que el mundo sea en realidad un pluriverso y no un universo como ha pretendido el pensamiento moderno-ilustrado desde la época de su nacimiento.(3)
1.- Cfr. Hazard, Paul: La crisis de la conciencia europea 1680-1715, Madrid, Ed.Pegaso, 1975.-
2.- Cfr. Furet, Francois: Pensar la Revolución Francesa, Barcelona, Ed. Petrel, 1980. Especialmente el capítulo: Agustín Cochin: La teoría del jacobinismo.-
3.-El desarrollo pormenorizado de las razones que justifican las medidas propuestas en estos tres campos puede encontrarse en nuestros libros: Hispanoamérica contra Occidente, Madrid, Barbarroja, 1996; Ensayos de Disenso, Barcelona, Nueva República, 1999 y en Metapolítica y Filosofía, Buenos Aires, Theoría, 2002.-
00:06 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max weber, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 24 mai 2008
J. Ortega y Gasset, philosophe espagnol du politique
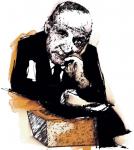
Robert STEUCKERS:
José Ortega y Gasset, philosophe espagnol du politique
Le 9 mai 1883 naît à Madrid José Ortega y Gasset. Brillant élève des Jésuites à Miraflores del Palo, près de Malaga, il perd la foi catholique sous la double influence de Renan et du "modernisme" religieux. Après avoir suivi les cours de droit et de philosophie d'une université de Bilbao, il publie une thèse de doctorat intitulée Les terreurs en l'an mille. Ce sera ensuite une série de séjours à Leipzig, à Berlin, à Marburg-am-Lahn. Fondateur de revues d'idées (Espana, El Sol, Revista de Occidente), hostile aux régimes autoritaires, il réagit en s'engageant personnellement. En 1931, il est élu député et fonde avec Maranon et Perez de Ayala un groupe parlementaire intitulé Al servicio de la Republica.
Cette aventure le déçoit. Aucune unité de vues ne le lie à ses compagnons de combat et il estime plus sage de se retirer de la scène politique. Désormais, il est convaincu que les intellectuels n'ont pas à chercher le pouvoir. Aux jeunes gens de tous les horizons politiques qui viennent lui demander des conseils, il répond : "Je sais - et vous aussi le saurez, dans quelques années - que tous les mouvements caracté-ristiques de notre époque sont historiquement faux et vont au devant d'un échec catas-trophique". Ortega craint la violence de ce qu'il appelait le juvénilisme, conséquence de l’avènement des masses : au cours du XIXe siècle, la population européenne a triplé. Cette démographie galopante ne pouvait que provoquer le rabaissement généralisé du niveau culturel et spirituel et, par voie de conséquence, l’avènement d'un homme moyen dont le comportement est comparable à celui d'un primitif transplanté dans une vieille cité.
À 15 ans, Ortega a vécu l’épouvantable défaite de 1898, qui oblige son pays à céder Cuba, les Philippines et Porto Rico aux Américains. C'est la fin d'une grande puissance coloniale. Cette décadence appelle un renouveau, mais encore faut-il en découvrir les causes. Ortega constate que l'Espagne a perdu sa cohésion et son unité, qu'elle n'a plus de projet susceptible de transcender l'individualisme des hommes ou des groupes ; et, surtout, qu'elle n'a plus d'élites clairvoyantes, dignes de rassembler et de diriger les masses. Cette dialectique masse-élites fera l'objet d'un livre : La Espana invertebrada (1922). Les mêmes arguments seront élevés à la dimension européenne dans ce qui deviendra l'essai le plus célèbre du philosophe, La révolte des masses, paru en 1930.
Pour être totalement espagnol, il faut être européen et Weltbürger (citoyen du monde). Contrairement à l'Allemand qui, dans son éveil spirituel, se retrouve seul et perçoit les événements extérieurs comme "un morne fracas cosmique qui heurte les rochers de son insularité égotique", l'homme du Sud éveille d'emblée sur l'agora et doit se libérer des imbrications sociales pour retrouver la solitude créatrice. S'inspirant de Jung, Ortega pose donc l'Espagnol comme l'homme de la spontanéité, aux réflexes rapides mais superficiels et parfois irréfléchis. L'Allemand, lui, réagit lentement mais les stimuli qui le frappent sont longuement assimilés dans son intériorité avant de susciter une réponse globale.
Ortega oppose la raison vitale à la raison pure de la philosophie allemande qu'il a côtoyée dans les universités d'Outre-Rhin. Pour Leibniz, Kant, Fichte ou Hegel, le monde n'est qu'un vaste chaos que la pensée doit ordonner. Ortega admet l'existence d'un moi libre et conscient qui ordonne rationnellement les choses, mais il conteste le finalisme implicite de l'idéalisme allemand et donne priorité à la vie.
Malgré ces divergences, il ne fait aucun doute que c'est en Allemagne qu'Ortega a trouvé les penseurs qui partageaient sa sensibilité profonde. A Berlin, par ex., Georg Simmel, dont il a suivi les cours, enseignait que certaines valeurs ont effectivement une validité objective et absolue, et que le relativisme de notre perception des valeurs n'est, en fait, qu'un regard perspectiviste, et donc limité, jeté sur la vérité absolue. Les réflexions que cet enseignement a inspirées à Ortega sont rassemblées dans son ouvrage El tema de nuestro tiempo (1923). Entre le relativisme, qui engendre le scepticisme, et le rationalisme, qui est quête d'absolu, il faut ouvrir une 3éme voie. L'entendement ne se laisse pas traverser passivement, mais il n’altère pas non plus ce qu'il appréhende. Sa fonction est clairement sélective : il retient du réel tous les éléments qui s’accommodent de son appareil récepteur, tandis que les autres lui échappent. Une telle vision est radicalement pluraliste. D'un point de vue anthropologique, cela signifie que chaque peuple, à chaque époque, est prédisposé à jouir de tel ou tel aspect du monde. Les perspectives sont les composantes de la réalité. Elles ne sont nullement déformantes, elles constituent l'organisation même du réel. "Une réalité, écrit Ortega, qui, aperçue de n'importe quel point de vue, s'avérerait toujours identique, c'est là un concept absurde".
Nietzsche a appris à Ortega l'idée d'une vitalité corporelle qui sous-tend toute expression vitale, même la plus spiritualisée. Cette vitalité corporelle est elle-même soumise à un rythme sinusoïdal, fait de chutes et d’ascensions. S'il estime que Nietzsche a eu tort de traduire sa pensée en des termes trop zoologiques, somatiques ou biologiques, Ortega ne rejette pas pour autant les prophéties intuitivement géniales du solitaire de Sils-Maria : le temps qu'il avait annoncé est le nôtre. A nous de le vivre.
L'attitude d'Ortega face à la tradition phénoménologique et existentialiste allemande est plus révélatrice encore de sa propre démarche. La phénoménologie de Husserl aurait, selon lui, raté la vocation qu'elle ambitionnait initialement. La volonté de saisir les phénomènes dans lesquels la pensée s'enracine, s'est estompée pour retomber dans une sorte de rationalisme cartésien. Dés que Husserl s'est mis à parler de "conscience pure", il a escamoté la réalité et déréalisé le monde que l'homme doit affronter.
Ortega est plus proche des thèses que Heidegger avait défendues dans Sein und Zeit (1927). La vie comme inquiétude, comme souci, comme insécurité et la culture comme recherche de sécurité étaient des idées qu'il avait déjà approchées dans son livre Meditaciones del Quijote (1914). Le philosophe espagnol a toujours prétendu ne jamais avoir été influencé par Heidegger. Quoi qu'il en soit - et malgré les affinités existant entre les 2 hommes - la controverse s'engagera assez rapidement. Dans L'évolution de la théorie déductive et l'idée de principe chez Leibniz, Ortega conteste l'interprétation heideggerienne du concept d’Être. L'Allemand se serait abusé sur la place de l'ontologie dans la pensée grecque et, pour Ortega, il n'est pas certain que l'homme se soit toujours interrogé sur l’Être. Heidegger aurait dû cerner davantage le sens de ce mot. Il aurait fallu se demander comment et pourquoi la spéculation sur l’Être est survenue en Grèce depuis Parménide. La linguistique, qu'interpelle Ortega, nous apprend que ce verbe est l'un des plus récents qui soient. Dans presque toutes les langues, il est formé de racines aux origines les plus diverses, ce qui souligne son caractère éminemment occasionnel et accidentel. Ortega reproche à Heidegger de ne pas avoir correctement perçu le côté dynamique de la conception grecque de l’Être, comme activité ou actualité.
Il est insoutenable, dit Ortega, de réserver à l'homme seul, le privilège exclusif de s'éprouver comme un être "problématique". L'animal peut, lui aussi, se sentir en péril, vivre en alerte perpétuelle. La déréliction et le pessimisme heideggeriens, qui suscitent la fameuse angoisse des existentialistes, peut entraîner une réaction positive de libération et d'énergie salutaire. Ortega ne conteste donc pas le côté dramatique de l'existence, mais il refuse de définir la vie par ce seul aspect. S'il ne faut pas verser dans l'optimisme béat, s'il faut percevoir la terrible négativité qui gît au tréfonds du monde, la tâche du philosophe est de militer dynamiquement contre ce destin.
L'angoisse et l'infinie "allégresse du monde" cohabitent en chacun de nous. Il faut prendre en compte ces 2 aspects si contrastés de la vie, si l'on ne veut pas se condamner à porter sur celle-ci un regard hémiplégique et réducteur. Ortega conteste cet existentialisme qui ne veut percevoir le monde que comme une noire crevasse et qui n'a d’intérêt que pour le malaise, l'abîme ou le néant. La vivacité hispanique qui habite le philosophe lui fait refuser cette philosophie macabre, cette manie germanique des profondeurs. Sa philosophie veut être, entre les profondeurs et la surface de l’Être, un perpétuel aller-retour.
Après cette initiation universitaire au monde philosophique allemand, Ortega s'est donné pour tâche d'initier la jeunesse d'Espagne à la pensée européenne. Par son labeur incessant, par le nombre important de traductions qu'il a fait publier, par la concision de ses textes, il a permis aux étudiants espagnols de comprendre l'actualité philosophique. Mais il ne s'est pas contenté de cette mission académique. Il souhaitait en effet que ce savoir soit mis au service de la société espagnole et qu'il ait un impact sur la vie politique de son pays.
"Toute ma vie, toute mon œuvre a été au service de l'Espagne". La monarchie décadente, le pouvoir exorbitant de l'aristocratie et du clergé, ces formes désuètes et mortes, exigeaient des innovations. Dans La Espana invertebrada, Ortega explique que toute nation se forme autour d'un "projet qui suggère un mode de vie en commun". C'est par de tels projets que se réalise la phase ascendante d'intégration des unités sociales. La ruine des nations survient lorsque le processus inverse, la désintégration, se met en marche. Alors, les parties, jadis intégrées par le projet initial, se détachent successivement de la vie commune et s'affaiblissent dans une isolation stérile. C'est quand une nation a oublié le projet qui l'animait qu'elle doit recevoir le qualificatif d'invertébrée.
En 1580, pendant le règne du roi Philippe II, l'union de la Castille et de l'Aragon a permis de "lancer l'énergie espagnole aux quatre vents pour inonder la planète et créer un empire d'une superficie jamais encore atteinte dans l'Histoire". La désagrégation, pourtant, n'a pas tardé. Les zones périphériques se sont détachées les 1ères : les Pays-Bas, Milan, Naples. Au début du XIXe s., les colonies sud-américaines acquièrent leur indépendance et l'Espagne se voit réduite à son espace péninsulaire. Après 1898, le séparatisme et le régionalisme entameront l'unité intérieure.
Sur le plan social, l'Espagne perd également son "squelette". Les diverses classes sociales devien-nent des entités hermétiques. Les militaires, les ouvriers, les intellectuels, les politiciens perdent contact les uns avec les autres. Chacun de ces groupes sociaux reste persuadé "d’être l'unique groupe existant, d’être un tout et le tout". Ainsi, les militaires déclenchent des pronunciamentos, la classe ouvrière s'exerce à l'action directe et, au bout du compte, surgit le chaos. Au sein même des groupes sociaux, Ortega, à l'instar du sociologue italien Vilfredo Pareto, distingue une minorité d'individus exemplaires, qui ont des qualités de dirigeants et une masse qui, en période ascendante d'intégration, les suit et, en période de désintégration, refuse toute hiérarchie interne au groupe. L'élite qui survit à la désintégration devient alors indigne de sa tâche.
Ortega a rêvé de forger une élite nouvelle avec des hommes venus de toutes les classes, et de sortir ainsi l'Espagne de son marasme. Ses idées politiques avaient le mérite d'une extraordinaire limpidité que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes ses œuvres, mais elles heurtaient de front une société dominée par les conflits d’intérêts, dans laquelle les hommes au pouvoir utilisaient toutes les potentialités de l'irrationnel pour conserver leurs privilèges.
Comme Miguel de Unamuno, Ortega a opté pour un "libéralisme" hispanique opposé aux totalitarismes d'un XXe s. à la recherche de stabilités définitives. "Ni le bolchevisme, ni le fascisme, écrit-il, ne résument tout le passé, condition indispensable pour le surmonter". Ces 2 totalitarismes sont des phénomènes de l'âge des "masses" qui a fait perdre aux hommes toute "conscience historique".
Pour acquérir cette conscience, nécessaire à l'équilibre de toute société politique, Ortega suggère l'enseignement d'une philosophie humaniste qui marquera l’avènement d'hommes nouveaux, conscients des impératifs de l'époque, parce que dépositaires d'une mémoire historique effective. Le bolchevisme et le fascisme se bornent, écrit-il, à nier la validité des institutions libérales sans se rendre compte que cette négation peut les conduire à des positions anachroniques. Il faut plutôt dépasser le libéralisme, en assimilant les acquis spirituels de cette idéologie politique polymorphe.
L'anti-totalitarisme d'Ortega s'accompagne d'une sévère critique des postulats rationalistes de la démocratie libérale. Il est convaincu que seule la sélection permettra de "gouverner les esprits" et d'"orienter les volontés". L'homme, pense-t-il, n'est jamais motivé par des "idées pures" mais par des sentiments et des associations d'images. C'est de la vie - et de la vie seule - qu'émerge la raison.
On a maintes fois insisté sur l'influence qu'Ortega a exercé sur la pensée du chef phalangiste José Antonio Primo de Rivera. Ce dernier a effectivement rendu hommage à la pensée du philosophe, tout en lui reprochant de ne pas assumer d'engagement politique cohérent. Ortega avait choisi le combat politique lors de l’avènement de la République, mais n'en avait tiré que des déceptions. Les années 30 auraient dû, estimait José Antonio, entendre sa voix prophétique et énergique. Cette volonté de se retirer "au-dessus de la mêlée" est sans doute une erreur que l'Espagne paie aujourd'hui encore, parce que le franquisme catholique était foncièrement incapable de traduire dans les faits politiques cette 3ème voie suggérée par Ortega et voulue par José Antonio.
Lorsque la guerre civile éclate en 1936, le philosophe choisit le chemin de l'exil. Cet exil, commencé à Paris et en Hollande, se poursuit au Portugal et en Argentine. En 1946, il se réinstalle à Madrid, boude le régime qui n'a réussit qu'à restaurer sans innover, et crée l'Instituto de Humanidades. Désormais, il fait la plupart de ses conférences en Allemagne où ses idées sont davantage lues et discutées. En 1950, à Baden-Baden, il rencontre Heidegger pour lui faire part de vivo de ses critiques. Il meurt le 17 octobre 1955.
La confrontation d'Ortega avec le monde effervescent de la politique correspond à la désorientation que vécurent les idéaux humanistes et libéraux dans la 1ère moitié de ce siècle. Son cas est semblable à celui de Benedetto Crocce en Italie. Pour les 2 hommes, le libéralisme apparaissait comme un système marqué par la tolérance, qui dépassait les autres idéologies parce qu'il accueillait toutes les vérités dans un cercle plus large, les replaçait là où elles pouvaient s'avérer utiles, et convertissait les éléments jugés arbitraires et fantaisistes en problèmes et en solutions logiques. Tout rejet du polymorphisme leur apparaissait comme stérile.
Ortega et Croce souhaitaient une tolérance active, un refus des illusions, la lucidité pour que l'homme ne se constitue pas prisonnier d'une utopie et ne revendique pas la fin de l'histoire. Malheureusement, le libéralisme n'était pas ce qu'il croyait. C'est lui qui nous impose, aujourd'hui, la mortelle tiédeur que ni Ortega ni Croce ne souhaitaient.
(Texte paru en 1981; version originale perdue).
00:24 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, espagne, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 09 mai 2008
El situacionismo y la revuelta
Infokrisis.
- Lo poco que ha quedado del mayo francés son unas pocas consignas, más o menos espectaculares e impactantes que fueron difundidas a través de serigrafías manuales o pintadas. Tales consignas -"imaginación al poder", por ejemlo- han terminado caracterizando a mayo del 68. Sin embargo, estas consignas eran patrimonio de un pequeño movimiento internacional de intelectuales europeos, la Internacional situacionista, considerad como última vanguardia artística del siglo XX. Algunos miembros del Movimiento de 22 de Marzo estaban influidos por el situacionismo.
El situacionismo europeo
Es un mito más que una presencia. En la revolución de Mayo situacionistas los hubo, pero pocos y no precisamente destacando por su activismo. Se ha querido ver en el Mouvement 22 de Mars de Cohn Bendit y Alain Geissmar, una inspiración situacionista. No es así. O al menos, no exactamente.
A cuarenta años vista, lo que queda del mayo francés son apenas unas cuantas consignas («A medida que la necesidad resulta socialmente soñada, el sueño se hace necesario. El espectáculo es la pesadilla de la sociedad moderna encadenada que, en última instancia, no expresa sino su deseo de dormir. El espectáculo es el guardián de este sueño».). Esas consignas fueran elaboradas por los situacionistas o extraídas de las obras de Raoul Vaneigen o de Guy Debord, jefes de fila del situacionismo.
El Movimiento del 22 de marzo, situacionista pero menos
Lo que sí es cierto es que el M22M era un grupúsculo entre los grupúsculos, acaso mucho más pequeño que otros, mucho más manipulable que otros en tanto que su ideología oficial era el anarquismo y ya se sabe que los anarquistas, por su ausencia de estructuras de organización “autoritarias” (es decir, por su ausencia completa de estructura organizativa) han sido siempre los preferidos de los servicios de Inteligencia para ser penetrados por sus agentes, manipulados en sus actividades y sacrificados en sus resultados. Un informe de los servicios secretos de a OTAN daba a la Internacional Situacionista con sede en Copenhague como teledirigida por la H.V.A., los servicios de seguridad y de inteligencia de Alemania del Este.
El informe en cuestión estaba datado en 1965 cuando los situacionistas iniciaron una campaña contra la presencia de tropas alemanas en territorio danés para unas maniobras conjuntas. La campaña terminó siendo una campaña contra la OTAN y no es raro que la inteligencia de la Alianza Atlántica se fijara en los situacionistas daneses.
Pero ¿realmente podemos creer ese informe? Difícilmente. A primera vista los “situacionistas” eran solamente un pequeño grupo de intelectuales de varios países, que utilizaban un lenguaje retorcido, frecuentemente críptico, para exponer ideas contracorriente que solamente merecían comentarios en muy escasos y reducidos medios intelectuales. Me hubiera gustado conocer de dónde extrajo François Duprat la información sobre la relación entre los situacionistas y la H.V.A. que incluyó en su obra La Comédie de la Revolutión (nº 73 especial de la revista Defense de l’Occident, junio 1968, pag. 45 y sigs, París 1968). El problema es que en mayo de 1977 François Duprat saltó por los aires en una carretera olvidada cuando viajaba de París a Normandía. El crimen, todavía hoy sigue impune. Duprat volverá a salir en estas páginas en varias ocasiones. Sea o no sea cierta la información, lo indudable es que la lectura de las obras de Duprat indica que disponía de información privilegiada aunque en algunos casos se tratara de evidentes intoxicaciones.
Los situacionistas confesos jamás han aceptado una vinculación entre el M22M y su Internacional. El movimiento que tenía a Cohn Bendit y a Geissmar como cabezas visibles, apenas tenía a 40 afiliados al iniciarse los sucesos de mayo, en su mayoría extranjeros. Hoy, ni siquiera merece un hueco en Wikipedia-Francia, como si sus antiguos militantes prefirieran hacerse olvidar. Al iniciarse los incidentes, los periodistas, ávidos de catalogar los grupúsculos que protagonizaban la revuelta se fijaron en el pequeño pero gesticulante M22M y publicaron sus relaciones con la Internacional Situacionista. No eran del todo evidentes, pero es cierto que algunos miembros del M22M conocían los textos situacionistas y habían hecho con ellos una mixtura de anarquismo, marxismo heterodoxo y ribetes situacionistas. Los situacionistas “de verdad” callaron por aquello de que todo lo que la prensa hablara de ellos pertenecía a lo que ellos llamaban “espectáculo” y daba a conocer su grupo hasta entonces enfeudado en los altos muros de la intelectualidad más sofisticada de la época. Pero el asesinado Duprat utiliza para evocar la actitud de los situacionistas la palabre “rechignant” (rechinando).
Y ¿por qué es importante para valorar los sucesos de mayo? Es simple: nuestra tesis es que lo que más ha llamado la atención de la Revolución de Mayo son sus consignas espectaculares (“No morirse de hambre a cambio de morirse de aburrimiento”, “imaginación al poder”, etc.) son de origen situacionista, sin embargo el papel efectivo de los situacionistas fue, poco menos que nulo. Hoy parece que hablar del papel del maoísmo y de trostkysmo en la Revolución de Mayo condene a la banalidad a los hechos de mayo. En 1968, estas dos corrientes del marxismo, a decir verdad, diferían muy poco del marxismo y, por lo demás, éste ya está en el basurero de la historia, mientras lo “libertario” goza aún de cierto aire de romanticismo y da la sensación de una mayor creatividad. Toda la importancia que se ha dado a Mayo del 68, no deriva de ser una sucesión de incidentes protagonizados por grupúsculos marxistas marginales… sino por un formidable movimiento creativo e imaginativo que supuso la “revuelta de la juventud contra el orden establecido”. No hay tal. Esa tesis solamente se apoya en unas cuentas serigrafías y carteles realizados en el taller de Nanterre por los estudiantes del M22M cuya única actividad en esas jornadas, fueron los discursos ampulosos y arrebatados y la difusión de consignas más o menos sonoras y rotundas. Esas consignas fueron la aportación del situacionismo y, de hecho, si es cierto que lograron proyectarse en la historia y es, a fin de cuentas, lo único que resta de mayo del 68, cuarenta años después.
La cuestión siguiente a plantear es ¿qué es el situacionismo?
Una internacional de intelectuales
Hay dos libros y un archivo en Internet en lengua española que vale la pena consultar para entender aquel situacionismo que existió tenuemente y que ya no es. Los dos libros son el Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones de Raoul Vaneigen y, especialmente, La sociedad del espectáculo de Guy Debord.
El 1 de junio de 1959 se publicó el número 1 de la revista Internationale Situationniste” que incluía una especie de manifiesto en el que se explicaba el por qué del nombre: situacionista es todo aquello que contribuye a construir situaciones, y añadían: “Situación construida: Momento de la vida construido concreta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos.
El movimiento había surgido a mediados de los años 50 a partir de círculos intelectuales agrupados en la Internacional Letrista, grupo que fue una de tantas rupturas de intelectuales con el comunismo al producirse la invasión soviética de Hungría en 1956. Teniendo como clímax los sucesos de mayo que dieron a conocer universalmente el situacionismo, el grupo se disolvió en 1972. Debord la había abandonado en 1970. Jamás debió tener más de 200 adheridos.
Debord (el polemista político rotundo) y Vaneigen (el poeta del situacionismo más sugerente cuyas consignas son los paradigmas del mayo francés), sobre todo, eran intelectuales brillantes que habían bebido en las fuentes del marxismo, pero no de la ortodoxia soviética ni de los dogmatismo trotskystas o maoístas que en los 60 tenían cierto predicamento en los medios de la izquierda, sino de las corrientes “marxistas revolucionarias” que tenían a Rosa Luxemburgo, al consejismo de Pannekoek, a las doctrinas de Amadeo Bordigha y a la Escuela de Frankfurt, especialmente a Georg Lucács.
La utopía situacionista aspiraba a una sociedad sin clases que surgiría de la derrota, no del capitalismo, sino de la dominación capitalista. Buena parte de los escritos situacionistas son críticas al capitalismo e intentos de analizar sus mecanismos de dominación.
La Internacional se junta en Cosio d’Arroscia el 28 de julio de 1957 con la fusión de media docena de grupos de intelectuales: la Internacional Letrista en primer lugar, el Movimiento Internacional por un Bauhaus Imaginista (MIBI), el grupo COBrA (disuelto en 1951 cuyo nombre deriva del acrónimo Copenhague, Bruselas ámsterdam donde radicaban los miembros del movimiento) y el Psychogeographic Comité de Londres. El origen de casi todos ellos era el mismo: intelectuales de izquierda que habían roto con el stalinismo entre finales de los años 40 y mediados de los 50, con una pasada militancia artística en las filas del surrealismo.
Vaneigen se preguntaba en La Revolución de todos los días como afectada el capitalismo y el sistema autoritario que según él generaba, en nuestra vida cotidiana, intelectual y colectivamente. De ahí infiere un tema interesante que trasladará a la “ideología mayo”: que la revolución es fundamentalmente el arte de cambiar la vida.
Tácticas situacionistas
Los situacionistas no se contentaron con realizar una crítica al capitalismo y a sus consecuencias sino que aspiraron a participar en actos de agitación anticapitalista. Para ello establecieron una serie de tácticas. La primera de todas ellas era la “desviación” (detournement) que era posible hacer con “objetos” creados por el capitalismo distorsionando su significado original y convirtiéndolo en un elemento crítico contra el “creador”. Estaba en el espíritu de la época y es fácil suponer que debió ser Warhol quien inspiró esta táctica a partir de su creación de serigrafía reiterativas y obsesivas sobre “objetos” creados por el capitalismo en los EEUU: las imágenes de Elvis Presley, de la sopa Campbell’s, de Marilyn Monroe, etc. Al igual que una palabra mil veces repetida pierde su sentido, todas estas imágenes multiplicadas sin apenas variaciones contribuían a que el objeto representado pierda su sentido originario y se convierta en símbolo de la banalidad capitalista.
El situacionismo aspiraba a integrar distintos elementos revolucionarios en su propia teoría por medio de lo que llamaban “comodificación”, la exposición de las ideas que bastaba por sí misma para ilustrar el objetivo crítico. Tal es la táctica que hizo que los escasos situacionistas presentes en los sucesos de mayo sintetizaran sus ideas en forma de consignas tan escueta como rotundas.
En cierto sentido los situacionistas fueron los precursores del ecologismo (o más bien de una forma ecológica de urbanismo) cuando establecían la noción de “psicogeografía”, que aspiraba a interpretar los efectos del horizonte geográfico en el comportamiento y en el estado anímico de las personas. El marco geográfico generaba una forma de comportamiento y unas rutinas. Frente a las rutinas, los situacionistas planteaban seguir las emociones.
La creación de situaciones
Pero la práctica situacionista tenía como eje central la “creación de situaciones”. La idea partía de la comprobación, casi conspiranoica, de que los acontecimientos son fruto de construcciones minuciosamente preparadas por poderes fácticos. Debord había advertido que algunas de estas construcciones no recibían la bendición de los medios de comunicación por distintos motivos. Estas construcciones, pues, podían ser utilizadas para denunciar al capitalismo. El caso más claro era, sin duda, la guerra del Vietnam y las protesta que podía generar a partir de la actitud adoptada por los medios de comunicación.
La idea de “situación construida” era fundamental en la perspectiva situacionista. El ser humano tiene la posibilidad de construir situaciones -“dado que él es el fruto de su historia”- y, por tanto e asumir su propio destino y ser “responsable del devenir de su existencia”.
También la técnica es denunciada como instrumento del capitalismo. En el nº 1 de Internationale Situationniste (01.06.58) se denunciaba que “La técnica se ha convertido en una terapéutica contra el virus revolucionario”. Las formas de aprendizaje que en aquel momento llamaban la atención –la utilización de magnetófonos mientras se dormía, para aprender determinadas materias- o las técnicas de gestión de grupos –el brainstorming, la “tempestad de ideas”- se consideraban como inventos del capitalismo para rentabilizar al máximo los tiempos muertos (el sueño) o la producción de ideas.
Debord y la sociedad del espectáculo
Sin duda, La Sociedad del Espectáculo, de GuDebord es la obra más imaginativa del situacionismo. Debord de joven se había curtido en las actividades de Socialismo o Barbarie de Castoriadis, disidente de la IV Internacional cuya idea era que las burocracias socialistas reproducían el sistema de dominación del capitalismo. Cuando se separó de Castoriadis, participó en la creación de la Internacional Letrista y de ahí al situacionismo. No era un organizador, sino un teórico y su falta de eficacia en la gestión de un grupo determinó las críticas de Veneigen y su escisión que fue la puntilla que determinó la muerte de la Internacional Situacionista. Debord reconoció en el consumismo el principal elemento de alienación capitalista: consumir es hermoso y seductor, por tanto, alienante en cuando que se deja de ser lo que se es para identificarse en el objeto consumido.
Para Guy Debord el espectáculo es el producto básico de la sociedad moderna. La política se ha convertido en un espectáculo y el ciudadano, en espectador de la teatralización o de la escenificación que inevitablemente han generado los poseedores del capital. El espectáculo es el instrumento del capital para imponer hasta el tuétano modelos culturales. La vida entendida como espectáculo es el eje central de la modernidad. De hecho, el propio mayo francés, si fue algo, fue puro espectáculo. En la sociedad del espectáculo, la política ha desaparecido. Todos somos espectadores que albergamos solamente el deseo de una vida tranquila y pacífica. Y en esto no hay diferencia: tanto los poderosos como los miserables vivimos una vida rutinaria en la que la novedad –o al menos novedades trascendentes- quedan completamente excluidas de nuestra perspectiva de vida. La novedad implica el riesgo y el riesgo es algo que el espectador no busca. El espectáculo termina siendo el “opio del pueblo”. De la misma forma que el espectador de un filme no tiene capacidad de operar sobre ese producto cultural sino que apenas puede aceptarlo o rechazarlo, la sociedad del espectáculo implica una actitud pasiva ante los acontecimientos. Todo escapa de nuestras manos y todo está fuera de nuestro control.
© Ernesto Milà – Infokrisis – Infokrisis@yahoo.es – http://infokrisis.blogia.com
00:36 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 mai 2008
Herder, une autre philosophie de l'histoire
HERDER

Publié en 1774, l’essai de Herder (1744-1803) sur Une autre philosophie de l’histoire (Auch eine Philosophie der Geschichte) soumet la philosophie des Lumières à une critique radicale qui n’est pas sans rappeler celle de Rousseau. Dénonçant la croyance dogmatique en un progrès continu de l’humanité et l’arrogance d’un rationalisme abstrait qui refuse de faire droit à la différence des cultures, Herder s’efforce d’élaborer une "autre" philosophie de l’histoire articulant plus harmonieusement l’horizon de l’universel et la reconnaissance de la dignité des singularités. C’est dire que la lecture de cet opus philosophique permet de reconduire à leur lieu de naissance de nombreux débats contemporains sur la diversité des cultures, le statut de l’universel face aux accusations d’ethnocentrisme et l’héritage des Lumières.
HERDER, UNE AUTRE PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE
Source : Siegfried Röder, article tiré de la revue germano-russe Russland und Wir n°3/1994, publié dans Nouvelles synergies européennes n°5/1994.
Le philosophe, théologien et linguiste Johann Gottfried von Herder, né à Mohrungen en 1744, était un grand Européen. Son importance, sa signification et son rayonnement n'ont pas cessé depuis sa mort. À Königsberg, il a suivi les cours de théologie et a écouté les leçons de Kant. Plus tard, devenu pasteur et prédicateur luthérien à Riga, sa réputation s’accroît en bien, on vient de loin pour l'entendre mais, en son for intérieur, Herder est travaillé par une inquiétude philosophique, par un questionnement incessant qui le conduit sur la route de France, pays qu'il souhaite explorer. Au cours de ce voyage, un mal le frappa aux yeux et il demeura pendant de longs mois à Strasbourg, où le destin le fit rencontrer le jeune Gœthe qui y étudiait le droit. Les 2 hommes nouèrent une amitié très solide et Gœthe, au faîte de sa gloire, appellera plus tard son aîné à Weimar. Et si Goethe fut davantage l'élu du destin et de la gloire, rien n'efface dans cette liaison amicale l'apport génial de Herder, sans qui Gœthe n'aurait pas été complètement Gœthe. La lecture des œuvres de Herder reste une mine d'or pour le philosophe, le linguiste, l'anthropologue et la praticien de ta littérature comparée. Jugeons-en.
Herder initie le monde philosophique au "sens morphologique" qui permet de saisir toutes les formes d'évolutions humaines. Depuis Herder, existe une véritable philosophie de l'histoire. Grâce à ses réflexions, le pathos moderne de la distance, le sens romantique du vécu et de l’histoire sont devenus des filons féconds de la philosophie parce qu'il les explore et les dépouille des affects trop personnalisés qu'ils présentent généralement d'emblée. Raison pour laquelle on le considère comme le père des sciences humaines en Allemagne. Il est impossible d'embrasser son œuvre tout entière au départ d'un seul de ses livres, même celui qui nous offre la vision la plus complète de sa pensée, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité), ne contient pas toutes les facettes de son génie philosophique. Pour Herder, la connaissance du vivant postule la connaissance d'une évolution, d'un développement. Au départ de ce principe de base, Herder traite d'histoire, d'anthropologie, d'éducation, de théologie, de mythologie, de philosophie, de linguistique et d'art.
L'infinitude des mondes, il la ressentait comme un cosmos animé de divin. Même si, dans sa perspective de pasteur luthérien, l'homme est une créature de la divinité, il dispose d'une fascinante et mystérieuse liberté : l'homme selon Herder est un "être laissé libre" dans l'orbite de la création. Et l'homme est libre, n'est libre, que s'il se montre capable d'assumer cette liberté. C'est donc en tant que Dieu visible et animal parmi les autres animaux que l'homme mène son existence paradoxale : cette polarité lui permet de façonner le monde, de créer des formes en permanence, dans le flux et les mutations du réel. La doctrine herdérienne de l'évolution n'est pas un transcendentalisme, en dépit des parallèles que l'on peut observer entre celle-ci et l'idéalisme de l'école a de Weimar. Herder conçoit les idées comme des forces émanant de sources vivantes, c'est-à-dire comme des entéléchies, à la manière d'Aristote. Herder cherchait dans l’histoire ce même Dieu "qui est en la Nature". Cependant sa démarche philosophique insiste plus intensément sur las dimensions historiques, au sens le plus large. Car dans l’histoire, Herder tentait de suivre pas à pas "la marche de Dieu à travers les formes ‘nations’ " et percevait cette marche comme celle d'un homme qui franchit les différents âges de sa vie ; plus tard, Hegel, dans sa propre philosophie de l'histoire, concevra cette marche de l'Esprit : de manière analogue, en rapport toutefois avec une dialectique objective.
Autre élément fécond dans l'œuvre philosophique de Herder : sa vision du mythe dans la poésie et la littérature. Le mythe émerge de ce miracle qu'est le langage de l'homme, car l'homme est avant toutes choses une "créature dotée du langage". Herder constate : "Le génie de la langue est aussi le génie de la littérature d'une nation" [n.b. : Ipso facto, la liberté de l'homme, qui est son propre dans la création, se manifeste dans la création incessante de formes, toujours plus différentes les unes des autres]. Il faut donc lui laisser cette liberté intacte et permettre l'émergence de formes toujours inédites, venues d'un humus précis. Le comble de l'arbitraire est de bloquer ces émergences fécondes, par ex. en arasant les cultures portées par des langues spécifiques et en imposant des modèles stéréotypés, un peu comme tentent de le faire la "nouvelle inquisition" dans les médias français, ou dans Le Soir en Belgique, ou la marotte du political correctness dans les universités américaines.
Toute langue, dans l'optique de Herder, connaît une phase de gestation, d'éclosion, de floraison et de frémissement. Comme aucun autre, Herder a incarné l’effervescence créatrice dans les brumes du XVIIIe siècle ; aujourd'hui encore, ses visions demeurent fécondes : son rayonnement n'a pas cessé. Son existence est restée au service de la philosophie des peuples, des arts, des poésies, en dépit des maladies qui le minaient et des soucis matériels qui les harcelaient, lui et sa famille qui comptait beaucoup d'enfants : jusqu'à son dernier souffle, il est resté actif. Pendant toute sa vie, il est resté un esprit largement ouvert pour tout ce que l'humanité avait forgé d'impassable, de vrai et de beau. Peu avant sa mort, il a eu encore la force de publier un poème imité de l’épopée espagnole, El Cid.
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : histoire, allemagne, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 avril 2008
A. Schuler und die kosmische Bläue

Alfred Schuler und die kosmische Bläue
"Sternverwandt irr empor, du mein armes Licht,
In den schwarzlockigen Abgrund irr empor -
O große Nacht
So nimm auch diese Lampe in umflorte Mutterhand.
Zu tief in heilgem Blute schwoll ihr Docht.
O gieße Lethe endlich unter diese Schmerzenstülle-"
(Gebet)
Alfred Schuler - Eine Randfigur?
Alfred Schuler (geb. Mainz 22.11.1865, gest. München 8.4.1923) gilt als ein Kuriosum der Literatur- und Geistesgeschichte. Verschwiegen kann er nicht werden, wenn die Geschichte jenes Kreises geschrieben wird, den man die Münchner "Kosmiker" nennt: neben Schuler vor allem Ludwig Klages, der Philosoph; Stefan George, der Dichter des geheimen Deutschlands; Alfred Kubin, der Zeichner und Schriftsteller. Nachzulesen ist diese durchaus amüsante Geschichte in den "Erzählungen des Herrn Dames" der Gräfin Franziska zu Reventlow. Gelegentlich wird erwähnt, daß Walter Benjamin, Ahnherr der Frankfurter Schule, den für seine Ästhetik so zentralen Begriff der "Aura" über Ludwig Klages indirekt von Alfred Schuler geborgt hat. Rainer Maria Rilkes Werk zeigt seine Berührung mit Schuler. In Studien zur Krankheit Nietzsches wird erzählt, daß ein Verrückter Nietzsche mit dionysischen Tänzen ins gesunde Leben zurückrufen wollte. Dieser Verrückte war Alfred Schuler. Am Rande begegnet Alfred Schuler auch im Werk Ernst Jüngers: "Manche Autoren sind nur durch Briefe und Briefwechsel, andere wesentlich nur durch Gespräche bekannt. Das setzt einen bedeutenden Kreis, ein "cénacle" voraus. Zum Beispiel Schuler (1865-1923): wir wissen weniger von ihm als über ihn - so durch George, Klages, die Gräfin Reventlow. Alfred Schuler hielt sich für einen Eingeweihten und verhielt sich in diesem Sinn. Sein Einfluß ist bedeutend bis in die politischen Niederungen; doch schwer zu verfolgen, denn er wirkte weniger durch Texte als durch Infiltration. In meiner Bibliothek verwahre ich: >Fragmente und Vorträge aus dem Nachlaß von Alfred Schuler mit einer Einführung von Ludwig Klages<, 1940. Die Einführung ist umfangreich, beinahe ein Buch für sich." (Ernst Jünger, Autor und Autorschaft - Nachträge) Und Jünger zitiert aus der Widmung Carl Schmitts: "Son oeuvre me rapelle a le mot de Léon Bloy: 'J´ai fait mes plus beaux voyages sur des routes mal éclairées.'" "Ich habe meine schönsten Reisen auf schlecht beleuchteten Wegen gemacht" trifft gut die Lektüre des Schulerschen Werkes.
"Ein roter Schein wie Fackeln in der Luft,
Wie Purpurruß, durchätzt von Pechbrandduft,
In Nacht ob Gassen schwarzer Menschenbrunst
Gährender Erzkolosse Sauerdunst,
So glüht es einst in unsrer Kindheit Wahn -
So glüht es auf woimmer Götter nahn -
Urfunken euch sei unser letzter Sang
Und Feuerstoß aus unsrem Untergang."
(Gebet)
Telesma und Blutleuchte
Alfred Schuler war ein Seher, ein Mystiker des Blutes. Er lebte in München als sei es das spät antike Rom. Er fühlte sich als Zeitgenosse Neros, der die letzten Tage der Wittelsbacher und den Revolutionsbrand von 1918 apokalyptisch deutet. Alfred Schulers "Lehre" ist jedoch eine eminent esoterische, kein plumper Entwurf, schon gar kein politischer, sondern eine in viele Verästelungen führende Schau, die die Interpreten vor viele Schwierigkeiten stellt. Der Einfluß Bachofens wird von allen hervorgehoben, als wäre Schuler nur der Sänger des Matriarchats. Unbestritten ist es das Mütterliche, das Schuler in Verbindung mit dem Totenreich und dem Prinzip des Lebens setzt, und ein großer Teil seiner Vortragsreihe "Vom Wesen der ewigen Stadt" ist ein Lobgesang auf das Weiblich-verströmende und eine Anklage gegen die Vernichtung durch das Männlich-evakuierende. Nur: Angelesenes aus Bachofen - das ist sicher nicht die Substanz des Schulerschen Werkes, es ist eine kosmische Schau und eine Ahmung (um das Kunstwort Leopold Zieglers zu verwenden), keine Nachahmung. Schulers Grundprinzip ist die kosmische Verbindung zwischen dem inneren Leben, das seinen Sitz im Blut hat, und dem äußeren All, dem Allumfassenden. Daher die Bezeichnung "Kosmiker". Über den Träger dieser kosmischen Substanz, das Telesma, sagte er:"Das Auge ins Innere gewendet erblicke ich eine vibrierende Lichtfülle, unzählige im Wechselgenuß aufleuchtende Fluiden, eine ewig ununterbrochene Hochzeit im Äther. Diese Substanz, wie ich vermute, identisch mit dem, was das "große Telesma" genannt und in analoger Weise geschildert wird, erachte ich als die verklärende, seligmachende Kraft, als ihren Sitz das Blut. Insoweit sie die Blutwelle leuchtend macht, nenne ich sie essentielles Leben. Diese Bezeichnung stellte sich mir von selbst zugleich mit dem Erlebnis ein. Der Besitz der Leuchte ist unser Anteil am absoluten Leben. Eine andere Deutschung kann dem Worte essentiell in diesem Zusammenhang nicht innewohnen. Man gewinnt andererseits den Eindruck, daß solche Leuchte mit Strömungen aus dem All, in welchem sie demnach verbreitet sein muß, in Verbindung ist. Der in Leuchte Stehende erlebt dieses Strömen als kalte aus dem Kosmos herabkommende Schauer, während die Essenz, dem Blute vermählt, in seliger Wärme glüht. - Die aus dem Weltall einschießende Substanz nenne ich kosmisch. Eros Kosmogonos erscheint mir als eine späte Symbolisierung solcher Herabkunft." (Vom Wesen der ewigen Stadt) Es geht ihm also um die gesteigerte Seelenkraft, die er als Blut beschreibt, nicht so sehr um Blut als Abstammung, oder wenn doch, dann um seelische Abstammung und mehr noch Übereinstimmung. Nur so kann der Zeitabgrund zwischen dem München der Jahrhundertwende und dem Neronischen Rom überbrückt werden. Wie es die Tradition lehrt, wie es die Gnostiker beschrieben haben: Durch den Fall in die geschichtliche Zeit wurde das Licht in die Finsternis verwirbelt. Die Evolution begann. "Ich habe das bisher durchlebte Menschendasein in zwei einander entgegengesetzte Perioden eingeteilt: in eine (prähistorische), in welcher ich die (gesamte) Körperwelt als ganz und gar von Leuchte durchdrungen annehme (wie das auch schon in dem Worte Urzeit - Ur=Ar=Licht - das ist Lichtzeit, zum Ausdruck gelangt), dem Heiden als das "goldene Zeitalter", dem Juden als das "Paradies" bekannt. Ihr stelle ich gegenüber die historische Periode, charakterisiert durch einen gegen die bisherige Leuchte gerichteten Evakuierungsprozeß in der Menschheit." (Vom Wesen der ewigen Stadt) Der Evakuierungsprozeß ist für Schuler ein Werk des Monotheismus (Molochismus), der zunächst den Lebenskern durch Transzendalisierung ins Jenseitige verlegt, um "das Fischlein Seele aus dem Blute Leben zu reissen." Nachdem dies erreicht ist, wird im zweiten Stadium, der Reformation, auch die transzendentale Maske beseitigt. Diesen Zustand charakterisiert er mit drastischen Worten: "Brutnest aller Berufsidioten. Bei verkohlter Seele. Erloschener Herzgrube. Allgemeine mechanische Zerbröckelung. Industrieller Maschinalismus. Weiteste Ringe der Rotation: Amerika. (...) Herausstülpung der untersten Eitermassen: Révolution Francaise. (...) Der moralische Polizei und Pastorstaat." (Fragmenta Neronis Domini)
Dem Entlebungsvorgang fallen immer wieder Licht- und Lebensträger gewaltsam zum Opfer: von der heidnischen Märtyrein Hypatia zur Prinzessin Lamballe, Opfer des sexuell entfesselten französischen Revolutionspöbel, bis zur Kaiserin Elisabeth und ihrem hermaphroditischen Freund König Ludwig von Bayern: "Tollwütige Bettelmönche hatten einst den Körper der heidnischen Philosophin Hypatia vor dem Hochaltar der Hauptkirche zu Alexandrien mit scharfen Marmorsplittern zerfleischt, im spritzenden Herzblut scharrend; rasende Hallenweiber bohrten ihre Zähne in das noch schlagende Herz der Hypatia der Revolution, der Prinzessin Lamballe. Ein Menetekel, zu schreiben in die weiße Apsis der Gewaltigen, daß der jungfräulich verklärte Leib als ihr letztes, ihr innerlichstes Opfer blutet. Doch ist der psychische Leib nicht so rasch wie der physische vernichtet. Gleich dem an Lesbos anschwimmenden Haupte des Orpheus, das noch im Tode sang, setzt sich ein letztes Klingen fort in den Werken deutscher Romantik. Ja noch mehr: In zwei Personen, die wir noch erlebt, strebt einmal noch die verhängnisvolle Zelle selbst empor. Die Wellen des Starnberger Sees, ich meine Ludwig des Zweiten gesendeten Tod, der Hafen von Genf, ich meine das blutige Ende Elisabeths, sind Zeugen, welches Los die wirkende Macht solchen Früchten vom alten Baume beschert hat. Sie fielen als letzte Widerstände unter den Schwingungen des schwarzen Rades, welches jetzt der Herr ist weithin über den Erdkreis." (Vom Wesen der ewigen Stadt)
Das blaue Licht
Doch die Zeit, der Schuler am meisten Aufmerksamkeit widmete, ist die des Kaisers Nero. Es sollten hier keine übertriebenen Schlüsse daraus abgeleitet werden. War es die Schicksalszeit der Blutleuchte? Nein, ich neige eher der Auffassung zu, daß jede Zeit Schicksalszeit ist. In jedem geschichtlichen Augenblick entscheidet sich alles aufs Neue, steht alles auf dem Spiel. Es dürfte aber ein Zusammenklingen der Gegenwart mit der Zeit des Künstlerkaisers gegeben haben. Andere Mystiker des 19. Jahrhunderts haben sich ebenfalls gerade dieser römischen Spätzeit zugewandt. Bemerkenswert etwa, daß wenige Jahrzehnte vor Schuler die Hauptfigur der Wiedererweckung des Okkultismus, der sich selbst den Namen Eliphas Lévi gab, sich als Erbe
des Apollonius von Tyana, des einflußreichen Weisen und Magiers der Spätantike, sah. Eliphas Lévi hat am 24.6.1854 in London den Geist des Apollonius beschworen. Lévi weihte auch den englischen Rosenkreuzer Edward Bulwer Lord Lytton in die Geheimnisse der spätantiken Magie ein. Bulwer Lytton verfaßte nicht nur einen Roman über Cola di Rienzo,
den letzten römischen Tribunen, den Richard Wagner zu seinem ersten großen Opernhelden machte - Vorbild für den jungen Adolf Hitler. Nein, mit dem Roman "The Coming Race" verfaßte Bulwer-Lytton den folgenreichen okkulten Roman schlechthin. In diesem wird ein englischer Spießbürger durch Zufall in das unterirdische matriarchale Reich der Vrilya initiiert. Die Frauen dieser Unter-Welt handhaben eine geheimnisvolle blauschimmernde Kraft namens Vril, die auch das subterrane Licht liefert. Die Spur des Vrils außerhalb dieses Romans ist leicht zu finden. Wer nur ein bißchen gräbt, wird fündig. Das Leuchten des adeligen Blutes ist blau. Für das blaue Licht fand Kadmon Assoziationen auf den mystischen Buchstaben E: "Das blaue Licht, Emblem der Sehnsucht nach dem Ursprung. Edelmut. Eden. Ekstase. Enigma. Erotik. Ewigkeit. Existenz." Das blaue Licht hat Namen wie "Aura", "Od" oder "Orgon". Wilhelm Reich: "Blau ist die spezifische Farbe der Orgonenergie innerhalb und außerhalb des Organismus. Protoplasma jeder Art, in jeder Zelle oder Bakterie ist blau. Gewöhnlich wird es als Licht'brechung' bezeichnet, was aber sehr unzutreffend ist, weil die Zelle unter denselben Lichtverhältnissen die blaue Farbe verliert, wenn sie stirbt. Gewitterwolken sind tiefblau, was von hohen Orgonmengen herrührt, die in den Massen des verdunsteten Wassers enthalten sind. Wasser in tiefen Seen oder Meerwasser ist blau; ebenso die leuchtenden Schwanzenden der Glühwürmchen, das Elmsfeuer und das Nordlicht." Nach Ansicht des Reichianers Peter Nasselstein kann die blaue Orgon-Energie von "esoterischen Faschisten" wie Gurdjieff und Crowley zu einem "blauen Faschismus" mißbraucht werden (analog zum "echten" also schwarzen Faschismus und zum von Reich so bezeichneten kommunistischen "roten Faschismus".
Bei Alfred Schuler steht die Farbe blau jedoch auch für das erste Aufleuchten des essentiellen Lichts im Jünglingsverband: "(Vom Jünglingshaus) klingen die Bezeichnungen Kamerad und Geselle, der Partner in Kammer und Saal, dringt das Institut der Vergesellung, bei den Germanen von so hoher Bedeutung, daß man im Zweikampf mit Rivalen focht, der Partnerwahl, wenn es zum Fest im Saale geht - aei gamos -, in die Waberlohe des Lebens. - Von dort auch fällt jenes ominöse Blau als die früheste Durchglühung der materiellen Finsternis mit essentiellem Lichte, das als Märchenleuchte im Bewußtsein der Späten lebt: conte bleu, bibliothèque bleue; von dort kommt das Tätowieren in Blau, ursprünglich im kosmischen Wirbelsymbol; und in den Zeiten des wiederaufglühenden Gesellenhaus der Gesellenschaft, welche, den Patriarchalismus der Zünfte bekämpfend, in ihrem Herbergsleben, wenn auch unbewußt, das alte Jünglingshaus wiedererstehen läßt, das Blau-Machen als Feiern, der blaue Montag als Rivale des solar-männlich-christlich bedingten Sonntags." (Vom Wesen der Ewigen Stadt)
Ludwig Klages, dessen eigentliche Stärke vor allem die phänomenologische Einfühlung war, spürt Schulers Beziehung zu München in den Farben des Blutes und des Himmels nach, den Sinnbildern der Ortsseele: "Wir finden deren zwei (Sinnbilder): rostbraunen Brodem und tiefdurchsichtiges Himmelblau. Symbole, wie wir hören werden, sind Wirklichkeiten, und Wirklichkeiten lassen immer auch ihre Spur zurück in der Welt der Dinge: weißblau waren die bayerischen Landesfarben, blau die Briefkästen, die Trambahnen, die Uniformen der Soldaten, blau war im "Wahrzeichen Münchens", der unvergleichlichen Frauenkirche, das mit Sternen durchstickte Deckengewölbe, blau ist der Mantel der "Mutter Gottes". Der rostbraune Brodem aber, der heimlich zur Nacht über jedem Bräuhaus und den sommerlichen Kastanienkerzen jedes Bierkellers zitterte, wölkte bei unbedecktem Himmel sichtbarlich über dem abendlichen Menschengewirr und Lärm und Dunst und Lichtergefunkel und Feuerschein jedes Oktoberfestes. Beides trug Schuler in der eigenen Seele: den zunderfarbenen Brodem verschollener Orgien und vom kosmischen Blau zwar nicht die olympische Helle, (...) wohl aber den azurnen Ferneton, der hinüberweist zum Totenreich. Darum erwachte seine Seele in München. (Ludwig Klages, Einführung zu: Alfred Schuler, Fragmente und Vorträge aus dem Nachlaß)
Evola über Schuler
Dies alles ist im Jahre 1940 einer größeren Öffentlichkeit bekanntgeworden, als es Ludwig Klages gelang im Verlag Johann Ambrosius Barth die Schulerschen Fragmente zu veröffentlichen. Erfolgte Besprechungen zeigen, daß das Buch auf eine gewisse Beachtung stieß. Julius Evola verfaßte eine eindeutig ablehnende Rezension in der "Bibliografia Fascista". Er fühlte sich auf seinem eigenen Gebiet angegriffen. Das heroisch-solare Rom - gedeutet als aus chthonischem Urschlamm herausgewachsen, in den Sümpfen des Tibers von säugenden Müttern begründet? Die strenge, klare, erstarrte Architektur Roms umspült von Wogen dionysisch entgrenzter Faschingsumzüge? Rom - ein Ur-Schwabing? Doch Schuler ist auch für Evola eine Art von "Mystiker", um nicht zu sagen "Initiierter", aber einer, der seine außergewöhnliche "psychometrische" Begabung nicht durch Studien fortgebildet hat. Daher die sehr verwirrten Auffassungen Schulers. Evola beschränkt sich in seiner Besprechung darauf, einige Widersprüche Schulers, sowie seine Anlehnung an dekadente und korrupte Riten zu kritisieren. Im Kern ist die Schulersche Welt Evola zu fremd um Substantielles über sie sagen zu können. Die im Nachlaß erhaltenen und im Vorjahr erstmals veröffentlichten Fragmente, die eine wohl für manche - jedenfalls für mich - unappetitliche Form der Homosexualität literarisch überhöhen, hätten ihn wohl in seiner Ablehnung bestärkt. Schulers Neigung zu Schlächterburschen mit schwieligen Händen und blutig-geilem Blick, mögen ein Naheverhältnis zu heutigen Schlächtermeistern des Orgien-Mysterien-Theaters nahelegen (deren Hauptmysterium allerdings deren Fähigkeit im Abkassieren von Steuergeldern darstellt), eine Männerbund- und damit staatsbildende Kraft haben Schulers Stallknechte und Metzgerschlafstätten nicht, dies wäre jedoch die einzige Form der Homosexualität, der ein Wert zugesprochen werden könnte Doch gilt für Schuler vielleicht sein eigener Auspruch, "daß wenn Schleusen geöffnet werden, zuerst der Unrat vorausfließt und dann das klare Wasser folgt." Eine Dekadenz der geöffneten Schleusen anstelle einer Dekadenz der aufgestauten Brühe. In diesem Sinne kann Schuler heute noch Schleusen öffnen. Auf den Schlamm folgt dann das hellblaue klare Wasser.
Cosmogonische Augen
Ein größerer Ausschnitt des Nachlaßwerkes Alfred Schulers ist nun durch Baal Müllers Ausgabe zugänglich: Alfred Schuler. Cosmogonische Augen. Gesammelte Schriften. Herausgegeben, kommentiert und eingeleitet von Baal Müller. Paderborn: Igel Verlag 1997. 482 Seiten, 11 Abbildungen, Paperback.
Zwar kann dieses Buch auch nicht den ganzen Schuler bringen, doch ohne den Eingriffen von Klages, der um überhaupt eine Ausgabe veröffentlichen zu können, alle drastisch homosexuellen Partien weggelassen hatte, wird doch das Bild Schulers vollständiger. Über orthographischen Korrekturen kann man natürlich geteilter Meinung sein. Schließlich sind Schulers Texte ohnehin schon sehr schwer zu verstehen, behutsame Korrekturen wie durch Klages könnten die Lesbarkeit sicher etwas erleichtern. Wegen des langen, monomanischen, aber dennoch als Zeugnis der Bekanntschaft unverzichtbaren Vorworts wird die Klages-Ausgabe sicher weiterhin in den Antiquariaten zu den gesuchten Titeln zählen. Das Vorwort dieser neuen Ausgabe erwähnt hingegen beispielsweise die Beziehung zu Papus, doch wird ersichtlich daß Müller tieferes esoterisches Wissen fehlt. Statt dessen natürlich philologische Anmerkungen, es sei aber zugestanden, daß auf allzuviel Philologengegacker verzichtet wurde. (Ein bißchen muß ja sein, um sich vor der Zunft zu rechtfertigen.) Der Kommentarapparat ist sicher ergänzungsbedürftig. Zugegeben, manches angeführt hätte ich nicht gewußt. Doch manches anderes, was ich für anmerkungswert gehalten hätte, fehlt. Daß schließlich bei der armen Prinzessin Lamballe schlicht "nicht ermittelt" steht, deutet auch auf Lücken in der Allgemeinbildung. Hier sei daher in den Worten Erik von Kuehnelt-Leddihns nachgetragen: "Princesse de Lamballe. Diese Freundin der Königin wurde verhaftet, weigerte sich aber im Gefängnis, einen Eid auf die Verfassung abzulegen, worauf man sie einer tobenden Volksmenge überantwortete. Sie wurde nicht nur umgebracht, geköpft und ausgeweidet, nein, man machte aus ihren Geschlechtsteilen ein grausiges "Arrangement", dasdurch die Gassen getragen wurde, ihr Kopf aber wurde auf einer Stange Marie-Antoinette hohnlachend präsentiert. Das geschah knapp vor den Septembermorden des Jahres 1792, liebevoll von Danton, einem "gemäßigten" Republikaner organisiert, wobei die Akteure des Gemetzels große Mengen Weins und je sechs Livres für ihre Mühewaltung bekamen."(Von der Humanität ...zur Bestialität. Eine Bilanz der französischen Revolution)Nicht nur vom Christentum, mehr noch von den humanistischen Revolutionen, kann und sollte eine Kriminalgeschichte geschrieben werden.
Martin Schwarz
00:30 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 avril 2008
Pourquoi les civilisations s'auto-détruisent-elles?

Pourquoi les civilisations s'autodétruisent-elles?
(WHY CIVILIZATIONS SELF-DESTRUCT)
Analyse d'un livre écrit par Elmer Pendell, édité aux Etats-Unis en 1977. Pour informations s’adresser à : Howard Allen Enterprises, Inc., Box 76, Cape Canaveral FL 32920. Etats-Unis.
La partie du livre qui nous intéresse ici, est celle qui couvre strictement la thèse développée par l’auteur : POURQUOI LES CIVILISATIONS S’AUTO-DÉTRUISENT. L’avant-dernier chapitre du livre traite des mesures préconisées pour corriger ce phénomène d’auto-destruction aux Etats-Unis. Comme ce chapitre ne fait pas partie de l’argumentation soutenant la thèse, son contenu n’a pas été considéré ici.
L’auteur est présenté en ces termes : «Elmer Pendell, est un des experts en populations de premier plan; détenteur de la ‘’Purple Heart’’ et de la ‘’Distinguished Service Cross’’, il est diplômé B.S. de l’Université de l’Oregon, M.A. de l’Université de Chicago, L.L.B. de l’Université George Washington, et Ph.D. à Cornell.
Le Dr. Pendell a enseigné aux Universités du Nevada, de l’Arkansas et de l’Oregon, ainsi qu’à l’Université de l’État de Jacksonville et à Cornell. Durant toute sa vie, son intérêt s’est porté sur les taux de propagation humaine et de son influence sur l’environnement. En qualité de co-auteur de Society Under Analysis, Population Roads to Peace or War et, Human Breeding and Survival, et auteur de Population on the Loose, The Next Civilization ainsi que Sex VERSUS Civilization, il a œuvré longtemps et brillamment pour trouver des solutions, aussi bien à court terme qu’à long terme, aux problèmes de population.
Dans ce dernier livre —certainement le plus significatif— le Dr. Pendell a consacré beaucoup d’efforts au problème démographique crucial de notre temps: le déclin accéléré de nos institutions et de notre mode de vie, causé par le taux élevé de reproduction, de ceux qui devraient se reproduire le moins. Sa contribution sans doute la plus importante à l’esprit moderne —une contribution qui ressort fortement dans ce volume— est le lien qu’il établit entre les pulsions sociales innées des individus, et la tolérance universelle, étendue aux taux différentiels de naissances socialement intolérables».
* * *
Voici donc dans les grandes lignes, la thèse développée dans ce livre. (Le texte ci-dessous pourrait être mis presque entièrement entre guillemets, car il reflète fidèlement le contenu de l’ouvrage. Pour des raisons pratiques, cela n’a toutefois été fait que pour des citations spécifiques, et traduites de l’anglais.)
Ce qui est fascinant dans la marche des civilisations, c’est leur nature rythmique et cyclique. Elles naissent, se développent, atteignent de hauts niveaux d’accomplissements et puis disparaissent. Le plus souvent sans grands soubresauts, mais comme atteints d’une grande torpeur. Lord Byron disait dans Childe Harold’s Pilgrimage : D’abord la Liberté et puis la Gloire. Viennent ensuite la Richesse, le Vice, la Corruption, et à la fin la Barbarie.
Des auteurs et historiens réputés ont donné des explications multiples, souvent complexes et hypothétiques sur la disparition des civilisations. Les causes invoquées sont toujours d’ordre environnemental. C’est l’originalité de Pendell, d’avoir investigué le facteur hérédité. Mais il reprend d’abord, l’opinion de quelques auteurs, historiens, ou chercheurs.
Voltaire: Lorsque les peuples s’amollissent ils invitent à leur conquête.
Louis Wallis: (An Examination of Society) La concentration de la propriété foncière affecte défavorablement le sens moral.
Eric Fisher: (The Passing of European Age) Les vieilles cultures ne peuvent s’adapter aux nouvelles conditions.
Tom B. Jones : (Ancient Civilizations) Comme en architecture ou tout autre domaine, l’achèvement d’un modèle conduit à une seule orientation possible: vers le bas.
Et aussi : Les matériaux bruts sont d’abord exportés, puis utilisés à l’intérieur, ensuite importés jusqu’à ce qu’on n’aie plus les moyens de se les procurer.
W.C. Lowdermilk : (Conquest of the Land Through Seven Thousand Years) Lorsque l’agriculture échoue, la civilisation échoue.
Brooks Adams : (The Law of Civilization and Decay) La concentration du pouvoir et de la prise de décisions blesse mortellement l’organisation sociale.
Willis J. Ballinger : (By Vote of the People) Il partage l’opinion de B. Adams.
Oswald Spengler : (The decline of the West) Les civilisations sont comparées à un organisme qui évolue selon les quatre saisons. Au printemps éclôt l’agriculture, lorsqu’arrive l’automne, les énergies sont largement consacrées à la production industrielle, et à la construction d’immenses vides culturels dénommés Villes Universelles. Ensuite vient l’hiver, et c’est la fin.
Carle Zimmerman : (Family and Civilization) Lorsque les liens familiaux se relâchent, la civilisation tombe en décadence.
J.D. Unwin : (Anthropologue social britannique) (Sex and Culture) Pour une civilisation, des mœurs permissives se traduisent par une perte d'énergie et ses réalisations diminuent.
Pendell traduit cela en ces termes: «Dans le contexte actuel, cela veux dire que nos pulsions innées pour la recherche de nourriture, sexe, attention, etc., peuvent être quelque peu apaisées par un intérêt pour des réalisations sociales. Cependant, lorsque ces ‘pulsions innées’ sont immédiatement satisfaites, il ne reste plus d’envie, de dynamisme pour les relations sociales».
Pour Unwin, lorsqu’une nation réussit, elle devient de plus en plus sexuellement permissive, avec pour résultat, la perte de sa cohésion, de son élan et de sa détermination. Il nous prévient aussi : «Aucune société et aucun groupe à l’intérieur d’une société n’a jamais toléré la monogamie pendant longtemps. Chaque société qui l’a adoptée, a soit abandonné la monogamie, ou bien a constamment révisé sa méthode de régulation des relations entre les sexes; et au cours de cette révision —parfois semble-t-il sans intention consciente— l’opportunité sexuelle a été étendue».
Harold H. Smith dans une chronique du Saturday Review (8 janv. 1955), estime que la complexité et les connaissances croissantes ont un effet de ‘Tour de Babel’. L’opinion de Smith est que : «Entre une multiplication des inventions et une structure qui se ‘pyramidalise’, l’individu est confronté à un étalage de problèmes de plus en plus complexes. Sous les torrents d’informations qui lui tombent dessus, l’évaluation de la signification de chaque élément devient de plus en plus superficielle. Il en résulte que la personne typique comprend de moins en moins les faits réels, tandis que l’idée qu’elle se fait du monde extérieur devient impressionniste et souvent chaotique».
Pour Nathaniel Weyl et Stephan Possony (The Geography of Intellect), la surpopulation a causé la disparition de certaines civilisations, particulièrement celles dépendant de l’irrigation. Le danger de surpopulation dans une région donnée avait également été reconnu par Guy Irving Burch et l’auteur dans Population Roads to Peace or War. W.B. Pitkins dit qu’une vaste population freine les réalisations individuelles.
Hérédité, génétique et chute des civilisations
Ce qui est curieux constate Pendell, c’est que nulle part n’est mentionné le facteur "hérédité", c’est que personne avant lui n’ait fait référence à la part jouée par la génétique humaine dans la chute des civilisations. Pendell ne prétend ni ne suggère, que la détérioration de l’hérédité constitue la seule et unique cause de la destruction des civilisations. Plusieurs causes —et celles citées ci-dessus en font partie— doivent être considérées. Parfois même, l’hérédité est tout à fait étrangère au désastre. Il n’en demeure pas moins que, pour Pendell, «chaque civilisation possède normalement un mécanisme intérieur d’auto-destruction qui assure que la moitié la moins capable de chaque génération devient génitrice de plus de la moitié de la génération suivante». Et c’est à cela, c’est-à-dire à la submersion des classes les plus évoluées par une masse de gens intellectuellement moins avancés, qu’il faut attribuer la mort des civilisations, nonobstant l’existence ou non de nombreux autres facteurs. Ce point de vue constitue l’idée centrale de ce livre.
A partir des premières civilisations connues, soit, la sumérienne, les phases successives de celle d’Égypte, de la Vallée de l’Indus ainsi que celles de Babylone, d’Assyrie et de Perse, celles de la Chine, des Olmèques, des Mayas, Aztèques, Incas, jusqu’à celles de Grèce, de Rome, ou de l’Empire Britannique, ce que toutes ces civilisations ont en commun, dit-il c’est que: «les personnes de haute intelligence ont des intérêts tellement variés et intenses, absorbant tellement de leur énergie, que cela limite le nombre de leurs enfants, et donc, réduit l’intelligence disponible pour le maintien de la civilisation. Conséquemment, tandis que le segment le moins favorisé de la population prolifère, chaque civilisation dissipe le génie de ses organisateurs».
A propos de Rome par exemple, l’auteur cite Charles Dewing, expert en démographie qui écrivit: «Il y a quelque chose de régulier dans ces anciennes civilisations, le timing est remarquablement similaire... La cité en expansion attirait l’attention d’autres peuples qui n’avaient pas construit de cité; elle était perçue comme une montagne dans le désert. Plusieurs de ces peuples migraient vers la cité. Étant donné que cette immigration persistait, bien sûr, les talents qui établissaient la cité allaient bientôt être dilués et ensuite subordonnés... La civilisation de la cité devait baisser. La chute allait donc être due à quelque chose de très apparenté à ce peu aimable mot: ‘dégénérescence’».
Sur l’effondrement de l’Empire Britannique, l’analyse du Dr. Robert Gayre, éditeur de Mankind Quarterly dans Rise and Fall of Nations : Genetic Impoverishment est due à l’effet que: «Pendant des siècles, le service d’outre-mer avait été dysgénique, puisque ses effets adverses avaient frappé de façon disproportionnée l’élite des nations formant le Royaume-Uni. Ceci était particulièrement le cas à partir du dix-neuvième siècle... Au cours des multiples campagnes menées, non seulement une génération était-elle virtuellement exterminée, mais cela s’est fait d’une façon sélective, touchant le commandement dans toutes les classes».
Pour montrer l’importance de l’hérédité dans la désintégration —mais aussi dans la naissance— des civilisations, le Dr. Pendell a cette belle image: «Quiconque essaie de comprendre la naissance ou la chute des civilisations sans porter attention à l’évolution biologique, s’engage dans un labyrinthe sans ‘indications ni épée’» (without a clue or a sword).
Réagir à l'intolérance des behavioristes
Pendell parle de l’existence d’un mécanisme génétique, d’abord créateur, et qui devient ensuite destructeur des civilisations. Ce mécanisme, il le démonte pièce par pièce, et tous ses rouages sont scrutés un à un à la lumière des exigences de l’évolution du vivant. Cependant, il reconnaît aussi que, si dans ce livre, l’emphase est mise sur l’hérédité, «il faut comprendre cela comme une réaction constructive et nécessaire à l’intolérance des behavioristes qui ont presque réussi a rendre illégale l’étude scientifique de l’hérédité».
L’état d’une civilisation —disons sa mise au monde, sa croissance et aussi son déclin— dépend en grande partie de l’esprit des individus pense Pendell qui dit aussi: «la structure de notre esprit est tout autant un produit de l’évolution que nos os, glandes et muscles. L’esprit et le corps ont évolué ensemble et ils travaillent ensemble». Une grande partie du livre est justement consacrée au processus évolutif, c’est-à-dire à savoir comment l’homme est devenu ce qu’il est, et plus particulièrement au point de vue de sa structure mentale.
Ego et "appétit social"
C’est ainsi que nous apprenons comment il se fait que l’esprit humain est divisé entre les motivations glorifiant l’ego d’une part, et les dispositions sociales que Pendell appelle aussi ‘l’appétit social’, d’autre part. Chacune de ces motivations a été nécessaire pour la survie de notre espèce. Elles sont d’ailleurs déjà présentes parmi de nombreuses espèces animales.
Concernant l’ego, Pendell développe très largement le concept de la conscience de soi, "siège de notre auto-importance.". Le niveau de conscience dépend de l’intelligence. La conscience consiste dit–il, à «organiser, organiser, organiser». Elle est héréditaire et une partie de sa tâche est accomplie par le subconscient. La conscience et l’instinct semblent avoir été reliés dès les débuts de l’évolution organique. La perception de l’inconfort et de la douleur auraient déclenché ce que nous appelons aujourd’hui l’instinct. Sans instinct, aucun organisme n’aurait survécu. L’orientation auto-centrée engendre les quatre désirs suivants: désir de sécurité, désir de reconnaissance (considération de la part des pairs), désir d’efficacité (besoin d’obtenir des résultats), et désir de domination. A propos de ce dernier désir, Vance Packard (The Status Seekers) dit: «La stratification existe partout dans notre société». Ce qui, reconnaît Pendell, n’est pas du tout conforme à la doctrine égalitaire américaine.
Enfin, on peut constater, «qu’en plus de veiller à nos besoins égocentriques et corporels les plus immédiats, la conscience se limite pour certains à ce que toute leur attention soit monopolisée strictement sur le déroulement de leur vie, tandis que pour la plupart, elle est de donner plus de sens à leur vie.’’
Les dispositions sociales elles, sont nées du besoin de compagnonnage et sont, elles aussi, héréditaires. Les chances de survie individuelle sont fortement accrues par l’unité du groupe, surtout lorsque les conditions de vie sont difficiles, tandis que les sentiments altruistes aident à la survie du groupe. Des standards de vie en groupe se sont développés durant 200 millions d’années, et des sentences de mort furent appliquées par le groupe contre les individus qui déviaient trop du modèle admis par le groupe. Ces dispositions sont profondément imprimées dans notre code génétique; elles étaient là depuis des millions d’années, et seuls ceux imprégnés de cet ‘appétit social’, devenu une part intégrale de la condition humaine, ont survécu.
La vie tribale avait été le berceau de l’appétit social. Celui-ci, se limitait toutefois au groupe; une amitié étendue à toute l’humanité n’aurait eu aucune valeur de survie pour des êtres qui évoluaient par groupes. Comme l’intelligence allait croissant —de plus en plus de problèmes se trouvant résolus— les hommes comprirent les avantages qu’il y avait à utiliser chacun aux tâches qui lui convenaient le mieux, d’où la division du travail et autres pratiques qui sont à la base d’une civilisation. Dans une grande partie du monde, la civilisation mit ainsi un terme à la vie tribale.
La loi de la dynamique des populations
Le constat de Pendell, c’est que les peuplades tribales qui ont créé leur civilisation, ont su tirer profit de la cruelle et longue sélection naturelle. C’est au moment de la naissance d’une civilisation, que l’efficacité générale est à son maximum. Une fois la civilisation bien en place, le processus évolutif faiblit, et il le fait dans la mesure où la civilisation s’impose. De la lecture du passé, Pendell tire que la détérioration accompagne la prolifération, c’est dit-il la ‘loi de la dynamique des populations’
Cette loi repose sur des constatations ayant trait au processus évolutif biologique d’une part, et aux instincts sociaux d’autre part.
Le point de vue biologique d’abord :
1. L’évolution tend à éliminer dans une proportion quelque peu plus grande, les individus inefficaces par rapport aux individus efficaces.
2. Une augmentation considérable de la population humaine dans une région, annonce une application plus limitée du processus de séparation. Cela est dû par exemple, à une amélioration de l’habitat ou de l’habillement, ou à de meilleures méthodes d’entreposage.
3. Lorsqu’un groupe prolifère, les survivants comprennent des individus situés plus bas dans l’échelle de l’efficacité.
4. Lorsque la croissance d’un groupe s’accélère soudainement, cela se traduit par moins de mortalités par mille naissances que d’habitude, et donc, par moins de rejets (weeding out) que d’habitude.
5. Puisque les naissances sont normalement plus nombreuses parmi la moitié la moins efficace de n’importe quel groupe spécifique, il y a une plus grande proportion de survivants parmi la moitié la moins efficace lorsque le groupe augmente en nombre.
Selon les travaux de Robert Klark Graham (The Future of Man) cette loi de la dynamique des populations, était déjà à l’œuvre dans les temps préhistoriques. Graham suggère que le point tournant dans l’évolution de l’espèce humaine se situe à l’époque des peuples Cro-Magnon. «Ce point tournant fondamental, c’est le moment où la sélection naturelle fût affaiblie au point où les influences détériorantes commencèrent à prédominer sur les influences améliorantes». Il faut noter que contrairement au discours usuel, Graham parle ici de l’espèce et non de l’individu.
La dynamique des populations vue sous l’angle cette fois des instincts sociaux se résume dit Pendell comme suit :
1. L’appétit social encourage la coopération.
2. La coopération peut être suffisamment élaborée et intense pour former une civilisation.
3. La division du travail cache l’importance ou l’inutilité d’individus dans leurs rôles variés.
4. Certains individus ne possèdent pas la capacité de participer utilement au processus de production.
5. L’incapacité peut être physique et/ou mentale.
6. L’appétit social des capables permet aux incapables de bénéficier du "produit national brut".
7. Lorsque la civilisation est jeune, le fardeau du partage n’est pas lourd
8. Ceux qui ont relativement peu d’intérêts et relativement peu de sentiments de responsabilité auront vraisemblablement un contrôle plus limité de leurs instincts, et auront donc une progéniture plus nombreuse.
9. Dans une civilisation en déclin, un taux de mortalité plus élevé des personnes capables constitue un type de désordre fonctionnel.
10. La prépondérance des moins compétents sur les plus compétents produira éventuellement des interférences avec les procédures et les processus fondamentaux de la civilisation, jusqu’au point où celle-ci cessera de fonctionner.
Un parallèle avec la seconde loi de la thermodynamique
Pendell observe —comme d’autres l’ont souvent fait dans l’étude des questions humaines— un intéressant parallèle entre la loi de la dynamique des populations et la seconde loi de la thermodynamique. Cette dernière peut être énoncée simplement en ces termes :
«Tout système isolé, et libre de le faire, passera toujours d’un état plus organisé à un état moins organisé, jusqu’à ce qu’il atteigne éventuellement et demeure dans l’état de désordre maximum possible, qui est l’état d’équilibre thermique».
Or, la civilisation exprimée en termes de la deuxième loi de la thermodynamique est un système isolé dit Pendell. Lorsque le processus évolutif échoue à maintenir le nécessaire niveau d’intelligence, le système passe d’un état de plus grande organisation à un état de moindre organisation, car les individus les moins intelligents forment une plus grande proportion de la population.
Appliquant cette thèse à la réalité historique, Pendell décrit brièvement plusieurs cultures en commençant par celle de Neandertal, puis celle de Cro-Magnon, qui toutes deux ont démontré des hauts niveaux d’intelligence a leur début. La prolifération de ces peuples fut accompagnée de leur détérioration. A propos de ces peuples anciens, Robert Klark Graham explique : «Nous savons que la grosseur du cerveau et l’intelligence tendaient à augmenter sous l’effet des conditions sévères de sélection naturelle imposées par la cueillette et la chasse. Nous savons que cette augmentation cessa apparemment avec l’apparition de l’agriculture mixte. Il n’est pas difficile de voir pourquoi cela s’est passé ainsi, puisque la production de la nourriture permettait à des millions ayant de plus faibles cerveaux de survivre alors qu’ils ne se seraient pas qualifiés pour la survie sous la sélection plus rigoureuse durant la phase chasseresse».
Pendell considère que l’histoire des villes anciennes de Jarmo dans le Nord de l’Irak, ou de Çatal Hüyük en Anatolie, représente en miniature la croissance et la chute d’une civilisation. Une des plus anciennes civilisations connues fleuri voici plus de 8000 ans, dans cette ville très cultivée et très développée de Çatal. Sa durée s’étendit sur 32 générations, dont les dix dernières témoignent d’un manque de créativité, jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Çatal peut être considérée dit-il, comme une application très ancienne du principe d’auto-destruction. Un archéologue a dressé à lui seul, 66 villes et villages similaires à Çatal, en Anatolie seulement. «Le fait que des douzaines voire des centaines —en tous cas beaucoup— de civilisations ont pris le même chemin de l’oubli devrait éveiller quelque suspicion sur le modèle qu’elles ont suivi. La suspicion que, nous aussi, qui suivons la même route, puissions faire quelque chose d’erroné, avec des conséquences mortelles».
Sommes-nous devenus les serviteurs des "faux-bourdons"?
Suit une description avec de nombreuses références, sur la situation de l’éducation aux Etats-Unis. La conclusion peut se résumer à l’opinion émise par le Dr. Max Rafferty, Doyen de l’École de l’Éducation de l’Université Troy State et ex Principal du Département de l’Éducation de Californie: «les examens standardisés présentés aux élèves des écoles primaires portent à soutenir la thèse selon laquelle les différentielles de naissance causent une détérioration du Q.I. national».
Comme on pouvait s’y attendre, dit Pendell, toutes les théories avancées pour trouver les causes de ce déclin ont été relatives à l’environnement, mais dit-il, «ces capacités d’apprentissage en baisse pourraient faire partie d’une histoire plus grande et plus tragique, dans laquelle la biologie joue un rôle dominant». Il termine cette analyse de l’éducation dans son pays par ces mots: «Il n’y a pas de forme plus mortelle d’auto-destruction que de forcer les éléments valables d’une civilisation à devenir les serviteurs des ‘faux-bourdons’ (drones)».
Le monde, dit plus loin le Dr.Pendell «a connu bien plus de civilisations que celles dévoilées par Arnold Toynbee dans A Study of History. Si nous combinions nos nouvelles connaissances au sujet du nombre de civilisations qui ont été exterminées, avec nos nouvelles connaissances au sujet de la mécanique de détérioration génétique, peut-être pourrons-nous imaginer des mesures qui feront que notre propre civilisation ne suive le chemin pris par toutes celles passées».
* * *
Chapitres du livre :
1 L’individu sur la scène centrale.
2 Le legs de l’instinct.
3 L’appétit social.
4 La parole : l’outil de la sociabilité.
5 Contraintes sur l’appétit social.
6 La mort – servante de la vie.
7 L’évolution à l’époque glaciaire.
8 L’appétit social versus l’évolution.
9 La chute des civilisations.
10 Le facteur héréditaire.
11 Le gaspillage du génie.
12 Le principe de l’auto-destruction à l’œuvre aux Etats-Unis.
13 Un cric pour la reproduction.
14 L’auteur rencontre ses commentateurs critiques.
(résumé de Vincent Andriessen).
00:04 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 04 avril 2008
De Hobbes aux pressions, boycotts et conspirations du silence

Pankraz :
De Hobbes aux pressions, boycotts et conspirations du silence
On les reconnaîtra à leurs paroles et mots favoris. Le terme favori, dans la sphère politique allemande d’aujourd’hui, est « pression », plus exactement « faire pression », soit « Druck » et « Druck ausüben ». On ne débat plus ensemble, on ne cherche plus à se convaincre par des arguments (réfléchis et pesés), on ne domine plus l’adversaire politique par son excellence argumentative ou rhétoricienne, non, on se borne à « faire pression », sans discontinuité, pendant de longs laps de temps. Les actualités télévisées, les informations de nos journaux fourmillent de « pressions » exercées, qu’elles soit imposées ou subies. « La pression sur la Chine dans la question du Tibet va en s’accroissant », annonçait, en début d’émission, il y a quelques jours, la speakerine des actualités quotidiennes de la chaîne ARD.
La rhétorique de la « pression exercée ou à exercer » s’est considérablement déployée et ne fait que croître chaque jour davantage, se dotant de nouvelles tournures et expressions. Jadis, on préparait toutes sortes de menaces en coulisses ; aujourd’hui, on prépare des « pressions », toujours en coulisses. Le cas échéant, la pression est accentuée systématiquement ; on ne la modère que rarement. On épuise totalement le potentiel de pression dont on pense disposer. Que ce soit l’ami ou l’ennemi qui soit visé, peu importe. Même et surtout les forces qui sont alliées au fauteur de pression ressentent la pression qu’il exerce sur elles, si besoin s’en faut. C’est certain : la pression politique, en tant que telle, est axiologiquement neutre.
Parallèlement à l’exercice de la pression augmente également la capacité de lui résister. La phrase usuelle, « Nous ne nous laisserons pas mettre sous pression », qu’elle soit prononcée sur un ton moqueur ou sur celui de l’indignation, appartient désormais au répertoire standardisé des politiciens, qui sont inévitablement mis sous pression ou tentent de se défendre contre les pressions exercées par des forces ennemies ou alliées. Pourront-ils, sur le long terme, résister à la pression ? Ou cèderont-ils, à la longue, aux multiples pressions qui s’exercent sur eux ? Ou crouleront-ils, défaits, sous le poids de celles-ci ?
En quoi consiste l’essentiel de l’exercice moderne de la pression ? Aujourd’hui, on n’exerce quasiment plus de pression par moyens militaires, en faisant manœuvrer des armées le long d’une frontière, en massant des troupes, etc., car pour déclencher une guerre, on dispose désormais de rampes de lancement dûment installées sur terre, sous eau ou sur orbite, qui peuvent frapper immédiatement, sans le moindre délai. Personne ne se laisse plus impressionner, mettre sous pression par ces engins télécommandés, surtout pas les grandes puissances, car elles sont prêtes à riposter efficacement à tout moment. Ce n’est pas davantage le cas des plus petites puissances car l’éventualité de se faire envahir ou mater militairement appartient à leur quotidien ; elles ne considèrent plus cela comme une pression mais comme une fatalité qui peut survenir à tout moment.
La pression économique, de manière similaire, que l’on appelle aussi le « boycott », est devenue inefficace. Les « boycottés » s’habituent assez vite à ce mode de pression et l’acceptent avec une certaine sérénité. Il suffit de songer à Cuba. Depuis cinquante ans, le boycott américain sévit contre l’île et, indubitablement, il nuit à son déploiement économique. Mais le régime cubain ne s’est jamais effondré.
Non, la véritable pression aujourd’hui -qui n’est pas seulement une pression exercée dans le cadre de la politique extérieure mais constitue surtout un instrument en politique intérieure- ne consiste pas en moyens militaires ou économiques, mais en méthodes sémantiques et en pressions sur le quotidien. Dans la vie mondaine actuelle, on appelle cela le « mobbing », vocable anglo-saxon, ou en bon vieil allemand, le « Bierverschiss », sorte de mise en quarantaine démonstrative et affirmée (ndt : en Belgique, on appelle cela le « Cordon sanitaire », que le Vlaams Belang, la NVA, Yves Leterme et certains identitaires wallons de gauche comme de droite ont subi ou subissent encore ; ajoutons que Joëlle Milquet, lors des négociations de 2007 pour la formation d’un gouvernement à utiliser toutes les ficelles du « mobbing »). On ignore ainsi consciemment et de manière ostentatoire la personne ou le groupe mis sous pression. On le réduit au silence, on lui inflige la conspiration du silence, on l’ignore, on ne le voit plus. Il ne peut plus jouer dans le jeu ou on le menace de ne plus l’autoriser à y jouer, exactement comme le font les enfants ou certains peuples primitifs quand ils ne tolèrent plus la participation au jeu social de certains membres de leur groupe ou communauté, qui se sont attirés la colère de la collectivité et doivent « être mis au pas » ou « éliminés ».
Elisabeth Noelle-Neumann est celle qui a analysé pour la première fois et de manière précise ce procédé d’exclusion dans son livre sur la « spirale du silence » (« Die Schweigespirale »). La pression née de cette exclusion, de cette quarantaine que nous appelons « Bierverschiss », est effectivement considérable et, en de nombreux cas, sinon dans la plupart des cas, très efficace parce que fort douloureuse. On ne s’y habitue qu’à grand peine ; on ne peut pas adapter avec précision son comportement sur ce mode d’exclusion, ni prévoir de manière exacte les façons dont il se manifestera à très court terme. Les directions d’où peuvent provenir ce type de pression, sont extrêmement diversifiées et exigent de celui, qui veut y résister, une attention extrême et permanente, une mobilisation pleine et entière de ses énergies. En prenant acte de ce mode de défense et de résistance, comme nous venons de le faire, on pourrait presque affirmer que ce type de quarantaine est un écolage idéal pour former une élite.
Sur ceux qui exercent cette forme de pression, celle-ci ne joue nullement un rôle formateur, capable de faire surgir une élite. La sphère politique s’infantilise et se primitivise. Ce n’est pas une élite qui émerge de cette praxis : bien au contraire, tout ce qui relève de l’ontologie humaine spécifique, c’est-à-dire des capacités à fonder la « Polis » ou l’Etat, déchoit, à vue d’œil, dans le matérialisme le plus plat. Que faut-il penser d’une « politologie » qui ramène tout à un schéma simpliste de pression et de contre-pression et ne mesure pas le carat des argumentaires et stratégies politiques à leur qualité substantielle et formelle, mais seulement au caractère purement quantitatif de la pression mécanique qui s’exerce sur des adversaires ou des compagnons de route plus ou moins récalcitrants ?
Thomas Hobbes, le grand théoricien du politique à l’aube des temps modernes en Europe, avec sa pensée rigoureusement mécaniciste, ne peut en aucun cas être mobilisé, comme figure de proue de la politologie, pour défendre une perspective aussi étroite, étriquée. Le schéma de la pression et de la contre-pression, qu’il a élaboré pour expliciter le monde organique et les « bas » instincts de la nature humaine, devait, disait-il, être résolument mis hors d’état de fonctionnement pour faire advenir le politique pur. Dans le domaine du politique pur, ce ne sont pas les pressions et contre-pressions qui doivent donner le ton, mais la volonté toute puissante du Léviathan, dans la construction politique duquel l’ensemble des autres porteurs de volonté doit ranger et soumettre ses directives, quel que soit le potentiel de pression que ses volontés et directives pourraient par ailleurs exercer.
Ou, pour parler le langage de la politique actuelle : lorsque la situation devient véritablement sérieuse, préoccupante, inquiétante, une pression vient d’en haut, de tout en haut, qui séduit chacun par le plus bel exercice de pression qui soit. Ce ne doit pas toujours être la pression du Léviathan. Pour générer la contre-pression nécessaire, la nécessité ou la misère subie hic et nunc par la patrie peut suffire ainsi que le regard conscient et offensif que portent les contestataires du désordre établi en direction des fauteurs de pression, des spécialistes du « mobbing », des experts ès-Bierverschiss, responsables de cette misère.
Jadis, les gamins de rue de Berlin, comme l’atteste une lettre de Zelter à Goethe, au temps de l’occupation napoléonienne, chantonnaient : « Druck und Stoss / Gehn in die Hos’ » (« Pressions et coups / vous vont dans la culotte »). Il n’y a pas grand-chose à y ajouter, sauf peut-être ceci : souvent les coups portent droit au cœur.
PANKRAZ.
(article paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°14/2008 ; traduction française: Robert Steuckers).
00:04 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manipulations médiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 03 avril 2008
F. Böckelmann et la perception contemporaine de l'espace

Thorsten HINZ :
Un ordre nouveau dans un monde sans frontière ?
Les réflexions du situationniste et médiologue allemand Frank Böckelmann sur la perception contemporaine de l’espace
L’essence du dernier livre de Frank Böckelmann peut se résumer en paraphrasant Goethe : la nation et l’Etat national ne veulent plus dire grand-chose aujourd’hui. Le monde (entier) est le lieu qui nous est désormais assigné. Mais pour que ce monde puisse être une partie (charnelle) pour l’Européen, tant sur le plan politique que sur le plan spirituel, il doit s’y ancrer avec modestie et sur un mode nouveau.
Les « raids de reconnaissance dans l’existence sans frontières » du médiologue Frank Böckelmann se subdivisent en six chapitres, où il disserte sur des thèmes apparemment fort disparates, tels le corps à multiples fonctions, la catastrophe urbaine, le sexe à l’ère d’internet, les droits de l’homme, la fin de l’hégémonisme américain, le retour des grands espaces (Grossräume) et, à la fin du volume, la chance que peut saisir l’Europe pour assurer sa survie en résistant. Quand on lit ce livre, ces thèmes disparates apparaissent vite liés entre eux par une logique rigoureuse, celle que Carl Schmitt a mise au point dans son essai « Land und Meer » (« Terre et Mer »), lorsqu’il traitait de la « révolution globale de l’espace ».
Cette révolution spatiale commence au 15ième siècle quand les Européens se lancent dans la navigation sur les océans de notre planète, conquièrent et mettent en valeur de nouvelles régions du monde. Cette révolution a transformé la notion des distances et la perception des ordres de grandeur ainsi que la structure du concept ‘espace’, ce qui a conduit à « une mutation générale de la politique, de l’économie et de la culture ». « Surgissent alors de nouvelles échelles de grandeur, de nouvelles dimensions de l’activité politique et historique des hommes, de nouvelles sciences, de nouveaux ordres, une nouvelle vie pour des peuples nouveaux ou renés de leurs cendres », écrivait Carl Schmitt. Au 20ième siècle, cette révolution poursuit sa course par l’avènement de la navigation aérienne, qui réduit à quelques heures de vol seulement les distances entre les continents et les points les plus extrêmes de l’Europe. Les technologies des fusées et de l’astronautique permettent aujourd’hui de surveiller n’importe quel point du globe et de l’atteindre techniquement en quelques minutes voire de le détruire, le cas échéant. Böckelmann écrit, en se référant au philosophe français de la vitesse et de la cinétique, Paul Virilio, sur les suites actuelles de cette « révolution de l’espace », cette fois en tenant compte des conditions imposées par les nouveaux médias et modes de communication. Les techniques nouvelles, qui permettent à internet de fonctionner, font en sorte qu’aujourd’hui chacun est potentiellement joignable en tous points du globe. C’est une nouvelle modification dans la perception de nos structures spatiales qui nous touche et nous saisit : l’homme lui-même cherche désormais à agencer son ego physique et psychique pour participer à la concurrence globale, avec pour but, de devenir un « soi sans soi » (« ein selbstloser Selbst »).
Dans un tel monde, les lieux en viennent à devenir partout de plus en plus semblables. Pour pouvoir exister économiquement parlant, chaque intervenant sur le marché, aussi modeste soit-il, est contraint d’être connecté au monde, d’envoyer des flux de données et d’en recevoir, d’avoir à proximité de son implantation un aéroport ou une autoroute. Ce que l’on nous demande, c’est d’avoir un signe permettant d’être reconnu partout sur la planète. Cela signifie que partout les marchandises, marques et services usuels doivent être directement accessibles ou aisément appelables, comme par exemple les distributeurs de billets ou les chaînes de restaurant. C’est la disparition du genius loci. Les lieux deviennent les filiales d’une société mondialisée. Les villes historiques ne nous révèlent plus ce qui se passe, se fait et se pense réellement derrière les murs ; elles ne véhiculent plus une spécificité vivante, ne sont plus l’écho d’une histoire ; leur signification se réduit à leur attrait touristique. Exemple actuel de cette « dé-localisation » (« Ortlosigkeit ») : le nouveau slogan publicitaire « Be Berlin » (« Sois Berlin »). Voilà donc une ville historique, qui n’est pas sans importance, mais qui, pour des raisons bien connues, se situe dans une zone marginale de l’économie globale, mendie de la sympathie et de la présence, en s’offrant comme une simple surface où chacun viendrait inscrire sa marque, sa touche personnelle.
La dévalorisation des structures traditionnelles, y compris les structures nationales et étatiques, semble inévitable, irrémédiable. Néanmoins, la petite musique emphatique qui accompagne le phénomène trahit de la naïveté. Est illusion l’espoir que ce processus conduira à un nouvel ordre mondial, où le politique, comme instance où se télescopent et fusionnent des forces concurrentes, se verrait enfin dépassé et remplacé par un ‘droit’ accepté par tous, un droit qui reposerait sur un canon de valeurs à l’origine européennes et désormais universelles (et universalistes). Le philosophe grec contemporain, hélas disparu depuis quelques années, Panajotis Kondylis en avait d’ailleurs démontré le caractère illusoire dès 1992, dans son ouvrage « Planetarischer Politik nach dem Kalten Krieg », « Politique planétaire après la Guerre Froide ». Partir du principe que la mise en réseau globale va amener une standardisation définitive des cultures et des formes de droit et de pratiquer la politique, cela a toujours été une idée fixe des « héritiers de l’Occident ». Les positions de départ et les intérêts des uns et des autres sont bien trop divergents. La « communication totale », que l’on nous annonce, ne s’opère qu’en surface et sous cette surface règne un « silence impénétrable ». Les kamikazes, qui ont frappé les métropoles occidentales, étaient des hommes cultivés selon les critères occidentaux actuels, accoutumés à toutes les finesses technologiques de l’Occident ; ils prouvent par leurs actes, et cela donne le frisson, que leur proximité violente conduit plutôt à des confrontations qu’à l’harmonie.
La mise en réseau du monde ne rend pas celui-ci plus sûr mais au contraire plus vulnérable. Une action de guerre asymétrique dans un coin perdu du monde fait l’effet d’une menace pour tous, à cause de sa rapide diffusion médiatique et plonge les économies et les Etats de la planète entière dans des zones de turbulence. Pour prévenir de telles actions, les flux de circulation et de données sont de plus en plus contrôlés. Mais qui peut exercer un contrôle réellement efficace ? Et voilà que revient à l’avant-plan la question de la puissance politique et militaire, qui avait été neutralisée par une volonté universaliste de tout ‘juridifier’. Et les Etats-Unis sont à l’avant-scène, le seul pays qui, jusqu’ici, avait profité de la globalisation et avait consolidé les atouts de sa puissance. L’existence politique des Etats-Unis avait commencé à se déployer sans aucun arrière-plan historique, comme la pure incarnation du système capitaliste et libéral. Les Etats-Unis avaient promu sans frein la « révolution de l’espace » aux 19ième et 20ième siècles ; ils avaient fait de la volonté universaliste de ce système l’équivalent des intérêts de l’Etat américain lui-même.
La situation actuelle de l’Europe correspond véritablement aux aspirations des Etats-Unis. L’Union Européenne élimine les compétences des Etats nationaux au profit d’un espace économique unitaire, sans jamais formuler les contours clairs d’une volonté politique propre et commune. Ce processus de dévolution de la puissance politique vers l’économie transnationale a lieu au moment précis où le capitalisme, en tant que mode de production (fabrication, commercialisation et vente de biens produits dans un but d’engranger des profits), se dissout sous les effets de la finance spéculatrice, sans fondement rationnel.
Simultanément, on constate que certains pays européens tiennent, têtus, à leur souveraineté : c’est purement chimérique et, à l’échelle globale, sans conséquence aucune, parce que cette souveraineté n’est plus qu’une espièglerie anachronique perpétrée sous le parapluie militaire américain. La véritable souveraineté ne peut être restaurée aujourd’hui que dans un cadre européen, vu les rapports de force sur ce globe, tant ceux qui dominent aujourd’hui que ceux qui domineront demain. La condition préalable à cette souveraineté retrouvée serait une volonté politique d’auto-préservation physique, volonté à partir de laquelle la capacité de décider réellement ré-émergera. Mais rien ne signale à l’horizon les moindres prémisses d’une telle volonté.
Les Européens se sont habitués à concevoir leur Europe comme un continent dé-territorialisé, comme un non lieu, dont l’esprit, jadis, a missionné et conquis le monde, raison pour laquelle il n’a plus besoin d’un véritable ancrage dans l’espace. Dans « Terre et Mer », Carl Schmitt nous rappelle la teneur du roman intitulé « Tancred » de Benjamin Disraeli. Celui-ci proposait que la Reine Victoria et toute sa Cour déménagent aux Indes, où les attendaient de gros revenus et une armée bien aguerrie. A l’époque, la Grande-Bretagne était la plus grande puissance de la Terre, alors qu’aujourd’hui l’Europe se présente au monde extérieur, sur les plans militaire et politique, comme une masse gélatineuse. Les messages qui émanent de ce lieu dé-territorialisé et sevré de toute puissance ne sont pas pris au sérieux ou, pire, sont réinterprétés et renvoyés à l’expéditeur pour l’abuser, le ponctionner et l’affaiblir encore davantage.
Böcklemann avance de solides arguments pour annoncer la fin prochaine de la globalisation unilatérale et le nouveau partage du monde, qui deviendra ainsi un pluriversum de grands espaces. L’Europe constituera-t-elle un de ces grands espaces autonomes ? Pour qu’elle le devienne, il faut d’abord qu’elle cesse de poursuivre sa mission universaliste, et qu’au contraire, elle recommence à souligner les différences qui existent entre elle et les autres, qu’elle redécouvre la volonté de puissance. Cette espérance de Böckelmann semble totalement incongrue vu l’état désespérant de l’actuelle élite eurocratique. Le retour de l’Europe ne dépend plus d’elle-même mais des intentions que cultivent à son égard les peuples de sa périphérie, surtout le monde islamique. Peut-être qu’un jour, les pressions deviendront totalement insupportables pour l’Europe, tant et si bien qu’elle n’aura pas d’autre alternative que de faire revivre en elle ses traditions, connaissances et anciennes vertus, qui lui donneront la force de s’affirmer et de décider. Mais personne ne peut se porter garant d’une telle issue.
Le livre de Böckelmann est fascinant. Il nous oblige à penser en termes nouveaux, à penser plus loin, à dépasser les étroitesses du présent.
Thorsten HINZ.
(recension parue dans « Junge Freiheit », Berlin, n°14/2008; traduction franç.: Robert Steuckers).
Frank BÖCKELMANN, „Die Welt als Ort. Erkundungen im entgrenzten Dasein“, Karolinger Verlag, Wien, 2007, 312 Seiten, 24 Euro.
00:56 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 28 mars 2008
Citation de Nicolas Berdiaev

Citation de Nicolas Berdiaev
« Les événements se déroulent dans la réalité de l’esprit avant de se manifester dans la réalité extérieure de l’histoire ».
00:56 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 27 mars 2008
Franz Xaver Baader
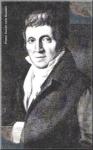
27 mars 1765: Naissance à Munich de Franz Xaver von Baader. Ingénieur des mines de formation, il se révèle comme philosophe en 1814, quand il soumet un mémoire aux Empereurs d’Autriche et de Russie et au Roi de Prusse, afin de pérenniser l’idéal de “Sainte-Alliance” continentale. Pour forger définitivement ce bloc véritablement eurasien (avant la lettre!), Baader étudie la théologie et plaide pour un rapprochement entre le catholicisme occidental et l’orthodoxie russe, que Rome refusera. Baader deviendra ainsi un adversaire résolu de la Papauté romaine, ennemie de l’unification européenne et eurasiatique.
La théologie de Baader puise ses sources chez les Pères de l’Eglise et chez les mystiques allemands du moyen-âge. Hostile au cartésianisme et au rationalisme des Lumières, Baader croit à la révélation divine et pense que l’homme participe du divin, comme le pensaient aussi les mystiques médiévaux. L’homme est donc un être intermédiaire entre la sphère du divin et celle de la nature. L’homme est une part d’un donné préexistant, dont il s’agit de maintenir l’harmonie. L’Etat doit tenir compte de ce donné et ne jamais succomber aux sirènes des idéologies mécaniques qui se revendiquent fallacieusement d’un “état de nature” et d’un “droit naturel”. Les Etats doivent se donner des constitutions particulières, fruits organiques de leur propre histoire, et non pas viser à adopter tous un modèle préétabli, unique, de constitution, qui serait considéré comme une panacée valable en tous temps et tous lieux. Baader s’insurgera très vite contre les misères générées par la société industrielle et réclamera l’avènement d’un Etat qui ait une politique sociale bien définie, afin d’éviter la prolétarisation des masses. Franz Xaver von Baader meurt à Munich le 23 mai 1841.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 15 mars 2008
Inventaire de la modernité avant liquidation

« Inventaire de la modernité avant liquidation /Au-delà de la droite et de la gauche, études sur la société, la ville, la politique »
Par Pierre Le Vigan
La modernité est en période d’épuisement historique. Consommer toujours plus, être toujours plus compétitif, être toujours plus « ouvert » sur le monde, tout cela aboutit à ce que les peuples soient de moins en moins eux-mêmes. S’ouvrir ? Oui, mais pour donner quoi et recevoir quoi ? C‘est cette crise de la modernité finissante qu’examine Pierre Le Vigan, collaborateur notamment des revues « Eléments » et « Nouvelle Ecole ». L’auteur explique pourquoi la société est de plus en plus désintégrée, et pourquoi les repères de valeurs s’estompent. Le capitalisme financier se dresse contre les producteurs, le travail n’est plus facteur d’intégration, le culte de l’urgence rend fou l’individu hypermoderne, la religion de la transparence nie les intimités et met l’homme à nu. Il n’est dès lors pas étonnant qu’il se blesse et que les maladies psychiques explosent. Dans ce contexte, l’immigration rend plus fragile encore le socle commun de souvenirs, le sens d’un avenir partagé et le monde commun lui-même qui fonde la « common decency ».
La ville est le lieu où cette crise du lien social se traduit le plus nettement, puisqu’elle est le lieu de la production des formes et qu’elle donne ses couleurs à nos vies et à notre imaginaire. Or cette ville est à la fois tentaculaire et vidée de son intensité urbaine que ne rappellent plus que les centres commerciaux géants ou les flammes des jours d’émeutes. Société fragmentée en multiples infra-cultures tribales, ville désurbanisée et ghettoïsée, l’étonnant serait que le politique se porte bien. De fait, le politique a perdu son espace qui est l’espace public ; le libéralisme qui a toujours sous-estimé la nécessité de liens communautaires devient la caricature de lui-même : il n’est plus la responsabilité de chacun, il n’est plus le droit à l’initiative. L’hypermédiatisation transforme la démocratie représentative en coquille vide, et la démocratie d’opinion prend la place d’une souhaitable mais impossible démocratie directe dans une société dont le lien social s’effrite voire se rompt.
Dans cette situation il ne peut y avoir, indique Pierre Le Vigan, qu’une réponse globale qui prenne en compte l’ensemble des pratiques de l’homme. La société doit confectionner à nouveau du lien social au service d’un projet de civilisation : indépendance de l’Europe, économie relocalisée et autocentrée. Pierre Le Vigan défend un véritable projet écologique qui prenne d’abord en compte les besoins d’enracinement de l’homme. Comme l’écrit l’auteur, nous sommes plongés dans une « guerre des valeurs » : s’aligner sur l’Amérique, ou être plus américain que l’Amérique – c’est encore une façon de raisonner dans les mêmes termes quantitatifs et marchands. C’est pourquoi, à l’inverse, l’auteur propose de penser la puissance autrement, comme la force intime d’une civilisation, irriguée par sa propre conception du monde. Conscient de la nécessité d’être concret et pragmatique, l’auteur évoque longuement et précisément les conditions pour redonner sens à la démocratie confisquée qui est la nôtre. Il propose ainsi une dose de proportionnelle mais s’oppose à la proportionnelle intégrale, il prône le référendum d’initiative populaire et préconise de dissocier nationalité et citoyenneté. C’est ainsi qu’apparaissent les grandes lignes d’une démocratie impériale européenne. « Nous ne cesserons d’affirmer le monde contre ce qui va dans le sens de sa négation [et] de la mort de l’esprit », écrit Pierre Le Vigan.
Noël Rivière
12/02/08
Polémia
Pierre Le Vigan, « Inventaire de la modernité avant liquidation /Au-delà de la droite et de la gauche, études sur la société, la ville, la politique », préface d’Alain de Benoist, Avatar Editions, Collection Polémiques, 2007, 424 p., 39 €.
00:01 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 12 mars 2008
Debord: la révolution au service de la poésie

Debord: la révolution au service de la poésie
Vincent Kaufmann publie Guy Debord, la révolution au service de la poésie. Il écrit en introduction: « L'improbable lecteur sans qualités que j'imagine être ne demande rien à Debord. Ne demandant rien, il est aussi le contraire d'un lecteur frustré, lui reprochant d'être ceci plutôt que cela, ceci moins que cela, ou l'accusant de duplicité, ou lui faisant des scènes parce qu'il n'aurait pas été capable de produire la théorie de la prochaine révolution, et encore moins de s'y engager, avec ou sans bombes. Il ne demande rien, et peut-être reçoit-il du même coup plus, ayant alors la possibilité d'entrevoir Debord tel qu'il est, tel qu'il a été. Voir Debord tel qu'il est, c'est voir en lui l'enfant perdu qu'il a toujours voulu être, expert en perdition ou sensible à l'irrémédiable passage du temps. C'est voir en lui le guerrier mélancolique, qui est aussi un joueur, celui qui fait de la guerre un grand jeu. C'est voir l'amoureux des passions et l'expert en plaisirs, ceux de l'amour comme ceux de la dérive à travers les villes, qui construit des internationales pour vivre ces passions. Et c'est surtout voir comment ces différents aspects d'une même personnalité se fondent dans une œuvre, dans un style. Debord écrit en stratège, il fait de la politique en poète, il fait la guerre par goût du jeu, et il construit des avant-gardes par mélancolie, comme s'il prévoyait d'emblée leur dissolution à venir. Et il le fait en étant toujours lui-même, en restant le même. Tout compte fait, il n'est pas sûr que Debord soit un auteur difficile à comprendre » (PM).
Vincent KAUFMANN, Guy Debord, la révolution au service de la poésie, 2001, Fayard, 412 pages, 24,30 Euro.
Archives et documents situationnistes
Chez Denoël est paru le n°1 des Archives et documents situationnistes dirigés par Christophe Bourseiller. Il écrit: « Les temps ont changé. Le spectacle n'a certes pas relâché le joug, mais l'Internationale situationniste ne saurait être appréhendée comme elle le fut auparavant. L'IS n'existe plus et Guy Debord est parti. Dans un tel contexte, il nous a paru essentiel d'oser passer à la recherche. Changement d'époque, changement de ton. Comme son titre l'indique, la revue se donne pour dessein l'étude de l'Internationale situationniste et des mouvements qui l'ont précédée ». A noter, un entretien avec Pierre-André Taguieff, sans doute l’élément le plus intéressant du dossier, et une étude très politiquement correcte de Bourseiller intitulée « Récupération à tous les étages. L'Internationale situationniste, Guy Debord et l'extrême droite » (PM).
Archives et documents situationnistes. 2001. Denoël. 172 pages. 14 Euro.
00:47 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 mars 2008
Leo Strauss et le nihilisme

Leo Strauss et le nihilisme
“Rivages” a publié Nihilisme et politique de Léo Strauss (1899-1973). Ce livre est composé de trois essais: Sur le nihilisme allemand (1941), La crise de notre temps (1962), et La crise de la philosophie politique (1962). La traductrice écrit en présentation: « Une “destruction de la raison” a eu lieu à la fin du XIXe siècle, avec le progressisme aveugle qui, après avoir triomphé politiquement et intellectuellement, a dû faire face à la critique des Nietzsche, Spengler, Heidegger. Et cette destruction de la raison dans l'historicité a conduit au nihilisme allemand qui a engendré le nazisme. La civilisation s'est alors trouvé incapable de résister efficacement au retour de la barbarie à l'intérieur de l'homme civilisé occidental. En d'autres termes, ou bien nous assumons ces faits et nous les interrogeons radicalement, et cela revient à réouvrir la querelle des Anciens et des Modernes (à retrouver la tradition de l'attitude philosophique que l'on pourrait résumer ainsi: modération dans l'action publique, recherche immodérée de la vérité dans le privé); ou bien nous continuons à avancer aveuglément, dans un nouveau nihilisme qui n'est pas, lui, opposé à la modernité, mais qui se confond avec elle, et l'on voit se profiler d'autres maux à l'horizon » (PM).
Léo STRAUSS, Nihilisme et politique. 2000. Editions Rivages. 146 pages. 12,96 Euro.
00:41 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 février 2008
A. Romualdi: Introduccion a Gobineau
Introduccion a: Arthur de Gobineau; la desigualdad de las razas
Adriano ROMUALDI
Hay libros que actúan sobre la realidad de muchos de los hechos políticos y que, saliendo del círculo estrecho de la discusión, se convierten en idea-fuerza, mitos, sangre que alimenta los procesos históricos. El más típico es indudablemente El Capital de Marx, un estudio histórico-económico que se ha convertido en dogma religioso, arma de batalla, evangelio del vuelco mundial de todos los valores cumplimentado por la casta servil. A estos libros pertenece el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas del conde de Gobineau, ignorado durante el tiempo que el autor vivió pero que - difundido en Alemania después de su muerte - fue destinado a transformarse en un de las más poderosas idea-fuerza del siglo XX: el mito de la sangre del nacionalsocialismo alemán.
Arturo de Gobineau nace en Ville d’Avray en el 1816 de una familia de antiguo origen normando. Poco antes de morir, en el Histoire d’Ottar Jara él revivirá los hechos del conquistador vikingo que arribó a las costas de Francia dando origen a su familia. El padre de Gobineau fue capitán en el Guardia Real de Carlo X. Después de la revolución del 1830 se apartó a vivir en Bretaña mientras el hijo fue a estudiar a Suiza. Aquí Gobineau aprendió el alemán y tuvo modo de asomarse a las vastas perspectivas que la filología germánica abrió en aquellos años. Ya Federico Schlegel en su Ueber die Sprache und Weisheit der Inder enseñó la afinidad entre las lenguas europeas y el sánscrito planteando una migración aria de Asia a Europa; en 1816, Bopp con su gramática comparada del griego, sánscrito, persa, griego, latino y gótico fundó la filología indoeuropea; por su parte, los hermanos Grimm redescubrieron el Edda y poesía germánica haciendo revivir el antiguo heroísmo y la primordial mitología germánica mientras Kart O. Müller halló en los dorios (Die Dorier, 1824) el alma nórdica de la antigua Grecia. Así, Gobineau tuvo modo que familiarizarse desde la adolescencia con un mundo que la cultura europea iba lentamente asimilado.
En 1834 Gobineau va a París. No es rico, y trata de hacerse paso como escritor y periodista. De sus obras literarias de entonces, Le prisionnier chancheux, Ternote, Mademoiselle Irnois, Les aventures de Nicolas Belavoir, E’Abbaye de Thyphanes, muchas páginas han resistido la usura del tiempo.
Un artículo aparecido en la Revue de deux mondes lo puso en contacto con Alexis de Tocqueville, el famoso autor de La democracia en América, también él de antigua estirpe normanda. Esta amistad les unió toda la vida a pesar de las fuertes diferencias de opinión entre los dos hombres: Tocqueville, el aristócrata que se resigna, y - sea incluso con melancolía - acepta la democracia como una realidad del mundo moderno y Gobineau, el aristócrata que se rebela e identifica la civilización con la obra de una raza de señores.
Fue Tocqueville, nombrado Ministro de Exteriores, quien llamó al amigo como jefe de gabinete. En vísperas del golpe de estado napoleónico Tocqueville dimitió; En cambio Gobineau hizo buen cara al cesarismo que - si bien no le reportaba a la predilecta monarquía feudal - al menos colocaba las esposas a la democracia y al parlamentarismo. Entró en diplomacia y fue como primer secretario a tomar la delegación de Berna. Es en Berna que escribió el Essai sur el inégalité des races humaines, cuyos dos primeros volúmenes aparecieron en el 1853, los segundos en 1855.
El ensayo retoma los movimientos del gran descubrimiento de la unidad indoeuropea, es decir de una gran familia aria extendida desde Islandia hasta la India. La palabra latina pater, el gótico fadar, el griego patér, los sánscritos pitar se revelan como derivaciones de un único vocablo originario. Pero si ha existido una lengua primordial de la que se han ramificado varios lenguajes, también habrá existido un estirpe primordial que - moviendose desde su patria originaria - difundirá este lengua en el vasto espacio existente entre Escandinavia y el Ganges. Es el pueblo que se dio el nombre de ario, término con el que los dominadores se designaban a sí mismos en contraposición a los indígenas de las tierras conquistadas (compara el persa y el sánscrito arya = noble, puro; el griego àristos = el mejor; el latino herus = dueño; el tudesco Ehre = honor).
Es aquí donde se encauza el razonamiento de Gobineau, movilizando a favor de sus tesis los antiguos textos indios nos muestra a estos arios prehistóricos - altos, rubios y con los ojos azules - penetrando en la India, en Persia, en Grecia, en Italia para hacer florecer las grandes civilizaciones antiguas. Con una demostración muy forzada también las civilizaciones egipcia, babilonia y china son explicadas con el recurso de la sangre aria. Cada civilización surge de una conquista aria, de la organización impuesta por una elite de señores nórdicos sobre una masa.
Si comparamos entre si a las tres grandes familias raciales del mundo la superioridad del ario nos aparecerá evidente. El negro de frente huidiza lleva en el cráneo "los índices de energías groseramente potentes". "Si sus facultades intelectuales son mediocres - Gobineau escribe - o hasta nulas, él posee en el deseo… una intensidad a menudo terrible". Consecuentemente, la raza negra es una raza intensamente sensual, radicalmente emotiva, pero falta de voluntad y de claridad organizadora. El amarillo se distingue intensamente del negro. Aquí los rasgos de la cara son endulzados, redondeados, y expresan una vocación a la paciencia, a la resignación, a una tenacidad fanática, pero que él diferencia de la verdadera voluntad creadora. También aquí tenemos que ver a una raza de segundo orden, una especie infinitamente menos vulgar que la negra, pero falta de aquella osadía, de aquella dureza, de aquella cortante, heroica, inteligencia que se expresan en el rostro fino y afilado del ario.
La civilización es pues un legado de sangre y se pierde con el mezcolanza de la sangre. Ésta es la explicación que Gobineau nos ofrece de la tragedia de la historia del mundo.
Su clave es el concepto de la degeneración, en el sentido propio de esta palabra, que se expresa en el alejamiento un género de su tipo originario (los alemanes hablarán de Entnordung, de desnorcización). Los pueblos antiguos han desaparecido porque han perdido su integridad nórdica, e igualmente puede ocurrir a los modernos. "Si el imperio de Darío todavía hubiera podido poner en campo a la batalla de Arbela persas auténticos, a verdaderos arios; si los romanos del basto Impero hubieran tenido un senado y una milicia formadas por elementos raciales iguales a los que existieron al tiempo de los Fabios, su dominación no habría tenido nunca fin."
Pero la suerte que ha arrollado las antiguas culturas también nos amenaza. La democratización de Europa, iniciada con la revolución francesa, representa la revuelta de las masas serviles, con sus valores hedonísticos y pacifistas, contra los ideales heroicos de las aristocracias nórdicas de origen germánico. La igualdad, que un tiempo era sólo un mito, amenaza de convertirse en realidad en el infernal caldero donde lo superior se mezcla con lo inferior y lo que es noble se empantana en lo innoble.
El Essai sur el inégalité des races humaines, si en muchos rasgos aparece hoy envejecido, conserva una sustancial validez. Gobineau tiene el gran mérito de haber afrontado por primera vez el problema de la crisis de la civilización en general, y de la occidental en particular. En un siglo atontado por el mito plebeyo del progreso, él osó proclamar el fatal ocaso de cada cultura y la naturaleza senil y crepuscular de la civilización ciudadana y racionalista. Sin el libro de Gobineau, sin los graves, solemnes golpes que repican en el preludio del Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, y en aquellas páginas en que se contempla la ruina de las civilizaciones, toda la moderna literatura de las crisis de Spengler, a Huizinga, a Evola resulta inimaginable.
Falta valorar la solución que Gobineau ha ofrecido problema de la decadencia de la civilización. A menudo es simplista. El mito ario, queda como indispensable instrumento para la comprensión de la civilización occidental, no se puede explicar mecánicamente el nacimiento de las varias civilizaciones del globo. Gobineau se encarama sobre los espejos para encontrar un origen ario a las civilizaciones egipcia, babilona, chino. Aunque muchos recientes estudios ayudarían a sus tesis (piénsese en la hipótesis de un Heine-Geldern sobre una migración indo-europea de la región póntica a China, o a la comprobación de un elemento ario en el seno a los casitas que invadieron Babilonia y a los hyksos que dominaron Egipto), queda el simplismo de los métodos demostrativos gobinianos. Además, los materiales arqueológicos y filológicos de que él se servirá son completamente inadecuados frente a la masa de los datos de que disponemos hoy (1).
Y sin embargo, la idea de un diferente origen de las razas está demostrada por los estudios más recientes en la materia (Véase Coon. L’origene delle razze, Bombiani 1970), mientras que las estadísticas sobre los cocientes de inteligencia asignan un valor cuantitativo inferior a los negros con respecto de los blancos y a los amarillos. Mientras la civilización blanca arrastra en su movimiento a los pueblos de color, ellos se revelan en su mayor parte imitadores y parásitos, de lo que no hay duda que de que el mestizaje de la humanidad blanca conduciría a un estancamiento, si no a un retroceso. La crisis de las cepas germánicas y anglosajonas, a cuya voluntad e iniciativa se debe el dominio euro-americano sobre el mundo, y que en el tipo blanco representan el elemento más puro, es seguro la más dramática situación desde los principios de la historia.
La gran obra del Ensayo sobre la desigualdad de la razas fue terminada. Pero la cultura francesa no se dio cuenta.
Tocqueville intentó consolar a Gobineau profetizando que este libro sería introducido en Francia desde Alemania: fue en efecto una respuesta a un problema surgido en la cultura alemana, y de ella habría regresado a Francia, desde Alemania: fue en efecto una respuesta a problemas surgidos en la cultura alemana, y en ella habría sido discutida. De Berna, Gobineau pasó a Fráncfort, luego - como ministro plenipotenciario - a Teherán, Atenas, Rio de Janeiro y Estocolmo. El tiempo que estuvo en Persia le permitió dedicarse a sus predilectos estudios orientalísticos. El Traité des écritures cuneiformes, La Historie des Perses, Réligions et philosophie dans l’Asia centrale. También escribió las Nouvelles Asiatiques y, siempre en literatura, la novela Adelaida, el poema Amadis, el fresco histórico sobre La Renassance y la que es quizás su novela mejor lograda: Les Pleiades.
La guerra franco-prusiana le sorprende en el castillo de Trye que formaba parte del antiguo dominio de Ottar Jara y que él adquirió. No se hacía graciosas ilusiones (un biógrafo suyo cuenta: "El canto de la Marsellesa, los gritos: a Berlín!, repugnaron a su naturaleza. No le dio el nombre de patriotismo a esas sobreexcitaciones peligrosas, demasiado ayuntamientos con las razas latinas. Donde divisó síntomas funestos"), pero en su calidad de alcalde organizó la resistencia civil contra el invasor. Sobrevenidos los prusianos, se comporta con gran dignidad y, aunque se valiera de la lengua alemana como la suya propia, nunca quiso hablar con ellos otra que el francés.
El desastre del los años 70 y la suspensión de su candidatura a la Academia de Francia le disgustaron completamente. La misión a Estocolmo, en aquella Escandinavia que quiso como a una segunda patria, le fue de algún consuelo, hasta que en el 1877 fue jubilado anticipadamente. Para Gobineau transcurrieron los últimos años de su vida entre Francia e Italia. En Venecia conoció a Richard Wagner el cual dijo de él: "Gobineau es mi único contemporáneo". Un reconocimiento basado en una recíproca afinidad. Ambos advirtieron el atractivo romántico de los orígenes primordiales: los tonos profundos que se vislumbran en los abismos del caudal de El oro del Rin son los mismos que repican en el Essai sur el inégalité des races humaines. Fue Wagner quien presentó a Gobineau al profesor Schemann de Freiburg, el cual fundaría el Gobineau-Archiv.
Gobineau murió de repente en Turín en el octubre de 1882. Nadie pareció darse cuenta de su desaparición. Fue universalmente admirado como un hombre de espíritu y como brillante conversador. Años después, fue cuando en la universidad comenzaron a haber cursos sobre de él, Anatole France dijo: " Je el ai connu. El venait chez el princesse Matilde. Ello était un grand diable, parfaitement simple et très spirituel. On savait qu'il écrivait des livres, maíz personne de ello les avait lus. ¿Alors, el avait du génie? Comme c’est curieux."
Fueron los alemanes los que lo valorizaron. Wagner le abrió las columnas del Bayreuther Blätter: ahora el wagneriano Hans von Wolzogen, Ludwig Schemann, Houston Stewart Chamberlain anunciaron su obra. Fue Ludwig Schemann quien fundó el culto a Gobineau instituyendo un archivo cerca de la universidad de Estrasburgo, entonces alemana. En el 1896 Schemann fundó el Gobineau-Vereinigung que difundiría el gobinismo en toda Alemania. En el 1914 pudo contar con una red influyente de protectores y amistades; el Kaiser mismo la subvencionó y buena parte del cuerpo enseñante fue influido por sus ideas.
Sobre la estela de la obra de Gobineau nació el racismo: Vacher de Lapouge, Penka, Pösche, Wilser, Woltmann, H. S. Chamberlain y luego - después de la guerra - Rosenberg, Hans F. K. Günther, Clauss retomaron las intuiciones gobinianas y las amplificaron en un vasto organismo doctrinal. En el 1933 el Nacionalsocialismo - asumiendo el poder en Alemania - reconoció oficialmente la ideología de la raza. Se realizó así lo que Wittgenstein había profetizado a Gobineau: "Vos os decís un hombre del pasado, pero en realidad sois un hombre del futuro."
El batalla de Gobineau no fue en vano. Él escribió: "Quand la vie n'est pas un bataille, ell n'est rien."
--------------------
Las citas aquí indicadas están sacadas del primer libro del Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, Ediciones de Ar, Padua 1964.
(1) Una exposición moderna de las migraciones arias y su importancia para la civilización he tratado de exponerla en mi "Introduzzione al problema indoeuropeo" en el prólogo al libro de Hans F. K. Günther, Religiosità indoeuropea, Edizioni de Ar, Padua 1970. A ella me remito para quién de este ensayo sobre Gobineau le llevara el deseo de conocer los puntos de vista más recientes en arqueología, filología y antropología.
00:15 Publié dans Histoire, Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 février 2008
Sur Gustave Ratzenhofer (1842-1904)
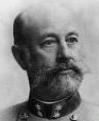
Robert STEUCKERS :
Sur Gustave RATZENHOFER (1842-1904)
Né à Vienne le 4 juillet 1842, le sociologue et Maréchal des armées impériales autrichiennes Gustav Ratzenhofer fut l'exemple même du self-made-man. Fils d'horloger, orphelin très tôt, Ratzenhofer devient cadet dès l'âge de seize ans, en 1859. Sa volonté, son entêtement opiniâtre, ont triomphé des barrières sociales strictement hiérarchisées de l'Autriche-Hongrie du XIXième. L'œuvre de Ratzenhofer est un reflet de cette lutte constante qu'il mène, lui, le fils d'horloger, pour s'imposer aux aristocrates de l'état-major et de la bonne société viennoise. Il gravira tous les échelons de la hiérarchie militaire et terminera sa carrière comme président du tribunal militaire suprême de Vienne en 1898 et comme Feldmarschall-Leutnant en 1901, année de sa retraite. Les idées et les notions sociologiques défilent dans ses livres comme des troupes à la parade et s'imposent au lecteur comme les ordres indiscutables d'un commandeur à ses troupes. Sa philosophie politique et sa sociologie font irruption dans l'histoire des idées comme un retour du romantisme politique de Fichte et de Schelling, mais sous les auspices d'une autre méthode, en l'occurrence la méthode biologique, en vogue depuis l'émergence des écoles darwiniennes. Chez Ratzenhofer, en effet, la méthode dialectique fait place à la méthode biologique.
Après avoir entamé une carrière d'écrivain militaire, Ratzenhofer se tourne vers la sociologie et la philosophie politique, armé des théories positivistes de Comte, Mill et Spencer et des idées de Ludwig Gumplowicz sur la lutte des races. Son premier ouvrage, Wesen und Zweck der Politik, als Teil der Soziologie und Grundlage der Staatswissenschaften (Essence et but de la politique en tant qu'élément de la sociologie et assise des sciences politiques), paru en trois volumes à Leipzig en 1893, est d'inspiration résolument comtienne, à la différence que, pour Comte, la philosophie positive débouche sur la sociologie, tandis que la Weltanschauung de Ratzenhofer, elle, se base sur la sociologie. Partant de la formule héraclitéenne polemos pathr pantwn, Ratzenhofer déduit que l'inimitié absolue est la force motrice primordiale de la politique. L'histoire humaine n'est pas seulement un cas spécial de l'histoire naturelle générale. L'homme est un élément de la nature globale: il n'est donc pas seulement soumis aux lois générales de la nature dans ses mécanismes et ses chimismes mais aussi dans son vécu intérieur, dans son psychisme.
Autre perspective développée par l'œuvre politique et sociologique de Ratzenhofer: l'évolution des divers types d'associations humaines. Une évolution réduite, par la méthode biologisante de Ratzenhofer, aux dimensions physiques, chimiques et biologiques des pulsions de l'âme humaine. Deux pulsions principales animent les hommes, les poussent à l'action: l'auto-conservation, soit la concurrence entre les sociétés pour les denrées alimentaires (Brotneid), et le sexe, pierre angulaire des liens de consanguinité (Blutliebe). Dans le monde des hordes primitives, le conflit, la règle de l'hostilité absolue, sont l'essence des relations entre les hordes. A l'intérieur d'une horde particulière, l'hostilité absolue est tempérée par les liens de consanguinité. L'Etat survient quand il y a conquête d'un territoire et de sa population par une ethnie forte: les vaincus sont réduits en esclavage et contraints d'exécuter les travaux de la sphère économique. La multiplication des contacts entre sociétés, favorisée par le commerce, atténue la rigueur des ordres sociaux nés des conquêtes violentes: c'est la civilisation.
Essence et objectif de la politique en tant que partie de la sociologie et fondement des sciences de l'Etat
Wesen und Zweck der Politik, als Theil der Sociologie und Grundlage der Staatswissenschaften, 3 vol., 1893
Cet ouvrage en trois volumes débute par une définition des fondements sociologiques de la politique. Les rassemblements humains commencent au niveau de la horde; ensuite, vient le stade la communauté, fermée sur le monde extérieur mais où l'on repère déjà les gentes et les clivages entre dominants et dominés. Le stade suivant est celui de l'Etat, porté par le peuple (Volk), ouvert par nécessité sur le monde —et par nécessité seulement— et organisé par un gouvernement, expression de la personnalité sociale. Le stade ultime, venant immédiatement après celui de l'Etat, est le stade du Kulturkreis, de l'aire culturelle, laquelle est hypercomplexifiée et présente des ramifications sociales multiples. La lutte sociale est le produit du contact entre la société et les éléments qui lui sont étrangers. La vie sociale conduit à une différenciation continue des individualités sociales.
D'où Ratzenhofer déduit les lois essentielles de la sociologie: les sociétés politiques structurées tempèrent la lutte sociale mais cette temporisation n'est pas éternelle; les structures temporisatrices finissent pas s'essouffler et pas se révéler caduques. Elles doivent alors faire place à de nouvelles structures, mieux adaptées aux nécessités que la société doit affronter. Ensuite, Ratzenhofer constate que les Etats en phase de croissance cherchent l'adéquation de leurs institutions politiques avec les exigences de la société qu'ils policent. Les Etats en déclin sont ceux qui subissent le choc d'éléments culturels nouveaux, c'est-à-dire les Etats dont les structures sont progressivement disloquées par le choc de l'innovation et doivent céder le terrain à de nouvelles individualités politiques, mieux adaptées aux nécessités. Toutes les expressions de la vie sociale doivent conduire à des actes politiques. De ce fait, la sphère politique peut et doit tirer profit des développements de la science sociologique. Une bonne connaissance des rythmes et des diversités de la société conduit les serviteurs de l'Etat à adapter et à moderniser continuellement les structures politiques et à assurer de la sorte leur durée.
Ratzenhofer affirme ensuite que les lois de la société sont les mêmes que celles de la nature. Ainsi, le concept de politique équivaut à la Lebensklugheit, c'est-à-dire l'intelligence intuitive des lois de la vie qui perçoit sans détours les nécessités politiques et opère sans cesse un recours sans illusion à l'environnement naturel. Cette Lebensklugheit, ajoute Ratzenhofer, est le fait de l'homme libre, non de celui qui est contraint d'obéir pour survivre. L'égoïsme, dans la sphère du politique, est égoïsme collectif car l'homme politique véritable est celui qui est capable de mettre sa propre Lebensklugheit au service d'une instance collective, poussé par l'impératif éthique.
La célèbre loi de l'hostilité absolue, pierre angulaire du système sociologique de Ratzenhofer, nous révèle que les pulsions égoïstes, individuelles ou collectives, sont les moteurs des mouvements sociaux. Egoïsmes moteurs qui contredisent les théories eudémonistes du social car l'action politique, aux yeux de Ratzenhofer et de son inspirateur Ludwig Gumplowicz, n'est pas de dévoiler le sublime qu'il y a dans l'homme mais de mesurer très objectivement les forces, les dynamismes qui agissent dans le tissu social. Ces forces, ces pulsions sont la source de la puissance politique d'une nation. L'objectif du politique, c'est de les harmoniser et de les canaliser dans le sens de l'idée motrice, du mythe mobilisateur qui fait la personnalité politique de la nation. Il faut donc comprendre les pulsions des hommes, puis les classer selon qu'elles appartiennent à telle ou telle «personnalité politique». Faire de la politique, c'est mobiliser les pulsions et prévoir les conséquences d'une mobilisation circonstantielle de telle ou telle pulsion. L'énergie de la volonté donne son plein rendement aux pulsions politiques et les poussent vers la créativité.
L'objectif réel de toute lutte politique c'est l'acquisition d'espace. Pour Ratzenhofer comme pour Ratzel, le but des conflits politiques, c'est de conquérir de l'espace (Raumgewinn) ou d'acquérir des moyens pour mettre son espace propre en valeur (esclaves, avantages commerciaux, etc.). Ensuite, deuxième objectif du conflit: asservir d'autres hommes pour assouvir des besoins (le Dienstbarmachen).
Le droit en politique est facteur de puissance, comme l'a démontré, avant Ratzenhofer, Rudolf von Ihering. Dans cette optique, le droit acquis constitue le socle des pulsions politiques. Le droit en vigueur constitue l'assise sur laquelle se déroule la lutte politique. Il est contesté mais détermine les règles d'action des antagonistes tout en favorisant, en dernière instance, le pouvoir de ceux qui détiennent l'autorité.
Dans toutes les sociétés, on trouve des principes de progression et des principes de régression. Les forces ou les personnalités politiques jouent sur les deux types de principes pour avancer leurs pions à leur avantage. Les mouvements autonomistes visent la dissolution de certaines structures en place, tandis que les mouvements centralisateurs cherchent à renforcer et à simplifier la puissance politique en place. Ces idées-forces sont en fait des instruments manipulés par des personnalités organisées en corps (ou en corporations). De ce fait, la politique n'est rien d'autre qu'un effet des forces de la nature. Ratzenhofer définit ensuite l'essence de la politique sociale. La société est un tissu d'associations et d'organisations, basées sur les communautés de sang (les groupes de descendants d'un même ancêtre ou des mêmes ancêtres), les communautés locales, les nationalités, les communautés confessionnelles et les Stände (les états).
Cette hétérogénéité conduit à une multitude d'«opérations politico-sociales» contradictoires et antagonistes. Les communistes agissent et s'organisent sur base d'une pulsion humaine très ancienne: donner aux éléments sociaux dépourvus de propriétés et de droits un accès à la propriété et au droit. La noblesse n'a eu de fonction sociale que jusqu'au XIIIième siècle, où elle détenait les fonctions juridiques, exécutives et militaires. Après son rôle a été de moins en moins pertinent, jusqu'à l'inutilité complète; d'où l'aristocratisme militant est stérile, surtout en France. Le grand capital tente de s'emparer de tout le pouvoir. Les classes moyennes sont trop hétérogènes pour pouvoir s'organiser de façon cohérente. Les nationalités, les ethnies, forment des parentés de langue et de mœurs et trouve leur point culminant dans les mouvements pangermaniste, panromaniste et panslaviste. L'Eglise tente de s'emparer d'un maximum de pouvoir dans les Etats modernes. Les Juifs veulent conserver les droits qu'ils ont acquis depuis leur émancipation mais ne forment pas un bloc homogène: ils sont divisés, notamment, entre assimilés et orthodoxes. Le rôle de l'Etat, c'est de contrer les opérations socio-politiques menées par tous ces groupes.
Toute doctrine du politique procède d'une étude psycho-pathologique de l'homme, ce qui n'est pas toujours enthousiasmant. Conclusion: la civilisation consiste en un pouvoir croissant de la société sur les individus. Avec elle, le général triomphe du particulier. Toute éthique repose sur nos devoirs sociaux, sur la maîtrise de nos pulsions individuelles au profit d'un projet collectif. Toute éthique déduite de l'intériorité de l'individue, comme celle de Schopenhauer, est dépourvue de valeur sociale et néglige une dimension essentielle de notre existence. de l'intériorité de l'individualeur sociale et néglige la essentielle de notre existence, c'est-à-dire notre imbrication dans une collectivité. Le postulat kantien («agis toujours de façon à ce que la maxime de ta volonté puisse être en même temps le principe d'une loi générale») correspond pleinement à la volonté ratzenhoferienne d'imbriquer l'éthique dans les réflexes collectifs.
Wesen und Zweck der Politik nous explique également la différence entre civilisation et barbarie. La civilisation est un effet de la production de biens et de valeurs; elle est un développement culturel de l'humanité sous l'influence constante de la politique, qui crée et consomme forces et biens de façon équilibrée. La barbarie a pour caractéristique de consommer de façon effrénée, sans compenser par une production réparatrice. La barbarie est ainsi marquée par le déficit permanent, le gaspillage désordonné des forces. D'où, les objectifs pratiques de la politique «civilisante» sont 1) de limiter le principe d'hostilité absolue en circonscrivant la lutte politique au terrain du droit (but: la paix politique); 2) de favoriser l'égalité de tous devant le droit; 3) d'accorder la liberté par des lois, sous réserve que les individus se soumettent aux nécessités collectives; 4) d'accroître les sources de production de façon à assurer l'avenir de la collectivité; 5) de promouvoir le développement des sciences; 6) de promouvoir le développement des arts, afin de sublimer la nature et ses formes; 7) de laisser se déployer us et coutumes naturels; 8) de laisser se déployer la religiosité intérieure, laquelle exprime des aspects insaisissables de la nature); 9) de promouvoir l'hygiène afin d'allonger l'espérance de vie; 10) de favoriser une conscience éthique, de façon à ce que tous connaissent clairement leurs droits et leurs devoirs.
L'autorité libère les hommes du sort peu enviable que leur laisserait l'hostilité absolue et les pulsions brutes, non bridées. De ce fait, pour Ratzenhofer, l'autorité, c'est la liberté. La politique civilisante doit s'opposer à deux dangers: 1) l'orientalisme ou la barbarie centre-asiatique, contre laquelle la Russie s'érige en rempart. Malheureusement, pense Ratzenhofer, les offensives successives de l'Empire ottoman ont contribué à orientaliser le monde slave et partiellement la Russie; 2) le communisme, dû à la dislocation des structures d'organisations corporatives en France et à la mainmise progressive du grand capital. Le Culturkreis européen doit organiser les Balkans, de façon à les soustraire à l'influence orientale/ottomane. Mais l'hostilité entre les différents peuples européens empêche le progrès de la civilisation et l'organisation rationnelle des sociétés: la France, par exemple, refuse d'appliquer certaines sciences, sous prétexte qu'elles ont été élaborées en Allemagne.
L'essence de la civilisation, c'est d'être un produit du politique, de la lutte contre les égoïsmes spontanés des hommes pour faire triompher les objectifs collectifs. Tout progrès civilisateur dérive d'un succès politique ayant eu pour objet une tâche d'intérêt commun. La civilisation s'oppose à la pulsion négative de vouloir exercer à tout prix le pouvoir (Herrschzucht) et de soumettre la collectivité à ses intérêts propres (que ce soient ceux d'un chef, d'un parti, de confessions, de nationalités, etc.). La civilisation, par ailleurs, a le droit de s'opposer à la barbarie. Elle doit transformer les égoïsmes privés, individuels ou organisés, en forces bénéfiques pour la collectivité. Elle doit affiner les mœurs naturelles et les faire accéder au niveau éthique. La civilisation connait des rythmes sinusoïdaux ascendants et descendants. Les phases de haute conjoncture sont celles où l'hostilité absolue est bien bridée et où les communautés politiques croissent et s'épanouissent. Les phases de basse conjoncture sont celles où les communautés sont détruites et où les privilèges se multiplient, où les pulsions égoïstes refont surface, où les arts et les sciences dégénèrent et où l'économie se fonde sur l'exploitation de tous par tous.
En guise de conclusion, Ratzenhofer la politique en tant qu'élément de la sociologie et assise den gouvernement, expression d'une vitales/socialesse n'a eu d'utilité Par la suite, de langue et de mœurs et s'organisent, en ultime instance, catholiquects insaisissables de la natureen sur le fonctionnement de toutes les sociétésK(Herrschs prône un socialisme qui n'est pas celui des sociaux-démocrates (lequel est en fait un individualisme des masses déracinées) mais une force politique agissant sur les forces sociales qui développent la société et créent la civilisation. Les individualismes de toutes natures, privés ou collectifs, disloquent la société.
Ethique positive. Réalisation du devoir-être éthique
Positive Ethik. Verwirklichung des Sittlich-Seinsollenden, 1901
L'objet de cet ouvrage est d'ancrer le devoir-être éthique dans la pratique socio-politique. L'homme, explique Ratzenhofer, dispose d'atouts que n'ont pas les animaux: le langage, l'utilisation d'outils, la maîtrise du feu, la station verticale, etc. Ces atouts ont avantagé l'homme dans la concurrence qui l'oppose aux animaux. Ce qui a conduit à l'extermination d'espèces concurrentes. Au cours de leur expansion coloniale, les Anglais ont transposé cet état de choses dans les rapports inter-raciaux: ils ont exterminé les Tasmaniens, après avoir quasi éliminé les Indiens d'Amérique du Nord, les Aborigènes d'Australie et les Boshimans. Ce processus est en œuvre depuis longtemps, constate Ratzenhofer, en embrayant sur le discours racisant, propre à son époque: la disparition des primates anthropomorphes et des races dites primitives sont un seul et même mouvement qui aboutira au triomphe de l'«Aryen» qui s'opposera ensuite au Juif.
Cette élimination des espèces concurrentes provoque une distanciation toujours plus accentuée entre l'homme et le monde animal. Car l'homme ne tue pas seulement pour se nourrir immédiatement mais pour dominer la terre. Cette volonté de domination totale, Ratzenhofer la juge négative: elle est ce qu'il appelle l'individualisme. Cet individualisme, ce processus qui vise à s'individuer, est le plus intense chez l'homme; individuellement, l'homme a intérêt à se placer au-dessus de toutes les créatures qui vivent à ses côtés et à se considérer comme le point focal de tous les phénomènes. Et à agir en conséquence. Mais d'où vient cet individualisme délétère? Dans les conditions primitives, les hommes vivent une socialisation de niveau tribal, à l'instar des animaux vivant en groupes. La pulsion naturelle est alors de privilégier le collectif, l'utilité collective plutôt que la pulsion individuelle. La conscience naturelle, au départ, est collective, tant chez les hommes que chez les animaux. Elle est facteur d'ordre, de stabilité (exemple: les fourmis).
Cette pulsion primitive naturelle grégaire s'estompe chez les prédateurs: l'intérêt physiologique acquiert plus de poids que la pulsion grégaire (par exemple chez les félins), qui, elle, décline. Chez l'homme, les progrès de la culture ébranlent la conscience grégaire au profit des intérêts physiologiques individuels, ce qui conduit à l'égoïsme et au désir pathologique de dominer les autres. Comment s'amorce le processus individualisant chez l'homme préalablement grégarisé, vivant en horde? Des incitations extérieures de diverses natures font que les individualités douées s'aperçoivent qu'il y a moyen de bien vivre en dehors du cadre restreint de la horde primitive.
Ce processus, essentiellement favorisé par l'attrait du lointain, amorce le développement intellectuel et culturel de l'homme. Le circuit limité des réflexes grégaires, quasi animaux, est rompu. Dès lors, l'homme doué qui crée, provoque, suscite cette rupture offense l'intérêt social de sa communauté, qu'il négligera ou voudra dominer, afin de satisfaire ses aspirations à un «lointain» séduisant. Au stade grégaire, la volonté est quasi nulle; c'est le règne de l'indifférence et de la morale de l'utile (le «bon») et du nuisible (le «mal») à l'échelon de la horde. Quand s'amorce le processus d'individualisation, cette distinction entre le bien/l'utile et la mal/le nuisible se transpose au niveau de l'individu: est bon ce qui va dans le sens de ses aspirations non grégaires; est mauvais ce qui les contrarie. Or toute éthique doit être fondée sur des rapports sociaux concrets et non sur une vérité détachée des relations sociales.
Ratzenhofer observe de ce fait: 1) que l'éthique, au stade de la horde, n'est pas un besoin ressenti; 2) que les individualités émergentes entrent en conflit avec les lois implicites de la horde; 3) que les expériences collectives positives de l'histoire démontrent l'existence d'une éthique de l'utilité collective; l'éthique, quasi inexistante au stade grégaire pur, éclot comme un avertissement permanent de revenir au souci de la collectivité. Tel est le Seinsollende (le devoir-être): une barrière morale nécessaire pour éviter la dislocation puis la disparition et des individualités fortes et des espèces (Gattungen). La culture est constituée de l'ensemble des volontés d'élargir l'horizon, limité au départ à celui de la horde. La Sittlichkeit, la moralité, est la pratique du devoir-être qui ramène sans cesse les esprits à l'intérêt collectif. La conjonction de la Sittlichkeit et de la culture donne la civilisation, dans laquelle sont unis les lois naturelles, l'épanouissement culturel de l'homme et l'éthique du devoir-être. Dans les rythmes sinusoïdaux de la civilisation, le devoir-être est présent dans les phases ascendantes; dans les phases descendantes, au contraire, son impact est de moins en moins évident.
La philosophie morale de Ratzenhofer, qu'il appelle «éthique positive», repose sur une dialectique entre l'individualisation et l'éthique. Le propre des races supérieures, c'est de réussir à faire triompher l'éthique de l'intérêt social qui se déploie sous divers oripeaux: militaire, religieux, scientifique.
Pour Ratzenhofer, il n'y a plus de peuples plongés dans la grégarité originelle. Tous subissent, à un degré ou à un autre, le processus d'individualisation. Si le processus d'individualisation culturante est freiné par des circonstances d'ordre spatial, ou intellectuel ou transcandental, il se mue en un processus vicié d'individualisation égoïste, sans que l'impératif éthique ne puisse agir en tant que correctif. Ces sociétés demeurent alors prisonnières de leurs égoïsmes jusqu'au moment où un puissant agent extérieur provoque l'éclosion d'un processus d'«éthicisation». Certains peuples déploient leurs énergies dans le monde grâce aux efforts de personnalités égoïstes et conquérantes. Celles-ci peuvent basculer soit dans la civilisation soit dans la barbarie. Le mélange racial peut être un facteur dynamisant ou un facteur de déliquescence (comme en Autriche où se mêlent toutes les races européennes, affirme Ratzenhofer). En Grande-Bretagne, les éléments du mixage racial étaient proches les uns des autres (Angles, Saxonx, Scandinaves - Ratzenhofer omet de mentionner l'élément celtique, pourtant très différent) et l'insularité a provoqué une endogamie positive, prélude à l'éclosion d'un profil éthico-politique bien distinct.
La civilisation, ajoute Ratzenhofer, signifie une lutte constante pour imposer un devoir-être éthique conforme à une race donnée (artgemäß). Le processus de civilisation passe par une promotion des connaissances scientifiques, de la religiosité intérieure, en tant que propension à satisfaire les impératifs collectifs (que ceux-ci dérivent de confession ou de la philosophie moderne moniste), par un développement des corpus juridiques, dont l'effort est civilisateur parce qu'il régule des rapports conflictuels d'ordre politique ou économique. Le processus de civilisation passe enfin par une élimination des inégalités en matières de droit et de propriété, par l'élévation spirituelle, intellectuelle, morale et physique de la race. La civilisation, ajoute Ratzenhofer, aide les meilleurs à détenir l'autorité.
Le développement de l'intellect favorise l'«éthicisation» avec l'appui des institutions de l'Etat. Le déploiement de l'éthique ne tue pas l'individualité collective, l'individualité du peuple, mais la renforce dans la lutte générale qu'est la vie.
Enfin, l'«éthique positive», que préconise Ratzenhofer, n'est pas celle, égoïste, de Nietzsche, qui dissocie l'individu de son peuple. Elle n'est pas non plus celle de Marx, dont le socialisme est «individualisme des masses» et favorise l'«animalité qui gît dans les masses». Elle n'est pas celle du christianisme qui transforme le peuple, personnalité politique, en «un troupeau de faibles». Le processus d'individualisation doit viser le bien commun. Si tel est le cas, nous avons affaire, dit Ratzenhofer, à un positivisme moniste, où les héros éthiques rendent les masses nobles. Les peuples qui vivent ce positivisme moniste sont sûrs de triompher dans la compétition générale entre les peuples du monde.
Parti aux Etats-Unis pour une tournée de conférences, il meurt sur le navire qui le ramène en Europe, le 8 octobre 1904.
- Bibliographie:
A. Ecrits militaires: «Die taktischen Lehren des Krieges 1870-1871» in Streffleurs Österreichische Militärische Zeitschrift, 1872; Unsere Heeresverhältnisse, 1873 (anonyme); Die praktische Übungen der Infanterie und Jägertruppe, 1875, 2ième éd., 1885; Zur Reduktion der kontinentalen Heere, 1875; Feldzüge des Prinzen Eugen, Bd. IV (le quatrième volume de cet ouvrage collectif édité par l'état-major général des armées royales et impériales autrichiennes est entièrement dû à la plume de Ratzenhofer), 1879; Im Donaureich (sous le pseudonyme de Gustav Renehr), vol. I («Zeitgeist und Politik»), 1877, vol. II («Kultur»), 1878; Die Staatswehr. Untersuchung der öffentlichen Militärangelegenheiten, 1881; Truppenführung im Karst Serajewo, 1888; de 1874 à 1901, Ratzenhofer publie plus d'une trentaine d'articles à thèmes militaires dans le Streffleurs Österreichische Militärische Zeitschrift et l'Organ der militärwissenschaftlichen Vereine.
B: Ouvrages sociologiques et philosophiques: Wesen und Zweck der Politik, 3 vol., Leipzig, Brockhaus, 1893; Soziologische Erkenntnis, ebenda, 1898; Der positive Monismus, ebenda, 1899; Positive Ethik, 1901; Kritik des Intellekts, 1902; à partir de 1900, Ratzenhofer publie de nombreux articles dans les revues viennoises Die Wage, N.Fr. Presse, Politische-anthropologische Revue (cette dernière étant éditée par Woltmann); Die Probleme der Soziologie, discours prononcé à Saint Louis (USA) en septembre 1904; éd. américaine: «The Problems of Sociology», in Vol. 5, pp. 815-824, International Congress of Arts and Science, St. Louis, 1904, édité par Howard J. Rogers, Boston. Le même texte paraît dans American Journal of Sociology, Vol. 10, pp. 177-188; quelques-uns des nombreux manuscrits laissés à sa mort ont été publiés sous le titre de Soziologie: Positive Lehre von den menschlichen Wechselbeziehungen, Leipzig, Brockhaus, 1907.
- Sur Ratzenhofer:
Ludwig Stein, «Gustav Ratzenhofer» in Anton Bettelheim (Hrsg.), Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog, IX. Band, 1904, Berlin, Duncker & Humblot, 1906; Otto Gramzow, Gustav Ratzenhofer und seine Philosophie, Berlin, Schildberger, 1904; Albion W. Small, General Sociology: An Exposition of the Main Development in Sociological Theory from Spencer to Ratzenhofer, University of Chicago Press, 1905; Albion W. Small, «Ratzenhofer's Sociology», American Journal of Sociology, vol. 13, pp. 433-438; Floyd N. House, «Gustav Ratzenhofer», in David L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 13, The Macmillan Company & The Free Press, 1968.
(Robert Steuckers).
00:10 Publié dans Biographie, Défense, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 22 février 2008
Robin George Collingwood
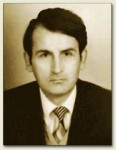
Le philosophe a dès lors pour tâche première de se replonger dans les événements des époques où ont émergé les idées, afin de bien saisir les dynamiques à l’œuvre dans les cultures et les civilisations. C’est par conséquent par une empathie de ce type que l’on peut dépasser les approches trop intellectualistes de l’histoire. Aujourd’hui, toute relecture de Collingwood —que l’on effectuera peut-être en parallèle avec la relecture récente de Merleau-Ponty par Myriam Revault d’Allones— implique une critique des poncifs a-historiques qu’assènent les médias et les propagandes, qui visent à distraire les Européens actuels des véritables enjeux géopolitiques de la planète —la géopolitique en général étant, elle aussi, une investigation empathique de l’histoire et, plus précisément, de l’histoire de la conquête et de la maîtrise des espaces terrestres (Robert Steuckers).
00:50 Publié dans Biographie, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 février 2008
Ernst Troeltsch
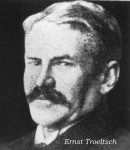
17 février 1865: Naissance à Haunstetten d’Ernst Troeltsch, philosophe allemand de l’histoire. Formé dans plusieurs disciplines, il a connu une carrière universitaire brillante. L’importance de son œuvre réside dans l’attention aiguë qu’il a portée sur le renouveau religieux en Allemagne dès les dernières décennies du 19ième siècle. Ce renouveau religieux se manifestait en dehors des cadres ecclésiaux et des théologies officielles, comme l’atteste le succès des idées de l’orientaliste Paul de Lagarde, auquel Troeltsch a maintes fois rendu hommage. Ensuite, après 1918, Troeltsch a mis ses compatriotes en garde contre les dangers croissants d’américanisation, surtout que celle-ci, en tant qu’expression de la modernité (ou de l’ultra-modernité), ne jaillissait pas de l’humus allemand mais n’était qu’une transposition plaquée sur une réalité non préparée à cette greffe.
00:30 Publié dans Biographie, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 février 2008
Armin Mohler ou l'image comme argument
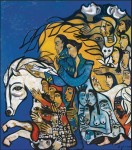
Hommages à Armin Mohler pour ses 80 ans
L'image comme argument
Quand on entre chez Armin Mohler, dans son appartement munichois, on suit d'abord un long corridor sombre. Au début de ce couloir, près de l'entrée, se dresse une commode, avec, en face d'elle, un grand miroir. Puis, on suit une rangée de bibliothèques énormes et très larges, s'élevant jusqu'au plafond, qui rendent ce corridor plus étroit. Une ou deux heures plus tard, on se trouvera en face d'elles, avec le maître du logis, pour s'entendre dire que celle-ci contient les ouvrages sur les réalistes russes, celles-ci les ouvrages sur les Espagnols, les Scandinaves, les Américains. Ainsi s'alignent plusieurs milliers de superbes volumes consacrés à l'histoire de l'art, la préoccupation majeure de l'autre Mohler, celle que le public politisé et idéologisé ne connaît pas. Car le Mohler que ce public plus militant connaît est avant toute chose l'auteur d'une thèse de doctorat, devenue un ouvrage de référence essentiel, Die Konservative Revolution in Deutschland. Ce livre, aujourd'hui publié en deux volumes avec tous les ajouts cumulés au fil du temps, a permis de forger un concept —celui de “Révolution Conservatrice”— qui est toujours utilisé dans les ouvrages traitant de l'histoire culturelle et politique allemande de ce siècle. Ensuite, ce livre a eu un effet de cristallisation, dans la mesure où il sert de référence à tous les penseurs de la droite.
Cet amateur d'art, ce fabuleux collectionneur de beaux ouvrages, cet homme qui a donné aux intellectuels de droite un fil d'Ariane, se tient debout au milieu de la pièce et appuie son corps massif sur une canne. Plusieurs opérations aux genoux ont fait leur effet. Les cheveux blancs sont peignés en arrière. Visiblement, il s'est préparé pour nous recevoir. A côté de son fauteuil préféré se trouve une liasse de papier et un petit tas de livres. Nous entrons directement dans le vif du sujet. Aucune de nos questions reste sans réponse. Mohler fait venir de nouveaux documents de la pièce voisine. Trois portraits-icônes sont accrochés au mur: Ernst Jünger, Carl Schmitt, Arnold Gehlen. Nous avons une courte conversation sur ces trois géants de la pensée allemande de ce siècle. Ensuite, dans la foulée, Mohler me fait traverser la pièce et frappe du bout de sa canne une autre photographie, accrochée au-dessus du chambranle de la porte, et dit: «Cet homme a eu un grand mérite en prononçant son fameux discours, si bien qu'on peut beaucoup lui pardonner». Je reconnais le visage de Martin Walser.
Penser avec les yeux
Oui, Armin Mohler, figure de proue du néo-conservatisme allemand, a cloué une photographie de Walser au-dessus de sa porte. Car Mohler est un homme qui pense avec les yeux (Er ist ein Augenmensch). Il a étudié l'histoire de l'art et il a écrit beaucoup d'articles sur le cinéma et sur les expositions. Ses livres, au fond, sont truffés d'images; Mohler harponne toujours le concret, raconte des anecdotes afin de déceler, par leur médiation, la tendance dont elles sont un reflet, la courant qui se profile derrière elles, les lignes directrices de leur époque; Mohler rend visibles les modes de comportement. Sa démarche d'esprit est tout le contraire d'une logique de juriste, qui cherche à capter et à figer tout ce qui peut donner lieu à une interprétation logique. Au contraire, les images suggérées et décrites par Mohler visent à révéler immédiatement le noyau fondamental de ce qu'il veut nous montrer ou nous démontrer.
Mais ces images deviennent floues sur leurs bords, elles semblent fuir, se fondre dans le fond-de-monde. C'est l'évidence. Il ne faut pas le répéter sans cesse. Armin Mohler ne se défend jamais contre ceux qui ne veulent pas le comprendre. Il se moque d'eux, tout simplement.
Pourtant Mohler aime les véritables joutes intellectuelles, celles où l'on prend son adversaire au sérieux, où on le considère comme honnête, comme un partenaire qui s'efforcera, sans céder sur l'essentiel de ses positions, d'arriver à une analyse commune avec vous, au départ d'idées pourtant divergentes, un adversaire qui tentera de forger une approche commune ou d'atteindre simplement la vérité dans la discussion, même s'il croit à des paramètres politiques complètement différents des vôtres. La liste des orateurs que Mohler avait choisis jadis, quand il était directeur de la Fondation Siemens, prouve ce goût prononcé pour les polémiques fructueuses. Ainsi, Bernard Willms est monté à cette tribune d'abord comme jeune homme de gauche, puis comme homme mûr de droite. Dans tous les débats de la Fondation Siemens (et dans les autres!), Mohler est toujours resté fidèle à sa méthode, c'est-à-dire la méthode des images. Pour lui, il ne s'agit pas de terrasser ou de surplomber ou de déchirer l'image que suggère un adversaire, ni même de faire dévier la discussion vers le flou infini qui entoure l'image, car alors le débat chavirerait dans un flot non maîtrisable de définitions chaotiques et les adversaires sortiraient tous vainqueurs sans avoir rien réglé ni décidé ni tranché. Armin Mohler cultivait un plaisir vraiment agonal quand il pouvait suggérer une plus belle image que celle de son adversaire.
◊ ◊ ◊
Cette scène est tiré d'un débat où Mohler a participé:
«Monsieur Mohler, vous dites que l'homme ne trouvera le sens que s'il a une conscience nationale. Pourquoi cela serait-il vrai?».
«Parce que nous le disons. Une telle idée, on la pose. Je ne peux pas vous expliciter ses fondements par la logique. Dans ce sens, je n'ai pas de théorie. Je pose une image et les gens doivent l'accepter ou non. S'ils ne l'aiment pas, eh bien, c'est simple, ils ne l'aiment pas. C'est dommage pour moi».
«Donc vous posez simplement une image et vous pensez que les gens n'ont pas besoin d'explications?».
«Exactement. Par l'éducation, que vous avez reçue, vous pensez évidemment que l'on doit, quelque part, trouver une explication logique. Mais moi, je ne peux pas vous donner d'explication logique. Il existe très certainement des gens qui pourront vous en donner. Mais ceux qui pensent comme moi ne peuvent pas faire grand chose de ces explications logiques. Nous disons: “cela ne doit pas être fondé (logiquement)”, nous le savons. C'est cela le perspectivisme. C'est MA perspective et j'essaie de la rendre accessible aux gens par des images. Souvent aussi par des arguments…».
◊ ◊ ◊
Armin Mohler ouvre tout à coup son armoire à verres, en extrait quelques gros classeurs et les étalent sur la table. Ils contiennent sa correspondance avec Ernst Jünger, le Maître. Une correspondance privée. Impubliée jusqu'ici. Une véritable mine de renseignements. On a envie de rester assis dans ce sofa très bas, presque à ras du sol, de commencer à lire sans s'arrêter: les lettres de Jünger débutent par la formule “Lieber Sekretarius”. Chaque fois, la réponse, sur copie carbone, est accrochée à la lettre initiale. Mais on n'a pas le temps de les lire. Mohler apporte les livres où signent tous les hôtes de la maison. La première mention est d'Ernst Jünger. Il est vrai que c'est par lui que tout a commencé. Le disciple Armin Mohler, rappelons-le, souffrait, dans sa Suisse en paix, d'une “sous-alimentation monumentale” et, sur fond de cette ambiance morose, tout à coup, l'Allemagne attaque l'Union Soviétique; un sentiment indéfinissable s'empare du jeune Mohler et met rapidement un point final à ses agissements d'intellectuel de gauche, aimant les arts et les beaux esprits. Maintenant, c'est le moment décisif. Mohler avale d'un seul trait le Travailleur de Jünger. Ce fut une lecture existentielle. L'ouvrage met un homme jeune sur les rails qu'il n'abandonnera jamais plus. Après cette lecture, tout sera différent. Mohler n'a jamais été au front. Il a étudié à Berlin. Pendant des semaines de travail, il a retranscrit à la main les essais de Jünger, au temps où il était militant nationaliste et national-révolutionnaire. Il est devenu ainsi le meilleur connaisseur du Maître. Plus tard, le souvenir de cet engouement pour le Travailleur et pour les écrits nationaux-révolutionnaires d'Ernst Jünger, servira de noyau à la critique acerbe que Mohler adressera au Maître quand celui-ci commencera à réécrire et à réadapter ses œuvres. Pour Mohler, un auteur qui, par ses livres, a bouleversé toute une génération, ne peut agir ainsi. Travailler l'image que l'on veut laisser derrière soi peut paraître insuffisant. Toutefois, Ernst Jünger (et d'autres!) ont eu des lecteurs qui, après avoir fermé ses (leurs) livres, ne se sont pas contenté de réfléchir dans leur fauteuil à côté de leur feu ouvert…
Armin Mohler a fêté ses 80 ans le 12 avril 2000.
Götz KUBITSCHEK.
(article tiré de Junge Freiheit, n°15/2000; http://www.jungefreiheit.de ; G. Kubitschek participera à l'ouvrage d'hommages à Armin Mohler qui paraîtra sous le titre Lauter Dritter Wege, Ed. Antaios, Alte Frankfurter Straße 59, D-61.118 Bad Vilbel).
00:10 Publié dans Hommages, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 février 2008
Bruce Begout: extrait de "Pensées privées"
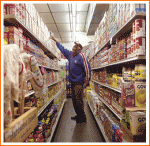
" Alors que la société occidentale a subi au cours des cinquante dernières années une érosion de ses traditions nationales et de ses rites sociaux, que ses classes sociales se sont fortement modifiées, perdant pour beaucoup d’entre elles leur habitus historiques et leurs principales coutumes, l’industrie de la culture a su proposer de nouveaux repères. Dans un monde social et urbain livré à la mutation permanente, à la décomposition et à la recomposition provisoires de toutes les valeurs qui lui servent d’assises, la société de consommation œuvre à la stabilité.
Elle crée une certaine inertie rassurante et répond à la demande sociale d’une cohérence continuée. Pour ce faire, elle constitue des points d’ancrage, des bornes d’identification : logo, marques, slogans, fidélisation. L’homme qui se trouve pris dans le tourbillon infernal de la vie sociale, de la mobilité et de la précarité du monde du travail, de la communication et des échanges urbains, éprouve un certain réconfort dans la standardisation des biens culturels et de consommation. Dépassé par les événements, il sait néanmoins qu’il retrouvera sa série télévisée chaque lundi soir et qu’il pourra acheter sa marque de yaourts favorite au supermarché, il sait également qu’il pourra ainsi compter sur la société de consommation qui ne le laissera pas tomber. Les marques font ainsi office de repères.
Face aux déficits des habitus sociaux, à l’impossible transmission d’une culture de classe, régionale ou nationale, elles s’engouffrent dans l’espace laissé vacant de l’Imitation et proposent des manières de vivre clefs en main qui soulagent la peur de se réinventer soi-même à chaque instant. Les biens culturels comme les marchandises aident ainsi à produire le Même, de l’itération générale et réconfortante. Aussi tout l’espace de la consommation de masse prend-il de plus en plus l’aspect d’une ritualisation de la vie quotidienne. Ce ne sont plus les mythes, les récits et les formes de vie traditionnelles qui fournissent la répétition nécessaire à la reproduction sociale et à l’entretien continuel de la mémoire. La visite hebdomadaire au centre commercial comme le calendrier des programmes télé pourvoient les hommes en jalons spatio-temporels quotidiens. "
Bruce BEGOUT, Pensées privées. Journal Philosophique, Grenoble, Millon, 2007, p. 196.
00:05 Publié dans Définitions, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 février 2008
J. F. Mattéi: le regard vide
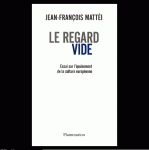
Le regard vide: essai sur l'épuisement de la culture européenne
par Jean-François MATTEI
Ed. Flammarion (2007)
Notre culture classique - les humanités que célèbrent George Steiner, Marc Fumaroli ou Alain Finkielkraut - a toujours été une " figure unique de l'inquiétude dans le courant des civilisations ", selon Jean-François Mattéi. Des plus grands penseurs du siècle passé aux " déclinologues " d'aujourd'hui, tous sont hantés par la possible extinction de la culture européenne. Qu'est-ce donc qui menace de s'éteindre ? L'Europe est certes l'héritière d'Athènes, de Rome, de Jérusalem, de Byzance et de Cordoue. Mais elle est davantage encore, telle est la thèse de cet essai, caractérisée par les modalités du regard qu'elle porte sur le monde, sur la cité et sur l'âme. C'est ce regard théorique et critique (regard se dit theoria en grec) qui a permis la diffusion universelle de sa culture, de Homère à Kundera. Mais, de critique, ce regard est devenu profondément autocritique, comme en témoigne la diatribe de Susan Sontag : " La vérité est que Mozart, Pascal, l'algèbre de Boole, Shakespeare, le régime parlementaire, les églises baroques, Newton, l'émancipation des femmes, Kant, Marx, les ballets de Balanchine, etc., ne rachètent pas ce que cette civilisation particulière a déversé sur le monde. La race blanche est le cancer de l'humanité. " Arborant le relativisme en blason et prônant la repentance, la pensée dominante refuse d'assumer l'identité de sa culture au motif que toute identité est menace. Jetant un regard vide sur leur époque, les intellectuels sont ainsi devenus des " symboles de l'expiation ", selon le mot de Lévi-Strauss à propos des ethnologues. Pour Jean-François Mattéi, la question de l'éminence, voire de la supériorité, de la culture européenne mérite d'être posée : n'est-elle pas la seule à avoir véritablement " regardé " les autres cultures ?
A propos de l'auteur :
Jean-François Mattéi, membre de l'Institut universitaire de France, est professeur émérite de philosophie à l'université de Nice-Sophia Antipolis et à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Il est notamment l'auteur de La Barbarie intérieure (Quadrige, 2004), De l'indignation (La Table ronde, 2005) et L'Enigme de la pensée (Les Paradigmes, 2006).
00:20 Publié dans Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 janvier 2008
Sur Herbert Marcuse
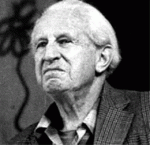
Werner Olles:
Herbert Marcuse, philosophe néo-marxiste de mai 68
Il y a tout juste vingt ans mourrait Herbert Marcuse, le penseur utopiste de la Nouvelle Gauche soixante-huitarde. Werner Olles, ancien agitateur des barricades allemandes à la fin des années 60, fait le point et rappelle l’engouement de sa génération pour Eros et la civilisation et L’Homme unidimensionnel.
Marcuse nous disait : « Je pense qu’il existe pour les minorités opprimées et dominées un droit naturel à la résistance, à utiliser des moyens extra-légaux dès que les moyens légaux s’avèrent insuffisants. La loi et l’ordre sont toujours et partout la loi et l’ordre de ceux que protègent les hiérarchies établies. Il me paraît insensé d’en appeler à l’autorité absolue de cette loi et de cet ordre face à ceux qui souffrent sous cette loi et cet ordre et les combattent, non pas pour en tirer des avantages personnels ou pour assouvir une vengeance personnelle, mais tout simplement parce qu’ils veulent être des hommes. Il n’y a pas d’autre juge au-dessus d’eux sauf les autorités établies, la police et leur propre conscience. Lorsqu’ils font usage de la violence, ils n’amorcent pas un nouvel enchaînement d’actes violents, mais brisent les institutions établies. Comme on pourra les frapper, ils connaissent les risques qu’ils prennent, et quand ils ont la volonté de se révolter, aucun tiers n’est en droit de leur prêcher la modération, encore moins les éducateurs et les intellectuels ».
Ces quelques phrases sur la « tolérance répressive », tirées de sa « Critique de la tolérance pure » ont eu un impact considérable et durable sur le mouvement étudiant de 1968. Dès mai 1966, Herbert Marcuse, professeur de philosophie sociale à l’Université de Californie à San Diego, avait prononcé la conférence principale lors d’un congrès sur la guerre du Vietnam tenu à l’Université de Francfort à l’invitation du SDS (le mouvement des étudiants gauchistes allemands de l’époque). Devant 2200 personnes, Marcuse constatait que « toutes les dimensions de l’existence humaine, qu’elles soient privées ou publiques étaient livrées aux forces sociales dominantes » et que le système ne connaissait plus aucun « facteurs extérieurs ». « La politique intérieure, dont la continuation est la politique extérieure, mobilise et contrôle l’intériorité de l’homme, sa structure pulsionnelle, sa pensée et ses sentiments ; elle contrôle la spontanéité elle-même et, corollaire de cette nature globale et totale du système, l’opposition n’est plus d’abord politique, idéologique, socialiste (…). Ce qui domine, c’est le refus spontané de la jeunesse d’opposition de participer, de jouer le jeu, c’est son dégoût pour le style de vie de la « société du superflu » (…). Seule cette négation pourra s’articuler, seul cet élément négatif sera la base de la solidarité et non pas son but : il est la négation de la négativité totale qui compénètre la « société du superflu ».
Dutschke défendait l’attitude de l’intellectuel
En juillet 1967, Marcuse, devant 3000 personnes entassées dans les auditoires bourrés de la Freie Universität de Berlin-Ouest, prononçait sa série de conférences en quatre volets, « La fin de l’Utopie ». Sans cesse interrompu par les applaudissements des étudiants, le penseur dissident du néo-marxisme explicitait une fois de plus ses positions sur le « problème de la violence dans l’opposition ». Lors de la troisième soirée, une discussion a eu lieu sous la direction du philosophe et théologien Jacob Taubes : y participaient plusieurs membres du SDS, dont Hans-Jürgen Krahl, Rudi Dutschke, Peter Furth et Wolfgang Lefèvre, ainsi que les professeur d’université sociaux-démocrates Richard Löwenthal et Alexander Schwan. Ils engagèrent tous un débat avec Marcuse sur le thème : « Morale et politique dans la société d’abondance ». Lors de la quatrième soirée, Marcuse, Dutschke, Peter Gäng, Bahman Nirumand et Klaus Meschkat ont discuté du « Vietnam : le tiers-monde et l’opposition dans les métropoles ». Ce fut surtout Marcuse qui tenta de donner une explication de cette question en parlant du rôle que pouvaient jouer les intellectuels dans le processus d’éclosion et de consolidation des mouvements de libération dans les métropoles. Pour Marcuse, le rôle des intellectuels consiste à éclairer les masses en révolte en « reliant la théorie et la pratique politique ». Il proclama également la constitution « d’une anti-politique dirigée contre la politique dominante ».
Mais un an plus tard, toujours dans le grand auditoire de l’Université Libre de Berlin, il essuie le refus concentré des étudiants, lorsqu’il prononce sa conférence sur « l’histoire, la transcendance et la mutation sociale » ; il dit clairement aux activistes de la Nouvelle Gauche qu’il ne songe nullement à donner sans détour des conseils pour organiser la révolution ni a y participer. Plus tard, Rudi Dutschke a dit qu’il comprenait l’attitude de Marcuse à l’époque. Il l’a défendu âprement face aux critiques acerbes des étudiants les plus radicaux qui voulaient infléchir le processus révolutionnaire dans une seule dimension, celle, exagérée, de la guerre civile.
Herbert Marcuse, mélange génial de Marxe, Freud et Isaïe, penseur éclectique, subjectiviste et néo-marxiste, figure du père dans la révolution culturelle de 68, est né le 19 juillet 1898 dans une famille de la grande bourgeoisie juive de Berlin. Devenu membre de la SPD sociale-démocrate, il appartenait aux courants vitalistes des jeunes socialistes, proche du mouvement de jeunesse. Après l’assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, il quitte la SPD et adhère à l’USPD (les socialistes indépendants plus radicaux et révolutionnaires). En 1918, il est membre d’un conseil de soldat à Berlin-Reinickendorf. Ensuite, il s’en va étudier à Berlin et à Fribourg, où il passe son doctorat en rédigeant une thèse sur Schiller. A Fribourg, il a été pendant un certain temps l’assistant de Heidegger. Mais les éléments nettement conservateurs de la pensée de Marcuse ne lui viennent pas directement de Heidegger mais d’une lecture très attentive de Hans Freyer, dont l’ouvrage Theorie des gegenwärtigen Zeitalters (= Théorie du temps présent) a fortement imprégné les thèses exposées plus tard dans L’Homme unidimensionnel. Pedro Domo démontre dans Herrschaft und Geschichte. Zur Gesellschaftstheorie Freyers und Marcuses (= Domination et histoire. A propos de la théorie de la société chez Freyer et Marcuse) que l’influence de Freyer s’est exercée sur Marcuse tout au long de sa vie. Même affirmation chez un autre analyste, Wolfgang Trautmann (in : Gegenwart und Zukunft der Industriegesellschaft. Ein Vergleich der soziologischen Theorien Hans Freyers und Herbert Marcuses ; = Présent et avenir de la société industrielle. Comparaison des théories sociologiques de Hans Freyer et de Herbert Marcuse). A cette influence de Freyer dans la composante conservatrice de Marcuse, il faut ajouter le véritable culte qu’il vouait à Schiller, héritage de la vénération que lui vouait le mouvement de jeunesse socialiste au tournant du siècle. Ce culte de Schiller a très vraisemblablement entraîné le mépris quasi féodal de Marcuse pour les sciences, la technique et la démocratie. Kolakowski l’a d’ailleurs décrit comme « le prophète d’un anarchisme romantique sous une forme hyper-irrationnelle ».
En effet, Marcuse propageait un « socialisme des oisifs ». Dans leur recherche d’un sujet révolutionnaire après la fin du marxisme et du progrès, les intellectuels de la classe moyenne aisée et les franges politisées du Lumpenproletariat ont fini par rencontrer cet idéologue de l’obscurantisme, qui constituait une symbiose entre Marx et Freud. En bout de piste, cela a donné l’utopie de la Nouvelle Gauche. Marcuse interprétait toutefois Marx à l’aide de critères pré-marxistes ; il voyait en lui un sociologue et non un économiste scientifique. Ensuite, il voyait en Freud un « adepte sceptique des Lumières ». Ce mélange a produit finalement cette idéologie de 68, caractérisée par le non sérieux relatif de la vie de l’éternel étudiant.
Cohn-Bendit a diffamé Marcuse en l’accusant d’être un agent de la CIA
Herbert Marcuse a quitté l’Allemagne sous la République de Weimar, en 1932, quand les nationaux-socialistes n’avaient pas encore pris le pouvoir. Il émigre aux Etats-Unis. Il y devint conseiller en guerre psychologique à l’Office of Strategic Services (OSS), une organisation militaire qui a préfiguré la CIA. C’est de cette époque que datent les études que l’on appelle « analyse de l’ennemi ». Le passé de Marcuse à l’OSS a induit Daniel Cohn-Bendit, un jour, à diffamer Marcuse, qu’il a accusé à Rome d’être un agent de la CIA, ce qui est objectivement faux.
Plus tard, Marcuse a enseigné la philosophie à l’Université d’Etat en Californie à San Diego. En ce temps-là, il vivait à La Jolla en Californie. A l’âge de 81 ans, le 29 juillet 1979, il meurt à Starnberg en Allemagne, à la suite d’une thrombose. Aujourd’hui, notre intention ne saurait être de récupérer et de redécouvrir Marcuse dans un sens « conservateur-révolutionnaire ». La pensée de ce néo-marxiste a été beaucoup trop influencée par la mystification de la révolution mondiale, même s’il ne plaçait plus aucun espoir dans la classe ouvrière, mais, au contraire, dans les groupes marginalisés de la société, refusant toujours davantage le système.
Ensuite, autre volet de la pensée de Marcuse : il concevait la « société technologique » de plus en plus comme un moyen d’asservir le prolétariat ; celui-ci était de toute façon lié au système capitaliste de la satisfaction et de l’élargissement des besoins. Dans un tel contexte, la position du prolétariat est purement défensive. L’économie, pour Marcuse, est toujours une économie politique qui ne produit jamais une « économie psychologique ». L’économie dominante gère les besoins que réclame le système, jusqu’aux pulsions les plus élémentaires.
Puisque le capitalisme a absorbé le « potentiel révolutionnaire » et que l’ère révolutionnaire du prolétariat est définitivement passée, n’explique pas pourquoi la « théorie critique » et la « praxis politique » n’ont pas coïncidé partout. Pourtant Marcuse voyait dans l’indépendance nationale un facteur positif. Il soutenait la guérilla nationale-communiste au Vietnam, corollaire de sa définition des Etats-Unis comme « héritiers historiques du fascisme ». Aucun immigrant n’avait formulé auparavant une critique aussi acerbe contre la politique américaine. Mais Marcuse n’avalisait pas pour autant la politique soviétique, qui convergeait de plus en plus avec celle des Etats-Unis. Il la qualifia un jour de « honteuse », ce qui lui a valu la haine tenace des gauches fidèles à Moscou. Il était cependant assez réaliste pour reconnaître que la Nouvelle Gauche n’allait jamais devenir un mouvement de masse. Raison pour laquelle il a limité sa thématique aux perspectives pluri-dimensionnelles de la théorie dialectique, visant la suppression de la « société d’abondance », le prise de conscience psychologique et sensitive de la répression dans les métropoles occidentales et de l’oppression flagrante et impérialiste des peuples du tiers-monde.
Par ailleurs, Marcuse prônait l’instauration d’un « pré-censure », qu’il nommait avec euphémisme un « idéal platonicien », et une dictature provisoire de la gauche, qu’il baptisait « éducation » (Erziehung), et qui devait préparer l’avènement d’une « société humaine ». Dans l’existence qui attendait les hommes au sein de cette « société humaine », le rois-philosophes d’inspiration platonicienne devaient veiller sans discontinuité à ce qu’il n’y ait plus jamais de guerre, de cruauté, d’agressivité, de stupidité, de brutalité et de racisme. Dès que cette hydre à têtes multiples se manifestait, les rois-philosophes devaient intervenir et sévir. Ainsi, l’utopie deviendrait possible, elle serait une société véritablement libre. Cette vision marcusienne contredit toutefois à terme son idéal libertaire d’inspiration nietzschéenne, héritée du mouvement de jeunesse. La “pré-censure” et l’“éducation” indiquent une contradiction majeure dans cette pensée subversive de gauche.
Max Horkheimer a reproché à Marcuse de se retrancher derrière le concept « d’homme nouveau ». Horkheimer s’insurgeait avec véhémence contre la domination du principe de plaisir et contre l’idée naïve qu’une société de masse puisse vivre sans aucune contrainte. De la pensée de Marcuse, il restera donc cette dénonciation de la rationalité technologique comme expression de l’arbitraire, tendant vers le totalitarisme. Sa thèse disant que « la technologie livre la grande rationalisation pour la non-liberté de l’homme » est restée actuelle et réelle. Elle exprime clairement les sentiments d’un philosophe qui a vécu et pensé la crise de l’existence humaine comme une crise de la philosophie. Restent également sa critique de la « société unidimensionnelle », de la liberté illusoire (qui risque de chavirer dans « le déluge de scepticisme »). Unidimensionnalité et liberté illusoire ont conduit à des quiproquos philosophiques terribles dont souffrent encore nos sociétés de masses modernes.
Le « grand refus » de Marcuse
Le « grand refus » de Marcuse n’offrait toutefois pas de contre-modèle concret à l’unidimensionnalité du capitalisme tardif. Il n’a pas été capable de générer une conception de la vie, un « oikos » alternatif, susceptible d’offrir à l’individu un éventail de possibilités afin d’échapper ou de résister à « la destruction totale et incessante des besoins de l’homme dans la conscience même de l’homme » (Hans-Jürgen Krahl). Telle a bien été la plus grande faiblesse de cet éclectique qui n’a pas pu se corriger, même dans la lutte collective pour l’émancipation menée par la Nouvelle Gauche (pour laquelle Marcuse a toujours témoigné sa sympathie). La raison de cet enlisement provient de ce que les contradictions quotidiennes du système capitaliste tardif ne se reflètent plus dans la conscience des masses. La subtilité des rapports de domination finit par conditionner la psychologie même des hommes.
Ainsi, la répression assortie de l’accord tacite entre le facteur subjectif et le maintien tel quel de la réalité de classe, dans un système de pouvoir très complexe, anonyme et technocratique, a conduit à l’échec du mouvement de 68.
Werner OLLES.
(texte issu de Junge Freiheit, n°31-32/1999).
00:05 Publié dans Philosophie, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 janvier 2008
Joseph Görres

25 janvier 1776, naissance à Coblence en Rhénanie du philosophe Joseph Görres.
Au début de sa grande carrière de penseur politique et de théologien, il montre un enthousiasme pour la révolution française et pour le “Club des Jacobins” qui sévit dans sa ville natale, bientôt annexée à la “République”. Il part à Paris pour plaider cette annexion de la Rhénanie mais revient dégoûté des mœurs politiques parisiennes.
Görres avait imaginé que la révolution allait avoir un effet bénéfique sur le plan éthique. Elle n’a généré pourtant que corruption et déni de droit et de justice. Pendant la première décennie du 19ième siècle, il se retire, entièrement désillusionné, de la politique et s’adonne aux études philosophiques, pour découvrir la “Naturphilosophie” de Schelling, le renouveau romantique allemand et la pensée mystique médiévale, ce qui l’amène, tout naturellement, à rejeter les principes secs et froids de la pseudo-pensée des “Lumières”.
Dès 1814, il fonde le journal “Rheinischer Merkur”, autour duquel se forme un club politique original, critique à l’endroit des folies révolutionnaires, mais non adepte de la restauration pure et simple. Au nom d’une pensée romantique, organique et mystique, il critique sévèrement cette volonté arbitraire de restauration. Son journal est interdit et il est contraint à l’exil, en Suisse et en Alsace.
Rappelé par le roi de Bavière à Munich, pour une fonction d’enseignant, il y approfondit ses études sur la mystique et sur l’œuvre de Saint François d’Assise. La vie de Görres est donc un itinéraire intéressant, dans la mesure où il prouve que les philosophades des Lumières ne valent que ce qu’elles valent, c’est-à-dire pas grand chose sinon rien, et que le recours à l’essence de l’Europe passe par une redécouverte du patrimoine mystique. Pour en savoir plus, cf.: www.bautz.de
00:25 Publié dans Histoire, Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 23 janvier 2008
Entretien avec Thomas Molnar

Entretien avec Thomas Molnar :
Crise spirituelle, mondialisme et Europe
Q. : Pour vous la disparition du spirituel et du sacré dans notre société a-t-elle pour cause la modernité ?
ThM : Je préfère inverser les termes et dire que la modernité se définit comme la disparition du spirituel et du sacré dans notre société. Il s'agit d'un réseau de pensée qui s'est substitué graduellement —peu importe le moment du débat historique— aux réseaux traditionnels et en a redéfini les termes et la signification.
Q. : Comment l'Eglise universelle peut-elle s'opposer au mondialisme ?
ThM : Elle ne s'y oppose guère sauf dans certains cas et certains moments, et là aussi d'une manière plutôt inefficace. Ayant accepté, avec enthousiasme ou résignation, sa nouvelle position de lobby (depuis Vatican II), l'Eglise s'intègre à la société civile, ses présupposés philosophiques, sa mentalité, sa politique. Un jour, un changement pourra, bien sûr, intervenir, mais pas avant que la structure de la société civile elle-même ne démontre ses propres insuffisances. Donc, le changement ne viendra pas de l'Eglise dont le personnel perd la foi et se bureaucratise. Dans l'avenir prévisible, les grandes initiatives culturelles et spirituelles n'émaneront pas de l'Eglise. Plus ou moins consciente de cette réalité, l'Eglise se rallie en ce moment au mondialisme, religion nouvelle des siècles devant nous.
Q. : S'opposer au modernisme et au mondialisme, n'est-ce pas refuser le progrès ?
ThM : Le mondialisme rétrécit le progrès, il ne s'identifie plus à lui. C'est que la bureaucratie universelle et ses immenses lourdeurs et notoires incompétences bloquent les initiatives dont la source ultime est l'individu, le petit groupe, la continuité, l'indépendance régionale, enfin la souveraineté de l'Etat face aux pressions impérialistes et idéologiques. Aujourd'hui, le "progrès" (terme particulièrement pauvre et ne recouvrant aucune réalité intelligible) s'inverse, la société perd ses assises, l'anarchie règne. Nous allons vers le phalanstère sans âme. Bientôt viendra l'épuisement technologique, car l'élan nécessaire pour toute chose humaine même matérielle, s'amoindrira, s'essoufflera. L'homme désacralisé ne connaît que la routine, assassine de l'âme.
Q. : A vous lire, il semble que le sacré n'est pas divin. Pouvez-vous expliquer cette approche ?
ThM : Le sacré n'est pas divin dans le sens "substantiel" du mot ; il médiatise le divin, il l'active en quelque sorte. D'abord, le sacré change d'une religion à l'autre, il attire et ordonne d'autres groupes humains (Chartres a été bâtie sur un lieu déjà sacré pour les druides, mais ces sacrés superposés n'expriment pas la même "sacralité"). Le sacré nous révèle la présence divine, cependant le lieu, le temps, les objets, les actes sacralisateurs varient.
Q. : Croyez-vous à une régénération du spirituel et du sacré en France et en Europe ?
ThM : Il n'existe pas de technique de régénération spirituelle technique que l'on utilise à volonté. L'Europe vit aujourd'hui à l'ombre des Etats-Unis ; elle importe les idées et les choses dont elle pense avoir besoin. Elle est donc menée par la mode qui est le déchet de la civilisation d'outre-mer. Bref, l'Europe ne croit pas à sa propre identité, et encore moins à ce qui la dépasse : une transcendance ou un telos. "L'unité" européenne n'est qu'un leurre, on joue à l'Amérique, on fait semblant d'être adulte. En réalité, on tourne le dos au passé gréco-chrétien et le plus grotesque de tout, on veut désespérément devenir un "creuset", rêve américain qui agonise déjà là-bas.
Tout cela n'exclut pas la régénération, qui part toujours d'un élan inédit, de la méditation d'un petit groupe. Aussi ne sommes-nous pas capables de le prévoir, de faire des projets, en un mot de décider du choix d'une technique efficace. Sans parler du fait que la structure démocratique neutralise les éventuels grands esprits qui nous sortiraient du marasme. Sur le marché des soi-disant "valeurs", on nous impose la plus chétive, les fausses valeurs qui court-circuitent les meilleures volontés et les talents authentiques. Si le sacré a une chance de resurgir sur le sol européen, le premier signe en sera le NON à l'imitation. Ce que je dis n'est pas nouveau, mais force m'est de constater dans les "deux Europes", Est et Ouest, l'impression du déjà-vu : l'Europe, dans son ensemble c'est Athènes plongée dans la décadence et l'Amérique, nouvelle Rome, mais d'ores et déjà à son déclin. La régénération ne peut être qu'imprévue.
Q. : Sans ce renouveau spirituel, que peut-il se passer en France et Europe ?
A court terme, des possibilités politiques existent, et la France pourrait y apporter sa part. L'Europe qui se prépare sera germanique et anglo-saxonne, la surpuissance de la moitié nord se trouve déjà programmée. Or, c'est la rupture de l'équilibre historique, car la latinitas n'a jamais été à tel point refoulée que de nos jours. La France pourrait donc redevenir l'atelier politico-culturel de la nouvelle Europe, grâce à son esprit et son intelligence des réalités dans leurs profondeurs. Bientôt, l'Europe en aura assez des nouveaux maîtres qui apportent l'esprit de géométrie, la bureaucratie la plus lourde, la mécanisation de l'âme. La France doit être celle qui crie « Halte ! » et, pour cela, pénétrer le continent, porteuse et l'alternative.
(propos recueillis par Xavier CHENESEAU ; celui-ci en détient le © ; pour toute reproduction ou traduction, lui écrire via la rédaction).
Notre invité en quelques livres :
1968 - Sartre, philosophe de la contestation
1970 - La gauche vue d'en face
1972 - La contre révolution
1974 - L'animal politique
1976 - Dieu et la connaissance du réel
1976 - Le socialisme sans visage
1978 - Le modèle défiguré, l'Amérique de Tocqueville à Carter
1982 - Le Dieu immanent
1982 - L'Eclipse du sacré
1990 - L'Europe entre parenthèses
1991 - L'américanologie, le triomphe d'un modèle planétaire ?
1991 - L'hégémonie libérale
1996 - La modernité et ses antidotes
A signaler la parution prochaine, aux Editions l'Age d'Homme, de deux nouveaux ouvrages de Thomas Molnar : Moi, Symmaque et L'âme et la machine.
00:40 Publié dans Entretiens, Philosophie, Politique, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 22 janvier 2008
Sur Ernst Kantorowicz

Stefan PIETSCHMANN :
Ernst Kantorowicz, biographe de Frédéric II de Hohenstaufen
„Vivet et non vivit“ (= Il vit et n’a pas vécu). A la fin de sa monumentale monographie consacrée à Frédéric II, Ernst Kantorowicz a placé cette citation latine, car il était indubitablement animé par une intention mystique : le mythe de l’Empereur Hohenstaufen, figure clef, est rappelé ainsi à la vie, au-delà des siècles, au-delà de la mort physique. Dès la parution de ce maître ouvrage en 1927, Ernst Kantorowicz acquiert d’un coup la célébrité.
Ernst Hartwig Kantorowicz, né en mai 1895 à Posen, est issu d’une vieille famille juive en vue. Après avoir passé son « Abitur » en 1913, il entame des études d’ingénieur commercial à Hambourg, afin de pouvoir, plus tard, gérer l’entreprise familiale, une fabrique de spiritueux. Dès qu’éclate la première guerre mondiale, Kantorowicz se présente comme volontaire au 20ième Régiment d’Artillerie de campagne de Posnanie, où il servira jusqu’à la fin des hostilités. Il revient du combat la poitrine constellée de décorations. En mai 1918, il s’était inscrit à l’Université de Berlin, en faculté de philosophie. C’est dans la capitale qu’il vécut la révolution, ce qui l’amena à retourner dans sa province natale de Posnanie, pour s’engager immédiatement dans un Corps Franc, dont le but était de défendre les revendications allemandes dans cette région de l’Est du Reich. Au cours du printemps 1919, il est engagé contre les Spartakistes à Berlin, et puis, en mai, alors qu’il étudie les sciences économiques, contre la République des Conseils à Munich.
Il déménage ensuite à Heidelberg. Il fait connaissance avec le poète Stefan George et, immédiatement après avoir remis sa thèse de doctorat (sur « L’essence des associations musulmanes d’artisans »), se consacre au thème de sa vie : la figure de l’Empereur Frédéric II de Hohenstaufen.
Indubitablement, il a été amené à ce choix, inspiré par les poèmes de Stefan George. Dans son poème « Rom-Fahrer », George avait averti ses disciples en faisant allusion au destin tragique de l’Empereur Frédéric II et de son petit-fils Konradin. « La grandeur des grandeurs de Frédéric, véritable nostalgie des peuples » est une nouvelle fois évoquée dans le poème « Die Gräber in Speier ». George y rappelle la figure de ce petit-fils de Béatrice de Bourgogne, dont la tombe est à Spire (Speyer) ; elle avait été la seconde épouse de Frédéric Barberousse. George voyait dans le règne de Frédéric II revivre la politique générale des Empereurs germaniques issus de ces premières lignées que furent les Carolingiens, les Ottoniens et les Saliens, une politique générale couplée au sens impérial et romain de l’Etat, à la culture grecque et orientale.
La fin des grands temps
Dans ses « Conversations avec Stefan George », Edith Landmann fait dire au poète ce qu’il ressentait face à la figure de Frédéric II, des Allemands en général. Question d’Edith Landmann : «Vous avez évoqué le passage de la belle ère allemande médiévale à l’époque plus prosaïque de Rudolf von Habsburg… ». Réponse de George : « Ce Rudolf était déjà un roi bourgeois. Avec lui, c’est autre chose. Les grands temps sont passés. C’est insaisissable, ce qui s’est passé là ; pourra-t-on jamais revenir au-delà de cette césure ? La meilleure explication de ce passage me semble celle-ci : à certaines époques, les dieux visitent un pays et quand ils repartent, les hauts temps s’évanouissent ». Le « Frédéric II » d’Ernst Kantorowicz décrit le déclin des Staufen, et fait de cette description une lecture si captivante, qu’elle ne laisse aucun lecteur indifférent. « Quelle impression cela a fait sur les Italiens, la mort de ce bel homme ! Les Allemands, en revanche, lui ont comme tapé sur l’épaule, en lui demandant de restreindre ses élans et en lui disant : tu aurais mieux fait de rester au pays, voilà ce qui arrive quand on ne le fait pas ». « Cette phrase, écrit Edith Landmann, m’est restée gravée dans la mémoire… ».
Stefan George disait de Kantorowicz qu’il était « ce que les Français nomment un ‘Chevalier’ » et, ajoutait-il, « il était si entièrement ‘Chevalier’, qu’on ne s’en apercevait plus ». Homme du monde, très élégant dans le choix de ses vêtements, dans sa gestuelle quotidienne, dans son langage ; il avait tout, dit le germaniste Boehringer, d’un escrimeur, virtuose du fleuret. « Son intelligence, qui avait la faculté de pénétrer profondément en toute matière, se doublait d’une étonnante capacité à percevoir les choses dans leurs interrelations ; c’est sur ces facultés intellectuelles-là que repose sa vision et sa présentation si grandioses et si vivantes de l’histoire ».
Le livre consacré à Frédéric II de Hohenstaufen, Kantorowicz l’a écrit, pour l’essentiel, dans son appartement de Heidelberg, charmante petite ville universitaire où George, lui aussi, tenait ses quartiers à l’époque, du moins pendant quelques étés jusqu’en 1926. Plusieurs passages du livre en témoignent. Stefan George et les frères von Stauffenberg en ont corrigé les épreuves et négocié sa publication auprès des éditeurs.
L’Allemagne secrète à Naples et à Palerme
Le livre contient une sorte de préambule, dont le style et la teneur sont typiques du Cercle de Stefan George : « Lorsqu’en mai 1924, le Royaume d’Italie a célébré le 700ième anniversaire de la fondation de l’Université de Naples, que Frédéric II de Hohenstaufen avait fondée, on a trouvé, au pied du sarcophage de l’Empereur, dans la cathédrale de Palerme, une couronne portant l’inscription suivante : ‘A ses empereurs et héros, l’Allemagne secrète’ (= Das Geheime Deutschland) ». Cette couronne et ce bandeau votif avaient été déposés, selon toute vraisemblance, par des amis de George, qui séjournaient vers Pâques 1924 à Palerme : parmi eux, il y avait Ernst Kantorowicz. Son mérite demeurera, d’avoir ramené au présent la figure sublime de Frédéric II, grâce aux stupéfiantes facultés de son intelligence critique, à la pertinence profonde de son questionnement. L’Etat, construit en Sicile par Frédéric II, fondé et gouverné par le truchement de la Constitution de Melfi, selon les lois de la raison, se référait à l’antiquité, jugée en son temps « païenne ». Ce « paganisme » antique et ce recours à la raison politique contribuèrent à faire de lui, pour ses ennemis, un « hérétique ». Il n’y avait pourtant rien d’autre d’ « hérétique », chez lui, que d’être simplement en avance sur son temps. Quelques siècles plus tard, personne n’aurait parlé de ‘stupor mundi’, en faisant référence à l’œuvre qu’il avait bâtie. Frédéric II nous interpelle, nous et nos contemporains, dans tous les domaines qu’il a touchés, tout simplement parce que sa pensée, sa sensibilité, sa volonté et son action anticipaient les époques qui allaient advenir, après l’ère proprement médiévale.
En décembre 1933, Stefan George meurt à Minusio en Suisse, sur un territoire politiquement neutre, afin d’échapper aux honneurs que n’auraient pas manqué de lui réserver le nouveau régime national-socialiste. La veillée funèbre du poète fut assumée par Ernst Kantorowicz, Claus von Stauffenberg et quelques autres. Il faut rappeler ici que c’est justement Kantorowicz, et non pas seulement Stefan George, qui a conforté les trois frères von Stauffenberg dans la certitude, mythique, qu’ils étaient les descendants des Staufer et donc, possédaient un sang royal.
Les différends d’ordre idéologique avaient pourtant déjà profondément divisé l’ « Etat », c’est-à-dire le Cercle de George, ce que ressentaient tout particulièrement les amis, sympathisants et membres de confession israélite qui étaient restés en Allemagne entre 1936 et 1938. Tout en ressassant ses souvenirs sur ces clivages qui divisaient cruellement le Cercle, Edgar Salin expliqua plus tard à Berlin, en quelques lignes poignantes, les sentiments de Kantorowicz, qui venait, lui, d’émigrer aux Etats-Unis en 1938 : « Il avait été profondément marqué par l’affliction générale qui avait uni dans la douleur tous ceux qui firent partie du Cercle mais avaient été séparés par les circonstances politiques. Mais lorsqu’il se hissa dans le train pour quitter la Suisse, il vit, à une autre fenêtre du wagon, un des ‘amis’ lever le bras à la nouvelle mode qui régnait alors en Allemagne, et deux autres, plus jeunes, répondant à son salut depuis le quai, de la même manière ». Ces deux jeunes hommes étaient ceux qui avaient soigné et aidé George, dans les derniers mois de sa vie, à Minusio.
En novembre 1938, Kantorowicz réussit à quitter l’Allemagne, grâce à son ami le Comte Albrecht von Bernstorff, qui fut assassiné en 1945 dans la prison de Berlin Moabit. En passant d’abord par l’Angleterre, son exil finit par le conduire aux Etats-Unis où il enseigna, dès 1939, à l’Université de Berkeley.
Refus des injonctions maccarthystes
En 1951, une fois de plus, Kantorowicz agit de cette manière chevaleresque, qu’admirait tant chez lui Stefan George : c’était à l’époque où sévissait la commission McCarthy. Comme en Allemagne en 1933, Kantorowicz demeura fidèle à lui-même et refusa de prêter le serment d’allégeance et de loyauté que les Etats-Unis exigeaient des professeurs. Il fut licencié sur le champ.
On est touché de constater combien les traces de la vision politico-mythique de George persistent dans l’œuvre de Kantorowicz, tant d’années après la mort du poète. Kantorowicz est resté fidèle à l’ « Allemagne secrète », à ce Reich de mystères et de mythes. Dans ses derniers ouvrages, il prouve encore qu’il ne cesse de servir ces mythes, d’explorer et d’étayer les concepts éducateurs et pédagogiques préconisés par le Cercle de Stefan George. A partir de l’automne 1951, il travaille à l’ « Institute for Advanced Study » à Princeton. En 1957, le deuxième de ses deux ouvrages majeurs sort de presse, intitulé « The King’s Two Bodies », « Les deux corps du Roi », qui ne fut traduit en allemand qu’en 1991 ! C’est un immense travail synoptique, composé d’innombrables pièces formant, toutes ensemble, une magnifique mosaïque, qui n’est pas toujours aisée à comprendre dans chacun de ses éléments. Tentons de cerner le noyau même de ce maître ouvrage en donnant ses sources principales : le point de départ de la quête de Kantorowicz se situe dans la « doctrine des deux natures » de l’église primitive, où le Christ est à la fois Dieu et homme ; ensuite dans les oeuvres des juristes de Cour anglais de l’époque des Tudor, qui avaient élaboré une « christologie royale » très sophistiquée.
En 1963, Ernst Kantorowicz rejoint Stefan George dans la mort. Il avait été un grand historien juif et allemand et aussi un patriote animé par une foi nationale infaillible.
Stefan PIETSCHMANN.
(article paru dans l’hebdomadaire berlinois « Junge Freiheit », n°30/2000 ; trad. franç. : Robert Steuckers).
01:00 Publié dans Hommages, Philosophie, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




