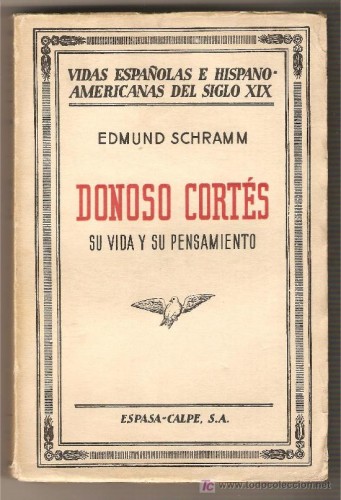Ex: http://eisernekrone.blogspot.com/
Ex: http://eisernekrone.blogspot.com/jeudi, 03 septembre 2009
De la destruction de l'environnement culturel
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
De la destruction de l’environnement culturel
Trois possibilités menancent en cette fin de 20ième siècle, de détruire le monde : la première de ces possibilités est la guerre nucléaire ; ce danger a déjà été perçu dès les années 50 et 60. La deuxième possibilité est la destruction de notre environnement écologique par le pillage des ressources naturelles. Les grandes catastrophes écologiques dans toutes les régions du monde en donnent un avant-goût : rappelons-nous les inondations catastrophiques qui ont frappé la Chine récemment. La troisième possibilité est bien mise en exergue par Gerhard Pfreundschuh dans un livre intitulé Die kulturelle Umwelzerstörung (= La destruction de l’environnement culturel). Cette troisième possibilité se manifeste par la perte des valeurs et l’ingouvernabilité croissante des sociétés, par la domination quantitative de masses écervelées et ensauvagées, par le règne des multiples mafias, par la prolétarisation de larges strates de nos populations, par la surpopulation et les migrations de masse. Pour Pfreundschuh, cette troisième possibilité est toute aussi dangereuse que l’apocalyspe nucléaire ou la pollution généralisée.
La destruction de nos environnements culturels, explique Pfreundschuh, a atteint des proportions inquiétantes et angoissantes. La destruction de nos environnements culturels est bien distincte de la destruction de l’environnement écologique. L’écologie se définit comme le rapport qu’entretient l’homme avec son environnement naturel et physique. La culture se manifeste essentiellement par des rapports ordonnés entre les hommes. On peut définir la culture comme un environnement créé par l’homme lui-même, comme un environnement “spirituel”. La culture implique l’existence d’acquis d’ordre social, économique, juridique et éthique, d’ordres et d’ordonnancements de toutes sortes, des communautés bien définies et profilées.
La destruction de l’environnement écologique aboutit à la mort des forêts, à l’accumulation de substances toxiques dans l’atmosphère et dans l’eau. La destruction de l’environnement culturel conduit à l’accumulation de bidonvilles, de zones de misère indicible dans des villes qui se décomposent par gigantisme, conduit au règne de la criminalité organisée, conduit à la dissolution des liens sociaux et à l’isolement des individus.
Pfreundschuh nous pose une question intéressante : «D’où une communauté humaine tire-t-elle la force de suivre une voie précise, en adéquation avec son temps, d’où tire-t-elle la force de marcher vers l’avenir dans la cohésion ?». Sa réponse est claire : «Une société ne trouve de cohérence pratique et réelle que si elle repose sur une cohérence spirituelle que seule une culture communément partagée peut lui apporter».
Fukuyama, philosophe libéral américain d’origine japonaise, constate : «La nation reste le point central d’identification, même, si dans l’avenir, nous verrons de plus en plus de nations s’organiser de manière identique sur les plans économique et politique». Le philosophe Norbert Elias a aussi pleinement reconnu l’incontournable imbrication culturelle de l’homme : «L’image, aujourd’hui largement répandue, d’un homme seul et isolé de tous, que l’on nous pose comme un être absolument indépendant et détaché de tous les autres hommes, comme un être existant exclusivement pour soi, ne correspond nullement aux faits. L’individu, dans cette optique, n’a pas grand choix. Il naît au sein d’un ordre politique et culturel, au sein d’institutions d’un certain type ; il est conditionné par ces ordres et ces institutions de manière plus ou moins heureuse. Et même s’il estime que ces ordres et institutions sont critiquables ou redondants, il ne peut s’y soustraire par la seule force de sa volonté personnelle, il ne peut réellement effectuer un saut libératoire hors de cet ordre existant. Il peut certes tenter d’y échapper en choisissant la voie de l’aventure, adopter le style du tramp américain (à la Kerouac), opter pour l’art ou pour l’écriture ; il peut même se retirer sur une île déserte : dans sa fuite hors de l’ordre politico-culturel dont il est issu, il restera un produit de cet ordre. Rejeter cet ordre, le fuir, sont néanmoins des expressions du conditionnement qu’il lui impose, tout comme la glorification et la justification de cet ordre.
Même si on ne partage pas la thèse de Pfreundschuh et qu’on n’accepte pas les causes de la destruction de l’environnement culturel qu’il avance, le concept même de “destruction de l’environnement culturel” mérite de mobiliser nos réflexions.
Brigitte SOB.
(article tiré de Zur Zeit, n°37/98; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:09 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture, déclin, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 14 août 2009
Qui est Jean-Claude Michéa?
| Qui est Jean-Claude Michéa ? |
 | |
| « Je me définirais, pour commencer, comme un socialiste, au sens que ce mot avait au début du XIXe siècle, dans les écrits de Pierre Leroux ou du jeune Engels. En d’autres termes, je demeure fidèle au principe d’une société sans classe, fondée sur les valeurs traditionnelles de l’esprit du don et de l’entraide. Je suis par conséquent définitivement opposé à tous ces programmes de modernisation ou de rationalisation de l’existence humaine qui conduisent, sous une forme ou sous une autre, à privilégier le calcul égoïste et les formes antagonistes de la rivalité (car en tant qu’amoureux du sport je pense, bien sûr, qu’il existe aussi des formes positives d’émulation). Je me définirais ensuite – ce n’est naturellement pas incompatible – comme un démocrate radical, c’est-à-dire comme quelqu’un qui pense que la démocratie ne saurait être réduite aux seuls principes du gouvernement représentatif. Ce dernier, en effet, conduit inévitablement à déposséder le peuple de sa souveraineté au profit d’une caste de politiciens professionnels et de prétendus experts. […] Si la démocratie désigne le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, il est évident que les gouvernements représentatifs modernes n’en constituent qu’une version extrêmement appauvrie, voire purement formelle. De ce point de vue, il serait philosophiquement plus juste de les définir comme des "oligarchies libérales", pour reprendre l’expression proposée par Castoriadis. […] Comme l’écrivait Debord, les droits dont nous disposons sont, pour l’essentiel, les droits de l’homme-spectateur. En d’autres termes, nous sommes globalement libres de critiquer le film que le système a décidé de nous projeter, mais nous n’avons strictement aucun droit d’en modifier le scénario, et cela que nous apportions nos voix à un parti de droite ou à un parti de gauche. »
Jean-Claude Michéa, interviewé par A Contretemps n°31, mai 2009 |
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nouvelle gauche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 08 août 2009
The Terror of the Hyperreal

http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Sunic-Communication.html#TS
The Terror of the Hyperreal
Tom Sunic
July 28, 2009
One of the secret lies of liberal democracy is the dogma of free speech. The word 'propaganda' has obtained over the last six decades a nasty flavor; hence the need to use the word 'communication.' However, as much as everybody in modern society craves to communicate, traditional community ties, or in-group ties, are more than ever before subject to the process of disintegration. It is worth recalling that etymologically the terms "community" and "communication" are of the same origin. But how can one communicate if community no longer exists?
To provide a make-believe image of absolute freedom of speech, the media and the modern Prince resort to a hyperbolic language filled with hyperreal metaphors and qualifiers. This is especially true regarding the terms 'democracy' and 'human rights'. These terms have assumed the emotional role in rallying political allegiance formerly reserved for terms evoking nationhood and patriotism. Opinion makers in Europe and America are not so much concerned with the content of their language, but rather with the appropriate packaging of the language and its emotional impact on the masses.
For effective communication a modern politician (or the modern Prince?) is required to use images with a cheerful setting and a happy ending scenario. His looks are important too. An aspiring presidential candidate must be concerned more with his dentures than with his deontology. A well-fitting Armani suit and polished Gucci shoes are far more important than his IQ. The image is essential since it does not encourage reflection, but obliterates all reflection. The hyperreal image on TV screens with all the trappings of wealth, power, and personal appeal is ideal for propagating new political lies and, by extension, for instituting horrendous political censorship.
For a European or American politician who aspires to high office, the ritual of repentance has become de rigueur.
The exception, of course, is President Obama who capitalizes on his Black identity to induce guilt in his audience.
Not long ago Europeans were proud of their colonial exploits. Not long ago the exclusion of the Other (Blacks, Jews, Arabs) was perceived as a normal thing - typical of human societies from time immemorial. Today the exclusion of the Other is replaced by the hatred of oneself. Ceaseless national-masochistic sermons about Euro-American real or surreal crimes bear witness to a quasi-pathological desire to cleanse oneself of a past that evokes guilt rather than pride.
Public language must be "soft" and didactic - conveying a self-deprecating message and requiring the modern Prince to formulate his statements in the conditional tense - or by using evasive sentences starting with adverbs such as "admittedly," "considerably," "presumably," etc. No politician wishes to stick out his neck by using affirmative sentences that would clearly enunciate his value judgments or depict his potential foe. After reading mainstream newspaper editorials, a student of political semiotics is struck with convoluted locutions such as 'one could say, 'one might say,' 'one should consider bombing Iran,' or 'help democracy become transparent in East Timor.' Such vague locutions provide a safe retreat for the liberal ruling class, as they signify nothing and everything at the same time.
Political language must be neutral or neutered; it must reflect the desire for a world of stasis - not of global liberal metastasis. The only exceptions are modern heretics who must endure the most violent epithets. Thus the $PLC, a principal architect and enforcer of modern discourse on race and immigration, likes to use expressions preceded by the noun 'hate,' or followed by the adjective 'extremist': 'hate groups', 'hate speech', 'hate crimes'; 'White extremists,' 'political extremism', etc. Contemporary politicians and their media watchdogs love to compare absolute Evil to absolute Good, using words that are loaded with emotional significance, such as "fascism" vs. "antiracism": the horrors of the Auschwitz on the one hand versus the Hollywood-like fantasy of multicultural conviviality.
Nothing new under the sun, as the old Latins used to say. This idea is well captured by the late Christopher Lasch, the best American visionary and the theorist of narcissistic democracy. He noted a long time ago in his book The True and Only Heaven that "Liberals' obsession with fascism ... leads them to see fascist tendencies or 'proto-fascism' in all opinions unsympathetic to liberalism."
As much as Lasch was right he was also wrong. Today he would be accused of "fascist, revisionist tendencies" by the masters of political discourse - thus giving further credit and credence to the paranoid liberal mind. Historically, both the fascist and communist temptations did not drop from the moon. They were logical responses to the failures of liberalism - to the "democratic deficit" of the liberal experiment. Therefore one must not rule out the revival of the fascist temptation, albeit in a new garb, as a third option in our late postmodenity: If a good man in a village is constantly and publicly called a crook, he will eventually embody those accusations. White nationalism, which is on the rise in the US and the EU, is the logical response to the chaotic policies of the liberal class and its promotion of all ethnic prides world-wide - except for white Europeans.
In postmodernity, political messages are transmitted by visual images and the sound bite - not the written word. Rėgis Debray, the ex-leftist guerrilla who ascended to high office in the French Ministry of Foreign Affairs - and probably the best observer of the perverse nature of liberal democracy, notes that the traditional 'graphosphere' has been completely devoured by the "videosphere." Books and prose are relics; the virtual video message has become omnipresent. It is no accident that a dissident or a violent radical no longer dreams of storming the Prince's palace, but rather contemplates the seizure of the TV tower.
Postmodern political imagery does not reflect the lack of reality, but rather mirrors the excess of reality. Henceforth any political debate on a TV screen is not designed to hide the truth, but ironically, to hide the absence of all truth. Everywhere the media and the modern Prince simulate fictitious events such as terrorist attacks as if they wish to have them happen, while at the same time they try to prevent them from happening. The bogeymen of the left -"hate groups" and "extremists" - appear to be nowhere near the horizon. Yet, as was the case in the ex-Soviet Union, they must be reinvented over and over again in order to provide legitimacy and solid funding to groups like the $PLC who love to dress up in the apparel of "tolerance" and "humanity." Everything is stage-managed as if everything were true.
What we are witnessing today in the West, in all spheres of official political discourse, is a gigantic display of lies - far worse than in the notorious totalitarian despotisms of the 20th century which the postmodern liberal pretends to abhor.
Political Metastasis
In his recent editorial in the quarterly Elėments (summer 2009), under the title "Une époque de basses eaux" - literally translated as "An epoch of low tide," or loosely and metaphorically as "Stalemate Times" - Alain de Benoist gives us a bleak picture of the forthcoming darkness:
In the catalogue of the ephemeral and the superficial, images and noise are following one after the other. Their goal is to capture attention and distract, and to make us think about other things, or more precisely, to make us cease to think altogether. The insignificant becomes a general rule. What comes to mind is the world depicted by the Wachowski brothers in the movie, Matrix (1999). In the movie everybody takes for real what is actually inauthentic; everybody is manipulated from the very moment he imagines himself to be free. Never have people thought to be able to do what they wish, yet never ever have they been subject to so many regulations. In fact they do not really know what they desire because it is the system that formulates their desires.
The biggest victory of the system is to have persuaded everybody not of its qualities, but of its fatal character. The system does not claim to be perfect; it claims that there are no other alternatives. Hence, if one cannot dream of a better world, then there is nothing that can be done.
High politics follows the same hyperreal lead. There is no longer any need to await disasters or the proclamation of a state of emergency, since they are constantly evoked and artificially provoked -creating thereby the genuine feeling of a state of emergency and impending disasters and setting the stage perfectly for a judicial or police clamp down. The security checks that one must endure at all airports in the West inevitably give the feeling of a creeping state of emergency. Depictions of catastrophic images on fictional television drama shows inevitably influence people's perceptions of real catastrophic events. The image no longer follows reality; it precedes reality. Modern politics is the show of hyper-reality - as witnessed for the first time during the recent ex-Yugoslav and Iraqi wars, which were getting bloodier and bloodier the more they were shown on TV.
The Books of the Dead
The same applies to modern historiography and to the sudden surge among Third World nations for the resurrection and beatification of their dead. The more dead they manage to hold up as icons of Western evil the better able they are to affirm their own ethnic identity. One of the best theoreticians of political hyper-reality, the late Jean Baudrillard, describes Auschwitz "not as a site of annihilation, but the site of dissuasion" (The Evil Demons of Images, 1988, p. 24). It is no longer a site of suffering; it is a site of deterrence and didactics, designed to be the ultimate symbol of postmodern Western culture as psychotherapy for Europeans.
The Jewish narrative regarding the "singular" and "unique" historical event of the Holocaust has already given birth to similar "singular" and "unique" narratives among other peoples, notably Armenians and (ironically) the Palestinians, with dozens more nations waiting in the wings.
Diversity obliges. Soon our postmodernity will be forced to open up post-graduate studies on political necrology or (more precisely) political necrophilia, as more and more groups clamor for their forgotten real or hyperreal dead. However, political necrophilia carries its own dangers for groups that see themselves solely through the lens of victimhood. In attempting to avoid the repetition of disaster, the Jewish narrative of "never again" does exactly the opposite: By focusing solely on a decontextualized event of persecution, it runs the risk of failing to rationally comprehend Jewish history - with unforeseen consequences.
Almost thirty years ago, Baudrillard wrote memorable words to illustrate the metastasis of liberal democracy:
The energy of the public sphere, the energy that creates social myths and dogmas is gradually disappearing. The social arena turns obese and monstrous. It grows like a mammal and glandular corpse. Once it was illustrated by its heroes but today it refers to its handicapped, its weirdos, its degenerates, its asocial persons - and all of this in a gigantic effort of therapeutic maternity. (Les strategies fatales, 1983) (Fatal Strategies.)
The system puts forward the transparency of evil by parading images of evil in the form of maladaptive individuals. The ruling class and its mediacracy need to display the proof of their power by showing that those who transgress the most basic values of the multicultural zeitgeist are psychologically deranged - literally insane. Proverbial 'revisionists, 'bigoted anti-Semites,' and 'Nazi pseudo-scholars,' are cherished demon images of liberal democracy. They need to be constantly put on exhibition in public places - like wayward Puritans of old - in order to lend further credibility to the eroding system.
Americans and Europeans are constantly put on false alerts by the media about pending terrorist threats. The invocation of terrorism is often fictitious, yet it engages the media machinery in a gigantic show of lies and mendacity. The purpose of the negative imagery is to scare the masses into submission. In a world that encourages narcissism and extreme individualism, one is not only the victim of the image. One becomes the image himself at the price of deforming his own tragic reality.
Tom Sunic www.tomsunic.info; http://doctorsunic.netfirms.com/) is an author, former political science professor in the USA, translator and former Croat diplomat. He is the author of Homo americanus: Child of the Postmodern Age ( 2007). Email him.
Permanent link: http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Sunic-Commun...
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, sociologie, monde contemporain, hyperréel |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 08 juillet 2009
Le Waldgänger et le militant
Le Waldgänger et le militant
par Claude Bourrinet - http://www.europemaxima.com/
« Fabrice eut beaucoup de peine à se délivrer de la cohue ; cette scène rappela son imagination sur la terre. Je n’ai que ce que je mérite, se dit-il, je me suis frotté à la canaille. »
Stendhal, La Chartreuse de Parme.
Qui s’avisera de lire la dernière fable de La Fontaine, son mot dernier avant la mort, connaîtra peut-être l’ultime message d’un sage épicurien en matière d’engagement : l’amateur de jardin ne place pas plus haut l’urgence sacrée de la contemplation, et tout ce qui en peut brouiller l’onde transparente est davantage qu’une faute philosophique : c’est un crime vis-à-vis de l’âme. La vertu de cet ultime apologue est de présenter, dans leur radical altruisme, les deux figures du militant qu’une civilisation ayant pour paradigmes l’apôtre et le citoyen a léguée à l’Europe. On ne fait pas plus concis. L’une, animée du zèle le plus politique, érige la justice en exercice de vertu. L’autre, poussée par une charité admirable, soigne avec abnégation son prochain. Les deux récoltent incompréhension, ingratitude et vindicte. L’hôte des bois, seul, dans son ermitage, sauve quelque chose du grand naufrage humain.
Néanmoins, il n’est pas certain que l’épilogue de ce grand livre du monde que sont les Fables fût si péremptoire dans la condamnation d’un travers dont on sentait, en cette fin de grand siècle, les prémisses. Mainte saynète offre en effet matière, sinon à l’espoir, du moins à un certain plaisir de vivre, voire à un bonheur certain. Si La Fontaine verse quelque peu dans le jansénisme avec les affres de l’âge, il reste pour l’éternité un épicurien sensible aux sollicitations positivement ordonnée d’un Monde qui n’est pas si désagréable que cela, nonobstant sa cruauté.
En ce temps-là, peu avaient oublié Montaigne, le maître de tous, celui qui inspirait ou repoussait, parfois les deux à la fois, sans qui il ne fût ni Charon, ni Pascal, ni La Fontaine, ni beaucoup d’autres. Le châtelain périgourdin avait eu l’occasion de côtoyer La Boétie, qui promettait, ne fût-ce la mort, de donner à la France une plume et un grand cerveau, sinon un grand cœur. Montaigne conçut ses Essais comme un écrin pour l’ouvrage de son ami, lequel est tout un programme, puisqu’il s’intitule De la servitude volontaire. Les Temps étaient pourtant à la rébellion (mais l’une n’empêche pas l’autre), Parpaillots, Ligueurs s’empoignaient, avec l’aide fraternelle des ennemis de la France, pour s’entrégorger pour la plus grande gloire de leur Dieu. Cet âge de fer vit naître, peut-être, le militant moderne. On se mit à concevoir des programmes politiques destinés à changer le régime monarchique, la religion se transmuta en idéologie, et les Églises devinrent des partis. L’État n’était plus le médiateur naturel du Dieu transcendant et du peuple chrétien : il était devenu un instrument autonome, susceptible de transformations, malléable, améliorable, dont on pouvait s’emparer, et qui possédait sa propre Raison. Ainsi, avec le militant, naquit la politique.
On connaît la position de Montaigne là-dessus. Le maire de Bordeaux et le grand commis qui s’entremit entre Henri III et Henri de Navarre, si son loyalisme le plaça dans les régiments royaux, où il fit avec un certain plaisir guerrier le coup de feu, se garda de s’offrir pleinement à la flamme du combat, où il eût à se brûler l’âme, le cœur, ou, quelque fût son nom, ce qui lui assurait de toutes les façons, devant le monde et devant lui-même, la pérennité de son être. Il s’en faut bien de se prêter pour ne pas se perdre. Tel était l’honnête homme, qui, moulé par un livre consubstantiel à sa recherche, invitait à exercer par le monde des hommes et face à la nécessité une indifférence active, qui n’est pas sans prévenir la nonchalance dévote de François de Sales. C’est bien là, chez Montaigne, qui n’évoqua jamais Jésus dans ses écrits, une sorte de synthèse improbable entre le stoïcisme et l’épicurisme. Aussi bien invoqua-t-il volontiers les figures emblématiques de Socrate, d’Alcibiade, de César, d’Alexandre, pour illustrer cette virilité négligente et attentive, cette implication dans les combats de la terre, et cette plasticité de l’âme et du corps, qui saisit le sel de la vie au moment du plus grand danger, comme si ce fût une promenade parmi les prairies élyséennes.
Nous sommes loin du culte chevaleresque et du moine-soldat. L’on n’y perçoit nullement la droite rectitude des héritiers de Zoroastre, des lutteurs manichéens et des croisés juchés sur leurs étriers afin de pourfendre le Mal et vider la cité des hommes des ennemis de la cité de Dieu.
Il faudrait donc repenser le problème et du militantisme et de l’engagement, en ayant conscience des conditionnement culturels et historiques qui en dessinent l’image. Bien évidemment, tout questionnement surgit en son point historial où la réponse est toujours contenue dans la manière d’interroger le destin. Les implicites sont bien plus redoutables que les apparences conceptuelles et rhétoriques les plus sensibles. La pensée, lorsqu’elle se fait servante de l’action, est freinée dans ses élans et ses capacités à creuser jusqu’aux racines. Elle exige un retrait.
L’interrogation première devra porter sur cette inhibition quasi universelle à mettre à la question les plus évidentes légitimités, incertaines dans la mesure de leur évidence. À n’en pas douter, l’engagement pour une cause est une nourriture pour l’existence, même passagère, dont il est bien difficile de se passer comme viatique. Il ne s’agit parfois que de trouver la chapelle sur le marché des causes. Les situationnistes, bien après Nietzsche, rejetaient cette forme de confort qui, même lorsqu’il impliquait la mort et la souffrance, le sacrifice et l’opprobre, semblait octroyer au croyant l’assurance d’un salut, au regard de Dieu, des hommes, ou de soi-même, en tout cas un rôle, dont la véritable et profonde raison réside dans l’irraison de pulsions inavouées ou d’un narcissisme, d’un amour-propre, pour user de la terminologie du Grand Siècle, qui confère à tout discours assertif, et même performatif lorsqu’il s’agit d’agir, cette dose plus ou moins volumineuse de soupçon, de défiance, qui ne demande qu’à envahir l’esprit et le cœur, et justifier toutes les désertions, les abandons et le ressentiment.
Mais il est vrai que le nomadisme militant et la haine des anciens emballements sont des traits caractéristiques de la conscience contemporaine, comme si la maladie sectatrice dénoncée chez les réformés par Bossuet se trouvait soudain envahir le champ politique, une fois les Grands Récits idéologiques chus dans la poussière de l’Histoire.
Il est permis de se demander si un tel type de conscience se manifestait dans l’Antiquité non chrétienne. Il ne semble pas qu’il y eût, avant l’universalisation de la Weltanschauung galiléenne, ce dépassement, cet outre-passement qui caractérise le lutteur convaincu de sa bonne foi et désireux de convertir autrui, avec cette obsession clinique de la trahison, des autres et de soi-même. On pourrait certes excepter de la communauté philosophique grecque, très bigarrée, les disciples d’Antisthène, ces cyniques, qui privilégiaient la physis au Nomos, et convoquaient la parrhèsia, la franchise qui invite à tout dire, pour lancer des invectives à l’égard des pouvoirs en place, ce qui leur valut maints déboires sous l’Empire, sous lequel leur mouvement avait pris une tournure populaire. Julien n’hésitait pas à mêler dans le même mépris cette Cynicorum turba, munie du tribôn et de la besace, et les « Galiléens incultes », auxquels ils ressemblaient beaucoup. Les autres philosophes se contentaient d’une saine abstention, ou, de façon plus risquée, de jouer les conseillers des Princes.
Pour le reste, les Anciens se battaient pour défendre les dieux du foyer, de la cité, de la communauté, ils n’avaient en vue que les intérêts de cette dernière, et si la pensée plus ample d’un ordonnancement impérial leur vint à l’esprit, à la suite des Perses et des Égyptiens, ce fut comme la donnée d’un état de fait, comme le fruit d’un arbre immense à l’ombre duquel devaient s’ébattre, dans leurs particularismes, les peuples variés constituant l’humanité. Nulle part, à nul moment, le Grec et le Romain n’apparaissent comme des sectateurs d’une religion impérieuse. À l’intérieur de la Cité s’affrontaient des factions, les potentes, les humiliores, populo grasso et populo minuto de toujours. Mais il s’agissait de combat politique, d’organisation de l’État, un État organique, lié par mille liens au tissu sociétal, et qui s’incarnait particulièrement dans des hommes, qui étaient des orateurs et des soldats. On recrutait des clientèles, on se faisait des armées privées. Ces solidarités verticales dureraient autant que l’ancien monde, jusqu’à la première moitié du XVIIe siècle, où les puissants, dans une sorte de protection déclinée jusqu’au bas de l’échelle sociale, unissaient les membres de la société, pour parfois les mobiliser contre un État de plus en plus froid et autonome.
Il s’avère néanmoins qu’apparaissaient dans les temps antiques des revendications souvent rapportées par les marxistes dans leur désir d’asseoir leur usurpation sur les traces du passé. Par exemple, dans les pages consacrées à Tibérius et Caius Gracchus, Plutarque reproduit un discours censé avoir été prononcé par Tibérius : « Les bêtes, disait-il, qui paissent en Italie ont une tanière, et il y a pour chacune d’elle un gîte et un asile ; mais ceux qui combattent et meurent pour l’Italie n’ont que leur part d’air et de lumière, pas autre chose. Sans domicile, sans résidence fixe, ils errent partout avec leurs enfants et leurs femmes, etc. » Comment éviter l’émergence de l’espoir quand il faut trouver du pain ? Les fils de Cornélie étaient assez grands pour se vouer au parti populaire et en perdre la vie. Leur stoïcisme les élevait à la conception d’un cosmos garant du Nomos de la Cité, et le caractère subversif de leur combat n’était qu’une tentative de restitutio de l’Urbs, des Temps anciens où le Romain était paysan et libre. On sent dans cette lutte héroïque cet élan de justice qui sert de modèle pour l’éternité aux révoltés de tous temps. Cependant, les Gracques sont d’ici-bas, de la portion sublunaire de l’univers, commune aux choses périssables et imparfaites, et l’édifice qu’ils convoitent, qui participe de la bonne vie en quoi Aristote voit le télos de l’action politique, n’est pas une cathédrale pointée vers le ciel. Leur silhouette ne ressemble pas à celles des saints peints par Gréco, longilignes, tendus presque à rompre vers un point du Ciel ouvrant des vertiges angoissés. Les Gracques ont combattu pour remplir le devoir de leur gens, de leur lignée, celle qui leur enjoignait de défendre le peuple, d’en être le protecteur. Logiquement, César reprendra le flambeau, et assurera les fondements d’un État plus apte à unir les membres de l’Empire.
Depuis la Renaissance, il est d’usage d’invoquer l’exemple de la geste politique antique pour inspirer l’action. Mais la filiation est rompue, la parenté apparente de la politique contemporaine avec celle de l’antiquité est illusoire.
La frontière, on le sent bien, tient à peu de choses, mais séparent deux contrées entièrement différentes. Augustin savait parfaitement que Cité terrestre et cité de Dieu étaient intimement mêlées, et qu’il n’était pas si loisible de les identifier au sein d’une vie qui se nourrit de tout ce qu’elle trouve pour se justifier. Tant que la notion de Res publica subsista, et quand elle revint dans la conscience des hommes, les luttes politiques manifestèrent la propension des clans, des ordres, des classes, des partis, à se projeter dans l’avenir pour établir ce que d’aucuns considéraient comme l’ordre légitime des choses. Chacun au demeurant, même dans les siècles « obscurs » où, selon toutes les apparences, le christianisme appuyait son empreinte, ne remettait en cause l’ordre naturel qui s’appuyait sur l’inégalité, la hiérarchie, l’occupation justifiée de places prédestinées qu’il ne s’agissait seulement que de consolider ou d’élargir. Les potentialités subversives du christianisme, un christianisme au fond vulgaire, comme il y eut un marxisme qu’on appela tel, n’apparaissaient pas, parce qu’on scindait nettement le bas et le haut de la Création, et que les fins de la Justice divines, parfois impénétrables, étaient reportées à plus tard, si possible après la mort, ou à la fin des Temps.
Le militant se trouvait donc chez les orants, les moines. Les évêques, avant le Concile de Trente, ressemblent plus à des Princes qu’à des Bergers soucieux de l’éducation de leur troupeau. L’engagement du croyant, hormis lors de ces brusques flambées que furent les Croisades, qui n’étaient pas si fréquentes, au fond, mis à part l’Espagne de la Reconquista (période où se développe la figure du militant, telle qu’elle se réalisa plus tard dans la vocation de l’hidalgo Ignace de Loyola), était de bien tenir son rôle dans l’économie divine. Cette idée subsiste chez Calderon, dans sa pièce El Gràn teatro del mundo, par exemple, où pauvre, riche, seigneur etc. ont leur rôle dévolu de toute éternité.
Le gouffre ouvert à partir de la révolution nominaliste, qui affirme que les universaux sont des signes, et non des substances, donne au discours, même déraciné, toute sa faculté d’expression et d’universalisation. Si la réalité est singulière, les universaux ne sont pas moins existants, quoique séparés, et relèvent de l’ordre logique, ce que le conceptualisme va étayer, en posant une morale autonome, indépendante de l’ordre naturel. La voie est donc ouverte pour l’élaboration d’une liberté civique spécifiquement humaine, constructiviste, dont les attendus et les conséquences ne dépendent plus d’une transcendance ou d’une immanence cosmique, ou même théologique.
La tension néanmoins prégnante dans l’anthropologie humaniste et baroque, qui sourd parfois de minorités marquées par la structuration mentale lentement instaurée par des siècles de christianisme, tension qui se manifeste spectaculairement dans l’éruption de mouvements millénaristes, comme les mouvements paysans allemands, comme celui des anabaptistes, ou ceux des niveleurs anglais, et même chez les jansénistes qui, bien que fondamentalement dans l’incapacité de proposer un programme politique, comme l’avaient fait les Réformés, ont durablement marqué de leur empreinte militante le paysage politique de la France des XVIIe et XVIIIe siècle, et bien plus tard, n’a pas été contrarié par l’adoption, au sein des grands commis de l’État, des principes machiavéliens de la Raison d’État, selon lesquels la fin justifie les moyens.
L’ironie voudra que ce soit l’être le plus hostile à l’ancien monde, Lénine, le fondateur du parti bolchevik, qui synthétise ces traditions pour unir l’enrégimentement jésuitique et le prophétisme apocalyptique. La puissance d’un programme comme celui contenu dans Que faire ? ne peut s’apprécier que si l’on y distingue la jonction électrique entre le formidable effondrement des valeurs provoqué par l’avènement de l’ère moderne et l’exacerbation d’un vieux fonds mystique, particulièrement présent en Russie orthodoxe, un peu moins dans l’Europe occidentale agnostique.
On découvrit il y a quelques décennies, au moment où mouraient ce que l’on nomma les « Grands Récits » que l’entrée en militantisme possédait de nombreux points communs avec la conversion, l’entrée en religion. Mais on ne put le dire que parce qu’on en était sorti, et que dorénavant on pouvait s’en moquer, comme du pape et des curés de village. Le militantisme de masse devint aussi étrangement suranné que les voix nasillardes de la T.S.F. et les chapeaux mous. Les sociologues et les ethnologues s’en donnèrent à cœur joie. On perdit même l’habitude de coller des affiches sur les murs. Et la production de « Grands Récits » fut remplacée par les stories selling, les compagnons de route par des publicistes girouettes, et les électeurs par des consommateurs d’offres politiques. Dans le même temps, les rivalités générées par la Guerre froide, qui avaient donné l’illusion qu’un choix était possible, devenaient des options de gouvernance.
La vérité se présente-t-elle sous une clarté solaire, nous continuons comme avec nos jeux d’ombres. Le désert a gagné tous les aspects de la vie et de la pensée, et Internet, ironiquement, n’a fait que l’universaliser. Les happy few qui communiaient jadis dans une cercle restreint, parisien, se relisant sans cesse et se prenant de la gueule, ne connaissaient pas autant ce sentiment de vide, cette inutile clameur, que nous, qui sommes dotés de tous les moyens d’expression et de diffusion. Les noms deviennent abstraits, et les paroles, comme les feuilles dans le vent, retombent où elles peuvent. Les idées restent idéelles, peut-être idéales, et ne sont guère suivies d’effets. Le pire, pour un homme qui se respecte, est l’illusion, vertu ô combien plébéienne !
Finalement, la solitude est la vraie condition de l’homme moderne, et il faut une force surhumaine pour réussir à rester homme. Il est plus difficile de trouver un homme véritable maintenant, que du temps de Diogène. Toute communication étant devenue impossible, qu’il n’existe qu’un impératif pour celui qui veut sauver quelque chose du désastre : écrire un texte, le glisser dans une bouteille balancée à la mer immense de l’absurde, et disparaître.
Au demeurant, il faut une perspicacité hors du commun pour saisir du premier coup d’œil, qui vaut un instinct, la vérité d’un système, surtout quand on est plongé dans les conditions horribles qui étaient celles d’Alexandre Zinoviev, lorsqu’il avait dix-sept ans sous Staline. Du moment où la vue prend un peu de hauteur, qui n’est certes pas celle de Sirius, la question de savoir ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire se pose autrement que lorsque elle reçoit l’écume des événements, à la manière des journaux.
Dans le premier chapitre du Voyage au bout de la nuit, Céline nous plonge dans une conversation de café du commerce. Bardamu et Ganate, anticipant les anti-héros beckettiens, parlent de tout, et changent d’avis en un temps record. La critique célinienne va loin. Car ce qui est dénoncé, dans le Voyage…, ce n’est pas seulement la guerre, la colonisation, l’Amérique et la misère. Ce serait déjà beaucoup, mais dès les premières lignes, on saisit l’angle par lequel il faut aborder le monde contemporain, celui qui, faisant appel aux masses, est responsable de dizaines de millions de mort et de l’assassinat d’une civilisation comme on en a rarement vu dans l’Histoire. Ce n’est pas un hasard que Le Temps, le quotidien à succès de la belle époque, vienne à nourrir la conversation. Comme écrit Camus dans La Chute, un autre livre sans concession lui aussi, « Une phrase leur [les historiens futurs] suffira pour l’homme moderne : il forniquait et lisait des journaux. ». Une remarque de Ganate nous met au fait, comme pour nous offrir une clé : « … Grands changements ! qu’ils racontent. Comment ça ? Rien n’est changé en vérité. Ils continuent à s’admirer et c’est tout. Et ça n’est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont changés !... » En plus de Schopenhauer, il y a de L’Écclésiaste et du Pascal chez Céline. Autant dire que c’est un moraliste de notre Temps de détresse, comme Cioran. Avec seulement de plaisir que le style.
Venons-en justement, au style. Car il faut bien l’avouer, la dose d’optimisme pour faire d’un homme un militant est à peu de chose près la même que pour en faire un imbécile. L’aristocrate, comme le guerrier, sait bien lui, que le cœur de ce phénomène somme toute étrange qu’est l’existence est de savoir mourir élégamment. Tout le reste est du commerce et de la réclame.
Comment prendre néanmoins les situations les plus désagréables ou les plus insupportables ? Les cas extrêmes ne semblent pas offrir beaucoup le choix. Ce même Zinoviev, dont l’autobiographie est un bréviaire pour tout dissident, sauva sa vie plusieurs fois par des gestes dont le génie venait de leur folie même. Ainsi, au sortir de la Loubianka, escorté par deux hommes du N.K.V.D., leur faussa-t-il compagnie de la manière la plus improbable, les sbires ayant oublié quelque chose et l’ayant laissé provisoirement sur place, dans la rue, ne pensant pas qu’il eût l’audace de partir. Ce qu’il fit, sans le sou, sans rien, pour suivre un destin picaresque. Et tragique.
Alexandre Zinoviev, paradoxalement, ne ménageait pas sa peine lorsqu’il s’engageait dans une activité. Il fut bon travailleur, bon soldat, héroïque même. Comme Jünger fut un bon guerrier. Ce qui distingue le rebelle véritable est sa pensée de derrière. Pascal en était un. Le non que l’on porte au fond de soi est peut-être plus efficace que toute agit-prop. Ne fût-on qu’un seul à dire non, la machine est déjà grippée. L’absence d’assentiment, la passivité, la désertion morale sont bien plus dangereux pour le totalitarisme, dur ou mou, que l’attaque frontale, qui ne fait souvent qu’alimenter la propagande en retour et conforter la police. À la longue, ce travail de sape, la multiplication des refus intimes, parfois prudemment partagés avec des happy few, travaille le sol qui soutient l’édifice. Car tout totalitarisme ne vise pas que les corps : il ne peut subsister si ses membres n’adhèrent pleinement à ses rêves, qui ne sauraient être que désirables.
La logique du monde étant régie, depuis des millénaires, par une destruction de plus en plus accélérée de la Tradition, le chaos est le point terminus de son évolution, ce qui peut offrir des perspectives sportives permettant aux âmes guerrières d’exceller.
Le monde contemporain, « post-moderne », est un univers hyper-sophistiqué, emmaillé d’un réseau électronique de surveillance, enfliqué et empuanti de délateurs, géométrisé, arithmétisé, balisé, lobotomisé, enfarci de lipides télévisés engluant les neurones encalminés, robotisé par un dressage pavlovien, qui produit sa bave en guise d’huile de vidange, une société où les flics ont désormais des silhouettes de scaphandres intersidéraux, spectres humanoïdes au regard vide, comme ces caméras qui nous épient cent fois en une heure ; nos gènes sont pesés, enregistrés, archivés, nos désirs sont gérés et marchandisés, nos rêves domestiqués, la trace des colliers irrite de sa sanglante et empestée blessure nos cous, nos poignées, nos sursauts, nos paroles sont empaquetées, lessivées, ensucrées, aseptisées, notre fatigue auscultée, hospitalisée, pharmacataloguée, notre mémoire est enrégimentée, encasernée, emmaillotée dans un drapeau qu’on nous a mis sur le dos, comme ça, quand on avait les yeux braqués sur le présent. Parce que l’homme post-moderne, il ne songe qu’à la baffre, aux délectables digestions d’après-orgies, à coups de bourrages tripaux et crâneux, avec de gros entonnoirs bien vissés qui lui traversent la carcasse jusqu’au croupion pour qu’il déverse son caca bien conforme, soupesé par les pinces régulées de scolopendres aux sourires frigides.
Mais par-delà les barreaux de la cage peinturlurée de couleurs vulgaires, se hument les sous-bois fauves et frais de la forêt splendide, aux sentiers rayés des flèches du soleil, aux buissons sombres des mystères ancestraux, aux butes arides tapissées de feuilles bruissantes, aux odeurs fortes et enivrantes de l’humus, qui est le parfum préféré des loups furtifs et libres. Ils n’ont de rêves que l’étreinte serrée des écorces et des taillis teignant leur pelage âcre des couleurs du combat. La horde suit son chef au fond de la nuit, et la lune, comme l’écho de leurs songes, fait étinceler les crocs acérés. Tapie à l’orée de sa cité sauvage, elle épie de ses yeux étincelants comme des étoiles les spectacles méprisables de la ville grasse et torve, écroulée sous sa masse abrutie.
Cependant ce recours physique aux forêt est bien rare, et ses plaisirs peu à même de se renouveler à mesure que le monde devient plus civilisé, plus féminisé, plus consensuel.
Au demeurant, ceux qui invoquent le peuple devraient réfléchir. Qu’aurait-on à lui proposer, sinon de juguler ses désirs et sa vanité ? Sa place est nécessairement inférieure aux prêtres et aux guerriers. Si révolution il doit y avoir, elle sera autant pour le peuple, dans la mesure où l’humilité est pour lui, avec la protection des puissants, un gage de bonheur, et contre le peuple, parce que le monde moderne est tout autant son produit, celui de l’intérêt, du matérialisme et du dénigrement du sacré.
Le recours aux forêts mentales offre plus de richesse, à mon sens. L’univers n’a pas si sombré dans l’Âge de Kali qu’il ne subsistât, à qui sait les saisir, d’antiques fragments de la Cité perdue. Ils sont à la mesure de chacun, et répondent à qui peut les percevoir. Des expériences dionysiaques et apolloniennes intenses sont à portée, à condition d’en extraire, comme un élixir, la quintessence.
Ainsi partira-t-on de ce postulat, que l’espoir est affaire de Thersite, que l’aristocrate, ou tout simplement celui qui ressent la nostalgie d’un ancien sens du monde, sait que le Temps n’existe pas, qu’il est vain d’ « améliorer les choses », de les « faire bouger », comme l’on dit, ce qui d’ailleurs a toute chance de les faire empirer ; qu’une fois perdu, le monde clos, hiérarchisé, naturellement enté dans l’ordre cosmique, n’a guère de chance de revenir au jour, à moins que la roue ne retourne à l’origine, ce qui ne peut se produire qu’après un cataclysme intégral. Au fond, le meilleur service qu’on puisse faire au monde est d’accélérer sa décomposition, afin de hâter la vitesse de la roue.
La vie est un naufrage. Je veux parler de celle qui échappe à la lumière d’Apollon, et qui est fort commune. Il est bien connu que la vraie est ailleurs, et que je est un autre. Il est évident que la recherche du bonheur est une stupidité, à laisser à la plèbe. Nous avons nos urgences. Et comme il faut bien subsister, la nécessité de côtoyer les imbéciles et les fainéants s’impose à nous. La frénésie que manifestent la plupart des hommes, non seulement à trouver une place plus ou moins rémunératrice, mais aussi à s’élever au sommet du panier de crabe où l’on est bien contraint de s’agiter, subsidiairement de s’appuyer sur la tête ou les parties génitales de ses congénères, rend l’espèce humaine suprêmement comique. Cependant, l’on n’est pas démuni, pour peu qu’on veuille sauver quelque chose de cette ridicule pantalonnade. Trois attitudes sont susceptibles d’êtres adoptées :
— l’attitude baroque : l’on est spectateur du Gràn teatro del mundo, des autres et de soi-même. La distance se présente comme une réaction de salubrité ;
— l’attitude que j’appellerais martiale : l’on possède un dharma, un devoir à remplir, fixé par l’Ordre cosmique, qui nous dépasse, et qu’on ne peut que deviner par les retombées d’un destin qu’on ne peut connaître que fort tard, trop tard peut-être. Nous ne sommes que de braves soldats postés sur la ligne de front, perdus ou sacrifiés, je l’ignore, fidèles à leur devoir.
Ces deux visions ne sont pas incompatibles, comme le suggère Calderon.
— Reste la poésie, qui est une grâce, ou une malédiction. L’Artifex est aussi, et surtout, Vates. Il accède à une existence supérieure par l’imagination, qui est la vision. Il traduit, annonce, clame, enchante. Il s’enchante lui-même car il saisit la finalité d’un combat où hommes, bêtes, dieux sont mêlés. Son rôle rejoint celui du prêtre, qui est de lier. Littéralement, il est porté par enthousiasme, par une force supérieure, l’éros, qui lui donne la paix.
Claude Bourrinet
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, réflexions personnelles, révolution conservatrice, nouvelle droite, théorie politique, politologie, sciences politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 30 juin 2009
Alguns paradoxos das doutrinas sobre os direitos dos homens
Alguns paradoxos das doutrinas sobre os direitos dos homens

No sentido técnico, paradoxo é equivalente a antinomia, assumindo, conforme ensina Reichenbach(1) a forma «seguinte: a implica não-a e não-a implica a» Mas a implica não-a só se a fôr falso e ipso facto não-a verdadeiro. E por seu turno não-a implica a apenas se não-a fôr falso e a verdadeiro. E teremos de admitir que a é verdadeiro e falso, ao mesmo tempo, o que representa uma impossibilidade.
Claro que estamos a dar à noção de implicação o sentido de implicação material da lógica proposicional bivalente, e não o sentido de «conter necessariamente»
Neste último caso, o paradoxo residiria nisto: em não-a estar contido necessariamente em a e em a estar contido necessariamente em não-a. De a deduz-se o seu oposto e, simultaneamente, desse oposto deduz-se de novo a.
Se digo «estou a mentir», mentindo mesmo, então estou a dizer a verdade, e se estou a dizer a verdade, então tenho de estar a mentir e assim sucessivamente. Eis o que se assemelha correcto, do ponto de vista da razão, e, igualmente, insustentável sob esse ponto de vista. Paradoxo típico.
Acontece, porém, que este termo paradoxo pode ser empregue de uma maneira mais ampla, significando tudo quanto reveste um carácter estranho, do ponto de vista racional, ou seja, algo que não se pode sustentar sem tombar no seu tanto de irracionalidade.
Em nossa opinião, a doutrina contemporânea dos direitos do homem encerra vários paradoxos, quer no sentido amplo que acabamos de referir, quer no sentido estrito em primeiro lugar mencionado.
Começaremos por aludir a alguns paradoxos em sentido amplo, aqui, em certa medida, ad hominem.
Estamos numa época em que se alude, insistentemente, à morte do homem, em que se afirma que a ideia de homem é uma criação epocal e limitada, criação, aliás, infeliz e pouco consistente(2).
Ora, como diria o nunca assás citado Monsieur de la Palice, sem homem não há direitos do homem.
É bastante curioso, no entanto, que os entusiastas dos direitos do homem não se preocupem, de maneira nenhuma, com a negação do homem, não a tentem refutar, pôr de lado, etc(3).
E, por seu turno, aqueles que dão o homem por bem morto e falecido não dirigem, habitualmente, críticas aos direitos do homem que, para eles, se fossem coerentes, deveriam representar o cúmulo do absurdo(4).
Em segundo lugar, embora se verifique um certo renascimento direito natural, podemos asseverar que grande número de juristas e teóricos do direito é, directa ou disfarçadamente, positivista, isto é, entende que direito é, apenas, o direito positivo(5).
No entanto, parece que os direitos do homem, não os direitos deste ou daquele homem, são direitos que se baseiam na natureza do homem, rigorosamente fundamentada, valendo em todos os tempos e todos os lugares. Em suma, os direitos do homem só poderão ter uma fundamentação jusnaturalista.
Sucede, contudo, que há imensos positivistas jurídicos que não deixam de se mostrar partidários dos direitos do homem e vice-versa(6). O que é bem estranho.
Claro que, contra esta crítica, se diz que não necessário estabelecer uma série imutável e eterna de direitos do homem, bastando aceitar aqueles que resultam do desenvolvimento histórico e que um quase universal estado de consciência apresenta como algo a respeitar e se encontraram nas leis e costumes(7).
Mas, se acontecer que a consciência universal, fruto do desenvolvimento histórico, consagre como únicos direitos do homem bradar «Viva o Chefe» e «Abaixo a democracia», iremos sustentar que, nessa altura, estão garantidos os direitos do homem?
A resposta a tal interrogação não pode ser senão negativa.
E isso pressupõe que os direitos do homem não representem uma qualquer resultante da história, devendo constituir qualquer coisa de inabalável e a priori.
Atribuir aos homens, como direitos algo de ridículo ou disparatado torna inadmissível que se fala, autenticamente, em direitos do homem.
Estes, portanto, têm de ser direitos naturais, não estando ad libitum nas mãos de um desenvolvimento histórico que o direito positivo consagre.
Logo, é bastante paradoxal, no sentido lato do termo, que positivistas jurídicos surjam irmanados a jusnaturalistas no aplauso entusiástico aos direitos do homem.
Por outro lado, se o homem é um ente relativo, mutável, se somos incapazes de lhe determinarmos certos atributos definitivos, ipso facto os direitos do homem serão relativos, mutáveis, sem fixidez.
E eis que voltamos à tese anteriormente, segundo a qual, porventura, se sustentará que, em certos períodos ou épocas, os direitos do homem se reduzirão a gritar «Viva o Chefe» e «Abaixo a democracia».
Para não tombarmos em erro semelhante, temos de admitir que o homem possui uma natureza, uma essência intemporal e fixa.
E, nessa altura, urge repelir a doutrina que sustenta que tudo é relativo. O relativismo é, portanto, incompatível com os direitos do homem.
No entanto, acentue-se que o relativismo é, precisamente, uma concepção bastante espalhada entre filósofos, sociólogos, antropólogos que se mostram entusiastas, claros e enérgicos, dos direitos do homem.
E se há relativistas entusiastas dos direitos do homem, há, igualmente, apologistas de tais direitos que não se preocupam com a crítica e o combate ao relativismo.(8) Paradoxal evento.
Contra estas considerações, ripostar-se-á que, ao contrário do que se sustenta, o relativismo é, antes, a base mesma dos direitos do homem. Precisamente se tudo é relativo, ninguém pode sobrepor as suas posições às posições alheias. O relativismo representa o respeito pelos direitos de cada um.
Só acontece que, se todas as posições são legítimas será legítima a posição contra os direitos do homem, o relativismo conduzindo, assim à legitimidade da sua destruição.
Sublinhar-se-á, todavia, que, todas as posições são legítimas mas não o será a posição que pretenda superiorizar-se frente às restantes.
Repare-se, que, nesta altura, já nem todas as posições são legítimas e estaremos perante um relativismo-regra que se impõe, absolutamente, e em que se não deve tocar.
Observar-se-á que essa regra é a do respeito de todos e, por isso, não tem nada de absoluto e impositivo. O próprio totalitarismo terá aí o seu lugar, desde que não procure banir as outras teses.
Estaremos, todavia, perante uma gritante falácia porque o totalitarismo unicamente terá o seu lugar deixando de ser totalitário; forçá-lo a aceitar as posições alheias é, já, submeter o totalitarismo ao seu oposto.
Quer dizer: o relativismo, ou se transforma em autoritarismo em «absolutismo» e auto-destrói-se, ou admite a licitude da sua negação e destrói-se também.
Por conseguinte, não será o relativismo que poderá constituir o fundamento dos direitos do homem, antes os porá em causa, pelas razões que expusemos.
Continua, portanto, a ser um paradoxo que relativistas se declarem entusiastas dos direitos do homem e que entusiastas dos direitos do homem admitam, tranquilamente, o relativismo.
Para muitos, contudo, os paradoxos, latu sensu, que apontamos, não são nada de condenável, antes apresentam-se como um fenómeno em extremo positivo.
As inconsistências, as ausências de boa justificação, enfim, as falhas que se possam apontar a estas ou aquelas correntes, são ultrapassadas pelo facto de que toda a gente acata os assim denominados direitos do homem, com base numa espécie de evidência ou intuição a-teórica.
Lutar-se-á muito, no plano especulativo, mas, no plano prático, ninguém discordará, com lógica ou sem ela, dos direitos do humanos.
Estes são algo que pertence ao senso comum da humanidade, um dado ético que está para além dos debates e das subtilezas filosóficas.
Face a isto importa sublinhar, antes de tudo, que evidência, senso comum, «dados», são critérios de verdade como quaisquer outros, representando, assim, atitudes filosóficas.
A pretensão que constituem tópicos supra-filosóficos, acima das controvérsias filosóficas, não passa de uma ilusão.
Em todo o caso, acentuar-se-á que se trata que se trata de critérios de verdade que tem a seu favor a imediatividade, a presença imediata, e, portanto, não necessitam de provas, demonstrações sendo impossíveis pô-los em dúvida.
Será assim, todavia?
O evidente é o que possui clareza e distinção que afastam as contestações. É, propriamente, o que se vê unanimemente, com uma visão incontestável, inacessível ao cepticismo.
Ninguém discorda do que fôr evidente. Logo, onde houver uma discrepância deixa de haver evidência. Ao fim e ao cabo, a evidência confunde-se com o critério do consenso geral, que é plenamente absurdo, pois faz a verdade função das opiniões. Acredita-se, sem discrepância, que o Sol gira à volta da terra? Então é a Terra que está imóvel. As teses mais incompatíveis serão ou não verdade, conforme a generalidade dos indivíduos o entender. Em suma: a verdade depende das crenças, em vez das crenças dependerem da verdade.
De resto, como definir o consenso geral. Será aquilo em há acordo, em todos os tempos e lugares? Mas como saber o que pensam os homens do futuro, se o futuro é, precisamente, o que ainda não ocorreu e se o conhecessemos torná-lo-iamos presente?
Será aquilo em que há acordo entre os vivos e os que existiram no passado e cujas opiniões conseguimos determinar?
Em tal circunstância, estaremos perante um consenso geral que não é geral, pois não temos o consenso das gerações vindoiras que podem vir opor-se ao que, até então, era geralmente aceite.
Deixemos, porém, a evidência e voltemo-nos para o senso comum. Este em última análise, reduz-se também ao consenso geral, como o próprio nome indica. O senso comum porque é comum é de todos. Ninguém se oporia, factualmente, às suas conclusões.
Basta, porém, uma só pessoa negar a validade de semelhantes conclusões para estas não merecerem ser acatadas. Pessoa alguma nega a validade das conclusões do senso comum? Estamos nós precisamente a fazê-lo. E se se afirmar que não o fazemos verdadeiramente?
Caímos num embaraço inextricável, porque, para aceitarmos o senso comum, temos de saber o que é verdadeiro e para sabermos o que verdadeiro arvorámos o senso comum em lei.
Voltemo-nos, agora, para o «dado». O que está dado é irrecusável, ei-lo aí, nada mais havendo a acrescentar. Mas existirá alguma coisa que, simplesmente, está aí? Como o sabemos? Recorrendo ao simples estar aí? Petição de princípio notória, visto o critério do «está aí» funda-se no «estar aí», que pressupõe já esse critério.
Por conseguinte, proclamar os direitos do homem evidencia, frutos do senso comum, dados, não os reforça de maneira nenhuma nem, muito menos, os faz escapar às lutas e aos debates filosóficos.
No fundo, o que se pretende é sustentar que, com coerência ou sem coerência, ninguém é contra os «direitos do homem». E nada mais falso, pois basta pensar nos contra-revolucionários e nos totalitários para se desmascarar essa pretensa consensualidade.
A situação, portanto, continua a ser esta: os direitos do homem são exalçados e aplaudidos, bastantes vezes, por aqueles que, se escutassem a lógica das suas posições especulativas, deveriam ser seus acérrimos negadores, o que constitui paradoxo patente.
Passemos adiante. Suponhamos que, deixando de lado o relativismo, o juspositivismo, os partidários da morte do homem, nós sabemos, com segurança firme e inabalável, o que este último é, definindo-o como um sujeito entre sujeitos, que tem consciência de si e uma essência racional.
Pondo entre parêntesis as dificuldades em averiguar o que é subjectividade, consciência, racionalidade, um primeiro problema nos aparece já que é o das relações entre homem e direito, uma vez que falar em direitos do homem é, patentemente, falar em direito.
E aqui deparamos com algo que tem muitos visos de paradoxal.
Imensos são os indivíduos que consideram o direito um conjunto de normas positivas e/ou não positivas e, ao mesmo tempo, procedem à apologia dos direitos do homem.
Ora, na verdade, se os direitos do homem pertencem ao homem apenas por ser homem, se são direitos de que o homem, por ser homem, isto é sujeito, então, ipso facto, são direitos subjectivos.
Ora, se o direito é exclusivamente um conjunto de normas (de certa índole, sem dúvida), não se vê, facilmente, como pode haver direitos subjectivos, pois a norma é o que se dirige e impõe ao sujeito.
Dir-nos-ão que a norma se limita a reconhecer uma certa espécie de direitos que lhe é anterior? Mas, nessa conjuntura o direito não é, exclusivamente, norma.
Explicar-nos-ão que o direito subjectivo é uma espécie de doação ou concessão da norma? Se doação e concessão é entendido como algo diferente, o direito subjectivo fica fora do direito que é a norma, numa contradição patente (teremos um direito que não é direito). Se doação e concessão representam pôr algo interno à norma, o direito subjectivo não é subjectivo, em vez de se fundar no sujeito-homem, não passaria de uma modalidade da norma.
Ensinar-se-á que a ciência jurídica não pode deixar de admitir direito subjectivos, se desejar corresponder à realidade jurídica?
Antes de mais nada, cumpre esclarecer que o problema dos direitos do homem não pode ser resolvido pela ciência do direito, uma vez que esta o que estabelece são as noções que permitem expressar a realidade da ordem jurídica positiva. Se os direitos do homem estiverem inseridos em tal ordem, a ciência do direito referir-se-lhes-á. Mas a questão toda é se tais direitos existem ou não, e não é a ciência jurídica que o poderá estabelecer, antes os seus dogmas dependem da prévia resolução de semelhante questão.
Dar à ciência do direito a tarefa de solucionar o problema dos direitos do homem é cair num círculo vicioso patente. Os direitos do homem fundamentar-se-ão na ciência jurídica e, por sua vez, a ciência jurídica terá esta ou aquela estrutura consoante houver ou não direitos do homem.
De resto, quando se assevera que, na realidade jurídica, estão presentes os direitos do homem procede-se a uma afirmação de índole ontológica (de ontologia jurídica) que, por isso mesmo, escapa ao âmbito da ciência jurídica.
Deixemos, porém, de lado esta temática, dando de barato que o direito não é apenas norma e que a ciência do direito não tem pretensões a pronunciar-se sobre os direitos do homem.
Consideremos que os direitos do homem são a esfera da liberdade em que, com toda a legitimidade, se move a vontade deste.
Não nos sentimos obrigados a tratar das eventuais conexões dos direitos do homem com o chamado livre-arbítrio. Parece-nos isso dispensável, porque pode-se, sempre, admitir que a vontade do homem possa praticar os actos que lhe apraz, quer seja internamente determinada, quer disponha dum espontânea capacidade de decisão.
Claro que, não entrando nesse terreno, não vamos, também, tratar da possível compatiblidade do determinismo com o livre-arbítrio, tese actualmente muito em voga(9).
Afastando estes tópicos, perguntemos porque é que o homem possui direitos inalienáveis enquanto homem, unicamente por ser homem?
A resposta assemelha-se simples. Exactamente porque o homem é um sujeito com consciência de si e, sobretudo, com uma natureza racional.
Simplesmente, uma dificuldade surge aqui. Se por natureza se entende essência, como o faz S. Tomás(10), torna-se patente que a essência do homem não é a racionalidade. Porventura será o homem só razão? Se assim fosse, o homem não poderia enganar-se, nem praticar o mal. Tudo quanto o homem fizesse seria verdadeiro e, então, seria verdade que o homem não tem dignidade nenhuma e meritório tratá-lo como um desvalor sem direitos.
Mas, observar-se-á, o homem não será só razão, por certo. No entanto, para além de Deus e dos anjos, é o único ente dotado de razão. E isso não bastará para lhe dar dignidade e direitos intrínsecos? Obviamente não, porque a razão é apenas um atributo do homem entre outros, existindo, ao lado dela, a capacidade de errar, de se abandonar ao que é vil e extremamente mesquinho, de agir irracionalmente, em suma. Onde estarão, nessa altura, a sua dignidade e direitos intrínsecos?
Sublinhar-se-á, a seguir, que é ele o único ente (além dos anjos e Deus) que pode praticar o Bem, coisa que não está na alçada dos gatinhos ou das pedras. Mas em contrapartida, também pode praticar infâmias, o que não acontece com os gatinhos ou as pedras.
Sem dúvida o homem, ontologicamente, é diferente dos animais e dos minerais; todavia, tal situação não equivale a ter dignidade e direitos enquanto homem, porque dignidade e direitos são categorias éticas, que não se confundem tout court com as categorias ontológicas.
Anotar-se-á que os homens e, apenas, os homens podem conseguir a salvação e atingir a beatitude? Bem! Já que estamos, agora, numa perspectiva teológica, replicar-se-á que os homens também podem ir para o inferno que é o contrário da beatitude.
De resto, se há homens perfeita e cabalmente indignos, como nos dizem e repetem, em especial a propósito da guerra de 1939-1945, de que forma sustentar que o homem tem uma dignidade e direitos intrínsecos só por ser homem?
E examinemos outro problema. Qual o limite dos direitos inalienáveis de cada homem, uma vez que, tratando-se de elementos de uma multiplicidade, — cada homem — não se concebe como ilimitado?
Se utilizarmos um critério objectivo, superior ao próprio homem, para fixação daquele limite, estamos perante uma ambiguidade patente. Os direitos do homem serão delimitados por algo de extrínseco ao homem que, porventura, praticamente os reduzirá a nada.
Os direitos do homem, portanto, só poderão ser fixados pelos próprios homens. Mas isso não levantará conflitos entre estes? Talvez se responda que não, porque os homens, sendo finitos por definição, têm limites que não ultrapassam.
Simplesmente, até onde vão esses limites? A sua simples existência não impede eventuais conflitos. Um ente finito pode, indiscutivelmente, visar a eliminação de outro ente finito sem perder a sua finitude.
É preciso encontrar um critério de delimitação recíproca dos direitos do homem que não seja função de nada de exterior ao próprio homem. O problema parece difícil de resolver, mas em realidade não o é.
Basta considerar que cada um estabelecerá os direitos que lhe aprouver, desde que não viole os iguais direitos dos outros.
A fórmula, aliás, é antiga. Encontra-se no art. IV da «Déclaration des droits de l`homme et du citoyen», de 1789. «L`exercice des droits naturels de chaque homme n`a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits»(11).
À primeira vista, isto parece o mais claro possível. Os direitos do homem poêm-se a si mesmos, juntamente com os seus próprios limites. Cada homem tem todos os direitos concebíveis, só não deve ir além do ponto em que se situam os direitos dos restantes.
Estamos perante uma concepção que representa o mais sólida razoabilidade e que, sem recorrer a nada de extrínseco, consegue pôr as barreiras necessárias aos direitos de cada um.
Contudo de Scilla passamos a Caribdis.
Com efeito, se o direito de a só é limitado pelo direito de b e o direito de b só é limitado pelo direito de a, para conhecermos até onde vai o direito de a — isto é, para conhecermos o direito de a — temos de conhecer, previamente, até onde vai o direito de b — isto é, temos de conhecer o direito de b. Mas, em contrapartida, para conhecermos o direito de b, temos de conhecer já o direito de a, que vimos depender do conhecimento do direito de b e assim sucessivamente.
Estamos num círculo vicioso ou dialelo nítido.
A fim de se saber até onde pode ir a vontade de a, preciso saber até onde pode ir a vontade de b, e para saber até onde pode ir a vontade de b preciso de saber até onde pode ir a vontade de a.
Anotar-se-á que isso é plenamente descabido. Basta esclarecer, inicialmente, o direito de a e de b, cada um de per si.
Todavia, estabelecer o direito de a é defini-lo, e definir, consoante a palavra indica, é marcar os fins, os contornos, logo os limites. Não é possível uma definição anterior à delimitação, acontecendo que, neste caso, a única regra que se apresenta para a delimitação é uma devolução recíproca.
Não tem, pois, consistência a observação que nos fizeram e o círculo vicioso mantém-se.
Os direitos do homem, no entanto, para além da circularidade viciosa que apontamos dão lugar a um outro paradoxo.
Indiquemos qual.
A liberdade é qualquer coisa inerente aos direitos do homem. Sem ela, estes não se concebem.
Ora suponhamos que a imensa maioria dos homens se pronuncia, livremente, contra os direitos do homem. A solução para a dificuldade assemelha-se fácil. A negação dos direitos do homem será estritamente proibida por todos os meios. E que significa isso? Que os direitos do homem e a liberdade não podem considerar lícita a sua destruição, dado que se o fizessem estariam a negar-se a si mesmas, logo a contradizer-se. O raciocínio tem a sua lógica. Em todo o caso, nessa altura, os direitos do homem e a liberdade seriam um Diktat que aniquilaria os próprios direitos do homem e a liberdade e que receberia um acatamento forçado. Num plano de coerência, deveriam ser permitidas as posições contrárias aos direitos do homem e à liberdade. Assim é que estes últimos seriam respeitados, em vez de impostos quer se queira quer não.
Temos aqui que duas concepções opostas parecem derivar com aparente lógica de idênticas premissas.
E temos igualmente, que num caso e noutro os direitos do homem se auto-destroem.
Os direitos do homem e a liberdade, para não se auto-negarem, acabam por auto-negar-se, visto tornarem-se uma obrigação a que ninguém pode resistir; ou então aceitam a legitimidade da sua negação e, de outra maneira embora, auto-destroem-se igualmente.
Em resumo: ou todos os homens estão forçados a venerar os direitos do homem, o que é colocar um princípio (precisamente o do respeito pelos direitos e liberdade do homem) acima do querer dos próprios homens, numa contradição flagrante (pois o fundamento do princípio são os direitos e a liberdade dos homens); ou estes se assim o entenderem, terão o direito de negar os direitos e a liberdade do homem e, então, entre tais direitos e tal liberdade conta-se a legitimidade da sua própria destruição, o que é nova contradição.
E sublinhe-se que semelhante negação pode ser pacífica e meramente doutrinária, nem por isso deixando de porventura dar lugar à auto-destruição referida, porque a exposição e a propagação de uma ideia conduz, em inúmeros casos, à prática dos actos que lhe correspondem. A menos que se institua, como preceito universal, que a acção nunca deve corresponder ao pensamento, o que é ditar a norma da geral hipocrisia(12).
Por certo brandir-se-á, a propósito do que dissemos, a consagrada máxima «não há liberdade contra a liberdade».
Vemos a liberdade arvorada em ideal categórico a que se tem de obedecer incondicionalmente. Mas em que consiste a liberdade? Em não se obedecer a concepções imperativas e ao que não resulte, da nossa espontânea adesão interior.
A liberdade não admite dogmas e é ela, arvorada em dogma. Paradoxo novamente e equiparável aos mais clássicos.
Lembremos um deles, em extremo conhecido. É o paradoxo semântico do termo heterológico. Suponhamos que as palavras se dividem em duas espécies: as que se aplicam a si próprias (v.g. português é um termo português) e que são autológicas, e as restantes denominadas heterológicas (v.g. cadeira não é uma cadeira em que nos sentemos).
Encaremos o vocábulo heterológico. Ou é, ele, autológico ou heterológico. Se é autológico aplica-se a si próprio e eis que heterológico é heterológico. Logo não é autológico. Ou é ele, heterológico. Nessa altura heterológico é heterológico. Logo aplica-se a si próprio e é autológico. Portanto, não é heterológico.
A analogia com «não há liberdade contra a liberdade» é flagrante.
Se «não há liberdade contra a liberdade» a liberdade torna-se um credo que não pode contestar, algo que elimina toda a oposição e ipso facto deixa de ser liberdade.
Mas se para evitar semelhante desastrosa consequência passar a haver liberdade contra a liberdade os inimigos da liberdade poderão licitamente destruir a liberdade, invocando a liberdade e a sua lógica interna, com o que se nega a liberdade. E se a fim de fugir a tal eventualidade se proibir que haja quem se oponha à liberdade voltamos ao começo e de novo desaparece a liberdade.
Eliminando quem se lhe oponha, ou admitindo quem se lhe oponha, a liberdade acaba sempre por suprimir a liberdade.
Vejamos outro problema. Como determinar os direitos e liberdades do homem? Que processo vamos utilizar com o objectivo de proceder a uma enunciação concreta de tais direitos e liberdades?
Por certo afirmar-se-á que o homem tem aqueles direitos que derivarem da sua intrínseca dignidade. Mas em que consiste essa intrínseca dignidade? Um dos seus aspectos principais é possuir direitos inerentes, por si mesmo.
Por consequência, os direitos dos homem assentam na dignidade deste e a sua dignidade no facto de possuir direitos.
Nova circularidade viciosa.
Não nos detenhamos nela, todavia, e examinemos alguns dos mais falados direitos do homem, consignados em quase todas as Declarações.
Aludiremos ao direito à vida, ao direito de liberdade de expressão do pensamento, à tolerância (liberdade religiosa) e, por último, à liberdade de associação.
O direito à vida é condição dos restantes direitos humanos.
Condição necessária, mas não suficiente. Com efeito, quem estiver preso, em cárcere horrendo, sujeito a torturas tão sabiamente doseadas que continue indefinidamente vivo, tem direito à vida, mas a uma vida cem vezes pior que a morte.
Considerar-se-á que tal situação não é de vida autêntica. Onde estará a vida autêntica, porém? No respeito mútuo? A minha vida autêntica implicará o acatamento da vida autêntica do próximo? Para saber até onde vai a minha vida autêntica preciso de saber até onde a vida autêntica do próximo e vice-versa. E voltamos então à circularidade viciosa já aludida.
Isto sem falar no problema da legítima defesa. Quem matar para não ser morto(13), o que legitimará o seu acto? O puro direito à vida? Não se vê em que o direito à vida de a seja, enquanto tal, superior ao direito à vida de b. Há que recorrer a algo para além do simples direito à vida para justificar quem se defende.
Adiante. Passemos à liberdade de expressão do pensamento como direito do homem só por ser homem.
Admitir-se-á, por exemplo, propaganda contra a liberdade de expressão?
A lógica parece impor semelhante atitude. Trata-se da expressão de um tipo de pensamento que, como todos os outros, deve poder ser livremente manifestado.
Contudo a propaganda contra a liberdade de expressão conduzirá, porventura, à destruição da mesma, uma vez que, consoante sustentou Fouillé, as ideias são forças(14).
Logo impõe-se banir a livre expressão do que seja propaganda contra a liberdade de expressão. Ambas as posições assemelham-se perfeitamente racionais só que, em ambos os casos complicarão o aniquilamento da liberdade de expressão que pretendem garantir.
A propaganda contra a liberdade de expressão é coerentemente exigível só que leva, acaso, à eliminação desta. Para evitá-la recorre-se ao banimento de tal propaganda. Simplesmente semelhante solução a fim de salvar a liberdade de expressão traduz-se no banimento da mesma visto que a expressão de certo género de pensamento é proibida.
Estabelecer-se-á que a liberdade de expressão do pensamento é a liberdade de exprimir tudo menos o que ataque tal liberdade? A liberdade de expressão do pensamento representará um critério limitativo do que se pode ou não exprimir? Mas a liberdade de expressão não consiste precisamente na ausência de critérios limitativos na ordem da expressão? Que liberdade de expressão será essa que decrete: é legítimo combater toda a espécie de ideias menos uma certa noção que é intangível.
E qual é a noção intangível? A de que não há noções intangíveis que não seja permitido pôr em causa, toda a gente tendo o direito de exprimir o seu pensamento sem peias e obstáculos.
Explicar-se-á que é patente que não há liberdade de expressão para o que fôr apologia crime? Se, por crime se entender apenas o que como tal é definido pelos Códigos positivos, patente é que o «crime» não passa de coisa mutável e alterável ao arbítrio do legislador. E não se concebe que a liberdade de expressão, direito inalienável, possa ser restringida em função de textos legais que hoje consideram crime o que amanha o não será e vice-versa.
Claro que se tomarmos por crime algo em si, objectivo e fixo, então suprimir a apologia do crime é sacrificar a livre expressão do pensamento das pessoas a algo que tem um carácter supra-pessoal, o que, na perspectiva dos direitos inerentes à pessoa enquanto pessoa, é perfeitamente insustentável.
O direito de livre expressão do pensamento é, em resumo, de índole extremamente paradoxal.
Ocupemo-nos a seguir da tolerância.
Esta consiste em admitir todas as doutrinas e na recusa de qualquer fundamentalismo ideológico.
Por vezes, quando se fala em tolerância alude-se à liberdade religiosa. Lembremos, por exemplo, as célebres Cartas sobre a Tolerância de Locke em que se discute fundamentalmente a liberdade dos vários cultos(15) (excluídos, desde logo, o católico e o islâmico).
Em todo o caso, a tolerância, tomada na sua mais estricta acepção, embora abranja a liberdade religiosa, ultrapassa-a patentemente.
Conforme dissemos, a tolerância envolve não só as concepções religiosas mas todas as concepções em geral — filosóficas, políticas, etc,.
Ora se devem tolerar todas as concepções também se deve tolerar a intolerância com o que, consoante nota Marcuse, a tolerância se destrói a si mesma(16).
Para obviar a isso só há um processo: não tolerar qualquer espécie de intolerância. Em semelhante circunstância a tolerância transforma-se numa ideia oficial, num credo que tem de ser acatado por todos. Eis que a tolerância se torna intolerância. O paradoxo é patente porque das malhas desta tenaz não há que escapar.
Ocupemo-nos, agora, de um outro direito humano considerado fundamental: a liberdade de associação.
Também aqui é visível o paradoxo. Suponhamos que se formam associações, pacíficas mesmo, contra a liberdade de associação. Se tais associações triunfarem, a liberdade de associação desaparece. Quer dizer que esta permitiu a sua auto-aniquilação.
Por certo observar-nos-ão que tal desaparição não é possível, porque para isso seriam precisas alterações políticas e constitucionais que não se fazem pacificamente.
O argumento não tem razão de ser. Se tais associações triunfarem, o estado da opinião pública conduzirá naturalmente, sem violência, a modificações político-constitucionais que façam desaparecer a liberdade de associação.
Para evitar isso, a solução é proibir tais associações. E teríamos o fim da liberdade de associação, precisamente para defesa da liberdade de associação, numa gritante contradição.
Tentar-se-á manter a liberdade de associação estabelecendo que proibidas serão, apenas, as associações que se ergam contra a ordem pública e que, como as associações adversas à liberdade de associação estão nessa situação, será em nome da ordem pública, que serão reprimidas.
Só nos parece que não é de invocar a ordem pública face a pacíficas associações e, por outro lado, que direitos inalienáveis devam ceder face à ordem pública assemelha-se bem extravagante.
O direito de liberdade de associação tem assim um conteúdo paradoxal óbvio.
Para não nos alongarmos não nos vamos referir a outros direitos do mesmo género.
Lembraremos o que, se nos não enganamos, Chesterton diz na Ortodoxia. Pode haver todo o género de adorações até a adoração dos crocodilos: o que não pode haver é a adoração do princípio de não haver adoração alguma.
Os direitos e a liberdade da pessoa, tomados como qualquer coisa de sagrados representam falácia patente, porque o seu conteúdo é precisamente que não existe nada de intocável e que cada um se conduz com plena autonomia(17).
Todavia concluir de quanto dissemos que não há direitos do homem é algo de precipitado e inaceitável.
Que os homens não tenham direitos simplesmente por ser homens é uma coisa, que não tenham direitos de nenhuma espécie é outra. Nada permite afirmar que não possuam direitos embora com fundamentos diversos da sua mera qualidade de ser homens.
Julgamos inegável que os homens tem deveres porque se os não tivessem não haveria distinção entre o bem e o mal e tudo seria bom ou tudo seria mau. Se tudo fosse bom seria bom o ponto de vista contraditório e portanto nem tudo seria bom. Se tudo fosse mau essa tese seria mesma seria má logo, errada, e, portanto, nem tudo seria mau. Ambas as hipóteses são absurdas donde se segue que tem tudo de haver tanto o bem como o mal e os consequentes deveres.
Ora se existem deveres ipso facto há direitos, os direitos de os cumprir.
Como seria imperativo realizar esta ou aquela ordem se não se tivesse o direito a realizá-la e acaso se pudesse ser impedido de praticar o que é obrigatório?
Os homens têm, pois, direitos. Os direitos que derivam dos seus deveres e que não são tão poucos como isso: o direito de servir o verdadeiro e o justo, o direito de ser governado convenientemente, o direito de devotar-se ao bem comum e assim por diante. Esses direitos, hoje em dia tão esquecidos, não encerram paradoxo algum e merecem o maior acatamento. Quanto aos restantes…
Notas:
1 – Hans Reichenbach, Elements of symbolic logic, New York/London, The Free Press, Collier MacMillan, first Free Press Paperback, 1966, p. 219.
2 – É a posição do chamado estruturalismo. Veja-se, significativamente Michel Foucault: «on peut-être sûr que l`homme… est une invention récente… L`homme est une invention dont l`archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine… on peut bien parler que l`homme s`éffacerait comme à la limite de la mer un visage de sable» (Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 398).
3 – Sem fazer uma pesquisa exaustiva basta acentuar que na obra Os fundamentos filosóficos dos direitos humanos, publicada pela Unesco, colaboram imensos filósofos contemporâneos, nenhum aludindo, e muito mentos tentando refutar, à tese da morte do homem. E claro que todos se manifestam apologistas dos direitos do homem. (Utilizamos a tradução espanhola de Grazziella Baravalle, Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, Barcelona, Serbal/Unesco, 1985).
4 – É curioso que numa síntese do próprio Foucault em Surveiller et Punir, ele diz: «le XVIII siècle a inventé les libertés», mas não as proclama destinadas acaso a desaparecer e o que lastima é que assentem num subsolo disciplinar (Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1975). E também curioso que o homem sendo uma invenção perecível já a «liberté humaine» represente o motor da história. (L`archéologie du Savoir, Paris, Gallimard, 1969, pp. 271-272).
5 – É a definição, que julgamos exacta, que Norberto Bobbio dá de positivismo jurídico. Cfr. Giusnaturalismo e positivismo juridico, Milano, Ed. di Comunità, 1984, p. 127.
6 – Para não multiplicar os exemplos citemos, apenas, H. L. Hart e Norberto Bobbio. O primeiro acha que são direito as regras «wich are valid by the formal tests of primary and secondary rules» mesmo que se situem «against… the enlightened or true morality» (The concept of Law, Oxford Clarendon Press, 2.ª ed., 1997, p. 209) o que o não impede de falar no «igual direito de todos os homens a ser livres» e assim por diante (H. J. A. Hart, Direito e Moral, trad, espanhola de Genaro Carrio, Buenos Aires, Depalma, 1962, pp. 65 e segs).
Talvez, no tocante a Norberto Bobbio, se objecte que este declara que «di fronte allo scontro delle ideologie ebbene sono giusnaturalista» (Giusnaturalismo e positivismo giuridico, cit., p. 146) mas no que, no tocante à teoria geral do direito, não é nem jusnaturalista nem positivista (nè l`uni nè l`altro, ibidem).
A verdade, porém, é que, noutro passo, posterior, declara: «Il bisogno di lbertà contro l`oppressione, di iguaglianza contro la disigualizanza, di pace contro la guerra… Di tutti questi argumenti il giusnaturalismo è stato una durevole manifestazione ; ma non è stata la sola. E non sembra oggi, teoricamente, la più accettabile» (Giusnaturalismo e positivismo giuridico, cit., p. 195). E, no que diz respeito à teoria geral do direito, Bobbio, a certa altura, declara que o positivismo jurídico é a redução do direito a direito estatual e deste a produto do legislador (Idem, p. 134).
Ora se a teoria geral é maneira de «intendere e spiegare il fenomeno giuridico» (idem, p. 138) e o direito equivale a direito positivo não vemos como possa não ser positivista a teoria geral. E, de resto, que diferença, haverá entre a teoria geral do direito e a atitude de «accostarsi allo studio del diritto… precindendo da ogni giudizio di valutazione… con metadologia scientifica» (Idem, p. 141.) Não é positivismo?
Aliás, na abordagem científica do direito não pode deixar de estar incluída a teoria geral do mesmo. E acontecendo que Bobbio em tal abordagem se proclama resolutamente positivista (Idem, p. 146) não pode deixar de o ser na teoria geral. Em última análise pois nada o distingue do positivismo jurídico. Simplesmente não deixa, como vimos, face ao direito positivo, de perfilar direitos — liberdade, etc., que curiosamente não serão direito.
7 – É a posição v.g. de Radbruch que fundamenta os direitos no «trabalho dos séculos», Rechtsphilosophie, Estugarda. K. F. Koehler, 8.ª ed., 1973, p. 328 onde está inserido um escrito, da sua chamada segunda fase, com o título «Fünft Minuten Rechsphilosophie».
8 – A tese do relativismo como algo em que assentam os direitos do homem é, por exemplo, dominante na juventude universitária dos U.S.A. segundo Allan Bloom: «O ambiente familiar e educacional dos estudantes é tão variado quanto a América pode proporcionar. Uns são religiosos outros ateus; uns são de Esquerda outros de Direita; uns tencionam ser cientistas outros humanistas ou terem uma profissão ou serem homens de negócios; uns são pobres, outros são ricos. Fazem parte do mesmo todo apenas no seu relativismo e na sua fidelidade à igualdade. E o relativismo e a fidelidade estão relacionados numa intenção moral. A relatividade da verdade não é um conhecimento teórico mas um postulado moral, a condição de uma sociedade livre» (A Cultura da incultura, Mem Martins, Europa-América, trad. portuguesa de Francisco Faia, 1988, p. 25.).
Quanto a autores entusiastas dos direitos do homem que em nada se preocupam com o relativismo basta citar v.g. Richard King, Civil rights and the idea of freedom, Athens and London ou Charles Taylor nos seus Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, citado, pp. 32-61. Este último é abertamente jusnaturalista.
9 – Veja-se sobre o compatibilismo, Ulrich Pothast, Die Unzulänglickeit der Freiheitsbeweise, Frankfurt am Main, Suhrkamptaschenbuch, 1987.
10 – S. Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, 29, I ad quartam, Madrid, BAC, I, 1951, p. 229.
11 – Déclaration des droits de l`homme et du citoyen, IV, in «Les déclarations des droits de l`homme de 1789», textes reunis et présentés par Christine Faure, Paris, Payot, 1988, p. 12.
12 – A hipocrisia como norma aliás não pode ser cumprida porque se o fosse a prática corresponderia ao pensamento e não mais haveria hipocrisia.
13 – Que porventura se possa evitar a desaparição do direito à vida por outros meios diferentes da morte dos seus negadores não impede que, em casos extremos, esses outros meios não resultem e se tenha de recorrer à morte, o paradoxo mantendo-se.
14 – Alfred Fouillé, La liberté et le déterminisme, Paris, Alcan, 1895, p. 222.
15 – Como se sabe Locke começou por escrever A letter concerning tolerance, publicada em Inglaterra em 1689. Em resposta às críticas redigiu em 1690, 1692 e 1702 mais três cartas sobre o tema. Elas ocupam o VI volume das «Works of John Locke», editadas em 1823, reimpresso nos nossos dias pela Scientia Verlag, Aalen.
16 – R. P. Wolff, Barrigton Moore Jr., Herbert Marcuse, A Critique of pure tolerance, Boston, Beacon Press, 1965. Ver Repressive tolerance de Herbert Marcuse inserido nesse volume, em especial, p. 82.
17 – Sustenta-se que o recurso ao raciocínio anagógico elide qualquer contradição na intolerância dos tolerantes.
O raciocínio anagógico é, ao fim e ao cabo, a redução ao absurdo do ponto de vista contrário a algo e não se vê no nosso caso que a intolerância, logicamente desenvolvida, leve ao auto-aniquilamento, a um absurdo, equivalente, por exemplo, a círculo quadrado.
Diz-se que a intolerância é in-humana mas isso não equivale a ser absurda não se devendo esquecer que os intolerantes são homens. Aliás, o in-humano não pode ser tomado à letra, é apenas um termo agressivo que exprime condenação. Não deixa de ser curioso todavia que quem não é um crente no evangelho da tolerância seja posto à margem da humanidade.
Prof. António José de Brito.
Alguma bibliografia
A. Diemer, J. Hersch, Paul Ricoeur, etc, Los Fondamentos filosoficos de los derechos humanos, Serbal, Unesco, 1985.
A. Messineo, I Diritti dell`uomo, La Civiltá Catolica, Roma, ano 103, vol. III, Julho, 1992.
Abel Jeannière, Les droits de l`homme, in Projet 116, Junho 1977.
Abelardo Lobato, La dignidad del hombre y los derechos humanos, in Studium, Madrid, vol. XXII, Ano 1982, fasc. I.
Adolfo Crippa, A nova problemática dos direitos humanos in Convivium, Março/Abril, Ano XIV, n.º 2, vol. 18.
Antonio Moreno, Principles of the natural law and equal rights of man, in Angelicum, Roma, 1976, vol. LIII.
Bernard Croethuysen, Philosophie de la révolution française, Paris, Gallimard, 1856.
E. H. Carr, Benedetto Croce, Jacques Maritain, etc, Los Derechos del Hombre, trad. espanhola, Laia, Fondo de Cultura Economica, 3.ª ed., 1975.
Enrico Berti, La legge naturale come fondamento dei diritti del`uomo, in Verifiche, Ano IX, n.º 1-2, Gennaio-Giugno, 1980.
Ernst Bloch, Naturrecht und menschlich Würde, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1961.
Heinrich Henkel, Einführung der Rechtsphilosophie, München, C. H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung, 1977, pp. 76 e 264-265.
François Rodier, Nature humaine et droits de l`homme, Revue de l`Enseignement Philosophique, 52ème Année, número 3, Fevereiro/Março, 1982.
Frederik J. Crosson, Maritain and natural rights in The review of metaphysics, vol. XXXVI, n.º 4, Junho, 1983.
Ian Shapiro, The Evolution of Rights in the liberal Theory, Cambridge, University Press, 1986.
Guillerme Hoyos, Los derechos humanos como problema filosófico, in Análisis, 32, I Congresso Internacional de Filosofia Latino-Americana, 15 a 21 de Junho de 1980, Ponencias.
H. Planitz, Das Naturrecht und die Menschenrechte, Juristische Blätter, 1948, p. 11 e segs.
Jacques Maritain, Les Droits de l`homme et la loi naturelle, New York, La Maison de France, 1942.
Joseph Loblin, Lo sviluppo storico del pensiero sui diritti dell`Uomo, La Civiltà Católica, Ano 131, 1980, vol, secondo, Quaderni 3115-3120.
Les Droits de l`homme, número colectivo de «Les Études Philosophiques», Paris, P.U.F., Abril-Junho, 1986.
Louis Lachance, Le Droit et les droits de l`homme, Paris, P.U.F., 1959.
Luc-Ferry-Alain Renault, Philosophie politique, 3, des droits de l`homme à l`idée républicaine, Paris, P.U.F., 1985.
Michel Villey, Le Droit et les droits de l`homme, Paris, P.U.F., 1983.
Miguel Artolla Gallego, Declaraciones y derechos del hombre, Revista de Occidente, Madrid, Extraordinario II, Fevereiro de 1982, n.os 10-11.
Niceto Blasquès, La cuestión de los derechos humanos in Arbor, Madrid, n.º 377, Maio de 1977.
Pelayo de Zamayon, Derechos del hombre. Su fundamentación racional, Anuario Filosófico, I, Universidade de Navarra, S. A. Pamplona, 1968.
Raul Cereceda, La Declaración universal de los derechos del hombre, Gregorianum, Roma, vol. 60, 1979.
Richard H. King, Civil Rights and the idea of Freedom, Athens and London, The University of Georgia Press, 1992.
Richard Tuck, Natural Rights Theories, Cambridge, University Press, 1979.
Roger Mahl, Dissidence et Droits de l`homme, in Revue d`histoire et de philosophie religieuses, Paris, P.U.F., tome LXV, 1985.
Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Massachussets, Havard University Press, 1977.
Stephan H. Pfürtner, Os direitos humanos na ética cristã, in Concilium/144 – 1979/4: Teologia Prática.
Tibor Macan, Are there any human rights? In The Personalist, vol. 59, n.º 2, Abril, 1978.
A. J. B.
00:12 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, philosophie, politologie, droits de l'homme, droit |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 28 juin 2009
Philosophie der Übung und der Charme der Disziplinlosigkeit

Philosophie der Übung und der Charme der Disziplinlosigkeit |
| Geschrieben von Felix Menzel - http://www.blauenarzisse.de/ | |
| Viel Disziplin ist nötig, um dem Artisten Peter Sloterdijk bei dem Entwurf seiner Philosophie der Übung auf über 700 Seiten zu folgen. Wahrscheinlich werden deshalb nur Sezessionisten, die sich bereits in höhere Zonen abgesetzt haben, sein neues Werk „Du mußt dein Leben ändern“ wirklich vollständig lesen. Die Gewöhnlichen, die eine Trainingseinheit mit Sloterdijk dringend bräuchten, dürften hingegen gefahrlos an dem absoluten Imperativ vorbeikommen und werden sich lieber an den Tipps zum professionellen Rumgammeln von Kathrin Passig und Sascha Lobo orientieren. Und während sich bei Sloterdijk automatisch ein distanziertes Leseverhalten einstellt, kann man bei Lobo und Passig gerade als Student natürlich mitfühlen, denn jeder angehende Akademiker dürfte schon einmal Aufgaben vor sich hergeschoben und ein paar Tage im universitären Trott rumgegammelt haben. Die beiden Blogger und Werbetexter sind Profis auf diesem Feld und nennen dieses Verhalten in ihrem mal eben geschriebenen Buch über die Dinge, die ohne Selbstdisziplin irgendwie auch funktionieren, hochwissenschaftlich „Prokrastination“. Dahinter verbirgt sich aber nicht viel mehr als professionelles Rumlümmeln, währenddessen sich die Arbeit auf mysteriöse Art und Weise selbst machen muß. Wer wagt die Sezession? |
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 juin 2009
La tyrannie de l'horloge
La tyrannie de l'horloge
Ex: http://frontalternationaliste.hautetfort.com/
"En aucun domaine, les sociétés occidentales existantes ne se distinguent des sociétés antérieures, qu’elles soient européennes ou orientales, que dans celui de la conception du temps. Pour le Chinois ou le Grec anciens, pour le berger arabe ou le paysan mexicain d’aujourd’hui, le temps est représenté par le cours cyclique de la nature, l’alternance du jour et de la nuit, le passage de saison en saison. Les nomades et les agriculteurs mesuraient et mesurent encore leurs jours depuis le lever jusqu’au coucher du soleil et leurs années en fonction du temps de la semence et du temps de la récolte, de la chute des feuilles et de la fonte des neiges dans les lacs et rivières.
Le paysan travaillait en fonction des éléments, l’artisan tant qu’il pensait nécessaire de perfectionner son produit. Le temps était perçu à l’intérieur d’un processus de changement naturel et les hommes n’étaient pas intéressés par son décompte exact. C’est pourquoi des civilisations hautement développées sous d’autres aspects usaient des moyens les plus primitifs pour mesurer le temps : le sablier avec son filet de sable ou d’eau, le cadran solaire inutilisable par temps couvert et la bougie ou la lampe dont la partie non consumée d’huile indiquait les heures. Tous ces dispositifs étaient approximatifs et inexacts, qui plus est, rendus souvent peu sûrs par les aléas météorologiques ou la paresse de l’approvisionneur. Nulle part dans le monde antique ou médiéval, il n’y eut plus d’une petite minorité d’hommes concernée par le temps en terme d’exactitude mathématique.
L’homme moderne occidental vit toutefois dans un monde régi par les symboles mathématiques et mécaniques du temps de l’horloge. L’horloge dicte ses mouvements et domine ses actions. L’horloge transforme le temps, de processus naturel qu’il était, en marchandise, qui peut être quantifiée, achetée et vendue comme de la soupe et du raisin. Et, parce que sans quelques moyens de garder l’heure exacte, le capitalisme industriel n’aurait jamais pu se développer et ne pourrait continuer à exploiter les travailleurs, l’horloge représente un élément de tyrannie mécanique dans la vie des hommes modernes, plus puissant que n’importe quelle autre machine."
George Woodcock
00:32 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : temps, horloge, philosophie, politique, tiers monde, occidental, homme occidental |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 23 juin 2009
Aristocratismo libertario
Aristocratismo libertário

Os Anarquistas de Direita (Fonte)
O anarquismo não é, contrariamente ao que poderíamos pensar, um movimento de sentido unívoco. Podemos identificar três tendências dominantes: à partida um anarquismo bruto, cujo genitor é Max Stirner, que rejeita os dados humanistas tradicionalmente admitidos e que valoriza um individualismo exclusivo. Depois um anarquismo de esquerda saído da filosofia «iluminista», que visa a emancipação dos povos e o exercício do poder político por todos, mesmo a custo de acções violentas e radicais. Por fim um anarquismo de direita, ou aristocratismo libertário, que coloca radicalmente em causa os princípios de 1978, não numa perspectiva contra-revolucionária, mas em nome de uma revolta individual contra todos os poderes instituídos. A definição dada de anarquismo de direita é a de uma revolta individual, em nome de princípios aristocráticos, que pode ir até à recusa de toda a autoridade instituída. Mas o anarquismo de direita não é um simples individualismo. Recusa a democracia, as normas rígidas dos pensamentos e dos comportamentos nascidos com a revolução industrial e defende os valores aristocráticos tradicionais da nação. É importante precisar relativamente a esta corrente cultural, que a conotação indecisa que se liga à expressão «anarquismo de direita», tem mais a ver com o descrédito e a ocultação que sofreu durante muito tempo no mundo das ideias dominado pela ideologia democrática do que com a aparência paradoxal do anarquismo de direita.
1-A recusa da Democracia
É o próprio fundamento do anarquismo de direita, toda a sua ideologia se constrói efectivamente em oposição ao postulado igualitário de 1789. O que choca os anarquistas de direita na ideologia democrática é a sua referência constante aos critérios quantitativos. Esta afirmação é particularmente significativa, não só porque os anarquistas de direita não reconhecem de todo a proeminência do número como consideram a dimensão colectiva nefasta ao homem. Portanto, situar toda a ambição político-filosófica numa perspectiva quantitativa, como fazem os democratas, conduz necessariamente a um nivelamento intelectual e moral que coloca em perigo «a inteligência, a capacidade criativa e a singularidade», segundo Michel-Georges Micberth. Pretender falar em nome do povo, das massas e dos homens é um golpe muito duro contra a verdadeira lei da espécie que é que a maioria viva em uníssono com a elite, isto é, com os homens raros, competentes e moralizados, que concebem, decidem e aceitam sozinhos os verdadeiros riscos. «Foi ao ser capaz de morrer por algo incompreensível para as maiorias, que uma pequena raça de homens conseguiu durante séculos fazer-se respeitar pela turba (Anouilh). Escreve Céline:« apenas há exploradores e explorados, e cada explorado apenas pretende tornar-se explorador. Não compreende outra coisa. O proletariado heróico igualitário não existe». Daí a aversão profunda sentida pelos anarco-direitistas face à «divisão da humanidade em duas facções mais ou menos iguais: os carrascos e as vítimas» (Darien), e neste contexto de democratismo crescente, em relação a tudo o que é multidão, mistura indiferenciada, movimento de massas, predominância quantitativa. Definir a liberdade como um principio colectivo parece incoerente. A liberdade escolhe-se e constrói-se graças à vontade e à energia, e apenas pode ser escolhida por um pequeno número. A recusa da democracia aparece então como um princípio filosófico. O anarquista de direita recusa, por isso, a República. Esta simboliza a decadência à vez moral e política. Considera o sistema politica instável, corrompido e ineficaz. Segundo ele, a burguesia detém efectivamente o poder e disfarça a sua dominação sob um semblante democrático que conduz a uma tirania colectiva. Os anarquistas de direita não encontram o seu universo moral e político nos princípios e realidades democráticas.
2-O ódio aos intelectuais
Os anarquistas de direita odeiam os intelectuais não somente porque estes são os inventores da democracia mas também porque representam a reclusão de certos pensadores no mundo das ideias. Os anarquistas de direita denunciam uma teimosia específica, acrescida de impotência, criticam uma submissão ao espírito dos tempos e realçam sobretudo um divórcio entre o pensamento e a realidade que constitui, na perspectiva anarco-direitista, um pecado capital. A hostilidade não está vinculada por opões partidárias, ela visa tudo o que é de natureza estritamente teórica, todos aqueles que colocam o seu gosto pela hipótese e pela metáfora antes da experimentação e das duras lições dos factos. Os intelectuais não são somente criadores literários ou construtores de sistemas filosóficos; têm por ambição determinar novas e grandes orientações políticas que acabam por intervir no domínio da acção, portanto a sua confusão e irresponsabilidade representam para os anarquistas de direita um perigo real. Porque para os anarco-direitistas os intelectuais pensam contra o homem, contra o seu presente e o seu porvir, indo no sentido das suas fraquezas, e popularizando um gosto pela abstracção e a irrealidade que apenas pode alienar o homem duma interpretação correcta dos factos.
3-Uma revolta constitutiva para um ideal libertário e aristocrático
Pouco preocupados com agradar ou desagradar, ainda que propensos (por vezes) aos gestos de bravura literários, os anarquistas de direita não limitam a sua busca pela verdade a uma crítica radical da realidade e dos princípios democráticos assim como à expressão de uma hostilidade dirigida contra os intelectuais, manifestam uma oposição igualmente violenta em relação às instituições que estruturam a sociedade e que, emanações directas ou indirectas do poder republicano, não se apoiam, segundo eles, sobre qualquer legitimidade real. De qualquer forma, esta crítica da validade ideológica de todos estes poderes instituídos não explica por si só a violência da sua rejeição, há outras razões que os levam a rejeitar sem nuances as estruturas dominantes: Logo à partida a convicção de que estas prolongam as imemoriais relações de força destinadas a escravizar os indivíduos e a refrear o normal exercício da inteligência, depois o desprezo que sentem pelo apetite de honrarias e de poder que existe na maior parte dos homens e que permite a imutabilidade das relações sociais desnaturados, enfim essa certeza segundo a qual os grandes corpos institucionais ameaçam gravemente o bem mais precioso do homem: a liberdade. A revolta é, para os anarquistas de direita, um dever intelectual e moral, à vez um acto de (legítima) defesa da inteligência e um teste infalível da qualidade dos homens. Compreendemos face a esta revolta profunda que a sua preocupação foi sempre demarcar-se definitivamente, não só da moral comum, da dos “bem-pensantes”, mas de toda a recuperação ideológica, correndo o risco de se tornarem para sempre escritores malditos, verdugos dos outros, e deles mesmos, não por uma qualquer perversão do pensamento, mas por amor à verdade, dita, escrita e procurada, até à exaustão. O anarquista acredita que é preciso responsabilizar os homens. O anarquista de direita propõe uma filosofia do “eu”. Este “eu” deve ser violento, exigente, lúcido e criador.
O anarquista defende o aristocratismo, que é para ele a procura perpétua da excelência, através dos valores da Honra e da Fidelidade. Em conclusão, o anarquismo de direita, movimento libertário que nasceu no século XIX e cujas raízes se encontram na filosofia barroca e libertina não é a denominação vaga e ambígua de uma revolta egocêntrica que encontraria os seus alimentos literários num sobressalto de individualismo. O anarquismo de direita é uma busca insistente da verdade, por vezes enraivecida e exacerbada, e resulta num novo modo de ser e pensar para a consciência humana. Nesta perspectiva, a recusa da democracia não surge como um combate inesperado contra um fim inelutável. Mas antes como um dos últimos bastiões onde ainda se podem esconder a inteligência e a singularidade humanas. É de notar que as aspirações libertárias que são aqui preconizadas são indissociáveis das exigências morais mais rigorosas e que o interesse da proposta anarco-direitista reside no esforço para criar uma síntese entre o anarquismo, a expressão da liberdade mais total, e o aristocratismo, o reconhecimento de valores superiores ao indivíduo.
Bibliografia:
- François Richard, Les anarchistes de droite, Collection Que sais-je, PUF, 1991. Este livro é uma síntese de todo o pensamento anarco-direitista e permite uma visão global do que representa o movimento. É completo e não é um manifesto para o anarquismo de direita. O autor faz prova de rigor tornando-o o mais objectivo possível.
– Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Collection Folio, Gallimard, 1952. Esta obra permite apreender o anarquismo de direita na literatura.
– http://www.19e.org/articles/anarchistededroite.htm. Este site permite compreender o que pode ser o anarquismo de direita, permite familiarizar-se com as noções desta corrente de pensamento.
– http://fr.wikipedia.org/wiki/L’anarchisme_de_droite. Este site permite, como o anterior, descobrir o pensamento anarco-direitista mas também encontrar todos os autores referenciados nesta corrente.
– http://www.micberth.com. Site integralmente dedicado a Michel-Georges Micberth.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conservatisme, aritocratisme, libertaires, littérature, lettres, anarchisme, anarchisme de droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 juin 2009
Fukuyama persiste et s'obstine

Fukuyama persiste et s'obstine... |
| « En 1992, Francis Fukuyama publiait son fameux essai sur la fin de l’Histoire, affirmant que l’éternelle guerre des idéologies politiques était terminée et que le concept de la démocratie libérale avait triomphé. Seize ans plus tard, le retour de l’autoritarisme russe, la stabilité du gouvernement communiste chinois et le renforcement des théocraties moyen-orientales semblent avoir donné tort à l’universitaire américain. […] Pour Francis Fukuyama, les prémisses de sa théorie sont toujours valables : malgré la Chine ou la Russie, la démocratie libérale reste la seule forme de gouvernement globalement acceptée, une sorte d’idéal vers lequel tendent la plupart des pays. "Bien entendu, reconnaît l’universitaire, plusieurs groupes affirment le contraire, comme les islamistes fondamentalistes, mais sur le long terme, je suis confiant, le système démocratique est le seul viable". »
L’Hebdo, 2 octobre 2008 Il faut croire que dans certains esprits, les théories a propri sont plus têtues que l’épreuve des faits… Et pourtant non, Francis, l’Histoire n’est pas terminée et elle ne le sera jamais tant qu’il y aura des hommes sur cette planète ! Car prendre en main son histoire, en tant que peuples et en tant qu’individus, relève d’une liberté inaliénable, celle de l’auto-détermination ; une liberté que les penseurs libéraux, qui n’ont pourtant que ce mot à la bouche, ne semblent pas prêts de nous accorder – ce qui importe peu car nous ne demandons pas leur autorisation. Après « l’horizon indépassable » des lendemains qui chantent soviétiques, les prophètes atlantistes voudraient nous faire croire à un avenir déterminé fait de mondialisme et de démocratie de marché. A en croire la voix des peuples du monde, il n’est pas sûr que nous allions dans ce sens…
|
00:25 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fukuyama, philosophie, occidentalisme, libéralisme, histoire, fin de l'histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 juin 2009
Johann Nepomuk Ringseis (1785-1880)

SYNERGIES EUROPÉENNES - DÉCEMBRE 1992
Robert STEUCKERS:
RINGSEIS, Johann Nepomuk 1785-1880
Né le 16 mai 1785 à Schwarzhofen en Bavière, le jeune Ringseis, très tôt orphelin, fréquentera l'école abbatiale des Cisterciens à Walderbach, puis le séminaire d'Amberg, avant de commencer des études de médecine en 1805 à Landshut sous la direction d'Andreas Röschlaub, dont il deviendra l'assistant. Influencé par les Lumières lors de sa première année d'étude, Ringseis se dégage vite du rationalisme étroit sous l'influence des idées de Stolberg et des écrits de Baader et des romantiques (surtout Joh. Mich. Sailer). Les mesures de confiscation des biens d'église en Bavière, dues à l'influence française, le choquent, le révoltent et ancrent définitivement ses convictions anti-révolutionnaires . Ringseis entame une brillante carrière médicale; philosophes célèbres, membres de la famille royale bavaroise sont ses patients attitrés. Plusieurs séjours en Italie avec le Kronprinz de Bavière contribuent à conforter son catholicisme. Quand le prince héritier, devenu Louis Ier, monte sur le trône en 1825, Ringseis est nommé Obermedicinalrath (ce qui équivaut à Ministre de la santé), avec pour mission de réformer la médecine en Bavière. C'est dans le cadre de ces activités politico-médicales que paraît en 1841 son ouvrage le plus célèbre: System der Medizin. Avec l'appui du roi Louis Ier, Ringseis devient en quelque sorte le promoteur de la nouvelle université de Munich, où se télescoperont et se fructifieront mutuellement les idées protestantes et catholiques de l'époque. Son engagement ultramontain se précise. Entre 1848 et 1850, période agitée dans toute l'Europe, Ringseis participe à la vie politique bavaroise. En 1852, il quitte l'université pour marquer son désaccord avec les réformes envisagées mais y revient en 1855 et prononce un discours sur la nécessité de l'autorité dans les hautes sphères de la science. En 1872, à 87 ans, il quitte ses fonctions ministérielles. Il meurt à Munich le 22 mai 1880.
System der Medizin. Ein Handbuch der allgemeinen und speziellen Pathologie und Therapie; zugleich ein Versuch zur Reformation und Restauration der medicinischen Theorie und Praxis (Système de la médecine. Manuel de pathologie et thérapie générales et spéciales; en même temps tentative de réformer et de restaurer la théorie et la pratique médicales) 1841
Les thèses principales de cet ouvrage très contesté dans les milieux médicaux du XIXième siècle sont: a) chaque organisme est dominé par un principe vital unitaire et individuel; b) la santé est l'état dans lequel ce principe domine seul; c) la maladie est l'état dans lequel ce principe ne domine plus seul mais est troublé par un élément étranger qu'il ne peut pas assimiler ni dominer; d) la guérison survient quand la force vitale, éventuellement soutenue par des médications, soumet et assimile le principe étranger entré dans le corps, l'élimine ou le maintient inoffensif; elle est complète quand la force vitale spécifique règne à nouveau seule dans l'organisme. Ce qui est pertinent dans cet ouvrage de médecine, c'est que Ringseis perçoit nettement la faiblesse des rationalismes issus du "satanique Descartes": ceux-ci imposent une logique qui ne vaut que pour les phénomènes extérieurs, dispersés et juxtaposés dans l'espace, et rejettent toutes formes de logique qui vaudraient pour les phénomènes intérieurs, qui s'emboîtent les uns dans les autres et se compénètrent mutuellement. Cette idée d'un "imbriquement quasi infini" (ein fast unendliches Ineinander) rejoint les critiques contemporaines des rationalités unilinéaires et unidimensionnelles, notamment les épistémologies philosophiques inspirées par les sciences physiques modernes de Heisenberg à Prigogine, de même que certaines audaces postmodernes.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie complète, articles et discours universitaires et circonstantiels compris, dans E.R., "Johann Nepomuk Ringseis", Allgemeine Deutsche Biographie, 28. Band, Leipzig, Duncker & Humblot, 1889; comme textes principaux: Über den revolutionären Geist der deutschen Universitäten, Rectoratsantrittsrede, Munich, 1833; Manifest der bayerischen Ultramontanen, écrit anonyme, Munich, 1848; Über die Nothwendigkeit der Autorität in den höchsten Gebieten der Wissenschaft, Rectoratsantrittsrede, Munich, 1855 (2ième et 3ième éd. complétées, 1856); Über die naturwissenschaftliche Auffassung des Wunders, Munich, 1861; Über das Ineinander in den Naturdingen, texte publié par les Dr. Schmauß et Geenen dans Beilage zum Tagblatt der 36. Versammlung deutscher Naturforscher und Aertze in Speyer, 1861.
- En français: références in Georges Gusdorf, L'Homme romantique, Payot, 1984, pp. 273-277; Georges Gusdorf, Du néant à Dieu dans le savoir romantique, Payot, 1983, pp. 242-245.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne, bavière, catholicisme, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 juin 2009
L'animal est-il une personne?
 L’animal est-il une personne ?
L’animal est-il une personne ?
Longtemps nous avons considéré les animaux comme ceux que la nature avait privés des qualités que nous, les humains, possédons : l’aptitude à raisonner, apprendre, communiquer, s’adapter, décoder, transmettre, enseigner, progresser… Les travaux scientifiques ont pulvérisé cette idée reçue, et depuis la dernière décennie, ils nous surprennent encore plus. Qui sont vraiment les animaux ? On les savait joueurs, blagueurs, rieurs, féroces parfois ; on les découvre tricheurs, menteurs, trompeurs, mais aussi aimants, mélancoliques ou encore émotifs, stratèges, sensibles aux intentions d’autrui, capables de respecter une morale ou d’élaborer une culture. La très grande ingéniosité des tests et l’extraordinaire diversité des observations scientifiques (éthologie, génétique, psychologie, zoologie, primatologie, neurosciences) nous révèlent les facettes de l’intelligence et de l’identité animales, et prouvent l’absurdité qu’il y a à réduire les compétences de la bête à la seule force de son instinct. Car en dépit des caractéristiques qui fondent l’homogénéité de son espèce, chaque animal est un individu à part entière, un être social unique, complexe, et par là même un sujet de droit. Des singes aux léopards, des éléphants aux antilopes, des baleines aux dauphins, l’auteur nous propose une approche de l’altérité qui apporte beaucoup au débat sur l’exploitation et la manipulation animales. Un plaidoyer fort documenté en faveur de la personne animale.
Yves Christen, biologiste, spécialiste de la maladie d’Alzheimer, a mené des recherches en immunogénétique dans le laboratoire de Jean Dausset à l’hôpital Saint-Louis et en immunologie à l’institut Pasteur, avant de se spécialiser dans le domaine des neurosciences. Il a notamment publié Les Énigmes du cerveau (Bordas, 1989), Les Années Faust ou la Science face au vieillissement (Sand, 1991) et Le Peuple léopard. Tugwaan et les siens (Michalon, 2000).
Disponible sur Amazon
Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info
URL to article: http://qc.novopress.info/?p=5104
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : animal, animalité, personne, personnalité, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 mai 2009
Erik von Kuehnelt-Leddihn (1909-1999), der liberalkonservative Monarchist
Erik Ritter von Kuehnelt-Leddihn (1909-1999), der liberalkonservative Monarchist
Auch Julius Evola, ein brillanter, wenn auch perverser Denker der heidnischen Rechten, betrachtete den Faschismus als eine Bewegung der Linken, die nichts mit der wahren Rechten zu tun hatte.
(Eine Sprachregulierung: Was ist „faschistisch“?)
Allerdings hatte vieles was Kuehnelt-Leddihn in seiner persönlichen Gleichung lieb und rechts war, auch nichts mit der wahren Rechten zu tun. Dies gilt an erster Stelle für seinen ultrakapitalistischen Wirtschaftsliberalismus (der Freund Hayeks war auch in der Mont Pèlerin Society), der gerade die bürgerlichen Zerstörer der alten aristokratischen Ordnung abfeierte und den er gegen links verteidigte, nicht verstehend oder akzeptierend, daß die stets beklagte Proletarisierung und Egalitarisierung eben die Konsequenz dieser Freihandelsvergötzung war. Aber er war auch der Auffassung, die Monarchie würde den wirklichen Liberalismus (englisch und nicht französisch verstanden, empiristisch und nicht rationalistisch) schützen. Dazu kam sein Unverständnis für alle Konservative, die nicht katholisch sind. Wobei sein Katholizismus andererseits wiederum - entgegen gerade wieder verbreiteten Gerüchten - sehr liberal war (sein Verlag wirbt wohl zurecht mit einem Zitat des liberalkonservativen Paradetheologen Hans Urs von Balthasar), der Ökumene zugewandt, insbesondere philojudaistisch, nur nicht linkskatholisch (Befreiungstheologie, feministische Theologie, usw.), aber ganz gegen die "Traditionalisten" wie Marcel Lefebvre gerichtet, den er mit Martin Luther verglichen hat und dies nicht nur wegen des Ungehorsams, sondern auch weil er ihn als mittelalterlich empfand. (Tatsächlich war Kuehnelt-Leddihn ja wie die meisten "Konservativen" sehr fortschrittlich, er nannte dies "additiv"; siehe auch: Konservativismus und Subversion) Die "Tradition" in einem übergeordneten, integralen Sinne hat er wohl trotz seiner Begegnung(en) mit Evola nicht verstanden. Für ihn war nur ein christlicher Staat als Pyramide gedacht - entgegen dem ja gerade dem Christentum entstammenden Gleichheitsprinzip - akzeptabel, nicht-christliche "Pyramiden"-Gesellschaft, was wir als Kastensystem bezeichnen würden, waren für ihn so unakzeptabel wie egalisierte Gesellschaften:
Und ein heidnischer Vertikalismus kann furchtbar sein. Corruptio optimi pessima, hatte uns schon der Aquinate gewarnt. Das fühlte ich schon einmal in der Anwesenheit vom Baron Giulio Evola, der einer der brillantesten Verteidiger der atheistischen oder agnostischen Rechten war. Dieser Mann, der durch die Rachebombardierung der Alliierten auf Wien im März 1945 querschnittgelähmt war, redete zu mir in kalter Verachtung wie ein amerikanischer College-Professor zu einem Dshu-Dshu Praktiker am oberen Ubangi.
(Weltweite Kirche. Begegnungen und Erfahrungen in sechs Kontinenten 1909-1999; Stein am Rhein 2000; S. 502)
Das Bonmot, den adeligen Dandy mit einem US-College-Professor zu vergleichen, ist wieder Erik von Kuehnelt-Leddihn in einer Nußschale: so originell wie schief. Bei aller, kaum verdeckten Boshaftigkeit ("perverser Denker", "agnostische Rechte") war der Ritter, der im Juli vor 100 Jahren in Tobelbad geboren wurde und im Mai vor 10 Jahren in Lans gestorben ist, persönlich wohl liebenswert wie eine Figur aus einem Roman des Co-Wahltirolers Ritter Fritz von Herzmanovsky-Orlando: ein Dshu-Dshu Praktiker am oberen Ubangi der Tarockei.
15:04 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politique, théorie politique, conservatisme, droite, monarchisme, hommage, biographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 mai 2009
Goethe come fenomenologo

di Ludwig Klages
Fonte: tellus
Difficilmente il Romanticismo avrebbe ripreso con tanta decisione, com’è avvenuto, i simboli dell’androgino e del ginandro, se Goethe non gli fosse apparso come modello esemplare della congiunzione di tratti maschili e femminili. Noi non dobbiamo farci tante domande, sulle particolarità dell’anima maschile e femminile, poiché per i nostri scopi può bastare sapere che quella maschile è caratterizzata da un’attività estrovertita, quella femminile da una passività ricettiva. In quella si radica, perciò, il senso della fattualità; in questa il sentimento della realtà. Nel linguaggio comune non si tiene conto della distinzione tra realtà e fattualità, ma in filosofia queste non dovrebbero essere mai confuse. Mostriamo con un esempio la loro differenza. Nelle vicinanze di una città si trova in un prato un boschetto.
Questo è un “dato di fatto” (Tatsache) e - come tale - resta sempre il medesimo, indifferente a chi lo pensi e per quale scopo. Supponiamo che in una bella giornata d’estate si trovino davanti al boschetto tre persone: uno speculatore edilizio, un botanico, un pittore di paesaggio, tutti e tre rivolti al medesimo oggetto percettivo, cioè al boschetto. Lo speculatore edilizio, esaminato di sfuggita il bosco, fa un calcolo approssimativo: la stima della grandezza della superficie, il valore di vendita del legno abbattuto, il terreno necessario alla costruzione di un caseggiato, il valore crescente del terreno, perché al massimo in due anni vi passerà davanti una ferrovia, con una fermata poco lontano ecc... Il botanico ha immediatamente notato un’orchidea, più lontano del legno di tasso, e confida di servirsene per il proprio erbario. Per entrambi, come si nota, l’oggetto percettivo è divenuto all’istante un oggetto del pensiero, ed entrambi hanno subito posto l’oggetto del pensiero al servizio di interessi personali, per quanto notevolmente differenti l’uno dall’altro.
Entrambi si comportano quindi in modo spiritualmente attivo, e - se avvertiti - sarebbero anche capaci di riflettervi sopra. Ma una attività spirituale o azione era già presente a loro insaputa nella costituzione dell’oggetto percettivo stesso, nella misura in cui esso è un dato di fatto, ovvero un prodotto del giudizio. Ci convinciamo di ciò passando ad un breve esame di quel che ha vissuto intanto la terza persona, il pittore di paesaggio. Anch’egli ha innanzitutto percepito il medesimo gruppo di alberi, ma subito il suo sguardo indugia sulle forme dei tronchi, sulle masse di foglie in movimento e sulle loro tonalità di colore, da lì passa all’azzurro del cielo d’estate e al bianco di un gruppo di nubi più distante, racchiude - in ogni caso senza la minima riflessione - tutto ciò in una immagine, davanti a cui l’osservatore trascura di fissare in concetti il fatto percettivo “là c’è un bosco ed io sono qui”. Senza per ora indagare il senso di quel che gli accade, riconosciamo tuttavia già una cosa: tanto più l’artista è avvinto dall’immagine intuita, quanto più la sua condotta, da spiritualmente attiva, diventa passivamente ricettiva, e con ciò in egual misura il suo contenuto percettivo perde il carattere di fatto oggettivo.
Supponiamo, cioè, che a causa di un impulso interno, su cui torneremo, egli si senta indotto a trasferire l’immagine intuita sulla tela, ed inizi così subito uno schizzo di colori, ma non riesca a finirlo nel tempo stabilito e si veda costretto a rinviarlo successivamente; allora facilmente accade che il suo oggetto, se vogliamo chiamarlo così, nel frattempo è scomparso e ha lasciato il posto ad un oggetto essenzialmente diverso.
Il tempo è improvvisamente mutato, nubi grigio cupo si addensano nel cielo, gli alberi si piegano nella tempesta, e infine comincia a piovere. Il fatto (il bosco qui sul posto) è rimasto lo stesso, l'immagine intuita è divenuta un’altra. E se ora il nostro pittore dovesse intraprendere un lungo viaggio, per poi ritornare nel tardo autunno, egli incontrerebbe allora nello stesso posto un'immagine intuita che, per così dire, sembrerebbe appartenere ad un altro mondo. Ma è necessario generalizzare la nostra considerazione.
La realtà delle immagini intuite o, come si preferisce, dei fenomeni (Erscheinun-gen), si trova in incessante trasformazione; perciò i fatti, a cui ci riferiamo col pensiero come a stati di cose in sé identici di contro a questo stesso mondo fenomenico, sono prestazioni del nostro spirito, anche se a noi estorte in occasione dell’esperienza sensibile, e per questo senza dubbio prestazioni compiute necessariamente.
Ma se qualcuno si ponesse la domanda, perché attribuiamo una realtà originaria ai fenomeni e ai fatti solamente una derivata, allora dovrebbe bastare a convincerlo la seguente indicazione: il contenuto dell'oggetto del pensiero a poco a poco s'impoverirebbe e infine svanirebbe nel nulla col venir meno dell'esperienza intuitiva. Se si privasse di conseguenza l’essere vivente della vista, dell’udito, dell’odorato, del gusto, e infine anche del tatto, il suo oggetto del pensiero sarebbe progressivamente cancellato, finché alla fine non rimarrebbe più nulla con cui il suo spirito possa cimentarsi.
Chiediamoci ora quale profitto nelle proprie ricerche Goethe dovette al proprio lato femminile, ovvero all’eccitabile sentimento della realtà. Ci colpisce in primo luogo la fondamentale importanza che egli, in opposizione all’intera filosofia a partire da Cartesio, inclusi i più notevoli pensatori del proprio secolo, ha attribuito all’intuizione (Anschauung) come formazione conoscitiva. Egli riscoprì ciò che si era chiamato nei secoli precedenti - con espressione felice, ma con altri intenti - visio sine comprehensione, e per questo è divenuto - in opposizione perfino alla scienza del proprio tempo - il primo moderno fenomenologo (Erscheinungsforscher). Per l’importanza che ha, questo fatto esige un adeguato riconoscimento.
Se Goethe ritrova la fonte delle sue più notevoli convinzioni - una parola, che è tratta dal senso della vista - nelle immagini intuite del mondo, e specialmente, in quelle visive, allora si potrebbero trovare d’accordo con ciò il fisico, il “sensualista”, se solo non risultasse decisiva ’aggiunta, che - grazie ad una proprietà subito da discutere - la ad una proprietà subito da discutere - la contemplazione in questione permetterebbe alla facoltà di giudizio il ritrovamento immediato della verità; con ciò restituiamo al termine intuizione (Intuition), oggi logorato dall'uso popolare, il suo vero significato, che dovrebbe essere reso con “feconda illuminazione mediante visione (Anschauung)” o, più brevemente, con “ispirazione” (Eingebung). Spinoza aveva inoltre compreso qualcosa di diverso, cioè un tipo di evidenza immediata simile a quella usata dai matematici; ma Goethe crede, anche in questo caso, di poter fare affidamento su di essa. «Se tu dici», scrive nel 1785 a Jacobi, «che in Dio si può soltanto credere, io invece ti dico che attribuisco grande valore al contemplare, e se Spinoza parla di scientia intuitiva..., a me queste poche parole danno il coraggio di dedicare la mia intera vita all'osservazione delle cose»; e ancora nel 1801: se la filosofia «innalza, consolida e trasforma in un profondo, quieto intuire il nostro originario sentimento di essere una cosa sola con la natura, allora è la benvenuta». Tale capacità egli la chiama altrove “giudizio intuitivo” (anschauende Urteilskraf). Chi infine riuscisse a cogliere lo spirito di una frase simile: «I miei studi sulla natura si basano solo sull’esperienza», noterà - forse con proprio stupore - che è impossibile rinvenire nella fisica, anzi in tutte le scienze della natura, la parola che qui Goethe adopera come “fondamento” della propria intera ricerca: la parola erleben! E se costui considerasse, ancora, i due versi molto citati: «Chi è in relazione con la propria Madre, la Natura, questi trova nel calice a stelo tutto un mondo», allora forse si potrebbe insinuare in lui un sospetto: che la frattura metafisica (die metapbysische Spalte) non sia tra le cosiddette scienze della natura e le cosiddette scienze dello spirito, bensì fra entrambe e la scienza della vita, iniziata, nell’età moderna, con Goethe. La possibilità di una scienza dei fenomeni deve essere intanto garantita non da un mero cambiamento di metodo, bensì da un radicale cambiamento nel porre la questione. L’indagine dei fatti è indagine delle cause: ma le cause non sono trovate dall’Intuizione intellettuale, o come la si voglia chiamare.
D’altra patte il termine fenomeno (Erscheinung), se deve avere un senso, può solo significare l’apparire di un qualcosa, il manifestarsi di un’anima in tutti gli eventi, o il rivelarsi di un’essenza in esso. Abbiamo lasciato in sospeso, che cosa senta propriamente il pittore, quando si affida all'immagine intuita, e il motivo che lo induce a voler fissare con l’aiuto di un’immagine ritratta il contenuto della propria esperienza vitale. Vuole realmente produrre una mera copia, come potrebbe anche fare una lastra sensibile alla luce? La risposta è: quanto più egli s’imbatte nello stato della contemplazione, che gli antichi a ragione chiamavano ’patico’, tanto più entra in relazione con l’anima dell’immagine; e quel che egli, perciò, si sente spinto a trasferire sulla tela, non è tanto una copia del bosco, quanto piuttosto un’apparizione dell’anima del bosco. Con ciò conosciamo il senso di quella trasformazione, che è negata al fatto percettivo oggettivo: la vita insita nei fenomeni, che - in quanto tale - oscilla senza stabilità tra l’andare e il venire. Indagarla, per così dire, attraverso il fenomeno, è il compito degli spiriti fedeli alla vita, e solo questi sono veri fenomenologi. Proprio questo intendeva Goethe.
Egli ha pubblicato nel 1776 un geniale saggio sullo scultore francese Falconet, che - come ogni sua opera - è un frammento autobiografico, ma riguardante questa volta della propria cosiddetta originaria visione del mondo. Riportiamo alcuni dei passi più fortemente probatori. L’artista «può entrare nella bottega di un calzolaio o in una stalla; può guardare il volto dell’amata, i propri stivali o l’arte antica, dappertutto vede le sacre vibrazioni... con cui la Natura congiunge ogni cosa. Ad ogni passo gli si schiude il mondo magico, quello stesso che fervidamente e continuamente ha avvolto le opere dei grandi maestri, alla cui riverenza è spinto ogni artista che voglia emularli. Ogni uomo ha più volte sentito nella propria vita la forza di questo incantesimo... Chi entrando in un sacro bosco, non è stato assalito neppure una volta da un brivido? Chi l’avvolgente notte non ha assalito con inaudito terrore? A chi, in presenza dell’amata, il mondo intero non è apparso dorato?... Ecco, ciò che si agita nell’anima dell’artista, ciò che tende all’espressione più chiara, senza la mediazione del conoscere».
Assumiamo ora, che lo stato sopra descritto generi la facoltà di giudizio, accordiamogli ispirazioni, intuizioni; il risultato sarebbe allora un sapere riguardante l’essenza dei fenomeni, e per il ricercatore volto a ciò un definitivo chiarimento, una rivelazione, per così dire, illuminata dalla quale l’immagine intuita otterrebbe il carattere del “fenomeno originario”, irriducibile a ogni riflessione. Nelle Sentenze in prosa si dice: «Tutto ciò che chiamiamo, nel senso più elevato, invenzione, scoperta, è l’importante attività [...] di un innato sentimento della verità che, a lungo formatosi nel silenzio, improvvisamente come un lampo porta ad una intuizione feconda. Esso è una rivelazione che si sviluppa dall’interno verso l’esterno».
Quando Novalis, a proposito dei principi d’indagine del Romanticismo, che proseguì il cammino iniziato da Goethe, enuncia l’espressione oscuramente sibillina: «All’interno va il misterioso cammino», con questa egli non intende che - in modo simile ad una contemplazione “narcisistica” - si debba volgere lo sguardo a se stessi e distoglierlo dal mondo dei fenomeni, bensì che allo spirito l’occhio si apre soltanto nella dedizione al mondo delle immagini, per cui esso contempla ciò che appare nei fenomeni e trova nell’esteriore qualcosa di interiore, la cui vita sempre in trasformazione si esprime nell’esteriore. In altre parole, la meta della fenomenologia è un’indagine dell’essenza (Wesensforscbung), altrimenti non vi sarebbe più neppure un’indagine dei fenomeni!
Il testo di Ludwig Klages fa parte del volume Goethe als Seelenforscher (1932) edito da Bouvier, Berlin-Bonn.
© traduzione Mario Clerici
© Marco Baldino, 1996
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, philosophie, révolution conservatrice, psychologie, phénoménologie, romantisme, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Livres sur Nietzsche

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
Livres sur Nietzsche
Recensions de Robert Steuckers
Tarmo Kunnas, Nietzsches Lachen. Eine Studie über das Komische bei Nietzsche, Edition Wissenschaft & Literatur, München, 1982.
Le comique chez Nietzsche est un thème, pense le philosophe et essayiste polyglotte finlandais Tarmo Kunnas, qui n'a guère été exploré. C'est le pathos nietzschéen, son romantisme fougueux, bruyant, qui séduit d'emblée et capte les attentions. Rares sont les observateurs, bons connaisseurs de l'œuvre complète de Nietzsche, qui ont pu percevoir l'ironie cachée, le sourire dissimulé, qui se situe derrière les aphorismes tranchés, affirmateurs et romantiques. Nietzsche se sentait trop solitaire, trop menacé, pour se permettre un humour souverain, direct, immédiat, sans fard. Tarmo Kunnas explore toute l'œuvre de Nietzsche pour y repérer les éléments de satire, d'ironie, d'humour et de parodie. Il nous révèle les mutations, les glissements qui se sont produits subrepticement depuis sa jeunesse idéaliste jusqu'à la veille de sombrer dans la folie.
Tarmo Kunnas, Politik als Prostitution des Geistes. Eine Studie über das Politische bei Nietzsche, Edition Wissenschaft & Literatur, München, 1982.
Nietzsche a été politisé, mobilisé par des partisans, mis au service des causes les plus diverses. Pour Tarmo Kunnas, Nietzsche est plutôt «anti-politique», hostile à l'emprise croissante du politique sur les esprits. Méticuleusement, il analyse la critique du système partitocratique chez Nietzsche, ses tendances anti-démocratiques, ses propensions à l'aristocratisme, son refus de l'idéologème «progrès», son anti-socialisme, son anti-capitalisme, son anti-militarisme et, finalement, les rapports entre Nietzsche et le nationalisme, entre Nietzsche et le racisme (l'anti-sémitisme).
Richard Maximilian Lonsbach, Friedrich Nietzsche und die Juden. Ein Versuch (zweite, um einen Anhang und ein nachwort erweiterte Auflage), herausgegeben von Heinz Robert Schlette, Bouvier Verlag / Herbert Grundmann, Bonn, 1985.
R. M. Lonsbach est le pseudonyme de R. M. Cahen, avocat israëlite de Cologne, émigré en Suisse en 1937, revenu dans sa ville natale en 1948. Cahen/Lonsbach était un admirateur de Nietzsche et son petit livre, aujourd'hui réédité, est une réfutation radicale des thèses qui font de Nietzsche un antisémite rabique. Ecrit dans l'immédiat avant-guerre, en 1939, ce livre a enregistré un franc succès dans les milieux de l'émigration allemande, ainsi qu'en Pologne, aux Pays-Bas et en Scandinavie. Il réfutait anticipativement toutes les théories de notre après-guerre qui ont démonisé Nietzsche. C'est en ce sens que cet ouvrage est un document indispensable. Malgré l'ambiance anti-nietzschéenne de l'Allemagne américanisée, Lonsbach/Cahen ne modifia pas sa position d'un iota et réaffirma ses thèses lors d'une émission radiophonique en 1960. Le texte de cette émission est également reproduit dans ce volume édité par H. R. Schlette.
Henry L. Mencken, The Philosophy of Friedrich Nietzsche, The Noontide Press, Torrance (California), 1982 (reprint of the first edition of 1908).
Journaliste brillant, fondateur de l'American Mercury, auteur d'un livre vivant sur la langue anglo-américaine, Henry L. Mencken, dont l'ampleur de la culture générale était proverbiale, écrivit également un essai sur Nietzsche en 1908. Pour l'Américain Mencken, Nietzsche est un transgresseur, sa pensée constitue l'antidote par excellence au sentimentalisme démobilisateur qui exerçait ses ravages à la fin du XIXème siècle. Mencken admire l'individualisme de Nietzsche, son courage de rejetter les modes et les dogmes dominants. Curieusement, Mencken croit repèrer un dualisme chez Nietzsche: celui qui opposerait un dyonisisme à un apollinisme, où le dyonisisme serait vitalité brute et l'apollinisme, vitalité de «seconde main», une vitalité dressée par les convenances. Les castes de maîtres seraient ainsi dyonisiennes, tandis que les castes d'esclaves seraient apolliniennes, parce qu'elles soumettent leur vitalité au diktat d'une morale. Cette interpétation est certes totalement erronée mais nous renseigne utilement sur la réception américaine de l'œuvre de Nietzsche. Dans le chef de Mencken, la pensée de Nietzsche devait compléter et amplifier celles de Darwin et Huxley, dans l'orbite d'un univers intellectuel anglo-saxon dominé par l'antagonisme entre l'«individualisme» de l'auto-conservation et l'«humanitarisme» du christianisme moral.
Mihailo Djuric und Josef Simon (Hrsg.), Kunst und Wissenschaft bei Nietzsche, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1986.
Ouvrage collectif sur l'esthétisme nietzschéen, ce volume contient un article centré sur l'histoire des idées de Descartes à Nietzsche, chez qui les concepts traditionnels d'«imagination» et d'«intuition» acquièrent progressivement une dimension entièrement nouvelle (Tilman Borsche: Intuition und Imagination. Der erkenntnistheoretische Perspektivenwechsel von Descartes zu Nietzsche). Mihailo Djuric évoque longuement la fusion de la pensée et de la poésie dans le Zarathoustra (Denken und Dichten in "Zarathustra"). Diana Behler passe au crible la métaphysique de l'artiste ébauchée par Nietzsche (Nietzsches Versuch einer Artistenmetaphysik). Goran Gretic étudie, quant à lui, la problématique de la vie et de l'art, dans laquelle se repère le renversement proprement nietzschéen: la métaphysique se fonde dans l'homme; donc, le chemin de la pensée ne passe pas nécessairement par l'homme pour accéder à l'Etre mais va de l'homme à l'homme.
Josef Simon (Hrsg.), Nietzsche und die philosophische Tradition, Band I u. II, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1985.
Deux volumes comprenant dix études sur Nietzsche. Parmi celles-ci, un essai de Volker Gerhardt sur le «devenir» dans la pensée de Nietzsche (Die Metaphysik des Werdens. Über ein traditionelles Element in Nietzsches Lehre vom "Wille zur Macht"); une étude de Tilman Borsche sur le redécouverte des présocratiques chez Nietzsche (Nietzsches Erfindung der Vorsokratiker). Le Japonais Kogaku Arifuku compare, lui, les fondements du bouddhisme, dont la vision du vide (sunyata), avec la définition nietzschéenne du nihilisme (Der aktive Nihilismus Nietzsches und der buddhistische Gedanke von sunyata [Leerheit]). Günter Abel analyse la philosophie de Nietzsche au départ d'une réinvestigation de l'héritage nominaliste (Nominalismus und Interpretation. Die Überwindung der Metaphysik im Denken Nietzsches). Abel définit le nominalisme comme une vision du monde qui perçoit celui-ci comme un monde d'individualités, où aucun «universel» n'a d'assise solide, où les principes doivent être manipulés avec parcimonie si l'on ne veut pas choir dans les «schémas» déréalisants, où les assertions doivent se référer à un «contexte» précis; ce monde-là, enfin, est fait, de finitudes concrètes, non d'infinitudes transcendantes. Josef Simon étudie, lui, le concept de liberté chez Nietzsche (Ein Geflecht praktischer Begriffe. Nietzsches Kritik am Freiheitsbegriff der philosophischen Tradition).
Mihailo Djuric u. Josef Simon (Hrsg.), Zur Aktualität Nietzsches, Band I u. II, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1984.
Onze textes magistraux, consacrés au visionnaire de Sils-Maria. Dont celui de Günter Eifler sur les interprétations françaises contemporaines de l'œuvre de Nietzsche (Zur jüngeren französischen Nietzsche-Rezeption). Mihailo Djuric se penche sur la question du nihilisme (Nihilismus als ewige Wiederkehr des Gleichen). Branko Despot démontre avec un extraordinaire brio comment le temps, la temporalité, suscite la «volonté de puissance». La vie, qui est «devenir», ne connait aucune espèce d'immobilité, mais le «déjà-advenu» impose des critères qui ne peuvent pas être ignorés, comme si le «déjà-advenu» n'avait jamais, un jour, fait irruption sur la trame du devenir et n'y avait pas laissé son empreinte. Dans la lutte «agonale», le surhomme doit affronter les aléas nouveaux et les legs épars du passé, vestiges incontournables. Le temps est donc lui-même volonté de puissance, puisque l'homme (ou le surhomme) doit se soumettre à ses diktats et épouser ses caprices, se lover dans leurs méandres (B.D., Die Zeit als Wille zur Macht). Tassos Bougas s'interroge sur le retour au monde préconisé par Nietzsche (Nietzsche und die Verweltlichung der Welt); son objectif, c'est de repérer les étapes de cette immanentisation et de dresser le bilan de la contribution nietzschéenne à ce processus, à l'œuvre depuis l'aurore des temps modernes (T.B., Nietzsche und die Verweltlichung der Welt). Friedrich Kaulbach et Volker Gerhardt se préoccupent de l'esthétisme nietzschéen et de sa «métaphysique de l'artiste» (F.K., Ästhetische und philosophische Erkenntnis beim frühen Nietzsche; V.G., Artisten-Metaphysik. Zu Nietzsches frühem Programm einer ästhetischen Rechtfertigung der Welt).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne, nietzsche, livres |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 22 mai 2009
200 Jahre Donoso Cortés
200 Jahre Donoso Cortés
von Marc Stegherr : Ex: http://www.sezession.de/
Kaum war die Exkommunikation der vier Bischöfe der »ultratraditionalistischen« Piusbruderschaft aufgehoben, ergossen sich über den Papst und die katholische Kirche, vor allem aus Deutschland, Fluten an unsachlichen, tendenziösen Kommentaren, die mit der Sache rein gar nichts mehr zu tun hatten.
Man mußte sich fragen, ob jene Theologen und Kirchenvertreter, die die katholische Kirche unablässig zum Frieden mit der Moderne drängen, nicht mit Blindheit geschlagen sind. Die Moderne ist in ihrem Ursprung eine Häresie gegen das Geoffenbarte, das Verbindliche. Der liberale Kulturhistoriker Peter Gay nannte nicht von ungefähr seine kürzlich erschienene Geschichte der Moderne die »Verlockung der Häresie« (The Lure of Heresy).
Die heftigsten Affekte der Moderne richten sich seit jeher gegen jene Institution, die die moderne Häresie, den Kult des Relativismus (Benedikt XVI.), nicht mitmachen will. Die jüngsten Ausfälle haben gezeigt, daß diese Affekte nur ruhten, sie sind keineswegs Vergangenheit, und sie werden sich im Zeichen des »neuen Atheismus« weiter verstärken. Der katholische Staatsmann und Geschichtsphilosoph Juan Francisco María de la Salud Donoso Cortés, Marques de Valdegamas, der 1809 das Licht Spaniens erblickte, hatte keinerlei Illusionen, was die Phobien und die aggressive Konsequenz der politischen Irrlehren der Moderne betraf.
Seine Ansicht, daß es zwischen der gottverleugnenden Moderne, ihren Ausgeburten Liberalismus und Sozialismus, und dem Katholizismus keinen Kompromiß geben könne, weil die Moderne de natura auf die Ablösung, ja Vernichtung des Katholischen angelegt sei, diese Radikalität des Spaniers beeindruckte nicht nur das katholische Europa seiner Zeit. Carl Schmitt, der Donoso »gesamteuropäisch« interpretierte, rühmte dessen Klarsicht und Radikalität. Treffend sei Donosos Erkenntnis, daß die modernen Ideologien Ersatzreligionen sind, ihre Begriffe säkularisierte theologische Begriffe. Nur der Liberalismus weiche jeder begrifflichen Festlegung aus.
Auch die Kirche war zu Donosos Zeit keinesfalls frei von dieser tödlichen Krankheit der »diskutierenden Klasse«, der »clasa discutidora«, die nicht weiß, ob sie es »mit Barabbas oder mit Jesus halten soll«. Während das revolutionäre Europa, die Mazzini und Proudhon, sofort erkannten, welches polemische Genie ihrem spanischen Todfeind eignete, hielten sich die Vertreter des liberalen Katholizismus, vor allem in Frankreich, an Detailfragen seiner Schriften auf. Sie irritierte die von keinem Zweifel angekränkelte Glaubensfestigkeit Donosos, während Rom über diesen glänzenden Anwalt heilfroh war, und sein Hauptwerk, den Essay, mit dem höchsten Segen bedachte.
Nicht anders heute: Ein österreichischer Geistlicher, der von Rom zum Weihbischof ausersehen ist, weil er den Glauben seiner Kirche ohne Abstriche verkündet, wird von seinen liberalen Amtsbrüdern solange gemobbt, bis er seine Berufung ablehnt. Die Kirche, für die Donoso Cortés stritt, hatte noch einen Klerus und eine Theologenzunft, die weitgehend immun waren gegen die Verlockungen der modernen Häresien. Heute haben sie ihren Marsch durch die Institution Kirche soweit abgeschlossen, daß selbst Personalentscheidungen am linkskatholischen Widerspruch gegen das Orthodoxe scheitern.
Donoso hat das vorhergesehen. In seinem Hauptwerk charakterisiert er den Liberalismus als ein Phänomen einer Gesellschaft in Auflösung: »Die Zeit ihrer Herrschaft ist jene flüchtige Übergangsperiode, in der die Menschheit hin- und herschwankt zwischen radikaler Negation und gläubiger Hinnahme der Offenbarung.« Dann ist ihr eine Schule gerade recht, bei der alles Für ein Wider hat. Der Reformtheologe Hans Küng, den der Papst im Sommer 2005 noch in Audienz empfangen hatte, mischte dieser Tage ätzende Galle mit verlogener Diplomatie. Wenn der Papst sicher auch selbst nicht antisemitisch sei, so hätte doch jeder gewußt, daß die vier Pius-Bischöfe antisemitisch eingestellt sind. Wie einst der Kreml schirme sich der Papst vor seinen Kritikern ab. Donoso hatte recht. Der atheistische Sozialismus hätte wenigstens den Mut zur Negation. »Für den Liberalismus hat er nur Verachtung.« Dem ist nichts hinzuzufügen.
Bücher von Donoso Cortés:
Über die Diktatur. Drei Reden
Essay über den Katholizismus, den Liberalismus und den Sozialismus und andere Schriften
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, espagne, conservatisme, catholicisme, 19ème siècle, réaction |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 21 mai 2009
Julius Evola: Carlo Michelstaedter
Carlo Michelstaedter
par Julius Evola (dans: Explorations. Hommes et problèmes; Puiseaux 1989)
Carlo Michelstaedter est l'un des auteurs qui ont affirmé, à l'époque moderne, la nécessité pour l'individu de s'élever à l'être, à une valeur absolute en mettant fin à tous les compromis sous lesquels se masque une abios bios, une vie qui n'est pas vie, ne acceptant ce dont l'homme a plus peur que de toute autre chose: se mettre en face de soi, prendre sa propre mesure en fonction, précisément, de l'"être". L'état correspondant à l'être est appelé par Michelstaedter l'état de la "persuasion"; il est défini essentiellement comme une négation des corrélations. Chaque fois que le Moi ne pose pas en soi-même mais dans l'"autre" le principe de sa propre consistance, chaque fois que sa vie est conditionnée par des choses et relations, chaque fois qu'il succombe àdes dépendances et au besoin - il n'y a pas "persuasion", mais privation de valeur. Il n'y a valeur que dans l'existence en soi-même, dans le fait de ne pas demander à l'"autre" le principe ultime et le sens de sa propre vie: dans l'"autarcie", au sens grec du terme. Aussi bien l'ensemble d'une existence faite de besoins, d'affections, de "socialité", d'oripeaux intellectualistes et autres, mais aussi l'organisme corporel et le système de la nature (lequel, en tant qu'expérience, est compris comme engendré, dans son développement spatio-temporel indéfini, par la gravitation incessante en quête de l'être, qu'on ne possédera cependant jamais tant qu'on le cherchera hors de soi) (1), rentrent-ils dans la sphère de la non-valeur.
Le Moiqui pense être en tant qu'il se continue, en tant qu'il ignore la pléntitude d'une possession actuelle et renvoie sa "persuasion" à un moment successif dont il devient par là dépendant; le Moi qui dans chaque instant présent s'échappe à lui-même, le Moi qui ne se possède pas, mais qui se cherche et se désire, qui ne sera jamais dans un quelconque futur, celui-ci étant le symbole même de sa privation, l'ombre qui court en même temps que celui qui fuit, sur une distance entre le corps et sa réalité qui reste inchangée à chaque instant - tel est, pour Michelstaedter, la sens de la vie quotidienne, mais aussi la "non-valeur", ce qui "ne-doit-pas-être". Face à cette situation, le postulat de la "persuasion" est le suivant: l'autoconsistance, le fait de résister de toutes ses forces et à tout moment `a la déficience existentielle, ne pas céder à la vie qui déchoit en cherchant hors de soi ou dans l'avenir - ne pas demander,mais tenir dans son poing l'"être": ne pas "aller", mais demeurer (2).
Alors que la déficience existentielle accélère le temps toujours anxieux du futur et remplace un présent vide par un présent successif, la stabilité de l'individu "pré-occupe" un tempf infini dans l'actualité et arrête le temps. Sa fermeté est une traînée vertigineuse pour les autres, qui sont dans le courant. Chacun de ses instants est un siècle de la vie des autres - "jusqu'à ce qu'il se fasse lui-même flamme et parvienne à se tenir dans le présent ultime" (3). Pour éclairer ce point, il est important de comprendre la nature de la corrélation qui est contenue dans les prémisses: étant donné que le monde est compris comme engendré par la direction propre à la déficience, dont il est comme l'incarnation tangible, c'est une illusion de penser que la "persuasion" puisse être réalisée au moyen d'une consistance abstraite et subjective dans une valeur qui, comme dans la stoïcisme, aurait contre elle un être (la nature expérimentée) dont on peut dire que, pourtant sans valeur, il est. Celui qui tend à la persuasion absolue devraint en fait s'élever à une responsabilité cosmique. Ce qui signifie: je ne dois pas fuir ma déficience - que le monde reflète -, mais la prendre sur moi, m'adapter à son poids et la racheter. C'est pourquoi Michelstaedter dit: "Tu ne peux pas te dire persuadé tant qu'il reste une chose qui n'a pas été persuadée". Il renvoie à la persuasion comme "à l'extrême conscience de celui qui est un avec les choses, qui a en soi toutes les choses: e ounekes".
Pour rendre plus intelligible le problème central de Michelstaedter, on peut rattacher le concept d'insuffisance au concept aristotélicien de l'acte imparfait. L'acte imparfait ou "impur", c'est l'acte des puissances qui ne passent pas d'elles-mêmes (kath auto) à l'acte, mais qui pour cela ont besoin du concours de l'autre. Tel est par exemple le cas de la perception sensorielle: en elle, la puissance de perception n'étant pas autosuffisante, ne produit pas d'elle-même la perception, mais a pour ce faire besoin de la corrélation à l'objet. Or, le point fondamental dont dépend la position de Michelstaedter est le suivant: sur le plan transcendental, l'acte imparfait ne résout qu'en apparance la privation du Moi. En réalité, il la confirme de nouveau. À titre d'exemple, prenons une comparasion. Le Moi a soif; tant qu'il boira, il confirmera l'état de celui qui ne suffit pas a sa propre vie, mais qui pour vivre a besoin de l'"autre"; l'easu et le reste ne sont que les symboles de sa déficience (il importe de fixer l'attention sur ce point: on ne désire pas parce qu'il y a privation de l'être, mais il y a privation de l'être parce qu'on désire - en second lieu: il n'y a pas désir, par exemple celui de boire, parce qu'il y a certaines choses, par exemple l'eau, mais parce que les choses désirées, à l'instar de la privation de l'être qui pousse vers elles, sont créés au même moment par le désir qui s'y rapporte, lequel est donc le prius qui pose la corrélation et les deux termes de celle-ci, la privation et l'objet correspondant, dans notre exemple la soif et l'eau). En tant qu'il se nourrit de cette déficience et lui demande la vie, le Moi se repâit seulement de sa propre privation et demeure en elle, s'éloignant de l'"acte pur" ou parfait, de cette eau éternelle au sujet de laquelle on pourrait citer les paroles même du Christ, eau pour laquelle toute soif, et toute autre privation, seraient vaincues à jamais. Cette appétence, cette contrainte obscure qui entraîne le Moi vers l'extérieur - vers l'"autre" -, voilá ce qui engendre dans l'expérience le système des réalités finies et contingentes. La persuasion, qui va brûler dans l'état de l'absolue consistance, du pur être-en-soi - cet effort a donc aussi le sens d'une "consommation" du monde qui se révèle à moi.
Le sens de cette consommation, il faut, pour l'éclairer, aller jusqu'à des conséquences que Michelstaedter n'a pas complètement développées.
Tout d'abord, dire que je dois pas fuir ma déficience signifie notamment que je dois me reconnaître comme la fonction créatrice du monde expérimenté. De là pourrait suivre une justification de l'Idéalisme transcendental (à savoir du système philosophique selon lequel le monde est posé par le Moi) sur la base d'un impératif moral. Mais on a vu que, selon la prémisse, le monde est considéré comme une négation de la valeur. Du postulat général exigeant que le monde soit racheté, que sa déficience soit assumée, procède donc, toujours comme postulat moral, mais aussi sur le plan pratique, un second point: la négation même de la valeur doit être reconnue, d'une certaine façon, comme une valeur. Cela est important. En effet, si je considère l'impulsion qui a engendré le monde comme une donnée pure, irrationnelle, il est évident que la persuasion, en tant qu'elle est conçue comme la négation de cette impulsion, va en dépendre, donc qu'elle n'est pas absolument autosuffisante mais dépend d'un "autre", dont la négation lui permet de s'affirmer. Dans ce cas, donc dans le cas où le désir même n'est pas réinséré dans l'ordre de l'affirmation de la valeur, mais reste intégralement une donnée, la persuasion ne serait donc pas du tout persuasion - le mystère initial en réduirait inévitablement la perfection à une illusion.
Il faut donc admettre comme postulat moral que l'antithèse même participe, d'une certain façon, de la valeur. Mais de quelle façon? Ce problème amène à inclure dans le concept de persuasion un dynamisme. En effet, il est écident que si la persuasion ne réduit pas à une suffisance pure et autonome - donc à un état - , mais est suffisance en tant que négation d'une insuffisance - donc est un acte, une relation -, l'antithése a certainement und valeur et peut être expliquée ainsi: le Moi doit poser dans un premier moment la privation, la non-valeur, y compris sous la condition òu la privation n'est posée que pour être niée, car cet acte de négation, et lui seul, engendre la valeur de la persuasion. Mais que signifie nier l'antithèse - qui en l'occurence revient à dire la nature? On se rappelle que pour Michelstaedter la nature est non-valeur en tant que symbole et incarnation du renoncement du Moi à la possession actuelle de soi-même, en tant que corrélat d'un acte imparfait ou "impur" au sens défini plus haut. Il ne s'agit donc pas de nier telle ou telle détermination de l'existant, parce qu'on n'atteindrait par là que l'effet, la conséquence, non la racine transcendentale de la non-valeur; il ne s'agit pas non plus d'éliminer en général toute action, car l'antithèse n'est pas l'action en général, mais l'action en tant que fuite de soi, "écoulement" - et il n'est pas dit que toute action ait nécessairement ce sens. Ce qu'il faut résoudre, c'est plutôt le mode - passif, hétéronome, extraverti - d'action. Or, la négation d'un tel mode est constitutée par le mode de l'action autosuffisante, laquelle est aussi puissance - tel est donc le sens du rachat tout à la fois cosmique et existentiel. De même que la concrétisation de la persuasion est le développement d'un monde d'autarcie et de domination; et le moment de la négation pure n'est que le moment neutre entre les deux phases.
Aussi bien le développement des vues de Michelstaedter dans ce qu'on pourrait appeler un "Idéalisme magique" apparaît-il obéir à une continuité logique. En fait, Michelstaedter s'est d'une certaine façon arrête à une négation indeterminée, et ce, en grande partie, pour n'avoir pas considéré suffisamment que le fini et l'infini ne doivent pas être rapportés à un objet particulier ou à une action particulière, mais sont deux modes de vivre n'importe quel objet ou n'importe quelle action. En général, le vrai Maître n'a pas besoin de nier (au sens d'annuler) et, sous le prétexte de la rendre absolue, de réduire la vie à une unité indifférenciée, comme, si l'on veut, dans une espèce de fulguration: l'acte de puissance - qui n'est pas acte de désoir ou de violence - , loin de détruire la possession parfaite, l'atteste et la confirme. Le fait est que Michelstaedter, à cause de l'intensité même avec laquelle il vécut l'exigence de la valeur absolue, ne sut pas donner à cette exigence un corps conret, donc la développer dans la doctrine de la puissance, ce qui pourrait avoir quelque relation avec la fin tragique de son existence mortelle.
Toutefois, c'est Michelstaedter qui a écrit: "Nous ne voulons pas savoir par rapport à quelles choses l'homme s'est déterminé, mais bien comment il s'est déterminé". Au-delá de l'acte, il s'agit donc de la forme ou valeur sous laquelle cet acte est vecú par l'individu. De fait, toute relation logique est, d'une certaine façon, indéterminée, et la valeur est une dimension supérieure où elle se spécifie. L'un des mérites de Michelstaedter, c'est d'avoir réaffirmé la considération selon la valeur dans l'ordre métaphysique: en effet, la "rhétorique" et la "voie vers la persuasion" peuvent être distinguées non d'un point de vue purement logique, mais du point de vue de la valeur. Dans ce contexte, il est très important que Michelstaedter reconnaisse qu'il y a, d'une certaine manière, deux voies. Cette coexistence est elle-même une valeur: car l'affirmation de la persuasion ne peut valoir comme affirmation d'une liberté que si l'on a conscience de la possibilité de l'affirmation comme valeur de la non-valeur elle-même, selon d'indifférence: seul étant libre et infini le "Seigneur du Oui et du Non" (sur cette problématique, cf. notre Teoria dell'Individuo Assoluto, I, 1-5). L'autre justification de l'antithèse dont il a été question plus haut, a évidemment pour présupposé l'option positive pour la "persuasion".
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola, evola, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 mai 2009
Money Talks

http://www.theoccidentalobserver.net/authors/Sunic-Money.html#TS
Money Talks
Tom Sunic
Never has money been so important in human relations. Never has it so much affected the destiny of so many Americans and Europeans. Today money has become a civil religion that makes it the centerpiece of discourse in all cultures and subcultures. At European and American cafes, on the Champs Élysées, or on Sunset Boulevard, at concert halls, and even in parliaments, one hears and smells its verbal derivatives such as “moulah,” “dough,” “fric,” “Kohle,” “pognon.” It is a language understood by all. In all segments of their lives Western citizens invariably talk about money and what money can buy. The great respite may come with the current financial crisis, which is finally undoing the liberal system with all its conventional wisdoms and lies. The ongoing economic depression may be the sign that the reign of money and the dictatorship of well-being are coming to an end.
Sounds familiar? No, it does not. In ancient European traditions money and commerce were looked down upon and at times these two activities were in principle forbidden to Europeans. Merchants were often foreigners and considered second class citizens.
The famous English poet and novelist D. H. Lawrence — a "revolutionary nationalist" — talks about “money madness” in his collection of poems Pansies. His poem “Kill money” summarizes best this facet of 20th-century mores: Kill money/put money out of existence/It is a perverted instinct/A hidden thought /which rots the brain, the blood, the bones, the stones, the soul.
Similar views were held by the long forgotten American Southern agrarians in the 30’s, who viciously attacked American money madness and the belief in progress. They had dark premonitions about the future of America. As noted by John Crowe Ransom, “Along with the gospel of progress goes the gospel of service. Americans are still dreaming the materialistic dreams of their youth.” And further he writes: “The concept of Progress is the concept of man’s increasing command, and eventually a perfect command over the forces of nature: a concept which enhances too readily our conceit and brutalizes our life.”
Thousands of book titles and thousands of poems from antiquity all the way to early modernity bear witness to a tradition of deep revulsion Europeans had for money and merchants. Charles Dickens’ description of the character Fagin the Jew in his novel Oliver Twist may be soon cut out from the mandatory school curriculum. Fagin’s physical repulsiveness, his strange name, and most of all his Jewish identity do not square with modern ukases on ethnic and diversity training in American schools. The crook Fagin illustrates boundless human greed when he sings to himself and his young captive boys: “In this life, one thing counts / In the bank, large amounts / I'm afraid these don't grow on trees, / You've got to pick-a-pocket or two / You've got to pick-a-pocket or two, boys, / You've got to pick-a-pocket or two.”
Already Ezra Pound, a connoisseur of the English language and a visionary on the methods of usury, and his contemporary, Norwegian Nobel prize winner Knut Hamsun, have disappeared from library shelves. Their fault? They critically examined the crisis of financial capitalism, or what we call more euphemistically today “global recession” and the main movers and shakers behind it.
In medieval times, money and the merchant class were social outcasts solely needed to run the economy of a country. Yet today they have morphed into role models of the West represented by a slick and successful banker dressed in an Armani suit and sporting a broad smile on his face. What a change from traditional Europe in which an intelligent man was destined for priesthood, sainthood, or a military career!
It is with the rising tide of modernity that the value system began to change. Even nowadays the word ‘merchant’ in the French and the German languages (marchand, Händler) has a slightly pejorative meaning, associated with a foreigner, prototypically a Jew. The early Catholic Church had an ambiguous attitude toward money — and toward Jews. Well known are St. Luke’s parables (16:19–31) that it “is easier for a camel to go thru the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven.”
But the Church chose a less pious way to power. In 1179, the Third Lateran Council forbade Jews from living in Christian communities and exiled them to ghettos — with full rights to practice usury and tax collecting. To a large extent the Church, while providing the best shelter for Jews against frequent bouts of popular anti-Jewish anger, also greatly amassed wealth — courtesy of Jewish tax collectors.
The father of the Enlightenment, the 18th-century French philosopher Voltaire, is often quoted as a first spokesman of tolerance and human rights in Western civilization. But it is often forgotten that Voltaire was also an unabashed anti-Semite. Voltaire’s critical remarks about Jews and their love for money were recently expunged from his books, or simply not translated. But some still thrive such as “always superstitious and greedy for the good of others, always barbarous, crawling when in misfortune and insolent in prosperity, that is what the Jews were in the eyes of the Greeks and Romans..” (Essais sur les mœurs)
The ancient European ruling class certainly had its share of corruption and greed. But in principle, until the Enlightenment, the social roles of money and merchants were subjugated to the role of the prince and power politics. Until then, the entire value system had been based on spiritual transcendence and not on economic growth — at least in its appearance. In ancient Greece, King Midas who was a kind man, could not resist the temptation of turning everything into gold with his magic fingers, until he ruined his family, turned water into undrinkable metal, and his face assumed the shape of a donkey. King Croesus went berserk after amassing so much wealth that he could not devote his time and his thoughts to the impending war with the Persians.
In the ancient European tradition, revulsion against money pervades the sagas and the old popular legends, teaching everybody that piety prospers over prosperity. Material wealth brings disaster.
Today, by contrast, official advocacy of frugality and modesty is perceived as a sign of the early stage of lunacy. If a well-educated and well-cultivated man comes along and starts preaching modesty or rejects honoraria for his work, he is considered a failure, a person who does not respect his own worth. How on earth can some well-read and well-bread person offer his services for free? How on earth can a well-educated man refuse using his mental resources to generate the almighty dollar? The answer is not difficult to discover. In capitalism everything has its price, but nothing has value.
The modern liberal capitalist system is a deeply inhuman system, based on fraudulent teaching that everybody is equal in economic competition. In reality though, it rewards only those whose skills and talents happen to be marketable. Those rare Whites who decide to retain some vestiges of old European traditions are squarely pronounced incompetent. Liberal capitalism both in America and in Europe has turned all humans into perishable commodities.
Nobody summarized this better than the Italian philosopher Julius Evola, another revolutionary nationalist who wrote: “Facing the classical dilemma 'your money or your life,' the bourgeois will answer: 'Take my life but leave me my money.'”
Greed, passionate greed eclipses all elements of human decency. Until relatively recently avarice was laughed at and its chief protagonists were considered immoral people, so well represented in Molière’s comedy L’Avare. Today the greedier the better: The money maker is the ultimate role model.
Both East and West participate in this ethic of greed. The richest people in post-communist Eastern Europe are former communist hacks who converted themselves in a twinkle of an eye from disciples of Marx into acolytes of Milton Friedman and Friedrich Hayek. Finance capitalism provides the perception of limitless possibility of how to get rich out of the blue. This is a typical Bernie Madoff syndrome, namely that affluence can be created by sheer speculation. The entire banking system in Eastern Europe has been sold to foreigners over the last 10 years.
Modern capitalism and a penchant for finance owe much to Judaism. Werner Sombart, a German disciple of Max Weber, who can in no way be called an anti-Semite wrote in The Jews and Modern Capitalism that “money was their sole companion when they were thrust naked into the street, and their sole protector when the hand of the oppressor was heavy upon them. So they learned to love it, seeing that by its aid alone they could subdue the mighty ones of the earth. Money became the means whereby they — and through them all mankind — might wield power without themselves being strong.”
Money changes social mores too. Young White couples put off having children until they achieve their economic dreams, while Mexicans and Blacks begin having children as impoverished teenagers, and Muslims place a high value on fertility. This is one of the main causes of our malaise, as White societies with declining fertility are inundated by highly fertile non-White populations with value systems that prize fertility over the accumulation of the accouterments of economic success.
And in this economic recession these Whites are not interested in a pay raise but rather in how to keep their job — security at all cost, even if it means working for lower wages. Neither are young job market entrants interested in saving money. Instead they live on credit in their petty little niche with their petty little pleasures and without incurring any risks.
What a difference from early American pioneers described by Jack London, who braved the vagaries of weather and who totally ignored the meaning of “hedge funds”! The attractions of money and the necessity of making money mean that everybody in our postmodern world becomes prey to the system.
It is a fundamental mistake among many so called right wingers and racialists to assume that capitalism is the only answer to communism. Both systems are in fact similar because they preach the same religion of progress and the unfolding of earthly paradise — albeit in different gears. But this time liberal capitalism has nobody to hide behind in order to conceal its vulgar depravity. The likely hypothesis is that the crumbling capitalist system will fall apart as a result of its own victory. One dies always from those who give him birth.
Tom Sunic (http://www.tomsunic.info/; http://doctorsunic.netfirms.com/) is an author, former political science professor in the USA, translator and former Croat diplomat. He is the author of Homo americanus: Child of the Postmodern Age ( 2007
00:22 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, usure, argent, monnaie, économie, sociologie, histoire, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Claduio Risé: la postmodernité est une révolution conservatrice!

Archives de "Synergies Européennes" - 1997
Claudio Risé:
La postmodernité est une révolution conservatrice!
Quel corpus idéologique succédera à la droite? Affinons notre question: comme jamais la droite ne gagne les élections, sauf en Angleterre, comme elle connaît la défaite depuis plus d'un demi-siècle en Italie, sera-t-elle éliminée à tout jamais des prochains chapitres des livres d'histoire? Cette question, nombreuses sont les revues les plus autorisées de l'établissement culturel et politique du monde occidental: depuis Foreign Affairs aux Etats-Unis, très écouté au “département d'Etat”, en passant par Theory, Culture and Society en Grande-Bretagne, l'une des revues les plus attentives aux phénomènes dits “postmodernes”, jusqu'au Monde Diplomatique de Paris, qui se pose comme l'observateur classique de la gauche en matières de politique internationale.
Le Monde Diplomatique se préoccupe surtout de “la droite à la conquête des âmes”, dont la gauche semble avoir oublié de s'occuper, parce qu'elle se concentre obsessionnellement sur sa propre survie après l'écroulement du marxisme. Cette droite qui inquiète le Monde Diplomatique est une droite dont la vitalité ne se mesure pas tant (ou pas seulement) en termes de suffrages, mais surtout en termes d'adhésions individuelles ou d'élites intellectuelles ou, plus particulièrement, de jeunes. De ce point de vue, la victoire récente des listes de droite lors des dernières élections universitaires italiennes —même si l'on décrète dans les rangs mêmes des droites qu'il ne s'agit que d'un phénomène “qualunquiste”, “quelconque”, purement réactif, dépourvu de signification— je crois, personnellement, qu'il s'agit d'un signal de plus, annonciateur d'une situation en mutation rapide.
Mais ce qui inquiète un bon nombre de politologues de gauche, ce sont les curieuses affinités qui relient la réflexion sur la postmodernité dans son ensemble au mouvement qui s'était développé dans l'Allemagne de la République de Weimar et que l'on appelle la “révolution conservatrice”, dont les principaux exposants furent Ernst Jünger, Martin Heidegger et le juriste Carl Schmitt.
Quels sont les indices qui nous permettent de dire que la “révolution conservatrice” est de retour? Goran Dahl, professeur de sociologie à l'Université de Lund en Suède, vient de consacrer un long essai sur cette question dans la revue Theory, Culture and Society. L'un des principaux indices permettant de poser l'analogie “révolution conservatrice”/“postmodernité” est la valorisation accordée à la technologie, perçue comme l'instrument parfait pour se libérer du “vieil ordre”, ainsi que des classes dirigeantes incapables et corrompues qui l'expriment. Du temps de la “révolution conservatrice”, Ernst Jünger avait fait du “Travailleur” le héros des nouvelles technologies destinées à changer le monde. Cette option “technique” avait grandement irrité les proto-nazis (on a trouvé la phrase suivante dans l'une de leurs publications mineures: «Jünger se rapproche de la zone des balles dans la nuque»), tout comme les sociaux-démocrates, désorientés par cette figure d'un “Travailleur” si peu marxiste, plus passionné par la guerre que par l'économie.
Aujourd'hui, à l'âge postmoderne, c'est quelque chose de très semblable qui se passe: la technologie et l'informatique constituent la grande ligne de partage entre ceux qui parient sur les “temps nouveaux” et sont prêts à courir des risques et à se lancer dans l'aventure, d'une part, et ceux qui, à droite mais surtout à gauche, dressent haut la bannière de la “vieille” modernité contre la postmodernité hypertechnologique. Ces partisans conservateurs et frileux de la “vieille modernité” accusent par exemple Internet de tous les maux imaginables: la guerre, l'effondrement de la religion ou la prolifération des religiosités alternatives et irrationnelles, la pédophilie, etc. Mais Internet est surtout utilisé ouvertement comme instrument pour rassembler des informations sur les mouvements affirmant les identités traditionnelles (culturelles, religieuses, nationales) et, de ce fait, proches des principes qu'avait affirmés jadis la “révolution conservatrice”.
Autre similitude entre postmodernité et “révolution conservatrice”, qui a surpris beaucoup de monde: les deux mouvements d'idées estiment que sont positives et fécondes les “différences” entre les peuples et les cultures, nées sur des territoires précis. Cette position conduit à une rupture voire à un choc frontal tant avec la gauche —qui prône l'universalisme et, en paroles du moins, l'égalité absolue— qu'avec la droite (du temps de la “révolution conservatrice”, c'était Hitler) qui est toujours plus ou moins ouvertement raciste et pour laquelle le différent est toujours inférieur. Sur le terrain des “différences”, le réveil de la révolution conservatrice acquiert une vitalité explosive face à l'égalitarisme hypocrite de la gauche car justement cet égalitarisme a été contesté en premier lieu par les peuples dominés par les empires coloniaux construits sur des fondements issus de l'idéologie progressiste! Sur cette thématique, la version postmoderne de la révolution conservatrice est bien vivante, non seulement parce qu'elle s'articule sur les notions dégagées par les principaux philosophes du siècle —de Derrida à Foucault et à Deleuze— mais surtout parce que ses thèses sont celles de tout le discours culturel et politique de l'ère post-coloniale, discours qui est sans doute la part la plus substantielle de la postmodernité.
Par l'effet de la globalisation, marque majeure de notre contemporéanité, cet héritage idéologique postcolonial trouve évidemment des alliés importants. Comme, par exemple, Kishore Mahbubani, secrétaire du ministère des affaires étrangères de Singapour, qui se plaignait, dans les colonnes de la revue Foreign Affairs, que les Occidentaux avaient du mal à comprendre que l'Asie pouvait accepter la technologie avancée sans pour autant renoncer à ses propres traditions et à sa propre culture.
L'Occident, selon cet homme politique de Singapour, n'a pas vraiment accepté que “d'autres cultures ou d'autres formes d'organisation sociale pouvaient avoir une égale validité”, justement parce que “la croyance en la valeur universelle de ses propres idées peut amener à l'incapacité de reconnaître le principe de la diversité”. La domination à l'ère coloniale de l'idéologie des Lumières et de ses dérivés idéologiques constitue d'ailleurs une thématique à la fois politique et morale que l'on ne peut plus esquiver. Thématique à laquelle un philosophe attentif et sensible comme Salvatore Veca, pour ne donner qu'un exemple, a consacré des réflexions très précises et pertinentes dans son dernier essai, Dell'incertezza (paru chez Feltrinelli). Pour Veca, la (re)-valorisation des différences induit que le lieu, le site, le topos d'une culture, puis la culture proprement dite ainsi que les traditions enracinées prennent le pas, dans l'ère postmoderne comme dans le corpus doctrinal de la “révolution conservatrice”, la place qu'occupait le temps (plus ascétique) dans la modernité, et cela sous l'oripeau de l'idée de progrès, présente depuis le XVIIIième des Lumières jusqu'à nos jours.
Avec la (re)-valorisation du topos, on affirme également ipso facto la centralité de la géopolitique (comme l'a noté l'Allemand Joachim Weber), qui affirme les caractéristiques “organiques” (c'est-à-dire culturelles au sens anthropologique) des nations qui ne sont finalement que fort mal représentées par les ordres juridiques que sont les Etats classiques, issus des révolutions bourgeoises et aujourd'hui nettement en crise. Cette radicalité “révolutionnaire-conservatrice” se lie non seulement avec les exposants philosophiques de la postmodernité mais aussi avec les autres protagonistes de la pensée scientifique contemporaine tels Paul Feyerabend, dont l'idée centrale est que le savoir n'est jamais universel, mais toujours une “valeur locale, destinée à satisfaire des besoins locaux”, propres de nations, de peuples et de cultures particulières (ou de “tribus”, dirait Michel Maffesoli, autre brillant exposant de cette option particulariste suscitant tant de turbulences).
«Le conservatisme, pour être plus révolutionnaire que n'importe quelle forme d'“illuminisme” positiviste, n'a besoin de rien de plus que d'esprit, et de rien de moins qu'une révolution conservatrice», écrivait Thomas Mann en 1921. Voilà pourquoi, à l'ère postmoderne, qui est tout à la fois conservatrice et futuriste, on assiste au retour de la “révolution conservatrice”, nous assure Goran Dahl. Du reste, on peut observer que cette “révolution conservatrice” n'a jamais totalement disparu. Tant Jünger que Heidegger ou Schmitt ont survécu gaillardement à l'effondrement allemand de 1945 et n'ont jamais abandonné leurs idées. Immédiatement après la fin des hostilités, ils ont trouvé des disciples attentifs et des continuateurs féconds. Certes, la “modernité” est restée en selle, du moins officiellement, et continue à nier les différences, à manier sa notion de “progrès”, à imposer son mépris pour tout ce qui est “local”, pour les potentialités de la “terre”. La survivance du corpus des Jünger, Schmitt et Heidegger peut sembler marginale. Mais aujourd'hui, postmodernité et postcolonialisme ont revalorisé les traditions, les différences et les territoires et il me semble beaucoup plus difficile de faire machine arrière, alors que les plus brillants esprits du siècle ont bel et bien participé au mouvement. Mais il est vrai aussi que les tenants actuels du différencialisme sont fort différents de cette “nichée de dragons” qu'avait aimée Stephen Spender dans le Berlin qui basculait dans le nazisme et qu'il a décrite avec un esthétisme complaisant dans Un monde dans le monde. Les tenants contemporains ressemblent au contraire davantage à ces étudiants qui viennent, en Italie, de voter pour les listes de droite lors des élections universitaires. Car, comme nous l'a dit Sergio Ricossa, dans les colonnes d'Il Giornale, le 27 avril 1997, “ils veulent connaître le monde tel qu'il est”. Ils sont moins romantiques, moins grandiloquents, que leurs prédécesseurs. C'est mieux, car notre siècle en a trop vus, des dragons...
Claudio RISÉ.
(article paru dans Il Giornale, 6 mai 1997).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, postmodernité, modernité, sociologie, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 mai 2009
Bibliographie nietzschéenne contemporaine

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
Bibliographie nietzschéenne contemporaine
par Robert Steuckers
Francesco Ingravalle, Nietzsche illuminista o illuminato?, Edizioni di Ar, Padova, 1981.
Une promenade rigoureuse à travers la jungle des interprétations de l'œuvre du solitaire de Sils-Maria. Dans son chapitre V, Ingravalle aborde les innovations contemporaines de Robert Reininger, Gianni Vattimo, Walter Kaufmann, Umberto Galimberti, Gilles Deleuze, Eugen Fink, Massimo Cacciari, Ferruccio Masini, Alain de Benoist, etc.
Friedrich Kaulbach, Sprachen der ewigen Wiederkunft. Die Denksituationen des Philosophen Nietzsche und ihre Sprachstile, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1985.
Dans ce petit ouvrage, Kaulbach, une des figures de proue de la jeune école nietzschéenne de RFA, aborde les étapes de la pensée de Nietzsche. Au départ, cette pensée s'exprime, affirme Kaulbach, par «un langage de la puissance plastique». Ensuite, dans une phase dénonciatrice et destructrice de tabous, la pensée nietzschéenne met l'accent sur «un langage de la critique démasquante». Plus tard, le style du langage nietzschéen devient «expérimental», dans le sens où puissance plastique et critique démasquante fusionnent pour affronter les aléas du monde. En dernière instance, phase ultime avant l'apothéose de la pensée nietzschéenne, survient, chez Nietzsche, une «autarcie de la raison perspectiviste». Le summum de la démarche nietzschéenne, c'est la fusion des quatre phases en un bloc, fusion qui crée ipso facto l'instrument pour dépasser le nihilisme (le fixisme de la frileuse «volonté de vérité» comme «impuissance de la volonté à créer») et affirmer le devenir. Le rôle du «Maître», c'est de pouvoir manipuler cet instrument à quatre vitesses (les langages plastique, critique/démasquant, expérimental et l'autarcie de la raison perspectiviste).
Pierre Klossowski, Nietzsche und der Circulus vitiosus deus, Matthes und Seitz, München, 1986.
L'édition allemande de ce profond travail de Klossowski sur Nietzsche est tombée à pic et il n'est pas étonnant que ce soit la maison Matthes & Seitz qui l'ait réédité. Résolument non-conformiste, désireuse de briser la dictature du rationalisme moraliste imposé par l'Ecole de Francfort et ses émules, cette jeune maison d'édition munichoise, avec ses trois principaux animateurs, Gerd Bergfleth, Axel Matthes et Bernd Mattheus, estime que la philosophie, si elle veut cesser d'être répétitive du message francfortiste, doit se replonger dans l'humus extra-philosophique, avec son cortège de fantasmes et d'érotismes, de folies et de pulsions. Klossowski répond, en quelque sorte, à cette attente: pour lui, la pensée impertinente de Nietzsche tourne autour d'un axe, celui de son «délire». Cet «axe délirant» est l'absolu contraire de la «théorie objective» et signale, de ce fait, un fossé profond, séparant la nietzschéité philosophique des traditions occidentales classiques. L'axe délirant est un unicum, non partagé, et les fluctuations d'intensité qui révolutionnent autour de lui sont, elles aussi, uniques, comme sont uniques tous les faits de monde. Cette revendication de l'unicité de tous les faits et de tous les êtres rend superflu le fétiche d'une raison objective, comme, politiquement, le droit à l'identité nationale et populaire, rend caduques les prétentions des systèmes «universalistes». Le livre de Klossowski participe ainsi, sans doute à son insu, à la libération du centre de notre continent, occupé par des armées qui, en dernière instance, défendent des «théories objectives» et interdisent toutes «fluctuations d'intensité».
Giorgio Penzo, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando Editore, Roma, 1987.
On sait que la légende de Nietzsche précurseur du national-socialisme a la vie dure. Pire: cette légende laisse accroire que Nietzsche est le précurseur d'un national-socialisme sado-maso de feuilleton, inventé dans les officines de propagande rooseveltiennes et relayé aujourd'hui, quarante ans après la capitulation du IIIème Reich, par les histrions des plateaux télévisés ou les tâcherons de la presse parisienne, désormais gribouillée à la mode des feuilles rurales du Middle West. Girogio Penzo, professeur à Padoue, met un terme à cette légende en prenant le taureau par les cornes, c'est-à-dire en analysant systématiquement le téléscopage entre Nietzsche et la propagande nationale-socialiste. Cette analyse systématique se double, très heureusement, d'une classification méticuleuse des écoles nationales-socialistes qui ont puisé dans le message nietzschéen. Enfin, on s'y retrouve, dans cette jungle où se mêlent diverses interprétations, richissimes ou caricaturales, alliant intuitions géniales (et non encore exploitées) et simplismes propagandistes! Penzo étudie la formation du mythe du surhomme, avec ses appréciations positives (Eisner, Maxi, Steiner, Riehl, Kaftan) et négatives (Türck, Ritschl, v. Hartmann, Weigand, Duboc). Dans une seconde partie de son ouvrage, Penzo se penche sur les rapports du surhomme avec les philosophies de la vie et de l'existence, puis, observe son entrée dans l'orbite du national-socialisme, par le truchement de Baeumler, de Rosenberg et de certains protagonistes de la «Konservative Revolution». Ensuite, Penzo, toujours systématique, examine le téléscopage entre le mythe du surhomme et les doctrines du germanisme mythique et politisé. Avec Scheuffler, Oehler, Spethmann et Müller-Rathenow, le surhomme nietzschéen est directement mis au service de la NSDAP. Avec Mess et Binder, il pénètre dans l'univers du droit, que les nazis voulaient rénover de fond en comble. A partir de 1933, le surhomme acquiert une dimension utopique (Horneffer), devient synonyme d'«homme faustien» (Giese), se fond dans la dimension métaphysique du Reich (Heyse), se mue en prophète du national-socialisme (Härtle), se pose comme horizon d'une éducation biologique (Krieck) ou comme horizon de valeurs nouvelles (Obenauer), devient héros discipliné (Hildebrandt), figure anarchisante (Goebel) mais aussi expression d'une maladie existentielle (Steding) ou d'une nostalgie du divin (Algermissen). Un tour d'horizon complet pour dissiper bon nombre de malentendus...
Holger Schmid, Nietzsches Gedanke der tragischen Erkenntnis, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1984.
Une promenade classique dans l'univers philosophique nietzschéen, servie par une grande fraîcheur didactique: telle est l'appréciation que l'on donnera d'emblée à cet petit livre bien ficelé d'Holger Schmid. Le chapitre IV, consacré à la «métaphysique de l'artiste», magicien des modes de penser antagonistes, dont le corps est «geste» et pour qui il n'y a pas d'«extériorité», nous explique comment se fonde une philosophie foncièrement esthétique, qui ne voit de réel que dans le geste ou dans l'artifice, le paraître, suscité, produit, secrété par le créateur. Dans ce geste fondateur et créateur et dans la reconnaissance que le transgresseur nietzschéen lui apporte, le nihilisme est dépassé car là précisément réside la formule affirmative la plus sublime, la plus osée, la plus haute.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nietzsche, allemagne, livre, bibliographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 mai 2009
Karl Ludwig von Haller en de restauratie gedachte
KARL LUDWIG VON HALLER EN DE RESTAURATIE GEDACHTE
door Willem van der Burcht - http://bitterlemon.eu/
De Zwitserse conservatieve staatstheoreticus en publicist Karl Ludwig von Haller werd op 1 augustus 1778 te Bern geboren in één van de voornaamste patriciërsfamilie van de trotse stadrepubliek. Hij was de kleinzoon van de grote natuurwetenschapper, arts, dichter en botanicus Albrecht von Haller (1708-1777) en de tweede zoon van de bekende staatsman, historicus, numismaticus en heruitgever van de “Bibliothek der Schweizergeschichte”, Gottlieb Emanuel von Haller (1735-1786). Hij liep school in de Academie van zijn geboortestad, maar de vroege dood van zijn vader en financiële problemen lieten universitaire studies niet toe, zodat hij op wetenschappelijk gebied geheel autodidact is gebleven.
Op amper zestienjarige leeftijd trad hij in dienst van de stad Bern – toen de grootste stadsstaat benoorden de Alpen – en maakte snel carrière door zijn bekende naam en zijn capaciteiten. Hij had goede vooruitzichten op een mooie loopbaan in dienst van de stad. Als twintigjarige was hij reeds Secretaris van de Commissie en politiek heel erg actief via politieke geschriften.
In juli 1790 maakte hij tijdens een reis naar Parijs persoonlijk kennis met de Franse revolutie. Hij zetelde in talrijke commissies en genootschappen en zijn toespraken en denkbeelden vielen bij velen in de smaak. Tussendoor schreef hij nog ontelbare verhandelingen, memoranda, tijdschrift- en krantenartikelen, enz.
Als delegatiesecretaris en in zijn talrijke publicaties, bemoeide hij zich ook met de Bernse buitenlandse politiek. Zo nam hij deel aan diplomatieke zendingen naar Genève (1792), Ulm (1795), Noord Italië -waar hij Napoleon ontmoette - en Parijs (1797); hij was aanwezig op het Congres van Rastatt (1797/1798) en in 1798 waarschijnlijk ook betrokken bij de onderhandelingen met de Franse generaal Brune, die met zijn revolutionaire troepen op het punt stond het Zwitserse Eedgenootschap binnen te trekken. Er werd nog voorgesteld dat de stad zelf met een progressief en liberaal “Projekt einer Constitution für die Schweizerische Republik Bern” op de proppen zou komen (maart 1798), maar het voorstel kwam te laat. Op 6 maart 1798 trokken de Fransen Bern binnen, wat het einde was van het oude Bern en ook van het oude Zwitserland dat, onder de benaming “Helvetische Republiek”, een Franse satellietstaat werd.
Anti-revolutionair verzet en eerste ballingschap
Albrecht Ludwig von Haller werd uit overheidsdienst ontslagen en met zijn tijdschrift Helvetische Annalen zette hij het verzet tegen het revolutionaire systeem voort. Algauw veroorzaakte hij een groot schandaal in de pers en ontkwam ter nauwer dood aan arrestatie vanwege de autoriteiten door naar Zuid-Duitsland te vluchten, waar hij zich aansloot bij de Zwitserse emigranten rond Nikolaus Friedrich von Steiger, de laatste verdedigers van een onafhankelijk Bern. Ondanks het feit dat ze ten gevolge van de krijgsgebeurtenissen niet lang op eenzelfde plaats konden blijven, spreidde hij een indrukwekkende literaire en propagandistische productiviteit ten toon.
In maart 1799 vond hij onderdak in het hoofdkwartier van het leger van Aartshertog Karel en in juni, tijdens de Eerste Slag van Zürich, was hij getuige van de eerste geallieerde zege op Napoleon, die echter algauw weer verloren ging door de Tweede Slag, die de Oostenrijkers ook dwong de terugtocht te aanvaarden. Vervolgens hield hij zich weer op in kringen van Zwitserse emigranten tot hij in juni 1801 als Hofkriegskonzipist in de Präsidialkanzlei van Aartshertog Karel in Wenen werd aangesteld.
De in 1803 tot Hofkriegssekretär bevorderde vluchteling werd – na de herinvoering van de kantonale soevereiniteit door de Mediatie Akte van Napoleon - in 1805 als professor in het staatsrecht aan de nieuw opgerichte Academie van Bern aangesteld. Hij moest echter alweer snel de benen nemen voor de oprukkende Franse troepen en hij vluchtte naar Agram in Kroatië.
Terug in Bern; academische loopbaan
Eind februari 1806 nam hij ontslag uit Oostenrijkse staatsdienst en keerde terug naar Bern om er zijn professoraat weer op te nemen. In hetzelfde jaar huwde hij de patriciërsdochter Katharina von Wattenwyl en bekleedde –naast talrijke andere ambten- de functies van Censor en Prorector aan de Academie van Bern. Hij begon zijn universitaire carrière met zijn openingsrede “Über die Notwendigkeit einer andern obersten Begründiging des allgemeinen Staatsrechts” (vert.: Over de noodzakelijkheid van een andere fundamentele grondslag van het algemene staatsrecht); het volgende jaar hield hij een rede “Über den wahren Sinn des Naturgesetzes, daß der Mächtige herrsche” (vert.: Over de ware betekenis van de natuurwet, dat de machtige heerse). In 1808 publiceerde hij zijn Handbuch der allgemeinen Staatenkunde [vert.: Handboek der algemene staatskunde], dat de basis vormde voor zijn lessen. Daarin worden zijn opvattingen over de staat - en in het bijzonder over het wezen en het ontstaan van de staatsgemeenschap - voor het eerst systematisch uiteengezet, en zodoende geldt het als voorloper van zijn grote werk, de Restauration der Staatswissenschaft (vert.: Restauratie der Staatswetenschap). Het Handbuch leverde hem roem en erkenning op, maar ook hoon en vijandschap.
Het "enfant terrible" van Bern
Von Haller kwam al gauw in conflict met zijn grote concurrent op de universiteit, Samuel Schnell. Nadat von Haller zijn ambt als Censor misbruikt had om zijn concurrent te benadelen, werd hij in 1809 verplicht zijn mandaat neer te leggen.
Dit verhinderde echter niet dat hij het jaar daarop lid van de Grote Stadsraad van Bern werd en in 1810 in de Kleine Stadsraad werd gekozen. In zijn opmerkelijke werk uit 1811: Politische Religion oder biblische Lehre über die Staaten (vert.: Politieke religie of Bijbelse leer over de staten) trachtte hij aan te tonen dat zijn nieuwe staatspolitieke opvattingen in alle opzichten in overeenstemming waren met wat de Bijbel daarover zegt. Hij bleek onvermoeibaar als politieke stokebrand, verklikker en intrigant in de Bernse stadspolitiek, en hij raakte betrokken bij enkele schandalen die een smet op zijn reputatie wierpen. Zo was hij de auteur van een (anonieme) recensie in de Göttingischen gelehrten Anzeigen waarin hij op een perfide wijze van leer trok tegen het levenswerk van Pestalozzi, waarmee hij de ongemeen harde hetze die tegen deze laatste gevoerd werd, nog aanwakkerde. Hij liet zich evenmin onbetuigd in de zogenaamde “Kreis der Berner Unbedingten” terwijl zijn rol in het “Waldshuter Komitee” nog steeds niet helemaal opgehelderd is. Voor zijn verantwoordelijkheid bij de onlusten in Nidwalden werd hij tot een celstraf veroordeeld, maar snel begenadigd. Wel leverde dit incident hem een blaam op vanwege de voorzitter van de Kleine Raad.
De door von Haller bejubelde doortocht van de geallieerde legers door Bern op 23 december 1813 en een algemene staking bij de overheid, leidden tot de val van de Mediatieregering, die werd opgevolgd door de Restauratieregering. Hij stelde zich kandidaat voor de verkiezingen voor de Grote (of “Soevereine”) Raad van de Republiek Bern, die op 12 januari 1814 gehouden werden, met een programma dat hij in twee propagandabrochures neerschreef: Was sind Untertanenverhältnisse? (vert.: Wat zijn onderdanenverhoudingen?) en Was ist die Alte Ordnung? (vert.: Wat is de oude orde?)
Zijn hoofdwerk: "Restauration der Staatswissenschaft"
Von Haller was co-auteur van de nieuwe Bernse grondwet van 1815 en lid van de commissie die de grondwet diende te herzien ten gevolge van de aansluiting van de Jura. In 1816 werd hij tot lid van de Geheime Raad gekozen, waar hij echter met zijn reactionaire voorstellen op niet veel steun kon rekenen.
Op de derde verjaardag van de Slag bij Leipzig voltooide hij het eerste deel van zijn magnum opus dat zijn naam zou geven aan een heel tijdperk: Restauration der Staatswissenchaft (vert.: Restauratie der Staatswetenschap). Dag op dag een jaar later, op 18 oktober 1817, werd het boek tijdens het Wartburgfest openbaar verbrand omdat het een Duitse grondwet niet genegen was.
De volgende delen van het monumentale werk (2: 1817; 3: 1818; 4: 1820; 5: 1834; 6:1825) kenden niet meer dezelfde weerklank als het eerste deel, ondanks de vele (negatieve) publiciteit die von Haller te beurt viel: in 1817 werd hij gedwongen “in allen Ehren” (sic) ontslag te nemen als professor aan de Bernse universiteit, en hoewel hij nog tal van ambten beklede, bleef hij vooral op een negatieve wijze in de belangstelling komen.
In zijn Über die Constitution der spanischen Cortes (vert.: Over de Constitutie van de Spaanse Cortes), betoonde hij zich een hartstochtelijke verdediger van de koninklijke rechten, tegen de usurpatoren van de Cortes-grondwet in. Het geschrift werd aanvankelijk door de bevriende censor toegelaten, maar kort daarop door de Kleine Raad van Bern verboden.
Karl-Ludwig von Haller -“cet extravagant”, zoals hij genoemd werd- maakte zich alsmaar minder en minder geliefd. Het enfant terrible van de Bernse politiek gold in die dagen niet alleen in Bern maar in heel Zwitserland als ultrareactionair. Die reputatie had hij ook te danken aan zijn engagement in wat de “Olry-Hallerschen Clique” werd geheten. Het grootste schandaal, dat de emmer ten slotte deed overlopen, stond echter nog te gebeuren.
Bekering tot het katholicisme en tweede ballingschap
Op 17 oktober 1820 legde de protestantse patriciër uit Bern – die later bekende “… in zijn hart reeds sedert 1808 katholiek te zijn geweest …” - op het landgoed van de familie de Boccard in Jetschwil (Freiburg), in het geheim de Katholieke Geloofsbelijdenis af. Tijdens een oponthoud op weg naar Parijs raakte zijn bekering echter bekend. Hij koos voor de vlucht naar voren en kondigde in een brief aan zijn familie zijn overstap naar het Katholieke geloof aan. Deze apologie, die meer dan 70 herdrukken beleefde en in vele talen werd vertaald, lokte een stortvloed aan reacties pro en contra uit! Zijn bekering zond een schokgolf doorheen Europa en ontketende een storm in de pers. Op voorstel van de Kleine Raad en na stormachtige debatten werd Von Haller door een overweldigende meerderheid in de Grote Raad uit al zijn ambten ontzet en voor immer en altijd van lidmaatschap van datzelfde orgaan uitgesloten.
Von Haller werd nu voor de tweede maal – en deze keer definitief – weggejaagd. Tevergeefs verzocht hij in Oostenrijkse, Pruisische of Spaanse dienst te kunnen treden; na afscheidsbezoeken aan Freiburg, Bern, Genève en Erlach te hebben gebracht, trok hij in mei 1822 met zijn familie – zonder zijn beide zonen, die tot 1823 hun studies in Gottstadt verderzetten – naar Parijs. Daar werd hij snel opgenomen in het gezelschap van gelijkgezinden, waaronder de Bonald, de Lamennais en anderen, en leverde hij talrijke bijdragen aan Franse ultraroyalistische en Duitse conservatieve bladen. In juli 1824, na het terugtreden van Chateaubriand, kreeg hij een aanstelling als “publiciste” verbonden aan het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
In Parijs vond hij ook de tijd en de energie om zijn familieleden tot het katholicisme te bekeren, achtereenvolgens de groep rond zijn dochter Cecilia, de bij hem inwonende Julie Mathilde von Erlach, zijn tweede zoon Albrecht (die later hulpbisschop van Chur zou worden), zijn oudste zoon Karl Ludwig (later publicist en politicus in Solothurn) en uiteindelijk ook zijn echtgenote.
Reeds in 1828 kocht von Haller in Solothurn het huidige bisschoppelijke paleis en in 1829 verwierf hij het burgerschap van deze stad. Kort na de Julirevolutie van 1830 trok hij weg uit Parijs om zich definitief in Solothurn te vestigen.
Voorvechter van de Restauratie tot het einde
In Solothurn stelde hij zich aan het hoofd van de ultraconservatieven en was vanaf 1834 drie jaar lang lid van de Grote Raad; in 1837 werd hij niet meer herkozen.
Koortsachtig richtte de reeds op pensioenleeftijd gekomen pamflettist zijn pijlen op de rampzalige tendensen van zijn tijd. In 1833 ontwierp hij het programma voor een “Bund der Getreuen zum Schutz der Religion, der Gerechtigkeit, und der wahren Freiheit” (vert.: Bond der getrouwen ter bescherming van de Godsdienst, de Gerechtigheid en de Ware Vrijheid), die zou uitgroeien tot een internationale strijdgroep tegen liberalisme, de vrijmetselarij en het revolutionaire systeem überhaupt. Met Satan und die Revolution (vert.: Satan en de revolutie) uit 1834 toonde hij aan dat de drijvende krachten achter de revolutie voortsproten uit het Kwade. In zijn Geschichte der Kirklichen Revolution oder protestantischen Reform (vert.: Geschiedenis van de kerkelijke revolutie of protestantse hervorming, 1836) ontmaskerde hij de reformatie als een tweede zondeval, en duidde haar als diepere oorzaak van en voorloper van de grote revolutie.
Met zijn geschriften tegen de vrijmetselarij (1840/41) wilde hij de “oerleugen” blootleggen die volgens hem aan de basis lag van de valse leerstellingen van die verderfelijke “sekte” en antistoffen aanreiken ter bestrijding ervan. Achter alle revolutionaire stromingen in Zwitserland vermoedde hij de hand van geheime genootschappen en hun ideeën van “gleichmacherei” (lett. vert.: “gelijkmakerij” of egalitarisme), van “onverschilligheid ten aanzien van iedere vorm van religiositeit”, van “exclusieve haat jegens de katholieke godsdienst en kerk”, van “afschaffing van iedere gedachte van een opperheerschappij” en van een “bevrijding van iedere hogere macht”. In zijn strijd tegen de revolutie, die bij wijlen extreme en obsessieve vormen aan nam, schreef hij ontelbare journalistieke bijdragen voor kranten en tijdschriften .
Hij ondernam ook nog meerdere reizen: in 1840 verbleef hij een tijdje in het Zuiden van Duitsland, meerbepaald in München; ook Freiburg, Luzern, Schwyz en Kienzheim in de Elzas deed hij aan. Op zijn reizen legde hij veel contacten en ook door middel van een uitgebreide correspondentie met iedereen van naam en faam in Europa, onderhield hij contacten met katholieken, bekeerlingen, ultramontanen, conservatieven en reactionairen.
Von Hallers werk gaf, samen met de activiteiten van de Jezuïeten, voedsel aan een antiprotestantse, traditionalistische en legitimistische politieke cultuur in Zwitserland, wat de spanningen aan de vooravond van de Sonderbundskrieg van 1847 aanzienlijk deed toenemen. De katholieke, conservatieve en overwegend landelijke kantons moesten het echter afleggen tegen de protestantse, liberale stadskantons; deze nederlaag én de revolutie die in 1848 door gans Europa trok, ervoer de bejaarde voorvechter als een persoonlijke nederlaag. Tijdens de laatste jaren van zijn leven zag hij zijn levenswerk instorten.
In hetzelfde jaar als de revolutie overleed zijn echtgenote, die al lange tijd zwaar ziek was. Op 20 mei 1854 volgde hij haar in het graf ten gevolge van een longontsteking. Drie dagen later werd hij op het kerkhof van Sint-Katharina van Solothurn bijgezet. Het kerkhof werd echter onder het radicale regime met de grond gelijk gemaakt, zodat er niets meer overblijft dat herinnert aan deze onvermoeibare strijder, wiens levenswerk gericht was tegen zijn eigen tijd.
Von Hallers reactionaire staatstheorie
Albrecht Ludwig von Haller was zijn hele leven lang vervuld van het profetisch zendingsbewustzijn, de kop van de slang van het jacobinisme te moeten verpletteren. Daarvoor ontwikkelde hij een restauratieve staatstheorie gebaseerd op de “natuurlijke gemeenschap”, als tegenpool voor Rousseau’s “kunstmatig-burgerlijke” leer van het “sociaal contract”. Tegenover deze zuiver speculatieve drogbeelden wilde hij een uit de Schepping en uit de Openbaring gedestilleerde, wetenschappelijk onderbouwde Waarheid plaatsen die universeel en absoluut geldig was.
Von Haller zag de basis van de maatschappelijke verhoudingen in de Natuurwet, waarbij de sterkere heerst en de zwakkere dient: “De machtige heerst, of hij wil of niet, terwijl de zwakke dient, of hij wil of niet”.
Tegenover de geconstrueerde, egaliserende filosofie van de revolutie, plaatste hij de door hem opnieuw naar voor gebrachte principes van de “eeuwige en onveranderlijke Goddelijke Ordening”: de fundamentele ongelijkheid, de “weldadige verscheidenheid” der “krachten en noden” en de superioriteit van de sterksten. Macht en heerschappij komen voort uit het Natuurrecht, het Goddelijke recht en het positieve recht.
Von Hallers doctrine wordt daarom vaak voor brutaal, materialistisch en utilitaristisch aanzien. Daar zijn leer ook de triomf van de sterke over de zwakke bejubelt en soms geweld verheerlijkt, wordt eveneens beweerd dat zijn ideeën op de “Uebermensch” van Nietzsche vooruitliepen of zelfs dat zijn stellingen – indien consequent doorgedacht – tot een toestand van anarchie zouden leiden.
De Staat als huishouding
De Staat is voor von Haller een oneindig uitgestrekte familie, één reusachtige huishouding. De heerschappijverhoudingen zijn over elkaar heen geordend en van een zuiver privaatrechterlijk karakter.
Zo wil hij dat het Staatsrecht, de opperste bekroning van de natuurlijke dienst- en maatschappelijke verhoudingen, wordt vervangen door een aggregaat van oneindig verschillende, vrije, private verdragen. Met andere woorden: staatsrecht en privaatrecht zijn voor hem identiek. Bijgevolg bestaat er binnen een staat ook geen gemeenschappelijk doel, maar is hij slechts een mengeling van talrijke verschillende private doelen. Dus dient de Staat uitsluitend de door God gewilde verhoudingen en toestanden te bewaren en garandeert hij zo de ware Vrijheid, de vrijheid der voorrechten en de natuurlijke ongelijkheid.
Deze opvatting die – consequent doorgedacht – de staat ontbindt tot op het niveau van de enkele individu, staat in schril contrast tot de ideeën over Staat en Natie die in die periode overal in Europa opgang maakten.
De Staat als patrimonium
De natuurlijke basis voor het uitoefenen van macht en heerschappij is grondbezit. De landsheer is niets anders dan de grootste eigenaar en de Staat is zijn patrimonium. In deze “Patrimonialstaat” (lett. vert.: patrimoniumstaat) – een uitvinding en woordkeuze van von Haller waarmee hij een soort van feodale standenstaat voor ogen had – is de vorst enkel tegenover God verantwoording verschuldigd. Zijn gezag wordt slechts beperkt door verdragen en het recht, door de eigendom en de autonomie van zijn onderdanen en door de uit de Natuur afgeleide morele wetten. Gerechtigheid moet het Kwade verhinderen terwijl Liefde het Goede moet bevorderen. De concrete vrijheid die ieder individu toekomt, wordt gemeten naar de relatieve macht die iemand op grond van zijn sociale positie binnen het kader van heerschappij en dienstbaarheid, toekomt.
Onafhankelijkheid zonder dienstbaarheid behoort tot de soevereiniteit van de vorst en staat op de hoogste spurt van het menselijke geluk. Dit voorrecht verplicht de vorst tot rechtvaardigheid en tot het goede. Deze premisse, dat slechts de zwakke misbruik zou maken van zijn macht en niet de sterke, heeft hem het verwijt opgeleverd op moreel vlak naïef te zijn.
Invloed en nawerking
Von Hallers ambitieuze voornemen om een totaalverklaring voor de gehele werkelijkheid te geven, kan gezien worden als een – enigszins laattijdige - poging om het Ancien Régime op rationalistische basis te legitimeren. Tegelijkertijd heeft hij echter een gefundeerde contrarevolutionaire doctrine en een monumentale uitdaging aan het adres van de moderniteit nagelaten!
Ondanks de vaak starre systematiek, de ongegeneerde wereldvreemdheid en de reeds in zijn tijd opgemerkte anachronismen, heeft von Hallers “politieke theologie” – hoewel slechts voor een korte tijd – een enorme weerklank in Europa gekend. Von Haller werd alom bewonderd (bijvoorbeeld door de jonge Achim von Arnim) en zijn Restauration der Staatswissenschaft verdrong Adam Müllers Elementen der Staatskunst als hoogste autoriteit op het gebied van de staatswetenschappen. Daarnaast was von Hallers denken – naast dat van de Maistre en de Bonald - van groot belang voor de ontwikkeling van de staatsleer van het politieke katholicisme.
Zijn onhistorische, rationalistische opvattingen over de staat werden in kringen van Pruisische Junkers hartstochtelijk verwelkomd en ze oefenden een grote invloed uit op de conservatieven van het laatromantische Berlijn, zoals op de Christelijk-germaanse kring rond de gebroeders Gerlch.
Voor de Pruisische koning Frederik Willem IV dan weer, was von Hallers idee van een op religieuze grondslagen gevestigde “patrimoniale standenstaat”, tot in de jaren vijftig van de 19de eeuw het te verwezenlijken ideaal. De invloed die von Haller op het Pruisische conservatisme uitoefende, werd slechts overtroffen door die van Friedrich Julius Stahl (1802-1861).
Ook in Wenen kon von Hallers Restauratie-idee op grote instemming rekenen. In Zwitserland zelf bleef zijn invloed eerder gering, hoewel toch enkele aanhangers in zijn voetsporen verder werkten. In Frankrijk, in Nederland, in Italië (en in het bijzonder in de Kerkelijke Staten) en in Spanje bekenden prominente geestelijken en politici zich tot von Hallers systeem. Dit uitte zich niet alleen in publieke stellingnamen, maar ook in de talrijke orden en onderscheidingen die hem verleend werden, alsook in zijn indrukwekkende briefwisseling.
De nawerking van von Hallers poging om de geestelijke premissen van de revolutie door een antitheorie in de kiem te smoren om zo de tijd terug te kunnen draaien, was echter van korte duur. De democratische, liberale en nationale krachten stormden over hem heen en bepaalden het verdere verloop van de geschiedenis tot in de 21ste eeuw.
"Restauratie” verwerd van een strijdkreet tot een scheldwoord, de reactionair werd ideologisch geïsoleerd en als verliezer van de geschiedenis uit het collectieve geheugen verbannen. Niettegenstaande, blijft deze eens zo toonaangevende “politieke Luther” of “Helvetische Bonald”, zoals hij wel eens genoemd werd, één der belangrijkste en eigenzinnigste conservatieve denkers van de 19de eeuw. Geen enkele zichzelf respecterende conservatief kan het zich veroorloven rond deze Zwitserse persoonlijkheid van Europees formaat heen te lopen.
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, sciences politiques, politologie, restauration, droite, conservatisme, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 25 avril 2009
Qu'est-ce que le relativisme?
| Qu'est-ce que le relativisme? Ex: http://unitepopulaire.org/
|
| « De toutes les pathologies dont souffre notre société, le relativisme "philosophique" est certainement l’une des plus dangereuses, car son caractère diffus, sa fausse logique empreinte de scientificité et son adéquation trop parfaite avec la notion de tolérance (suprême valeur du monde post-moderne) lui procurent d’inestimables avantages sur les courants philosophiques concurrents. Si, depuis Montaigne, le relativisme a attiré de nombreux penseurs refusant l’idée selon laquelle une civilisation ou une religion ne peuvent se déclarer supérieures à toutes les autres, il est indéniable que depuis une soixantaine d’années, le paradigme relativiste a étendu son empire sur toutes les nations occidentales, abrutissant dramatiquement leurs populations désormais incapables de sauvegarder les bases mêmes et les principes primordiaux de la pensée et de la culture européenne. […]
Loin d’avoir permis la sauvegarde de la diversité culturelle, le relativisme a engendré la haine de soi (ou, par voie de conséquence, la xénophilie) et l’essor de l’individualisme radical, qui ont laminé à une vitesse extraordinaire des nations millénaires.
Aujourd’hui, le relativisme apparaît cependant davantage comme la conséquence d’une déréliction généralisée, comme un discours servant à légitimer les faiblesses d’un peuple, hier glorieux et rayonnant, et aspirant désormais à une totale retraite. »
François-Xavier Rochette, "Vaincre le relativisme ?", Rivarol, 6 mars 2009 |
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : relativisme, pensée moderne, modernité, postmodernité, sociologie, anthropologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 16 avril 2009
L'eroe di Baltasar Gracian
di Luca Leonello Rimbotti
Fonte: mirorenzaglia [scheda fonte]
Il vecchio storico inglese Thomas Carlyle insegnò con inclinazione romantica che l’eroismo ha molte facce, che quasi ogni aspetto della vita può essere interpretato come un momento in cui si può dispiegare una speciale attitudine verso l’ascesi di perfezione. Eroe è il Dio pagano che assomma su di sé tutte le qualità della stirpe, ma eroico può essere allo stesso modo lo spirito sacerdotale, ed eroi possono essere il profeta, il poeta, lo scrittore, il sovrano.
Era un gesuita, e dal gesuitismo imparò tutte quelle nozioni di affilata capacità di introspezione e di acuta conoscenza dei tempi e dei modi, che fecero di quell’ordine il tempio della dissimulazione e infine anche della sua degenerazione curiale, l’ipocrisia farisaica. In Gracián, tuttavia, si nota l’assoluta assenza di riferimenti ai dogmi cristiani: per questo, tenuto in sospetto dalla Compagnia di Gesù, fu prima ammonito, poi allontanato nel 1657 dalla cattedra e infine messo in condizione di non nuocere relegandolo presso un convento sperduto, con la tassativa proibizione di scrivere. Lo si accusava di aver intrapreso una precettistica del tutto profana sul saper vivere e, soprattutto, sul saper predominare sulle cose e sul mondo degli uomini, insomma di essere un laicissimo teorico di ciò che oggi chiameremmo una volontà di potenza in piena regola.
La recente pubblicazione de L’eroe (Bompiani), uno dei testi più celebri del trattatista aragonese, è l’occasione per verificare come il pensiero europeo si sia sempre misurato con queste categorie dell’essere e del mostrarsi, del fare e dell’avere ragione della realtà, in maniera che, dai sofisti e dagli stoici fino a Machiavelli, ai moralisti francesi o a Nietzsche e all’esistenzialismo, problema non da poco è sempre stato quello di avere a che fare col dispiegarsi dell’essere tra le penombre dell’apparire e del sembrare. Gracián insegnava la dissimulazione in quanto categoria dell’essere superiore e dell’innalzarsi al di là di se stessi, in un procedimento di continuo esercizio alla protezione dei propri fini. «Impedisca a tutti l’uomo colto di sondare il fondo della sua fonte, se da tutti vuole essere venerato…la metà è più del tutto, perché una metà ostentata e l’altra promessa, son più di un tutto dichiarato».
La velatezza dell’essere, in questo caso, non sarà un volgare atteggiamento di subdolo mascheramento volto all’inganno, ma, molto più sottilmente e nobilmente, lo strumento di una cerca dell’eccellenza, da ottenersi con il freno dei modi, la perfezione in ogni manifestazione di sé e un dosato ombreggiare i propri disegni. Qualcosa di propriamente “politico”, insomma: «Dissimulare una volontà sarà sovranità». In queste proposizioni sembra riecheggiare, in qualche modo, la dialettica heideggeriana circa il velamento della verità, secondo la struttura stessa della parola greca antica, che proponeva non a caso l’alfa privativo: a-lethéia, proprio nel senso che verità è essenzialmente un togliere veli per gradi. La dialettica sottile dell’apparire e del velarsi, lungi dall’essere solo un gioco femmineo di ritrosie seduttive, è in realtà, secondo la logica dell’etica tradizionale, il segreto della gloria. E la gloria, considerata dagli antichi l’unica e insieme la massima via all’eternità, è ugualmente per Gracián il premio al lavoro terreno dell’uomo di valore superiore.
In anni recenti è stato Emanuele Severino - il cui pensiero sappiamo essere sulla scia heideggeriana - a precisare i contorni del significato della gloria dal punto di vista esistenziale e tradizionale: «L’indefinita manifestazione dell’eterno, in cui la Gloria consiste e che indefinitamente si arricchisce, è il senso autentico della nostra destinazione per l’eternità». La gloria ha dunque a che fare col destino. E il destino ha a che fare con la fortuna e la fortuna con l’audacia, persino con l’azzardo. A patto che prima, dentro di sé, il temerario che si senta chiamato sulla via della gloria abbia percepito la concordanza della sua anima, tesa all’impossibile, con gli arcani segreti del fato. Difatti, in un passo de L’eroe si dice per l’appunto che la fortuna è «gran figlia della suprema provvidenza» e che «è regola da maestri compiuti nella politica discrezione notare la propria fortuna e quella dei propri sostenitori». Non diversamente la pensarono, a ben vedere, e magari senza aver letto un riga di Gracián, personaggi come Napoleone, che diceva di preferire generali fortunati a generali ben preparati, oppure come Hitler, che confessò più volte di aver giocato d’azzardo tutta la vita, sicuro di avere dalla sua parte la “provvidenza”. La fanatica fiducia in se stessi, quale suprema attitudine al comando in grado di piegare anche gli eventi sfavorevoli a proprio vantaggio, veniva da Gracián ricordata come dote dell’uomo di tempra superiore. E faceva l’esempio di Cesare, che al marinaio stanco e sfiduciato rivolse l’ammonimento: «Non dubitare, che offendi la fortuna di Cesare». Il dubbio interiore come ingiuria al destino. Quanto di meno cristiano e di più pagano si possa immaginare. Comprendiamo benissimo il motivo per cui lo scrittore venne messo al bando nella Spagna cattolicissima del gran secolo.
Tutto questo ha i contorni del tragico. Poiché in Gracián è ben vivo il senso di una lotta che l’eroe deve intraprendere prima di tutto su se stesso. Il controllo su ciò che appare e sulle occasioni che gli si presentano deve essere il frutto di un drammatico auto-controllo: questa volontà auto-imposta deve essere la sua signoria. Tanto che, se necessario, anche quando dentro l’uomo differenziato tutto lo sospingesse a dir di sì, la sua potenza e il suo comando interiore lo condurranno a un vittorioso dir di no. Questo si inserisce alla perfezione in quel dominio metafisico in cui si attua il contatto fra trascendenza e vita terrena. È ciò che gli antichi greci chiamavano kairòs, l’attimo fuggente, e i romantici tedeschi indicavano come der grosse Zufall, il grande caso fortunato. Saper cogliere il manifestarsi del momento in cui il destino si manifesta per cenni: la levigata sensibilità, quasi un istinto lungamente esercitato, saprà all’istante percepire questa epifania subitanea. Un evidenziarsi del sacro che indica il momento dell’agire. Poiché kairòs è suprema saggezza, è intima consonanza con gli interni voleri del fato, ma è anche sentimento di giustizia. Tradizionalmente, ciò che appare nel mondo, nell’immutabilità di ciò che è vero da sempre, oppure nell’improvviso irrompere dell’inatteso attraverso l’attimo, è anche ciò che è giusto: giusto è ciò che sa sopraggiungere al momento opportuno.
Una filosofia del rischio? Piuttosto, un’acuta capacità di percezione delle armonie e delle disarmonie del mondo. Nella sua introduzione a L’eroe, Antonio Allegra precisa che le sollecitazioni di Gracián verso l’affermazione di sé hanno il carattere di una libera alleanza col destino: «Occorre, in ogni caso, agire all’interno dello spazio della fortuna e del mondo: tutto sta nel potere ancora affermare un margine di libertà rispetto alla situazione integralmente mondana che si presenta, che va acutamente interpretata e colta nelle sue nascoste potenzialità». L’individuo differenziato, l’essere superiore costruito su un’elaborata e fanatica fiducia, si esprime attraverso la decrittazione dei segni lasciati cadere dal fato provvidenziale. Si tratta in fondo di un gioco: vince chi sa elaborare al massimo grado la dialettica tra il vivere all’occasione e l’essere uomo integro in grado di interpretare correttamente i segnali. L’individuo potenziato da questa superiore autocoscienza non è scelto dal caso, ma è lui stesso che sceglie l’attimo. Risolutezza e fulminea capacità di ricorrere alla decisione sono i sintomi dello spirito dominatore: «La prontezza fa da oracolo nei dubbi maggiori, sfinge negli enigmi, filo d’oro nei labirinti, e suole aver l’indole del leone, che riserva il massimo sforzo per quando ne ha più bisogno», scrive Gracián. Un manuale di politica: la golpe e il lione di Machiavelli, più un tocco di quel pessimismo barocco e manieristico che piacque tanto a Schopenhauer e che cercava di interpretare la complessità del mondo moderno allora già in agguato: L’eroe venne pubblicato nel 1637, l’anno di uscita del Discorso sul metodo di Cartesio. Ma anche una filosofia dell’intuito. Una vera mistica terrena dell’azione e del primato. In questo senso, la maschera che, secondo, Gracián, l’uomo superiore deve indossare per assicurarsi il dominio sul mondo non è un trucco plebeo, ma il necessario stigma della diversità: l’eroe gioca le sue maestrìe certo di non dover aprire a nessuno il suo cuore. Il mondo intriso di scaltrezze e di indegnità abbisogna di menti in grado di batterlo sul suo stesso terreno, mantenendo giusto il cuore. «Ti voglio singolare», suona l’esortazione con cui Gracián apre il suo pamphlet rivolgendosi al lettore, «qui avrai non una politica né un’economica, ma una ragion di stato di te stesso». La si direbbe una potente anticipazione di figure metapolitiche come l’Anarca jüngeriano oppure l’Autarca evoliano…
La fama di Gracián non si limitò alla sua epoca o ai momenti di insorgenza sovrumanista. In tempi recenti il suo nome ha riscosso un famigerato successo tra le turbe dei manager d’azienda…e il povero Gracián si è visto trascinare via dall’etica tradizionale aristocratica e dal suo stoicismo barocco, fin dentro le maleodoranti stanze dei consigli d’amministrazione, nei grattacieli americani: numerose edizioni dei suoi libri sono state vendute come il pane tra le schiere di yuppies alla ricerca del facile successo attraverso i manuali di auto-stima per piazzisti in carriera. I suoi libri hanno conosciuto l’onta di essere paragonati alle pubblicazioni a grande tiratura in uso sin dagli anni Cinquanta negli USA, ad esempio quelle a cura della Fondazione Carnegie: come vincere la paura degli altri, come avere successo nel lavoro…Noi aggiungiamo: come trascinare un filosofo del sovrumanismo europeo nel fango della morale da insetti tipica del liberalismo americano…
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, philosophie, 17ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 mars 2009
Hommage à Emil Cioran
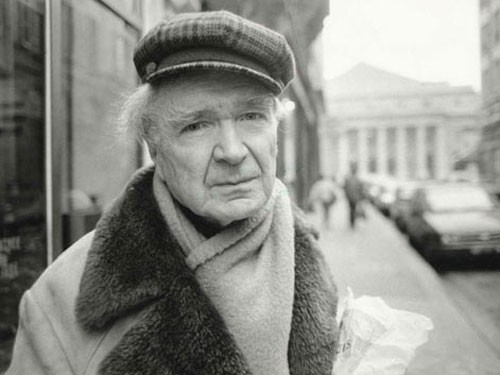
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Hommage à Emile Cioran
Au beau milieu de notre société de consommation et de plaisir, il était le héraut du déclin et du doute. L'écrivain roumain Emile Cioran est mort à Paris, à l'âge de 84 ans, le 20 juin 1995. Rien que les titres de ses livres, Précis de décomposition, Syllogismes de l'amertume ou De l'inconvénient d'être né, pourraient déclencher une dépression. Face à un homme comme Cioran, qui, selon sa propre confession, considère que toute rencontre avec un autre homme est une sorte de “crucifixion”, on est en droit de se poser la question que Nietzsche lui-même nous a suggérée: comment est-il devenu ce qu'il était?
Déjà à l'âge de dix ans, Cioran a vécu une sorte d'exclusion du Paradis. Il a dû quitter le monde de son enfance pour s'en aller fréquenter le lycée de Sibiu. Cioran décrit ce grand tournant de sa vie d'enfant: «Quand j'ai dû quitter ce monde j'avais le net pressentiment que quelque chose d'irréparable venait de se produire». Cet “irréparable” était très étroitement lié au monde simple des paysans et des bergers de son village natal. Plus tard, Cioran s'est exprimé sans ambigüité sur le monde de son enfance: «Au fond, seul le monde primitif est un monde vrai, un monde où tout est possible et où rien n'est actualisable».
Autre expérience décisive dans la vie de Cioran: la perte de la faculté de sommeil à l'âge de 20 ans. Cette perte a été pour lui “la plus grande des tragédies” qui “puisse jamais arriver à un homme”. Cet état est mille fois pire que purger une interminable peine de prison. Voilà pourquoi son livre Sur les cîmes du désespoir a été conçu dans une telle phase de veille. Cioran considérait que ce livre était le “testament d'un jeune homme de vingt ans” qui ne peut plus songer qu'à une chose: le suicide. Mais il ne s'est pas suicidé, écrit-il, parce qu'il ne pouvait exercer aucune profession, vu que toutes ses nuits étaient blanches. Elles ont été à l'origine de sa vision pessimiste du monde. Et jamais, dans sa vie, Cioran n'a été contraint de travailler. Il a accepté toute cette “peine”, cette “précarité”, cette “humiliation” et cette “pauvreté” pour ne pas devoir renoncer à sa “liberté”. «Toute forme d'humiliation» est préférable «à la perte de la liberté». Tel a été le programme de sa vie, aimait-il à proclamer.
Avant d'émigrer en France en 1937, Cioran écrivait Larmes et Saints, un livre qu'il considérait être le résultat de sept années d'insomnie. Ce que signifie l'impossibilité de dormir, Cioran l'a exprimé: la vie ne peut “être supportable” que si elle est interompue quotidiennement par le sommeil. Car le sommeil crée cet oubli nécessaire pour pouvoir commencer autre chose. Ceux qui doivent passer toutes leurs nuits éveillés finissent par segmenter le temps d'une manière entièrement nouvelle, justement parce que le temps semble ne pas vouloir passer. Une telle expérience vous modifie complètement la vie. Tous ceux qui veulent pénétrer dans l'œuvre de Cioran, doivent savoir qu'il a été un grand insomniaque, qu'il en a profondément souffert.
Les nuits de veille de Cioran sont aussi à l'origine de son rapport particulier à la philosophie. Celle-ci ne doit pas aider Cioran à rendre la vie “plus supportable”. Au contraire, il considère que les philosophes sont des “constructeurs”, des “hommes positifs au pire sens du terme”. C'est la raison pour laquelle Cioran s'est surtout tourné vers la littérature, surtout vers Dostoïevski, le seul qui aurait pénétré jusqu'à l'origine des actions humaines. La plupart des écrivains de langues romanes ne sont pas parvenu à une telle profondeur, écrivait Cioran. Ils sont toujours resté à la surface des choses, jamais ils n'ont osé s'aventurer jusqu'aux tréfonds de l'âme, où l'on saisit à bras le corps le “démon en l'homme”.
1937 a aussi été l'année où Cioran a dû reconnaître que la voie religieuse et mystique lui était inaccessible. Comme il le constatait rétrospectivement, il n'était tout simplement “pas fait pour la foi”. Car avoir la foi était au fond un don, écrivait Cioran, et on ne peut pas vouloir croire, ce serait ridicule.
Quand on prend connaissance de cet arrière-plan, on ne s'étonnera pas que Cioran revient sans cesse sur son expérience du “néant”, du “néant” qui ne devient tangible que par l'ennui. Du point de vue de Cioran, on ne peut supporter la vie que si l'on cultive des illusions. Et si l'on atteint la “conscience absolue”, une “lucidité absolue”, alors on acquiert la “conscience du néant” qui s'exprime comme “ennui”. Cependant, l'expérience de l'ennui découle d'un doute, d'un doute qui porte sur le temps. C'est à ce sentiment fondamental que pensait Cioran quand il disait qu'il s'était “ennuyé” pendant toute sa vie.
On ne s'étonne pas que Cioran avait un faible pour les cimetières. Mais ce faible n'a rien à voir avec les attitudes prises aujourd'hui par les Grufties. Pour notre auteur, il s'agissait surtout d'un changement de perspective. C'est justement dans une situation de douleur de l'âme, d'une douleur qui semble immense, démesurée, que le changement de perspective constitue la seule possibilité de supporter la vie. Quand on adopte la perspective du “néant”, tout peut arriver. Dans une certaine mesure, on en arrive à considérer comme parfaitement “normal” la plus grande des douleurs, à exclure toutes les “déformations par la douleur” qui conduisent au “doute absolu”.
Au cours des dernières années de sa vie, Cioran n'a plus rien écrit. Il ne ressentait plus l'“impérativité de la souffrance” qui fut toujours le moteur de sa production littéraire. Peut-être a-t-il tiré les conséquences de ses propres visions: nous vivons effectivement dans une époque de surproduction littéraire, surproduction absurde, totalement inutile.
Michael WIESBERG.
(trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres, littérature, lettres françaises, lettres roumaines, littérature française, littérature roumaine, france, roumanie, pessimisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 mars 2009
Frédéric Nietzsche et ses héritiers
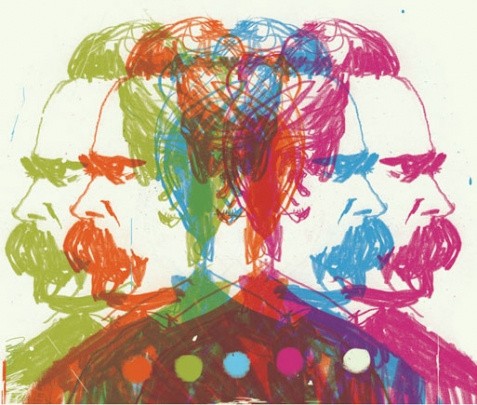
Frédéric Nietzsche et ses héritiers
(Intervention de Robert Steuckers - Université d'été de la FACE - 1995)
L'inpact de Nietzsche est immense: on ne peut remplacer la lecture de Nietzsche par une simple doxa, mais si l'on fait de l'histoire des idées politiques, on est obligé de se pencher sur les opinions qui mobilisent les élites activistes. L'objet de cet exposé n'est donc pas de faire de la philosophie mais de procéder à une doxanalyse du nietzschéisme politisé. Nous allons donc passer en revue les opinions qui ont été dérivées de Nietzsche, tant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique. Nietzsche est présent partout. Il n'y a pas un socialisme, un anarchisme, un nationalisme qui n'ait pas reçu son influence. Par conséquent, si l'on maudit Nietzsche, comme cela arrive à intervalles réguliers, si l'on veut expurger tel ou tel discours de tout nietzschéisme, si l'on veut pratiquer une “correction politique” anti-nietzschéenne, on sombre dans le ridicule ou le paradoxe. On en a eu un avant-goût il y a deux ans quand un quarteron de cuistres parisiens a cru bon de s'insurger contre un soi-disant rapprochement entre “rouges” et “bruns”: si rapprochement il y avait eu, il aurait pu tout bonnement se référer à du déjà-vu, à des idées nées quand socialistes de gauches et pré-fascistes communiaient dans la lecture de Nietzsche.
L'an passé, pour le 150ième anniversaire de la naissance de Frédéric Nietzsche, un chercheur américain Steven A. Aschheim a publié un ouvrage d'investigation majeur sur les multiples impacts de Nietzsche sur la pensée allemande et européenne, The Nietzsche Legacy in Germany 1890-1990 (California University Press). Etudier les impacts de la pensée de Nietzsche équivaut à embrasser l'histoire culturelle de l'Allemagne dans son ensemble. Il y a une immense variété d'impulsions nietzschéennes: nous nous bornerons à celles qui ont transformé les discours politiques des gauches et des droites.
Steven Aschheim critique les interprétations du discours nietzschéen qui postulent justement que Nietzsche a été “mésinterprété”. Il cite quelques exemples: l'école de Walter Kaufmann, traducteur américain de l'œuvre de Nietzsche. Kaufmann estime que Nietzsche a été “droitisé”, au point de refléter l'idéologie des castes dominantes de l'Allemagne wilhelmienne. Or celles-ci conservent une idéologie chrétienne, essentiellement protestante, qui voit d'un assez mauvais oeil la “philosophie au marteau” qui démolit les assises du christianisme. Le professeur anglais Hinton Thomas, lui, a publié un ouvrage plus pertinent, dans le sens où il constate que Nietzsche est bien plutôt réceptionné à la fin du 19ième siècle par des dissidents, des radicaux, des partisans, des libertaires, des féministes, bref, des transvaluateurs et non pas des conservateurs frileux ou hargneux.
Nietzsche est donc d'abord un philosophe lu par les plus turbulents des sociaux-démocrates, par les socialistes les plus radicaux et les plus intransigeants. Ces hommes et ces femmes manifestent leur insatisfaction face à l'orthodoxie marxiste du parti social-démocrate, où le marxisme devient synonyme de socialisme procédurier, sclérosé, bureaucratique. Les socialistes allemandes les plus fougueux rejettent la filiation “Hegel-Marx-Sociale-Démocratie”. L'itinéraire de Mussolini est instructif à cet égard. De même, la correspondante du journal L'Humanité, Isadora Duncan, en publiant des articles apologétiques sur la révolution russe, écrit, en 1920, que cette révolution réalisent les idéaux et les espoirs de Beethoven, Nietzsche et Walt Whitman. Aucune mention de Marx.
Ces socialistes radicaux voulaient en finir avec la “superstructure”. Ils pensaient pouvoir mieux la démolir avec des arguments tirés de Nietzsche qu'avec des arguments tirés de Marx ou d'Engels. Les jeunes sociaux-démocrates regroupés autour de Die Jungen, la revue de Bruno Wille, l'idéologue Gustav Landauer critiquent les pétrifications du parti et exaltent la fantaisie créatrice. La féministe Lily Braun s'oppose à toutes les formes de dogmatisme, vote les crédits de guerre contre le knout du tsarisme, le bourgeoisisme français et le capitalisme anglais, et finit, comme Mussolini, par devenir nationaliste. De même le pasteur non-conformiste Max Maurenbrecher évolue de la sociale-démocratie aux communautés religieuses libres, dégagées des structures confessionnelles, et de celles-ci à un nationalisme ferme mais modéré.
Après 1918, la gauche ne cesse pas de recourir à Nietzsche. Ainsi, Ernst Bloch, futur conseiller de Rudy Dutschke qui finissait par théoriser un national-marxisme, dérive une bonne part de sa méthodologie de Nietzsche. Marcuse, en se réclamant de l'Eros, critique la superstructure idéologique de la civilisation occidentale.
Mais les conformistes de la gauche n'ont jamais accepté ces “dérives indogmatisables”. Dès le début du siècle, un certain Franz Mehring ne cesse de rappeler les jeunes amis de Bruno Wille à la “raison”. Kurt Eisner, qui avait pourtant aimé Nietzsche, rédige un premier manuel d'exorcisme en 1919. Plus tard, Georg Lukacs abjure à son tour l'apport de Nietzsche, alors qu'il en avait été compénétré. Plus récemment, Habermas tente d'expurger tous les linéaments de nietzschéisme dans le discours de l'école de Francfort et de ses épigones. En France, Luc Ferry et Alain Renaut tente de liquider le nietzschéisme français incarné par Deleuze et Foucault, sous prétexte qu'il prône le vitalisme contre le droit. Toutes les manifestations de “political correctness” depuis le début du siècle ont pour caractéristique commune de vouloir éradiquer les apports de Nietzsche. Vaine tentative. Toujours vouée à l'échec.
(résumé de Catherine NICLAISSE).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : philosophie, allemagne, révolution conservatrice, nietzsche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 mars 2009
Notas sobre la tecnica y la suerte

Notas sobre la técnica y la suerte
Alberto Buela (*)
Hace ya muchos años un helenista de la talla de Conrado Eggers Lan nos llamaba la atención acerca de la relación entre téchne(tècnica) y týche(fortuna) en los griegos mientras nosotros la dejábamos pasar como con tantas otras enseñanzas de la otrora famosa Universidad de Buenos Aires.
El hombre, ese ser careciente del que nos habla A. Gehlen, ocupa en la escala de lo real un molesto e incordioso lugar intermedio entre la divinidad, las criaturas puramente espirituales y los procesos necesarios y regulares de la naturaleza. No somos ni dioses ni bestias, somos esta realidad “mistonga” que se mueve, por un lado, entre el deliberar y el hacer en función de un plan y metas a lograr y, por otro, el suceder ajeno a él de fuerzas fuera de su control. No pertenecemos totalmente al reino de la contingencia (lo que puede ser siempre de otra manera) pero tampoco totalmente al reino de la necesidad (lo que es regularmente siempre así).
El azar, la fortuna, la suerte, la týche es lo casual, aquello que no tiene causa racional sino una causa irracional y por ende accidental. Es ajena a la intención y a la responsabilidad. Sus categorías son el encuentro y el suceso. Se festeja el encuentro un tesoro o el suceso de un descubrimiento. Su emblema es Pandora, la frívola.
La técnica, la investigación, la téchne es una causa racional y por ende sustancial. Está vinculada a la deliberación y el sujeto es responsable de sus consecuencias. Sus categorías son la búsqueda y la conclusión. Busco una causa y al hallarla concluyo el trabajo. Su emblema es Prometeo, el liberador trabajoso.
Los antiguos griegos representaban a la fortuna como una mujer cautivante a través de los rasgos de inestabilidad, irracionalidad, seducción vinculada al engaño, ambivalencia y todos estos rasgos juntos Hesíodo se los atribuye a Pandora. Recordemos que ésta, esposa de Epimeteo y cuñada de Prometeo, es tentada por Zeus cuando le ofrece la famosa caja para perjudicar indirectamente a su cuñado que se había mostrado más astuto que Zeus mismo[1], y ella frívolamente la abre desoyendo los consejos de su prudente marido y deja escapar todos los males que son los que vienen a quebrar el orden originario de la Edad de Oro ocasionando la desdicha del género humano hasta hoy.
Posteriormente Prometeo tendrá que robar el fuego, elemento con el que el género humano iniciará las tèchnai.
Así, en adelante el hombre tendrá que hacer uso de su phrónesis, su sabiduría práctica o sapiencia expresada en la téchne para con trabajo y esfuerzo alimentarse y poder vivir.
A partir de ello surgen dos posturas clásicas ante la relación de téchne y týche, una la de aquellos que afirman que pueden someter a la fortuna a través del poder de la razón. Es la vía de la modernidad que incluso anula a la suerte o fortuna y le otorga el monopolio al hacer sobre el suceder. Surge así el homo faber. Y otra distina, es la de aquellos que sostienen que no pueden dominarla totalmente y que como Ortega van a sostener que “el hombre es una isla racional rodeada de un mar de irracionalidades”. Son los sostenedores de la imperfecta y careciente condición humana.
Hoy rescatar la týche, la suerte es una tarea más a favor del logro de una mayor y mejor visión del hombre, el mundo y sus problemas. Recatarla como hecho raro y accidental no intentado sino “que sucede” y que como tal viene a mostrar el carácter de provisorio de la existencia humana y de la vida del hombre de todos los días.
En un primer análisis descriptivo podemos decir que la fortuna es el encuentro por accidente de varias causas independientes unas de otras. Se produce un cruce de causas que no podemos explicar pero que están allí y han producido tal o cual suceso. El ejemplo clásico es el del encuentro del tesoro, donde se cruzan dos causas independientes: la del hombre rico que esconde por temor un tesoro en un campo abandonado y el pobre labrador que no teniendo donde arar lo hace en ese campo y lo encuentra.
En un segundo y más profundo nivel de análisis observamos que la fortuna o suerte introduce la novedad en la naturaleza y genera la prosperidad necesaria a la felicidad. Los pobres han sido y son siempre los más recurrentes a la týche con la esperanza que ella le provea aquel quantum de prosperidad que la vida de todos los días le niega. Ella es un constitutivo de la felicidad pero que escapa no solo a la virtud sino a la voluntad, a la capacidad de dominio del hombre. Ella nace de la contingencia operativa del obrar humano que cuando es perfecto consiste en obrar de un modo regular aunque variado, no siempre igual. Pero cuando es imperfecta es cuando falla y no se logra el fin perseguido. La existencia de la fortuna, el azar, la suerte o la týche muestra que los hombres no somos ni dioses ni bestias.
La filosofía moral moderna que se presenta como autónoma con Kant a la cabeza busca dominar todo con la razón, entre otras cosas busca la certeza en los juicios éticos. En tanto que los planteos éticos premodernos, ej. Aristóteles, están guiados por la idea de verosimilitud donde entra a jugar, entre otros, el concepto de fortuna.
La idea de probabilidad alimenta la ética antigua en oposición al ideal de certeza deductiva típica de la modernidad.
Para los griegos no se podía buscar el mismo tipo de rigor para razonamientos matemáticos como para los morales. Estos últimos se caracterizaban por el uso de la expresión “por lo general = hos epí to polý “. Así el hombre en la vida práctica delibera sobre los medios y en particular sobre aquello que “por lo general” acontece de cierta manera. Allí aplica la téchne (técnica) pero sabe que allí también puede converger la týche (fortuna).
Pero, ¿dónde o quién da la pauta de cómo se debe obrar?. Para la ética racionalista moderna son las normas o leyes generales del obrar humano resumidas en el principio formal kantiano de: obra de tal forma que la máxima de tu acción se transforme en ley universal” y esta norma “hay que cumplirla”, en tanto que para la ética premoderna se apoya en el ejercicio de la virtud y ésta solo puede desarrollarse o perderse (en la vida espiritual el que no avanza retrocede van a enseñar los grandes monjes medievales) y la pauta va a estar dada por el hombre prudente, el spoudaios, como juez último de la rectitud de los actos.
El hombre digno, el spoudaios, el hombre de valor va a enseñar Aristóteles es el que enjuicia todas las cuestiones de la filosofía práctica y desvela lo verdadero. “El hombre digno y de valor difiere sobre todos los demás por ver lo verdadero en cada cuestión, como si fuera la norma y la medida de ellas” (Eth. Nicomaquea, 1166 a 12-29).
[1] Recordemos que el problema entre Zeus y Prometeo nace cuando carneado un toro Prometeo arma dos sacos de cuero, en uno de los cuales coloca la grasa y los huesos a sabiendas que iba a ser el más grande y en otro la pulpa de la carne. Llegado Zeus le dio a elegir y su angurria lo llevó más grande. A partir de ese momento hasta nuestros días los dioses comen grasa la que se les ofrece en forma de en ciros o velas encendidas para su honra. Al percatarse Zeus que Prometeo (etimológicamente: el que ve antes) previó su ambición desmedida y lo engañó a partir de un defecto suyo, preparó su venganza utilizando a la frívola Pandora, su cuñada. ¡Cuidado con la aproximación indirecta del enemigo!.
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : technique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook