lundi, 13 juin 2022
De la "webocratie"

De la "webocratie"
Au milieu des difficultés, des embarras et des hypocrisies d'une classe politique culturellement désarmée, coupable d'avoir sous-estimé de manière flagrante la relation entre la démocratie et la diffusion du savoir, incapable de réguler les géants du numérique, nous nous retrouvons dans la fâcheuse situation de la fameuse grenouille bouillie à petits feux doux.
Luca Giannelli
Source: https://www.dissipatio.it/macron-webcrazia-digitale-occidente/
Il y a quelques années, lors d'une de ses proverbiales conférences de presse, Jean-Luc Godard racontait comment, dès son plus jeune âge, ses parents lui reprochaient de toujours raconter des histoires, tout le contraire de ce que les critiques les plus obtus lui reprochaient : ne pas raconter d'histoires du tout, faire des films sans structure narrative conventionnelle. Raconter des histoires, disait l'écrivain Bernard Malamud, est un moyen de trouver un sens à la vie. Pour le président français Macron, cela semble être le moyen de trouver un sens à la politique :
"Nos sociétés post-modernes ne sont pas sécularisées mais ont émergé d'un grand récit qui était religieux. Le 20e siècle a connu d'autres récits, après le grand récit de l'émancipation, le grand récit des totalitarismes, et collectivement nous avons pensé que la fin des totalitarismes passait par la fin des grands récits".
Le Monde diplomatique, mars 2022
Le président français est très occupé dans sa tentative de marcher sur la ligne fantômatique entre modernité et postmodernité. Lui qui, en 2017 déjà, allait au cœur du problème : "Nous avons (de toute urgence) besoin d'un grand récit" (Der Spiegel, 14 octobre 2017).
Issu d'une certaine culture constructiviste d'outre-mer, encline à revisiter le passé avec un goût ironique et populaire en réaction aux dogmes rationalistes, le terme "postmodernisme" a fait son entrée dans le monde intellectuel dans les années 1970, jusqu'à être systématisé comme une véritable "condition", en tant que catégorie "post-narrative" à part entière, à la fin de la même décennie, par le philosophe français Jean-François Lyotard, qui a su capitaliser sur un essai de 1967 de Rorty dans l'introduction de The Linguistic Turn, dans lequel il prédisait la fin de la philosophie dans un monde où la communication avait pris la place de l'expression.

Plaçant les "récits" des Modernes à l'origine des dogmatismes et de toutes les dérives politiques du XXe siècle (totalitarismes, guerres et autres méfaits divers), Lyotard propose une attitude de détachement vis-à-vis de termes philosophiques galvaudés comme "vérité", "réalité" ou "objectivité", régulièrement "cités". Cela a donné lieu à un débat très local entre la pensée "faible" et la pensée "forte" (en un mot, entre le relativisme et le fondamentalisme, ou, si vous préférez, entre Nietzsche et Parménide, avec Heidegger agissant comme un roc ambigu et encombrant), qui avait pour porte-parole Gianni Vattimo et Emanuele Severino. C'était le débat classique en noir et blanc, capable de produire surtout des fleuves et des fleuves d'encre (ceux des pages d'Alfabeta constitueraient à eux seuls une jungle) dont on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à chérir, mais qui, dans l'ensemble - le pouvoir de la communication - a fini par fonctionner comme un alibi culturel pour un certain yuppisme rampant, une sorte d'incubateur de la pop italienne si en vogue aujourd'hui, un épigone à faible intensité du camp américain des années 1960.
Une sorte de nivellement, mais pas dans le sens où Totò l'entendait. Tout a la même valeur, tout peut être interprété et doit être traité exactement de la même manière. Ayant dépassé la verticalité de l'art et de l'histoire au nom d'une nouvelle horizontalité citationniste, toute hiérarchie culturelle sautée, les critiques élevés au rang d'artistes, selon l'hétérogénéité des fins la plus canonique, la "condition postmoderne" a ainsi transcendé la dimension critique de Lyotard, pour en arriver à la joyeuse justification du désengagement: comme le dit Jameson, la philosophie de la globalisation, capable de servir de toile de fond à l'ère de la production flexible. En fin de partie, de l'univers postmoderniste sont nées des montagnes de malentendus sur les cendres d'une modernité qui se voulait dépassée mais qui, idéologies mises à part, restait elle-même indéfinie, prisonnière des milliers de distinctions et d'interprétations auxquelles elle continue d'être soumise. Un peu comme le quintet, le jeu mystérieux du film le plus "nocturne" de Robert Altman, celui auquel tout le monde joue mais dont personne ne connaît les règles.
 Quelque quarante ans après l'essai de Lyotard, on peut se demander s'il est encore possible de qualifier notre condition de "postmoderne". Plus que jamais, marqués que nous sommes par des urgences économiques, pandémiques, guerrières et diplomatiques dont le résultat, pour une fois, ne peut être que d'exaspérer des processus déjà en cours, dans les difficultés, les embarras et les hypocrisies d'une classe politique culturellement désarmée... coupable d'avoir sous-estimé de manière flagrante la relation entre la démocratie et la diffusion de la connaissance, aux prises ces dernières années avec une "société civile" qui s'est souvent révélée peu civilisée, incapable de réguler les géants du numérique au point de se retrouver dans la fâcheuse situation de la fameuse grenouille bouillie à petits feux doux.
Quelque quarante ans après l'essai de Lyotard, on peut se demander s'il est encore possible de qualifier notre condition de "postmoderne". Plus que jamais, marqués que nous sommes par des urgences économiques, pandémiques, guerrières et diplomatiques dont le résultat, pour une fois, ne peut être que d'exaspérer des processus déjà en cours, dans les difficultés, les embarras et les hypocrisies d'une classe politique culturellement désarmée... coupable d'avoir sous-estimé de manière flagrante la relation entre la démocratie et la diffusion de la connaissance, aux prises ces dernières années avec une "société civile" qui s'est souvent révélée peu civilisée, incapable de réguler les géants du numérique au point de se retrouver dans la fâcheuse situation de la fameuse grenouille bouillie à petits feux doux.
Une fois que l'on a réalisé à quel point la fracture numérique a contribué à accroître le fossé entre les riches et les pauvres, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, à augmenter les processus d'atomisation et les effrayantes multiplications du moi, l'objectif des dirigeants ne semble pas être de capturer et de répandre la connaissance mais de la contenir et de gérer le consensus. Car c'est paradoxalement la "sphère publique" elle-même qui est entrée en crise, avec la dictature des algorithmes et la logique rudimentaire du "j'aime - je n'aime pas", réduite désormais à des micro-récits consommés par des selfies et des posts dans un présent qui ne pense même pas à faire l'histoire. Contrairement à ce qu'espéraient non seulement certains pionniers américains des années 1970 comme Stewart Brand, mais aussi de nombreux technocrates purs et durs comme le magazine Wired qui, en mai 2009 encore, consacrait sa couverture au "Nouveau Socialisme", Internet n'a conduit ni à une plus grande diffusion de la culture, ni à la croissance d'une opinion publique comprise comme le reflet d'une communauté politique supérieure à elle-même, qui, comme l'a observé Martin Gurri dans La Révolte du Public n'existe plus, remplacée par une série de publics tribalisés et mutuellement armés.


Et si le pacte tacite entre les entreprises bigtech et les utilisateurs est celui des applications gratuites en échange d'informations privées, bien plus inquiétant pour l'avenir de nos démocraties, risque d'être celui qui se met en place entre les grandes plateformes et les gouvernements, célébré avec la concentration entre les mains de Zuckerberg d'Instagram, Facebook et WhatsApp : je te laisse prospérer et toi en échange tu contrôles ce qu'on appelait autrefois la "majorité silencieuse" et qui aujourd'hui est de plus en plus une majorité mais beaucoup moins silencieuse. Une sorte de pacte confirmé par les documents divulgués par Snowden en 2013, qui ont révélé la participation des grandes plateformes aux programmes de surveillance et de renseignement américains, et qui, je pense, permet également de comprendre pourquoi une grande partie de l'hostilité des médias envers le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, le grand amateur de Tolkien qui a immédiatement dénoncé la prédilection des médias sociaux les plus politiques parmi ceux en circulation à montrer les posts les plus populaires au détriment des plus récents en faveur d'un récit dominant, dénotant ainsi une "irrégularité" jugée par beaucoup comme politiquement peu fiable.
D'où l'appel insistant à de nouveaux "grands récits" exprimé à plusieurs reprises par Macron ; lequel Macron, avec Ricoeur ou sans lui, est diplômé en philosophie et après avoir battu Le Pen, malgré ses trois millions de voix de plus qu'en 2017, s'est imposé comme l'homme de paille le plus autorisé de la pensée libérale dans le monde occidental et s'est automatiquement élevé - un peu comme la victoire illo tempore de Prodi sur Berlusconi - pour devenir un modèle trop facile pour nombre de nos politiciens "progressistes", dans une gamme variée qui va de l'auto-proclamé roi du storytelling Renzi aux anciens gilets jaunes Di Maio, fidèles désormais du Premier ministre Draghi. C'est un Macron qui, avant et plus que d'autres, a compris que le problème des démocraties occidentales est de trouver des critères de jugement et de légitimation qui aient une valeur à la fois locale et universelle ; un Macron lucidement "post-moderne", conscient de l'irréversibilité du processus culturel, de l'affirmation d'une multiplicité de langages incommensurables, de combien l'éclatement des métarécits a multiplié la pluralité et les formes d'un savoir qui ne peut plus se présenter comme une vision universelle du monde.
Mais il est en même temps un Macron "moderne" qui, contrairement à Rorty et Lyotard, regrette l'unité et la totalité perdues, un Macron nostalgique de ce grand récit du vingtième siècle qui avait façonné le monument inattaquable du progrès, réticent comme beaucoup de gouvernements européens à se mesurer à tout ce qui est multiple, fragmentées et instables, fortement motivées pour offrir une interprétation du passé qui puisse donner un sens à l'avenir, puisque seules sont "modernes" les sociétés qui ancrent les discours de vérité et de justice sur des méta-récits (culturels, historiques, scientifiques) englobant toute l'histoire humaine dans un cadre de référence unique ; un Macron qui, face à la croissance généralisée des processus d'atomisation, une effrayante multiplication du moi, est prêt à disqualifier comme "réactionnaire", "populiste", "souverainiste" ou "eurosceptique" quiconque tente de remettre en question le récit libéral-progressiste capable d'annuler les différences entre la vérité historique et la séduction rhétorique. C'est un terrain sur lequel le secrétaire du PD socialiste italien, Letta, semble s'être accordé avec son programme pour "un nouvel ordre européen", qui penche désormais vers une confédération qui fonctionnerait comme une sorte d'anneau encore plus large qui réunirait les 27 États membres de l'UE avec les pays candidats. Partant d'hypothèses post-modernes critiques, les démocraties européennes semblent donc viser à établir une normalisation "moderne".
Que cette modernité, une énigme pour tout penseur digne de ce nom, dont même le Cardinal Ruini a identifié l'ineffabilité il y a quelques années ("il y a beaucoup de modernités", selon ses mots), ne puisse être séparée du web, est en tout cas hors de question. De là, l'avenir de nos démocraties, inévitablement, ne peut que passer, de là, à la perspective macronienne, illustrée en novembre 2018 lors d'un forum de l'ONU à Paris sur la gouvernance de l'internet. Une perspective "centriste" qui entend se démarquer à la fois de la vision libertaire californienne, dont les protagonistes sont des acteurs forts qui rejettent tout contrôle étatique, et de la vision "chinoise", entièrement supervisée par un État autoritaire. La solution esquissée par le président français est la troisième voie canonique, qui implique dans ce cas les acteurs privés, les journalistes, les gouvernements et l'habituelle et indéfectible société civile.

Le jeune Emmanuel Macron avec le philosophe Paul Ricoeur.
Une intention louable, mue par une juste préoccupation pour la perte de centralisation dans l'organisation de l'État, mais toujours enveloppée dans une perspective prisonnière de cet absolutisme miraculeux de la terre promise (le numérique comme outil de civilisation du monde) typique de la Silicon Valley, exhibé à l'époque par l'Obamiste italien Renzi. Une pensée - un récit, pour être précis - qui semble prendre substantiellement en otage une politique qui n'a jamais semblé aussi proche d'étouffer dans la logique des milliards d'algorithmes ; une idée que même Sabino Cassese semble regarder sans crainte, persuadé que des greffes comme celle de nature "technocratique" sont bonnes pour la démocratie (Sullo stato della democrazia, Il foglio, 24 mai 2022).
Ce qui est surprenant, dans l'ensemble, chez tant de porte-drapeaux convaincus de la démocratie avec un "D" majuscule, c'est la suppression "démocratique" du concept même sur lequel le libéralisme a prospéré, à savoir le pluralisme. Les raisons du consensus, combinées à la surpuissance économique et à un déficit culturel inquiétant et irréversible, empêchent nos classes dirigeantes de comprendre que les problèmes sociaux ne sont pas nés avec le web et qu'aucun web ne pourra jamais les guérir. Pour le dire autrement, que les problèmes du web, que tant de scandales et de clameurs peuvent créer (Trump et la prise d'assaut du Capitole en sont un exemple), sont en dehors du web. N'oublions jamais que la fake news la plus lourde de conséquences et à l'origine d'une guerre qui n'a exporté aucune démocratie et a accru le terrorisme est née non pas sur les médias sociaux mais dans un journal comme le New York Times (qui s'est ensuite au moins excusé, contrairement à tous les autres qui l'avaient suivi comme des moutons). Le web obscurcit, amplifie, cache ou exagère, peut-être, mais il ne guérit pas, et encore moins ne rachète. Seul un politicien inculte et ignorant peut croire ou faire semblant de croire que des concepts tels que la légitimité, la stabilité, peuvent être gouvernés par des plateformes numériques.
Ce ne sont pas de nouvelles mythologies, de méta-narratifications idéalistes, dont nous avons besoin, mais d'une véritable démocratisation de la culture, d'une politique qui sait faire de la politique, qui pense la démocratie non comme quelque chose de donné pour toujours, comme le fameux diamant, mais comme un bien à chérir et à cultiver, inséparable d'une connaissance qui ne peut être déléguée au circuit social.
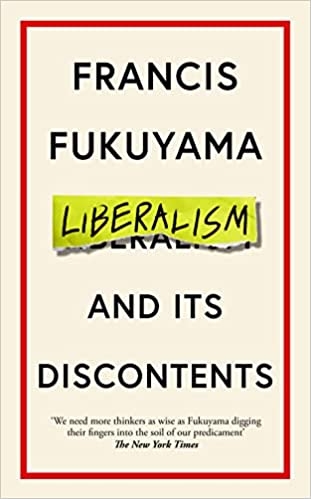 Une politique qui tente de répondre à la question suivante : quelles sont les perspectives de la démocratie dans une société qui, sous les coups d'une concentration progressive des richesses, a perdu l'idée originelle de communauté ? Une politique qui sait aller au-delà de la très générique "confiance dans les institutions démocratiques" encore prônée dans son dernier livre (Liberalism and its Discontents) par un Fukuyama qui a toujours démontré que sa conception du libéralisme est non seulement idéaliste, mais aussi profondément déformée, s'il est vrai qu'il a attribué le succès du Japon à son libéralisme économique sans comprendre que le modèle japonais était en fait le modèle étatiste de Hamilton, fondateur, au début du 19ème siècle, du système bancaire américain. La politique ne peut être réduite à devenir un spectacle digne d'Oprah Winfrey, pour qui "tout est question d'imagination". Sans une véritable culture de la politique, la démocratie sera toujours une créature à la vie trouble. Pour la récupérer, il ne suffit certainement pas, comme le font Fukuyama, Cassese et consorts, de diaboliser tous les Orbans, Le Pen et Bolsonaros du monde...
Une politique qui tente de répondre à la question suivante : quelles sont les perspectives de la démocratie dans une société qui, sous les coups d'une concentration progressive des richesses, a perdu l'idée originelle de communauté ? Une politique qui sait aller au-delà de la très générique "confiance dans les institutions démocratiques" encore prônée dans son dernier livre (Liberalism and its Discontents) par un Fukuyama qui a toujours démontré que sa conception du libéralisme est non seulement idéaliste, mais aussi profondément déformée, s'il est vrai qu'il a attribué le succès du Japon à son libéralisme économique sans comprendre que le modèle japonais était en fait le modèle étatiste de Hamilton, fondateur, au début du 19ème siècle, du système bancaire américain. La politique ne peut être réduite à devenir un spectacle digne d'Oprah Winfrey, pour qui "tout est question d'imagination". Sans une véritable culture de la politique, la démocratie sera toujours une créature à la vie trouble. Pour la récupérer, il ne suffit certainement pas, comme le font Fukuyama, Cassese et consorts, de diaboliser tous les Orbans, Le Pen et Bolsonaros du monde...
A propos de l'auteur
Luca Giannelli est journaliste et rédacteur en chef du Télé-Journal à La7, où il couvre les domaines de la culture et de la politique. Chez GOG Edizioni, il a publié 'America vs. America".

16:38 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, webocratie, problèmes contemporains, emmanuel macron, postmodernité, modernité, grands récits, narrations |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


