vendredi, 05 septembre 2025
États-Unis et Chine: une concurrence, deux mondes

États-Unis et Chine: une concurrence, deux mondes
Derrière les stratégies des États se cachent des actions rationnelles. Cependant, contrairement à ce que prétend généralement la sagesse conventionnelle occidentale, la rationalité n'est pas universellement la même pour toutes les nations: les cultures conditionnent les mentalités et, par conséquent, les processus décisionnels.
Andrés Berazategui
Source: https://politicar.com.ar/contenido/1065/estados-unidos-y-...
La concurrence entre les États-Unis et la Chine met en évidence différentes manières de planifier des stratégies et d'agir. La pensée stratégique, étant quelque chose de complexe, révèle également que les contextes culturels qui sous-tendent les décisions des acteurs internationaux peuvent être très différents. En effet, la stratégie est planifiée en vue d'atteindre des objectifs à l'aide d'un ensemble de moyens utilisés de manière rationnelle. Or, la rationalité des acteurs, c'est-à-dire leur capacité à calculer et à évaluer de manière réfléchie l'utilisation des moyens permettant d'atteindre ces objectifs, n'est pas nécessairement la même chez tous, car les rationalités peuvent être conditionnées par des contextes culturels différents. Par exemple, l'immolation personnelle pour commettre un attentat peut être un moyen parfaitement rationnel pour un certain acteur, alors que pour un autre, c'est tout le contraire. Sans aller jusqu'à cet extrême, nous pensons qu'il est possible d'observer une différence de mentalité dans les stratégies des États-Unis et de la Chine, les deux plus grandes puissances actuelles.
Ce n'est plus un secret pour personne que les États-Unis et la Chine sont en concurrence dans de nombreux domaines de la politique internationale. Citons quelques-uns des thèmes les plus importants : la rivalité dans le commerce international ; les différents discours utilisés par les États-Unis et la Chine pour justifier leurs actions ; la présence militaire du géant asiatique au-delà de ses frontières et en particulier dans la mer de Chine méridionale ; les tensions permanentes autour de Taïwan ; l'alliance de plus en plus étroite entre la Chine et la Russie ; l'activité croissante dans l'espace extra-atmosphérique ; les accusations relatives à la cybersécurité ; les campagnes de « désinformation » ; la concurrence pour les ressources — notamment les minéraux et les métaux critiques — ; les développements en matière de biotechnologie, de semi-conducteurs, d'intelligence artificielle...

Cependant, les deux pays présentent des différences notables dans la manière dont ils planifient leurs stratégies et défendent leurs intérêts. Même s'il n'a pas été le premier à le remarquer, il convient de rappeler ce qu'a dit Henry Kissinger à propos des différences entre la Chine et l'Occident. Il a illustré son propos en donnant l'exemple des « jeux respectifs auxquels chaque civilisation s'est adonnée » : le wei ki (plus connu sous le nom de go en Occident) en Chine et les échecs dans le monde occidental. Kissinger explique que dans le wei ki, l'idée d'encerclement stratégique est fondamentale. En effet, le nom du jeu peut se traduire par quelque chose comme « jeu de pièces environnantes ».
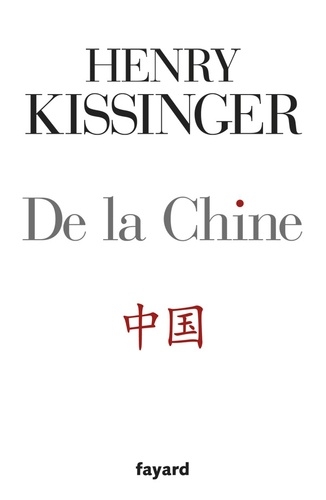 Kissinger poursuit : « Les joueurs placent à tour de rôle les pierres à n'importe quel endroit de la grille, créant ainsi des positions de force et s'efforçant en même temps d'encercler et de capturer les pierres de l'adversaire ». Il souligne également comment, au fur et à mesure des mouvements des pièces, les équilibres se modifient progressivement jusqu'à ce que, vers la fin de la partie, « le plateau se remplisse de zones de forces qui s'entrelacent partiellement ». Le wei ki cherche à encercler les pièces de l'adversaire en occupant le plus grand nombre possible d'espaces vides. Le but du jeu n'est pas de « manger des pièces », mais d'obtenir la domination stratégique du plateau en acculant l'adversaire tout au long de la partie, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune possibilité de faire des mouvements productifs ». Pour sa part, le jeu d'échecs est différent. Kissinger nous dit que, dans ce jeu, on recherche la victoire totale. Et c'est vrai, dans le jeu d'échecs, l'objectif « est le mat, placer le roi adverse dans une position où il ne peut plus bouger sans être détruit ». L'interaction des pièces est directe : elles cherchent à s'éliminer pour occuper des cases bien délimitées. Les pièces se mangent et sont retirées du plateau, épuisant ainsi l'adversaire et orientant les efforts vers l'encerclement de la pièce principale, le roi, jusqu'à ce que, comme nous l'avons dit, celui-ci ne puisse plus bouger sans être détruit.
Kissinger poursuit : « Les joueurs placent à tour de rôle les pierres à n'importe quel endroit de la grille, créant ainsi des positions de force et s'efforçant en même temps d'encercler et de capturer les pierres de l'adversaire ». Il souligne également comment, au fur et à mesure des mouvements des pièces, les équilibres se modifient progressivement jusqu'à ce que, vers la fin de la partie, « le plateau se remplisse de zones de forces qui s'entrelacent partiellement ». Le wei ki cherche à encercler les pièces de l'adversaire en occupant le plus grand nombre possible d'espaces vides. Le but du jeu n'est pas de « manger des pièces », mais d'obtenir la domination stratégique du plateau en acculant l'adversaire tout au long de la partie, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune possibilité de faire des mouvements productifs ». Pour sa part, le jeu d'échecs est différent. Kissinger nous dit que, dans ce jeu, on recherche la victoire totale. Et c'est vrai, dans le jeu d'échecs, l'objectif « est le mat, placer le roi adverse dans une position où il ne peut plus bouger sans être détruit ». L'interaction des pièces est directe : elles cherchent à s'éliminer pour occuper des cases bien délimitées. Les pièces se mangent et sont retirées du plateau, épuisant ainsi l'adversaire et orientant les efforts vers l'encerclement de la pièce principale, le roi, jusqu'à ce que, comme nous l'avons dit, celui-ci ne puisse plus bouger sans être détruit.
Dans le wei ki, on cherche à encercler et à contourner, on fait appel à la flexibilité, à l'exploration des espaces sur l'échiquier en essayant d'occuper ses vides : le wei ki a une conception du temps plus liée à des développements fluides et rythmés. La rationalité dans les échecs se manifeste différemment: il s'agit de dominer la zone centrale du plateau, car c'est son « centre de gravité ». Les joueurs cherchent à « tuer » les pièces adverses en les mangeant et en les remplaçant par leurs propres pièces. Aux échecs, on s'affronte pièce par pièce, on cherche donc à être décisif. Une pièce qui est mangée reste à l'extérieur et le temps est mesuré avec plus de précision, car l'élimination d'une pièce ne se fait pas par un détour (tâche qui prend un certain temps), mais elle est mangée à un moment précis, localisable avec exactitude.
 Ce n'est pas un hasard si, d'un point de vue militaire, les plus grands stratèges des deux cultures sont si différents. Sun Tzu et Clausewitz illustrent clairement les différences que nous avons relevées ici, car ils s'appuient tous deux sur des rationalités analogues à celles que nous avons exposées en parlant des jeux.
Ce n'est pas un hasard si, d'un point de vue militaire, les plus grands stratèges des deux cultures sont si différents. Sun Tzu et Clausewitz illustrent clairement les différences que nous avons relevées ici, car ils s'appuient tous deux sur des rationalités analogues à celles que nous avons exposées en parlant des jeux.
Sun Tzu explique qu'il faut essayer de subordonner la volonté de l'ennemi, mais si possible sans combattre. Sa maxime selon laquelle « l'art suprême de la guerre consiste à soumettre l'ennemi sans livrer bataille » est bien connue. Sun Tzu recherche ce que l'on pourrait définir comme une patience stratégique, étroitement liée à la notion d'un temps qui s'écoule et se régule au fur et à mesure que ses propres mouvements et ceux de l'ennemi se produisent. C'est pourquoi les questions immatérielles revêtent une telle importance pour le stratège chinois. Si l'idéal ultime est de soumettre sans livrer bataille, on comprend que Sun Tzu accorde autant d'importance à des choses telles que connaître l'ennemi ou recourir au mensonge et à la tromperie. Pour l'Orient, la bataille est très coûteuse en hommes et en ressources, c'est pourquoi il vaut mieux essayer de l'éviter et n'y recourir que lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative.
Clausewitz est tout à fait différent, tout comme le reste des stratèges militaires classiques occidentaux. Pour commencer, pour le Prussien, la bataille est cruciale. De plus, l'idéal n'est pas d'éviter les batailles, mais au contraire d'essayer d'en trouver une qui soit décisive. L'objectif de la guerre est de vaincre l'ennemi par la force, car la guerre est avant tout un acte de violence physique. C'est pourquoi Clausewitz accorde une grande importance aux variables matérielles, temporelles et spatiales qui peuvent favoriser au mieux les performances au combat. Dans la pensée stratégique militaire occidentale, la confrontation, la force et l'anéantissement de l'ennemi sont fondamentaux.

Si nous appliquons cette analyse à la concurrence actuelle entre la Chine et les États-Unis, nous constatons que les schémas de pensée que nous avons exposés se retrouvent dans la manière dont les deux puissances gèrent leurs géostratégies respectives. La Chine cherche principalement à promouvoir des intérêts mutuellement avantageux avec d'autres acteurs — afin de les convaincre qu'il est profitable de s'entendre avec elle —, tout en recourant au soft power pour se présenter comme une puissance bienveillante et diplomatique qui ne recherche que la prospérité commune.
Les mesures coercitives sont généralement des derniers recours que la Chine met en œuvre de manière indirecte et à des degrés d'intensité variables en fonction du contexte. La projection du géant asiatique sur la mer de Chine méridionale ressemble à un coup de wei ki : il occupe des espaces « vides » (de souveraineté pratique relative ou contestée) en construisant des îles artificielles qui s'articulent autour d'une « ligne de neuf points » qui entoure l'espace qu'il entend dominer. La construction de ces îles est menée de manière si soutenue et ferme qu'elle laisse peu de place aux manœuvres politiques des États de la région. Dans le même temps, la Chine, à travers son initiative « Belt and Road », déploie sa puissance sur une vaste zone géographique en générant des investissements et des intérêts communs avec des acteurs qui, en principe, bénéficient du projet. Avec l'initiative « Belt and Road », la Chine étend à long terme son influence et son commerce en attirant un grand nombre de pays avec de bons dividendes.
Les actions américaines, en revanche, sont clairement différentes. Les États-Unis mettent toujours l'accent sur le hard power, les actions directes et même les menaces publiques. Sa stratégie pour la région indo-pacifique, principal espace de concurrence avec Pékin, consiste généralement en une combinaison d'accords en matière de sécurité et de renseignement avec les pays de la région (AUKUS, QUAD, Five Eyes, ou accords bilatéraux de défense avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines) et de sanctions économiques et de restrictions technologiques à l'égard de la Chine. Les États-Unis s'opposent explicitement à la Chine, au point que la reconnaissance de cette dernière comme principale menace pour les intérêts mondiaux des États-Unis est un point de convergence fondamental entre les partis démocrate et républicain. Le fait que Donald Trump se soit montré un peu plus ouvert au dialogue avec Xi Jinping ne change rien à l'équation, selon nous. La concurrence stratégique entre les deux pays est là pour durer. Chacun agira selon sa stratégie, sa vision du monde et ses valeurs. En définitive, selon son propre esprit.
10:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, chine, états-unis, sun tzu, clausewitz, wei ki, jeu de go |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 septembre 2023
Le go et le mahjong de la géopolitique

Le go et le mahjong de la géopolitique
Leonid Savin
Source: https://www.geopolitika.ru/article/go-i-madzhong-geopolitiki
L'utilisation de la terminologie des échecs en géopolitique est devenue une évidence. Le livre de Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard : America's Primacy and its Geostrategic Imperatives (Le grand échiquier : la primauté de l'Amérique et ses impératifs géostratégiques), y a partiellement contribué. L'appel aux échecs en tant que jeu intellectuel connu du monde entier a été interprété dans l'ouvrage de Brzezinski sous l'angle de l'hégémonie américaine et de la nécessité de la préserver. Mais il faut se poser la question suivante : est-il suffisant de parler d'échecs lorsque nous parlons d'un monde complexe et global, aux relations multiples et variées, avec les intérêts et les contradictions d'un grand nombre de parties ? Dans le monde bipolaire, qui a pris fin avec l'effondrement de l'URSS, il était encore possible de parler d'un duel entre Blancs et Noirs, mais depuis 1991, nous vivons un moment unipolaire.
Une réponse probable à la question de savoir pourquoi Brzezinski a choisi une telle allégorie se trouve dans les mémoires d'Alexandre Douguine sur sa rencontre avec Brzezinski à Washington. Lorsqu'on lui a demandé s'il se rendait compte que les échecs sont toujours un jeu à deux acteurs (Sea Power et Land Power en tant qu'agents principaux de la géopolitique), Brzezinski a répondu qu'il n'y avait pas pensé. Probablement parce qu'il voyait la bataille sur l'échiquier comme la bataille finale où l'atlantisme lève tous les obstacles à sa domination sur le monde. Une domination qui passe par le contrôle du cœur de l'Eurasie, c'est-à-dire par la victoire finale sur la Russie.
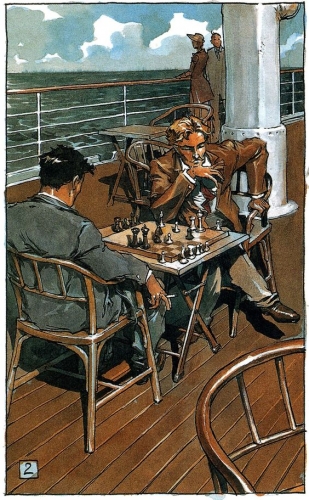
Il s'agit d'une bataille, et non d'une guerre, car une partie d'échecs n'est que le reflet d'une bataille.
Oui, une réflexion stratégique est nécessaire. Mais il s'agit toujours d'une bataille entre deux camps. Ce qui n'est pas le cas du prototype du jeu d'échecs, le chaturanga, où le terrain comporte des pièces pour quatre joueurs et où les pièces elles-mêmes symbolisent les quatre branches de l'armée sous le contrôle d'un commandant.
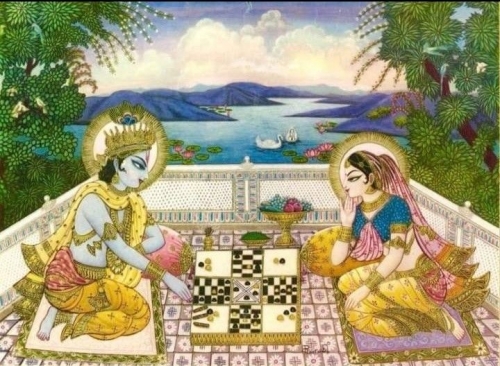

La transformation en un jeu pour deux symbolise également le dualisme caractéristique de la culture et de la métaphysique occidentales. Il est intéressant à cet égard de rapprocher la transformation du jeu d'échecs du concept de politique de Carl Schmitt, qui divise en amis et en ennemis (il n'est d'ailleurs pas question de forces neutres), et qui s'inscrit également de manière organique dans la tradition politique occidentale, dont les racines (à savoir l'opposition marquée du bien et du mal) se trouvent toutefois en Orient, dans le zoroastrisme.
Cependant, si le Chaturanga a changé ses fonctions et ses règles, il existe en Orient d'autres jeux stratégiques qui ont conservé leur forme originelle. Ils n'en sont pas moins intellectuels. Il s'agit du go et du mahjong. Bien que le go se joue à deux, il est de nature plus géopolitique. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une bataille unique, mais d'une guerre, avec de multiples combinaisons de batailles qui se déroulent sur le terrain. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une chasse à la tête d'un roi (leader politique, gouvernement ou commandant en chef) entouré de ses gardes du corps aux capacités différentes, mais plutôt de la conquête d'un territoire. Le go est plus complexe dans ses règles et reflète davantage la réalité politique du monde moderne - vous devez penser à une variété de combinaisons dans une variété d'endroits.


Il est probable que le succès des actions de politique étrangère de la Chine réside en partie dans la pratique du jeu de Go, qui crée un état d'esprit multicouche et non linéaire pouvant être appliqué aux relations internationales.
Le jeu de mahjong est tout aussi intéressant : il requiert des qualités telles que l'expérience, la mémoire et l'observation, qui sont également nécessaires dans les arts politiques. Mais il y a aussi un facteur aléatoire (on peut l'appeler la main invisible de Jupiter, pour reprendre la formule d'Adam Smith) qui, selon les règles (il existe différentes variantes du jeu), peut être insignifiant ou décisif. Parmi les quatre joueurs, celui qui réunit la combinaison de dés la plus précieuse l'emporte. Cela rappelle à nouveau la politique étrangère de la Chine : s'emparer habilement du marché des métaux rares, dépasser l'Occident dans de nombreux domaines, de l'économie à la technologie, obtenir des ressources énergétiques de la Russie à des prix abordables, s'engager avec d'autres pays dans le cadre d'une stratégie gagnant-gagnant, et l'initiative "la Ceinture et la Route" elle-même - tout cela montre que la Chine est un excellent joueur de mahjong sur la carte du monde et qu'elle rassemble les meilleurs dés pour elle-même.
La Russie doit également apprendre à agir efficacement sur plusieurs fronts et dans plusieurs dimensions simultanément. La nature eurasienne de la Russie appelle à une complexité croissante des vecteurs géopolitiques. L'OTN est une bonne épreuve de force à plusieurs égards, mais pour construire un pôle véritablement souverain dans un monde multipolaire, il est nécessaire non pas de reporter un certain nombre de décisions à des "temps meilleurs", en les justifiant par le fait que ce n'est pas le bon moment, mais dès à présent de procéder à une réorganisation profonde. Et, avant tout, il est obligatoire d'intégrer les décisions pertinentes dans la stratégie de politique étrangère et de créer des mécanismes pour leur mise en œuvre.
20:32 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeu de go, go, mahjong, échecs, jeu d'échecs, géopolitique, leonid savin |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 29 août 2021
Échecs et Jeu de Go : les deux philosophies opposées des États-Unis et de la Chine

Échecs et Jeu de Go : les deux philosophies opposées des États-Unis et de la Chine
Federico Giuliani
Ex: https://it.insideover.com/politica/scacchi-e-go-le-due-filosofie-opposte-di-usa-e-cina.html
En observant ce qui se passe en Afghanistan, et en retraçant ce qui s'est passé sous ces latitudes ces dernières années, il est possible de comparer deux approches différentes utilisées par les puissances mondiales pour faire des incursions à Kaboul et dans ses environs.
La première approche, adoptée par les Etats-Unis et, plus généralement, par les puissances occidentales, vise essentiellement à atteindre les objectifs fixés. À tout prix, sans compromis et sans prendre de raccourcis. L'autre, beaucoup plus pragmatique et attentiste, suit le comportement de la Chine, ce qui renvoie à l'esprit asiatique dans la résolution des affaires de la vie. Dans ce cas, au lieu de mener une action verticale, il est préférable d'encercler la cible sans la frapper, en attendant sa capitulation qui, tôt ou tard, devra venir.

Soyons clairs: ces deux façons de traiter l'adversaire géopolitique ne sont pas construites à la planche à dessin et ne peuvent pas être définies comme de véritables stratégies. Beaucoup plus simplement, nous nous trouvons devant deux modes opératoires qui peuvent être placés aux antipodes et dictés par des contextes culturels différents. De ce point de vue, l'Ouest et l'Est peuvent être considérés comme deux extrêmes diamétralement opposés, tandis que les États-Unis et la Chine incarnent les "idéaux types" parfaits des approches mentionnées.
L'approche américaine (et occidentale) : la partie d'échecs
Nous pouvons faire une comparaison pour mieux comprendre la différence entre ces deux approches. L'attitude géopolitique utilisée par les Américains en Afghanistan suit les principes appliqués dans le jeu d'échecs ; au contraire, l'approche chinoise propose les règles du go (ou weiqi), un jeu de société similaire mais en même temps différent des échecs.
Dans le détail, deux philosophies opposées sous-tendent ces modus operandi. En comparant les stratégies des échecs et du go, il est possible de déduire une "philosophie de l'attaque" que l'on retrouve également dans les actions de politique étrangère de Washington et de Pékin. Alors qu'aux échecs l'objectif est d'abattre le roi par une attaque directe, auquel cas tous les autres pions sont éliminés, au go il existe un plan d'encerclement visant à neutraliser l'ennemi grâce à la force qui l'entoure et l'empêche de se déplacer.
En d'autres termes, aux échecs, le but est de dominer le centre du terrain afin d'obtenir un échec et mat. Les deux adversaires contrôlent une "armée" de 16 pions, chacun d'importance variable, dont un roi chacun. Dès qu'un des deux rois est "mangé", la partie est terminée avec la victoire de celui qui a réussi à manger le roi de son adversaire. Le concours se termine par l'anéantissement de l'adversaire. L'un des deux challengers devient ainsi le maître du territoire après avoir détruit l'autre. Et c'est précisément l'approche utilisée par les États-Unis en Afghanistan (et ailleurs).
L'approche chinoise : le jeu de go
Le discours du weiqi est différent, comme l'a souligné le site web China Files. Le go répond à une philosophie bien éloignée de celle qui guide les échecs. Dans ce cas, les deux joueurs doivent placer des pions d'importance égale sur une grille de 19×19 lignes. Calculatrice en main, il y a 361 intersections sur un plateau de Go, ce qui est beaucoup plus qu'aux échecs. Il y a deux camps, les Blancs et les Noirs. Mais personne n'est obligé de manger quelqu'un d'autre. Au début de chaque tour, chaque challenger place sa pierre dans l'une des intersections libres. L'objectif ici est de placer les pièces de manière à encercler celles du challenger.
Le but du go n'est donc pas d'anéantir l'adversaire, mais de contrôler une plus grande surface de la table que l'ennemi. De ce point de vue, la stratégie de la politique étrangère chinoise semble suivre la voie d'un joueur de Go. En Afghanistan, Pékin a essentiellement encerclé Kaboul par le biais d'accords commerciaux, de réunions et de dialogues de toutes sortes, afin d'amener le pays sous son influence géopolitique sans y faire la guerre. Il reste à voir laquelle des deux stratégies, surtout à long terme, portera le plus de fruits.
09:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jeu de go, actualité, chine, états-unis, occident, weiqi, stratégie, géostratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



