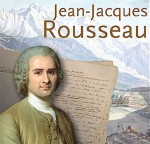Entendemos o Nacionalismo, não como uma prática política mais, mas como uma forma de estar na vida, um estado de vivência…
Neste contexto, consideramos ser fundamental a clarificação de certos conceitos divulgados por teorias e doutrinas que, pelo mimetismo imposto pela moda e, menos eufemisticamente, pela ignorância, assumem significados que não o são.
O Nacionalismo é, em si mesmo, um conceito com nome próprio que não suporta adjectivações !
Referir um nacionalismo adjectivado (e.g. "nacionalismo revolucionário" ou "nacionalismo liberal") é pretender reduzir um conceito abrangente, incluente de toda uma "nação", a uma mera teorização política a que (quantas vezes…) nem falta a abstrusa designação de esquerda ou direita.
"A fortiori", o termo "nacionalismo" poderá ser identificado pelo nome da Nação a que se refere (e.g. "nacionalismo galego").
Por muito que estremeça o ideário histórico incutido nas populações europeias desde a normalização carolingia, na Europa de hoje um "país" não corresponde necessariamente a uma "nação", pelo contrário, a maioria dos países europeus constituiram-se por amálgama de territórios conquistados, subordinados a um Estado centralizador que se impôs, unificando nações diferenciadas.
1. Filosofia e Conhecimento
Talvez os antigos gregos tivessem razão quando afirmavam que existia uma erudição própria escondida em cada palavra.
Se prestarmos atenção ao vocábulo "filósofo" ("philosophos" em grego), um termo que surge, segundo Ponticus Heraclides (séc. IVº EP), quando Pitágoras recusa a denominação de "sophos" ("sábio") que lhe é atribuida pelo rei de Phlionte (cidade do Peloponeso) e retorquiu afirmando que mais não se considera além de "philo sophos" ("amigo da sabedoria").
Do adjectivo "filósofo", forma-se o substantivo "filosofia" ("philo + sophia"), "amizade pela sabedoria", que reflecte um encaminhamento em direcção à "sabedoria" e se opõe à noção de "possuidor de sabedoria" ("sophos").
A erudição do termo é bem patente no seu significado de "busca" da sabedoria, e de "recusa" (por impossibilidade) de a possuir !
Mas, invariavelmente, o valor erudito das palavras é fagocitado pelo utilitarismo com que se pretende aplica-las, e os vocábulos "filosofia" e "filósofo" sofreram o "habitual" tratamento de aculturação predominante.
No presente, particulariza-se como "filosofia de …" qualquer actuação teorizante nos mais diversos campos específicos, da gramática à política como da arte à lógica. Amarfanha-se, amalgama-se, oprime-se o sentido de "filosofia" com o significado de disciplinas outrora pertencentes ao "corpus philosophicus", mas que se disjuntaram constituindo áreas de estudo especifico.
Com efeito, o "pensamento" grego via na filosofia a "sabedoria", a totalidade do saber da época e um conhecimento aspirando ao universal !
Posteriormente, o "saber" foi-se compartimentando em "saberes" (ciências) enquanto o conhecimento se afirmava como compreensão dos limites e das condições da existência.
Compete pois ao ciêntifico o "saber" que permite o controlo da Natureza, e ao filósofo o "conhecimento" de uma vida acorde com a Natureza !
Se nos restringirmos ao espaço político, referir "filosofia do fascismo", "filosofia do marxismo", "filosofia do liberalismo", etc, não é culturalmente aceitável, pois que fascismo, marxismo, liberalismo, etc, são teorizações de um mesmo conceito filosófico que é a "Política", um conceito que provém de "Politeia" (da raiz grega "pólis", cidade ; em latim "civitas").
A origem do erro reside na assimilação habitual de "política" à "gestão da pólis", confundindo-se o conceito filosófico de "política" com as teorizações que propõem "gestões políticas" diversas.
Para bem compreendermos os âmbitos de acção do "conceptual filosófico" e da "teorização política", devemos ter presente as três realidades sobrepostas que a noção de "polis" engloba :
- um factor social, entendido como uma comunidade autónoma, habitualmente constituida por sinoecismo (1), fortemente estruturada, étnica e culturalmente coesa.
- um espaço, que conecta o "habitat" a um território e ao seu ecosistema.
- um Estado, dotado de poderes de regulação sobre o "espaço" e o "factor social".
Assim que, se o "factor social" e o "espaço" determinam a "Nação" (conceito filosófico), as regras de Estado são do âmbito da teorização política, embora com uma excepção qualitativa relacionada com o substracto cultural das comunidades que constituem o "factor social" da "Nação".
E esse substracto cultural constitui o que os gregos denominavam "agraphoi nomoi", comummente entendido como "leis não escritas" (costumes e tradições).
O que valoriza, na tradição ética grega, os "agraphoi nomoi", não é somente o facto de evitarem a imperfeição técnica das leis escritas ("nomoi"), mas a sua relatividade cultural (2).
Na Esparta e na Atenas clássicas, muito diferentes na teorização política, o mais importante era o conceito filosófico de comunidade de homens livres (noção espartana de "homoioi") que o grego orgulhosamente proclamava.
"Cada um, então, de acordo com sua vontade, pode fulgir... ou calar-se. Pode imaginar-se mais bela igualdade ?"
(palavras deTeseu ao arauto in "Suplicantes" de Eurípides - vv. 426-441)
Se Atenas adopta uma "politeia" teorizada na participação activa dos membros da comunidade ("politai") nos trabalhos do "Boule" (Conselho), do "Helieia" (Tribunal) e da "Ekklesía" (Assembleia), para Esparta a organização da vivência em comunidade dependia substancialmente dos costumes e do definido por alguns poucos princípios reguladores, os famosos ordenamentos ("rethra"), atribuídos a Licurgo (séc. IX ou VIII EP).
Lucius Furius Philus, no diálogo "De Res Publica", escrito por Cicero, defende (Livro III - VIII a XI) a tese de que justiça é coisa social, e não natural, que como tal varia conforme o povo e varia num mesmo povo através do tempo. É o interesse que comanda os homens.
"Existe uma lei verdadeira, é a recta razão, conforme com a natureza espalhada em todos os seres, sempre de acordo consigo própria, não sujeita a perecer, que nos chama imperiosamente a preencher a nossa função, nos interdiz a fraude e dela nos afasta. Jamais o homem honesto é surdo às suas ordens e proibições; estas não têm acção sobre o perverso.
Nesta lei, nenhuma emenda é permitida, não é lícito revogá-la totalmente ou em parte. Nem o Senado, nem o povo podem dispensar-nos de a ela obedecer (…). Esta lei não é uma em Atenas, outra em Roma, uma hoje, outra amanhã, é uma única e mesma lei que rege todas as nações em todos os tempos (…) quem não obedece a esta lei ignora-se a si mesmo, e, porque ignorou a natureza humana, sofrerá por isso mesmo o maior castigo …"
(Marcus Tullius Cicero (106-43 EP) in "De Res Publica", Livro III, XXII).
No plano doutrinário a filosofia posiciona-se entre o escrito e o não escrito, entre a lei e o costume, consciente de que, pela biologia intrínseca do cérebro humano, uma "hierarquia de domínio" vai estabelecer-se entre os individuos que constituem o "factor social" que constitui a "polis", e que compete à teorização política fundamentar a organização dessa "hierarquia de domínio" no interior da comunidade, da sociedade, ou da Nação, pois esta tenderá a controlar a repartição da totalidade dos recursos (bens e serviços).
Os factores culturais envolventes deverão constituir a linha de conduta que a acção filosófica tem por obrigação impor à teorização política.
2. Teorização Política
Como demonstrou o fundador da antropología política, Pierre Clastres (1934-1977), em "La société contre l'État" (1974), a ligação entre "Política" e "Estado" não é tão evidente como habitualmente se crê, pois existem formas de organização que evitam a aglomeração do "poder" no Estado, competindo à "teoria política" desenvolver a formatação do Estado, com base numa fundamentação cultural estruturada pelos conceitos filosóficos assentes nos valores primevos dos individuos que constituem a Nação.
Parece-nos provada a necessidade de constituir um "corpus philosophicus" fundacional da "teorização política", antes de "desenhar soluções de pormenor" ou, pior ainda, copiar dos alfarrábios soluções "read-made" !
Provindo o termo do grego "theorein", "teoria" significa "contemplar, observar, examinar", e "teoria política" é, como qualquer outra teoria, um quadro de trabalho para compreensão de uma proposta.
Em linguagem corrente, uma teoria é um conjunto de conceitos, fundamentados em teorias precursoras ou em casos reais, conducentes a um resultado especulativo, a uma representação ideal.
Desde a lógica das matemática, diz-nos o primeiro teorema de Kurt Gödel (1931), que (numa teoria) existem enunciados que não são demonstráveis e cuja negação tão pouco é demonstrável !
Se assim é numa ciência exacta como as matemática… na política arriscamos navegar na mais pura virtualidade !
E para que essa virtualidade não se transforme em enunciado dogmático, devemos ter recurso à "fundamentação cultural estruturada pelos conceitos filosóficos".
Se nos fixarmos nas propostas políticas ditas nacionalistas encontraremos a nivel da teorização política "um pouco de quase tudo" !
Desde o fascismo, ao nacional-socialismo, ao nacional-bolchevismo, ao salazarismo (católico-corporativista), ao franquismo (falangista), ao europeismo (nas mais diversas tonalidades), ao monarquismo lusitanista (integralismo), e um longo etc, todos se dizem nacionalistas e afirmam o seu desejo de uma solução política "nacionalista" !
Como Blaise Pascal, façamos um pouco de "ucronia" (3).
Se toda a vontade nacionalista antes referida, chegasse a uma vitória política e, consequentemente ao "controlo do Estado", quantas horas tardariam a lançar-se (mutuamente) à cabeça, as cadeiras do "poder" ?
Como poderia um nacionalismo monárquico aceitar uma solução republicana ? E o nacional-bolchevismo colaborar com os fascistas ?
Perante o que nos demonstra a realidade, as variáveis são tantas (incluindo os "infiltrados" e os "inocentes"), tantas as teorizações políticas, que o "poder teo-democrático" em funções pode "ressonar sem sobresaltos" !
Parece-me óbvio que sem uma "fundamentação cultural" consequente as divagações prosseguirão, cada hipótese continuará a afirmar-se como sendo a mais acertada e, todas (ou quase) continuarão a considerar o "nacionalismo" como uma teoria política mais.
Não, não sou pessimista, mas tão pouco sou optimista ! Esses sentimentos não se coadunam com a análise responsável de um projecto politico.
Temos necessidade de nos elevarmos por em cima da fragmentação teórica do saber político que envolve o nacionalismo.
A filosofia não teoriza a política, mas fundamenta os conceitos necessários à sua expressão, e creio ser já tempo de enquadrar a teoria política nacionalista com o conceito adequado !
Uma das primeiras cacafonias teorizadoras com que deparamos nas páginas "web" e nos "fórum", assumidamente nacionalistas, assim como numa variada literatura existente, é a confusão entre o significado atribuido a certos vocábulos e a sua real significação. Dois dos mais sintomáticos exemplos são, "nação - pátria" e "povo - população".
Confundindo "povo" com "população", dilui-se a noção de etnicidade, uma estrutura fundacional do nacionalismo… Amalgamando "nação" com "pátria", abandonamos decididamente o campo nacionalista pelo patriótico, a visão de futuro pela simbologia do passado !
Nada mais que esclarecer os exemplos apontados e teriamos uma importante redução nos candidatos a nacionalistas.
Outro aspecto, nem o último nem o menos importante, é o enfeudamento a soluções "prontas-a-utilizar", o recurso a teorias aplicadas em periodos históricos recentes e que ainda brilham no imaginário politico de muitos.
Não nego o interesse em conhecer essas experiências, que podem, na devida perspectiva histórica, enriquecer conceitos ou complementar teorizações, mas saibamos distinguir o antigo do velho, o texto lúcido e pertinente da retórica fora de circunstância.
3. Europa e Nacionalismo
Existem posicionamentos que advogam por "pensar Europa já e agora", e outros mais críticos relativamente à oportunidade de optar desde já pela Europa. De entre os primeiros, distinguimos os que creem que uma Nação é algo de perene e que á dado adquirido como parte constituinte da Europa, e outros, bem intencionados, mas que se comportam como borboletas nocturnas encandeadas pelo "farol europeista" !
Desde uma perspectiva analítica também é por demais evidente a actividade de alguns émulos de Fausto que, com propósitos inconfessáveis, exaltam uma Europa alquímica, saida de alguma retorta do Grande Arquitecto, com o evidente objectivo de transmutar a Nação em poltronas de eurodeputado.
Quando Drieu de la Rochelle defendia uma solução europeia, essa solução passava por uma França (culturalmente dominante) aliada a uma pujante Alemanha nacional-socialista, referindo uma Europa conceptualmente fundamentada em valores étnicos e culturais que hoje somente encontramos nas hemerotecas.
Sejamos conscientes de que o denominador comum que têm, na actualidade, os povos de regiões como a Wallonie belga, o Vaud suiço ou o Vale do Ave português, é a sua acelerada perda de identidade ! A rotura drástica e dramática com os laços culturais que os uniam ao seu território. Na Europa de hoje, como na Europa que alguns (consciente ou inconscientemente) pretendem, as Nações desvanecem-se !
Que Europa se pretende ? Uma Europa sem Nações ?
Uma "pátria europeia" habitada por uma população multi-étnica e culturalmente "miscigenada" ?
A Europa financeira dos bancos e das empresas, dos negócios, da usura e dos lucros ?
Não será isso embrulhar o nacionalismo em reluzente papel e oferta-lo a quem pagar mais subsídios ?
Como já o escrevi repetidamente, e em nada altero o afirmado, estou intimamente convencido de que devemos lutar por uma Europa forte, mas, e sem lugar a dúvidas ou tergiversação, étnica e culturalmente coesa.
Que a árvore não nos esconda a floresta ! Se primeiramente não nos constituirmos em Nações autónomas de qualquer poder central e centralizador, em Nações representativas de uma realidade cultural, falar em nacionalismo é uma falácia !
Europa não é, nunca foi uma Nação, mas um conjunto de Nações étnicamente próximas (antes da invasão migratória) e culturalmente compreensíveis.
Pretender, como Lenine, uma Europa de Repúblicas Socialistas, ou uma espécie de Império "envergonhado de o ser", como propõe Jean Thiriart, ou um negócio financeiro montado numa manipulação cultural, estilo União Europeia, ou uma Europa do arquipélago das Curilhas ao dos Açores, e de Instambul a Rabat, não é, seguramente, respeitar as tradições, as "agraphoi nomoi" que são o bastião da nossa cultura !
Provavelmente, os que defendem essas "soluções", pensem (por manifesta ignorância e manipulação) que Carlos Magno foi um grande protector da cultura europeia, tal como tinha sido o Império de Roma ou a evangelização cristã...
E aí não nos encontram ! Porque é um engano, uma burla política, uma falácia…
O projecto da "Nova Ordem Mundial" é criar grandes blocos económicos sem conteúdo cultural !
Nesse sentido se vão formatando a União Europeia, a Mercosul, a Asean e a União Africana.
Posteriormente, será fácil tudo amalgamar num mercado global, num Estado global… dirigido por um governo Mundial !
A afirmação nacionalista é um conceito identitário, não é uma teorização política, nem se engloba no ardil das direitas ou das esquerdas.
E a nossa afirmação nacionalista, com respeito por todas as outras que se manifestem no território europeu, relaciona-se com a defesa da "nossa Cultura", do "nosso Povo" e, consequentemente da "nossa Nação" !
A partir desta base, poderemos participar na compreensão de uma Europa Identitária ! Não num "mercado comum" !
4. Fundamento Conceptual do Nacionalismo
Insistimos em que o trabalho inicial dos nacionalistas é determinar o fundamento conceptual do nacionalismo que provém de nós mesmo, como povo.
Várias áreas devem ser estudadas para que, a partir de conceitos claros e esclarecidos, se possa desenvolver uma "teorização política", uma proposta de organização que nos enquadre como fenómeno nacionalista e nos permita transparecer como Nação.
A História deve ser interpretada como instrumento de aprendizagem que os nossos ancestros nos deixaram, não como um acumular de lendas, de glosas míticas, de milagres fundacionais ou de acasos proféticos.
Uma Nação não nasce por decreto nem por bula papal ! Uma Nação é "um todo coeso", um laço cultural expresso por um povo num contexto territorial.
Que referência cultural se pode deduzir quando se divaga entre as mais variadas concepções de ética, de estética e de religiosidade ?
A que Nação se reporta quem devaneia entre conceitos de "território como parte da Nação" e "território como constituinte de um país" ?
Como seria interessante que, quem se pretende nacionalista, tivesse a consciência de que denominar uma "população" como "povo" não passa de uma afirmação manipulada (ou manipuladora), mas que não altera uma virgula à realidade, à distinção étnica e etológica existente sobre o terreno !
Que pretendemos ?
Fundamentar o conceito "nacionalista" e tentar viver nele e com ele, numa simbiose conseguida, ou continuar a discutir virtualidades, como se estivessemos a dialogar com o coelho de Alice no outro lado do espelho ?
Nacionalismo é a defesa de uma identidade nacional, é um conceito étnico-cultural que pretendemos se expresse através de uma "teoria política" que devemos formular, adequando a sua formatação à realidade que somos e ao futuro que pretendemos.
É a partir da Nação que deveremos pensar a Europa. Não o contrário !
Tenhamos sempre presente as palavras que proferiu, na defesa do "seu" globalismo, o barão Edmond Rothschild à revista "Entreprise", em 18 de Julho de 1970, sobre a constituição do Mercado Comum Europeu, fase que precedeu a actual União Europeia :
"… (como condição) a estrutura que deve desaparecer, o ferrolho que deve saltar, é a nação" ! (4)
Cremos firmemente que, para um futuro consequente, o trabalho dos nacionalistas (em cada Nação) deveria percorrer três etapas fundacionais (eventualmente subdivididas) :
1. Significação Conceptual
- conceitos filosóficos
2. Teorização Política
- estrutura do Estado
3. Organização e Actuação
- prospectiva
Com um razoável consenso nestas premissas, as nações europeias poderão "formatar" uma Europa Identitária !
Senão, o nacionalismo continuará a ser, para uns, um exercício intelectual, para outros, um passatempo e, para alguns… uma actividade (consciente ou não) para que "o ferrolho" se desvaneça de vez !
Despertemos a cultura imanente em cada Nação, interliguemos os conceitos e avancemos no caminho da Europa Identitária…
Como diz o poeta : "… o caminho faz-se andando !".
(1) Na Antiguidade, o sinoecismo (do grego "sunoikismós", dérivado de "sún", com, e "oikos", casa, ou seja "conjunto de casas") é o acto fundador de uma cidade. Uma reunião de várias aldeias formavam uma vila… uma cidade…
(2) A primeira lembrança que nos vem à memória refere-se ao famoso passo da tragédia de Sófocles, Antígona (450-59), onde desafiando as determinações de Creonte, rei de Tebas, Antígona presta honras fúnebres a Polinices, seu irmão, morto em combate com o seu também irmão, Eteocles.
A jovem princesa justifica seu acto alegando obediência às normas divinas, eternas e intocáveis, superiores, como valor imperativo, à proclamação do rei.
(3) "Ucronia" - História alternativa de um evento particular modificado, imaginado, através do qual o autor estabelece conclusões hipotéticas.
"Se o nariz de Cleópatra tivesse sido mais pequeno, a face da terra teria mudado" (Blaise Pascal in "Pensées", 90).
(4) Sejamos conscientes do enfrentamento entre o nacionalismo, que é garante da identidade de cada povo, e a miscigenação mundialista expressa pelo sistema, aparentemente contraditório, liberal-marxista, cujo objectivo é o total desenraizamento cultural dos povos e a criação de um governo mundial.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg












 Dans l’introduction à l’une des versions italiennes du premier livre de Guillaume Faye, “Le système à tuer les peuples”, j’avais tenté de brosser succinctement son itinéraire politique, depuis ses années d’étudiant à l’IEP et à la Sorbonne. J’avais rappelé l’influence d’un Julien Freund, des thèses de Pareto, de Bertrand de Jouvenel sur ce jeune étudiant dont la vocation allait être de mener un combat métapolitique, via le “Cercle Spengler” d’abord, via le GRECE (Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne) ensuite. J’avais insisté aussi sur son interprétation de Nietzsche, où, comme Alexis Philonenko, il pariait sur un rire sonore et somme toute rabelaisien, un rire déconstructeur et reconstructeur tout à la fois, sur la moquerie qui dissout les certitudes des médiocres et des conformistes. Je ne vais pas répéter aujourd’hui tout cet exposé, qu’on peut lire sur internet, mais je me concentrerai surtout sur une notion omniprésente dans les travaux de Faye, la notion cardinale de “politique”, oui, sur cette “notion du politique”, si chère au Professeur Julien Freund. L’espace du politique, et non pas de la politique (politicienne), est l’espace des enjeux réels, ceux qui décident de la vie ou de la survie d’une entité politique. Cette vie et cette survie postulent en permanence une bonne gestion, un bon “nomos de l’oikos” —pour reprendre la terminologie grecque de Carl Schmitt— une pensée permanente du long terme et non pas une focalisation sur le seul court terme, l’immédiat sans profondeur temporelle et le présentisme répétitif dépourvu de toute prospective.
Dans l’introduction à l’une des versions italiennes du premier livre de Guillaume Faye, “Le système à tuer les peuples”, j’avais tenté de brosser succinctement son itinéraire politique, depuis ses années d’étudiant à l’IEP et à la Sorbonne. J’avais rappelé l’influence d’un Julien Freund, des thèses de Pareto, de Bertrand de Jouvenel sur ce jeune étudiant dont la vocation allait être de mener un combat métapolitique, via le “Cercle Spengler” d’abord, via le GRECE (Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne) ensuite. J’avais insisté aussi sur son interprétation de Nietzsche, où, comme Alexis Philonenko, il pariait sur un rire sonore et somme toute rabelaisien, un rire déconstructeur et reconstructeur tout à la fois, sur la moquerie qui dissout les certitudes des médiocres et des conformistes. Je ne vais pas répéter aujourd’hui tout cet exposé, qu’on peut lire sur internet, mais je me concentrerai surtout sur une notion omniprésente dans les travaux de Faye, la notion cardinale de “politique”, oui, sur cette “notion du politique”, si chère au Professeur Julien Freund. L’espace du politique, et non pas de la politique (politicienne), est l’espace des enjeux réels, ceux qui décident de la vie ou de la survie d’une entité politique. Cette vie et cette survie postulent en permanence une bonne gestion, un bon “nomos de l’oikos” —pour reprendre la terminologie grecque de Carl Schmitt— une pensée permanente du long terme et non pas une focalisation sur le seul court terme, l’immédiat sans profondeur temporelle et le présentisme répétitif dépourvu de toute prospective.



 Réduction à 89% de la taille originale [ 572 x 600 ]
Réduction à 89% de la taille originale [ 572 x 600 ]