lundi, 08 septembre 2025
Ordre, autorité, communauté

Ordre, autorité, communauté
Le conservateur authentique, c'est-à-dire continental, se distancie du pseudo-conservatisme anglo-américain. Il s'oppose beaucoup plus fermement au libéralisme, dont le mot d'ordre est devenu : liberté, égalité, fraternité.
Jiří Hejlek
Source: https://deliandiver.org/rad-autorita-pospolitost/
Nous nous trouvons dans une situation qui exige un nouvel ancrage intellectuel de l'action politique. Il est aujourd'hui courant d'utiliser le terme « conservatisme » dans ce contexte. Nous nous opposons ainsi au libéralisme dominant, que nous rejetons instinctivement, mais dont nous reprenons généralement les schémas intellectuels et le langage, restant ainsi sous son influence.
L'éminent philosophe politique russe Alexandre Douguine est bien conscient des écueils auxquels se heurte le conservatisme et préfère donc qualifier sa position de « quatrième théorie politique », qui s'inscrit dans la continuité du traditionalisme conservateur.
La première théorie, actuellement victorieuse mais en déclin, est le libéralisme, envers lequel il faut se démarquer.
La deuxième est le socialisme et le communisme, qui sont morts d'épuisement à un âge avancé, tandis que la troisième théorie, c'est-à-dire le fascisme au sens large, est morte jeune de ses propres maladies. Il n'est plus possible de s'appuyer sur l'une ou l'autre des deux dernières théories, même si l'on peut y trouver des éléments positifs. Cherchons donc une quatrième théorie. Voilà expliciter sommairement la position de Douguine. Il convient encore de noter qu'il s'appuie sur les conservateurs les moins respectables, tels qu'Alain de Beonist aujourd'hui et Arthur Moeller van den Bruck, Oswald Spengler ou Carl Schmitt dans le passé.
Nous conserverons le terme « conservatisme », car il est plus courant en Europe centrale qu'en Russie. Il est souvent opposé au libéralisme, mais généralement sans clarification de ses fondements idéologiques. Nous laisserons de côté les expressions confuses telles que « politique libérale-conservatrice » et montrerons au contraire la forte opposition entre ces deux positions politiques et idéologiques.

Cette opposition est complètement occultée par l'interprétation anglo-saxonne des termes correspondants et des concepts qui leur correspondent. Partons de la théorie civilisationnelle selon laquelle la civilisation actuelle dans la majeure partie de l'Europe est une civilisation atlantique, dont les foyers sont les pays anglophones. Elle a pour ambition de conquérir progressivement le monde entier et, depuis ses débuts à la fin du 17ème siècle, elle utilise non seulement la violence, mais aussi une propagande sophistiquée.
C'est une civilisation bâties sur des illusions auxquelles elle succombe elle-même, et c'est pourquoi l'hypocrisie est sa caractéristique typique. L'ensemble de ces illusions forme son idéologie libérale éclairée, qui se présente hypocritement comme une simple description de ce qui est « naturel » et donc universellement valable.
L'illusion centrale, autour de laquelle tout le reste gravite, est celle de la liberté. Le libéralisme a fabriqué de toutes pièces un individu libre qui, d'un côté, est l'égal de tous les autres et, de l'autre, n'est qu'un simple exemplaire de « l'homme en général ». L'idole ainsi créée est devenue une divinité dans le culte de l'humanisme et des droits de l'homme.

La Révolution française, qui a suivi la Révolution anglaise de cent ans et la Révolution américaine de plus de dix ans, a formulé le célèbre slogan du libéralisme : liberté, égalité, fraternité. Ses racines sont toutefois anglo-saxonnes. Lorsque le conservatisme a commencé à se former à la fin du 18ème siècle en opposition au libéralisme, une différence déjà nette est apparue en Europe entre les positions des fondateurs du conservatisme britannique et continental.
Le conservatisme britannique, puis américain, ne sont en fait que des ramifications du libéralisme. Ils en maintiennent les principes fondamentaux: la liberté individuelle, la protection de la propriété, la méfiance envers l'État et les autres autorités, et surtout le libre marché. Après tout, deux célèbres conservateurs britanniques sont issus des rangs des libéraux: Edmund Burke et Winston Churchill.

Le leader conservateur victorien Disraeli (photo) était un défenseur du libre-échange. Nous ne devons pas non plus nous faire d'illusions sur nos héros conservateurs anglo-saxons des années 80, Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Sans parler de Donald Trump. Leurs positions morales étaient certes louables, mais en matière économique et sociale, ils étaient des libéraux purs et durs.
Chez les Britanniques, il ne faut pas se laisser tromper par leur attachement apparent au caractère aristocratique du conservatisme. Immédiatement après la révolution anglaise de 1688, dont Burke est si fier, les aristocrates sont devenus des entrepreneurs capitalistes, alors qu'en France, et a fortiori en Allemagne, ils sont longtemps restés séparés de la bourgeoisie. De même, la figure du roi britannique est trompeuse. L'influence de la couronne a décliné jusqu'à ce qu'avec l'avènement de la dynastie hanovrienne, qui détient encore aujourd'hui la couronne, la Grande-Bretagne devienne essentiellement une république oligarchique dirigée par les financiers de la City de Londres, qui ont renversé le roi légitime en 1688 et placé sur le trône leurs marionnettes Marie et Guillaume d'Orange.
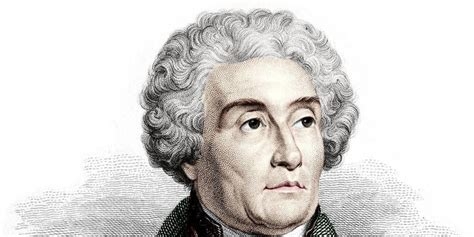
En France, le conservatisme est né de l'opposition à la révolution. Tout le monde connaît aujourd'hui le nom du pseudo-conservateur Burke, mais qui connaît Joseph de Maistre (illustration) ou Louis-Gabriel de Bonald, véritables pères fondateurs du conservatisme ? L'art anglo-saxon de la propagande a réussi à effacer presque totalement ces grands hommes de la mémoire historique. Il en a été de même pour un autre noble et diplomate, l'Espagnol Juan Donoso Cortés. Ce n'est pas un hasard si tous étaient catholiques, tout comme les fondateurs du conservatisme romantique allemand, Adam Müller, Friedrich Schlegel et Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. On peut également citer des poètes et des écrivains. Outre Schlegel, déjà mentionné, il y a son ami Novalis, le Français François René de Chateaubriand et, plus tard, l'admirable Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski. Son œuvre complète a été traduite en allemand par Moeller van den Bruck, chef de file du conservatisme allemand du premier quart du 20ème siècle.
Après avoir clarifié la question de l'origine du conservatisme dans sa forme continentale authentique, accompagnée d'un bref aperçu historique, nous nous pencherons sur les principes fondamentaux du conservatisme authentique. Revenons donc à la liberté libérale. Celle-ci montre clairement son vrai sens sous la forme de la liberté du commerce. Alors que les libéraux « pudiques », tels qu'Isaiah Berlin, mettent l'accent sur la liberté négative, c'est-à-dire la liberté de quelque chose (par exemple de la peur), et comprennent ainsi la liberté comme une indépendance, les libéraux directs mettent l'accent sur la liberté pour quelque chose. Il ne s'agit en fait que de pouvoir. La liberté du marché est la liberté des plus riches d'éliminer progressivement les moins riches. La liberté des grandes nations leur permet d'opprimer les petites. La liberté de l'individu sans scrupules lui donne le pouvoir d'asservir les plus démunis. Les Anglo-Saxons mettent donc l'accent sur le droit naturel, qui crée l'illusion parfaite que cette oppression est une évidence. Ils s'opposent également à un État qui pourrait faire obstacle à ce gouvernement illusoire du droit. À la place de l'État, ils ont mis en place une structure appelée « société », ou « société ouverte » ou « société civile ». Nous y reviendrons plus tard.
 Les conservateurs ont remarqué la confusion entre liberté et pouvoir. Ils ont compris que la liberté n'est pas indivisible. Au contraire, peu de choses peuvent être divisées aussi bien que la liberté. La liberté des uns repose souvent sur la servitude des autres. Là où se manifeste le désir de liberté d'une communauté, une autre vague de désir pour une autre liberté se lève contre elle. Adam Müller (ill. ci-contre) a génialement appelé ce phénomène « anti-liberté ». Dans nos actions, la valeur est ce qui ne peut être réduit à quelque chose de plus fondamental, ce qui ne peut être défini par autre chose. Déclarer quelque chose comme une valeur est une sorte d'axiome moral.
Les conservateurs ont remarqué la confusion entre liberté et pouvoir. Ils ont compris que la liberté n'est pas indivisible. Au contraire, peu de choses peuvent être divisées aussi bien que la liberté. La liberté des uns repose souvent sur la servitude des autres. Là où se manifeste le désir de liberté d'une communauté, une autre vague de désir pour une autre liberté se lève contre elle. Adam Müller (ill. ci-contre) a génialement appelé ce phénomène « anti-liberté ». Dans nos actions, la valeur est ce qui ne peut être réduit à quelque chose de plus fondamental, ce qui ne peut être défini par autre chose. Déclarer quelque chose comme une valeur est une sorte d'axiome moral.
L'interprétation de Kant de la valeur comme impératif catégorique était erronée, mais ne nous attardons pas là-dessus. Pour nous, il est important de comprendre que la liberté n'est pas une valeur. D'où pouvons-nous donc la déduire pour ne pas avoir à la considérer comme un simple pouvoir ? La réponse conservatrice est: de l'Ordre. L'ordre n'est pas l'œuvre des hommes ni une question de règles. Il est donné aux hommes de l'extérieur comme tout ce qui sert leur bien. Mais il n'est pas donné de telle sorte que nous le voyons, le comprenons et l'appliquons immédiatement. Il change de forme au cours de l'histoire et l'homme doit le redécouvrir sans cesse. Il a également ses formes culturelles. C'est pourquoi les conservateurs accordent une telle importance à l'histoire et aux différentes nations. De Maistre disait qu'il ne connaissait pas l'homme, mais seulement des Français, des Allemands, des Russes, etc. La liberté n'est possible que dans le cadre de l'ordre, elle n'est pas le libre arbitre d'un individu ou d'un groupe d'individus. La liberté dans le cadre de l'ordre découle de l'axiome le plus fondamental: rien de ce qui concerne l'homme n'est autonome, mais hétéronome.
 Adam Müller soulignait la différence fondamentale entre ce qui est vivant et ce qui est inanimé ou mort. Il disait par exemple que le concept est mort, mais que l'idée est vivante. Oswald Spengler (ci-contre) a repris cette idée plus tard dans sa conception de la civilisation. Selon lui, chaque civilisation commence spontanément, s'éveille à son apogée. Dès que les formes culturelles vivantes se figent et se fossilisent, une période de civilisation, une époque de formes mortes, commence, signe indubitable de sa fin prochaine.
Adam Müller soulignait la différence fondamentale entre ce qui est vivant et ce qui est inanimé ou mort. Il disait par exemple que le concept est mort, mais que l'idée est vivante. Oswald Spengler (ci-contre) a repris cette idée plus tard dans sa conception de la civilisation. Selon lui, chaque civilisation commence spontanément, s'éveille à son apogée. Dès que les formes culturelles vivantes se figent et se fossilisent, une période de civilisation, une époque de formes mortes, commence, signe indubitable de sa fin prochaine.
Un conservateur authentique reconnaît cette différence dans tout et fait la distinction entre l'organique et le mécanique, entre ce qui peut croître par lui-même et ce qui est simplement construit. Tout ce qui trouve son origine dans l'autonomie humaine est artificiel, mécanique, donc mort. Ce qui nous est donné de manière hétéronome est vivant, organique. L'ordre est de nature organique, ce qui est une définition bien meilleure que « naturel ». Le principe de l'ordre hétéronome s'oppose radicalement à l'idée autonomiste d'une loi déterministe de l'histoire et de son mouvement immanent, et donc à l'idée de progrès.
Si nous nous en tenons au mot d'ordre de la Révolution française, nous devrions maintenant nous occuper de l'égalité. À première vue, il est évident que l'égalité appartient également au domaine des mécanismes morts. Les libéraux ont beau se tortiller comme ils le peuvent, ils en arrivent toujours à transformer l'égalité en uniformité.
 Et l'égalité juridique initialement prévue, combinée à la conception libérale de la liberté comme arbitraire, transforme d'une part chaque être humain vivant en un élément mort et indifférent de la soi-disant société et, d'autre part, lui permet de se créer – de manière illusoire, bien sûr – en ce qu'il veut. C'est ainsi, par exemple, que nous sommes passés du statut juridique des femmes à la création de dizaines de statuts sexuels, appelés de manière absurde « genres ». La question se pose donc: si l'ordre est le fondement de la liberté possible, quel est le fondement de l'égalité ? Et tout comme l'égalité est liée à la liberté, le fondement de l'égalité est-il lié à l'ordre ? Cette fois, la réponse tient en deux mots étroitement liés : hiérarchie et autorité. Et ceux-ci sont bien sûr liés à l'ordre.
Et l'égalité juridique initialement prévue, combinée à la conception libérale de la liberté comme arbitraire, transforme d'une part chaque être humain vivant en un élément mort et indifférent de la soi-disant société et, d'autre part, lui permet de se créer – de manière illusoire, bien sûr – en ce qu'il veut. C'est ainsi, par exemple, que nous sommes passés du statut juridique des femmes à la création de dizaines de statuts sexuels, appelés de manière absurde « genres ». La question se pose donc: si l'ordre est le fondement de la liberté possible, quel est le fondement de l'égalité ? Et tout comme l'égalité est liée à la liberté, le fondement de l'égalité est-il lié à l'ordre ? Cette fois, la réponse tient en deux mots étroitement liés : hiérarchie et autorité. Et ceux-ci sont bien sûr liés à l'ordre.
 Au tout début de la civilisation atlantique des Lumières, on avait encore conscience de l'ordre inhérent à toute chose. Carl Linné et ses disciples trouvaient l'ordre de la nature dans son organisation hiérarchique. Au cours de la première moitié du 19ème siècle, le naturaliste et philosophe Lorenz Oken (ill. ci-contre) a créé un système sophistiqué pour toute la nature. L'effondrement du principe hiérarchique n'est survenu que lorsque la hiérarchie, qui faisait obstacle à la pensée des Lumières parce qu'elle maintenait l'idée d'hétéronomie, a été littéralement uniformisée (le terme nazi de Gleichschaltung est ici approprié) par le principe purement autonomiste de l'évolution. Le modèle évolutionniste a écarté de la pensée européenne la pensée hiérarchique, non seulement dans ses relations avec la nature, mais aussi dans ses relations avec l'environnement humain. Aujourd'hui encore, on sous-estime philosophiquement la négation darwinienne des frontières entre les espèces, qui sont devenues « fluides ».
Au tout début de la civilisation atlantique des Lumières, on avait encore conscience de l'ordre inhérent à toute chose. Carl Linné et ses disciples trouvaient l'ordre de la nature dans son organisation hiérarchique. Au cours de la première moitié du 19ème siècle, le naturaliste et philosophe Lorenz Oken (ill. ci-contre) a créé un système sophistiqué pour toute la nature. L'effondrement du principe hiérarchique n'est survenu que lorsque la hiérarchie, qui faisait obstacle à la pensée des Lumières parce qu'elle maintenait l'idée d'hétéronomie, a été littéralement uniformisée (le terme nazi de Gleichschaltung est ici approprié) par le principe purement autonomiste de l'évolution. Le modèle évolutionniste a écarté de la pensée européenne la pensée hiérarchique, non seulement dans ses relations avec la nature, mais aussi dans ses relations avec l'environnement humain. Aujourd'hui encore, on sous-estime philosophiquement la négation darwinienne des frontières entre les espèces, qui sont devenues « fluides ».
Alors que dans la nature, la hiérarchie est une propriété immanente que personne ne peut remettre en question, dans l'environnement humain (nous ne l'appelons pas « société »), elle est maintenue, voire transformée, par un facteur hétéronome, à savoir l'autorité conférée à certaines personnes qui sont responsables de son utilisation. Celle-ci est un instrument indispensable au maintien de la cohésion des groupes humains. Après avoir brisé la hiérarchie dans l'environnement naturel de l'homme, la civilisation atlantique a dû trouver le moyen de perturber la hiérarchie ici aussi.
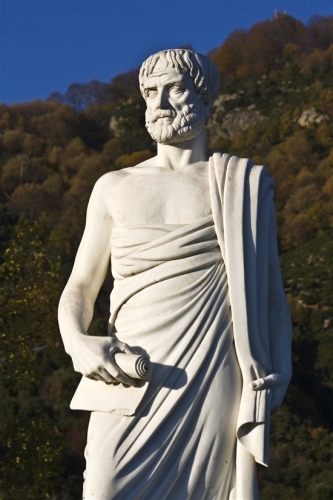 La seule possibilité était de nier toute forme d'autorité, ce qui a plongé la fragile hiérarchie interhumaine dans le chaos actuel. Un conservateur authentique doit donc insister sur le rétablissement de l'autorité, en particulier dans quatre domaines. Il s'agit de la famille, de l'école, du travail et de l'État. Si les trois premières autorités, à savoir les parents, les enseignants et les employeurs, ne suscitent apparemment pas beaucoup de controverses, l'autorité de l'État est aujourd'hui problématique. Il existe une explication conservatrice à cela. Par État, nous entendons une structure institutionnelle qui garantit aux citoyens d'un État donné ce qu'Aristote appelait « eu zén », une bonne vie, ou plus précisément une bonne existence, ce qui ne signifie pas le bien-être matériel, mais une vie digne.
La seule possibilité était de nier toute forme d'autorité, ce qui a plongé la fragile hiérarchie interhumaine dans le chaos actuel. Un conservateur authentique doit donc insister sur le rétablissement de l'autorité, en particulier dans quatre domaines. Il s'agit de la famille, de l'école, du travail et de l'État. Si les trois premières autorités, à savoir les parents, les enseignants et les employeurs, ne suscitent apparemment pas beaucoup de controverses, l'autorité de l'État est aujourd'hui problématique. Il existe une explication conservatrice à cela. Par État, nous entendons une structure institutionnelle qui garantit aux citoyens d'un État donné ce qu'Aristote appelait « eu zén », une bonne vie, ou plus précisément une bonne existence, ce qui ne signifie pas le bien-être matériel, mais une vie digne.
L'État, ou la communauté, doit, par son gouvernement, offrir à ses citoyens un cadre de vie meilleur que celui dont ils disposeraient sans lui. Malheureusement, la formation politique actuelle, qui prétend être un État, ne gouverne pas et n'administre pas le pays de manière à rendre la vie digne d'être vécue. Les conservateurs veulent que la nation retrouve sa pleine souveraineté, qui lui apporterait un État capable de devenir une véritable autorité.
À ce stade, on ne peut ignorer la question de la démocratie. Elle n'est pas essentielle à notre analyse, nous n'y ferons donc qu'une brève allusion. Aujourd'hui, on n'utilise plus les slogans « liberté et égalité », mais « liberté et démocratie ». On y ajoute parfois « prospérité ». Celle-ci est certes bonne pour la paix dans l'État, mais ce qui importe davantage, c'est la vie digne dont nous venons de parler. Si un slogan est répété à l'envi, les mots qu'il contient perdent leur sens. Pour conserver son efficacité, il faudrait le retirer de la circulation comme une pièce usée ou un billet de banque froissé. Mais cela n'arrive généralement pas. Le slogan change en effet de mission. Il devient une shahada, une profession de foi succincte. Le prononcer signifie que l'on appartient à la religion correspondante.

Aujourd'hui, lorsqu'une personne se revendique de la « liberté et de la démocratie », elle montre qu'elle appartient à la civilisation atlantique et qu'elle professe sa religion, centrée sur les valeurs sacrées du libéralisme (liberté), de la démocratie (égalité) et des droits de l'homme (fraternité). Dans l'Empire romain, la loyauté s'exprimait par des sacrifices aux dieux romains, les chrétiens ont le Credo et les musulmans la shahada, les communistes avaient le socialisme et l'internationalisme prolétarien. Le fait que le mot « démocratie » soit devenu une sorte de formule magique rend son analyse et son interprétation difficiles. La « liberté » est plus facile à comprendre, car elle a d'autres utilisations que politiques.

Une fois débarrassé de son contexte idéologique, le mot « démocratie » ne pose pas de problème majeur aux conservateurs. Il a alors un double sens. Tout d'abord, il exprime la volonté de donner à tous les citoyens jouissant des droits correspondants, et donc pas aux étrangers par exemple, la possibilité de participer à la vie publique. Dans ce sens, le conservateur considère la démocratie comme l'opposé de l'oligarchie, qui est le régime politique typique du libéralisme, hypocritement déguisé en démocratie. Une telle « démocratie » n'est rien d'autre que le règne de l'argent, comme l'a démontré Oswald Spengler.
Dans le second sens, la démocratie est également acceptable pour les conservateurs sous certaines conditions. Il s'agit d'une démocratie procédurale, formelle, c'est-à-dire la sélection des représentants politiques sur la base d'élections. Pour un conservateur authentique, le problème réside dans le système parlementaire multipartite, qui tend vers une oligarchie libérale et dans lequel les partis politiques se réduisent à la représentation non pas des citoyens, mais de groupes d'intérêt.
La république est un bon terme pour désigner une démocratie non partisane et anti-oligarchique. À l'heure actuelle, où la noblesse européenne, avec à sa tête les familles royales, a été dénationalisée et s'est en fait fondue dans la ploutocratie mondiale, le système politique le plus acceptable pour les conservateurs est la république telle que décrite ci-dessus. Il est donc plus approprié d'utiliser le terme « républicain » que « démocratique » en relation avec le conservatisme.

L'idée s'impose que le problème le plus immédiat lié à l'égalité est la question sociale. Le paragraphe précédent a déjà indiqué que le conservateur est proche du socialiste à bien des égards (notamment dans son opposition commune à l'individualisme libéral). Bien sûr, il ne part pas comme lui de l'égalité ni de la « solidarité ». La « solidarité » est l'équivalent actuel du mot désuet « fraternité ». Du point de vue du conservatisme authentique, il s'agit pour ainsi dire d'un concept d'urgence qui implique la notion de « société » en tant qu'entité sociale atomisée et mécanique. Les partisans actuels du socialisme trahissent par le terme « solidarité » leurs origines libérales du début du 19ème siècle. Un social-démocrate pourrait leur faciliter leur rejet croissant de l'héritage libéral.
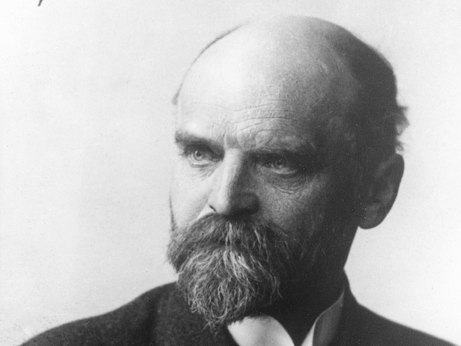 Le créateur de la sociologie philosophique allemande, Ferdinand Tönnies (photo), s'est inspiré des oppositions déjà évoquées entre « vivant » et « mort », ainsi qu'entre « organique » et « mécanique ». En tant qu'opposant actif au national-socialisme naissant, il adhéra en 1930, à l'âge de 75 ans (!), au Parti social-démocrate allemand. Entre autres, en 1936, année de sa mort, parut une nouvelle édition de son opera magna, Gemeinschaft und Gesellschaft (« Communauté et société ») de 1887. Il y oppose les structures sociales mécaniques et organiques. La société représente les structures mécaniques, tandis que la communauté représente les structures organiques. C'est précisément la communauté qui est devenue au 20ème siècle la clé de la résolution des problèmes sociaux pour les conservateurs. Dans le monde anglo-américain, un courant politique appelé « communitarisme », d'après le terme anglais désignant la communauté, a même influencé la philosophie politique de la fin du 20ème siècle. Les communitaristes étaient soit des libéraux, soit des pseudo-conservateurs.
Le créateur de la sociologie philosophique allemande, Ferdinand Tönnies (photo), s'est inspiré des oppositions déjà évoquées entre « vivant » et « mort », ainsi qu'entre « organique » et « mécanique ». En tant qu'opposant actif au national-socialisme naissant, il adhéra en 1930, à l'âge de 75 ans (!), au Parti social-démocrate allemand. Entre autres, en 1936, année de sa mort, parut une nouvelle édition de son opera magna, Gemeinschaft und Gesellschaft (« Communauté et société ») de 1887. Il y oppose les structures sociales mécaniques et organiques. La société représente les structures mécaniques, tandis que la communauté représente les structures organiques. C'est précisément la communauté qui est devenue au 20ème siècle la clé de la résolution des problèmes sociaux pour les conservateurs. Dans le monde anglo-américain, un courant politique appelé « communitarisme », d'après le terme anglais désignant la communauté, a même influencé la philosophie politique de la fin du 20ème siècle. Les communitaristes étaient soit des libéraux, soit des pseudo-conservateurs.
Chaque individu appartient à plusieurs communautés, et ces appartenances constituent son identité. La communauté fondamentale est la famille, ou plutôt la lignée. À la campagne notamment, il s'agit de la communauté de voisins, qui peut s'étendre à tout le village. La communauté religieuse, de la paroisse au diocèse, est également incontournable. Nous connaissons également les cercles d'amis, qui sont des communautés d'amis. La communauté se crée également dans les relations de travail. L'histoire nous a surtout appris l'existence des corporations, qui réunissaient des personnes exerçant la même profession, de manière beaucoup plus étroite et surtout plus durable qu'aujourd'hui.
Les communautés sont capables de créer un réseau complexe de relations, dont la société civile n'est qu'un piètre substitut. Là où aucune structure identitaire de communautés ne se construit, la société civile s'installe. La communauté qui englobe toutes les autres est la nation. La nation n'est toutefois pas seulement une communauté de contemporains, elle comprend également les ancêtres et les descendants. La tâche des contemporains est de transmettre l'héritage de leurs ancêtres à leurs descendants. Pour les conservateurs, il n'y a donc pas de conflit générationnel. Si l'on exclut les contemporains de la nation, il ne reste que le peuple. C'est précisément le peuple que les libéraux et les socialistes libéraux appellent à tort « société ». Mais le peuple n'est pas un mécanisme, il est vivant, très vivant. Il est également le sujet qui forme les institutions couronnées par l'État. Seul le peuple, qui est en même temps une nation, peut créer un État libre. Libre au sens de l'indépendance et au sens du pouvoir. Pour cela, il faut encore que l'État soit construit et maintenu (c'est-à-dire conservé) par des individus connaissant l'ordre et dotés d'une autorité légitime.

La vie d'une nation se déroule au sein de communautés hiérarchisées. Cela vaut également pour les relations de travail. Pour le conservateur continental (tout comme pour le socialiste), le travail jouit d'un grand prestige. Les gens devraient exercer des professions utiles, qui apportent un bénéfice réel, qu'il soit matériel ou immatériel, et ils devraient les exercer si possible toute leur vie et dans le cadre de la famille. Le credo du conservateur vise le déclin de toutes les formes possibles de migration et de mobilité.
Il ressort clairement de ce qui précède que le conservateur continental (contrairement au conservateur anglo-américain) est opposé au capitalisme. La question reste ouverte de savoir si – ou plutôt comment – les idées du corporatisme peuvent être reprises dans l'économie. L'une des caractéristiques qui distingue la communauté de la société est la cohésion interne. C'est pourquoi nous ne parlons pas de solidarité, c'est-à-dire des relations entre des étrangers, mais de cohésion, de cohésion interne. Seuls les membres d'une même communauté nationale peuvent aider volontiers les autres membres de cette communauté.
Le réseau des communautés doit également servir de base à la vie politique. La politique doit être exercée par des citoyens respectés et riches d'une longue expérience de la vie. Ceux-ci représenteraient différentes communautés partielles, et non des partis. Il est toutefois évident que des partis politiques verraient le jour au sein des assemblées représentatives, mais ceux-ci ne seraient pas des institutions permanentes.
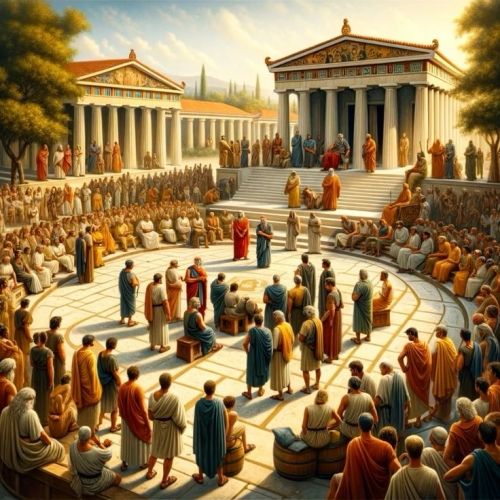
Le contrôle de l'économie doit être une tâche importante. Les conservateurs ont toujours exigé que l'économie soit contrôlée politiquement, civilement. C'est une autre caractéristique qu'ils partagent avec les socialistes et qui les oppose aux libéraux. Bien qu'ils soient partisans d'un ordre hiérarchique dans le domaine économique, ils considèrent comme néfaste l'apparition de trop grandes différences de richesse entre les individus. On retrouve cette idée dans La République de Platon.
Pour conclure, rappelons un fait oublié. Dans la folie écologique actuelle, rappelons-nous que ce sont les conservateurs continentaux qui ont été les premiers à brandir l'étendard de la protection de la nature. Leur romantisme les a conduits à cette idée, ainsi que l'égarement des capitalistes. Dès le début du 19ème siècle, Adam Müller s'est lancé dans une campagne contre la déforestation en Allemagne pour des profits dérisoires. On peut trouver de nombreux exemples de ce type.

Les conservateurs ne doivent plus laisser les extrémistes s'approprier cette question. L'approche conservatrice ne devrait probablement pas utiliser le terme « écologie » et ses dérivés, mais nous pourrions plutôt parler de protection et de préservation (conservation) de la nature pour les générations futures, pour la nation. Cela va de pair avec l'entretien général du paysage et la production d'une alimentation nationale saine.
Faisons un bref résumé. Un conservateur authentique, c'est-à-dire continental, se distancie du pseudo-conservatisme anglo-américain. Il s'oppose beaucoup plus fermement au libéralisme, dont le slogan est devenu : liberté, égalité, fraternité (1). Le conservateur, en revanche, répète : ordre, hiérarchie et autorité, communauté et nation. Il s'oppose aux déviations sexuelles et de genre, à la folie écologique et aux autres pratiques terroristes de la ploutocratie mondiale.
Note :
(1) Et en effet, ce slogan mystique des démocraties a surtout sa place sur les drapeaux. Dès qu'on le retire, il devient et est déjà devenu source d'innombrables contradictions. Dans la triade Liberté – Égalité – Fraternité, le mot liberté est primordial, sinon pourquoi serait-il placé en tête ? D'ailleurs, sa primauté sémantique découle trop clairement de tout ce que nous avons envisagé depuis la Renaissance [idée libérale].
Les deux autres termes expriment également des exigences, mais les choses se présentent ainsi : la fraternité est une réminiscence pathétique, inconsciemment religieuse, elle témoigne de la descendance chrétienne évangélique et du lien qui existe entre toutes les formes de démocratisme, tous les hommes sont les enfants du même Père divin, ils sont donc frères et doivent s'aimer fraternellement.
Sur le plan moral et émotionnel, cette réminiscence est appropriée, mais sur le plan factuel, elle n'est qu'une métaphore, tandis que l'exigence de liberté est prise au sens littéral, « réaliser et naturaliser ».
Quant à l'égalité, en tant qu'exigence abstraite, elle n'a pas plus de sens concret ; en réalité et naturellement, les hommes ne sont pas, ne peuvent et ne doivent être égaux, l'humanité n'est pas, ne peut pas et ne doit pas être la répétition d'un même exemplaire biologique et psychique en trois milliards d'exemplaires, l'inertie de l'égalité et de l'uniformité arrêterait son évolution si elle ne la ramenait pas à l'état simiesque : le rouquin n'est pas l'égal du brun, le travailleur n'est pas l'égal du paresseux, le génie n'est pas l'égal de l'idiot, l'homme à la volonté active n'est pas l'égal du primitif incorrigible qui ne veut rien d'autre que satisfaire ses besoins végétaux.
L'égalité en tant qu'exigence abstraite est tout simplement un malentendu, et plus précisément une conclusion erronée tirée du rationalisme philosophique des Lumières et de l'empirisme philosophique des Lumières: dans le rationalisme, elle découle de la définition de l'homme comme être doué de raison, contrairement à l'animal, et de la conception cartésienne de la raison comme « la chose la mieux partagée du monde », c'est-à-dire la chose la mieux, la plus généralement et la plus équitablement partagée dans le monde ; dans l'empirisme, on y est parvenu par l'expérience, c'est-à-dire par l'observation de la vie, qui présente chez l'homme les mêmes attributs, depuis la même bipédie jusqu'à la même capacité de parler et de penser raisonnablement.
Mais, qu'il soit dit aux rationalistes que la raison est certes la chose la plus uniformément partagée entre les hommes (chacun a une raison), mais qu'elle est très inégalement et inégalement répartie (personne ne l'a autant et comme un autre) ; aux empiristes, qu'il faut dire que nous sommes tous bipèdes, mais que chez beaucoup, la qualité humaine continue à marcher à quatre pattes, seul le tronc s'est redressé.
Le reste de l'erreur a été fourni par le zèle enthousiaste de la lutte des Lumières contre l'Ancien Régime et ses privilèges de naissance et de classe, et plus encore par le primitivisme égalitaire démagogique du progressisme moderne.
L'identité abstraite de la même chose, mais répartie de manière inégale entre les individus, ne fonde absolument pas une quelconque égalité naturelle et intrinsèque entre tous, et ne peut en aucun cas être formulée comme une exigence d'égalité qui, dans la coexistence sociale, égaliserait et nivellerait les différences individuelles entre les personnes.
Voltaire n'a donc jamais été l'égal de son tailleur, et à l'époque, ils le savaient tous les deux, et Einstein n'est pas l'égal d'un gitan analphabète, et aujourd'hui, au moins Einstein le sait. Cela n'empêchait pas le tailleur, et encore moins le gitan, d'être des adeptes bruyants et exigeants de l'égalité commune à quatre, en pensant avant tout à l'égalité des biens. Pour leur faire plaisir, pensons-y nous aussi, hélas, mais montrons en même temps que l'égalisation ou l'uniformisation des gens dans la société, ne serait-ce qu'en termes de propriété absolue, est une solution totalement utopique qui ne survivra pas à une seule génération : au cours de ces trente années, ces personnes « égalisées » contribueront de manière très, très différente selon leurs talents et leur diligence, et à la fin de la génération, une inégalité renouvelée apparaîtra et l'égalisation devra être répétée de force, de sorte que le développement social devra nécessairement repartir tous les trente ans d'une « tabula rasa » sociale, de zéro, du déluge. – Réflexion de V. Černý tirée de : O povaze naší kultury (Brno : Atlantis, 1991), 39–41.
Note du site DP :
« ... aucun conservateur ne veut être exclu du débat public comme quelqu'un qui a déjà « franchi la ligne ». Les conservateurs ? Ce ne sont que des libéraux un peu en retard sur leur temps, que les progressistes tirent derrière eux comme un canard en bois, qui se met parfois sur la tête, dont on bloque parfois les rouages, mais qui, en principe, maintient le cap », déclare – en notre nom et au nom de notre – Václav Jan dans son article (« Desatero progresivní detektivky »). Et il en a toujours été ainsi, puisque les premiers conservateurs continentaux ont été des aristocrates libres penseurs – des libéraux français, des monarchistes modérés qui ont pris peur devant les conséquences de leur propre idéologie (voir O. Spengler, Myšlenky, p. 162 et suivantes) : y compris la guillotine.
C'est ainsi que « la droite » s'est progressivement rapprochée de ses adversaires de classe, les réactionnaires irréconciliables du « trône et de l'autel » (voir P. Sérant, Le romantisme fasciste, p. 299 et suivantes). Dans la seconde moitié du 19ème siècle, sous la pression des socialistes internationalistes, les nationalistes-républicains bourgeois, véritables démocrates, se joignent à eux.
Par la suite, les esprits les plus pénétrants constatent que dans un contexte de décomposition générale, de « déclin de l'Occident », le conservatisme ne peut plus être que révolutionnaire... « Si nous comprenons la raison bourgeoise comme une pensée démocratique-libérale au sens général, il est évident que la révolution conservatrice la critique de manière destructrice, c'est-à-dire de manière totalement négative. » Alors que : « Le néo-marxisme veut que sa critique de la raison bourgeoise aboutisse à quelque chose de positif – il ne peut donc logiquement être la continuation d'une critique qui voulait aboutir à la destruction. » Il en découle que « il est vrai que, par rapport au monde qui les entoure, les fascismes sont révolutionnaires au sens le plus radical et aussi au sens étymologique du terme, ce que même leurs adversaires les plus honnêtes ont fini par reconnaître.
Horkheimer, marxiste à l'origine et finalement porte-parole d'une sorte de néo-judaïsme abstrait, a reconnu à la fin de sa vie que « la révolution ne peut être que fasciste », car seul le fascisme veut renverser complètement le « système de valeurs » existant et « changer le monde », de sorte qu'il considère le monde actuel exactement comme les premiers chrétiens considéraient le monde gréco-romain et l'Empire romain. » (voir G. Locchi, Podstata fašismu, p. 40, 16)
11:47 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conservatisme, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Écrire un commentaire