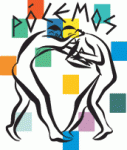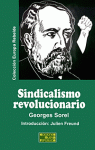Intervention lors de la 8ième Université d'été de "Synergies européennes", Trente, juillet 1998
Pour la Vie, contre les structures abstraites !
Par Maître Jure VUJIC
Que signifie au juste la revendication de la vie face aux structures abstraites? Dans le cadre d'une approche philosophique, cela conduit vers une intention de réduire la portée des démarches de la pensée consciente et de ses médiations, et de potentialiser celle de l'inconscient ou de la vie immédiate par une saisie de la réalité humaine en deça des formes et des constructions sociales et politiques artificielles et abstraites par essence, des traditions historiques désuètes et des cristallisations culturelles stériles.
Cette démarche philosophique que l'on pourrait qualifier soit d'“irrationaliste” soit de “vitaliste” sous-entend même l'importance de la philosophie de Kant constatant les limites de la raison théorique et dont les prolongements critiques engendrent un double courant: l'un axé sur la volonté morale et sur une dialectisation de la raison (Fichte et Hegel) qui débouche par réaction dans le marxisme et le “matérialisme dialectique”; l'autre, qui revendique l'immédiateté de la vie, l'intuitionisme et le primat de l'instinct, procède du courant de pensée engendré par Schopenhauer, véritable père de l'irrationalisme contemporain, et trouve ses ramifications philosophiques chez Nietzsche, Jung, Adler et même Freud, l'existentialisme français de Sartre et la philosophie existentielle de la vie que l'on retrouve chez Bergson, Schelling, Kierkegaard, Maurice Blondel. L'école allemande, avec Wilhelm Dilthey, G. Misch, B. Groethuysen, Ed. Spranger, Hans Leisegang, A. Dempf, R. Eucken, E. Troeltsch, G. Simmel, ainsi que la philosophie naturaliste de la vie d'Oswald Spengler et Ludwig Klages.
Le dénominateur commun que l’on retrouve dans chacun de ces courants de pensée hétéroclites et qui réside dans la revendication du principe de vie face au constructivisme abstrait, étant donné la diversité des perspectives qui l’expriment, ne se laisse pas enfermer dans un schéma d’interprétation global à la manière dont procède Georges Lukacs, le célèbre marxiste hongrois, qui considère la pensée irrationaliste allemande comme typiquement bourgeoise et « réactionnaire », en tenant pour définitivement acquis que l’histoire des idées est subordonnée à des forces primaires agissantes : situation et développement des forces de production, évolution de la société, caractère de la lutte des classes, etc…
Ce qui est certain, c’est que ce courant de pensée vitaliste ou « irrationaliste » remet en question l’idée de progrès historique, la linéarité et le mythe progressiste, et qu’il représente ainsi la contrepartie du courant de pensée qui, du XVIIIième siècle français à travers Kant et la révolution française, débouche dans la dialectique hégélienne et marxiste ; contrepartie dans la mesure où il déprécie le pouvoir de la raison, que ce soit en contestant l’objectivité du réel, que ce soit en réduisant la connaissance intellectuelle à son efficacité technique, que ce soit en se réclamant d’une saisie mystique de la réalité « absolue », décrétée irrationnelle dans son essence. La lutte contre l’abstraction et la raison a des formes aussi variées que les motivations qui l’engendrent. Elle peut notamment aboutir à faire un principe de la notion d’absurde qui a surgi chez Schopenhauer et plus tard chez Cioran.
De Leibniz à Kant et Schopenhauer
A l’opposé du rationalisme de la pensée occidentale, du principe de raison suffisante énoncé par Leibniz, du cartésianisme, la revendication de la vie dont Schopenhauer se fera le principal promoteur, sous-entend que l’intelligence ou la raison n’est pas à la racine de toute chose, qu’elle a surgi d’un monde opaque, et que les principes qu’elle introduit demeurent irrémédiablement à la surface de la réalité, puisqu’ils lui sont, comme l’intelligence elle-même, surajoutés. Le corollaire d’une telle conception est que la réalité qui fonde toutes les existences particulières est elle-même sans fondement, sans raison, sans cause (générale), que notre manière de raisonner, dès lors, est valable seulement pour ce qui est des rapports que les êtres et les choses entretiennent dans l’espace et dans le temps.
Au-delà d’un impératif absolu de la loi morale de type kantien, qui fonde le constructivisme de type ontologique et abstrait, Schopenhauer se fait le chantre d’une sourde impulsion à vivre, antérieure à toute activité logique, que l’on peut saisir au plus profond de soi-même pour une appréhension directe avant sa déformation abstraite dans les cadres de l’espace et du temps, et qui se révèle comme une tendance impulsive et inconsciente. Schopenhauer, dans sa réflexion, reprend des motifs hérités du « divin Platon » dans l’allégorie de la caverne qui nous révèle que le monde que nous percevons est un monde d’images mouvantes.
Schopenhauer et le « Voile de Maya »
D’autre part, il empruntera à la tradition de l’Inde l’idée que les êtres humains sont enveloppés dans le « voile de Maya », c’est-à-dire plongés dans un monde illusoire. Schopenhauer restera persuadé que les fonctions psychiques ne représentent, par rapport à la réalité primaire et absolue du vouloir-vivre (Wille zum Leben) qu’un aspect secondaire, une adjonction, une superstructure abstraite. A la tentation de l’illusoire, de l’abstrait et de l’absurde, que l’on menait vers un pessimisme radicale, Schopenhauer proposait le remède de la négation du vouloir-vivre, une forme supérieure d’ascétisme.
A l’idée d’humanité, qui lui paraît absurde, il oppose des « modèles » éternels qu’il empruntera au platonisme. Cet emprunt lui sert à expliquer les types de phénomènes du vouloir dans l’espace et dans le temps, phénomènes reproduisant incessamment des modèles, des formes, des idées éternelles et immuables. Il y a des idées inférieures, ou des degrés élémentaires, de la manifestation du vouloir : pesanteur, impénétrabilité, solidité, fluidité, élasticité, magnétisme, chimisme ; et les idées supérieures qui apparaissent dans le monde organique et dont la série s’achève dans l’homme concret.
Transformant la primauté du vouloir-vivre schopenhauerien en primauté de la volonté de puissance, opposant au renoncement préconisé par Schopenhauer une affirmation-glorification de la volonté, Nietzsche se fait l’annonciateur de l’homme vital, de l’homme créateur de valeurs, de l’homme-instance-suprême, en même temps que de grands bouleversements qui préfigurèrent le nihilisme européen du XXième siècle. Et cela, au temps du positivisme abstrait et du constructivisme, c’est-à-dire à un moment où la prudence l’emporte et où la vie humaine paraît confortablement ancrée dans des institutions sécurisantes. Sur le chemin où l’homme européen s’est trouvé engagé jusqu’à présent, déterminé par l’héritage de l’Antiquité et par l’avènement du christianisme, la revendication de la vie chez Friedrich Nietzsche qui, par sa critique radicale et impitoyable de la religion, de la philosophie de la science, de la morale s’exprime à travers sa phrase lancinante : « Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite ».
Nietzsche : vitalisme et tragique
Le vitalisme de Nietzsche se révélera tout d’abord dans son œuvre La naissance de la tragédie, puis à travers la dichotomie qu’il institue entre l’esprit apollinien, créateur d’images de beauté et d’harmonie, et l’état dionysiaque, sorte d’ivresse où l’homme brise et dépasse les limites de son individualité. Apollon, symbole de l’instinct plastique, dieu du jour, de la clarté, de la mesure, force plastique du rêve créateur ; Dionysos, dieu de la nuit, du chaos démesuré, de l’informe, est pour Nietzsche le grand élan de la vie qui répugne à tous les calculs et à tous les décrets de la raison. Les deux figures archétypales sont pour Nietzsche la révélation de la nature véritable de la réalité suprême, l’antidote contre les structures existentielles et psychologiques abstraites et sclérosées. C’est dans cette optique que Nietzsche condamnera la révolution rationnelle de Socrate, dont il pense qu’elle a tué l’esprit tragique au profit de la raison, de l’homme abstrait et théorique.
Pour Nietzsche, être forcé de lutter contre les instincts, c’est la formule de la décadence : tant que la vie est ascendante, bonheur et instinct sont identiques. Avec Socrate et, après lui, le christianisme venant aggraver le processus, l’existence s’est, selon Nietzsche, banalisée sur la base d’un immense malentendu qui réside dans la morale chrétienne de perfectionnement, ce que Deleuze nommera plus tard la morale des dettes et des récompenses.
Ce que Nietzsche veut dévoiler, c’est la toute-puissance de l’instinct, qu’il tient pour fondamental : celui qui tend à élargir la vie, instinct plus fort que l’instinct de conservation tendant au repos, que la crainte alimente et qui dirige les facultés intellectuelles abstraites. La volonté créatrice chez l’individu est ce par quoi il se dépasse et va au-delà de lui-même ; il s’agit de se transcender et de s’éprouver comme un passage ou comme un pont. Le vitalisme de type héroïque conduira Nietzsche à dénoncer le nihilisme européen en y contribuant par sa philosophie « à coups de marteau » à se faire, à coups d’extases, l’annonciateur du surhomme et de l’Eternel retour face à l’homme abstrait et théorique et au mythe progressiste de l’humanité.
C’est ce qui fera dire à l’écrivain grec Nikos Kazantzaki qui appellera Nietzsche le « grand martyr », parce que Nietzsche lui a appris à se défier de toute théorie optimiste et abstraite.
Freud, apologiste des instincts vitaux
Avec Freud, nous pouvons quitter le domaine de la philosophie puisqu’il s’agit d’un médecin spécialisé en neuro-psychiatrie, dont toutes les théories en appellent à son expérience clinique. Mais il convient d’observer que les deux plans, celui de la réflexion philosophique et celui des sciences humaines ne peuvent être séparée abstraitement. Freud forgera, pour qualifier l’élargissement de ses théories, le terme de métapsychologie, en estimant que la réalité qu’il désigne est celle des processus inconscients de la vie psychique, qui permet de dévoiler ceux qui déterminent, par projection, les constructions métaphysiques. Freud, irrationaliste au sens ontologique du terme et apologiste des instincts vitaux du subconscient humain restera néanmoins un pessimiste biologique.
C’est ainsi qu’au regard des deux grands dissidents de la psychanalyse qu’il a créée, son pessimisme diffèrera de la confiance d’Adler dans la force ascensionnelle de la vie, comme de la vague nostalgie d’un paradis perdu qui imprègnera la pensée de Jung. Pour Adler, le besoin de s’affirmer chez l’être humain reste prédéterminant dans sa pensée, la vie est une lutte dans laquelle il faut nécessairement triompher ou succomber. Face aux abstractions de la raison qui nous menacent, la poussée vitale, ne peut être valablement appréhendée que d’une manière dynamique sous la forme de tendances, d’impulsions, de développement. L’essentiel pour comprendre l’être humain, ce n’est pas la libido et ses transformations, c’est la volonté de puissance sous ses formes diverses : auto-affirmation, amour-propre, besoin d’affirmer son moi, besoin de se mettre en valeur.
L’idée de communauté chez Adler
Adler identifie au sentiment social la force originelle qui a présidé à la formation de buts religieux régulateurs, en parvenant à lier d’une certaine manière entre eux les êtres humains. Le sentiment représente avant tout pour lui une tendance vers une forme de collectivité qu’il convient d’imaginer éternelle. Quand Adler parle de la communauté, il ne s’agit jamais pour lui d’une collectivité abstraite de type sociétaire actuel, ni d’une forme politique ou religieuse déterminée. Il faut entendre le terme au sens d’une communauté organique idéale qui serait comme l’ultime réalisation de l’évolution chez Carl Gustav Jung ; le pouvoir des archétypes n’est que la projection de l’affirmation de la vie face à la superstructure psychologique conditionnée par les contingences externes et abstraites.
Jung : l’inconscient originaire, source de vie
Jung dispose d’une véritable « vision du monde » à partir de données intrapsychiques et qui sont à la base de sa métapsychologie, ainsi que de sa psychologie analytique. Jung insiste sur l’origine même de la conscience, émergence dont il pense qu’elle s’est lentement développée par retrait des projections, ainsi que sur l’autonomie créatrice d’un inconscient impénétrable par un outillage biologique. Toutes ses élucidations sont inscrites dans la perspective d’un inconscient originaire, source de « vie », d’une ampleur incommensurable, et d’où surgit quelque chose de vrai. Pour lui, aucune théorie ne peut vraiment expliquer les rêves, dont certains plongent dans les profondeurs de l’inconscient. Il faut les prendre tels qu’ils sont : produits spontanés, naturels et objectifs de la psyché qui est elle-même la mère et la condition du conscient.
La doctrine de Jung postule l’existence de l’inconscient collectif, source des archétypes qui manifestent des images et des symboles indépendants du temps et de l’espace. Pour Jung, le psychisme individuel baigne dans l’inconscient collectif, source primaire de l’énergie psychique à l’instar de l’élan vital de Bergson. Selon Jung, l’homme moderne qui se trouve plongé dans des virtualités abstraites, a eu le tort de se couper de l’inconscient collectif, réalité vitale et objective, ce qui aurait creusé un hiatus entre savoir et croire.
Animisme, instinctivisme, symbolique ontologique
La sagesse jungienne débouche sur un anti-modernisme dont la condition de validité est que le monde eût été meilleur dans les époques à mentalité magique, qui privilégiait l’animisme, l’instinctivisme et le symbolisme ontologique par rapport au rationalisme abstrait et empirique des temps modernes. Avant d’aborder une succincte présentation de la philosophie à proprement parler existentielle, il convient de faire un détour sur une certaine forme d’irrationalisme philosophique que l’on peut qualifier d’existentialisme ou d’humanisme crispé et dont la figure de proue reste Jean-Paul Sartre.
La raison dialectique, issue de la révolution française, de Hegel à Marx, implique une critique de la raison classique, plus spécifiquement de la manière dont celle-ci concevait les principes d’identité et de non-contradiction ; et sa visée n’est plus de se détacher de la réalité historique et sociale pour la penser en dehors du temps, mais, au contraire, d’exprimer l’orientation même de cette réalité. C’est ainsi que Karl Marx décrétait, dans ses fameuses thèses sur Feuerbach, qu’il ne s’agit plus d’interpréter le monde, mais de le transformer.
Sartre et la totale liberté de l’homme
Ces remarques visent à situer l’attitude de Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste de l’engagement et de la liberté, hostile à tout retrait hors de la réalité historique et sociale. Promoteur au départ d’une conception irrationaliste de la liberté, il a voulu, à partir d’elle, exercer une action politique et sociale révolutionnaire, ce qui l’a forcément conduit à se rapprocher du courant de pensée communiste. Dans L’Etre et le Néant, Sartre entreprend de démonter la totale liberté de l’homme. Il veut prouver que la liberté humaine surgit dans un monde « d’existants bruts » et « absurdes ». La liberté, c’est l’homme lui-même et les choses au milieu desquelles elle apparaît : lieu, époque, etc., constituant la situation. Lorsque Sartre nous dit que l’homme est condamné à la vie et à la liberté, il faut entendre que celle-ci n’est pas facultative, qu’il faut choisir incessamment, que la liberté est la réalité même de l’existence humaine.
Quant aux choses abstraites dans lesquelles cette liberté se manifeste, elles sont contingentes au sens d’être là, tout simplement, sans raison, sans nécessité. Il y a donc pour Sartre, sur le plan ontologique, une dualité radicale entre la liberté (le pour-soi) et le monde (l’en-soi). Il n’en demeure pas moins que l’engagement marxiste-léniniste de Sartre dénote chez lui une certaine intégration dans les circuits abstraits d’une idéologie contestatrice pour ses débuts ; et réactionnaire dans l’après-68.
Chez Sartre, l’existentialisme consistait à intégrer dans le souci d’exercer une action politique et sociale et de la justifier, l’apport du courant hégélo-marxiste à une théorie ayant d’abord consacré le primat de la vie immédiate comme liberté absolue au sein d’une réalité parfaitement opaque ; effort qui confère à son humanisme une singulière crispation et le conduit irrémédiablement dans les méandres de l’abstraction idéologique.
A l’instar de cet existentialisme de type sartrien, la « philosophie de la vie » qui se développera du 19ième au 20ième siècle en Allemagne et en France privilégie les notions de vitalisme, de personnalisme, d’irréversibilité, d’irrationnel par rapport au statisme, à la logique, à l’abstrait, à la généralité et au schématisme. C’est dans ce courant de pensée que s’inscrit Henri Bergson, promoteur de l’idée « d’élan vital », qui s’oppose au mécanicisme, au matérialisme et au déterminisme.
L’Etre est conçu comme une force vitale qui s’inscrit dans son propre rythme, dans une donnée ontologique spécifique. L’intuition reste l’impératif pour tout être humain pour appréhender l’intériorité et la totalité. La vie reste et transcende la matière, la conscience et la mémoire et appelle l’élan d’amour qui seul est à même de valoriser l’intériorité, la liberté et la volonté créatrice.
Le vitalisme de Maurice Blondel
Le vitalisme de Maurice Blondel réside dans l’affirmation et la suprématie de l’action qui est la véritable force motrice de toute pensée. On peut déceler dans les conditions existentielles de l’action l’interaction d’une pensée cosmique, et Blondel proclamera que la vie « est encore plus que la vie ». Parallèlement à ce courant de pensée français s’insérant dans la philosophie de la vie, se développera une philosophie de la vie purement allemande, de type scientifico-spirituel, qui appréhendera le phénomène de la vie dans ses formes historiques, spirituelles et constituant une véritable école d’interprétation des phénomènes spirituels dans le cadre de la philosophie, de la pédagogie, de l’histoire et de la littérature.
Wilhelm Dilthey assimilera le phénomène de la vie sans a priori métaphysique au concept de la « compréhension » (Verstehen), avec des prolongements structuralistes et typologiques. Dans le sillage de son école se distingueront des penseurs tels que G. Mische, B. Groethuysen, Ed. Spranger, Hans Leisegang, A. Dempf. Dans cette continuité, Georg Simmel concluera que la vie, qui est par essence informe, ne peut devenir un phénomène que lorsqu’elle adopte une forme, ce qui suppose qu’elle doit elle-même se transcender pour être au-dessus de la vie. Dans le cadre de l’école structuraliste de la philosophie de la vie allemande, s’illustreront Oswald Spengler, qui décrivit le déclin de l’Occident comme une morphologie de l’histoire de l’humanité, et surtout Ludwig Klages, qui prophétisera la ruine du monde au nom de la suprématie de l’esprit, car l’esprit étant l’ennemi de la vie anéantit la croissance et l’épanouissement de la nature innocente et originelle.
De Chateaubriand à Berdiaeff
Chateaubriand disait, dans Les Mémoires d’Outre-tombe : « La mode est aujourd’hui d’accueillir la liberté d’un rire sardonique, de la regarder comme une vieillerie tombée en désuétude avec l’honneur. Je ne suis point à la mode, je pense que, sans la liberté, il n’y a rien dans le monde ; elle donne du prix à la vie ; dussé-je rester le dernier à la défendre, je ne cesserai de proclamer ses droits ». Nul autre penseur et écrivain que Nicolas Berdiaeff, le mystique aristocrate russe du 20ième siècle ne donnera autant de résonance à ces paroles en insistant constamment sur l’étroite correspondance entre la liberté et l’impératif de la vie face aux diverses séductions des strucures abstraites de la pensée, de la psychologie, de l’idéologie qui engendrent diverses formes d’esclavagisme. L’homme est tour à tour esclave de l’être, de Dieu, de la nature, de la société, de la civilisation, de l’individualisme, de la guerre, du nationalisme, de la propriété et de l’argent, de la révolution, du collectivisme, du sexe, de l’esthétique, etc.
Les mobiles internes de la philosophie de Berdiaeff restent constants depuis le début : primauté de la liberté sur l’être, de l’esprit sur la nature, du sujet sur l’objet, de la personne sur le général et l’universel, de la création sur l’évolution, du dualisme sur le monisme, de l’amour sur la loi. La principale source de l’esclavage de l’homme et du processus engendré par l’abstraction et l’illusion constructiviste réside dans l’objectivation et la socialisation à outrance de l’Etre, dans l’atomisation sociétaire et indivi-dualiste qui détruit les formes organiques de la communauté ; cette dernière est fondée sur l’affirmation de l’idée personnaliste et authentiquement aristocratique, donc différencialiste ; l’affirmation de la qualité en opposition avec la quantité, la reconnaissance de la primauté de la personne impliquant bien celle d’une inégalité métaphysique, d’une diversité, celle des distinctions, la désapprobation de tout mélange.
Berdiaeff, en dénonçant toute forme de statolâtrie, a considéré que la plus grande séduction de l’histoire humaine est celle de l’Etat dont la force assimilante est telle qu’on lui résiste malaisément. L’Etat n’est pas une personne, ni un être, ni un organisme, ni une essentia ; il n’a pas son existence propre, car il n’existe que dans et par les hommes dont il se compose et qui représentent, eux, de vrais centres existentiels. L’Etat n’est qu’une projection, une extériorisation, une objectivation des états propres aux hommes eux-mêmes. L’Etat qui fait reposer sa grandeur et sa puissance sur les instincts les plus bas peut être considéré comme le produit d’une objectivation comportant une perte complète de la personnalité, de la liberté et de la ressemblance humaine. C’est l’expression extrême de la chute. La base métaphysique de l’anti-étatisme chez Berdiaeff est constituée par le primat de la vie et de la liberté de l’être, de la personne, sur la société.
Miguel de Unamuno et l’homme concret
Dans le prolongement de Berdiaeff, et pour conclure, Miguel de Unamuno, dans son œuvre Le sentiment tragique de la vie, proclamera la suprématie de la concrétude de la personne face à l’humanité abstraite par cette phrase : « Nullum hominem a me alienum puto ». Pour lui, rien ne vaut, ni l’humain ni l’humanité, ni l’adjectif simple ni le substantif abstrait, mais le substantif concret : l’homme. L’homme concret, en chair et en os, qui doit être à la base de toute philosophie vraie, qui se préoccupe du sentimental, du volitionnel, de la projection dans l’infini intérieur de l’homme donc de la vie et d’un certain sentiment tragique de la vie qui sous-entend le problème de notre destinée individuelle et personnelle et de l’immortalité de l’âme.
Maître Jure VUJIC.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg