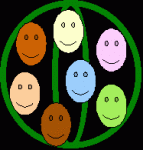Frank GOOVAERTS (†):
Sur l’itinéraire d’Erich WICHMAN (1890-1929)
Un isolé anarchisant de la “révolution conservatrice” néerlandaise
La gauche et la droite ne se combattent qu’en apparence. En réalité, elles te combattent, toi!
(Erich Wichman).
◊ 1. INTRODUCTION : esquisse d’un chaos
Si, pendant l’entre-deux-guerres, il y avait en Europe un pays où la “révolution de droite”, telle que l’a définie le sociologue allemand Hans Freyer (1887-1969), n’avait aucune chance de réussir, et même se dressait contre l’âme populaire, c’étaient bien les Pays-Bas! Ce pays tranquille de moulins et de cyclistes, de tulipes et de polders, appartenait indubitablement aux pays les plus stables du vieux continent. Cela n’implique pas que les divers défis, auxquels les démocraties libérales se voyaient confrontées, ne se manifestaient pas aux Pays-Bas. Bien au contraire! Il y avait simplement que la si célèbre “sobriété” néerlandaise (que nous pouvons désormais mettre en doute depuis les “Golden Sixties”...) générait un bourgeoisisme typique et induisait la population à réagir différemment du gros de celles des pays voisins.
Pourtant, la “révolution de droite” s’y est manifestée, notamment avec le NSB (“Nationaal-Socialistische Beweging” ou “Mouvement national-socialiste”) de l’ingénieur Antoon Mussert (1894-1946), qui est le mouvement de loin le plus connu à l’étranger. Ce qui fait la caractèristique unique des Pays-Bas, dans l’univers des fascismes ou para-fascismes d’avant 1940, c’est qu’à côté de ce parti fort structuré qu’était le NSB, il y avait là-bas encore au moins quarante petites formations fascisantes en activité, dont l’idéologie s’inspirait davantage des régimes autoritaires circum-méditerranéens que du “grand frère” allemand. Cette mosaïque politique nous donne l’impression d’une complication extrême, où règnent le chaos, l’incompétence et la dissolution, les querelles et les suspicions, si bien qu’aucune force politique ne s’est jamais dégagée d’elle. Il semble que seuls les éléments négatifs unissaient les hommes: les Pays-Bas déclinent parce qu’ils n’ont aucun réflexe national et ne veulent pas vraiment se débarrasser d’une démocratie corrompue. Si l’on examine ce conglomérat de petits partis et groupuscules, on tire la conclusion suivante: leur préoccupation principale était de concevoir des uniformes rutilants pour leurs diverses milices. Ils brûlaient aussi littéralement leurs fonds en publiant des revues ineptes. Wim Zaal notait non sans ironie et à juste titre: “Mystique, discipline, unité, figure du chef, vie dangereuse, le regard vers le futur... on peut s’imaginer ce que devenaient ces ingrédients du fascisme quand ils tombaient aux mains des Néerlandais, avec leur héritage séculaire de querelles politiques et théologiques. Ce qui aurait dû devenir une tempête ne devint qu’un vague trouble dans autant de verres d’eau; chacun avait sa doctrine sublime, son interprétation personnelle et ses propres galons à son uniforme de combat, à la facture unique. Au cours des années, nous avons vu défiler aux Pays-Bas des fascistes intellectuels en chambre, des fascistes issus du vieux libéralisme, des fascistes prolétariens, des fascistes croyants, des fascistes qui se piquaient d’aristocratisme et des fascistes synthétiques (1). Le rideau s’était levé sur ce qui aurait dû déboucher sur un drame martial; ce ne fut qu’un vaudeville...
◊ 2. Les racines du fascisme néerlandais
Certains ont défini le fascisme comme un mouvement de “rancuneux”, ce qui n’est pas entièrement faux. Mais cette idée ne peut toutefois pas être généralisée. Pour le cas des Pays-Bas, elle ne convient pas du tout. Le pays était resté neutre pendant la première guerre mondiale et n’a donc pas connu, après la fin des hostilités, le problème insoluble d’une masse de chômeurs et d’anciens soldats inadaptés à la société civile, cultivant des aspirations révolutionnaires. Le Dr. Joosten, qui est l’historien qui a examiné le plus attentivement le phénomène du fascisme chez nos voisins du Nord, conclut ses investigations en disant que des forces bien différentes se tenaient autour du berceau de la “révolution de droite” aux Pays-Bas (2). L’historien néerlandais estime que ce sont surtout des idéaux réactionnaires, conservateurs, intégristes, etc. qui ont alimenté le fascisme local. Il oublie cependant l’influence d’un leader socialiste, Troelstra (1860-1930), qui avait appelé à la révolution en 1918, une révolution qui échoua, parce que la base l’avait laissé tombé, par manque d’élan révolutionnaire, par petit-bourgeoisisme ou, mieux, par les deux à la fois.
Si l’on veut donner un nom au père spirituel du fascisme néerlandais, alors, généralement, on désigne, pour ce titre, un philosophe, professeur d’université, G. J. P. J. Bolland (1854-1922), une figure très particulière de la pensée, qui a commencé comme autodidacte pour se frayer un chemin jusqu’aux plus hauts sommets du monde universitaire néerlandais. Il estimait que la “raison pure”, corrigée par Hegel, ne s’était incarnée que dans son seul cerveau. Il s’opposait avec vigueur à la démocratie et au socialisme, parce que ces deux forces politiques ne visaient qu’à hisser les “masses de travailleurs stupides” au pouvoir. Dans les tissus d’injures qu’il débitait à l’adresses de la “juiverie” et de la franc-maçonnerie, il nous rappelle les ntionaux-socialistes ultérieurs. Pourtant, il me paraît impossible de le décrire et de le stigmatiser comme un fasciste sans plus; il était beaucoup trop réactionnaire pour mériter ce titre, beaucoup trop conservateur et bien trop peu révolutionnaire. Mais ses professions de foi hégéliennes et son anti-sémitisme ont inspirés une jeune génération d’adeptes, dont H. A. Sinclair de Rochemont (1901-1942), qui allaient plus tard se retrouver au sein du VVA (“Verbond van Actualisten” ou “Alliance actualiste”), qui fut, grosso modo, la première tentative de concentrer les forces fascistes aux Pays-Bas.
Autre foyer de mécontentement, qui allait tendre ultérieurement vers le fascisme: la loi électorale de 1894, qui effrayait certains libéraux, qui, en 1907, créent le “Bond van Vrije Liberalen” ou “Ligue des Libéraux Libres”, pour se donner une structure. De ce milieu se dégage un homme, qui fut à la fois journaliste et professeur d’université en sciences politiques, le Prof. J. H. Valckenier-Kips (1862-1942). Pendant toute une période, il fut l’étudiant de Bolland mais infléchit le futur fascisme néerlandais vers des positions idéologiques plus solides, permettant de parler véritablement de “pères fondateurs”. Pendant la première guerre mondiale, Valckenier était déjà pro-allemand et antisémite (ce qui n’était nullement une rareté dans les Pays-Bas de l’époque) mais, en plus, il se posait comme un “anti-démocrate” virulent. Le corpus d’idées qu’il défendait, allait plus loin et était bien plus vaste que celui de ses amis du départ, qui, pour l’essentiel, n’étaient que des libéraux braqués, devenus anxieux devant l’évolution de la société. Dans la revue conservatrice “De Tijdspiegel” (= “Le miroir du temps”), il esquissait, entre 1910 et 1918, l’idée d’un Etat organique, où l’individu devait être soumis au tout, sujet sur lequel il revenait sans cesse, en l’abordant de mutliples façons. Après la première guerre mondiale, il s’est quelque peu éclipsé, a quitté les feux de la rampe, pour revenir à l’avant-plan au début des années 30, d’abord dans les rangs du NSB, ensuite dans ceux du “Zwart Front” (= “Front Noir”) d’Arnold Meijer.
Mais celui qui tint véritablement le fascisme néerlandais sur les fonds baptismaux fut sans contexte le Dr. Emile Verviers (1886-?), un enseignant libre en sciences économiques à Leiden, lui aussi ancien étudiant de Bolland. Il était issu d’une famille catholique-romaine, mais cette famille politico-religieuse ne rencontrait pas son approbation, car elle s’était montrée trop paternaliste devant le danger de révolution rouge en 1918. Bien qu’il ait défendu, dans les colonnes de sa revue, “Katholieke Staatkunde” (= “Politique catholique”), des idées qui correspondaient pleinement à celles de l’aile conservatrice du “Rooms-Katholieke Staatspartij” (= “Parti Etatiste Catholique-Romain”), Verviers évolua graduellement vers l’idée d’un Etat fortement anti-démocratique et autoritaire, pour l’avènement duquel il préconisait de plus en plus souvent l’usage de la violence. Après la Marche sur Rome de Mussolini, il déclara —ce qui n’était nullement injustifié— que les Italiens suivaient ainsi une voie qu’il avait théorisée depuis plus de dix ans. Mais Verviers n’est jamais devenu un Duce néerlandais. Il n’avait pas d’adeptes, ce qui est dû, principalement, à son désir insatiable de controverses. Pourtant, ses théories n’ont pas été sans influence. Le jeune Mussert a sans doute suivi les leçons du Prof. Verviers. Celui-ci, à qui on peut sûrement reproché des tentations intégralistes, se mit à avoir de réelles difficultés avec la hiérarchie catholique de l’évêché du Brabant à partir de 1924, ce qui entraîna sa quasi disparition pendant des années. Ce n’est qu’en 1934 qu’il réémergera, devenant rédacteur-en-chef d’une revue du NSB, le mensuel “Nieuw Nederland” (“Les Pays-Bas nouveaux”). Deux années plus tard, il disparait à nouveau, quitte l’avant-plan, bien entendu après une querelle.
D’après les informations que nous avons glanées et reproduites dans la première partie de cet article, on pourrait en déduire que la “révolution de droite” aux Pays-Bas a été essentiellement l’apanage de fascistes intellectuels, de théoriciens en chambre. On remarquera dès lors que ce milieu, aux Pays-Bas, n’a pas apporté grand chose de substantiel au corpus idéologique du fascisme européen. Dans la plupart des cas, on s’est borné à emprunter aux voisins, d’abord en Italie, ensuite en Allemagne et plus tard en Flandre. Ce milieu fascisant néerlandais est donccaractérisé par une effarante absence d’inventivité, sauf si nous nous penchons sur une figure originale et unique, celle d’Erich Wichman.
◊ 3. Un vitaliste délirant !
Pol Vandromme a remarqué un jour : “Brasillach n’était pas amoureux du fascisme, mais de la poésie fasciste” (3). On peut formuler une remarque semblable à propos d’Erich Wichman, le “premier des fascistes néerlandais”, simultanément “alcoolique de principe”, comme il le disait de lui-même, lui, le”gangmaker” et la “prima donna” de la “révolution de droite”, couleur locale; disons que, chez lui, l’admiration pour l’élan fasciste vers l’action primait. Dans leur appréciation du fait fasciste, on peut tracer plus d’un parallèle entre Brasillach et Wichman: tous deux aiment l’aventure, la camaraderie, l’expression de la volonté vitale, la jeunesse. Tout comme chez Brasillach, le fascisme n’était pas davantage, chez Wichman, un programme politique, mais, écrivait-il, “une atmosphère, un ton, un rythme des sentiments, une mentalité, une attitude devant la vie; c’est briser en mille miettes les certitudes qui ont perdu tout sens, toute vitalité, c’est rendre toutes choses fluides, c’est tout recommencer à nouveau, c’est la jeunesse” (4).
Wichman n’a jamais, par exemple, pris au sérieux la forme de l’Etat corporatif; en fin de compte, il ne croyait en aucun système et le fascisme réellement existant, tel qu’il était vécu en Italie, ne lui convenait pas: “Pas un seul cheveu de mon crâne, qui devient chauve, ne songe à transplanter aux Pays-Bas le fascisme italien, tel qu’il est aujourd’hui, tel qu’il a été et tel qu’il deviendra, sans y apporter des changements” (5).
La vie d’Erich Wichman est tout, sauf une vie sans tache, est une suite ininterrompue d’actions tapageuses et d’incidents provoqués; elle est un vaudeville comique, elle révèle tous les aspects d’un drame de Sophocle. Erich Wichmann (ce n’est qu’au cours de son existence qu’il abandonna le dernier “n” de son patronyme pour lui donner un air plus néerlandais), est né le 11 août 1890 à Utrecht, une ville qu’il a toujours haïe, à cause de son petit bourgeoisisme grégaire. Sa famille était originaire d’Allemagne du Nord. Sa mère, Johanna Zeise, était issue d’une famille fortunée d’inventeurs et de pharmaciens, où l’on trouvait souvent un attrait pour la littérature. Son père, Arthur Wichmann, était professeur à l’université d’Utrecht. C’était un homme pragmatique, un géologue et un vulcanologue respecté, connu pour ses voyages outre-mer.
Ses parents lui ont légué l’intelligence, ses prédispositions pour les arts et les sciences, mais aussi ce goût de l’aventure, qui prit, plus tard, des proportions effrayantes. A peine âgé de onze ans, il perdit un oeil après une intervention chirurgicale rendue nécessaire par la présence d’un glaucome à l’oeil droit. Cette opération l’a défiguré, rendu extrêmement laid, ce qui ne l’empêcha pas de devenir plus tard un fameux bourreau des coeurs. Enfant, il utilisait son handicap pour donner libre cours à son originalité: il jetait son oeil de verre dans la piscine municipale en criant “un p’tit doublon pour celui qui le repêche!” [ndt: un doublon correspond ici à dix cents néerlandais].
Wichman disposait donc d’une intelligence phénoménale, couplée à une maturité précoce et exceptionnelle. Dès l’âge d’environ dix ans, tous s’accordait à considérer qu’il était une sorte d’enfant prodige, qui ferait parler de lui plus tard. Cependant, à l’école, il ne faisait pas grand chose de bon. Il n’étudiait qu’exceptionnellement, mais, en même temps, semblait disposer d’une inspiration inépuisable pour agacer ses condisciples et ses professeurs. Un jour, il se présente à l’école, muni d’un revolver chargé (plus tard il disait de lui-même: “Est-ce que je ressemble à un type qui circulerait avec un revolver non chargé?”). Cet incident fit qu’il fut renvoyé de l’école (6). Après en avoir fréquenté une série d’autres, où son comportement très rebelle lui créa toute sortes d’embûches, il aboutit dans un pensionnat très sévère en Thuringe. Mais là aussi, étudier sérieusement était le cadet de ses soucis, car il avait bien sûr d’autres préoccupations: il découvrait Nietzsche et Baudelaire (la lecture de ce poète français le conduisit à expérimenter toutes sortes de drogues). A cette époque, il eut une seule fois l’occasion d’écrire une petite contribution pour le célèbre hebdomadaire satirique allemand, le “Simplicissimus”.
En 1909, il arrête les frais dans son pensionnat allemand et s’en va étudier la biologie et la chimie à Utrecht. Il y étonne par son érudition. Un jour, quelqu’un s’adressa à son père pour lui dire: “Votre fils est si exceptionnel qu’il pourrait réussir dans n’importe quelle faculté”. Avec les deux pieds bien sur terre, le père Wichman répondit laconiquement : “J’aimerais qu’il soit un peu moins exceptionnel et qu’il réussisse au moins dans une seule faculté”. En effet, l’objectif d’Erich Wichman n’était pas d’obtenir des diplômes, car il n’en n’eut jamais aucun, mais d’accumuler le maximum de savoir en tous domaines. Au lieu de potasser ses cours, il peignait ou écrivait des poèmes et, au moment de passer ses examens, sa mémoiure extraordinaire lui venait en aide. Il eut ainsi un jour l’idée d’apprendre par coeur le volumineux cycle de “Mathilde” de J. Perk, uniquement pour prouver que l’art poétique de cet auteur lui plaisait!
Il était surtout une star dans la vie nocturne des étudiants. Dans les cercles de fêtards, il mit au point ses premières aspirations politiques et artistiques. A partir de 1912, il commença à s’adonner corps et âme à l’art pictural. L’expressionnisme allemand —il correspondait avec Kadinsky— et le futurisme italien suscitaient son intérêt, ce qui eu pour résultat de le faire écrire quelques articles sur l’art moderne dans les revues étudiantes.
En 1914, Wichman déménage et se fixe à Amsterdam, où il est rapidement accepté dans la bohème locale, très turbulente. C’est là qu’il devint cet “alcoolique de principe”, car, disait-il, “l’alcool est justement le contre-poison naturel contre la hollandite” (7). Ce type de déclarations témoigne de l’intense rapport amour/haine que Wichman cultivait envers son pays natal, une attitude qui lui était caractéristique. Wichman aimait la Hollande, mais à sa manière: pour lui, elle était trop petite d’esprit, trop égocentrique, trop axée sur elle-même; il en haïssait la “stopverfmentaliteit”, la “mentalité-mastic”, qu’il repérait partout. “Qu’elle s’assèche la main, qui voudra ériger ma statue plus tard en Hollande”, avait-il coutume de dire!
Wichman se plaisait énormément à Amsterdam, même s’il ne fut pas capable d’y prendre racine, vu sa nature de bohème et de juif errant. Des nuits entières, il faisait la fête avec ses copains, et, le jour, il s’adonnait comme un possédé à ses oeuvres d’art. Le temps qu’il lui restait, il l’employait à mettre la ville sens dessus dessous, avec ses amis. En plus, il se querellait avec tous les critiques d’art et l’on sait, avec certitude, qu’il en prit un jour un par le col pour le secouer. La victime eut le nez en sang, sans doute pour la première fois, et Wichman essuya sa première condamnation.
Wichman aurait aimé servir sa patrie pendant la première guerre mondiale, mais la disparition de son oeil droit l’empêcha d’être mobilisé. Libéré de ses obligations, il put consacrer tout son temps à d’autres initiatives. Dès mars 1916, il fonde avec son ami Louis Saalborn la société “De Anderen” [= “Les Autres”], une association d’artistes plastiques dont l’objectif principal était de défendre les intérêts professionnels et sociaux des artistes modernes. Du point de vue politique, cette association représentait une brochette de radicaux, de nihilistes, de communistes, de futuristes et surtout d’anarchistes. Wichman, qui publia bon nombre de brochures auprès des éditions de “De Anderen”, a reçu là le virus de l’anarchisme, dont il n’a jamais pu se débarrasser ultérieurement.
Sur le plan financier, sa situation était devenue très précaire. Il a connu des temps fort durs, il a souffert de la faim, surtout après que son père ait cessé de lui verser une somme mensuelle, pour son entretien. Qu’importe: Wichman s’est montré un virtuose dans l’art de faire des dettes. Il l’exprima un jour en vers:
“Tot tranen toe ben ik bekommerd,
nu kan ik nooit meer naar de lommerd,
omdat mijn hele inventaris
al daar is”. [“J’ai souci jusqu’aux larmes, car au mont-de-piété jamais ne pourrai plus aller, car là-bas se trouve d’ores et déjà tout mon inventaire”].
Pour échapper à ses créanciers, Wichman imaginait les idées les plus folles. Des années plus tard, il installa près de son logis, proche du “Molenpad” à Amsterdam, une série de flèches indicatrices, sur lesquelles étaient inscrits les mots suivants : “Chez Erich Wichman”. Malheur à ceux qui suivaient le chemin indiqué par l’artiste! Après tout un trajet, où il s’agissait de gravir des escaliers, puis de les redescendre, le candidat visiteur, exténué, se retrouvait à son point de départ. En 1924, après avoir brûlé la chandelle par les deux bouts, après avoir bamboché des nuits entières, après avoir souffert de la faim, Wichman craque physiquement, pour la première fois. Il s’effondre et on l’envoie à l’hôpital, avec, pour mention, “danger: suicidaire”. Il réagit avec cynisme: “C’est très grave n’est-ce pas? Mais crever de faim ne les émeut pas!” (8).
En septembre 1916, il épouse Leni Kampfraath, une tailleuse de diamant, avec laquelle il vivait depuis un certain temps. La légende affirme qu’Erich Wichman, qui avait été jusque là un fameux coureur de jupons, est resté fidèle après son mariage... à sa femme et à sa maîtresse... Le couple a rapidement un enfant, ce qui oblige Wichman à trouver un emploi stable: il devient d’abord chef émailleur dans une fabrique d’argenterie à Utrecht, ensuite concepteur et réalisateur de nacelles en béton insubmersibles. Dans le cadre de ce travail, il tentera en vain d’attirer l’attention d’une firme américaine!
En 1919, Wichman met en émoi la bourse du diamant à Amsterdam, en vociférant en public que la “démocratie est un mensonge”et en tentant d’expliquer “à un troupeau de deux mille ânes huant et sifflant” qu’il vaut mieux lire Goethe, son auteur favori, que d’aller voter (9). Un an auparavant, il avait écopé de trois jours de prison, parce qu’il avait circulé dans la ville en portant un écriteau sur le ventre, sur lequel il était inscrit: “Ne votez pas, lisez Goethe!”. Il incitait ainsi les Néerlandais à faire une “révolution aristocratique”.
Autre déception de grande envergure: l’échec de l’exposition et du livre, tous deux intitulés “Erich Wichman tot 1920” [= “Erich Wichman jusqu’en 1920”]. Toutes les réactions avaient été négatives, bien que le grand médiéviste et philosophe Huizinga (1872-1945) ne s’était exprimé qu’en termes critiques couverts. Le seul homme qui réagit avec un enthousiasme sans partage fut le poète expressionniste Hendrik Marsman (1899-1940), qui apporta plus tard son propre concours à certaines actions politiques.
Le coup qui fit entrer Wichman dans la légende, fut la création du “Rapaille-Partij”, du “Parti de la Canaille”. La raison qui a motivé la création de cette étonnante formation politique fut, pour être bref, le fait que les Néerlandais étaient obligé de voter sous peine de poursuites judiciaires. Cette loi était impopulaire, surtout parce que beaucoup de Néerlandais la considéraient comme coercitive. Wichman et sa bande pensaient, en revanche, que l’électeur n’était tout simplement pas capable, par définition, de choisir le moindre candidat convenable. Le 28 avril 1921, des élections municipales ont lieu à Amsterdam et la bande à Wichman saisit l’occasion pour se moquer ouvertement du système démocratique. Au départ, l’idée émanait d’un groupe d’ouvriers bateliers anarchistes, que l’on appelait les “Veelbelovers” [= “ceux qui promettent beaucoup”]. Il n’a pas fallu longtemps pour que Wichman en tire toutes les ficelles. Dans une taverne bien connue, l’”Uilenkelder”[= “La cave aux hiboux”] et dans son propre logis, le long du “Prinsengracht” [= “Le Canal des Princes”] à Amsterdam, Wichman et ses sympathisants de “De Anderen” préparèrent l’émergence d’un parti anti-tout, qui allait faire fureur (10).
Le programme du parti n’avait guère de contenu, mis à part la plantation d’arbres pour remplacer les urinoirs publics qu’il convenait de démolir, le petit verre de genièvre à cinq cents et le droit de pêcher et de chasser dans le Parc Vondel. Seuls étaient retenus les candidats qui souligneraient encore davantage le ridicule de l’entreprise. Le premier d’entre eux fut Cornelis de Gelder, alias “Had-je-me-maar” [= “Si-tu-pouvais-m’attraper”]. Ce surnom bizarre rappelait une chansonette des kermesses hollandaises. Cornelis de Gelder était un ivrogne notoire, un “idiot professionnel”, qui gagnait sa croûte en déambulant le long des terrasses des cafés de la Place Rembrandt, armé d’un lourd bâton et muni d’une boîte à cigares déguisée en instrument de musique, à l’aide de quelques cordes tendues. A certains moments, il frappait la boîte de son bâton, faisait l’idiot et terminait immanquablement ce qu’il estimait être une représentation culturelle de haut vol par le cri “Had-je-me-maar”. On raconte que ce hère original, quand il était à jeun, faisait bonne impression, était fort aimable, mais finalement peu se souviennent de lui. Le deuxième candidat était aussi un spécimen très original: Bertus Zuurbier (1880-1962), un monomane mi-anarchiste mi-bolchevique, qui avait longtemps travaillé comme ouvrier batelier, puis était devenu rinceur de bouteilles, mais demeurait surtout un chômeur permanent. Il errait ainsi dans la vie, vendant pendant toute l’année des numéros souvent fort anciens de “De vrije Socialist” [= “Le Socialiste libre”]. Quand on lui faisait remarquer que ces numéros dataient, il répondait: “Vieux, dis-tu? Mais pour toi, tout cela est bien nouveau, vilain bourgeois!”. Lorsque la Reine Wilhelmina participa au lancement d’un sous-marin de la flotte néerlandaise et plongea avec lui, Zuurbier circulait dans la ville, vendant un journal de son cru en criant : “Lisez ici combien bas a sombré Sa Majesté!”. A plusieurs reprises, il fut condamné pour trouble à l’ordre public.
Le public attendait le résultat de ces élections avec impatience, surtout que tous les partis avaient fait campagne contre le “Groep van Gelder” [= “Le Groupe de Gelder”]. Le “Kristelijk Historisch Dagblad” [= “Le Quotidien historique chrétien”] s’est voulu original et vexant tout à la fois en proposant d’appeler la nouvelle formation le “Rapaille-Partij”. Wichman accepta avec gratitude ce qui était censé être une insulte: “Exactement comme vous avez jadis repris à votre compte l’injure de “Gueux” et en avez fait un titre de gloire, nous acceptons, nous, ce nom que vous nous donnez comme une distinction honorifique”. Pour faire connaître leurs idées et leur programme à l’homme de la rue, le groupe disposait d’une revue, “De Raad” [= “Le Conseil”], qui paraissait affublé du slogan: “Gardez cette feuille, plus tard elle vaudra de l’argent”!
Le “Rapaille-Partij” fit force propagande et, rappelons-le aussi, les candidats ne furent pas en reste : Zuurbier maudissait dans ses colportages la démocratie, le suffrage universel et demandait à ceux qui l’écoutaient de voter pour lui, parce que, lui au moins, allait pouvoir bien utiliser l’argent de ses honoraires de conseiller. “Had-je-me-maar”, pour sa part, se fit photographier assis devant une table pleine de bouteilles et de verres vides, le cruchon de genièvre bien en évidence dans la main, chantant à pleine poitrine les chansons qu’il avait lui-même composées.
Wichman et ses amis voulaient démontrer que la démocratie conduisait à l’absurdité. L’entreprise était considérée comme une protestation bouffonne —quasi dadaïste— mais elle se mua en réalité bien tangible, dans la mesure où, après dépouillement des bulletins de vote, il s’avèra que 14.246 citoyens avaient voté pour les deux clochards, qui, du coup, étaient devenus des élus du peuple!
“Had-je-me-maar” posa immédiatement problème. L’hebdomadaire “Het Leven” avait mis une limousime à sa disposition après les élections. Il en profita pour se faire conduire en état d’ébriété dans toute la ville, ce qui ligua l’ensemble du collège municipal contre lui. Celui-ci décida de faire arrêter dès que possible le bambocheur, qui, à cause d’une condamnation précédente avait perdu son droit de vote. Motif: ivresse sur la voie publique. Wichman était au courant de ce projet et décida de fournir à l’ivrogne quelques gardes du corps, pour l’empêcher de faire sa tournée des bistrots. Ce dont il n’avait nulle envie. Notre fêtard roula donc ces gardes du corps dans la farine: “Had-je-me-maar” se plaignit d’avoir une soif terrible et amena sa garde prétorienne au bistrot pour s’envoyer un petit rafraichissement dans le gosier. La suite est facile à deviner : le soifard professionnel saoûla copieusement ses gardes, qui roulèrent sous les tables. Il en profita pour s’éclipser et visiter d’autres lieux. Il n’alla pas loin. La police l’arrêta et le força à signer une déclaration dans laquelle il renonçait à son poste de conseiller municipal.
Quant à Bertus Zuurbier, il s’intéressait surtout à l’argent qu’il pouvait tirer de son modeste poste et ne manquait jamais une séance du conseil. L’homme avait des talents déclamatoires avérés, mais il n’en fit pas souvent usage dans le cadre du conseil. D’après des témoins, sa seule intervention fut celle-ci: “Fermez la fenêtre car il y a un courant d’air”. Quand on lui reprocha un jour son silence, il répondit que les temps étaient durs et qu’on ne devait pas exiger de lui de prononcer de longs discours pour les cinq florins de cachet qu’il touchait.
Le résultat final de toute cette aventure fut vraiment très minime. Les autorités votèrent une petite loi, à la vitesse éclair, destinée à empêcher ultérieurement que des initiatives dans le genre du “Rapaille-Partij” participent aux élections. Wichman, qui voulait en ultime instance autre chose qu’éveiller l’appétence des Amstellodamois pour le rire et la moquerie, était très déçu. Il partit pour l’Allemagne, où, selon certaines sources, il étudia la physique nucléaire à Munich. Il se rendit ensuite en Italie, où il fit connaissance avec le fascisme et noua vraisemblablement des contacts avec le futuriste Marinetti. Sans doute découvrit-il dans le fascisme ce qu’il cherchait depuis longtemps: “Je ne me suis pas trompé, c’était ce dont j’avais besoin: être plus proche des animaux et en même temps plus proche des dieux et, à travers tout cela, la florissante luxuriance d’un pays bien gouverné. Oui, l’ami, c’était là l’oeuvre de l’homme fort” (11).
Sa situation financière demeurait précaire. Pour y remédier, il accepta un modeste poste de traducteur au consulat des Pays-Bas à Milan. Il y rencontra le prêtre et moraliste néerlandais Wouter Lutkie (1887-1968), qui jouera plus tard un rôle de premier plan dans le mouvement fasciste néerlandais, que Wichman décrit comme suit : “Son oeil unique, largement écarquillé, nous regardait fixement. Il était vêtu d’une chemise de sport, d’un veston et d’un pantalon. Sa chemise était grande ouverte, dévoilant son torse nu. Le pantalon était large, avait la forme d’un entonnoir, comme ceux des marins; il marchait sur le bas de ses pantalons qui s’effilochaient. Il y avait une ouverture dans sa manche droite, par où passait un coude. Il avait l’air d’un vagabond”. (12).
Vers la moitié de l’année 1924, Wichman revient au pays natal, ses valises pleines à craquer de chianti, de macaroni, de spaghetti et de ravioli (13). Dans la revue “Katholieke Staatkunde” du Dr. Verviers venait de paraître un appel “aux hommes du Rapaille-Partij”. Wichman y répond par la voie d’une lettre ouverte, qu’on peut désormais “disposer de sa personne, de sa plume et de son pinceau et, s’il le faut, sans phrase, de ses poings et de sa vie” (14). Cette lettre, au ton résolument martial, montre qu’il est dévoré par le feu révolutionnaire et qu’il n’hésiterait pas à passer à l’acte terroriste: “Je ne ferai pas de dégâts pour moins de cinq millions : ce n’est pas pour rien que je suis chimiste. Ils en auront une bonne avec moi! Et alors j’irai en prison pour bien bouffer à leurs frais!” (15).
Dans une collection de brochures bien connues à l’époque, intitulée “Pro en Contra” [= “Le Pour et le Contre”], Wichman fait paraître “Het fascisme in Nederland” [= “Le fascisme aux Pays-Bas”], où il polémique contre Henk Eikeboom, un ancien collaborateur du “Rapaille-Partij”: “Il n’y a plus de place en ce monde”, écrit-il, “pour l’aventure, l’imprévu, l’élasticité, la fantaisie et la ‘démonie”. Seule a droit au chapitre la raison la plus stupide. Dieu s’est mis à vivre tranquille” (16).
Il se fit ensuite membre du “Verbond van Actualisten”, une ligue que nous avons déjà citée ici, mais qui faisait de l’oeil au système démocratique et cultivait un pacifisme de principe, deux démarches qui lui déplaisaient. Pour répondre à ces lacunes, Wichman fonde alors le “Bond van Rebelsche Patriotten in een Ondergaand Volk” [= “Ligue des patriotes rebelles au sein d’un peuple en déclin”]. Dans une “lettre ouverte à S. M. Albert, Roi des Belges” [“Open brief aan Z. M. Albert, Koning der Belgen”], il remarque que les Pays-Bas pourraient parfaitement être annexés tout de suite à la Belgique, vu les réactions molles des Néerlandais vis-à-vis de certaines revendications territoriales belges. Cette lettre, empreinte d’ironie grinçante, a quasiment été le seul fait d’arme de ces “patriotes rebelles”. Wichman rédige ensuite un pamphlet anti-communiste, intitulé “Lenin stinkt” [= “Lénine pue”, ce qui signifie aussi “Lénine est corrompu”], qui critique surtout le culte de la personnalité qui s’est instauré autour du leader bolchevique. Cette critique est sans concession. Elle paraît à la fin de l’année 1924.
Apparemment, Wichman ne supportait plus, une fois de plus, sa patrie et, au début janvier 1926, on le retrouve à Paris, où il a failli crever de faim. Il passa le plus clair de son temps à étudier, dans les bibliothèques de la ville, les ouvrages qui traitaient de la vie des ascètes chrétiens et des saints mendiants, dans l’intention de rédiger un petit ouvrage, qu’il voulait d’abord intituler “De Kunst van het Armoedzaaien” [= “De l’art de répandre la pauvreté”]. Plus tard, il débaptise ce manuscrit et l’appelle “Verrekken – Een handleiding voor beginners en meer gevorderden” [= “Crever – Un vade-mecum pour débutants et pour ceux qui ont déjà fait des progrès”]. L’ouvrage est resté inachevé.
En 1927, il publie dans “De Vrije Bladen” [= “Feuilles libres”] un essai satirique très étonnant sur les habitudes de boire aux Pays-Bas. Titre de l’essai: “Het witte gevaar” [= “Le danger blanc”]. Nous avons affaire là à un écrit très peu conventionnel, où Wichman, qui, rappelons-le, est “un alcoolique de principe”, engage le combat contre les idéaux sociaux en faveur du lait et contre l’alcool, idéaux qui se manifestaient par des campagnes publicitaires dans tous les Pays-Bas, pour inciter les Néerlandais à boire du lait. Wichman: “Plus encore que pour l’absence de bouteille, ou s’il le faut, de carafe de vin rouge; plus que pour la présence de fleurs (Degas: “Les fleurs d’une table sont les bouteilles”), de la boîte ronde en fer blanc pleine de biscuits, du pot de confiture ou de sirop, du beurre de cacahuètes, de grains d’anis, de granulés, de pépites en chocolat et d’autres horreurs (brrr), la table d’un lunch hollandais est une chose si repoussante surtout à cause de ces récipiants blancs, en forme de quille renversée, faits de céramique, qui sont censés contenir un liquide trouble, une émulsion sale, oui sale, qui n’est rien d’autre qu’une sécretion de pis de vache (...). “Melk is goed voor elk” [= “le lait est bon pour chacun”, dit la publicité]. Cette phrase, qui ne compte que cinq petits mots contient:
◊1. Une faute de langue (grosse comme une vache),
◊2. Une manoeuvre , qui équivaut à un coassement, comme celle que tente le “Comité de défense contre la boisson” d’Amsterdam —quelles vaches!— [ndt: en français dans le texte] qui oeuvre en étroite coopération avec l’administration municipale pour tapisser nos voies publiques d’affiches telles “Niet drinken, niet schenken, een goede raad zou’k denken”, etc. [= “Ne trinque pas, ne verse pas, voilà le bon conseil, je crois”]. Mais tout cela n’est pas vrai, “bij de luier hoort de uier” (“pis et couche-culottes vont ensemble”), “zulke ezels praten voor kwezels” (“de tels ânes ne causent que pour les bigots”), “dat gekwek maakt iemand gek” (“ces coins-coins vous rendent fou”), je vais donc donner à ces messieurs une autre leçon: “cieder is goed voor ieder” (“le cidre est bon pour tous”), “wijn is goed voor de pijn” (“le vin est bon pour vos douleurs”), “rode is goed voor de noden” (“le gros rouge est bon pour vos misères”), “witte is goed voor de hitte” (“le blanc est bon pour la fièvre”), “oude is goed voor de koude” (“le vieux [genièvre] est bon contre le froid”) et “jonge is goed voor de longen” (“le jeune [genièvre] est bon pour les poumons”], “bieren zijn goed voor de nieren” (“les bières sont bonnes pour les reins”), “jenever is goed voor de lever” (“le genièvre est bon pour le foie”), “klare is je ware” (“le genièvre pur [le schiedam] est digne de toi”)!” (17).
En décembre 1927, eut lieu, en Hollande, un événement qui déterminera le reste de la vie de Wichman, et accélèrera aussi sa fin. C’est en effet l’année où paraît le premier numéro de “De Bezem” (“Le Balai”), qui fut vraiment la première revue fasciste “pur sang” des Pays-Bas. Wichman y apporte immédiatement sa collaboration, ainsi qu’au petit parti qui se constitue en marge de la publication. Il y fait paraître des articles et des dessins satiriques, dirige les réunions où l’on boit sec d’impressionnantes quantités de genièvre, organise des exercices de tir, de combat au gourdin et aux poings nus, afin de transformer les membres en une version locale des squadri fascistes italiens. A ce moment-là, Wichman cesse de travailler comme artiste. Il devient un agitateur, en dépit de sa santé qui ne cesse de décliner. Lorsque la radio libre de gauche, VARA, annonce le 20 avril, jour des “petits princes” en Hollande, qu’il organisera une fête du 1 mai, Wichman se rend dans ses locaux, accompagné de son “écuyer” Couveld, qui sera son camarade dans toutes ses folies, et qui se fera remarquer plus tard en tirant en l’air un coup de pistolet dans le théâtre Carré, qui faisait, ce jour-là, salle comble. Sans faire trop de façons, Wichman escalade le podium, s’empare du microphone et crie “Vive la Princesse Juliana”. Ensuite il débranche l’émetteur VARA, en le renversant. Dans la bagarre qui s’ensuivit, il eut le bras droit déboîté.
Un mois plus tard, Wichman provoque une nouvelle fois tumulte et sensation. Des annexionnistes belges venaient par bateau en rade de Hansweert pour jeter de petits drapeaux belges dans les eaux du Wielingen [bras de l’estuaire de l’Escaut, ndt], acte symbolique censé réclamer l’annexion à la Belgique de la Flandre zéelandaise. Les autorités néerlandaises n’entreprenaient rien pour contrer ces actions. Wichman décide alors de se rendre sur place avec trois ou quatre de ses équipes du “Bezem”. La Maréchaussée néerlandaise avait barricadé le port, si bien que les “Bezemers” devaient rester derrière la digue. Les Belges ne pouvaient donc pas voir leurs adversaires, mais ceux-ci firent un tintamarre de tous les diables, faisaient claquer fièrement leurs étendards orange tandis que Wichman tirait à qui mieux mieux des coups de pistolet, qu’ils s’imaginèrent qu’une masse impressionnante de contre-manifestants néerlandais se massait derrière la digue. Ils préférèrent faire demi-tour!
Il est symbolique de constater que la mort de Wichman est due à un vieil ennemi de la nation néerlandaise, une ennemi qu’elle n’a jamais cessé de combattre. En décembre 1928, Wichman devait prononcer une conférence devant une corporation étudiante de l’université d’Utrecht. Il se rend sur place et constate que ces auditeurs sont tous partis à Breukelen, pour aider la population en détresse à cause d’une digue qui était sur le point de se rompre. Sans hésiter, Wichman se porte à son tour volontaire, se rend sur place et y travaille toute la nuit pour conjurer le danger. Il y attrapa une méchante fièvre et comme sa santé était précaire, son corps n’a pu y résister et il est mort, inopinément, le matin du Nouvel An 1929 d’une pneumonie, peu de temps après avoir levé un verre de vin en l’honneur de l’an neuf... Trois jours plus tard, ces amis le portent à “son premier et dernier lieu de repos” (18), avec, sur le cercueil, le drapeau des “Princes”.
◊ 4. Conclusion:
L’itinéraire d’Erich Wichman est un exemple d’école pour nous dire comment il NE faut PAS faire de politique! Il était un individualiste accompli et donc incapable d’oeuvrer sérieusement en politique, pour quelqu’idéologie que ce soit. Nous avons déjà posé la question, mais indirectement: dans quelle mesure Wichman peut-il être considéré comme un “fasciste”? Il était depuis longtemps un “anti-démocrate”, avant qu’il ne devienne “fasciste”. Au lieu de lui coller l’étiquette, devenue infâmante, de “fasciste”, il conviendrait plutôt de le baptiser “anarcho-nationaliste” ou de l’étiqueter d’une façon différente mais similaire. Wichman était d’inspiration “grande-néerlandaise”. Il entretenait des contacts avec ce nationaliste flamand emblématique que fut le Dr. August Borms, ainsi qu’avec le poète expressioniste flamand, engagé dans le camp nationaliste, Wies Moens. Cees de Doodt remarqua un jour que le fascisme disparaissait de la scène aux Pays-Bas, chaque fois que Wichman partait à l’étranger. Cees de Doodt rend ainsi honneur, en quelque sorte, à cet homme inclassable, qui ne cessait de lutter contre tout. Bien que le NSB, plus tard, voulut revendiquer pour lui la mémoire de Wichman, nous pouvons poser la question: cet homme se serait-il senti à l’aise dans ses rangs? Car, au bout du compte, on peut dire qu’il ne se sentait nulle part chez lui...
Frank GOOVAERTS.
(Texte inédit de Frank Goovaerts, collaborateur de la revue nationaliste flamande “Dietsland-Europa”, assassiné par un voyou en septembre 1990. Sur cette figure poignante et fascinante du mouvement flamand, disparue trop tôt, lire “Adieu à Frank Goovaerts”, in “Vouloir”, n°73/75, printemps 1991).

 C’est une pure rêverie d’imaginer que les principes humanitaires qu’elle a pu proclamer lui seront appliqués: ses vainqueurs l’accableront avec le cri implacable Vae Victis [malheur aux vaincus]. Le couteau de la guillotine était aiguisé dans l’ombre quand, à la fin du dix-huitième siècle, les classes dirigeantes en France étaient occupées à développer leur «sensibilité».
C’est une pure rêverie d’imaginer que les principes humanitaires qu’elle a pu proclamer lui seront appliqués: ses vainqueurs l’accableront avec le cri implacable Vae Victis [malheur aux vaincus]. Le couteau de la guillotine était aiguisé dans l’ombre quand, à la fin du dix-huitième siècle, les classes dirigeantes en France étaient occupées à développer leur «sensibilité».




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg


 En 1968, le mariage de Röhl avec Ulrike Meinhof connaît l’échec. Chacun des époux tente de prendre le contrôle du journal. Röhl emporte le combat. Ulrike Meinhof entre dans la clandestinité et fonde, avec Baader, la « Fraction Armée Rouge ». Röhl condamne ce type de combat voué à l’échec, hystérique et sans fantaisie. En 1993, Röhl rédige un doctorat sous la houlette de l’historien Ernst Nolte, professeur à l’Université Libre de Berlin. Il défend son professeur, victime d’une vindicte de gauche et d’une campagne de presse hystérique lors de la fameuse « querelle des historiens », animée principalement par le philosophe Jürgen Habermas. Le sujet de sa thèse de doctorat est intéressant : « Nähe zum Gegner. Die Zusammenarbeit von Kommunisten und Nationalsozialisten beim Berliner BVG-Streik von 1932 » (= Proximité avec l’adversaire. La coopération des communistes et des nationaux socialistes lors de la grève des transports à Berlin en 1932). Après avoir brisé quelques lances pour l’honneur de Nolte, Röhl [photo 2] quitte alors le petit monde étriqué de la gauche allemande et rejoint le parti libéral, où il retrouve le juriste et constitutionaliste Alexander von Stahl, l’historien Rainer Zitelmann et le biographe d’Ernst Jünger, Heimo Schwilk, dans un cénacle critique, « Liberale Offensive », qui cherche à donner un tonus national au parti, comme en Autriche.
En 1968, le mariage de Röhl avec Ulrike Meinhof connaît l’échec. Chacun des époux tente de prendre le contrôle du journal. Röhl emporte le combat. Ulrike Meinhof entre dans la clandestinité et fonde, avec Baader, la « Fraction Armée Rouge ». Röhl condamne ce type de combat voué à l’échec, hystérique et sans fantaisie. En 1993, Röhl rédige un doctorat sous la houlette de l’historien Ernst Nolte, professeur à l’Université Libre de Berlin. Il défend son professeur, victime d’une vindicte de gauche et d’une campagne de presse hystérique lors de la fameuse « querelle des historiens », animée principalement par le philosophe Jürgen Habermas. Le sujet de sa thèse de doctorat est intéressant : « Nähe zum Gegner. Die Zusammenarbeit von Kommunisten und Nationalsozialisten beim Berliner BVG-Streik von 1932 » (= Proximité avec l’adversaire. La coopération des communistes et des nationaux socialistes lors de la grève des transports à Berlin en 1932). Après avoir brisé quelques lances pour l’honneur de Nolte, Röhl [photo 2] quitte alors le petit monde étriqué de la gauche allemande et rejoint le parti libéral, où il retrouve le juriste et constitutionaliste Alexander von Stahl, l’historien Rainer Zitelmann et le biographe d’Ernst Jünger, Heimo Schwilk, dans un cénacle critique, « Liberale Offensive », qui cherche à donner un tonus national au parti, comme en Autriche.












 Junges Forum Nr. 6: Evola von links! Metaphysisches Weltbild - Antibürgerlicher Geist
Junges Forum Nr. 6: Evola von links! Metaphysisches Weltbild - Antibürgerlicher Geist