Romain LABARCHEDE:
Les lignes de fracture du système
C'est un lieu commun rebattu : les idées mènent le monde. Cette explication simpliste mérite quelques précisions : quelques idées sont plus agissantes que d'autres, quant au plus grand nombre, elles ne mènent rien du tout, et souvent, elles mènent nulle part, tout au plus elles marginalisent quelques illuminés. Pourquoi telles idées ont mené le monde à une certaine période pour tomber dans l'oubli peu après ? Vérité d'hier se révèlera erreur aujourd'hui…
Réduites à elles-mêmes, les idées ne sont rien, ne produisent aucune action, si elles se répandent, se propagent, ce n'est pas de leur seul fait : elles doivent s'incarner. Plus simplement, tant qu'une idée, bonne ou mauvaise, ne trouve pas un corps pour la servir, elle demeure sans effet. D'où l'importance des hommes avec leurs qualités propres.
Que peuvent-ils, à leur tour, sans stratégie, sans tactique, sans mode opératoire, sans méthode et sans plan d'action ? Que peuvent-ils, même les plus courageux, s'ils ne tiennent qu'accessoirement compte des circonstances, des évènements, des forces en présence ?
La pertinence des idées, la qualité des hommes : des dirigeants et des exécutants, la lucidité des analyses, l'opportunité des méthodes et du plan d'action, tous ces éléments concourent à la réussite ou à l'échec des opérations. Aujourd'hui la météo idéologique est moins perturbée qu'à l'époque de la guerre froide, où le monde dit libre s'opposait au monde du prolétariat, les affrontements forts d'hier sont terminés puisque hors sujet.
Après l'implosion du modèle communiste, le libéralisme économico-politique n'a plus de concurrent idéologique, il est en situation de monopole. Serait-ce la fin des idéologies ? Bien évidemment non, il est facile de constater la convergence des deux courants hégémoniques dans un discours commun qui satisfait le plus grand nombre. Droite et gauche se sont recentrés, adoptant pour l'essentiel les mêmes objectifs avec des nuances quant aux moyens.
L'idéologie dominante repose sur deux principes :
-l'individualisme, l'individu est plus important que la communauté à laquelle il appartient.
-l'égalitarisme, tous les hommes sont égaux.
Ces principes de base peuvent se décliner en version plus ou moins forte ou plus ou moins douce, chacun accommodant à son goût. Cette idéologie dominante est instrumentalisée par la classe dirigeante pour asseoir son pouvoir et légitimer ses actions.
Au début des années 1750, Jean-Claude Vincent de Gournay, homme d'affaires et inspecteur des manufactures, était convaincu que le meilleur moyen de maximiser les ressources matérielles et humaines de la Nation était de : laisser-faire les hommes, laisser-passer les marchandises. Il ne visait alors que le domaine économique.
Aujourd'hui, c'est la règle générale qui prévaut dans tous les domaines : politique, social, religieux, culturel, familial, il est interdit d'interdire ! La déesse Permissivité fait perdre la tête et la raison aux élites. Dans notre antique mythologie , Jupiter ne fait-il pas perdre la raison à ceux dont il a juré la perte ?
I le système occidental
Ces précisions liminaires fournies, il convient d'appréhender le monde tel qu'il est, et non tel que l'on voudrait qu'il fût. Qu'est-ce que le système occidental?
Comme nous l'avons écrit dans Orientations pour un mouvement politique effectivement opérant, paragraphe les complotistes, nous ne croyons pas au complot mondial, obéissant à un mystérieux chef d'orchestre, ordonnant par relais hiérarchiques, l'application d'un plan établi et connu des seuls initiés. L'homme est un être social, (zoon politikon -Aristote) mais il est aussi un prédateur insatiable, (homo uomini lupus, l’homme est un loup à l’homme) ce qui le rend capable du meilleur comme du pire. La force essentielle du capitalisme, c'est qu'il satisfait toutes les pulsions et les besoins de l'homme ( de tous les hommes, bons ou mauvais ) sans qu'il y ait un quelconque accord sur une fin. Chacun trouvant son bonheur dans ce qui lui est agréable sur le moment.
Selon Tchakhotine, les quatre instincts primordiaux de l'homme sont : l'agressivité, l'intérêt matériel immédiat, la sexualité et le besoin de conformité-sécurité. Le système capitaliste satisfait simultanément ces quatre instincts, chacun prenant ce qui lui convient au moment désiré. Les jouisseurs s'épanouiront dans l'hédonisme, les prédateurs dans la concurrence, les profiteurs dans la spéculation, les grégaires dans la consommation, chacun pouvant à sa guise satisfaire un instinct, pour ensuite en satisfaire un autre ; le profiteur devient jouisseur puis prédateur etc…Retenons que dans la plupart des systèmes vivants, ce sont les prédateurs qui dominent et marquent les mutations de chaque système.
Oswald Spengler, dans son ouvrage le plus connu : le déclin de l'occident évoquait le vieillissement des cultures et des civilisations, mais le titre est regrettablement ambigu, car qu'observons-nous aujourd'hui, sinon l'hégémonie du monde occidental, du style de vie occidental ? Ce qui apparaît clairement, c'est le déclin du vieux continent Européen en tant qu'espace politico-culturel homogène, alors que le système occidental connaît une hégémonie quasi planétaire, jamais observée auparavant. Les nations Européennes sont aux ordres des Etats-Unis d'Amérique qui imposent et nourrissent leur domination :
- au moyen de la morale des droits de l'homme, excellent instrument d'intervention médiatique à géométrie variable,
- au moyen du droit d'ingérence en usant et abusant de la force militaire ( guerre du golfe, kosovo, Afghanistan…),
- au moyen de la logique du marché comme régulateur majeur : globalisation économique,
- au moyen de la diffusion planétaire d'une sous-culture de masse qui abrutit les cerveaux et amollit les consciences.
L'american way of life c'est la voie de la mort douce pour ceux qui n'ont pas la volonté de conserver leur identité.
L’Occident, bien que réalité planétaire, demeure un ensemble flou, recouvrant des réseaux, des espaces, des cultures, et des civilisations disparates. Il regroupe des sociétés diverses, organisées en cercles d’appartenance concentriques, ayant au centre un noyau dur qui alimente la périphérie : le modèle américain.
Dans « l’Occident comme déclin » paru en 1984, ed. du Labyrinthe, donc avant la chute du mur de Berlin et l’implosion du bloc soviétique, Guillaume Faye distinguait :
- des nations très occidentales : USA, Grande Bretagne, Europe du Nord,
- des nations moyennement occidentales : France, Italie, Espagne, Grèce,
- des nations en voie d’occidentalisation : Russie, pays de l’Est Européen,
- enfin des nations peu occidentales : Iran, Afghanistan.
A l’intérieur des pays dits en voie de développement, l’élite dirigeante, fortement occidentalisée, souvent coupée de sa culture originelle, est en rupture d’identité. Le peuple ne se reconnaît plus dans sa classe politique, les éléments les plus radicaux s’orientent vers des mouvements fondamentalistes. Dans un entretien accordé au quotidien Sud-Ouest, le 26.09.01, Mariam Abou Zahab, politologue qui enseigne l’histoire de l’Afghanistan et du Pakistan aux Langues Orientales à Paris, répond à la question : Pourquoi un tel décalage entre le gouvernement et l’opinion ?
« le fossé entre l’élite et la rue à propos de l’Amérique n’est pas neuf. Le Pakistan est totalement schizophrène : la bourgeoisie envoie ses enfants dans des universités américaines, la jeunesse singe le mode de vie yankee, et tous tiennent en même temps des propos violemment antiaméricains. Les gens ne sont pas conscients de cette contradiction. » Cette remarque pertinente convient à nombre de pays traditionnellement musulmans, avec tous les risques de dérives que nous savons.
L'Occident représente l'ouest, point cardinal du coucher de l'astre solaire. Pour Raymond Abellio, le modèle californien constitue l'essence et l'épicentre de l'Occident, ouest extrême, symbole d'une civilisation crépusculaire et vieillissante, où la lumière déclinante du jour fait place progressivement à l’obscurité de la nuit. L'astre renaissant, vainqueur des ténèbres, apparaîtra à nouveau par l'Orient, la lumière reviendra par l'Est.
La renaissance du Grand Continent Européen se réalisera en union avec les terres et nos frères de la Nouvelle Aurore.
II Géopolitique Anglo-saxonne
Jean-Gilles Malliarakis dans « Yalta et la naissance des blocs » éd. Albatros,1982, remarquable synthèse sur cet épisode historique, écrit : « Pour comprendre l’attitude de Churchill, on doit se reporter aux considérations fondamentales de la Grande Bretagne. Celle-ci disposait d’un empire aux dimensions de l’univers, un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Contrairement aux territoires rassemblés par la France , plus coûteux à féconder que profitables à exploiter, les colonies britanniques étaient essentiellement rentables. Le grand problème était évidemment de maintenir les liaisons entre Londres et Honk-Kong, la fameuse route des Indes passant par Gibraltar, Malte, Chypre, Suez et Aden. En Europe centrale et orientale, les intérêts anglais n’étaient pas considérables mais il fallait à tout prix empêcher les Russes d’accéder à la Méditerranée. Il suffisait dans la zone des Balkans de garder la Grèce et de neutraliser la Yougoslavie. Tout le reste pouvait bien passer sous contrôle soviétique, Winston Churchill n’en avait cure. » p.149.
Ces lignes sont lumineuses, outre les événements politiques postérieurs qui ont confirmé l’exactitude de l’analyse, l’essentiel est mis en évidence : en politique internationale, seuls les intérêts géopolitiques prévalent, l’idéologie est un ornement qui semble opérant aux naïfs, ou à ceux qui se suffisent d’explications sommaires.
Zbigniew Brzejinski, stratège américain dévoile au grand jour les intentions géopolitiques et géoéconomiques des USA, tant ils sont sûrs de leur puissance. Il établit un double constat :
- les USA sont la première puissance globale de l'histoire.
- comme la maîtrise du pouvoir planétaire se situe en Eurasie, il faut par tous les moyens empêcher l'émergence ou l'unification politico-économique de celle-ci.
Les USA, possèdent le statut de puissance impériale, hégémonique et mondiale. Ils doivent progresser pour durer. Le problème à résoudre consiste à conserver le plus longtemps, le statut d'unique puissance mondiale. (monde unipolaire) Se référant aux travaux des géopolitologues Anglais du début du siècle,(Halford John Mackinder, Homer Lea) Brzejinski redoute avant tout l'émergence d'une puissance continentale pleine et entière (Eurasie), de même qu'il redoute une puissance asiatique, chinoise ou japonaise.
Pour empêcher l'émergence de ce continent unifié, il faut simplement :
- théoriser l'élargissement de l'OTAN, en tant que bouclier face à l'hypothétique renaissance de l'hydre totalitaire.
- réaliser le new silk road land bridge ( pont terrestre sur la nouvelle route de la soie ) qui maîtrise toutes les grandes voies de communication au cœur du continent et les accès du Caucase ou du Moyen-Orient. Ainsi le cœur de l'Asie est neutralisé, sous tutelle des USA.
Ce projet de pont terrestre sur la nouvelle route de la soie permet de contenir la Russie comme le préconisait Mackinder en 1904, lors de l'inauguration du Transsibérien et en 1919, lors de la victoire des bolcheviques. Contenir la Russie et briser l'unité de l'Europe telles sont les préoccupations des stratèges Yankees.
Donc, il convient de créer une barrière d'Etats pour contenir la Russie loin des mers et de l'Océan Indien. Cette barrière débute à l'Ouest sur l'Adriatique, avec l'Albanie pour aboutir en Chine. Comme la route de la soie du temps de Marco Polo, elle relie les deux parties les plus peuplées de la masse continentale eurasienne. Pour ce faire les USA jouent à fond la carte turque et favorisent les aspirations hégémoniques d'Ankara, qui accorde la nationalité turque à tous les ressortissants de peuples turcophones de l'ex-URSS. En cas d'adhésion de la Turquie à l'UE, ces turcophones, munis d'un passeport turc, circuleront dans tous les pays d'Europe sans aucune difficulté. Il est malaisé d'évaluer ce flux migratoire, mais soyons certains qu'après un tel raz de marée ethnique, notre vieux continent, aura subi une lourde colonisation de peuplement..
L'émergence de l'idéologie pantouranienne dans la pensée politique turque, et chez les autres peuples turcophones : Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan, constitue une nouvelle donne qu'il faut analyser avec attention. Le pantouranisme, ou panturquisme, est une idéologie de type racialiste qui vise à l'unité de tous les peuples de souche turque ou turcophones, qui implique un projet géopolitique regroupant tous ces peuples de la mer Egée au Sinkiang chinois.
Cet espace politique islamo-turcophone constituerait une barrière homogène et étanche, dans l'intérêt de Washington, pour neutraliser la Russie et le continent Eurasien. Mais cette expansion, à l'est, n'est pas la seule possible pour Ankara, qui en jouant la carte néo-ottomane, espère un retour à l'ouest, dans les Balkans, ce qui, d'un point de vue Européen est inacceptable. A l’exception de quelques souverainistes Français attardés qui souhaitent ressusciter l'alliance de François I° avec le Sultan, afin de constituer un axe jacobin Paris-Ankara. Pour ces diverses raisons, les USA appuient de tout leur poids la Turquie et imposent son entrée au sein de l'UE.
Il y a convergence d'intérêt entre les USA et les Etats musulmans, turcophones ou islamistes, comme l'a établi avec sérieux et minutie, Alexandre del Valle, auteur de deux ouvrages richement documentés et solidement argumentés dont nous recommandons vivement la lecture : Islamisme et Etats-Unis : une alliance contre l'Europe. éd. l'Age d'homme, Guerres contre l'Europe : Bosnie, Kosovo, Tchétchénie. éd. des Syrtes.
III les lignes de fracture
Néanmoins le système n'est pas un mécanisme inusable, comme tout organisme vivant il présente des faiblesses, résultant de contradictions fortes entre le discours et la pratique que le peuple, les citoyens, peuvent à tout moment contester. Ces lignes de fracture sont les points faibles du système, cibles sur lesquelles doivent impérativement s'orienter nos actions.
Ce sont les seuls points par où le système peut être fragilisé. Encore faut-il établir une bonne stratégie, trouver les bonnes propositions, le bon mode opératoire et les bonnes actions qui susciteront un désir profond de changement au sein du corps social. Ne rien privilégier dans l’absolu, envisager tous les possibles en fonction des événements et des circonstances. Etudions les principales lignes de fracture que nous avons volontairement classé par ordre alphabétique, sans qu'il soit possible d'établir une hiérarchie ou une échelle d'importance, car à tout moment, l’imprévu, l’impensé, peut se produire, l’essentiel est d’être prêt à agir.
Fracture démocratique : crise de la représentation
Contradiction entre le discours de la classe dirigeante et les réalités vécues par le peuple. Les citoyens sont rarement consulté sur les questions qui les préoccupent directement. La représentation démocratique dérive en confiscation de la souveraineté. Les décisions prise par des bureaucrates ou des technocrates nommés ne respectent pas le principe de légitimité démocratique. Ce principe est également bafoué lorsqu'une conscience morale à prétention universelle impose sa volonté à une ou plusieurs Nations. Face à ces contradictions le citoyen finit par se désintéresser de la "chose publique" pour n'en retenir qu'une farce sordide.
La réforme du scrutin électoral de 1958 a accentué la dégradation de la conscience citoyenne, en renforçant la stabilité du pouvoir en place aux dépens de la démocratie réelle, c’est à dire la juste représentation de la volonté générale. Cette réforme dont le but était d’assurer une majorité stable, comme instrument de gouvernement, sans souci de représentation des réalités sociologiques ou politiques du pays, a profondément altéré la conscience citoyenne collective. Le fossé entre pays légal et pays réel s’est approfondi, la représentation parlementaire est discréditée, la politique est devenue logique de pouvoir et non service public de bien commun. L’Assemblée Nationale n’est plus l’expression la plus juste du corps électoral, son rôle se limite à dégager une majorité confortable au gouvernement en place. Le scrutin majoritaire à deux tours constitue une caricature de représentation nationale. La logique majoritaire a isolé, laminé, marginalisé les courants minoritaires ou les forces de proposition qui n’étaient pas inféodées à un mouvement majoritaire. Aucune évolution n’est envisageable, seule perspective : la sclérose…Nous sommes passés du système des partis (de tous sans exclusion) à celui « du » parti au pouvoir. Facétie imprévue venant des urnes, la cohabitation perturbe le doux ronronnement imaginé par le législateur. Décidément, les électeurs-citoyens sont incorrigibles, ils s’obstinent à mal voter…
Sous la Troisième et Quatrième Républiques existait un équilibre subtil entre différents modes de scrutin. D’une part les assemblées issues directement des urnes, au scrutin proportionnel, reflet exact des attentes, des critiques, des impatiences, des craintes, des velléités, des refus, des espoirs, voire des révoltes de tous les électeurs : l’Assemblée Nationale et les Conseils Municipaux. D’autre part, deux institutions élues, l’une au scrutin indirect, : le Sénat, l’autre au scrutin majoritaire : les Conseils Généraux.
Le système électoral actuel, reposant sur le scrutin majoritaire à deux tours génère une crise de la représentation dont nous mesurons les conséquences négatives : démobilisation, dépolitisation et abstentionnisme.
Fracture écologique : crise de la biosphère
Contradiction entre le développement productiviste et les nombreuses pollutions qu'il provoque. L'économie, lorsqu'elle n'est pas bridée par un pouvoir politique plein et entier, donne libre cour aux pires excès : c'est la démesure à tous les niveaux, dans tous les domaines. Les Grecs de l'Antiquité redoutaient cette hybris, démesure responsable des pires malheurs. Ceux qui prétendent faire de la défense de l'environnement leur activité politique première, abordent et débattent des enjeux écologiques avec une inefficacité notoire. Leur sectarisme, leur dogmatisme, leur purisme, leur rigorisme les rend particulièrement dangereux, dans la mesure où ils bloquent certains grands projets. La satanisation de l’énergie électronucléaire illustre le comportement obsessionnel de cette mouvance. Pour une fois qu’un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EDF) remplit sa mission, les intégristes Verts, inquisiteurs de la nature foncièrement bonne, vestales de la pureté originelle difficile à conserver (sécularisation du dogme virginal ?) n‘ont qu’un objectif majeur : la suppression progressive de cette source d’énergie : la plus économique, la moins polluante, qui assure de plus notre indépendance énergétique face aux transnationales pétrolières. Ces dernières souhaitent conserver leur hégémonie par la consommation croissante des seules énergies fossiles. Elles combattent par tous les moyens l’émergence d’une énergie alternative respectant les enjeux écologiques tout en permettant la puissance. Souvenons-nous des ouvrages du regretté Pierre Fontaine qui avait établi les pratiques maffieuses des grandes compagnies pétrolières.
Fracture économico-sociale : rupture du lien social, crise de confiance
Contradiction entre le bien-être de certains et l'horreur économique supportée par d'autres. Le but premier de l'économie est de satisfaire les besoins, alors que pour le capitalisme, c'est la poursuite illimitée du profit qui active le cercle vicieux du productivisme, produire plus pour consommer plus, consommer davantage pour produire davantage. Spirale infernale de l'économie de croissance et du tout-marché, à qui nous opposons une économie de puissance avec marché, ce dernier jouant son rôle régulateur dans le seul espace économique clairement défini, sans possibilité de phagocyter les sphères de l'espace social.
Fracture étatique : crise des Services Publics
Contradiction entre la mission de l'Etat, servir le bien commun et l'intérêt général, et les dérives administratives catégorielles supportées par la communauté. L'appareil d'Etat tentaculaire, en dépit de gros moyens sans cesse revus à la hausse, n'assure pas un service public satisfaisant. La logique de chaque administration est simple : assurer l'augmentation de l'enveloppe budgétaire destinée à chacune, tout l'appareil d'Etat raisonne ainsi, dans l'intérêt de ceux qui bénéficient d'une sécurité viagère, pendant que les autres sont confrontés aux douces aménités du marché concurrentiel. La rénovation en profondeur de nos administrations est une priorité, devant laquelle nos gouvernements successifs furent regrettablement résignés. La véritable classe dirigeante se trouve dans les bureaux ministériels, les politiques n'ayant trop souvent qu'un simple rôle de figuration. Ils acceptent ou refusent ce que les bureaux leur soumettent, en supposant qu'ils les aient analysés. Notre vie quotidienne est rythmée par d'inévitables procédures, démarches et autres tracasseries, que le professeur Jacques Ellul a définies comme une oppression bureaucratique, ce despotisme envahissant n'est pas près de s'atténuer….
Fracture ethnico-culturelle : crise civilisationnelle
Contradiction entre la colonisation massive de peuplement et les incompatibilités culturelles, les possibilités d'intégration (n'oublions pas nos millions d'autochtones : chômeurs, travailleurs pauvres ou exclus) qui génèrent d'inévitables chocs ethnico-culturels.
Lorsqu'il est porté devant les tribunaux des affaires d'excision, comment ignorer ces actes de barbarie perpétrés sur notre sol, en sachant que les rares cas dont il est fait état, donnent un aperçu bien en dessous des réalités, car il est extrêmement difficile pour les victimes de se retourner contre leur propre milieu d'origine.
Le 11 juillet, le gouvernement Français et le gouvernement Algérien ont signé un avenant à l'accord de 1968, qui fixait le régime particulier des immigrés Algériens, lesquels étaient soumis à un régime dérogatoire par rapport au droit commun des étrangers. Ce nouveau texte entrera en vigueur dès que les parlements des deux pays l'auront ratifié. Mais cet accord est à double tranchant, car le précédent régime offrait quelques privilèges, dont celui de faire venir plusieurs femmes, " comment vont réagir les préfectures quand les maris polygames voudront faire renouveler leur titre de séjour ?" s'inquiète Jean-François Martini du Gisti. ( groupe d'information et de soutien des immigrés ) La polygamie est officiellement pratiquée en France, pire elle est reconnue par les services publics….(Le Monde 28.07.01) Face à ces regrettables réalités, le principe constitutionnel de laïcité s’avère totalement inopérant, quant aux élucubrations communautaristes, élaborées par quelques intellos en mal de notoriété, nous en percevons les limites, ainsi que les inévitables dommages. Cessons les discussions byzantines, abordons les vrais problèmes sans faux-fuyants. Il convient sans plus tarder, pour les Etats qui, bon gré mal gré, sont confrontés à des flux migratoires, d’appliquer une nouvelle politique d’accueil. Nous évoluons dans un Etat de droit, lequel doit s’appliquer, sauf erreur de notre part, sur l’ensemble de l’espace territorial de l’Etat de droit. Ce droit (droit du sol ou jus soli) est celui de la Constitution et de la République , une et indivisible. Face au choc des civilisations que subissent les pays hôtes, il convient d’imposer à tous les immigrés, sans distinction d’appartenance, un serment de loyauté au droit local du pays d’accueil, qui selon le principe d’égalité sera le droit de tous et de toutes. (nul n’est censé ignorer la loi ).
Ceux qui refuseront de prêter serment seront immédiatement reconduits. Ceux qui accepteront de prêter serment seront de jure tenus de respecter le droit du pays d’accueil.
Fracture territoriale : crise identitaire
Contradiction entre un espace politique dont le pouvoir jacobin, bureaucratique et abusivement centralisé, confisque l'aménagement du territoire, aux élus locaux, alors que la base aspire à une légitime autonomie. Le découpage administratif de notre hexagone mérite attention. Le département est une création de la Révolution Française , qui parvenue au pouvoir, devint centralisatrice. Talleyrand y voyait son « œuvre déterminante ». Le Constituant Thouret, surnommé « le père des départements » fit adopter le découpage actuel. Pour Sieyès, l’équation : égalité des citoyens égale uniformité de l’administration, était posée comme un dogme irréfragable. Mirabeau quant à lui, réclamait pas moins de 120 départements, plus la surface serait réduite, moins les circonscriptions locales résisteraient à la centralisation républicaine, gage d’unité nationale. Depuis sa création, le département n’a cessé de polariser les plus vives critiques. Ce découpage «au cordeau» a inspiré quelques réformateurs de la cartographie administrative. Les projets de rectification furent nombreux et variés, plus de 50 propositions différentes.
Quelques unes pour mémoire, le géographe Paul Vidal de la Blache avait retenu une liste de 17 capitales, dont Paris. Autour de chacune existait une zone d’influence. Cette ébauche fut critiquée par manque de précision (toujours l’obsession du tracé au cordeau).
Auguste Comte dans son système de politique positive publié en 1854, préconisait 17 intendances avec pour capitales : Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Rouen, Nantes, Toulouse, Lille, Strasbourg, Reims, Orléans, Angers, Montpellier, Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon et Rochefort.
En 1864, Frédéric Le Play, dans La réforme sociale en France, proposait la création de 13 provinces, au sein desquelles, il groupait sous leurs anciens noms les provinces historiques. En 1871, le député Raudot soumettait à l’Assemblée Nationale la division du territoire en 25 provinces.
En 1890, le député Hovelacque souhaitait réduire le nombre des départements à 18 : Lille, Rouen, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse,, Montpellier, Marseille, Lyon, Dijon, Nancy, Reims, Paris, Le Mans, Tours, Limoges, Clermont-ferrand et Alger.
En 1895, un groupe important de députés autour de M de Lanjuinais proposait la création de 25 régions avec 126 arrondissements.
Mais le réquisitoire le plus virulent fut formulé par Michel Debré, favorable au regroupement en 45 « gros départements » (La mort de l’Etat républicain. Ed. Gallimard,1947)
« On ne pourra en France parler de vie locale tant que subsistera l’actuelle division administrative, son cadre et ses autorités. […] Si notre Etat n’est pas encore un cadavre à tête dodelinante, il est dèjà un grand corps amaigri, sans muscle, sans chair, la peau collée sur les os, avec un cerveau trop lourd et un système nerveux engourdi. Cette allure de grand malade, c’est au département qu’il le doit »
Depuis, le mammouth boulimique de budgets, a bien profité, dodu à point, à peine peut-il se mouvoir. Mais faire endosser au seul département les multiples dysfonctions et autres gabegies récurrentes de notre appareil administratif est excessif. Il y contribue, c’est certain, mais la racine du mal réside dans l’absolutisme jacobin hypercentralisateur.
La caste administrativo-bureaucratique surveille et décide à la place du peuple, des citoyens, des populations locales, considérés immatures, donc susceptibles de mal choisir.
Comment expliquer, depuis que la question est débattue, en dépit d'un très large consensus, que la Bordeaux-Pau ,(deux fois deux voies ou liaison autoroutière) en soit toujours au stade des études ? Axe fortement structurant, devant relier les deux principales agglomérations de la région Aquitaine, qui par delà son rôle régional, s'inscrit dans une logique internationale, reliant l'Aquitaine et l'Aragon. Les Aquitains attendent….le bon vouloir jacobin.
L'aménagement du territoire s'effectue dans l'opacité et la non-concertation. Jean-Pierre Raffarin, président (DL) du Conseil Régional de Poitou-Charentes nous apprend : "tout ceci est obscur, opaque pour les citoyens. Les contrats de plan représentent 400 milliards de francs avec les fonds européens, 1500 personnes sont au courant en France. Je suis très inquiet. On consulte les CRADT. Qu'en savent les citoyens ?"
Précisons que les Conférences Régionales d'Aménagement et de Développement du Territoire se tiennent à huis clos.(Sud-Ouest 8.02.01)
Ces pratiques sont en totale contradiction avec les principes démocratiques, les citoyens sont exclus des concertations, quant aux politiques locaux, ils ne peuvent qu'accepter ce qui leur est proposé par la hiérarchie administrative, au moment où celle-ci juge opportun de le faire. Ces excès de centralisation occasionnent mal-vivre et mal-être, pour bien vivre, c'est une lapalissade, il faut du bien-être, ce qui est possible lorsque chacun vit pleinement ses racines, son identité, sans carence ni confiscation. La revendication identitaire résulte de cette privation, face à une administration omnipotente, qui décide de tout.
IV l'homme providentiel ?
Ces contradictions fortes du système génèrent des crises pouvant provoquer une mutation dépassant les opinions du moment. Le clivage politique habituel se trouve pour une période neutralisé par un courant transversal fortement mobilisateur; constituant une opportunité rare qu'il convient de saisir sans hésitation. Reste à savoir les capacités et les qualités des forces alternatives potentiellement disponibles sur l'échiquier politique. Les apparences sont trompeuses, rien n'est certain, ni le bien, ni le pire, les prévisions adorent se faire attendre, entre paradis à venir et catastrophe imminente, chacun peut choisir et espérer le Grand Soir en se croisant les bras, ce qui limite les efforts, ainsi que les risques..
Reste que l'homme providentiel ne surgira pas ex nihilo comme le croient beaucoup, tout se prépare dans l'effort et la constance, dans l’observation attentive, dans la mobilisation, et la promptitude à agir, avec ce petit rien qui fait toute la différence : l'intuition géniale qui visite quelques rares têtes, l'esprit souffle où il veut et quand il veut.
Romain Labarchède






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg


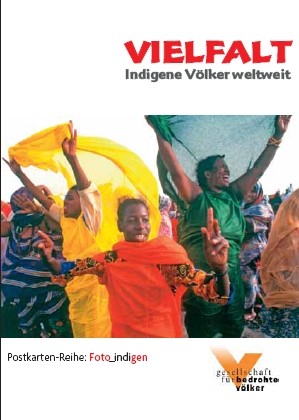


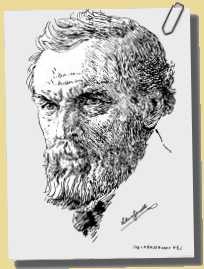
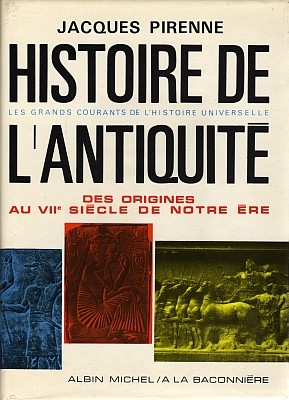
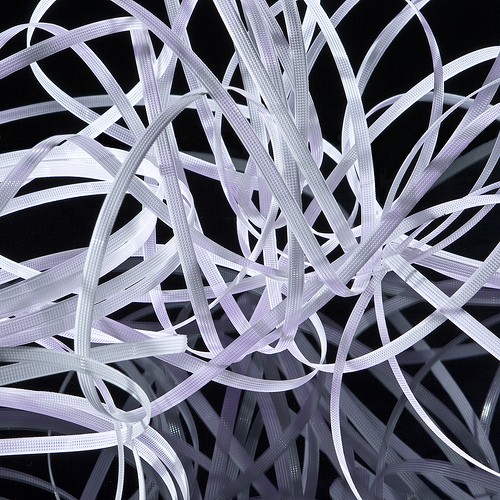
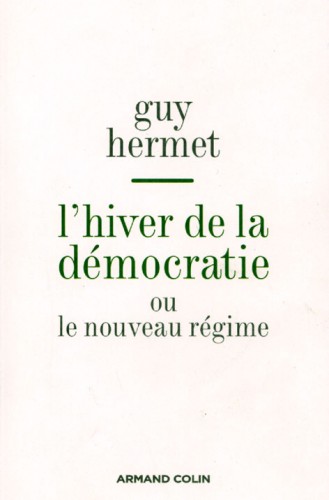

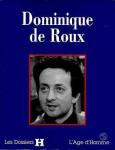



 (Nsalternatief.wordpress.com)
(Nsalternatief.wordpress.com)


 “Le grand problème de la production capitaliste n’est plus de trouver des producteurs et de décupler leurs forces mais de découvrir des consommateurs, d’exciter leurs appétits et de leurs créer des besoins factices. ” Paul Lafargue Extrait de Le droit à la paresse
“Le grand problème de la production capitaliste n’est plus de trouver des producteurs et de décupler leurs forces mais de découvrir des consommateurs, d’exciter leurs appétits et de leurs créer des besoins factices. ” Paul Lafargue Extrait de Le droit à la paresse
 Honni et vilipendé, injustement calomnié, le Florentin fut un modèle de rigueur dans son analyse des mécanismes politiques. A l’heure du règne tout puissant des « autorités morales » et autres « polices de la pensée », il est salutaire de relire les principes, d’une étonnante franchise, de ce patriote, soucieux de l’unité de son pays.
Honni et vilipendé, injustement calomnié, le Florentin fut un modèle de rigueur dans son analyse des mécanismes politiques. A l’heure du règne tout puissant des « autorités morales » et autres « polices de la pensée », il est salutaire de relire les principes, d’une étonnante franchise, de ce patriote, soucieux de l’unité de son pays.
