vendredi, 21 novembre 2014
Hiroshi Teshigahara, La Femme des Sables, (Japon, 1964)

Hiroshi Teshigahara, La Femme des Sables, (Japon, 1964)
Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com
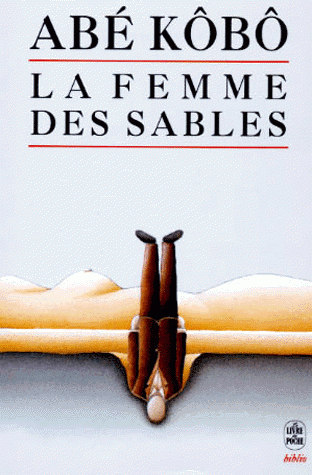 La deuxième des quatre œuvres issues de la collaboration de Teshigahara avec l’écrivain Kobo Abe, La Femme des Sables, est son long métrage le plus célèbre. C’est aussi certainement celui qui laisse l’impression la plus forte et la plus durable.
La deuxième des quatre œuvres issues de la collaboration de Teshigahara avec l’écrivain Kobo Abe, La Femme des Sables, est son long métrage le plus célèbre. C’est aussi certainement celui qui laisse l’impression la plus forte et la plus durable.
Si l’on peut rester de marbre devant Le Traquenard ou Le Visage d’un Autre, à cause notamment de certaines longueurs franchement pénibles, d’un style parfois curieux et d’un propos relativement décousu, le flot d’images surréalistes et envoûtantes de La Femme des Sables, en revanche, constitue une expérience esthétique fascinante, et ce malgré un director’s cut de 147 minutes bien tassées.
Visuellement, cette œuvre regorge de trouvailles : superpositions de plans, alternance entre les gros plans d’insectes, de grains de sable ou du grain de la peau humaine, et de longues étendues désertiques animées par le vent ou par les traces laissées par un être humain… La photographie en noir et blanc est franchement splendide, et du point de vue de l’atmosphère générale, le terme « hanté » ne semble pas usurpé.
La trame du film elle-même est plutôt originale : un citadin, instituteur de son état dans une mégapole japonaise et entomologiste amateur, se rend dans le désert à la recherche de spécimens rares, dans l’espoir de voir son nom passer à la postérité dans une encyclopédie. Après une longue marche, il s’allonge sur le sable et laisse ses pensées vagabonder. Il songe aux papiers, aux archives, aux dossiers, aux permis, à la masse effroyable de paperasse qui donne à chacun un sentiment ambigu : celui d’appartenir à une société et d’être reconnu par celle-ci, tout en étant au fond qu’un nom parmi tant d’autres – un grain de sable parmi les grains de sable.
Il s’assoupit, et à son réveil il se laisse convaincre par un inconnu de se laisser guider jusqu’à un village au beau milieu du désert où il pourra se restaurer et passer la nuit. Arrivé au village, notre homme découvre une maison de bois passablement délabrée, encaissée au fond d’une fosse de sable. Le voyageur descend par une échelle de corde à la rencontre de son hôte, une femme vivant seule dans cette tombe à ciel ouvert. Au cours du repas, l’homme plein d’orgueil et sûr de sa supériorité de citadin, prend son hôte de haut lorsque celle-ci lui parle de son quotidien et des étranges phénomènes dont elle est régulièrement témoin.
L’homme se rend compte au cours de la nuit que la femme vit d’un labeur peu commun : elle entasse des kilos de sable dans de grandes caisses de métal, que des paysans hissent depuis le sommet de la fosse à l’aide d’un treuil. On pense tout d’abord qu’il s’agit d’une méthode fastidieuse destinée à éviter que la maison ne finisse par être intégralement ensevelie ; on apprend plus tard que ce sable est revendu à des entrepreneurs peu scrupuleux qui mettent en œuvre ce matériau peu coûteux et dangereux dans leurs constructions.
La condescendance du voyageur vis-à-vis de la femme qui le nourrit et l’héberge est bien vite vengée : le matin venu, l’homme s’aperçoit en effet que l’échelle de corde a disparu… Il ne tarde pas à comprendre qu’il est tombé dans un piège et que sa survie dépend de l’aide qu’il voudra bien apporter à la femme des sables dans sa tâche absurde et sans fin. L’homme passe de la révolte et de l’espoir à la résignation, puis au dépassement de sa condition tout au long de ce film en forme de quête initiatique.

Le film tourne autour de la notion d’identité : la place que l’homme occupe dans la société, instituteur au sein d’une grande ville, semble largement suffire à son épanouissement ; pourtant son incursion d’entomologiste amateur en quête de renommée et les réflexions qu’il se formule au cœur du désert, au sujet de ce qui fonde l’identité en tant que citadin, sont deux éléments qui montrent bien que notre homme redoute déjà au fond de lui de n’être rien d’autre qu’un grain de sable dans le désert. Lorsqu’il se retrouve confronté à une villageoise recluse au fin fond du désert pourtant, son statut officiel lui fournit une assurance mâtinée d’orgueil qui se mue vite en condescendance ; plus tard encore au cours de sa captivité, il nourrit toujours l’espoir d’être secouru, il place tous ses espoirs dans la certitude que le monde moderne auquel il appartient finira par le rattraper, qu’on viendra le chercher, que tout rentrera dans l’ordre pour lui.
A mesure que le film se déroule, toutes les craintes de l’homme s’avèrent fondées. Il comprend qu’il n’a jamais rien acquis d’autre qu’une identité de façade, intégralement administrative et sans réalité charnelle. Sa solitude cauchemardesque trouve un écho direct dans cette image du prisonnier au fond d’une tombe de sable. De nombreux plans du film viennent alimenter l’analogie, parfois en exacerbant le caractère futile des tentatives d’évasion : l’homme est semblable aux insectes qu’il collectionne, s’agitant vainement pour s’extirper de cette fosse où il lui faut maintenant apprendre à vivre.
Toute la futilité et l’absurdité de la condition humaine sont mises en évidence de façon tragique ; le labeur quotidien, infiniment renouvelé, infiniment absurde, rappelle bien évidemment le mythe de Sisyphe. Il ne faut pas s’en étonner : l’ouvrage de Kobo Abe semble en effet largement redevable à la philosophie existentialiste. La conclusion de la Femme des Sables est d’ailleurs fidèle, en substance, à celles que Kierkegaard, Sartre ou Camus ont pu formuler dans leurs travaux : Teshigahara nous suggère en effet à la fin de son long métrage que l’homme doit trouver sa liberté intérieure en acceptant sa condition, en collaborant avec la femme des sables et en se livrant à une activité intellectuelle.
Au-delà de cette lecture philosophique, qu’il ne faut bien évidemment pas se sentir obligé de partager, il reste un petit bijou du cinéma japonais des années 60, à l’ambiance particulièrement soignée, et dont la beauté formelle n’est certainement pas la moindre des qualités.
Lydéric / C.N.C.
Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source.
00:05 Publié dans Cinéma, Film, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, 7ème art, cinéma japonais, japon, lettres, lettres japonaises, littérature japonaise, littérature, abé kobo |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


