Le Comptoir : Comment les gens se soignaient-ils en France avant la création de la Sécurité sociale en 1945 ?
Michel Étiévent : En 1938 en France, il y a sept millions de salariés. Cinq millions d’entre eux n’ont aucune protection sociale. Les deux millions restants ont de vagues assurances sociales. Celles-ci sont nées en 1930 et s’apparentent plutôt à de l’aumône. Certains ont aussi de vagues mutuelles mais elles sont épuisées à la moindre épidémie de grippe. La majorité des gens ne se soignent pas et attendent la mort. C’est l’insécurité totale du lendemain. Cinq millions de salariés n’ont pas de retraite non plus. La seule retraite à l’époque, c’est le cimetière. On imagine la rupture qu’apportât la Sécurité sociale en amenant simplement de la dignité. La Sécu, au final, ce n’est rien d’autre que le droit de vivre.
En 1945 en France, le taux de mortalité infantile est de 100 pour 1.000. Neuf ans après seulement l’institution de la Sécu, on passe à 30 pour 1.000. De 1915 à aujourd’hui, on a gagné près de trente années d’espérance de vie. On le doit essentiellement à la Sécu qui a apporté à tous la possibilité de se soigner et qui a mis à la disposition de tous les grands succès médicaux, comme la naissance de médicaments tels que la pénicilline, ou ceux pour soigner l’hépatite, qui ont pu sauver des vies.
« La Sécu, ce n’est rien d’autre que le droit de vivre. »
À la faveur de quoi le processus de création de la Sécurité sociale s’est-il enclenché ?
Après la guerre, le Conseil national de la résistance (CNR), un groupe de 18 jeunes résistants mené par Jean Moulin avant sa mort, a décidé d’en finir avec cette insécurité du lendemain. C’est l’idée de cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. C’est le sens d’ailleurs de la première intervention d’Ambroise Croizat, ministre communiste de la Libération, à l’Assemblée nationale en 1945 : « Désormais, nous mettrons fin à l’insécurité du lendemain, nous mettrons l’homme à l’abri du besoin, nous ferons de la retraite non plus l’antichambre de la mort mais une étape de la vie et nous ferons de la vie autre chose qu’une charge et un calvaire. » Du programme rédigé par le CNR naît la fameuse ordonnance du 4 octobre 1945 qui institue la Sécurité sociale.
Qui est Ambroise Croizat ?
Ambroise Croizat est un fils d’ouvrier, un fils de manœuvre, qui naît le 28 janvier 1901 à Notre-Dame-de-Briançon, en Savoie. Très vite, Antoine Croizat, son père, comprend que si on veut améliorer les conditions de vie extrêmement dures des travailleurs, il faut se bouger. Il lancera une grève en 1906. Ce sont les prémisses des revendications pour la protection sociale. Il s’agit de changer les rythmes, d’avoir des conditions de travail plus décentes et surtout d’obtenir une caisse de secours, l’ancêtre de la Sécu en fait, qui amènerait une couverture en cas de maladie ou d’accident de travail, puisqu’à l’époque, il n’y avait rien. Il se fera licencier pour ça. La famille va alors partir pour Ugine avant de rejoindre Lyon. Ouvrier depuis ses 13 ans, Ambroise va devenir un syndicaliste important de la CGT [Confédération générale du travail, NDLR]. Il adhérera au Parti communiste en 1920. En 1936, il est secrétaire de la fédération nationale CGT des métaux et il devient alors député de Paris. C’est le Front populaire. Dans les batailles menées à l’époque, c’est lui, avec d’autres, qui imposera les 40 heures, les congés payés, les conventions collectives.
Suite au pacte germano-soviétique d’août 1939, le PCF est dissous et ses militants incarcérés, dont les 36 députés communistes de l’Assemblée nationale. Croizat est ainsi arrêté et sera déporté au bagne d’Alger par Pétain. Il est libéré en 1943, après le débarquement anglo-américain sur les côtes algériennes et marocaines, et il rejoint le général de Gaulle dont le gouvernement provisoire est alors à Alger. Il fera ainsi partie de la commission consultative du premier gouvernement provisoire de la France, qui est en lien avec le CNR fondé la même année. Croizat est nommé président de la commission Travail par de Gaulle et il est chargé de préparer clandestinement la mise en œuvre du programme social du CNR.

En 1945, à la Libération, et suite au succès du Parti communiste aux élections législatives, il est nommé ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il laissera un héritage social considérable : les retraites, les comités d’entreprise, la médecine du travail, le triplement du montant des allocations familiales, le doublement du congé maternité, la prévention dans l’entreprise, la reconnaissance des maladies professionnelles, et la mise en place de tous les statuts sociaux (de la fonction publique, des mineurs, d’électricien-gazier, etc.) avec Marcel Paul. Croizat a permis aux travailleurs d’avoir un rôle social, avec la création des comités d’entreprise notamment, dans la gestion et l’avenir de leur profession. Il va le payer très cher puisqu’il va mourir très jeune, en 1951. Il a 50 ans. Un million de personnes suivent le cortège dans les rues de Paris lors de son enterrement. C’est un enterrement à la Victor Hugo. Il n’y en a pas eu beaucoup. Les gens lui ont rendu hommage.
J’imagine qu’Ambroise Croizat n’a pas mené cet immense chantier seul. Sur le terrain, qui a bâti la Sécu ?
La Sécu va être bâtie par le peuple français, par un petit groupe de militants de base, essentiellement issus de la CGT en fait. Ces mêmes militants géraient la Sécu. La CGT avait d’ailleurs la majorité dans les conseils d’administration des caisses où 75 % des sièges étaient réservés aux travailleurs syndiqués et 25 % aux patrons. Ce sont donc des ouvriers comme Jolfred Fregonara, qui apparaît dans le film La Sociale, qui ont bâti en un temps très court la Sécu. On dit souvent que ça a pris 18 mois parce que ça correspond au temps qu’Ambroise Croizat, qui avait la maîtrise d’œuvre de ce chantier, est resté au gouvernement, mais en fait la création des caisses a eu lieu du 22 mai 1946 à août 1946. C’est un travail considérable. Ces militants vont construire 138 caisses de Sécu et 113 caisses d’allocations familiales, qui vont complètement changer la vie des gens. Il faut imaginer que les caisses de l’époque, c’est parfois une baraque en planches, parfois un wagon aménagé dans une gare, c’est un petite pièce ici ou là où des bénévoles, ramassent les feuilles de Sécu, payent les gens, etc.
On comprend l’enthousiasme indescriptible dans lequel ces militants ont bâti la Sécu, hors de leur temps de travail, pendant leur temps de congé et de manière totalement bénévole. Ils ont bouleversé la vie des Français en un temps très court, dans un pays totalement ruiné.
Au moment de la création de la Sécu, quelles ont été les résistances ?
Immédiatement, dès l’apparition de l’ordonnance d’octobre 1945 instituant la création de la Sécu, des défiances sont apparues. Elles viennent, naturellement, d’abord des patrons qui n’en veulent pas puisqu’il faut payer des cotisations sociales. Ensuite, ça vient de syndicats minoritaires, comme la CFTC [Confédération française des travailleurs chrétiens, NDLR], qui voulaient revenir aux anciennes caisses. Les oppositions proviennent évidemment des mutuelles dont la Sécu prend alors les biens puisque c’est elle qui va désormais tout gérer. Ça vient aussi des médecins, notamment du syndicat des médecins libéraux, qui s’opposent tout de suite à la Sécu parce qu’elle fixe leurs honoraires. Ils supportaient par ailleurs difficilement que la Sécu soit gérée par des ouvriers, qui plus est par des ouvriers de la CGT. Les assurances privées ont également lutté contre la Sécu, on comprend pourquoi. La droite française s’est battue farouchement bien qu’elle se refusait à le faire ouvertement puisque le rapport de force était contre elle. C’est d’ailleurs ce rapport de force au moment de la Libération qui a permis à la Sécu d’être mise en place : les cinq millions d’adhérents à la CGT, les 29 % d’adhérents au Parti communiste et les classes ouvrières sont sortis grandis de leur résistance alors que le patronat était totalement mouillé par la collaboration. Ce dernier pouvait difficilement dire quelque chose.
« Cotiser selon ses moyens et de recevoir selon ses besoins.«
Quels sont les principes qui ont orienté la création de la Sécurité sociale ?
Il y en a quatre et ils ont tous été volés aujourd’hui.
Le premier, c’est l’unicité : dans une seule caisse, au plus proche des habitants, par département, on va grouper tous les risques sociaux (maladie, vieillesse, maternité). De la naissance jusqu’au décès, les gens peuvent disposer de tous leurs droits sur place et au même endroit.

Le troisième, et il constitue l’exception française, c’est la solidarité. La Sécu est financée essentiellement par la cotisation sociale par répartition et par solidarité, qu’on soit bien portant ou malade, vieux ou jeune, actif ou non actif. Ce qui est formidable dans la cotisation sociale, contrairement à l’impôt, c’est qu’elle va directement du cotisant au bien-être des gens. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle aujourd’hui, on voudrait supprimer les cotisations sociales, parce que cet argent ne passe par aucun actionnaire, aucune banque, il va directement aux gens qui en ont besoin.
Le dernier pilier de la Sécu, qui est à imputer à Croizat aussi, c’est la démocratie. Si on veut permettre l’accès au droit de la santé pour tous, il faut que l’institution soit gérée par les intéressés eux-mêmes. C’est l’idée des conseils d’administration à majorité ouvrière.
Comment la Sécurité sociale a-t-elle évolué depuis ?
Dès 1947, les mutuelles qui géraient certaines des anciennes caisses sont arrivées à imposer leur existence grâce au retour de la droite au pouvoir après l’expérience gaullo-communiste de 1945-47. Et puis, la même année, les Américains vont s’en mêler en proposant le plan Marshall, c’est-à-dire en offrant une aide financière colossale à condition qu’on arrête l’invention sociale. Les communistes sont alors évincés du gouvernement. Au même moment, la classe ouvrière va se diviser, notamment avec l’invention de FO [Force ouvrière, NDLR], qui est d’ailleurs directement le fruit de la CIA(1) [Central intelligence agency, les renseignements américains, NDLR]. Elle est destinée à casser l’unité ouvrière de manière à ce que les caisses n’appartiennent plus entièrement à la CGT. Ça a notamment été reconnu par George Meany, le chef des syndicats américains, qui a financé FO. Cette époque correspond aussi au début de la Guerre froide, où une répression formidable est menée contre les communistes mais aussi contre les syndicalistes – les grandes grèves de 1947 seront d’ailleurs durement réprimées.
Ce mouvement s’est amplifié avec les années puisque dès 1953, les premières vraies batailles contre la Sécu apparaissent. On essaye d’abord de miner la retraite des fonctionnaires. Puis, en 1959, on va essayer d’imposer ce qu’on appelle les franchises, c’est-à-dire que les gens ne seront remboursés qu’à partir d’une certaine somme dépensée en soins médicaux, à l’époque c’était 3 000 francs. L’opposition a été si forte qu’elles n’ont pas pu être mises en place.
En 1958, c’est la première attaque forte contre la Sécu par le général de Gaulle, pourtant porteur de l’idée en 1945 quoiqu’elle lui ait été imposée par le rapport de force. Les directeurs de caisses seront dès lors nommés et non plus élus. Puis, il revient sur l’idée même de Sécurité sociale en imposant les ordonnances Jeanneney d’août 1967. Celles-ci imposent le contrôle préalable des budgets et le paritarisme, supprimant ainsi la gestion de la Sécu par les travailleurs puisque 50 % des sièges du conseil d’administration passent alors aux mains des patrons, laissant 50 % aux ouvriers. Il suffira alors d’un syndicat patronal minoritaire (mais unique) pour faire basculer la gestion vers le patronat. De Gaulle casse aussi la Sécu en plusieurs branches : auparavant tout était lié, les accidents de travail, la maternité, la maladie, la vieillesse. C’est comme un saucisson, quand on le coupe c’est plus facile de le manger. Le principe de solidarité est supprimé.
« Aujourd’hui, alors que la France est la 5e puissance du monde, 32 % des Français hésitent ou renoncent à se soigner pour des raisons financières. »
Et puis, il y aura toute une succession d’attaques. Avec le plan Barre, l’État commence à vouloir faire des économies sur la Sécu. Le ticket modérateur – le reste à charge pour l’assuré – était très mince sous Croizat et, dès lors, il ne cessera plus d’augmenter sous tous les gouvernements successifs dans le sillage de la privatisation rampante de la Sécu via le contrôle de l’État. Rocard impose ensuite la CSG (Contribution sociale généralisée), qui est un impôt et plus du tout une cotisation sociale prélevée sur le salaire. Georgina Dufoix va essayer d’imposer des franchises dans les années 1980. Et l’ensemble des plans Juppé, Raffarin, Chirac vont allonger la durée de travail et de cotisation. Et ça continue jusqu’à aujourd’hui avec l’ANI (Accord national inter-professionnel) de 2013 que la CGT n’a pas signé mais que la CFDT [Confédération française démocratique du travail, NDLR] a avalisé. Celui-ci impose une mutualité dans l’entreprise et constitue une rupture d’égalité puisque tout le monde n’est pas concerné, mais uniquement ceux qui travaillent (vieux, chômeurs et précaires ne l’ont pas). La mutuelle est au choix du patron. L’ANI impose aussi une rupture de confidentialité dans la mesure où les patrons peuvent potentiellement connaître le profil pathologique de leurs employés. Tout ça participe à privatiser la Sécu.

Le problème du prix des médicaments est scandaleux par ailleurs : un traitement pour l’hépatite C aujourd’hui coûte 100 dollars à la fabrication et est vendu 48 000 euros à la Sécu. On pourrait très bien créer un Pôle public du médicament avec des médecins et des usagers qui géreraient tout ça. Un autre moyen “d’économiser” serait de faire enfin de la prévention : par exemple, on connaît la toxicité de l’amiante depuis 1967 mais il a fallu attendre 1997 pour l’interdire. Entre temps c’est 30 000 morts et on en annonce 100 000 nouveaux. Il y aurait beaucoup de choses à faire avant de vouloir supprimer la Sécu. Il faudrait seulement un peu de courage politique. Et c’était la vertu cardinale de certains de nos représentants au moment de la Libération : ils plaçaient l’humain au centre de tout leur champ politique. Ce n’était pas les banques qu’ils voulaient sauver, c’était l’homme.
Note
1- George Meany a déclaré peu après “l’opération” au club de presse de Washington : « Je suis fier de vous dire, parce que nous pouvons nous permettre de le révéler maintenant, que c’est avec l’argent des ouvriers de Detroit et d’ailleurs qu’il nous a été possible d’opérer la scission très importante pour nous dans la CGT, en créant le syndicat ami Force ouvrière. » (cité dans E… comme espionnage, de Nicolas Fournier et Edmond Legrand, éditions Alain Moreau, 1978).



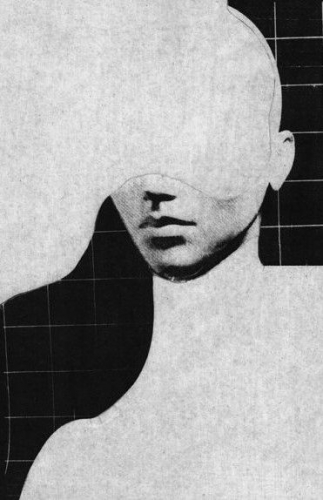

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg

