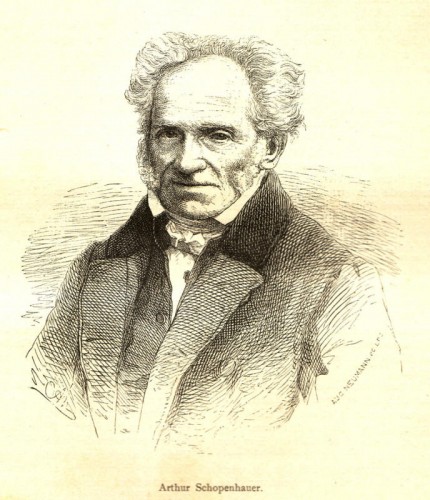
Schopenhauer, philosophe de la volonté et archétype du solitaire méprisant la politique
Baal MÜLLER :
Il y a 150 ans mourrait Arthur Schopenhauer
« L’absence d’esprit prend toutes les formes pour se dissimuler : elle se camoufle en pathos, en emphase ; elle prend le ton de la supériorité et se donne des grands airs et tout cela de cent autres façons »
Arthur Schopenhauer (1788-1860).
La philosophie allemande classique du 19ème siècle peut se subdiviser, grosso modo, en deux courants majeurs qui, tous deux, commencent avec Kant. Celui-ci avait accompli dans sa « Critique de la raison pure » une « révolution copernicienne » passant ainsi de l’ontologie à la théorie de la connaissance ; il avait aussi affirmé que la capacité humaine de connaître était intrinsèquement liée aux formes de la représentation que sont le temps et l’espace, d’une part, les douze catégories de la raison, d’autre part, parmi lesquelles le principe de causalité. Pour faire en sorte que la raison ne produise pas elle-même ces propres objets, Kant s’était vu contraint d’accepter une « chose en soi » transcendantale, qui, pour le sujet connaissant, n’était pas connaissable au-delà de cet appareil fonctionnel.
Côté subjectif de ce monde coupé en deux par Kant, nous trouvons vers 1800 la philosophie idéaliste, qui culminera dans les grands systèmes de Hegel et de Schelling, puis, sous le signe du matérialisme, sera poursuivie par Marx et Engels. L’autre courant est moins visible, il est plutôt souterrain et cherche à saisir la face objective, en dépit de la césure kantienne. Ce courant-là commence avec Arthur Schopenhauer et nous amène, au-delà de Nietzsche, vers la modernité, une modernité qui n’est pas seulement philosophique.
Schopenhauer, né le 22 février 1788 à Danzig dans le foyer d’un négociant, est un penseur et une personnalité de la transition. Selon la tradition philosophique allemande, et surtout selon cet idéalisme allemand contre lequel il engage la polémique, Schopenhauer participe lui aussi à cette volonté de systématiser, c’est-à-dire de chercher à expliquer les principes métaphysiques du monde en un seul ouvrage : en effet, c’est ce qu’il tentera de faire dans son ouvrage principal, « Die Welt als Wille und Vorstellung » (= « Le monde comme volonté et comme représentation »), dont le premier volume paraît dès 1819 et dont le second ne paraitra qu’en 1844. Il amorce ses réflexions au départ du principe fondamental de Kant, celui de la subjectivité de la faculté de connaître, et le soumet à une métaphysique volontariste, dans la mesure où il identifie la « chose en soi » avec la volonté, qu’il interprète comme une pulsion d’existence, agissant derrière tous les phénomènes. Contrairement à l’usage habituel, il entend la volonté comme un principe irrationnel, que l’on n’expérimente pas seulement lorsque l’on procède à une analyse introspective de soi et, partant, comme une pulsion vitale et sexuelle, mais qui se manifeste, compénétrante, à travers la nature toute entière voire aussi dans le déroulement causal non vivant.
En dépit du caractère universel de la volonté qui se combat elle-même éternellement par le truchement des phénomènes qu’elle génère et qui détermine ainsi tout élan individuel de volonté, comme l’explique Schopenhauer dans un écrit de 1839, qui lui vaut un prix de la Société Royale Norvégienne des Sciences, et qui a pour titre « Über die Freiheit des menschlichen Willens » (= « De la liberté de la volonté humaine »), eh bien, en dépit de cela, il existe tout de même deux portes dérobées par lesquelles l’homme peut se dégager de la souffrance que lui inflige le monde : l’une est constituée par la morale, l’autre par l’esthétique. Par empathie avec les autres créatures souffrantes, l’homme peut dépasser son isolement apparent et reconnaître la même volonté de vivre (et en fin de compte se reconnaître lui-même) en tous les autres êtres, ce que Schopenhauer exprime par les mots « tat twam asi » (« cela, tu es »), empruntés aux Upanishads de l’Inde ancienne. Dans son éthique de la compassion, qu’il explicite dans « Über das Fundament der Moral » (= « Du fondement de la morale »), il se tourne, de manière radicale, contre l’impératif catégorique de son maître Kant, dont il mésinterprète l’appel à toujours penser aux conséquences de sa propre action pour l’universalité (pour la chose publique), comme une obligation à se soumettre à une pensée obéissante à l’autorité. Tout anti-étatiste pourrait, en se soumettant à une telle pensée, considérer que les lois ne sont que contraintes et non par autant de formules dont la validité est universelle.
L’autre échappatoire vers le paradis (toutefois sans Dieu) est la « contemplation détachée de tout intérêt » qu’offre la contemplation esthétique : en jouissant d’une œuvre d’art, surtout une œuvre musicale, l’homme peut aussi dépasser le « principium individuationis » et s’unir au fond cosmique de l’univers.
Schopenhauer comme précurseur de la psychanalyse freudienne
Aujourd’hui on ne juge pas tant l’importance de Schopenhauer à la teneur de ses principales idées philosophiques qu’à ses multiples influences postérieures. De son vivant, son ouvrage principal n’a quasiment pas été pris en considération. Il a fallu attendre le dernier tiers du 19ème siècle, donc après la mort de Schopenhauer, pour assister à une réception de son œuvre d’une rare intensité. Schopenhauer a amorcé ses réflexions philosophiques à l’époque dite des « Biedermeier » en Allemagne ; dans sa jeunesse, il a encore connu Goethe. Sa mère, Johanna Schopenhauer, écrivait des romans et tenait un salon littéraire à Weimar. Sa célébrité posthume, Schopenhauer la doit au fait qu’il fut un contemporain de Richard Wagner, dont « L’Anneau des Nibelungen » avait été fortement imprégné par la pensée de notre philosophe. Il la doit également à Friedrich Nietzsche qui, dans ses « Considérations inactuelles », évoque « Schopenhauer comme éducateur » et fait l’éloge de sa « volonté de vérité » et de son pessimisme héroïque. C’est justement au départ de cette réflexion nietzschéenne sur Schopenhauer qu’un filon s’amorce en direction de la critique révolutionnaire/conservatrice du vingtième siècle. En effet, l’archétype du solitaire et du précepteur oisif, méprisant la politique, se repère dans le philosophe grognon des « Considération d’un apolitique » de Thomas Mann. Celui-ci reconnaît encore sa dette à l’endroit de Schopenhauer dans quelques-uns de ces récits, dont la nouvelle « Tobias Mindernickel », où il traite de l’éthique de notre philosophe.
L’œuvre de Schopenhauer a eu un impact considérable sur des écrivains aussi importants que Hermann Hesse, Samuel Beckett et Thomas Bernhard. Dans l’univers des philosophes, l’impact a d’abord été moindre et ce sont, dans un premier temps, des figures marginales du monde universitaire du début du 20ème siècle qui se sont intéressées à lui : songeons à Georg Simmel et à Max Scheler qui, tous deux, font démarrer leurs réflexions à la suite de Schopenhauer. La plupart du temps, les philosophes universitaires l’ont considéré d’abord, et souvent à raison, comme un disciple original de Kant ou comme un précurseur de Nietzsche. Certes, il fut l’un des principaux précurseurs de Nietzsche mais il fut surtout l’une des principales figures anticipatrices de la psychanalyse. La réduction freudienne de la vie sentimentale à la pulsion sexuelle se retrouve, bien avant Freud, dans l’œuvre de Schopenhauer, et sans la moindre ambiguïté. Dans la conception schopenhauerienne de la volonté comme une puissance irrationnelle dépassant la conscience individuelle, nous trouvons les prémisses essentielles de l’inconscient collectif de Carl Gustav Jung.
Schopenhauer nous a transmis aussi la sagesse indienne, ce qui ne fut pas le moindre de ses mérites. Le premier contact qu’il a eu avec l’univers mental indien date de 1813, lorsqu’il séjournait à Weimar et qu’il y rencontra pour la première fois l’orientaliste Friedrich Majer, disciple de Herder. Sous l’influence des études de Majer, Schopenhauer finit par se considérer comme « le premier bouddhiste d’Europe ». Ainsi débuta l’histoire d’une méprise créatrice, comparable à l’interprétation quiétiste de l’antiquité classique, dont on vantait « la noble simplicité et la grandeur tranquille ». Les conséquences de cette méprise résident surtout dans une interprétation fausse du bouddhisme comme nihilisme, un nihilisme qui reposerait sur une rétention vis-à-vis de tout agir et verrait le but le plus élevé de l’existence dans une immersion dans le « néant ». On a vu l’effet de cette mésinterprétation du bouddhisme sévir dans la décennie qui suivit la Grande Guerre, où régnait une ambiance de déclin, comme, plus tard, dans la vogue bouddhiste qui se retrouve en Occident jusque aujourd’hui.
Petit bourgeois réactionnaire et ennemi des bourgeois étriqués
 Schopenhauer est lié à son temps quand il exprime son système philosophique basé sur la volonté ; il l’est également dans l’insouciance relative dont il fait montre à l’endroit de toute recherche empirique, ainsi que dans sa prétention à pouvoir présenter une interprétation générale du monde qui sera à jamais irréfutable. Mais les impulsions qui partent de son œuvre pour aboutir à notre temps sont fort nombreuses. Parmi elles : son « habitus » non académique de philosophe artiste et de littérateur. Il y a aussi son attitude ambivalente face à la classe bourgeoise : d’une part, Schopenhauer est très nettement un petit bourgeois réactionnaire qui méprise la période prérévolutionnaire d’avant 1848, le « Vormärz » ; d’autre part, en tant que demi bohémien, il est un ennemi de la mentalité bourgeoise étriquée (le « Spiessertum »), qui se manifeste surtout dans l’institution du mariage, cible de sarcasmes perpétuels pour ce misogyne grognon et animé par ses pulsions. Pour s’assurer un certain équilibre émotionnel, notre célibataire endurci s’est flanqué pendant toute sa vie d’un compagnon canin, un caniche : dès que l’un de ces animaux favoris mourrait, il s’en procurait un nouveau qu’il baptisait invariablement « Atman », comme tous ses prédécesseurs. Ce nom signifiait en sanskrit « souffle de vie » ou « âme individuelle », car, croyait-il, il y avait, actif, dans chaque caniche un seul et même principe de vie, le « Pudels Kern », le « noyau du caniche ».
Schopenhauer est lié à son temps quand il exprime son système philosophique basé sur la volonté ; il l’est également dans l’insouciance relative dont il fait montre à l’endroit de toute recherche empirique, ainsi que dans sa prétention à pouvoir présenter une interprétation générale du monde qui sera à jamais irréfutable. Mais les impulsions qui partent de son œuvre pour aboutir à notre temps sont fort nombreuses. Parmi elles : son « habitus » non académique de philosophe artiste et de littérateur. Il y a aussi son attitude ambivalente face à la classe bourgeoise : d’une part, Schopenhauer est très nettement un petit bourgeois réactionnaire qui méprise la période prérévolutionnaire d’avant 1848, le « Vormärz » ; d’autre part, en tant que demi bohémien, il est un ennemi de la mentalité bourgeoise étriquée (le « Spiessertum »), qui se manifeste surtout dans l’institution du mariage, cible de sarcasmes perpétuels pour ce misogyne grognon et animé par ses pulsions. Pour s’assurer un certain équilibre émotionnel, notre célibataire endurci s’est flanqué pendant toute sa vie d’un compagnon canin, un caniche : dès que l’un de ces animaux favoris mourrait, il s’en procurait un nouveau qu’il baptisait invariablement « Atman », comme tous ses prédécesseurs. Ce nom signifiait en sanskrit « souffle de vie » ou « âme individuelle », car, croyait-il, il y avait, actif, dans chaque caniche un seul et même principe de vie, le « Pudels Kern », le « noyau du caniche ».
Arthur Schopenhauer meurt le 21 septembre 1860, comme un vieil original, peu célèbre et bizarre, à Francfort sur le Main, ville où, après ses années de pérégrination et d’études, il s’était fixé pour y passer la seconde moitié de sa vie. Quelques années après son passage de vie à trépas, Léon Tolstoï le nomme « le plus génial de tous les hommes ».
Baal MÜLLER.
(article paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°38/2010 ; http://www.jungefreiheit.de/ ).



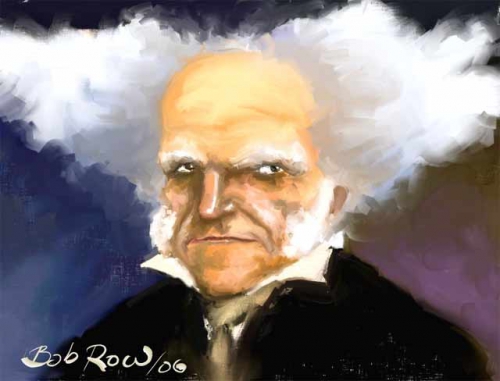

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg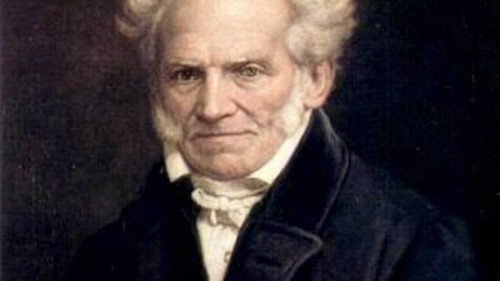
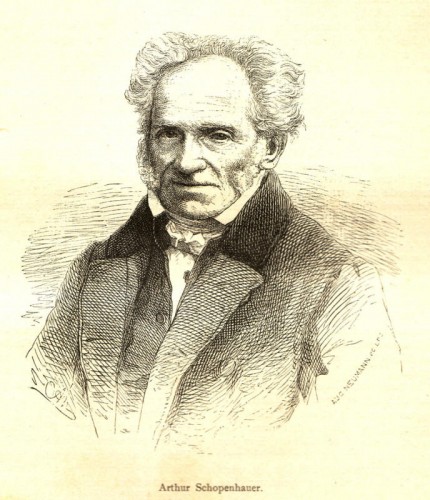
 Schopenhauer est lié à son temps quand il exprime son système philosophique basé sur la volonté ; il l’est également dans l’insouciance relative dont il fait montre à l’endroit de toute recherche empirique, ainsi que dans sa prétention à pouvoir présenter une interprétation générale du monde qui sera à jamais irréfutable. Mais les impulsions qui partent de son œuvre pour aboutir à notre temps sont fort nombreuses. Parmi elles : son « habitus » non académique de philosophe artiste et de littérateur. Il y a aussi son attitude ambivalente face à la classe bourgeoise : d’une part, Schopenhauer est très nettement un petit bourgeois réactionnaire qui méprise la période prérévolutionnaire d’avant 1848, le « Vormärz » ; d’autre part, en tant que demi bohémien, il est un ennemi de la mentalité bourgeoise étriquée (le « Spiessertum »), qui se manifeste surtout dans l’institution du mariage, cible de sarcasmes perpétuels pour ce misogyne grognon et animé par ses pulsions. Pour s’assurer un certain équilibre émotionnel, notre célibataire endurci s’est flanqué pendant toute sa vie d’un compagnon canin, un caniche : dès que l’un de ces animaux favoris mourrait, il s’en procurait un nouveau qu’il baptisait invariablement « Atman », comme tous ses prédécesseurs. Ce nom signifiait en sanskrit « souffle de vie » ou « âme individuelle », car, croyait-il, il y avait, actif, dans chaque caniche un seul et même principe de vie, le « Pudels Kern », le « noyau du caniche ».
Schopenhauer est lié à son temps quand il exprime son système philosophique basé sur la volonté ; il l’est également dans l’insouciance relative dont il fait montre à l’endroit de toute recherche empirique, ainsi que dans sa prétention à pouvoir présenter une interprétation générale du monde qui sera à jamais irréfutable. Mais les impulsions qui partent de son œuvre pour aboutir à notre temps sont fort nombreuses. Parmi elles : son « habitus » non académique de philosophe artiste et de littérateur. Il y a aussi son attitude ambivalente face à la classe bourgeoise : d’une part, Schopenhauer est très nettement un petit bourgeois réactionnaire qui méprise la période prérévolutionnaire d’avant 1848, le « Vormärz » ; d’autre part, en tant que demi bohémien, il est un ennemi de la mentalité bourgeoise étriquée (le « Spiessertum »), qui se manifeste surtout dans l’institution du mariage, cible de sarcasmes perpétuels pour ce misogyne grognon et animé par ses pulsions. Pour s’assurer un certain équilibre émotionnel, notre célibataire endurci s’est flanqué pendant toute sa vie d’un compagnon canin, un caniche : dès que l’un de ces animaux favoris mourrait, il s’en procurait un nouveau qu’il baptisait invariablement « Atman », comme tous ses prédécesseurs. Ce nom signifiait en sanskrit « souffle de vie » ou « âme individuelle », car, croyait-il, il y avait, actif, dans chaque caniche un seul et même principe de vie, le « Pudels Kern », le « noyau du caniche ».