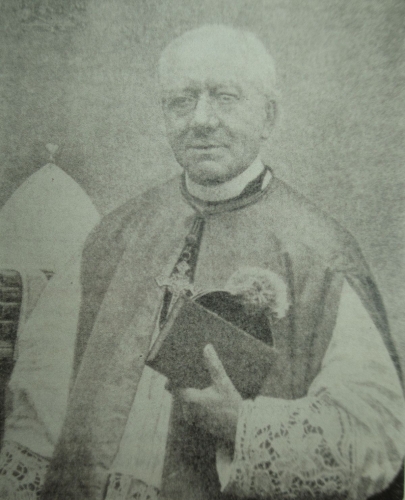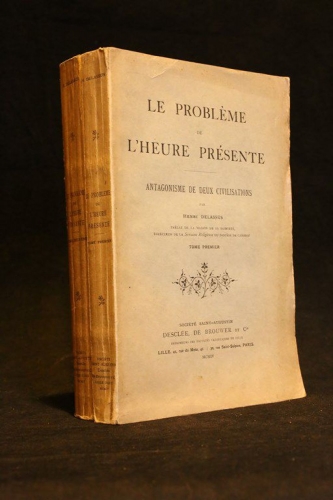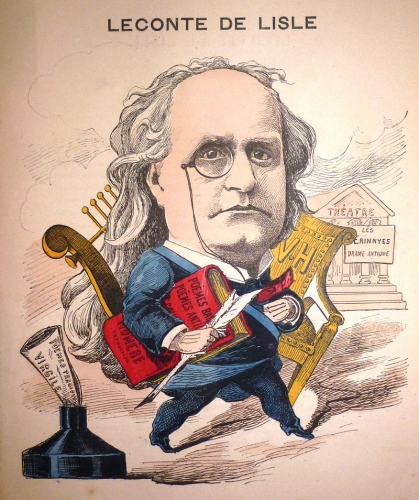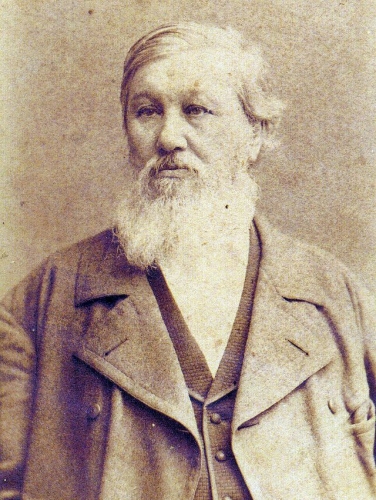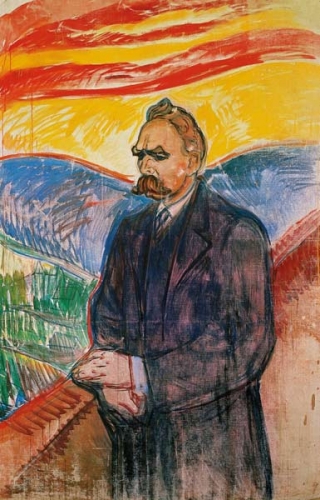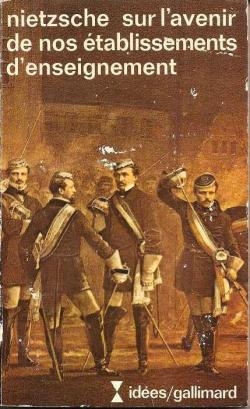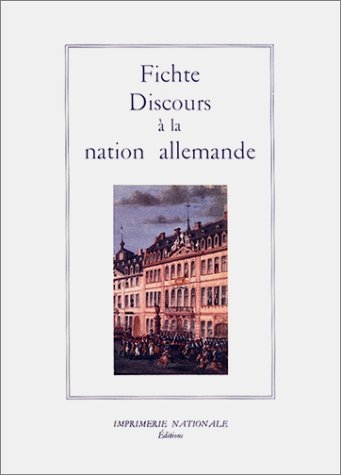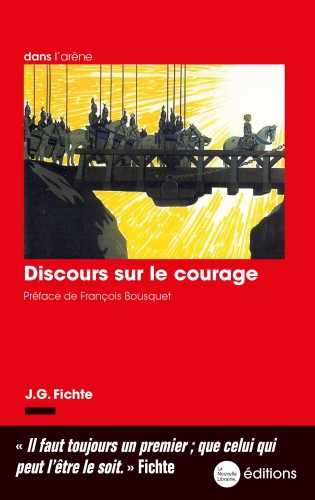mardi, 25 novembre 2025
Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen
Claude Bourrinet
Gérard de Nerval incarne parfaitement l'oscillation entre l'étreinte de la limite – discipline rationnelle, concept astreint, expression dirigée, ethos mesuré -, et la dynamique transgressive du dire, de l'émotion, de l'esprit, du rêve, de la folie, de la quête, balancement qui caractérise l'Occident depuis la Grèce préclassique jusqu'au romantisme historique et au-delà. On peut, comme Northrop Frye, George Steiner, ou René Girard, par exemple, évoquer un romantisme intemporel (comme l'est aussi, du reste, le classicisme). Autant dire que l'exploration de l'oeuvre nervalienne se prête singulièrement à une auscultation de l'Occident à la recherche de son identité, du moins de l'un de ses deux pôles dialectiques. Nerval incarne précisément cette crise où l'Occident ne peut plus rester le même, et où il lui faut se transmuer en ce qu'il est peut-être profondément: une fascination de l'illimité, une plongée vertigineuse, mortelle ou rédemptrice, dans ce gouffre qu'est l'homme.
Le moment Nerval, une crise dans le destin européen
La révolution romantique
L’œuvre de Nerval apparaît, en France, plus peut-être que celle d’un Chateaubriand ou d’un Hugo – nous verrons pour quelles raisons -, comme l’enregistrement enfiévré de la secousse sismique que fut la « crise de la conscience occidentale » de l’ère dite – selon la terminologie européocentrée des historiens - « contemporaine ». Précipitée par la déchirure révolutionnaire, elle fit suite à celle du XVIIe siècle, qui avait ébranlé l’Europe « baroque » par la critique dissolvante de la religion, de l’autorité de l’Église et de la tradition, commotion résultant de l’émergence de la science, du relativisme et du scepticisme hédoniste. Après les Guerres de religions, on s’efforça d’y faire face, avec plus ou moins de succès, par un surcroît de contrainte idéologique, étatique, et stylistique. Le classicisme mit de l’ordre dans les esprits, sinon dans le langage. Or, le romantisme fut le jaillissement d’une lave incandescente qui déforça et submergea le corset tellurique perclus de dogmes rationalistes, mais de plus en plus décrépits, dont la France des Lumières, des gazettes et des salons parisiens, avait ceintré l’Europe. La secousse se prolongea dans le symbolisme ; le surréalisme, après la convulsion dadaïste, en fut l'achèvement « existentiel », peut-être provisoire. Car le soulèvement spirituel qui avait presque tout emporté excédait les limites de l’art, et nous remue encore.
Afin de saisir le « cas Nerval », non sous un angle réducteur, par une polarisation sur la dimension littéraire (comment le classer ?), ou clinique (les circonstances sordides de son suicide … ou de sa « folie »), il est nécessaire d’opter pour un ouverture plus "civilisationnelle", en menant une analyse philosophique, théologique, religieuse et théosophique, et en prenant en compte le constat de la rupture entre le Divin et l’homme menacé d’un assèchement radical de sa présence au monde.

Dans la « suite » de poèmes intitulée « Le Christ aux Oliviers », Nerval s’inspire de Jean-Paul Richter, de son roman Siebenkäs (1796-1797) : Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei ; « Discours du Christ mort depuis l'édifice du monde, qu'il n'y a pas de Dieu », œuvre souvent appelée "Le Songe" en français, et traduite partiellement par Madame de Staël. Nerval place en épigraphe ces deux vers de Jean-Paul : Dieu est mort ! le ciel est vide… / Pleurez ! enfants, vous n’avez plus de père ! Au XIXe siècle, on entérine l’idée de la « Mort de Dieu » ( id est le Dieu « judéo-chrétien » sur qui pèse, du reste, le lourd soupçon d’avoir tué le « Grand Pan », le christianisme étant, selon Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion).
Cette idée du « désenchantement du monde » (Max Weber ; Entzauberung der Welt), qu’incarne, si l’on ose dire, le cadavre du Dieu fait Homme (ainsi Dostoïevski fut-il frappé par le tableau d’Holbein représentant le corps rigidifié au regard vitreux du Christ martyrisé), hante l’Occident. Et, au fond, on pourrait penser qu’il s’agit-là, peut-être, d’un signe, d’une marque propre à l’identité occidentale, car le nihilisme semble se présenter déjà, sous certains aspects (la contingence absolue et angoissée des mortels, ou le « Crépuscule des dieux », et l’idée de Fin du monde – ou d’un monde), dans la Weltanschauung des Indo-européens ou des cultures sémitiques. Ce serait envisageable s’il n’existait le même mythème, d’une sorte de cataclysme final - ekpurosis, déluge, extinction du Soleil, ou toute autre déclinaison apocalyptique- (donc d’effondrement de l’Ordre et de dilution du Sens), dans la plupart des civilisations extra-eurasiatiques – idée obsédante qui nous travaille encore maintenant. Il est vrai que l’idée de renaissance cyclique, ou, plus rarement, de parousie (après parfois une période de souffrance), est affirmée dans tous les cas. Et pour des romantiques comme Nerval, l’espoir d’une palingénésie, de la métamorphose des dieux et des religions, idée que Pierre-Simon Ballanche avait soutenue, permet de ne pas perdre tout espoir.
Ainsi, en un premier temps, Nerval témoigne-t-il de la tentative réitérée depuis plus d’un siècle, face à une religion sclérosée et décadente, vidée de sa substance mystique, de recouvrer le lien rompu entre le Ciel et la Terre, de retrouver la lettre perdue de la langue cosmique, de récupérer l’âge d’or. Par voie de conséquence, le « péché » - qu’il ne faut pas appréhender dans un sens religieux, mais mythique - le « Mal » par conséquent -, c’est l’Exil, la perte, la séparation, hantise d’un homme dont la mère, qu’il connut à peine, alla trouver la mort, en 1810, dans un pays glacé comme l’enfer dantesque.
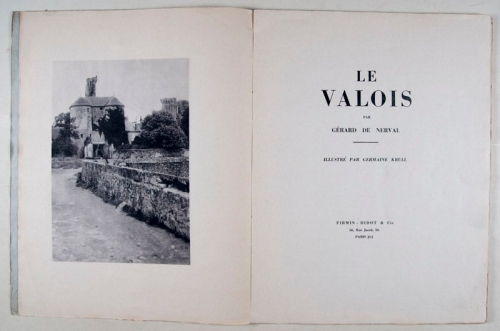
Cette bolgia infernale, où reposent, inapaisées, les cendres maternelles, est la prémonition d’une société de deuil. La révolution industrielle déshumanise le monde par le productivisme et la marchandise dissolvante. Les villes tentaculaires vont rassembler une humanité déshéritée, massifié, indifférenciée, mécanisée, par opposition à une campagne encore authentique, enracinée, différenciée, mais, elle aussi, de plus en plus rongée par l’esprit de gain et de fabrique, même dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France. Certes, la Fin du monde se présente, sous le roi bourgeois (et surtout en Grande Bretagne, qui profile l’avenir de l’Occident), selon des apparences moins grandioses que celles proposées par les traditions eschatologiques. Elle promet d’être plutôt froide, glaçante, et interminable, un long cauchemar. Et surtout, elle est descendue à un étiage sordide, radicalement sécularisé, Elle se traduit par un changement social profond, quasi anthropologique, dont l’homo œconomicus est l’acteur, personnage amoindri d’un âge de fer et de charbon, où Sylvie ne confectionne plus de dentelle (« on n’en demande plus, dans le pays ») : - Que faites-vous donc?» Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. « Qu'est-ce que c'est que cela ? — C'est ce qu'on appelle la mécanique; c'est pour maintenir la peau des gants afin de les coudre. — Ah! vous êtes gantière, Sylvie? — Oui, nous travaillons ici pour Dammartin, cela donne beaucoup en ce moment …
Paradoxalement, Nerval balance entre un progressisme inspiré par les Lumières – mais à vrai dire, du bout des lèvres, comme un réflexe idéologique acquis, ou peut-être parce que les Illuminés dont il a écrit la vie, dans l’ensemble, croyaient en un avenir délivré de l’étouffoir chrétien -, et un pessimisme profond devant les dégâts causés par la modernité.

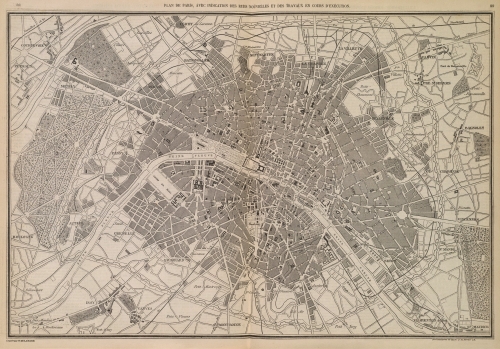

Dans le même temps où il se désole, par exemple, de la disparition du vieux Paris, les urbanistes louis-philippards n‘ayant pas attendu la curée Haussmannienne pour tailler en pièce la cité médiévale, il partage, avec un romantisme d’opposition, une autre acception du « Mal », à rebours de la religion officielle, se traduisant par une admiration fervente pour la révolte de Satan, (moi, qui suis feu issu de feu, le premier ange à avoir été façonné), que Jésus a vu « tomber du ciel comme l’éclair », ou la rébellion des Titans réfractaires à la tyrannie de Zeus. Nerval avait conté, dans la relation de son voyage en Orient, l’insoumission d’Adoniram, amant de la Reine de Saba, Balkis, victime de Salomon, et grand architecte, sculpteur génial, artiste maudit, maître du Feu. Tous ces factieux mythiques incarnent le progrès, comme Prométhée. Hiram et la Reine de Saba sont tous deux des figures majeures de la Franc-maçonnerie, dont Nerval était proche.
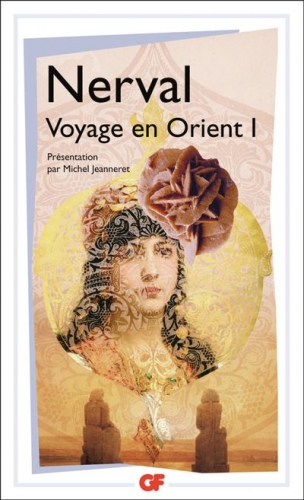
Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l’engagement politique de Nerval qui, non seulement, est loin d’être constant, si l’on signifie par là qu’il aurait partagé les rêves républicains d’un renversement insurrectionnel, mais, quand, par aventure, on le constate, par exemple à la suite des Trois Glorieuses, on discute encore de son sérieux. Il ne fut souvent ajusté à ce monde, qu’il ne pouvait ignorer, car il côtoyait l’escouade des Bousingots, que de manière fort lâche, contingente. Mais cet emballement très contrôlé par une discrétion, une timidité, et une propension à la rêverie devenues proverbiales, ne dura qu’un temps fort bref. Les inductions réalisées par l’analyse de son œuvre permettent de définir, chez lui, une ferme opposition à toute censure (littéraire, morale, religieuse...), mais aussi un scepticisme idéologique non moins solide. Il réagissait en écrivain pour qui publier, chercher, penser, s’exprimer, est une respiration vitale, et un gagne-pain. Toujours est-il qu’il éprouvait une indifférence certaine à l’égard des dissensions politiques du moment, même en pleine révolution, en 1848, et qu’il a eu recours à l’aide ministérielle de la monarchie de Juillet, après 1840, pour se rendre en Orient, ou pour régler les frais de son hospitalisation, non qu’il appuyât le Roi-poire, mais parce que la vraie vie était ailleurs.

La voie du rêve
Ainsi Nerval ne propose-t-il pas de système, ni politique, ni métaphysique, et n’essaie-t-il pas de concevoir une mythologie structurée et cohérente, hormis en soulignant ses affinités avec Orphée, et surtout dans son insistance sur la figure d’Isis (qui peut d’ailleurs se décliner en avatars féminins, telles Artémis, Vénus, la Vierge, etc, véritable leitmotiv mystique, puisé dans le vaste corpus ésotérique de la théosophie néoplatonicienne égyptomaniaque). Loin d’être intellectualisée – ce qui ne signifie pas qu’il n’y mette de la méthode et une certaine lucidité logique -, son entreprise de réappropriation de l’Être, de la plénitude, pourvue de multiples facettes, ésotérique, théosophique, théurgique, occultiste, métaphysique, philosophique, part du sujet, désormais central depuis la cassure du XVIIe siècle, en plongeant, à la suite des romantiques allemands, en-deçà de la Raison, dans la deuxième vie qu'est le rêve (et les surréalistes suivront).
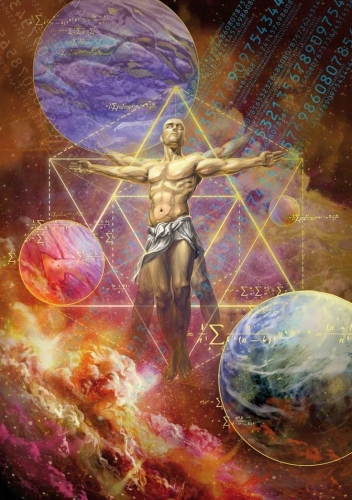
La théologie des Pères de l’Église et des docteurs scolastiques, englobait l’homme dans le tout cosmique. Adam et Eve avait été créés après le Cosmos (le péché originel est véritablement la révolte du sujet contre l’étau bienveillant d’un Dieu jaloux de son omnipotence, instaurant ainsi une dissonance, une sécession, un schisme dans l’Ordre divin). L’Un précédait, dans l’ordre de procession plotinienne, l’Intellect, l’âme et les sens (les dernières paroles de Plotin sont : « Je m’efforce de faire remonter ce qu’il y a de divin en moi à ce qu’il y a de divin dans l’univers »). Le microcosme était le reflet du macrocosme. Le sujet n’était pas central. L’anthropologie du monde traditionnel est holiste. En revanche, la centralité du sujet appartient à un monde éclaté, émietté, individualiste, orphelin : la solitude de l’homme face au cosmos est absolue, comme l’a constaté, avec des accents désespérés, un Pascal.
Le chemin de Nerval est très long, très ancien, archaïque, c’est une longue boucle, comme disent les randonneurs, non sans à-pics. Il renoue avec l'hellénisme des mythes, présents par exemple dans de nombreux poèmes des Chimères (Car la Muse m’a fait l’un des fils de la Grèce). Ces mythes, les "physiciens" (ceux que l’on nomme maintenant les « présocratiques ») de la Grèce préclassique, avaient tenté de s’en défaire en fondant une explication rationnelle du monde et de l’homme, et en distinguant globalement l'univers en deux dimensions, celle du Logos, et celle du sensible, du mouvant.

Le terme physis serait particulièrement approprié à la vision poétique de Nerval, car il s’agit-là d’une nature qui n’est pas du tout celle que la science moderne étudie et modifie (celle qui est objet de l’arraisonnement théorique et pratique du sujet), mais la totalité des phénomènes, de ce qui apparaît et se déploie pour former un monde. Mais ce qui le différencie des « sages » de l’époque pré-classique de la Grèce, c’est une irrationalité qui accompagne sa démarche ésotérique : ce qui apparaît (φαίνω, phaino, « apporter à la lumière, faire briller, remplir de clarté, briller, être brillant, resplendissant, devenir évident, être amené à la lumière... »), se déploie, cache le secret, et le révèle en même temps, mais seulement à l’initié. Nerval est plus proche des mystes d’Éleusis, que des Ioniens ou des Éléates, et il est dionysiaque, tout autant qu’apollinien, surtout orphique...
Enfin Platon vint. Réinterprétant le monisme de Parménide, dont il reprend la notion d’Être parfait, éternel, immuable, source de ce qui est, il a consacré la distance, entre le monde des sensations fuyantes et insaisissables, dégradées (celui des phénomènes selon Héraclite), et le monde des Idées, des essences, du Bien, lesquels sont subsumées, selon le néoplatonisme, au IIIe siècle, sous l’Un, par le mode de la procession, systématisant ainsi la hiérarchie ontologique platonicienne.
On sait que le nominalisme du XIVe siècle, dont l’illustre représentant est Guillaume d’Ockham, de l’Université d’Oxford, opposé à Thomas d’Aquin et à Duns Scot, confina les « Universaux » dans la sphère sémantique des signes (sémiotique), des noms, des structures mentales, des concepts, instaurant une rupture radicale entre les signifiants, les signifiés (le discours, la parole, la langue, le concept, la « représentation ») et les essences, le référent, qu’il fût « intérieur », ou « extérieur ». Et au fond, n’est-ce pas la condition de l’œuvre fictionnelle, d’être close et autoréférentielle ? Ainsi n’avons-nous plus accès à une gnose, à la connaissance absolue et initiatique des choses divines (qui relève désormais de la foi, de la théologie), ni aux réalités extra-mentales. C’était ainsi placer le problème de l’accès au « vrai », au niveau épistémologique, de l’étude de la constitution des sciences, ou de la connaissance en général (c’est ainsi que sont jetées les bases lointaines de la méthode analytique et logique anglo-saxonne). S’en trouvaient limités les pouvoirs cognitifs de l’homme – bornes relativisées par une approche empirique orientée vers les particularités, du singulier. Ainsi naquit l’Occident moderne, selon Foucault, Cassirer, Gilson, Guitton, et d’autres...
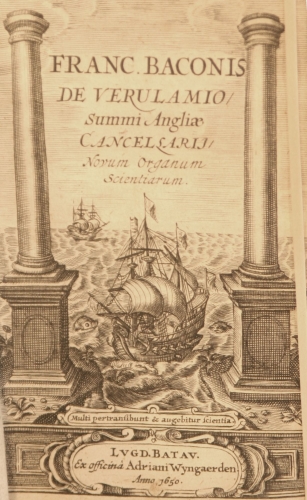
Deux ou trois siècles plus tard, ce nouvel « instrument » oxonien d’investigation du monde des phénomènes, trouvera un champion en Francis Bacon, dont le Novum Organon scientiarum – 1620 - tire les conséquences pratiques du rejet de l’aristotélisme. Dans le même temps, la mathématique constitue, en quelque sorte, après la tabula rasa cartésienne, une arkhê ferme pour étayer la science des Temps modernes. Les révolutions scientifiques du début du XVIIe siècle auront une portée utilitariste revendiquée et des conséquences politiques : la subjectivation, nécessairement centrée sur l’individu, donnera, explicitement ou implicitement, aussi bien l’absolutisme (Hobbes, « homo homini lupus est ») que la démocratie potentielle (Descartes, « […] la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes »). Le baroque part du bas pour aller vers le haut toujours plus inaccessible ; il est vision humaine, d'un homme soudain perdu dans le cosmos. Montaigne a pris acte : ne reste plus que l'homme relatif, et il faut essayer d'en être heureux. Les jésuites ont essayé d'aménager la demeure, par une sorte de tranquillité active (Saint François de Salles, qui doit tant à Montaigne), suscitant l’indignation de Pascal.
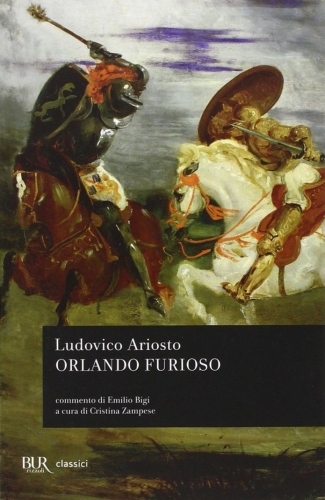
Ambivalent, le baroque donne une structure « culturelle » à la reconquête des esprits et des cœurs par l’Église catholique, mais il est aussi une aspiration violente à la liberté. Il préfigure le romantisme. L’aristocratie, dès la deuxième moitié du quattrocento, à partir du triomphe européen de la Renaissance et des grandes chevauchées italiennes, désirait ressusciter les Grands Hommes de l’Antiquité, les héros mythologiques grecs et romains, ou bien les preux de Charlemagne (ceux de la Matière de Bretagne étant passés de mode au XVIe siècle) – ainsi Boiardo, avec l’Orlando innamorato (1483), L’Arioste, avec son Orlando furioso (1516), et Le Tasse, avec sa Jérusalem délivrée -, tendance qui allait perdurer tout au long du XVIIe siècle, comme une réplique concurrente de divinisation royale, dont l’achèvement fut l’apothéose solaire de Versailles. Ces chimères épiques et tragiques, héroïques et flamboyantes, que Nerval n’aurait pas désavouées, destinées à se transmuer en œuvres opératiques ou en romans à clés, étaient impuissantes devant la froide nécessité socio-politique. Elles inspireront les chefs de la Fronde ou des guerres étrangères : c’étaient souvent les mêmes, comme Condé-Cyrus, mais les duchesses et comtesses n’avaient pas voulu être en reste sur ce chapitre glorieux.
Au début du siècle, après le chaos des Guerres de religions, Henri IV, ayant remis de l’ordre, du moins provisoirement, et le Cardinal Rouge ayant pris la suite, la mise en pratique des intuitions absolutistes développées par Bodin dans La République, s’imposait, en attendant leur réalisation complète avec Louis Le Grand. La contre-Réforme oriente les esprits dans les principes d’obéissance. Les poètes, dans les salons, notamment celui de la marquise de Rambouillet, se font arrangeurs de syllabes et joueurs mondains. Peu à peu, la nouvelle noblesse de cour, pénétrée par la bourgeoisie riche, prend le contre-pied des aristocrates du XVIe siècle, qui étaient animés par un esprit affranchi. Malherbe est venu et a initié ce qui allait devenir le classicisme, cette autodiscipline de l’art, faite de rétention, d’ascèse, d’appauvrissement de la langue et de contraintes consacrées par la création de l’Académie française en 1635, entreprise – souvent hasardeuse- de domestication des intelligences et des talents. Les règles, au théâtre, s’imposeront dans les années 30, ainsi que les « poètes grammairiens », les « docteurs en négative », comme le dénonce Mlle de Gournay.
La révolte poétique sera l’expression du refus d’une entreprise littéraire cornaquée par la Ragione di Stato, dont l’incarnation despotique est Richelieu. Les champions de la rébellion en seront, dans le domaine théâtral, Hardy, le grand Corneille lui-même, avant qu’il ne se plie, avec génie, aux règles, et en poésie, Régnier, anti-conformiste, individualiste original, Théophile de Viau, libertin converti, qui, bien que « moderniste », avait toujours sous sa plume le mot de « franchise », mort à 36 ans après avoir été mis au cachot par les cagots, Boisrobert, sévère envers un siècle voué à l’argent, Saint-Amant, La Ménardière, qui célébra « le grand Ronsard », le concettiste Tristan… Tous ces écrivains sont des êtres de plein air, des amants de la liberté, de la libre expression de soi (comme Angélique, cette Fille du Feu), sans laquelle il n’est pas de noblesse. Même Sorel, le satirique qui ne l’aimait pas, louait « l’âme véritablement généreuse ».
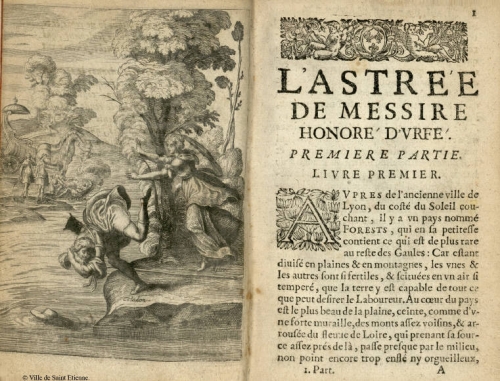
Et il n’est pas d’auteur exprimant mieux cette aspiration qu’Honoré d’Urfé, qui a donné à la France l’exquis roman pastoral L’Astrée, qu’il situe dans le Forez, au milieu des bergers et des druides. Rien de plus étranger à l’ancien ligueur catholique que la médiocrité. Il prône une éthique platonicienne, fondée sur l’amour, le sublime, l’enthousiasme, la générosité, tous mouvements de l’âme et du cœur qui portent le fini vers Dieu. Honoré d’Urfé, c’est l’anti-Descartes, le négateur de l’esprit géométrique. Racan le suivra dans ses Bergeries, célébrant l’âge d’or. Mais l’Astrée est une utopie dans un siècle qui s’adonne à l’intérêt, à l’utilité, à l’ambition calculée, à la ruse, à la mathématique appliquée.
Face à une modernité triomphante, celle de la Raison, le baroque, lui-même paradoxalement mouvement d’« avant-garde », se manifeste comme la prise hyperbolique d’une réalité vaine et fuyante, un tourbillon frénétique de sensations exaltantes ou mortelles, l'ivresse angoissée au cœur du vide, et la conviction que la vie, comme l’affirme Calderón de la Barca, se joue sur une scène, sur El Gran Teatro del Mundo : La vida es sueño. Quelle est donc la sagesse de Sigismond, jeune héritier du trône (ce roi dépossédé, comme Nerval l’héritier inconsolé d’un lointain empereur...), prisonnier du roi Basile (encore un thème nervalien!)? Même si l’existence est irréelle, si vraiment je rêve – comme un fou ?, et que rien ne prouve la réalité de ce que je crois avoir la consistance du réel, si bien que j’ai l’impression de vivre tout en rêvant, et de rêver, tout en vivant (« La vie est un songe, et les songes eux-mêmes ne sont que des songes »), j’agirai comme si c’était réel, fût-ce en rêve, c’est-à-dire avec honneur et humilité. Il est possible d’être maître de soi, même dans le songe. L’affirmation du moi transcende toute détermination psycho-sensorielle et mentale, tous les ancrages aux mondes possibles. Il est un absolu, telle la folie.
Au XVIIIe siècle, la séparation, dans l’ordre de l’épistémologie (que puis-je connaître?) entre l’homme et le monde qui lui est « extérieur », entre le phénomène et le noumène, comme dit Kant, entre ce que notre « conscience », générée par nos structures cognitives, perçoit, appréhende, et la « chose en soi », inaccessible, est admise, du moins dans certains cercles philosophiques (cela n’empêche pas le commun des mortels d’agir naïvement comme si le monde était « réel », et il aurait été bien surpris, ce jedermann, qu’on tentât de le persuader qu’il en fût autrement =. Cependant, l’idéalisme allemand va essayer de résoudre le problème de cette dichotomie en faisant abstraction du noumène.
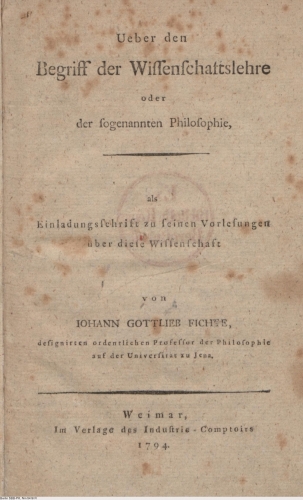
La Wissenschaftslehre (« Doctrine de la science »), est publiée en 1794. Fichte pose le moi comme fondement du monde, jetant ainsi les bases de ce que sera plus tard la phénoménologie. La réalité n’existe pas en-dehors de la conscience. Aucune frontière n’est destinée à interdire la création. Le rêve s’offrait ainsi à l’investigation du Je. Novalis en parsème son œuvre. Pour Friedrich Schlegel, il est un moyen d’accéder à des réalités supérieures. Gotthilf Heinrich Schubert en analyse la symbolique. Avec l’idéalisme allemand, les spéculations sur la fusion de l’art et du réel (de Novalis à Wagner) seront récurrentes (1). On ne connaît pas exactement la liste des romantiques germaniques que Nerval a pu étudier, et s’il a lu les idéalistes – Kant, Fichte, Schelling, Hegel – comme Madame de Staël l’avait fait. Il ne maîtrisait pas suffisamment la langue allemande pour aller loin, bien qu’il traduisît, outre Faust, plusieurs poètes allemands (Goethe lui-même, Schiller, Klopstock, Burger, Jean-Paul Richter etc.). Le romantisme français, comme le fait remarquer Julien Gracq, n’« a que très vaguement connu » le romantisme allemand, et a, dans l’ensemble, hormis Nodier et Nerval, parfois Hugo, méconnu la dimension infinie de l’être intérieur, pour se « pay[er] de menue monnaie [...] : médiévalisme, orientalisme, inauthentique charme des nuits de lune, petites mélancolie des crépuscules », à l’exception du « sens tragique, inexorable, de la pesée de l’histoire - ignoré de l’Allemagne de Kant et de Hegel » (Préface de Henri d’Ofterginden, de Novalis).
Toujours est-il que, pour Nerval, et du reste pour la plupart des romantiques, le Je est la source de toute connaissance et expérience. Mais il élargit ces plongées davantage que quiconque, jusqu’à l'"infra-conscient", dans les racines mêmes de ce qui fait « image », dont la nature cachée laisse pressentir des mystères, et peut-être même des divinités, des monstres, ou des lieux habités par les ancêtres, aussi graves que la réalité et peut-être plus denses, lestée d’une charge spirituelle plus forte que dans la vie éveillée. Car, par « infra-conscient », il faut comprendre le rêve, mais, lorsqu’on lit Nerval, on voit qu’on va aussi profondément que le fit Freud, lequel, on s’en souvient, suscita une admiration enthousiaste de Breton, en 1920, à la grande surprise du psychanalyste (au prix d’un malentendu, car, pour Breton, et, plus tard, dès 1924, les surréalistes, comme pour Nerval, l’explicitation du rêve, ou de tout récit profondément intériorisé, ne vise pas à guérir d’une psychopathologie, à s’en délivrer, mais à retrouver le monde, à l’habiter). Selon Nerval, il s'agit d'un Réel aussi tangible et existentiel que le monde de l'éveil, la balance égale entre le monde physique de la veille et l’aisance du sommeil, dit René Char. Le « Réel », la Poésie, donc, mise en pratique. La Poésie, c’est la vraie vie, excédant, ô combien, le graphisme de la feuille imprimée.
Toute cette manifestation subversive est dirigée contre la conception cartésienne de l'intellect, instrument de maîtrise, de domination de la nature. Le sensible, que Descartes considérait, à la suite de Platon, comme menteur, devient source de vérité, non seulement le sensible extérieur (les paysages, la beauté des choses, la musique etc., souvent mêlés de la mémoire des mythes et des souvenirs littéraires ou picturaux), mais aussi le sensible intérieur, qui est un continent inexploré, immense, qu'il faut parcourir pour restaurer le divin, et réanimer les anciens dieux et déesses, ainsi que les Titans révoltés. Le rêve est en effet sensation de monde qui mène jusqu’à l’origine de toute chose, qui offre la clé ouvrant à la vraie vie. "Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire ainsi." (André Breton, Manifeste du Surréalisme (1924)).
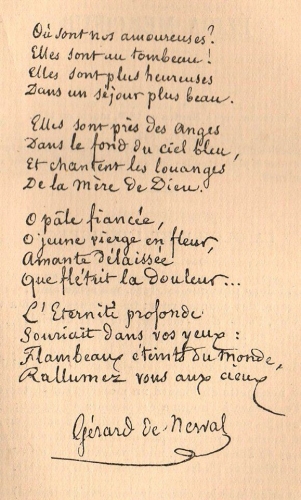
Nerval et l’écriture
Ainsi, une fois donc qu'on a parcouru la voie labyrinthique des œuvres de Gérard de Nerval, et qu'on pense, non sans quelque vanité, en être sorti, s'aperçoit-on bien vite qu'il est inutile de fonder la connaissance qu'on croit obtenir de lui sur les données, fiables ou non, qu'abandonnent à notre curiosité des documents divers sur sa vie, dûment enregistrés par les multiples instruments taxinomiques que possèdent les archives de la police, de la société des Lettres ou de la vie civile. Il échappe à la classification, et déborde les discours qui voudraient le fixer au mur de la critique comme un papillon.
Nerval est tout poésie, c'est-à-dire création, et avant tout de lui-même – c’est peut-être là source de fatalité et de tragédie - ; son identité erratique suit les méandres de son écriture. Ce mystère s’est inscrit dans sa mort. Son suicide, à l'aube du 26 janvier 1855, dont les causes vraisemblables s'imposent au bon sens – la misère, la maladie, le froid extrême (-20°), la nuit angoissante, la solitude, l’abandon -, demeure néanmoins de tous ses actes le plus énigmatique et le plus paradoxal, si l'on s'en rapporte aux accents lumineux et positifs de la fin d'Aurélia, œuvre posthume, notons-le, qui survit à sa mort biologique, non sans ironie hoffmannienne.
La situation de Nerval devant son œuvre manifeste un autre rapport au mot que la transparence naïve que louait le classicisme bannissant le trouble et le désordre. Il avait donc, dès 1828, touché par le charisme du « prophète » Hugo, embrassé la cause romantique. Plus profondément, il prit au sérieux le cahier des charges de la littérature, avant qu’elle ne subît, dès la Grèce classique du Ve siècle, l’opprobre de contredire la rationalité philosophique, scientifique, ou technique. Le romantisme va bien au-delà des mérites que l’« École » française lui accorda : le sens de l’Histoire, la liberté, l’imagination, la révolte, et même, à Paris et en Italie surtout, la tentation humanitariste et politique. Certes, la Révolution, plus que le royalisme qui, du reste, fut aussi rétif face à lui que les libéraux voltairiens, fut au fond le véritable ébranlement par lequel la passion s’immisça dans les cerveaux échauffés. Chateaubriand lui doit beaucoup, et jamais Nerval ne la renia. Saisissant même les romantiques allemands, et certains Illuminés, comme Louis-Claude de Saint-Martin, en France, qui espérait l’instauration d’une nouvelle religion, à la place du christianisme, elle ouvrait tous les possibles.
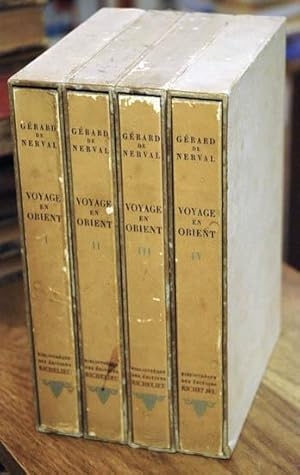
Pourtant, il faut aller chercher beaucoup plus loin les sources de la subversion romantique, et l’on retrouvera Nerval, qui est de son temps tout en l’excédant.
Nerval tenta, en décembre 1842, le retour aux sources, l’Exil volontaire, réponse décidée à la crise qui l’avait abattu en février 1841, le « Voyage en Orient » (dont on sait qu’il fut plus réécrit, que donné tel quel), la quête des origines du Divin, de la naissance de la Lumière et de la Sagesse. Ex Oriente Lux. Il y chercha la hiérogamie, le Dieu Soleil, la coïncidence de tous les contraires, de la femme et de l’homme, de l’homme et du Divin, de la Nuit et du Jour, de l’Est et de l’Ouest, du Feu et de la Poussière, de l’ascension et de la chute, de la base et du sommet, du passé et du présent. Mais il ne parvint pas à la conscience unificatrice. Tout échec mûrit. Il en garda une vérité : l’Orient se trouve au seuil de la maison, dans « le lit du poète », affirme-t-il. Pour Nerval, de retour d’Orient, le « chemin » de la demeure est d’abord le sol natal, le Valois, dont il essaiera de (re)trouver le cœur, la mémoire, et en même temps son identité profonde. Après l’épreuve du voyage, de l’étranger, de l’étrange, il faut que le poète « apprenne maintenant », comme l’écrit Heidegger à propos du poème Souvenir, de Hölderlin, « le libre usage de ce qu’il a en propre ». Mais ce sera encore une épreuve vaine.Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, affirme Proust. Définitivement. Pourtant, le secret se situe encore plus proche de soi, au plus profond de soi-même. Novalis le dit : « Le chemin mystérieux mène vers l’intérieur ».
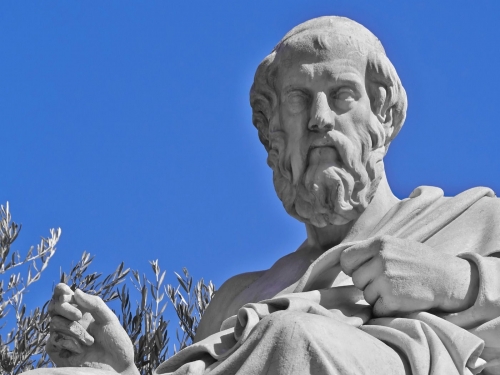
La quête intérieure
Revenons à Platon. Le « tournant platonicien », comme on le sait, bannit le poète de la Polis, comme fauteur d’erreur, susceptible donc de gâcher l’esprit des jeunes éphèbes. Son statut privilégié, que l’on note par exemple chez un Pindare, chez les Inspirés de l’âge préclassique de la Grèce, et qui semblait prévaloir depuis au moins Homère et Hésiode, fut soudain déchu, quand les Muses furent accusées de mentir. La poésie, premier langage de l’Occident, était le pont entre l’Olympe et les humains. Elle s'opposait à la prose, promue langue philosophique par Platon. Les « théologiens » (philosophes) pré-socratique usaient d’une langue qui se rapprochaient de la poésie. La poésie est versification, utilisation de l’allégorie, de la métaphore, codification qui lui montre sa mission mystique, d’établir un espace commun entre dieux et hommes. Ce n’est pas une utopie, comme le sera la République des Lettres de la Renaissance, ni l’Arcadie, mais une hétérotopie, un monde réel, autre (nous retrouverons cette dimension, mais dans le domaine du rêve), où les Muses servent d’intermédiaires entre les dieux et le poète « inspiré » s’adressant à un public pour qui l’existence des dieux ne fait aucun doute. La muse met en parole – ennepe ( ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα ; « Muse, dis-moi l’homme ») – le message venu d’ailleurs. A partir de Platon, qui ne jurait que par la « géométrie », Calliope n'eut plus la prétention de servir de médiation entre le vates et le Divin, et se contenta d’orner la vie, comme une figure rhétorique.

La période hellénistique, alexandrine, fut une ère de rationalisation plus ou moins désacralisante de la poésie, malgré Théocrite. Et aussi malgré Virgile, qui l’entra dans le vaste corpus mystique du néo-pythagorisme. Mais le classicisme latin, volontiers scolaire, héritier de l’alexandrinisme, poli par la paideia, formateur du citoyen eruditio et institutio in bonas artes, eut tendance à réduire le poète à l’état d’artifex, de facteur de versification. La poésie, la langue poétique, s’afficha comme τέχνη, jusqu’à un âge encore assez récent. Rimbaud, déjà, s'en désolait : Voici de la prose sur l’avenir de la poésie -Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse. — De la Grèce au mouvement romantique, — moyen-âge, — il y a des lettrés, des versificateurs. D’Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d’innombrables générations idiotes ....
Marc Fumaroli avait, dans l’un de ses ouvrages brillants d’érudition, L'Age de l'éloquence : Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l'époque classique, souligné combien un passage du Dialogue des orateurs, de Tacite - vers 102 ap J.C. - proposait aux Romains lettrés, entérinant l’inutilité civique de l’art oratoire dans un régime qui étouffait la liberté républicaine, désormais désuète, de nouvelles perspectives – le bonheur apolitique du locus amoenus, comme vita nova de l’honnête homme. Cette utopie bucolique et poétique, celle de Théocrite et de Virgile, qui avaient écrit dans un cadre monarchique, celle aussi du Cicéron du Jardin et de la Bibliothèque, sera restituée à la Renaissance, et l’Arcadie de Jacopo Sannazaro va nourrir l’imaginaire humaniste, puis baroque, jusqu’au romantique Rousseau, que Nerval idôlatra.
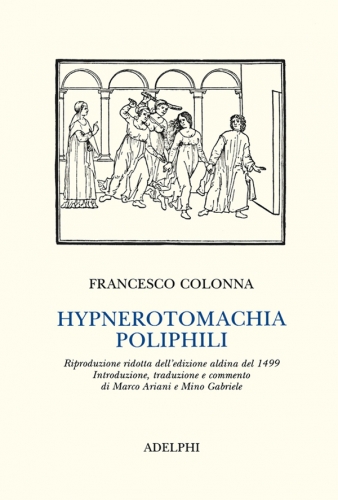
C’est aussi en 1499 que le fameux libraire-imprimeur vénitien Aldo Manuce édite l'Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna, œuvre quasi onirique qui irrigua l'imaginaire européen, la littérature et l’art des jardins, jusqu'à Nerval, et dont l'esprit habite le merveilleux tableau de Watteau, Pèlerinage à l'île de Cythère (car il s'agit véritablement d'un périple sacré, pareil aux mystères antiques), que l’on retrouve, romancé ou rêvé, dans Sylvie, ainsi que dans Le Grand Meaulnes, Ce fut un retournement inouï, qui nous ouvrit à un monde intérieur, loin de tout engagement civique. Nerval, même s’il évoque des figures historiques, et parfois effleure, comme par inadvertance, en passant, pour ainsi dire, les évènements d’actualité, parfois tragiques, est dans un territoire en marge, hors de l’Histoire. Il partagea très vite, avec maints romantiques qui s’étaient illusionnés sur les promesses des Trois Glorieuses, la déception, et même le dégoût, qu’inspira alors la politique.
Mais s’il faut retrouver des précédents, à ces Écoles buissonnières si pleines de charmes, on peut remonter aux guerres civiles qui déchirèrent l’Urbs, et aboutirent à l’Empire, à ces Latins qui défièrent la virtus romaine exigeant qu'on ne devînt homme (uir, quiris) qu'en servant, les armes à la mains, dans les légions, aux confins de l'Univers, pour reculer ou défendre les frontières de l'Empire, ou bien sur le forum, en se donnant à la Res publica. Le fil d’or de la passion, asociale (Tristan et Iseut) et néanmoins dévoilement de vérité, court de Catulle à Baudelaire, en passant par Tibulle, Properce, Ovide, Pour aggraver le cas de ces déserteurs, l’amour est considéré comme le cœur de l’existence, dans une société guerrière qui l’appréhende comme une maladie, comme une déchéance. C’était anticiper. Plus tard, beaucoup plus tard, le troubadour Guiraut Riquier affirmera : « Non es hom senes amor valens » , « On ne peut avoir de valeur sans l'amour ». Amour, alors, fut cette torture merveilleuse, qui permit de découvrir les abysses jusque-là insondés du cœur humain, et prépara cette Odyssée où Nausicaa serait devenue la véritable héroïne d’Homère, et Aurélia l’inspiratrice d’un livre bouleversant, à nul autre pareil. Les chantres de l’amour passion, ou mystique, abondent (et, au XIIIe siècle, avons-nous bénéficié, peut-être, de l’apport raffiné de la poésie arabe, qui influença les Fidèles d’amour - dont l’existence est hypothétique -, source lyrique et ésotérique de la Vita nuova, de Dante) : Apulée et son exquis Âne d'or, puis les troubadours, Chrétien de Troyes, la Matière de Bretagne, Shakespeare, L'Astrée, d'Honoré d'Urfé, Madame de La Fayette, Les Lettres portugaises de Guilleragues, Stendhal, Nerval, etc. L’éros devint le plus sérieux concurrent de l’agapè chrétienne. « Elle n'est sujette, la nature, à s'illuminer et à s'éteindre, à me servir et à me desservir que dans la mesure où montent et s'abaissent pour moi les flammes d'un foyer qui est l'amour, le seul amour, celui d'un être. » (André Breton ; L’Amour fou) .
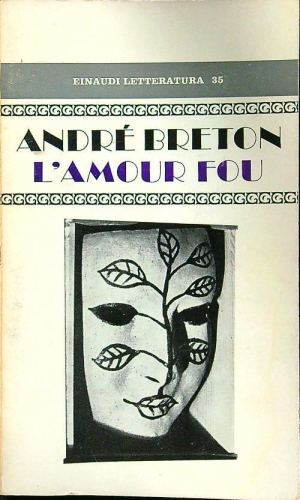
Bref, ce que l’Europe recouvra, avec le romantisme, c’est, en déliant les entraves de la convenance littéraire, qui tenaient le cœur en captivité, la saveur du grand large, le goût de l’infini et de la liberté, dont l’amour est comme l’allégorie.
Il ne fallut donc pas attendre la déchéance de Casimir Delavigne – inspirateur, au demeurant, du jeune Gérard, avant 1828 – pour que resurgît la poésie « grecque » : la Renaissance ranima l'étincelle mystique, par le revif de l'orphisme et du néoplatonisme, sève d'un ésotérisme qui va nourrir en partie les Temps modernes, ainsi que, subrepticement, l'inspiration nervalienne. Entre-temps, le souffle irradiant de la Bible, toujours sous braise depuis la destruction du Temple, mais désormais incandescent, fut attisé par la Réforme et le catholicisme inspiré, parfois soupçonné d’hérésie ou de saveur ésotérique, réfractaire à la « Philosophie ». A côté de la Raison démonstrative, de plus en plus dominatrice en Europe, et la contrariant, la « raison du cœur » rafraîchit la haute poésie, celle des prophètes, offrant à l'imagination et à la passion le Sturm und Drang qui lui était nécessaire, c'est-à-dire l'instinct de liberté et le sentiment de l'infini, dans le monde extérieur et au-delà, mais surtout dans l'intériorité de l'esprit, dans le rêve où se joignent microcosme et macrocosme, et où les contraires coïncident. Face à une civilisation de plus en plus froide et desséchée, sujette aux emballements matérialistes et à la réserve sceptique, on put ainsi redevenir prophète, vates, vaticinateur, et, pourquoi pas, magicien, ou brigand au grand cœur. Ou Illuminé. Ou Voyant. Et ce fut le Romantisme.
La « folie », une voie initiatique
Toutefois, l'œuvre de Nerval n'est pas, à la manière romantique, un épanchement, une confession lyrique, un abri pour le moi, mais le théâtre tragique de son élaboration, de son accomplissement, de son exaucement, dans l'angoisse et la joie. Le verbe est créateur de sens. Il réalise son sens, il est performatif, et c'est pourquoi il est dangereux. Il suit intimement, sans écart, les sinuosités du labyrinthe de la vie, et les éclairs de rêves. Il est lui-même lueur révélante, apocalyptique, illuminante, si l’on ose cette tautologie, et dédale où se dissimule le minotaure, ou bien grotte où s'ébattent les nymphes. Il est la clé qui force le sens, l'Absolu, l’Éternité, le Salut. Mais il est incomplet : il faut trouver la lettre qui manque ; chercher, toujours, sans fin, au-dessus de l'abîme.
Et l'on voit ce qui, soudain, change avec Nerval, et annonce un nouveau continent de la connaissance. Au lieu de se laisser happer par le monde des images, par les visions, de se perdre dans le gouffre de la folie, il tente de maîtriser cet « épanchement », avec une volonté remarquable et poignante, et non seulement d'en considérer les terribles merveilles comme un univers réel, au même titre que celui d'ici, de la terre lourde et laborieuse, mais d'en tirer toutes les leçons, d'en explorer les arcanes pour trouver la lumière. Rappelons l'émouvant et fameux aveu de Baudelaire, pourtant guère prolixe au sujet d'un poète si proche de lui dans le temps et dans l’inspiration, dans la tonalité, répondant au calembour injurieux de Veuillot, qui, dans L'Univers du 3 juin 1855, avait écrit que Nerval avait non pas spiritualisé, mais alcoolisé sa vie : « Qui ne se rappelle les déclamations parisiennes lors de la mort de Balzac, qui cependant mourut correctement ? — Et plus récemment encore, — il y a aujourd’hui, 26 janvier, juste un an, — quand un écrivain d’une honnêteté admirable, d’une haute intelligence, et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, — si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, — délier son âme dans la rue la plus noire qu’il put trouver, — quelles dégoûtantes homélies !... »
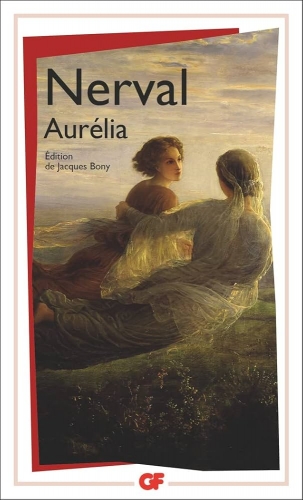
Nerval est peut-être l'être le plus pieux que le XIXe siècle eut sécrété. Dans Aurélia, il indique « les causes d'une certaine irrésolution [les principes de la Révolution, le rationalisme, le scepticisme voltairien] qui s'est souvent unie chez [lui] à l'esprit religieux le plus prononcé ». Il est passé à côté de son temps, et pourtant, il est l'âme d'un âge où la divinité a définitivement quitté la terre désormais désertifiée des hommes, comme l'est la Cythère de 1843, la Cérigo occupée par les Anglais, que surplombe, sur une colline desséchée battue par le clapotis de la Mer de Crète, cette Crète où Ariane dévide son fil, un pendu qui se voit de loin. Il clame dans le désert, en affrontant, dans son propre esprit, le nihilisme qui le ronge comme un monstre chimérique sorti du chaos.
L'expérience du rêve, liée à celle de la nostalgie des origines, transmute sa trajectoire en initiation, en « glissement vers le mythe », comme dit Albert Béguin. C'est retrouver l'aube de l'humanité, l'épanchement du rêve dans la vie réelle, et les déesses, les dieux rendus à la visibilité, à la vénération qui leur est due ; c'est l'expansion du moi, au-delà de la faute originelle, de la mort, de la souffrance, de la solitude, vers une dimension universelle qui concerne l'humanité entière et son destin. Se sauver est retrouver l'harmonie, lui redonner vie, peut-être même rappeler les dieux sur terre, et reconstituer l'Arcadie, l'âge d'or, une nouvelle Cythère, parée d'un amour printanier.

Non sans péril, celui de haute mer. Albert Béguin le rappelle : « Ceux qui se risquent à ces explorations intérieures en ramènent des œuvres singulières et durables, qui conservent de leur auteur, non point son être accidentel et périssable, mais son essence et sa figure mythique. Ils cherchent à rejoindre le plan profond où se déroule, non plus leur propre histoire terrestre, mais leur destinée éternelle. Comme le mystique, ils paient de l'anéantissement de leur personne la plongée dans la nuit. » Heidegger le dit de même : « La détresse en tant que détresse nous montre la trace du salut. Le salut é-voque le sacré. Le sacré relie le divin. Le divin approche de Dieu. / Ceux qui risquent plus appréhendent, dans l’absence de salut, l’être sans abri. Ils apportent aux mortels la trace des dieux enfuis dans l’opacité de la nuit du monde. »
Nerval dit de lui-même, dans Promenades et Souvenirs : « Je suis du nombre des écrivains dont la vie tient intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître. » En vérité, Wege – nicht Werke : « Des chemins, non des œuvres », comme écrivait Heidegger quelques jours avant sa mort. Nerval reprocha à Alexandre Dumas de ne produire que des articles de consommation, des objets de divertissement. Lui, expérimentait. Ses livres étaient des quêtes risquées, des jeux d’arène dangereux où danse la corne du taureau. Lorsqu’avec lui, on évoque la « littérature », il est capital de s’enlever de l’esprit l’acception courante, triviale, de ce mot.
Être tout « littéraire », c’est-à-dire rêve, est une autre façon d’affirmer sa folie. Dans une Lettre à Mme Dumas, il s’indigne: "...Mais comme il y a ici des médecins et des commissaires qui veillent à ce qu’on n’étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voie publique [ Nerval évoque la sempiternelle dénonciation de la littérature – vaine, inutile, nuisible – de la part des êtres positifs, ayant pieds sur terre, qui œuvrent pour le Bien commun, et mettent l’utilité pratique, celle des économistes et des banquiers, au-dessus de toute la beauté du monde – qui, le rappelle Gautier, ne sert à rien ], on ne m’a laissé sortir et vaguer définitivement parmi les gens raisonnables que lorsque je suis convenu bien formellement d’avoir été malade, ce qui coûtait beaucoup à mon amour-propre et même à ma véracité. Avoue ! avoue ! me criait-on, comme on faisait jadis aux sorciers et aux hérétiques, et pour en finir, je suis convenu de me laisser classer dans une affection définie par les docteurs et appelée indifféremment théomanie ou démonomanie dans le Dictionnaire médical. À l’aide des définitions incluses dans ces deux articles, la science a le droit d’escamoter ou réduire au silence tous les prophètes et voyants prédits par l’Apocalypse, dont je me flattais d’être l’un ! Mais je me résigne à mon sort, et si je manque à ma prédestination, j’accuserai le docteur Blanche d’avoir subtilisé l’esprit divin. »).
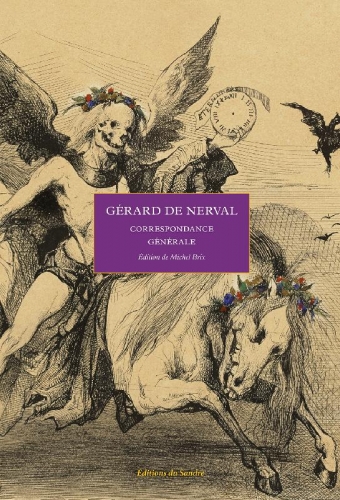
Nerval proteste contre la version clinique, et met l'accent sur la dimension "poétique" (existentielle, en vérité), sur la "voyance", à la suite des romantiques allemands comme Novalis. La "folie" (liée au rêve) est un autre nom pour désigner la création "poétique" (ces deux mots sont des pléonasmes), mais aussi le véritable royaume de la vie humaine, qui ne correspond pas au domaine restreint et restrictif de la conscience "diurne", trop mesquine et trompeuse. La vérité se trouve à l'intérieur de l'être humain, et le monde extérieur est le résultat de la projection de ce contenant trop inexploré. Évidemment, pour un scientifique comme le docteur Blanche (portant très ouvert, adepte de méthodes douces et intelligentes), c'est là une perception entachée de suspicion. Dans les faits, nous ne nous en apercevons pas, mais nous sommes des fous, nous vivons comme des fous. Certes, des fous qui se parent d'un costume "raisonnable", pour donner le change. A moins que nous ne soyons des rêveurs qui croient, parfois, ne pas rêver.
La littérature rend visible, lisible, réelle, cette « folie ». L’île de Calypso, l’antre du Cyclope, dans l’Odyssée, la Terre du Milieu, du Seigneur des anneaux, l’Enfer, de Dante, sont lestés de plus de réalité, de présence (parousia) que le décor urbain évanescent, exsangue et fantomatique de nos besoins erratiques, qui, de la maison au supermarché, de la voiture au bureau, ornent notre vacuité existentielle ; et Julien Sorel, Hamlet, Rastignac, le Grand Meaulnes, Rodion Romanovitch Raskolnikov, Erec et Enide, Don Quichotte (ce proto-Nerval), Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, sans parler du pharmacien Homais, et même, dans les Évangiles, Pierre, Paul, ou Jean, existent davantage, que mon voisin, ou que le ministre de l’économie du moment, et me sont peut-être comme des étoiles à suivre, ou à ne pas suivre. Ils sont la réalité, en vérité. Peut-être la plus authentique, celle qui possède un sens. Ne dit-on pas que les femmes du peuple montraient Dante du doigt, considérant le teint cuivré de son visage comme le témoignage irréfutable de son séjour en Enfer ? Elles avaient la foi du charbonnier. Combien ont cru que Malraux avait participé à la guerre civile de 1927, à Shanghai, et qu’il avait même été l’un des chefs de l’insurrection ? Ernst Jünger, quant à lui, entre deux coups de feu, lisait avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. » Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année.
Les paysages mentaux et le théâtre de nos songes, tout « imaginaires » qu’ils soient, peuplent davantage, même le jour, la salle obscure de notre existence, que ce que l’on appelle la « réalité », mais qui ne se résout qu’à une cascade de données sans signification véritable. Et nous ne sommes essentiellement cette « folie » : grande ou petite.
Note:
(1) « Après toutes ces citations poétiques, je puis moi aussi me permettre d’employer une image. La vie et les rêves sont les feuillets d’un livre unique : la lecture suivie de ces pages est ce qu’on nomme la vie réelle ; mais quand le temps accoutumé de la lecture (le jour) est passé et qu’est venue l’heure du repos, nous continuons à feuilleter négligemment le livre, l’ouvrant au hasard à tel ou tel endroit et tombant tantôt sur une page déjà lue, tantôt sur une que nous ne connaissions pas ; mais c’est toujours dans le même livre que nous lisons. »
[…]
« Si l’on se place, pour juger des choses, à un point de vue supérieur au rêve et à la vie, on ne trouvera dans leur nature intime aucun caractère qui les distingue nettement, et il faudra accorder aux poètes que la vie n’est qu’un long rêve. »
Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1819 (mais la publication n'en a été faite, en France, qu'en 1886.
15:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, poésie, 19ème siècle, romantisme, romantisme français |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 avril 2025
Nerval, l'homo viator

Nerval, l'homo viator
par Claude Bourrinet
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528
Seuls les ignorants ou les sots considéreront encore Nerval comme un écrivain mineur. Longtemps, il fut tenu dans les marges de la grande littérature, non seulement dans les manuels scolaires, mais aussi par la critique. Il y a des raisons à ce mépris, qui ne tiennent pas seulement aux carences des littérateurs. Nerval fut, dans la postérité, aussi intempestif que de son vivant. Il incarne, dans une sorte de pureté effrayante, qui aboutira à la mort sordide, l’essence de la littérature, qui est l’exil.
Car non seulement il illustra, en France, un mouvement romantique, qui, dans les faits, n’était pas homogène, mais il se rattachait à un courant, à une tradition, qui excédaient un XIXe siècle qui était aussi stupide que notre époque. Il fut un antimoderne, comme la plupart des écrivains « maudits » de cet âge scientiste et industriel qui reconnut ouvertement, dans une angoisse mortelle, la mort de Dieu. Il exprima une révolte profonde, au-delà des griseries idéologiques.
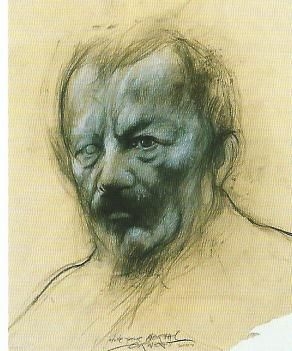
Il fut influencé par le romantisme allemand, autrement plus profond qu’un romantisme français volontiers historien, politique, et qui versa en partie dans un humanitarisme benêt. Il ne lut probablement pas Fichte, l’initiateur de l’idéalisme allemand, mais il connut Novalis, Brentano et Hoffmann. Le moi est un univers, c’est l’univers, le monde. La quête de Nerval, depuis l’explosion de démence qui le projeta vers l’Étoile, le 23 février 1841, et à la suite de son échec en Orient, en 1843, devint intérieure. Là se trouvait le divin, et le cosmos (et il rejoint dans cet itinéraire Goethe, et le Faust, le deuxième, celui de l’invocation des Mères). L’Univers est un tout, qui contient, et, dans le même temps, se trouve contenu. Avec Nerval, les frontières disparaissent, entre la vie vernaculaire et cette seconde vie, aussi réelle que la première, qu’est le rêve. Il s’y meut dans un monde aux multiples labyrinthes existentiels, à la recherche des origines, de la patrie mystique, celle qui octroie l’Identité (ayant cru, un moment, la retrouver dans son enfance, anamnèse déambulatoire qui lui faisait hanter les paysages de son Valois natal – mais l’essence du Paradis, dira Proust, est d’être à tout jamais perdu). Peut-être sa condition d’homo viator est-elle, au fond, sa véritable « identité », tant dans la première vie, que dans la seconde. S’il a trouvé quelque chose, un « sens », ce n’aura été qu’en ayant toujours à chercher, et finalement à se perdre.
Il ne faut pas prendre sa folie, dont l’une des déclinaisons est justement la dromomanie, geste dérisoire de la quête, comme uniquement la manifestation d’une pathologie – ce qu’elle est, bien entendu, en partie. Le surréalisme, qui poursuivit ce que Nerval avait commencé, y voyait une initiation à la vraie vie. L’existence sans folie n’est qu’un squelette sans chair et sans âme. Nous vivons aussi bien dans une dimension « matérielle », sociale, prosaïque, que dans un rêve qui s’y épanche, selon les dimensions de notre être, de notre capacité à recevoir « poétiquement » l’enchantement du monde, comme un souffle printanier se ruant par la fenêtre. Et cela, l’écriture, c’est-à-dire la littérature, en est l’inscription incantatoire, qui « chante », qui prodigue le carmen, mais souvent, chez Nerval, un chant par moment singulièrement clair, « classique », d’une tonalité limpide, « française », rarement sujette à des éruption de lave kaïnite, quand la lave perce la croûte du langage « civilisé ».
L’écriture est magie. Elle est plus que signes socialisés sur le papier (ou l’écran), elle est aussi hiéroglyphe de secrets enfouis, qu’il faut ramener à la lumière, peut-être en trouvant la « lettre qui manque » (d’où les recherches ésotériques, théosophiques d’un Nerval, qui s’inspire de l’alchimie, de la kabbale, des « Illuminés » de l’Ancien Régime, de Ballanche, son contemporain, et de la notion fondamentale de palingénésie religieuse, de l’orphisme, de l’hermétisme, surtout du culte d’Isis, amante-mère, qui réunit ce qui a été disloqué, et rappelle obstinément à sa mémoire douloureuse sa mère tragiquement disparue). Elle est aussi instrument de métanoïa, de transformation de l’homme voué à devenir Dieu. Avec Nerval, et avant Rimbaud, l’écriture devient la voie royale de la Connaissance. Nerval, à ce titre, incarne le Voyant, qu’évoque le jeune poète aux « semelles de vent », dans l’une de ses trois lettres à Izambard. Il fut en quelque sorte son Jean le Baptiste (quoiqu’il ne faille pas oublier Baudelaire, « le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu », selon Rimbaud, qui fut l’un des rares à reconnaître en Nerval un Grand de la pensée – mais Rimbaud avait-il lu Nerval ?).
Illustration : Michael Ayrton (Britannique, 1920-1992) El Desdichado, 1944 signé et daté (en bas à gauche) huiles sur panneau.
20:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nerval, gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, romantisme, poésie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 décembre 2024
Nerval et les Filles de peu
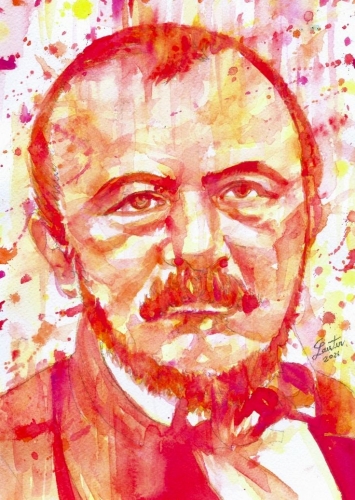
Nerval et les Filles de peu
Nicolas Bonnal
Peu de récits auront autant enchanté notre adolescence littéraire que Sylvie. C’est cet enchantement que j’ai misérablement décidé de combattre en rappelant les éprouvantes phrases de Marx :
« La Bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle essentiellement révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens multicolores qui unissaient l’homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié, pour ne laisser subsister d’autre lien entre l’homme et l’homme que le froid intérêt, que le dur argent comptant. »
Il me semble que c’est un bon moyen de réévaluer Sylvie : Nerval y souligne le développement du capitalisme et Sylvie, promise à un grand frisé chez un certain père Dodu, développe son talent de fée industrieuse. On y parle de salle de théâtre (qui ruina l’auteur malheureux), de journal (idem), de voyage en train, de fêtes (le mot revient vingt fois en vingt-trois pages, on est déjà dans la civilisation festive), de mises en scène théâtrales (on s’habille et on se déshabille, on change de costume, cf. la scène chez la vieille tante), et de péripétie touristique. Le Valois devient un territoire touristique dès cette époque. Le coin de Nerval sera d’ailleurs utilisé dans Drôle de frimousse de Stanley Donen quand Fred Astaire danse avec Audrey à Coye-la Forêt. Grâce à Dieu nous avons la comédie musicale pour célébrer ces thèmes et ces hauts-lieux.

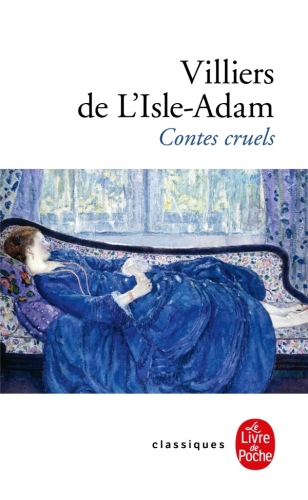
Marx nous fait comprendre que le monde bourgeois va tout emporter (cf. le rewriting humoristique de Villiers-de-l’Isle-Adam dans Virginie et Paul – contes cruels) :
« Elle a noyé l’extase religieuse, l’enthousiasme chevaleresque, la sentimentalité du petit bourgeois dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange ; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l’unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l’exploitation, voilée par des illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, directe, brutale, éhontée. La Bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les professions jusqu’alors réputées vénérables, et vénérées. Du médecin, du juriste, du prêtre, du poète, du savant, elle a fait des travailleurs salariés… »
Attention Nerval est conscient de ce monde boursicoteur :
« En sortant, je passai par la salle de lecture, et machinalement je regardai un journal. C’était, je crois, pour y voir le cours de la Bourse. Dans les débris de mon opulence se trouvait une somme assez forte en titres étrangers. Le bruit avait couru que, négligés longtemps, ils allaient être reconnus ; – ce qui venait d’avoir lieu à la suite d’un changement de ministère. Les fonds se trouvaient déjà cotés très haut ; je redevenais riche. »
Le poète est liquidé, et il lui reste à se pendre ou à devenir maudit (job à temps plein en France avant de toucher sa retraite). C’est cet élément qu’il faut tenir en compte en rappelant que Nerval s’est pendu, fauché, en janvier 1855, en pleine époque bourgeoise, celle que Joly décrit dans ses entretiens fameux. La littérature romantique est morte, et l’alittérature du fils de Mauriac commence – singulièrement en France : on a Verlaine, Mallarmé, Rimbaud qui vont liquider la poésie (voyez ce qu’en dit justement Tolstoï dans son essai sur l’art). Flaubert dépeint le vide et Borges a bien indiqué dans ses « inquisitions » qu’il a inventé la fin de la littérature – dans Bouvard et Pécuchet. Emma Bovary, isolée et perdue dans son couvent, gavée de livres romantiques et aventureux, est une consommatrice littéraire de bouquins et de voyages romantiques (le piano, la cascade, l’Italie, la Suisse, etc.) et elle se suicidera pour dette et pas par amour.

Or tout cela se sent chez Nerval : on se déguise tout le temps, on a des costumes ; les fêtes traditionnelles perdent leur enchantement leur enracinement plutôt) et deviennent de simples attractions ; le paysage druidique est évoqué comme un simple décor un peu comme dans un film de Hunebelle avec Jean Marais. Du preux chevalier français Hunebelle passera peu de temps après à la célébration d’OSS 117, héros de l’Otan et de leur Occident… Eh oui, c’est ça les années gaullistes (voir mon livre sur la destruction de la France au cinéma).
Mais chez Nerval ce qui peine c’est tout ce passage culturel mythologique païen. Il s’en plaint quelque part, de cette civilisation gréco-latine qui ôta son caractère authentique à la France médiévale et chrétienne (voir Céline aussi, Bernanos, j’ai déjà évoqué ces thèmes anti-hellènes et antimodernes) ; et ce gavage culturel est hélas scolaire. Des esprits aussi différents que Gustave Le Bon ou Guénon s’en plaignent, l’un dans sa Psychologie de l’éducation (ouvrage toujours actuel et percutant), l’autre bien sûr dans sa Crise du monde moderne.
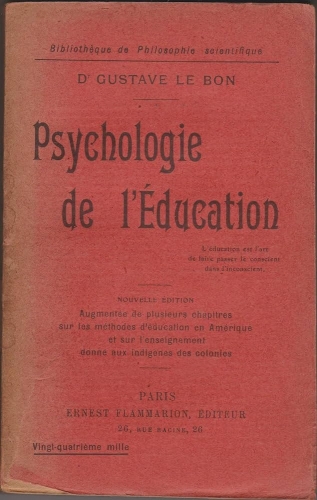
Nerval dépeint en trois mots la grisaille culturelle quotidienne du khâgneux (ou étudiant) :
« Rappelé moi-même à Paris pour y reprendre mes études, j’emportai cette double image d’une amitié tendre tristement rompue, – puis d’un amour impossible et vague, source de pensées douloureuses que la philosophie de collège était impuissante à calmer. La figure d’Adrienne resta seule triomphante, – mirage de la gloire et de la beauté, adoucissant ou partageant les heures des sévères études. Aux vacances de l’année suivante, j’appris que cette belle à peine entrevue était consacrée par sa famille à la vie religieuse. »
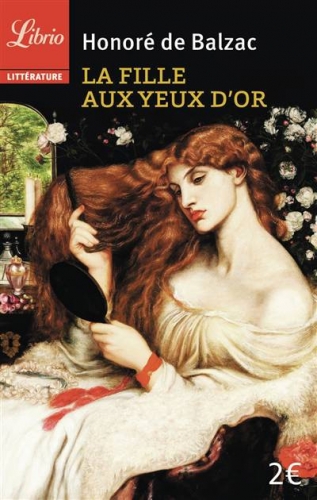
On ne peut que plaindre le destin de cette Adrienne qui va bientôt mourir, vers 1832 dit Sylvie. La monarchie de juillet aura tout coulé, relisez le début de la Fille aux Yeux d’or, où Balzac étincèle.
La philosophie de collège en effet occupe le cerveau de nos jeunes bourgeois et en peu de temps notre littérature va devenir une littérature de collège et de prof. Syndrome gravissime et peu commenté…
Comme Musset, Nerval se plaint de son temps et fait sa confession d’enfant du siècle ; il ajoute :
« Nous vivions alors dans une époque étrange, comme celles qui d’ordinaire succèdent aux révolutions ou aux abaissements des grands règnes. Ce n’était plus la galanterie héroïque comme sous la fronde, le vice élégant et paré comme sous la régence, le scepticisme et les folles orgies du directoire ; c’était un mélange d’activité, d’hésitation et de paresse, d’utopies brillantes, d’aspirations philosophiques ou religieuses, d’enthousiasmes vagues, mêlés de certains instincts de renaissance ; d’ennuis des discordes passées, d’espoirs incertains, – quelque chose comme l’époque de Pérégrinus et d’Apulée. »
Le mot « vague » revient tout le temps sous sa plume. On court toujours après Isis, mais après la déesse Isis, rien du tout. Nerval n’a pas besoin qu’on le démolisse au milieu des ruines du Valois : il le fait lui-même, et son histoire d’amour vague inspiré par des lectures et des dissertations. Il écrit cruellement :
« – Nulle émotion ne parut en elle. Alors je lui racontai tout ; je lui dis la source de cet amour entrevu dans les nuits, rêvé plus tard, réalisé en elle. Elle m’écoutait sérieusement et me dit : – Vous ne m’aimez pas ! Vous attendez que je vous dise : La comédienne est la même que la religieuse ; vous cherchez un drame, voilà tout, et le dénouement vous échappe. Allez, je ne vous crois plus ! Cette parole fut un éclair. Ces enthousiasmes bizarres que j’avais ressentis si longtemps, ces rêves, ces pleurs, ces désespoirs et ces tendresses, … ce n’était donc pas l’amour ? Mais où donc est-il ? »
Au-delà de ces cercles de l’enfer ou au paradis il y a surtout du théâtre, machine alors à détraquer les esprits (puis ce fut le cinéma, la télé, l’ordi, le smartphone…) :
« Que dire maintenant qui ne soit l’histoire de tant d’autres ? J’ai passé par tous les cercles de ces lieux d’épreuves qu’on appelle théâtres. « J’ai mangé du tambour et bu de la cymbale, » comme dit la phrase dénuée de sens apparent des initiés d’Éleusis. – Elle signifie sans doute qu’il faut au besoin passer les bornes du non-sens et de l’absurdité : la raison pour moi, c’était de conquérir et de fixer mon idéal. »
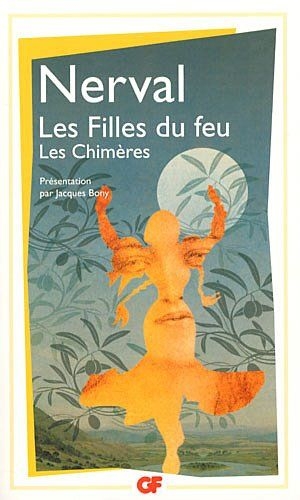
Adrienne est du reste religieuse et actrice (elle est même chanteuse, dans la fameuse scène faisant pompeusement et scolairement référence à Dante…) et Nerval décrit encore un spectacle éreintant et frustrant :
« Ce que je vis jouer était comme un mystère des anciens temps. Les costumes, composés de longues robes, n’étaient variés que par les couleurs de l’azur, de l’hyacinthe ou de l’aurore. La scène se passait entre les anges, sur les débris du monde détruit. Chaque voix chantait une des splendeurs de ce globe éteint, et l’ange de la mort définissait les causes de sa destruction. Un esprit montait de l’abîme, tenant en main l’épée flamboyante, et convoquait les autres à venir admirer la gloire du Christ vainqueur des enfers. Cet esprit, c’était Adrienne transfigurée par son costume, comme elle l’était déjà par sa vocation. Le nimbe de carton doré qui ceignait sa tête angélique nous paraissait bien naturellement un cercle de lumière ; sa voix avait gagné en force et en étendue, et les fioritures infinies du chant italien brodaient de leurs gazouillements d’oiseau les phrases sévères d’un récitatif pompeux. »
Ce globe éteint c’est devenu le nôtre.
Adrienne est peut-être transfigurée (quand on joue c’est facile…) mais son nimbe est de carton doré. Après, elle meurt.
Nerval auteur scolaire et collégien ? Léon Bloy en parle quand il règle son compte à Huysmans (qui lui-même va inspirer de A à Z Dorian Gray, voir le chapitre Onze du livre profané de Wilde) : pour lui cet auteur ne fait que nous tenir au courant de ses lectures – comme Nerval. Et il demande aussi un changement de réalité quand l’âge bourgeois achève de noyer l’extase religieuse et l’enthousiasme chevaleresque :
« Le célèbre naturaliste Huysmans a raconté, dans un livre de désolation, cette recherche désespérée de l’idéal à rebours, cette humble demande d’une minute de rêve à l’idiotifiante banalité des brasseries à femmes et des caboulots. »
Ce désespoir devant la réalité deviendra comme on sait une constante – après on s’habituera, car comme dit Dostoïevski dans ses Souvenirs de la Maison des morts, l’homme est le seul animal qui s’habitue à tout.

Ajoutons que Nerval célèbre à sa manière le dix-huitième siècle, en qui il ne voit pas le siècle des Lumières de nos Lagarde et Michard, mais celui de l’accordée de Greuze (tableau, ci-dessus), des temples philosophiques, du rousseauisme des racines et des origines, de la quête de Cazotte et des illuminés maçonniques. Taine d’ailleurs se moque de ce trait aristocratique au début de ses Origines de la France moderne : avant 89 on ne pense plus qu’à s’amuser et à se déguiser, dit-il.
Terminons avec une belle et oubliée référence cinématographique : la Belle au bois dormant, film de danse soviétique (1964) qui célébra comme personne le plus beau conte de Perrault. Peut-être qu’elle a existé cette France des fées et des contes, des princes et des amours, un jour…
Le lien ici :
https://m.ok.ru/video/1709087197842?__dp=y
Sources principales :
https://www.vousnousils.fr/casden/pdf/id00180.pdf
https://instituthumanismetotal.fr/bibliotheque/PDF/marx-e...
https://fr.wikisource.org/wiki/Belluaires_et_porchers/Tex...
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2024/11/01/n...
12:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 novembre 2024
Nerval et la fin de la France druidique

Nerval et la fin de la France druidique
Nicolas Bonnal
Sylvie a émerveillé des générations de lectrices et de lecteurs de sensibilité médiévale et romantique. C’est que ce bref roman conte la fin de la France initiatique et irréelle. Ce qui avait pu rester va être détruit (cf. Balzac qui décrit le processus dans toute son œuvre, du passage de cette France des druides et des chevaliers à celle des Macron) ou réduit à l’état de spectacle ou d’illusion (cf. cette fascination pour le théâtre ou les actrices qui caractérise Nerval).
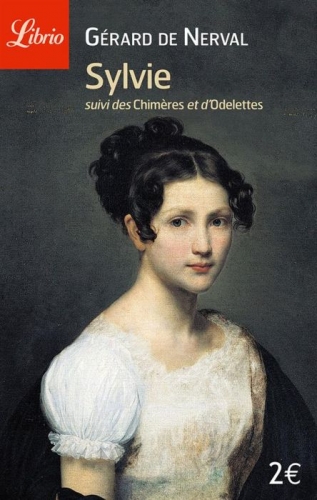
L’arrivée du chemin de fer, machine apocalyptique dont Dostoïevski a si bien parlé dans l’Idiot (voyez mon livre) va tout modifier ; c’est la fin des distances, c’est la fin du mystère et du pèlerinage de la vie :
« Senlis est une ville isolée de ce grand mouvement du chemin de fer du Nord qui entraîne les populations vers l’Allemagne.
– Je n’ai jamais su pourquoi le chemin de fer du Nord ne passait pas par nos pays, – et faisait un coude énorme qui encadre en partie Montmorency, Luzarches, Gonesse et autres localités, privées du privilège qui leur aurait assuré un trajet direct. Il est probable que les personnes qui ont institué ce chemin auront tenu à le faire passer par leurs propriétés. – Il suffit de consulter la carte pour apprécier la justesse de cette observation. »
Citons cet extrait de Gautier que nous avions repris déjà :
« C'est un spectacle douloureux pour le poète, l'artiste et le philosophe, de voir les formes et les couleurs disparaître du monde, les lignes se troubler, les teintes se confondre et l'uniformité la plus désespérante envahir l'univers sous je ne sais quel prétexte de progrès. Quand tout sera pareil, les voyages deviendront complètement inutiles, et c'est précisément alors, heureuse coïncidence, que les chemins de fer seront en pleine activité. »
Chez Nerval le rêve est comme dans film Brazil (tourné à Marne-la-Vallée…) le seul moyen (avec le théâtre, et on aurait invoqué encore la cinéphilie dans les années soixante) de fuir la réalité et de retourner vers les lieux de la Source :
« Je me représentais un château du temps de Henri IV avec ses toits pointus couverts d’ardoises et sa face rougeâtre aux encoignures dentelées de pierres jaunies, une grande place verte encadrée d’ormes et de tilleuls, dont le soleil couchant perçait le feuillage de ses traits enflammés. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse en chantant de vieux airs transmis par leurs mères, et d’un français si naturellement pur, que l’on se sentait bien exister dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France… ».
Puis vient l’apparition mi-théâtrale mi religieuse d’Adrienne :
« Tout d’un coup, suivant les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et la danse et le chœur tournaient plus vivement que jamais. En lui donnant ce baiser, je ne pus m’empêcher de lui presser la main. Les longs anneaux roulés de ses cheveux d’or effleuraient mes joues. De ce moment, un trouble inconnu s’empara de moi. – La belle devait chanter pour avoir le droit de rentrer dans la danse. On s’assit autour d’elle, et aussitôt, d’une voix fraîche et pénétrante, légèrement voilée, comme celles des filles de ce pays brumeux, elle chanta une de ces anciennes romances pleines de mélancolie et d’amour, qui racontent toujours les malheurs d’une princesse enfermée dans sa tour par la volonté d’un père qui la punit d’avoir aimé. La mélodie se terminait à chaque stance par ces trilles chevrotants que font valoir si bien les voix jeunes, quand elles imitent par un frisson modulé la voix tremblante des aïeules. »
On a toute la symbolique des récits du Graal que j’ai décryptée dans mon livre (anneau, blondeur, danse, baiser, brumes, tour…) grâce à des auteurs consacrés comme Guénon, Fulcanelli ou Coomaraswamy (oh, cet essai sur le fier baiser…) ; on a la référence à Dante et à l’origine avec le chant :
« À mesure qu’elle chantait, l’ombre descendait des grands arbres, et le clair de lune naissant tombait sur elle seule, isolée de notre cercle attentif. Elle se tut, et personne n’osa rompre le silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées, qui déroulaient leurs blancs flocons sur les pointes des herbes. Nous pensions être en paradis. – Je me levai enfin, courant au parterre du château, où se trouvaient des lauriers, plantés dans de grands vases de faïence peints en camaïeu. Je rapportai deux branches, qui furent tressées en couronne et nouées d’un ruban. Je posai sur la tête d’Adrienne cet ornement, dont les feuilles lustrées éclataient sur ses cheveux blonds aux rayons pâles de la lune. Elle ressemblait à la Béatrice de Dante qui sourit au poète errant sur la lisière des saintes demeures. »
L’apparition est brève et promise au couvent (que de merveilles perdues ou sacrifiées dans ces couvents – Michelet en a bien parlé) :
« Adrienne se leva. Développant sa taille élancée, elle nous fit un salut gracieux, et rentra en courant dans le château. – C’était, nous dit-on, la petite-fille de l’un des descendants d’une famille alliée aux anciens rois de France ; le sang des Valois coulait dans ses veines. Pour ce jour de fête, on lui avait permis de se mêler à nos jeux ; nous ne devions plus la revoir, car le lendemain elle repartit pour un couvent où elle était pensionnaire… »
Sylvie la brune (ou la grecque, l’autre étant blonde et nordique) est de ce monde et souffre de l’égoïsme poétique du narrateur :
« Quand je revins près de Sylvie, je m’aperçus qu’elle pleurait. La couronne donnée par mes mains à la belle chanteuse était le sujet de ses larmes. Je lui offris d’en aller cueillir une autre, mais elle dit qu’elle n’y tenait nullement, ne la méritant pas. Je voulus en vain me défendre, elle ne me dit plus un seul mot pendant que je la reconduisais chez ses parents… »
Mais les bons parents vont nous priver d’Adrienne :
« La figure d’Adrienne resta seule triomphante, – mirage de la gloire et de la beauté, adoucissant ou partageant les heures des sévères études. Aux vacances de l’année suivante, j’appris que cette belle à peine entrevue était consacrée par sa famille à la vie religieuse. »
Il n’en reste qu’une figure.

Remontons le temps. On est sans doute dans les années 1820, sous Charles X, roi dont Stendhal pensa le plus grand bien. La France aristocrate et traditionnelle a de beaux restes :
« Quelques années s’étaient écoulées : l’époque où j’avais rencontré Adrienne devant le château n’était plus déjà qu’un souvenir d’enfance. Je me retrouvai à Loisy au moment de la fête patronale. J’allai de nouveau me joindre aux chevaliers de l’arc, prenant place dans la compagnie dont j’avais fait partie déjà. Des jeunes gens appartenant aux vieilles familles qui possèdent encore là plusieurs de ces châteaux perdus dans les forêts, qui ont plus souffert du temps que des révolutions, avaient organisé la fête. De Chantilly, de Compiègne et de Senlis accouraient de joyeuses cavalcades qui prenaient place dans le cortège rustique des compagnies de l’arc… ».
Le narrateur ne pouvait rien avec Adrienne, mais il a perdu l’amour de Sylvie (promise à l’industrie et au grand frisé) :
« Je m’excusai sur mes études, qui me retenaient à Paris, et l’assurai que j’étais venu dans cette intention. « Non, c’est moi qu’il a oubliée, dit Sylvie. Nous sommes des gens de village, et Paris est si au-dessus ! ». Je voulus l’embrasser pour lui fermer la bouche ; mais elle me boudait encore, et il fallut que son frère intervînt pour qu’elle m’offrît sa joue d’un air indifférent. Je n’eus aucune joie de ce baiser dont bien d’autres obtenaient la faveur, car dans ce pays patriarcal où l’on salue tout homme qui passe, un baiser n’est autre chose qu’une politesse entre bonnes gens… »
Pourtant la belle grecque a mûri :
« Je l’admirai cette fois sans partage, elle était devenue si belle ! Ce n’était plus cette petite fille de village que j’avais dédaignée pour une plus grande et plus faite aux grâces du monde. Tout en elle avait gagné : le charme de ses yeux noirs, si séduisants dès son enfance, était devenu irrésistible ; sous l’orbite arquée de ses sourcils, son sourire, éclairant tout à coup des traits réguliers et placides, avait quelque chose d’athénien. J’admirais cette physionomie digne de l’art antique au milieu des minois chiffonnés de ses compagnes… »

C’est Nietzsche qui évoque cette observation du voyageur Cicéron sur la beauté athénienne…
Vient la grande scène : on rend visite à la tante et on va remonter dans le Temps, dans le vrai Temps, celui d’avant 89 (époque sur laquelle il ne faut pas trop se faire d’illusions, voir Taine) :
« Je la suivis, montant rapidement l’escalier de bois qui conduisait à la chambre. – Ô jeunesse, ô vieillesse saintes ! – qui donc eût songé à ternir la pureté d’un premier amour dans ce sanctuaire des souvenirs fidèles ? Le portrait d’un jeune homme du bon vieux temps souriait avec ses yeux noirs et sa bouche rose, dans un ovale au cadre doré, suspendu à la tête du lit rustique. Il portait l’uniforme des gardes-chasse de la maison de Condé ; son attitude à demi martiale, sa figure rose et bienveillante, son front pur sous ses cheveux poudrés, relevaient ce pastel, médiocre peut-être, des grâces de la jeunesse et de la simplicité. »
La vieille tante s’émeut et nous aussi car on atteint le sommet de la prose française (comme disait Jean Richer, père de mon ami et préfacier Nicolas, l’œuvre de Nerval ne compte pas par sa quantité mais par sa magie) :
« La tante poussa un cri en se retournant : « Ô mes enfants ! » dit-elle, et elle se mit à pleurer, puis sourit à travers ses larmes. – C’était l’image de sa jeunesse, – cruelle et charmante apparition ! Nous nous assîmes auprès d’elle, attendris et presque graves, puis la gaieté nous revint bientôt, car, le premier moment passé, la bonne vieille ne songea plus qu’à se rappeler les fêtes pompeuses de sa noce. Elle retrouva même dans sa mémoire les chants alternés, d’usage alors, qui se répondaient d’un bout à l’autre de la table nuptiale, et le naïf épithalame qui accompagnait les mariés rentrant après la danse. Nous répétions ces strophes si simplement rythmées, avec les hiatus et les assonances du temps ; amoureuses et fleuries comme le cantique de l’Ecclésiaste ; – nous étions l’époux et l’épouse pour tout un beau matin d’été. »
La fin du livre est plus sombre et Nerval compte ses ruines avec une émouvante référence à Byzance, qui accueillit les Saxons en fuite après 1066 :
« Cette vieille retraite des empereurs n’offre plus à l’admiration que les ruines de son cloître aux arcades byzantines, dont la dernière rangée se découpe encore sur les étangs, – reste oublié des fondations pieuses comprises parmi ces domaines qu’on appelait autrefois les métairies de Charlemagne… »
Le narrateur revoit Adrienne, mais comme actrice :
« La scène se passait entre les anges, sur les débris du monde détruit. Chaque voix chantait une des splendeurs de ce globe éteint, et l’ange de la mort définissait les causes de sa destruction. Un esprit montait de l’abîme, tenant en main l’épée flamboyante, et convoquait les autres à venir admirer la gloire du Christ vainqueur des enfers. Cet esprit, c’était Adrienne transfigurée par son costume, comme elle l’était déjà par sa vocation. »
Il revoit Sylvie qui va se jeter dans les bras du « grand frisé » (un suspect, ce Nerval ?) et s’adonne à l’industrie des gants :
« Elle soupirait et pleurait, si bien que je ne pus lui demander par quelle circonstance elle était allée à un bal masqué ; mais, grâce à ses talents d’ouvrière, je comprenais assez que Sylvie n’était plus une paysanne. Ses parents seuls étaient restés dans leur condition, et elle vivait au milieu d’eux comme une fée industrieuse, répandant l’abondance autour d’elle. »
On est loin de la Fiancée du Cantique des cantiques :
« Mon frère de lait parut embarrassé. J’avais tout compris. – C’est une fatalité qui m’était réservée d’avoir un frère de lait dans un pays illustré par Rousseau, – qui voulait supprimer les nourrices ! – Le père Dodu m’apprit qu’il était fort question du mariage de Sylvie avec le grand frisé, qui voulait aller former un établissement de pâtisserie à Dammartin. Je n’en demandai pas plus. La voiture de Nanteuil-le-Haudoin me ramena le lendemain à Paris. »
Balzac a parlé très prosaïquement des illusions perdues ; et ici :
« Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie. J’ai essayé de les fixer sans beaucoup d’ordre, mais bien des cœurs me comprendront. Les illusions tombent l’une après l’autre, comme les écorces d’un fruit, et le fruit, c’est l’expérience. Sa saveur est amère ; elle a pourtant quelque chose d’âcre qui fortifie, – qu’on me pardonne ce style vieilli. »
La fin arrive sur un ricanement :
« J’oubliais de dire que le jour où la troupe dont faisait partie Aurélie a donné une représentation à Dammartin, j’ai conduit Sylvie au spectacle, et je lui ai demandé si elle ne trouvait pas que l’actrice ressemblait à une personne qu’elle avait connue déjà. – À qui donc ? – Vous souvenez-vous d’Adrienne ? Elle partit d’un grand éclat de rire en disant : « Quelle idée ! » Puis, comme se le reprochant, elle reprit en soupirant : « Pauvre Adrienne ! elle est morte au couvent de Saint-S…, vers 1832. »
La France des origines c’est terminé. La suite est chez Flaubert ou chez Céline.
Sources:
https://www.sos-grannygeek.com/wp-content/uploads/2020/03...
https://www.vousnousils.fr/casden/pdf/id00180.pdf
https://www.amazon.fr/Perceval-reine-%C3%A9tudes-litt%C3%...
16:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : gérardde nerval, nerval, nicolas bonnal, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 31 janvier 2024
Léon Bloy contre-attaque
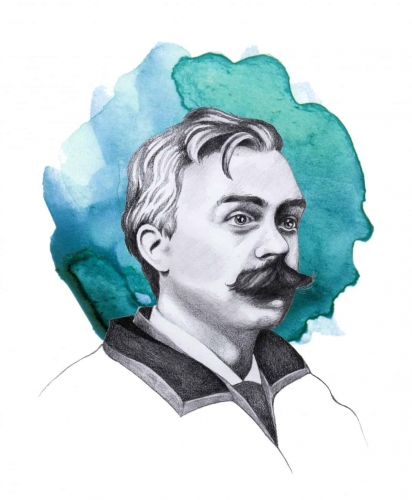
Léon Bloy contre-attaque
Par Eugenia Arpesella
@eugeniarpe
Source: https://revistapaco.com/leon-bloy-contraataca/
Pour sa prose extemporanée, pour son catholicisme extrême, pour être antimoderne et réactionnaire, pour être un saint, un prophète et un égaré, Léon Bloy (1846-1917) a été jeté, avec son œuvre, dans l'oubli littéraire. Il est possible qu'il s'agisse d'un oubli un peu forcé, produit d'une opération de censure largement consensuelle. En tant que critique littéraire, Bloy a descendu presque tous les écrivains et intellectuels français de son époque. Aujourd'hui, pourtant, Bloy pourrait être le saint patron des annulés. Mais le drap du fantôme du politiquement incorrect serait trop court pour lui, et s'il voyait de ses yeux le pétrin dans lequel nous nous sommes fourrés, il s'en servirait volontiers pour se pendre.
Il y a dix ans, à la stupéfaction des cardinaux, le Pape François l'a sorti des catacombes dans sa première homélie en tant que pape, dans la chapelle Sixtine : "Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, je me souviens de la phrase de Léon Bloy : "Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le diable"". En Argentine, entre-temps, il est difficile de trouver ses livres, les Journaux sont épuisés et ses romans et essais peuvent, avec un peu de chance, être consultés sur le web, et pas nécessairement parce qu'ils ont si mal ou si peu vieilli. La bonne nouvelle est que la maison d'édition de Bucarest vient de publier Sobre la tumba de Huysmans, traduit pour la première fois en espagnol par Nicolás Caresano, qui est également chargé des notes et du prologue de l'édition. Il s'agit de l'un des derniers livres publiés par Bloy de son vivant, qui rassemble les comptes rendus critiques qu'il a rédigés sur les romans de Joris Karl Huysmans, un auteur contemporain avec lequel il entretenait une amitié compliquée.

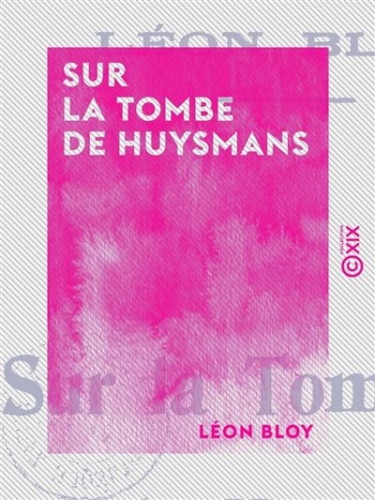
Après la mort de Huysmans, en 1913, Bloy, dans un geste lapidaire, publie ce livre. "Les pages qui suivent marquent deux époques", explique Bloy. "Les premières ont été écrites avant la conversion de Huysmans, lorsque, plein d'espoir et sans prévoir les atroces tribulations qu'il me réservait, je le choyais avec délicatesse. Les autres expriment l'amer désenchantement qui a suivi. A la fin de cette préface à la première édition, Bloy se justifie : "On me reprochera peut-être de manquer de respect à un défunt. La mort, disait Jules Vallés, n'est pas une excuse. Les notes du traducteur donnent des indications intéressantes sur le tempérament de Bloy et sur son sens des relations publiques. Par exemple, Caresano précise que Jules Vallés avait publié les premiers articles socialistes et anticléricaux de Bloy dans son journal La Rue. Mais lorsque Bloy se convertit au catholicisme, il lui rendit la pareille en le qualifiant de "délinquant capable de jeter Homère dans les toilettes".
L'amitié entre Bloy et Huysmans semble avoir été intéressée, surtout de la part de Bloy, qui voyait en Huysmans un converti plutôt qu'une promesse littéraire. La publication du roman A rebours (que Michel Houellebecq évoque longuement dans Soumission) enthousiasme Bloy au point qu'il en fait l'éloge, à l'étonnement de beaucoup : "Je ne vois pas de roman qui déclare plus résolument cette alternative : ou bien nous nous muons en bêtes, ou bien nous contemplons la face de Dieu".
Disciple d'Émile Zola, que Bloy avait baptisé "le crétin des Pyrénées", Huysmans était comme la brebis égarée qu'il fallait récupérer et ramener au bercail. Plus tard, la dérive littéraire et spirituelle de Huysmans vers le satanisme a fait que l'amitié entre les deux, comme l'a expliqué Bloy plus haut, a littéralement sombré dans l'enfer. On ne peut comprendre son radicalisme vis-à-vis de Huysmans, et celui de toute son œuvre, sans considérer l'histoire de sa fervente conversion. Dans sa prime jeunesse, Léon Bloy avait été un athée et un anticlérical forcené jusqu'à ce qu'il rencontre Barbey D'Aurevilly, écrivain monarchiste et conservateur réputé, qui devint son mentor spirituel et littéraire et l'accompagna sur le chemin de l'initiation au catholicisme. Initiation qui, comme on le sait chez les croyants, est un chemin total, absolu. Mais la foi de Bloy est celle du Calvaire, celle du Vendredi saint, celle de la nuit noire. "Je ne ressens jamais la joie de la résurrection. Je vois toujours Jésus à l'agonie", écrit-il dans son Journal. L'amour du Christ est l'amour de la Vérité, et cette Vérité, dira Bloy, se trouve dans la souffrance. La souffrance du Christ crucifié entre deux voleurs, la pauvreté qu'il a lui-même endurée tout au long de sa vie. Bref, sa conversion n'a pas été une conversion de splendeur, de joie, de paix, de réconciliation.
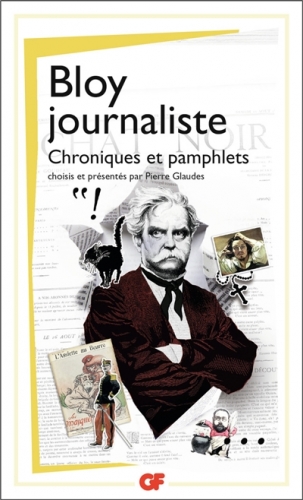 Écrivain catholique, ou plutôt journaliste catholique, pamphlétaire et auteur de libelles, il s'est lancé dans l'écriture comme un prophète désespéré et malveillant : toute son œuvre est un grand défi aux valeurs de la modernité, cette déchirure de l'histoire dont les fruits ont été autant de poisons pour l'esprit. Le suffrage universel, la science, le progrès, la république, le matérialisme, l'immanentisme comme précurseur de l'individualisme récalcitrant, l'art, la littérature, le catholicisme mou et sentimental, sans parler de Luther et de la Réforme protestante ! Il s'est donc battu en duel contre tout ce qui, pour lui, éloignait irrémédiablement les hommes du mystère, de la transcendance, c'est-à-dire de Dieu. L'essayiste Roberto Calasso résume bien cette croisade morale et de principe : Bloy s'est attaché à fustiger les bourgeois hypocrites, les intellectuels éclairés et, surtout, les âmes tièdes et en paix avec elles-mêmes. "Qu'est-ce qu'avoir bonne conscience ? C'est être convaincu qu'on est une parfaite canaille", écrit-il dans son Journal. Terriblement pauvre, il se comportait lui-même comme un misérable et le savait mieux que quiconque : "Je mendie comme un voleur à la porte d'une ferme qu'il a l'intention d'incendier". Certains critiques suggèrent qu'il y a toujours quelque chose de sacré dans la colère de Bloy, rappelant le Christ contre les pharisiens et contre les marchands du temple.
Écrivain catholique, ou plutôt journaliste catholique, pamphlétaire et auteur de libelles, il s'est lancé dans l'écriture comme un prophète désespéré et malveillant : toute son œuvre est un grand défi aux valeurs de la modernité, cette déchirure de l'histoire dont les fruits ont été autant de poisons pour l'esprit. Le suffrage universel, la science, le progrès, la république, le matérialisme, l'immanentisme comme précurseur de l'individualisme récalcitrant, l'art, la littérature, le catholicisme mou et sentimental, sans parler de Luther et de la Réforme protestante ! Il s'est donc battu en duel contre tout ce qui, pour lui, éloignait irrémédiablement les hommes du mystère, de la transcendance, c'est-à-dire de Dieu. L'essayiste Roberto Calasso résume bien cette croisade morale et de principe : Bloy s'est attaché à fustiger les bourgeois hypocrites, les intellectuels éclairés et, surtout, les âmes tièdes et en paix avec elles-mêmes. "Qu'est-ce qu'avoir bonne conscience ? C'est être convaincu qu'on est une parfaite canaille", écrit-il dans son Journal. Terriblement pauvre, il se comportait lui-même comme un misérable et le savait mieux que quiconque : "Je mendie comme un voleur à la porte d'une ferme qu'il a l'intention d'incendier". Certains critiques suggèrent qu'il y a toujours quelque chose de sacré dans la colère de Bloy, rappelant le Christ contre les pharisiens et contre les marchands du temple.
En revanche, Franz Kafka l'admirait, tout comme Jorge Luis Borges. Le "Miroir des énigmes", publié dans Autres inquisitions, rend justice au Bloy non racheté. Mais l'un des meilleurs portraits de l'écrivain français est peut-être celui du père Leonardo Castellani, jésuite et écrivain argentin : "Il est facile de rire de Léon Bloy. Autrefois, je me moquais de lui, ce saint plus impatient que le mauvais larron ! La somme d'injures, d'imprécations et d'épithètes qui lui sont tombées dessus de son vivant est énorme et, à Dieu ne plaise, justifiée. Ah, le malheureux ! Mais la misère est une chose sérieuse. On ne peut pas rire de la misère. Jésus-Christ, dans sa passion, était littéralement misérable. Tout ce qui est suspendu à un arbre est maudit, dit la Loi. C'est ainsi que le monde d'aujourd'hui s'est moqué de Bloy et de Jésus-Christ.
Dans le prologue de Sur la tombe de Huysmans, Caresano pose la question que nous nous posons tous si nous sommes arrivés jusqu'ici : qu'est-ce que ce vieux sage et carcaman a à nous offrir aujourd'hui ? Quels abîmes de notre présent ce prophète du 19ème siècle peut-il éclairer ? Son héritage", dit Caresano, "nous enseigne encore qu'il n'est pas possible d'affirmer sans nier en même temps, d'admirer sans mépriser implicitement et que, parfois, la seule façon d'atteindre le centre profond d'une époque est de se déplacer vers les marges". L'une des qualités intemporelles de Bloy est peut-être son affront à l'exercice de la critique et à ses implications dans le monde de la culture, c'est-à-dire le coût que peu sont prêts à payer aux dépens d'un relativisme dépourvu de sainteté. Le "politiquement correct" ne cache-t-il pas des intérêts ? Affirmer simultanément l'un et l'autre et en tirer la conclusion qui intéresse le plus le pouvoir en place, n'est-ce pas une affaire détournée ? "Celui qui ne prie pas le Seigneur...". En l'invoquant lors de la messe inaugurale de son pontificat, le pape François a renouvelé un affront au pharisaïsme de notre époque, plus courroucée et stridente que celle de Bloy, mais tout aussi déserte.
20:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : 19ème siècle, léon bloy, france, catholicisme, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 janvier 2024
La logique de l'atlantisme de Palmerston à nos jours
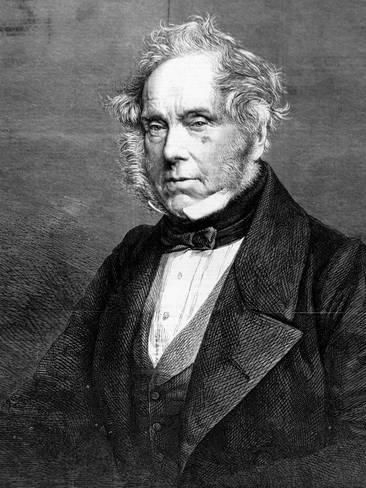
La logique de l'atlantisme de Palmerston à nos jours
Maxim Medovarov
Source: https://www.geopolitika.ru/article/k-logike-atlantizma-ot-palmerstona-do-nashih-dney
Pour comprendre la logique de l'atlantisme, y compris sa logique actuelle, il suffit de prendre un exemple probant - les événements des années 1830. De 1830 à 1841, les leviers de l'atlantisme mondial étaient en fait entre les mains de Palmerston, surnommé Palm (PAM) - le magicien pan-atlantique. Officiellement simple ministre des affaires étrangères sous les faux premiers ministres Gray et Melbourne (un homme et une ville australienne), Palmerston a en fait déterminé toute la géopolitique britannique pendant ces onze années (à l'exception d'une très courte pause en 1834-35, lorsque le roi Guillaume IV a nommé pour la dernière fois dans l'histoire un premier ministre, à savoir Wellington, contre la volonté du Parlement, mais Palmerston a de nouveau fait ce qu'il voulait et a mis le roi à sa botte).
Palmerston est un précurseur direct de l'OTAN, et le système qu'il a créé était en avance sur son temps, face à l'immaturité de la situation internationale de l'époque, à son impréparation à s'opposer au programme atlantiste jusqu'au bout. C'est pourquoi ce dernier n'a pas été pleinement réalisé du vivant de Palmerston (qui a absolument dominé la scène politique britannique de 1827 à sa mort en 1865).
Pour comprendre la logique dans laquelle les atlantistes opèrent encore aujourd'hui, il est préférable de se pencher sur la géopolitique de Palmerston, car elle était beaucoup plus prononcée que celle de ses successeurs, pas toujours cohérents et parfois effacés. Aujourd'hui, tout le monde discute du problème que pose la Guyana-Essequibo, que le Venezuela traîne depuis Palmerston jusqu'à aujourd'hui donc depuis 192 ans. Mais à l'époque, il ne s'agissait pas d'un événement unique, mais d'une stratégie bien pensée, incluse dans une chaîne d'événements similaires.
La logique des actions de Palmerston et de ses prédécesseurs et successeurs directs était simple et peu compliquée, voire grossière, et pouvait être comprise par un écolier. Étonnamment, seuls quelques dirigeants d'autres États l'ont comprise et ont osé s'y opposer, tandis que la majorité d'entre eux ont été pris par surprise.
L'action du "Magicien de la Pan-Atlantique et Cie" s'articule autour de trois axes :
- Éliminer tous les grands États continentaux, très petits en termes de territoire mais disposant de ports maritimes incroyablement favorables en prise avec les régions environnantes, et les transformer en avant-postes de la puissance navale britannique en tant qu'États fantoches (et seulement s'ils étaient très chanceux - fragmenter les États continentaux eux-mêmes en plusieurs morceaux) ;
- soutenir une alliance de libéraux et de gauchistes pour organiser des activités révolutionnaires et mener des guerres civiles contre les conservateurs (en d'autres termes, exporter la révolution) ;
- le tout accompagné d'un traitement tout à fait bestial de sa propre population et d'une détérioration constante de son niveau de vie. Paradoxalement, l'atlantisme fonctionne toujours au profit d'un cercle étroit d'élites et jamais au profit des masses de leurs propres pays, qui ne tirent aucun bénéfice réel de l'exploitation coloniale du reste du monde.
Voyons maintenant où les deux techniques susmentionnées ont apporté aux atlantistes de l'ère Pam un succès retentissant, et où elles ont échoué, et pourquoi. Le lien avec notre époque est direct : les tactiques géopolitiques des atlantistes n'ont pas changé de manière significative.
À la fin des années 20 et au début des années 40 du 19ème siècle, les atlantistes ont toujours eu recours à la même astuce géopolitique, à savoir "prendre un morceau de côte et en faire un avant-poste de la mer". C'est ainsi que se sont déroulés les événements suivants :
- Les Britanniques arrachent un morceau de territoire contesté pendant les guerres entre l'Argentine et le Brésil et en font l'État fantoche de l'Uruguay (1828), qui tombera plus tard (dans sa zone côtière) sous la dépendance de la France atlantiste ;

- les Britanniques arrachent aux Pays-Bas le nouveau royaume fantoche de Belgique (1830) pour faire contrepoids à la France, aux Pays-Bas et à la Prusse ;


- l'arrachement à l'Empire ottoman d'une partie non viable de la Grèce méridionale, dépendante des forces de la mer, l'assassinat subséquent du président pro-russe Kapodistria (1831) (portrait, ci-dessus) et la transformation de la Grèce en une marionnette de Londres avec endiguement simultané des Turcs ;
- le démembrement de la Grande Colombie à la mort de Bolivar (1830-31), y compris l'arrachage de la région du fleuve Essequibo au profit de la Guyane britannique (Guyana) ;
- la saisie des îles Malouines à l'Argentine (1833) ;
- le démembrement des Provinces-Unies d'Amérique centrale après le renversement du protégé britannique en cinq États nains et faibles (1838-40), avec la consolidation simultanée du Honduras britannique (Belize) ;
- Saisie par les Britanniques de leur sphère d'influence dans les zones côtières pendant les guerres civiles en Espagne, au Portugal et en Uruguay;
- les débarquements britanniques pour soutenir les Circassiens sur la côte du Caucase pendant la guerre contre la Russie ;
- la guerre de l'opium et la prise de Hong Kong à la Chine (1839-40).
Bien entendu, le couronnement de la stratégie de conquête du continent sera un peu plus tard l'enfant chéri de Palmerston, la guerre de Crimée contre la Russie, qui n'atteindra cependant pas ses objectifs maximaux en raison des succès russes en matière de défense et du refroidissement des alliés européens à l'égard de la Grande-Bretagne de Palmerston.
Dans tout cela, la stratégie claire de Palmerston et de ses prédécesseurs et successeurs immédiats, les atlantistes, était évidente. Leurs adversaires continentaux se révélaient généralement soit compréhensifs, mais franchement faibles sur le plan militaire ou politique, soit forts, mais ne comprenant rien aux coups géopolitiques des stratèges atlantistes. Si l'on prend les années 1830, il n'y avait sur la planète que deux souverains suffisamment intelligents et forts pour que le magicien panatlantique se casse les dents face à leur détermination: l'émir afghan Dost-Mohammed et le chef suprême du Paraguay, le Dr Francia. Tous les autres se sont fondus dans les mains des Atlantistes de la manière la plus pathétique qui soit.
La stratégie atlantiste élaborée par Palmerston et Cie est restée essentiellement inchangée à ce jour. Si son premier pilier est le mordant des territoires côtiers, le second est le soutien britannique aux mouvements subversifs et terroristes dans d'autres pays: dans les années 1830, le plus souvent de gauche et libéraux, mais les montagnards caucasiens (mission d'Urquhart) et la gentry polonaise et hongroise étaient également impliqués. Palmerston a fait un grand pas en avant en transformant Londres en quartier général révolutionnaire mondial, tout en réprimant brutalement toute contestation sociale et toute opposition au sein même de la Grande-Bretagne.
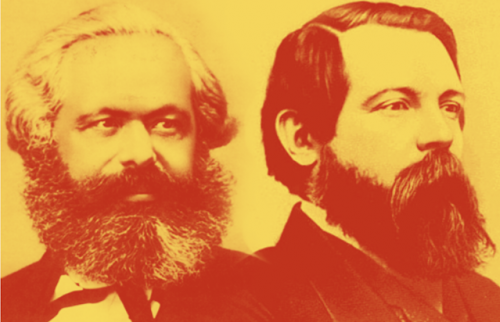
Par conséquent, lorsque Fiodor Tioutchev et Friedrich Engels s'opposent soit à la Russie soit à la révolution en 1848-1853 (le premier se rangeant du côté de la Russie, le second du côté de la révolution), il convient de garder à l'esprit que c'est à partir des années 1830 qu'une alliance solide entre l'élite britannique (et l'élite française, de plus en plus dépendante d'elle) et la révolution mondiale est en train de se former. Marx et Engels, Herzen et Bakounine ont donc été, dès le début, des prostitués vendus par Londres.
Le mot "révolution" est trop polysémique et est utilisé par toutes sortes de forces dans des sens opposés. Mais pour les communistes en particulier, il convient d'expliquer que l'Occident libéral et ploutocratique a tendance à s'attribuer le monopole de la révolution, qui est interprétée comme une lutte commune de la bourgeoisie et des gauchistes contre les institutions et les valeurs traditionnelles en vue de l'émancipation complète de l'individu par rapport à tout (cela a commencé avec Dieu et le monarque, s'est poursuivi avec les domaines et les églises, et s'est terminé avec le sexe). Ces dernières années, les idéologues de l'atlantisme ont commencé à appeler ces processus la "révolution atlantique", l'opposant aux révolutions conservatrices-continentales, si ce n'est par leur conception, du moins par leurs résultats. À cet égard, une fois de plus, l'exemple de dizaines de cas est probant, lorsque des personnalités importantes ont commencé dans leur jeunesse par professer un révolutionnarisme de gauche, mais, en lui donnant dès le début un caractère anti-bourgeois, sont rapidement arrivées à des positions conservatrices, sacrées, traditionnelles. Je dirais que c'était le secret du Dr Francia et de sa révolution paraguayenne, contre laquelle toute la puissance navale combinée de la Grande-Bretagne et de la France n'a rien pu faire à l'époque de Palmerston.
Nos communistes sont souvent trop attachés au dogme selon lequel ils sont soi-disant révolutionnaires, alors que l'Occident capitaliste est soi-disant devenu conservateur depuis longtemps. Mais ce n'est pas le cas. Du point de vue des mondialistes atlantistes, l'impérialisme moderne de l'OTAN et de l'UE est précisément une révolution contre les forces et les régimes traditionnels; en outre, pour eux, il s'agit d'une continuation des anciennes révolutions bourgeoises et de la révolution "prolétarienne" de Marx-Engels, entre autres. Au contraire, ils voyaient dans la défunte URSS ou dans les régimes nationaux-socialistes arabes un "despotisme réactionnaire", selon certaines thèses de Marx et Engels.


C'est pourquoi les gauchistes d'hier ne cessent de devenir les plus grands idéologues de l'Occident: c'était le cas avec Swinburne, c'était le cas avec Adorno et Horkheimer, c'est le cas aujourd'hui avec Glucksmann et Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy et Žižek. Les trotskistes de l'entourage de Leo Strauss sont devenus les néocons américains et ont formé Bush. Les gauchistes des années 60 et 70, John Kerry, Joschka Fischer, Jens Stoltenberg, sont devenus des piliers du capitalisme et de l'impérialisme américains, ce qui n'est évidemment pas un hasard. Il ne s'agit pas seulement de vénalité, mais du fait que l'idée gauchiste originelle selon laquelle "l'individu doit être émancipé" et "le capitalisme doit être soutenu contre les sociétés traditionnelles parce qu'il est plus émancipateur" ne pouvait tout simplement pas conduire à autre chose si elle était suivie à la lettre.
Dans les années 1830, les atlantistes de Palmerston et Cie ont perfectionné les techniques d'encouragement des révolutions qui, à bien des égards, sont devenues le modèle des révolutions colorées du début du 21ème siècle - l'école est la même. Voyons qui et comment les libéraux britanniques ont soutenu.
Pour les pays d'Europe occidentale, il s'agissait d'un réseau de structures maçonniques et paramaçonniques (Carbonara) comme la "Jeune Italie" et d'autres, sur le modèle desquelles de nouveaux clones apparaîtront plus tard en Europe de l'Est dans la seconde moitié du 19ème siècle (et Mikhaïl Katkov, dans les années 1860, craindra que les Britanniques ne créent les organisations "Jeune Yakoutie" et "Jeune Mordovie").


L'Armée rouge italienne, financée par les Whigs britanniques et soutenue par l'intelligentsia britannique de gauche, a connu un sort peu enviable: elle a été utilisée puis abandonnée. Ni Garibaldi ni Mazzini n'ont acquis de pouvoir réel. Mais tous deux finirent par travailler comme troupes mercenaires pour le compte de l'atlantisme britannique en Uruguay et pour la noblesse polonaise et, à la fin de leur trajectoire historique, comme mercenaires dans la guerre franco-prussienne.
L'épopée uruguayenne est particulièrement honteuse. Une guerre civile opposa les continentalistes blancos (blancs) dirigés par l'ancien président traditionaliste Oribe aux atlantistes-colorados (rouges), qui s'enfermèrent dans le port de Montevideo et, avec l'appui de la marine française, occupèrent la ville pendant huit ans (ce fut le plus long siège d'une ville à l'époque moderne dans le monde). Pour maintenir la tête de pont maritime de Montevideo entre les mains des capitalistes anglo-français et étrangler les continentalistes d'Oribe et de Rosas, les révolutionnaires européens ont été salement mis à contributions par leurs maîtres libéraux.

L'action la plus connue de Palmerston a été de soutenir les libéraux espagnols et portugais dans leurs guerres civiles contre les conservateurs ibériques: les carlistes en Espagne et les miguelistes au Portugal respectivement. Ce sont d'ailleurs les carlistes qui ont été les premiers à se qualifier de "traditionalistes". Le plan de Palmerston se traduisit par la signature de la Quadruple Alliance des forces subversives: les gouvernements britannique, français et les juntes libérales d'Espagne et du Portugal. Certes, cette alliance s'est effondrée au bout de dix ans en raison de multiples contradictions, mais c'est une autre histoire. L'essentiel est qu'un précédent a été créé pour la consolidation des forces de la révolution libérale en un bloc militaire, le prototype de l'OTAN.


Cependant, Palmerston n'a pas tenu compte de l'internationalisation du conflit. Il s'est avéré que la partie pouvait se jouer à deux. Alors que les francs-maçons libéraux fournissent des armes et des contingents aux libéraux espagnols et portugais, les conservateurs de toute l'Europe (y compris ceux d'Angleterre même) se portent volontaires pour combattre aux côtés des carlistes et des miguelistes. Les royalistes français de Vendée ont combattu au cours de cette guerre, les royalistes prussiens menés par le prince Lichnowsky ont combattu pour aider les carlistes (il sera plus tard tué lors de la révolution de 1848 par une foule de communistes qui, une fois de plus, ont travaillé comme des marionnettes britanniques). Ces efforts ne sont pas vains: si les carlistes ne l'emportent pas et si le régime libéral d'Isabelle l'emporte et connaît bientôt un coup d'État interne mené par le général Prim, qui porte au pouvoir les conservateurs anti-britanniques (dont l'idéologue Donoso Cortes), avec lesquels Palmerston rompt les relations diplomatiques en 1848.
Mais surtout, les traditionalistes anglais et écossais eux-mêmes se portent au secours des carlistes. En outre, si les mouvements "Young..."/"Jeune..." en Europe étaient autant d'outils de Londres et de Paris contre les forces traditionnelles, le mouvement "Young England" (et plus tard "Young Ireland") devint au contraire un point de rassemblement des traditionalistes britanniques contre le régime libéral atlantiste de Londres. Les raisons de ce phénomène doivent être mentionnées séparément, car c'est là que réside la troisième caractéristique la plus importante de l'atlantisme.
Le troisième signe de l'atlantisme (après le morcellement des territoires insulaires et côtiers et l'alimentation artificielle des révolutions) peut sembler inhabituel et extrêmement illogique, irrationnel, voire ridicule. Mais sans lui, l'atlantisme ne serait pas l'atlantisme.
Il réside dans le fait que, tout en tirant d'énormes profits de l'exploitation du reste du monde conquis, les régimes atlantistes ne sont pas du tout enclins à consacrer ce butin au développement de leurs propres pays. Ils s'obstinent à maintenir les populations de leurs pays dans des conditions sociales épouvantables, ne développent pas les avantages sociaux disponibles, détériorent les infrastructures, etc. Les élites atlantistes dépensent tout le butin pour elles-mêmes, et non pour la population qu'elles contrôlent, au sein de laquelle elles ne recrutent que certains individus.

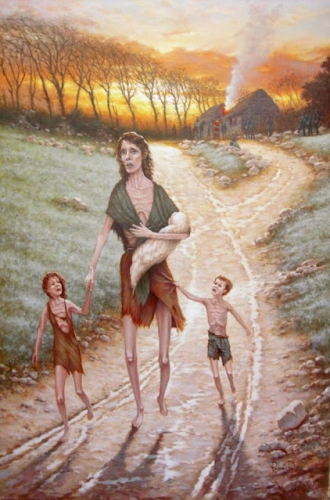
En d'autres termes, il n'est pas accidentel mais naturel que dans leurs propres pays (Grande-Bretagne, États-Unis, France, Australie, Japon, etc.), les régimes atlantistes les mieux consolidés maintiennent la majeure partie de la population dans des conditions absolument épouvantables depuis des décennies, voire des siècles. Un niveau de logement et de services publics proche de zéro, la saleté et la toxicomanie au cœur des mégapoles, l'absence de soins de santé en tant que système national gérable (ce qui a conduit à son effondrement honteux en 2020), le chaos dans l'éducation, la destruction délibérée de l'infrastructure des chemins de fer et des transports publics (dans le but bien précis de nuire aux citoyens de leur propre pays)... Tout cela n'est en aucun cas une innovation du 21ème siècle. C'est ainsi qu'était l'atlantisme au 19ème siècle "classique": dans les métropoles, et même par rapport à ses colons dans les îles et les colonies d'outre-mer (la façon dont le gouvernement britannique a traité les colons des îles stratégiquement importantes de l'Ascension et de Sainte-Hélène est une autre histoire, et il y a eu aussi toutes sortes d'histoires dans les îles du Pacifique). Plus récemment, Trump a fait remarquer à juste titre que "les États-Unis sont un pays du tiers monde à l'intérieur" (bien qu'il ait modestement négligé d'ajouter qu'il n'a lui-même rien fait pour remédier à cette situation).
Le comportement des gouvernements atlantistes, qui mènent des politiques ouvertement cannibales et antisociales non seulement à l'égard des pays et des peuples étrangers, mais aussi à l'égard des leurs, souligne une fois de plus la nature parasitaire de ces élites. Les peuples de leurs pays (y compris les Anglo-Saxons de souche, les Français de souche, etc.) ne sont pas "leurs" pour eux, mais seulement du matériel consommable, sauf qu'il est un peu plus cher que les peuples du "Tiers-Monde". L'Atlantisme est extrêmement élitiste et repose sur des clivages de classe, il n'apporte de fabuleux profits qu'à la couche "nomade" des cosmopolites mondialistes. Les habitants des pays atlantistes eux-mêmes - tant les zones rurales que les bidonvilles urbains - ont souffert de ces parasites pendant des siècles, tout comme nous, et sont considérés par les atlantistes non seulement comme des sujets, mais aussi comme de dangereux ennemis intérieurs qui ne devraient en aucun cas recevoir quoi que ce soit de bon: pas de routes, pas de services publics, pas de salaires, pas de soins de santé, pas d'éducation.
Lorsque nous parlons des années 1830 et, dans une moindre mesure, des années 1840 pour découvrir les trois principaux signes de l'atlantisme, alors, après avoir énoncé l'orientation social-darwiniste, anti-populaire et anti-humaine de la politique socio-économique des régimes atlantistes de l'époque (la Grande-Bretagne, en premier lieu, mais aussi la France et les États-Unis), l'espace s'ouvre pour parler de l'opposition traditionaliste à ce mal, qui, juste à cette époque, a commencé à se consolider activement.
Cela pourrait faire l'objet de nombreuses conférences et de nombreux livres, mais je voudrais attirer l'attention sur notre principal travail sur l'histoire et la théorie du "socialisme féodal/socialisme chrétien" du 19ème siècle sur le matériel britannique comme base de tout le traditionalisme, qui est à la fois anticapitaliste et antimarxiste. Ce travail, présenté sous la forme de deux articles dans un numéro de la revue Notebook on Conservatism pour 2020 [1], comprend toute une galerie de portraits vivants de grands penseurs sociaux peu connus en Russie, bien qu'au début du 20ème siècle, Fr. Sergius Bulgakov a commencé à les étudier de manière systématique. Les deux articles couvrent respectivement la première et la seconde moitié du 19ème siècle. Lorsque l'on travaille avec les écrits des grands "socialistes féodaux", on est invariablement frappé par le fait que, malgré l'énorme fossé technologique entre leur époque et la nôtre, rien n'a changé pour l'essentiel et tous leurs arguments et idéaux sont plus que pertinents. Telle est la leçon de l'importance de se tourner vers la "période de formation" de l'atlantisme et du traditionalisme des années 1830-40, dont les traits génériques nous concernent encore aujourd'hui.
Note:
[1] Medovarov M.V. The Becoming of Feudal and Christian Socialism in British Social Thought of the First Half of the XIX Century // Notebook on Conservatism. 2022. № 4. С. 129-142 ; Medovarov M.V. Feudal and Christian Socialism in the British social thought of the second half of the XIX - early XX century and its perception in Russia // Notebook on Conservatism. 2022. № 4. С. 169-182.
23:28 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, atlantisme, lord palmerston, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 septembre 2023
Balzac et la première rébellion féministe des femmes

Balzac et la première rébellion féministe des femmes
Nicolas Bonnal
La Femme de trente ans… Ce roman lance le bovarysme psychologique et sociétal. Mais Julie est beaucoup moins passive qu’Emma et elle se rebelle intellectuellement contre les hommes… Et déboulonne la société, annonçant nos législations folles d’aujourd’hui (on n’en fait pas un drame : après tout, qu’elle dégage, l’espèce dite humaine) :
– Obéir à la société ?... reprit la marquise en laissant échapper un geste d’horreur. Hé ! monsieur, tous nos maux viennent de là. Dieu n’a pas fait une seule loi de malheur ; mais en se réunissant les hommes ont faussé son œuvre. Nous sommes, nous femmes, plus maltraitées par la civilisation que nous ne le serions par la nature. La nature nous impose des peines physiques que vous n’avez pas adoucies, et la civilisation a développé des sentiments que vous trompez incessamment. La nature étouffe les êtres faibles, vous les condamnez à vivre pour les livrer à un constant malheur. Le mariage, institution sur laquelle s’appuie aujourd’hui la société, nous en fait sentir à nous seules tout le poids : pour l’homme la liberté, pour la femme des devoirs. Nous vous devons toute notre vie, vous ne nous devez de la vôtre que de rares instants. »
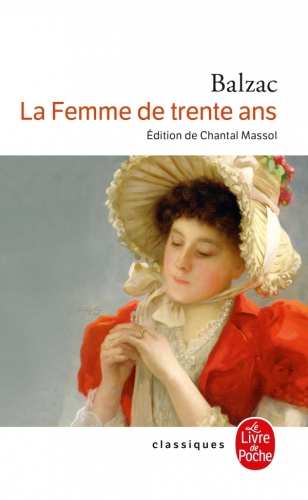
Makow rappelait que pour les féministes le sort des femmes dans la société machiste, c’est Auschwitz. ! Notre sacré Balzac (pas son personnage) n’en est pas loin non plus :
« Hé bien, le mariage, tel qu’il se pratique aujourd’hui, me semble être une prostitution légale. De là sont nées mes souffrances… »
Pour notre bon gros romancier réaliste (réaliste ou romantique ?), la vie de la femme devient un cercle des horreurs dantesques :
« Mon avenir est horrible, je le sais : la femme n’est rien sans l’amour, la beauté n’est rien sans le plaisir ; mais le monde ne réprouverait-il pas mon bonheur s’il se présentait encore à moi ? Je dois à ma fille une mère honorée. Ah ! je suis jetée dans un cercle de fer d’où je ne puis sortir sans ignominie. Les devoirs de famille accomplis sans récompense m’ennuieront; je maudirai la vie; mais ma fille aura du moins un beau semblant de mère. Je lui rendrai des trésors de vertu pour remplacer les trésors d’affection dont je l’aurai frustrée. Je ne désire même pas vivre pour goûter les jouissances que donne aux mères le bonheur de leurs enfants.
Je ne crois pas au bonheur. »
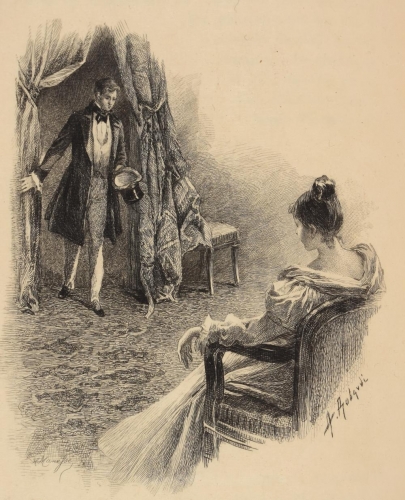
Cerise sur le gâteau :
« Vous honnissez de pauvres créatures qui se vendent pour quelques écus à un homme qui passe, la faim et le besoin absolvent ces unions éphémères; tandis que la société tolère, encourage l’union immédiate bien autrement horrible d’une jeune fille candide et d’un homme qu’elle n’a pas vu trois mois durant ; elle est vendue pour toute sa vie. Il est vrai que le prix est élevé ! Si en ne lui permettant aucune compensation à ses douleurs vous l’honoriez ; mais non, le monde calomnie les plus vertueuses d’entre nous ! Telle est notre destinée, vue sous ses deux faces : une prostitution publique et la honte, une prostitution secrète et le malheur. Quant aux pauvres filles sans dot, elles deviennent folles, elles meurent ; pour elles aucune pitié !
La beauté, les vertus ne sont pas des valeurs dans votre bazar humain et vous nommez Société ce repaire d’égoïsme. »
Et ces braves gens n’avaient rien vu.
 Le pauvre curé répond à Julie :
Le pauvre curé répond à Julie :
– Madame, vos discours me prouvent que ni l’esprit de famille ni l’esprit religieux ne vous touchent, aussi n’hésiterez-vous pas entre l’égoïsme social qui vous blesse et l’égoïsme de la créature qui vous fera souhaiter des jouissances…
– La famille, monsieur, existe-t-elle? Je nie la famille dans une société qui, à la mort du père ou de la mère partage les biens et dit à chacun d’aller de son côté. La famille est une association temporaire et fortuite que dissout promptement la mort. »
Balzac tape ensuite sur le désastreux bilan napoléonien des réformes du droit civil :
« Nos lois ont brisé les maisons, les héritages, la pérennité des exemples et des traditions. Je ne vois que décombres autour de moi. »
Le curé est excellent (ah, si nos bons prêtres pouvaient parler comme ceux de Stendhal, de Balzac ou même de Pagnol) :
– Madame, vous ne reviendrez à Dieu que quand sa main s’appesantira sur vous, et je souhaite que vous ayez assez de temps pour faire votre paix avec lui. Vous cherchez vos consolations en baissant les yeux sur la terre au lieu de les lever vers les cieux. Le philosophisme et l’intérêt personnel ont attaqué votre cœur ; vous êtes sourde à la voix de la religion comme le sont les enfants de ce siècle sans croyance ! Les plaisirs du monde n’engendrent que des souffrances. »
Et ici le prêtre enfonce très bien le clou.
«Vous allez changer de douleurs voilà tout. »
C’est le fardeau de la personnalité qui va apparaître, dont parlera plus tard Pearson, et dont se moquera Nietzsche dans son Zarathoustra. Debord évoquera ce conglomérat de solitudes sans illusions que nous sommes devenus. Tout cela se termine par une destruction – destruction ou anéantissement ? - de la démographie européenne qui aujourd’hui s’exporte au reste du monde, Amériques, Asie, Afrique exclue bien entendue
Sources:
Balzac - La femme de trente ans, ebooksgratuits.com, pp. 96-102-103
Nicolas Bonnal – Chroniques sur la fin de l’histoire (I, II et III), Amazon.fr
21:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, honoré de balzac, balzac, féminisme, 19ème siècle, bovarysme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 septembre 2023
De Thierry Breton à Napoléon III : Victor Hugo et l’interdiction de penser et d’imprimer

De Thierry Breton à Napoléon III: Victor Hugo et l’interdiction de penser et d’imprimer
Nicolas Bonnal
Les interdits cybernétiques de Thierry Breton évoquent Orwell pour le Daily Mail. Mais nous avons de nombreux précédents en France concernant l’interdiction de tout par la bureaucratie ; et je prévoyais dans mon livre sur l’exception française (Les Belles Lettres, 1997) que la technocratie française socialiste et gaulliste annexerait l’Europe (démographiquement et intellectuellement) et qu’elle finirait par tout interdire.
On fait avec les moyens du bord : en 1851 c’est l’imprimerie, avec Breton c’est internet (d’ailleurs je m’en fous : l’humanité a ce qu’elle mérite). Victor Hugo :
« À l’heure qu’il est, personne ne sait au juste ce que c’est que le 2 décembre, ce qu’il a fait, ce qu’il a osé, qui il a tué, qui il a enseveli, qui il a enterré. Dès le matin du crime, les imprimeries ont été mises sous le scellé, la parole a été supprimée par Louis Bonaparte, homme de silence et de nuit. Le 2, le 3, le 4, le 5 et depuis, la vérité a été prise à la gorge et étranglée au moment où elle allait parler. Elle n’a pu même jeter un cri. Il a épaissi l’obscurité sur son guet-apens, et il a en partie réussi. Quels que soient les efforts de l’histoire, le 2 décembre plongera peut-être longtemps encore dans une sorte d’affreux crépuscule. Ce crime est composé d’audace et d’ombre ; d’un côté il s’étale cyniquement au grand jour, de l’autre il se dérobe et s’en va dans la brume. Effronterie oblique et hideuse qui cache on ne sait quelles monstruosités sous son manteau. »
Rappelons que peu à peu l’empire devint libéral et… populaire, le plébiscite de 1870, quelques mois avant la « correction » (Marx) face à la Prusse – correction méritée pour un empire qui avait croisé le fer avec la moitié de la terre, Chine, Mexique, Italie (1867 et 70), Autriche ou bien sûr… Russie – confirmant Napoléon dans sa pérennité dynastique.
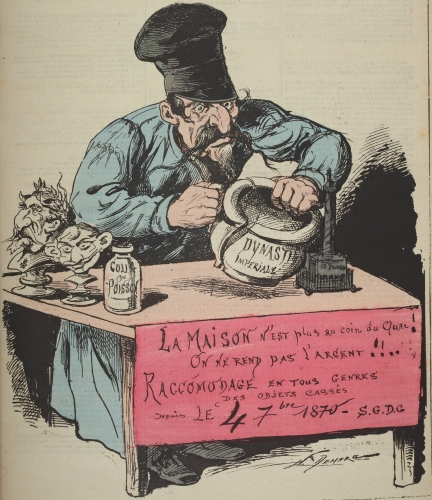
Aucune illusion à se faire sur le suffrage universel : sous Napoléon III ce fut comme sous Hitler. Hugo rajoute :
« Et c’est là le scrutin, et répétons-le, insistons-y, ne nous lassons pas ; je crie cent fois les mêmes choses, dit Isaïe, pour qu’on les entende une fois ; et c’est là le scrutin, c’est là le plébiscite, c’est là le vote, c’est là le décret souverain du « suffrage universel », à l’ombre duquel s’abritent, dont se font un titre d’autorité et un diplôme de gouvernement ces hommes qui tiennent la France aujourd’hui, qui commandent, qui dominent, qui administrent, qui jugent, qui règnent, les mains dans l’or jusqu’aux coudes, les pieds dans le sang jusqu’aux genoux ! »
Comme sous Macron et sous Breton on a des élections et des médias euphorisants :
« Maintenant, et pour en finir, faisons une concession à M. Bonaparte. Plus de chicanes. Son scrutin du 20 décembre a été libre, il a été éclairé ; tous les journaux ont imprimé ce qui leur a plu ; qui a dit le contraire ? des calomniateurs… »
Après Hugo (il sera pacifiste sous Napoléon, belliciste sous Gambetta, donc méfiance) part sur les grands mots :
« Ils résolurent d’en finir une fois pour toutes avec l’esprit d’affranchissement et d’émancipation, et de refouler et de comprimer à jamais la force ascensionnelle de l’humanité. L’entreprise était rude. Ce que c’était que cette entreprise, nous l’avons indiqué déjà, plus d’une fois, dans ce livre et ailleurs. »
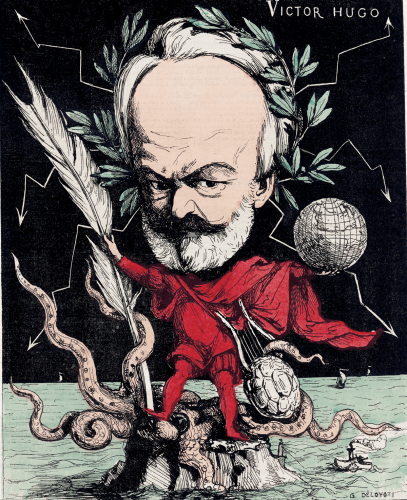
Mais quand on voit la liquidation de la « culture masculine blanche » (désolés, c’est la culture, même s’il n’y en a plus, lisez Barzun) par Fink (qui commande tout) et consorts (Ursula Bourla etc.) on peut méditer les belles paroles qui suivent (sublime envolée avec accumulation d’infinitifs) :
« Défaire le travail de vingt générations ; tuer dans le dix-neuvième siècle, en le saisissant à la gorge, trois siècles, le seizième, le dix-septième et le dix-huitième, c’est-à-dire Luther, Descartes et Voltaire, l’examen religieux, l’examen philosophique, l’examen universel ; écraser dans toute l’Europe cette immense végétation de la libre pensée, grand chêne ici, brin d’herbe là ; marier le knout et l’aspersoir ; mettre plus d’Espagne dans le midi et plus de Russie dans le nord ; ressusciter tout ce qu’on pourrait de l’inquisition et étouffer tout ce qu’on pourrait de l’intelligence ; abêtir la jeunesse, en d’autres termes, abrutir l’avenir ; faire assister le monde à l’auto-da-fé des idées ; renverser les tribunes, supprimer le journal, l’affiche, le livre, la parole, le cri, le murmure, le souffle ; faire le silence ; poursuivre la pensée dans la casse d’imprimerie, dans le composteur, dans la lettre de plomb, dans le cliché, dans la lithographie, dans l’image, sur le théâtre, sur le tréteau, dans la bouche du comédien, dans le cahier du maître d’école, dans la balle du colporteur ; donner à chacun pour foi, pour loi, pour but et pour dieu, l’intérêt matériel ; dire au peuple : mangez et ne pensez plus ; ôter l’homme du cerveau et le mettre dans le ventre ; éteindre l’initiative individuelle, la vie locale, l’élan national, tous les instincts profonds qui poussent l’homme vers le droit ; anéantir ce moi des nations qu’on nomme Patrie ; détruire la nationalité chez les peuples partagés et démembrés, les constitutions dans les États constitutionnels, la République en France, la liberté partout ; mettre partout le pied sur l’effort humain. »
C’est ce qu’ils refont aujourd’hui nos clercs et bureaucrates associés au capital des fonds de pension américains. Hugo écrit au passage (il irait en taule aujourd’hui donc je le cite goulument) sur ce gouvernement (déjà) des aristos (ils sont toujours là) et des millionnaires – et des obsédés sexuels (cf. la Fête impériale) :
« Allons, nous allons exposer ce triomphe de l’ordre ; nous allons peindre ce gouvernement vigoureux, assis, carré, fort ; ayant pour lui une foule de petits jeunes gens qui ont plus d’ambition que de bottes, beaux fils et vilains gueux ; soutenu à la Bourse par Fould le juif, et à l’église par Montalembert le catholique ; estimé des femmes qui veulent être filles et des hommes qui veulent être préfets ; appuyé sur la coalition des prostitutions ; donnant des fêtes ; faisant des cardinaux ; portant cravate blanche et claque sous le bras, ganté beurre frais comme Morny, verni à neuf comme Maupas, frais brossé comme Persigny, riche, élégant, propre, doré, brossé, joyeux, né dans une mare de sang. »
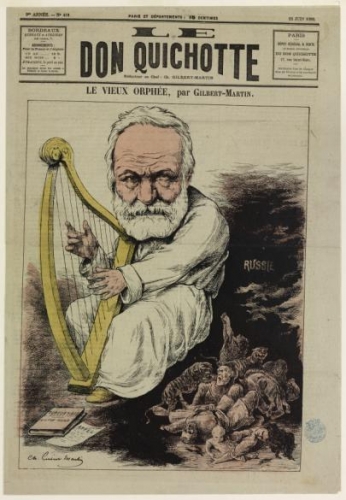
Puis il remarque (comme le fera Albert Speer dans ses mémoires sur le troisième Reich, autre association de bureaucrates socialistes et de milliardaires russophobes) le lien entre dictature et progrès technique (voyez aussi mon Internet nouvelle voie initiatique, quatrième partie) :
« Parce que vous avez vu réussir un coup de main prétorien, vous vous déclarez bas-empire ! C’est vite dit, et lâchement pensé. Mais réfléchissez donc, si vous pouvez. Est-ce que le bas-empire avait la boussole, la pile, l’imprimerie, le journal, la locomotive, le télégraphe électrique ? Autant d’ailes qui emportent l’homme, et que le bas-empire n’avait pas ! Où le bas-empire rampait, le dix-neuvième siècle plane. Y songez-vous ? Quoi ! nous reverrions l’impératrice Zoé, Romain Argyre, Nicéphore Logothète, Michel Calafate ! Allons donc ! Est-ce que vous vous imaginez que la Providence se répète platement ? Est-ce que vous croyez que Dieu rabâche ? »
Comme je l’ai dit le pouvoir devenu libéral sera conforté par le dernier plébiscite. Et comme le dit Flaubert (alors ami de Hugo, avec il correspond et dont il récupère le courrier) dans son Journal, quelque part en 1853 :
« Mais une vérité me semble être sortie de tout cela ; c'est qu'on n'a nul besoin du vulgaire, de l'élément nombreux des majorités, de l'approbation, de la consécration. 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n'y a plus rien, qu'une tourbe canaille et imbécile. Nous sommes tous enfoncés au même niveau dans une médiocrité commune. »
Breton comme Biden ou Macron l’ont parfaitement compris. Il n’y a aucune résistance, qu’une poignée de râleurs qui cliquent en attendant d’être affamés et privés de tout comme les autres, alors pourquoi se priver, merde ? Censure aussi Victor Hugo, Thierry. Et notre cher passé…
Flaubert encore : « L'humanité a la rage de l'abaissement moral, et je lui en veux de ce que je fais partie d'elle. »
Sources principales :
http://www.bouquineux.com/?telecharger=304&Flaubert-C...
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12469157/EU-accu...
http://www.centremultimedia.be/IMG/pdf/hugo_napoleon_le_p...
https://www.amazon.fr/Autopsie-lexception-fran%C3%A7aise-...
https://www.amazon.fr/INTERNET-SECRETS-MONDIALISATION-Nic...
13:22 Publié dans Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor hugo, napoléon iii, histoire, 19ème siècle, censure, thierry breton, nicolas bonnal, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 15 août 2023
Victor Hugo et le génie des énergies naturelles (eau, vent)
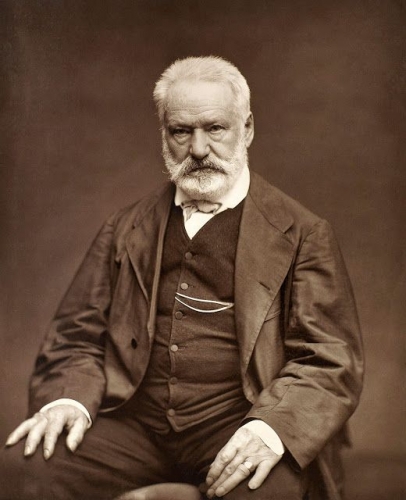
Victor Hugo et le génie des énergies naturelles (eau, vent)
Nicolas Bonnal
Dans Quatre-vingt-treize, Hugo défie les hommes et leur barbarie. Il se fait le chantre en pleine guerre civile française, en pleine horreur révolutionnaire, de la sagesse, de la beauté et de la richesse de la nature.
Il décrit ainsi une promenade :
« Pendant que ceci se passait près de Tanis, le mendiant s’en était allé vers Crollon. Il s’était enfoncé dans les ravins, sous les vastes feuillées sourdes, inattentif à tout et attentif à rien, comme il l’avait dit lui-même, rêveur plutôt que pensif, car le pensif a un but et le rêveur n’en a pas, errant, rôdant, s’arrêtant, mangeant çà et là une pousse d’oseille sauvage, buvant aux sources, dressant la tête par moments à des fracas lointains, puis rentrant dans l’éblouissante fascination de la nature, offrant ses haillons au soleil, entendant peut-être le bruit des hommes, mais écoutant le chant des oiseaux. »
Bruit des hommes, chant des oiseaux. Hugo aimait Leopardi (voyez mon texte).
Hugo explique aussi que certains paysages créent du mal-être :
« En présence de certains paysages féroces, on est tenté d’exonérer l’homme et d’incriminer la création ; on sent une sourde provocation de la nature ; le désert est parfois malsain à la conscience, surtout à la conscience peu éclairée ; la conscience peut être géante, cela fait Socrate et Jésus ; elle peut être naine, cela fait Atrée et Judas. La conscience petite est vite reptile ; les futaies crépusculaires, les ronces, les épines, les marais sous les branches, sont une fatale fréquentation pour elle ; elle subit là la mystérieuse infiltration des persuasions mauvaises. »
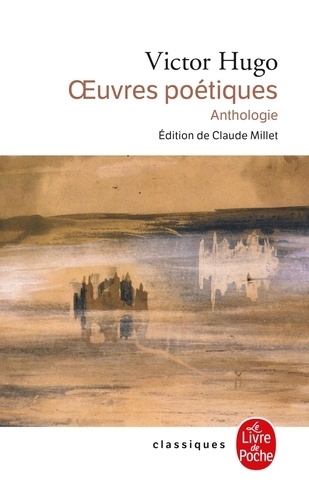
C’est tout le message de Tolkien (dernier écrivain romantique et magique) que l’on a là.
La nature est plus sage et plus belle. L’homme évidemment peut « dépasser » la nature. Cela fait longtemps qu’il ne le fait plus. Notez :
« Restez dans la nature. Soyez les sauvages. Otaïti est un paradis. Seulement, dans ce paradis on ne pense pas. Mieux vaudrait encore un enfer intelligent qu’un paradis bête. Mais non, point d’enfer. Soyons la société humaine. Plus grande que nature. Oui. Si vous n’ajoutez rien à la nature, pourquoi sortir de la nature ? Alors, contentez-vous du travail comme la fourmi, et du miel comme l’abeille. Restez la bête ouvrière au lieu d’être l’intelligence reine. »
Belle définition de la société idéale (« nature sublimée ») :
« Si vous ajoutez quelque chose à la nature, vous serez nécessairement plus grand qu’elle ; ajouter, c’est augmenter ; augmenter, c’est grandir. La société, c’est la nature sublimée. Je veux tout ce qui manque aux ruches, tout ce qui manque aux fourmilières, les monuments, les arts, la poésie, les héros, les génies. »
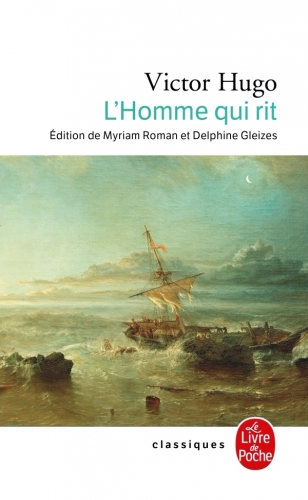
Malgré la brutalité et l’imbécillité de l’homme, de ses guerres et de ses fabrications (comme dit Lao Tse) la nature persiste :
« La nature est impitoyable ; elle ne consent pas à retirer ses fleurs, ses musiques, ses parfums et ses rayons devant l’abomination humaine ; elle accable l’homme du contraste de la beauté divine avec la laideur sociale ; elle ne lui fait grâce ni d’une aile de papillon ni d’un chant d’oiseau ; il faut qu’en plein meurtre, en pleine vengeance, en pleine barbarie, il subisse le regard des choses sacrées ; il ne peut se soustraire à l’immense reproche de la douceur universelle et à l’implacable sérénité de l’azur. Il faut que la difformité des lois humaines se montre toute nue au milieu de l’éblouissement éternel. L’homme brise et broie, l’homme stérilise, l’homme tue ; l’été reste l’été, le lys reste le lys, l’astre reste l’astre. »
On répète parce que c’est trop beau : « L’homme brise et broie, l’homme stérilise, l’homme tue ; l’été reste l’été, le lys reste le lys, l’astre reste l’astre. »
Il est amusant de voir d’ailleurs que la nature n’a jamais été aussi belle alors que l’homme écolo et repenti prétend à coups d’éoliennes et d’énième guerre mondiale la protéger.
Une dernière grande envolée poétique :
« Ce matin-là, jamais le ciel frais du jour levant n’avait été plus charmant. Un vent tiède remuait les bruyères, les vapeurs rampaient mollement dans les branchages, la forêt de Fougères, toute pénétrée de l’haleine qui sort des sources, fumait dans l’aube comme une vaste cassolette pleine d’encens ; le bleu du firmament, la blancheur des nuées, la claire transparence des eaux, la verdure, cette gamme harmonieuse qui va de l’aigue marine à l’émeraude, les groupes d’arbres fraternels, les nappes d’herbes, les plaines profondes, tout avait cette pureté qui est l’éternel conseil de la nature à l’homme. Au milieu de tout cela s’étalait l’affreuse impudeur humaine ; au milieu de tout cela apparaissaient la forteresse et l’échafaud, la guerre et le supplice, les deux figures de l’âge sanguinaire et de la minute sanglante ; la chouette de la nuit du passé et la chauve-souris du crépuscule de l’avenir. En présence de la création fleurie, embaumée, aimante et charmante, le ciel splendide inondait d’aurore la Tourgue et la guillotine, et semblait dire aux hommes : Regardez ce que je fais et ce que vous faites. »
L’homme brise et broie, l’homme stérilise, l’homme tue ; l’été reste l’été, le lys reste le lys, l’astre reste l’astre. »
La France de jadis…
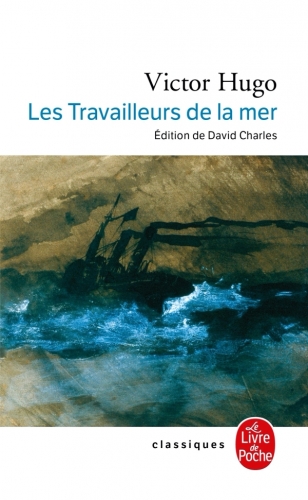
Enfin Hugo lance même un message sublime sur l’énergie naturelle. L’homme doit s’aider de la terre pour vivre mieux :
« Que tout homme ait une terre, et que toute terre ait un homme. Vous centuplerez le produit social. La France, à cette heure, ne donne à ses paysans que quatre jours de viande par an ; bien cultivée, elle nourrirait trois cent millions d’hommes, toute l’Europe. Utilisez la nature, cette immense auxiliaire dédaignée. Faites travailler pour vous tous les souffles de vent, toutes les chutes d’eau, tous les effluves magnétiques. Le globe a un réseau veineux souterrain ; il y a dans ce réseau une circulation prodigieuse d’eau, d’huile, de feu ; piquez la veine du globe, et faites jaillir cette eau pour vos fontaines, cette huile pour vos lampes, ce feu pour vos foyers. Réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et reflux, au va-et-vient des marées. Qu’est-ce que l’océan ? une énorme force perdue. Comme la terre est bête ! ne pas employer l’océan ! »
17:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor hugo, nicolas bonnal, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, écologie, nature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Max Stirner sur l'art et la religion
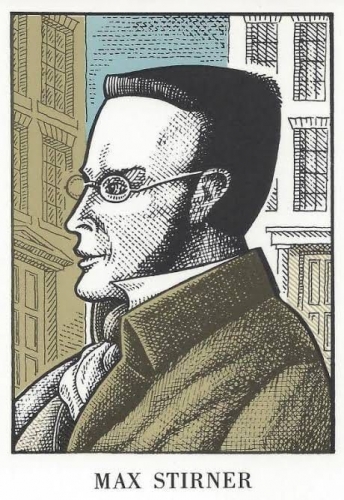
Max Stirner sur l'art et la religion
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2023/08/02/max-stirner-om-konst-och-religion/
L'un des représentants les plus originaux de la philosophie allemande fut Max Stirner (1806-1856), auteur de Der Einzige und sein Eigentum, une sorte de jeune hégélien et, pendant un certain temps, l'un des principaux objets de la haine de Marx et Engels. La philosophie de Stirner peut être qualifiée d'égoïste ; il décrit la croyance en la plupart des phénomènes sociaux, de la propriété à l'État et à l'humanité, comme des spectres. Aujourd'hui, on parle parfois de "constructions sociales". La perspective de Stirner rappelle en partie cette approche, mais se concentre sur la manière dont ces spectres ou "roues dentées dans la tête" affectent l'individu. Il a également développé une vision dialectique de l'évolution historique de la relation entre "der Einzige" et les fantômes qui hantent le cerveau. Selon Stirner, les êtres humains et la civilisation passent par trois phases, qu'il appelle, ce qui n'est pas très politiquement correct, "négroïde", "mongoloïde" et "caucasienne". Dans la dernière phase, l'homme maîtrise sa création et non l'inverse; on peut comparer cela au schéma historique de Marx, qui met l'accent sur l'économie plutôt que sur les fantômes cérébraux, mais la perspective de base est similaire. Après avoir été maîtrisé par sa création, l'homme reprend le contrôle, avec des outils beaucoup plus puissants qu'avant le début du processus. L'une des différences entre Marx et Stirner réside dans le fait que pour Stirner, il est possible aujourd'hui, au niveau individuel, de se libérer de l'État, de la propriété, etc. Libéré mentalement, il faut ajouter que l'État reste une réalité, quelle que soit la façon dont on l'envisage.
Stirner a été décrit par Spengler comme un représentant de l'égoïsme commun plutôt que de l'égoïsme noble ("je vaux pour moi-même" contre "je vaux pour la culture"). Mais tout comme Engels a d'abord encensé "St Max", avant que Marx ne le débarrasse impitoyablement de ces illusions, il a influencé une partie de la droite la plus authentique. L'Anarch d'Ernst Jünger est un développement du "Einzige" de Stirner ; Schmitt et Mussolini l'ont également lu. On ne sait pas dans quelle mesure ils ont compris la phase "caucasienne" de Stirner ; la critique de "Saint Max", qu'elle soit de droite ou de gauche, s'est souvent concentrée sur son apparence petite-bourgeoise. Jünger nous donne une idée de la manière dont un type de personnalité plus héroïque pourrait traiter certains arguments de Stirner ; Evola peut également être intéressant dans ce contexte. Sa distance par rapport aux idéologies/"fantômes cérébraux" de la société moderne, sa nature socialement et idéologiquement de promiscuité, et son aspect de sur-socialisation rappellent souvent Stirner, même si ce dernier aurait considéré la tradition comme un autre spectre cérébral. Ce à quoi Evola a probablement objecté qu'il ne parlait pas de ce qu'il n'avait pas vécu et que le matérialisme de Stirner était le véritable spectre.
Art et religion
L'art fait l'objet, et la religion ne vit que dans ses nombreux liens avec cet objet, mais la philosophie se démarque très clairement de l'un et de l'autre.
- Stirner
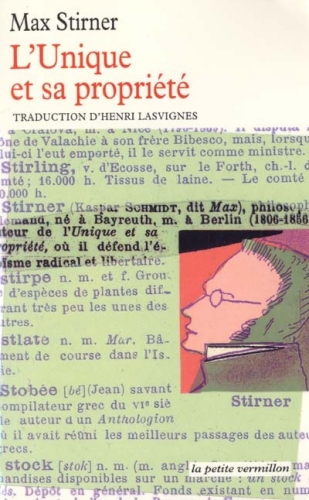 Plusieurs écrits de Stirner sont désormais disponibles sur l'internet, notamment Kunst und Religion de 1842. Stirner utilise le raisonnement hégélien pour expliquer la religion comme une sorte d'aliénation. L'homme sent qu'il a une autre face en lui et "il est poussé à se diviser entre ce qu'il est réellement et ce qu'il doit devenir". Il s'agit d'une analyse purement anthropocentrique de la religion plutôt que d'une analyse plus cosmologique, mais elle n'est pas totalement inintéressante. En particulier, Stirner place l'artiste au centre, car ce sont, selon lui, les génies artistiques qui fondent les religions. "Seul le fondateur d'une religion est inspiré, mais il est aussi le créateur des Idéaux, par la création desquels tout autre génie sera impossible", écrit Stirner. Il note également que la vraie religion n'est pas tiède, qu'il y a l'amour religieux et la haine religieuse. C'est ici que Stirner devient étonnamment actuel, "à notre époque, la quantité de haine a diminué dans la mesure où l'amour de Dieu s'est affaibli. Un amour humain s'est infiltré, qui ne relève pas de la piété pieuse mais plutôt de la morale sociale ; il est plus "zélé" pour le bien de l'homme que pour le bien de Dieu". Religion et morale sociale ne sont pas la même chose, ce qui signifie qu'une église envahie par la morale sociale sous la forme du libéralisme de gauche risque de mettre la religion au second plan.
Plusieurs écrits de Stirner sont désormais disponibles sur l'internet, notamment Kunst und Religion de 1842. Stirner utilise le raisonnement hégélien pour expliquer la religion comme une sorte d'aliénation. L'homme sent qu'il a une autre face en lui et "il est poussé à se diviser entre ce qu'il est réellement et ce qu'il doit devenir". Il s'agit d'une analyse purement anthropocentrique de la religion plutôt que d'une analyse plus cosmologique, mais elle n'est pas totalement inintéressante. En particulier, Stirner place l'artiste au centre, car ce sont, selon lui, les génies artistiques qui fondent les religions. "Seul le fondateur d'une religion est inspiré, mais il est aussi le créateur des Idéaux, par la création desquels tout autre génie sera impossible", écrit Stirner. Il note également que la vraie religion n'est pas tiède, qu'il y a l'amour religieux et la haine religieuse. C'est ici que Stirner devient étonnamment actuel, "à notre époque, la quantité de haine a diminué dans la mesure où l'amour de Dieu s'est affaibli. Un amour humain s'est infiltré, qui ne relève pas de la piété pieuse mais plutôt de la morale sociale ; il est plus "zélé" pour le bien de l'homme que pour le bien de Dieu". Religion et morale sociale ne sont pas la même chose, ce qui signifie qu'une église envahie par la morale sociale sous la forme du libéralisme de gauche risque de mettre la religion au second plan.
Quoi qu'il en soit, Stirner décrit un cycle historique, comparable au jeu de Spengler entre culture et civilisation, dans lequel les génies artistiques créent des religions, qui sont ensuite soutenues par les gens ordinaires avant d'être appauvries et finalement détruites par la rencontre avec les artistes à nouveau. Mais aujourd'hui, les artistes sont des comédiens, qui montrent qu'ils sont devenus des coquilles vides. Mais le cycle ne s'arrête pas là, "même la comédie, comme tous les arts, précède la religion, car elle ne fait que laisser la place à la nouvelle religion, à celle qui se formera à nouveau".
Il y a donc des idées intéressantes chez Stirner, même si sa compréhension de la religion est clairement limitée par son contexte historique. Il peut être utile d'examiner deux penseurs influencés par Stirner, à savoir Dora Marsden et Hakim Bey, et la manière dont ils ont tenté de dépasser ces limites pour "der Einzige".

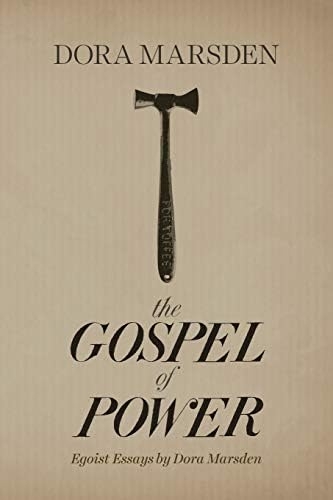
Comme nous l'avons mentionné plus haut, Stirner a donné à l'artiste un rôle central dans l'histoire et a influencé de nombreuses âmes artistiques. Par l'intermédiaire de Dora Marsden (1882-1960), éditrice, suffragette et philosophe, l'égoïsme de Stirner a eu une influence non négligeable sur l'avant-garde britannique. Ezra Pound, T. S. Eliot, D. H. Lawrence, James Joyce et Wyndham Lewis, entre autres, ont écrit dans son journal The Egoist. Marsden apparaît comme une personnalité hors du commun, à la fois intelligente et indomptable, avec un désir presque germanique de créer un système structuré. Sa perspective se confond avec Héraclite, le mysticisme et la logique stricte. Au lieu de l'anarque de Jünger, elle parlait de l'archiste. Dans L'illusion de l'anarchisme, elle écrit que "à la naissance de chaque unité de vie, il y a un archiste. Un archiste est quelqu'un qui cherche à établir, maintenir et protéger, par les armes les plus puissantes dont il dispose, la loi de ses propres intérêts". Elle dépeint le monde comme une arène où les différents intérêts s'affrontent, un contrepoint utile à la vision libérale du monde d'aujourd'hui où les intérêts sont soit camouflés en idéaux, soit diabolisés.
Il est intéressant de noter que, dès The Egoist, Dora Marsden a développé une vision du monde plus cosmique, dans laquelle l'ego créatif est devenu quelque chose de permanent plutôt que temporaire. Plus tard, elle a écrit The Mysteries of Christianity (Les mystères du christianisme), où elle aborde l'aspect "féministe" du christianisme.
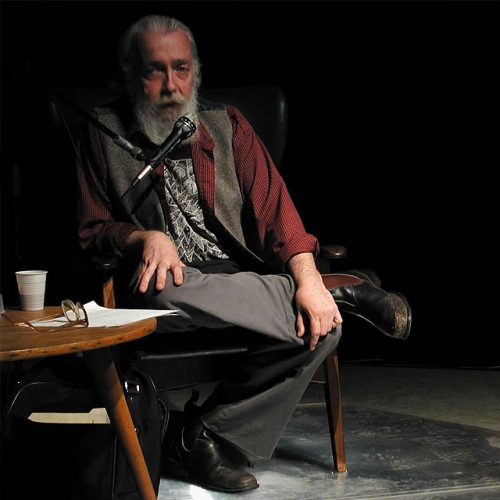
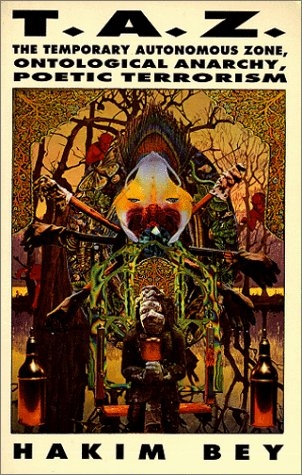
La question de savoir dans quelle mesure sa métaphysique représente un perfectionnement de Stirner plutôt que quelque chose de propre, bien qu'original, est une autre question. Dans ce contexte, les réflexions de Hakim Bey sur Stirner dans l'essai Black Crown & Black Rose - Anarcho-Monarchism & Anarcho-Mysticism dans son ouvrage désormais classique intitulé T.A.Z. sont intéressantes. Bey n'est pas un penseur totalement dépourvu de problèmes et son langage est parfois théâtral, voire pathétique. Néanmoins, cet essai est probablement la meilleure tentative pour rapprocher der Einzige d'une cosmologie plus traditionnelle (bien que l'absence de Dora dans la discussion de Bey sur l'individualisme et le monisme radical suggère qu'il ne l'a pas lue). Bey place le matérialisme de Stirner dans un contexte historique, "né longtemps après la déliquescence de la chrétienté, mais bien avant la découverte de l'Orient et de la tradition illuministe cachée dans l'alchimie occidentale, l'hérésie révolutionnaire et l'activisme occulte". Il se rapproche ici de la catégorisation par Evola du dévotionnalisme et de la foi aveugle en des choses non expérimentées comme des formes inférieures de spiritualité. Sa critique de Stirner identifie les deux points les plus faibles : l'absence d'un "concept opérationnel de la conscience non ordinaire" et "une certaine froideur à l'égard de l'autre". Stirner n'avait pas lui-même expérimenté d'autres états de conscience que ceux du petit-bourgeois, et était donc enclin à en considérer les fruits comme des spectres cérébraux. Malgré des approches similaires à l'argument de l'"union des égoïstes", l'éros est également plutôt absent de l'œuvre de Stirner. Bey mentionne qu'il peut s'agir d'une réaction compréhensible à "la chaude suffocation de la sentimentalité et de l'altruisme du 19ème siècle", mais l'isolement n'est pas non plus une voie fructueuse.
En fin de compte, Stirner reste un auteur enrichissant, comme le suggèrent ceux qui ont été inspirés par lui. La distance spirituelle qu'il recherchait par rapport aux "roues dentées dans la tête" du monde moderne n'est pas moins saine aujourd'hui. Le sentiment de liberté qui peut naître du fait de considérer "l'État", le "racisme" ou autres chimères comme des spectres cérébraux est souvent significatif, que l'on s'inspire d'Evola ou de Stirner. Jünger, Marsden et Bey montrent comment d'autres types de personnalité peuvent compléter la pensée de "St Max".
14:31 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, max stirner, égoïsme, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 juin 2023
Un rebelle européen aux racines russes

Un rebelle européen aux racines russes
Yana Panina
L'anarchisme classique à travers les yeux du radical russe Mikhaïl Bakounine
L'histoire du véritable anarchisme avec un arrière-plan russe est étroitement liée à la personnalité de Mikhaïl Bakounine, dont la contribution au destin du monde entier s'est avérée colossale. Véritablement russe, éduqué à la philosophie européenne, son objectif principal était de créer un monde où tous les hommes seraient égaux et libres, et où la vie ne serait pas mesurée par l'épaisseur de la bourse ou la hauteur du piédestal social. Les idées utopiques de Bakounine allaient à l'encontre des pensées de Marx, pour qui le radical n'était soudain plus que "ce gros Russe". Qui était-il donc et sa philosophie est-elle encore vivante aujourd'hui ?
Conditions préalables à la formation de l'anarchisme de Bakounine
Mikhaïl Bakounine a "hérité" des idées de liberté et d'égalité de son éducation au sein d'une famille nombreuse et très conviviale. Une petite communauté de 11 enfants, égaux en termes de conditions et de relations, formait une sorte de commune, où chacun grandissait spirituellement et développait sa propre "personnalité" : "... je veux dire une liberté digne de ce nom, une liberté offrant une pleine possibilité de développer toutes les capacités, intellectuelles et morales, cachées en chaque homme...", décrira plus tard Bakounine.
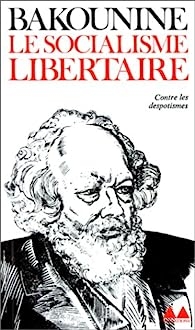 Mikhaïl Alexandrovitch n'était pas le seul représentant de la "nouvelle pensée révolutionnaire". Sa cousine, Catherine, n'était pas en reste. Selon ses souvenirs, dans sa jeunesse, la jeune fille était plutôt une "jeune fille innocente", mais à l'âge adulte, elle est devenue résolue et forte, une véritable manifestation de l'homme libre, comme Bakounine lui-même l'entendait. À force de persévérance, Catherine réussit à se faire engager comme sœur de miséricorde dans la ville assiégée de Sébastopol pendant la guerre de Crimée. "Je devais résister par tous les moyens et avec toute mon habileté au mal que divers fonctionnaires, fournisseurs, etc. infligeaient à nos malades dans les hôpitaux ; et je considérais que c'était mon devoir sacré de lutter et de résister", a déclaré plus tard Catherine pour décrire son véritable objectif. Son esprit rebelle de résistance à la bureaucratie, sa fermeté et sa persévérance ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Nikolaï Pirogov : "Chaque jour et chaque nuit, on pouvait la trouver dans la salle d'opération, assistant aux opérations, alors que des bombes et des missiles traînaient autour d'elle. Elle faisait preuve d'une présence d'esprit difficilement compatible avec la nature d'une femme". Qu'est-ce que cela signifie ? Que Bakounine lui-même, mais aussi tous les membres de sa famille, n'étaient pas seulement de fortes personnalités, mais aussi des personnes qui n'avaient pas peur de s'affirmer, des personnes qui aimaient la liberté et la vérité. L'éducation et l'environnement ont beaucoup influencé le futur anarchiste et révolutionnaire.
Mikhaïl Alexandrovitch n'était pas le seul représentant de la "nouvelle pensée révolutionnaire". Sa cousine, Catherine, n'était pas en reste. Selon ses souvenirs, dans sa jeunesse, la jeune fille était plutôt une "jeune fille innocente", mais à l'âge adulte, elle est devenue résolue et forte, une véritable manifestation de l'homme libre, comme Bakounine lui-même l'entendait. À force de persévérance, Catherine réussit à se faire engager comme sœur de miséricorde dans la ville assiégée de Sébastopol pendant la guerre de Crimée. "Je devais résister par tous les moyens et avec toute mon habileté au mal que divers fonctionnaires, fournisseurs, etc. infligeaient à nos malades dans les hôpitaux ; et je considérais que c'était mon devoir sacré de lutter et de résister", a déclaré plus tard Catherine pour décrire son véritable objectif. Son esprit rebelle de résistance à la bureaucratie, sa fermeté et sa persévérance ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Nikolaï Pirogov : "Chaque jour et chaque nuit, on pouvait la trouver dans la salle d'opération, assistant aux opérations, alors que des bombes et des missiles traînaient autour d'elle. Elle faisait preuve d'une présence d'esprit difficilement compatible avec la nature d'une femme". Qu'est-ce que cela signifie ? Que Bakounine lui-même, mais aussi tous les membres de sa famille, n'étaient pas seulement de fortes personnalités, mais aussi des personnes qui n'avaient pas peur de s'affirmer, des personnes qui aimaient la liberté et la vérité. L'éducation et l'environnement ont beaucoup influencé le futur anarchiste et révolutionnaire.
Les idées de Mikhaïl Bakounine ont également été fortement influencées par l'esprit révolutionnaire de la Russie dans laquelle il est né et a grandi. Le petit Misha a connu le soulèvement de décembre 1925 à l'âge de onze ans. La société a alors l'espoir d'un changement sérieux de l'État, une grande partie de l'aristocratie russe y voit le véritable salut du pays. Divers cercles se forment, auxquels adhèrent de nombreuses personnalités des arts et des sciences et des membres influents de la noblesse russe. En 1835, après avoir été renvoyé d'une école d'officiers et avoir effectué un service militaire insipide, Bakounine s'est retrouvé dans l'un de ces cercles. C'est le manque de liberté de pensée et d'action, ainsi que la discipline rigide et les règles strictes pendant le service militaire qui, selon certains chercheurs, l'ont amené à penser que l'anarchisme était l'avenir de la Russie et, plus tard, de toute l'Europe.
Installé à Moscou, le jeune penseur se fait de nombreuses connaissances : Stankevitch, Pouchkine, Tchaadaïev, Belinsky, Botkine, Katkov, Granovsky, Herzen, Ogarev, pour ne citer que quelques-uns des membres du cercle social de Bakounine. C'est sous l'influence de Stankevitch que Mikhail Aleksandrovitch approfondit l'étude de la philosophie allemande : il commence à s'intéresser aux idées de Kant et de Fichte. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le futur anarchiste est à cette époque convaincu que l'amour de Dieu donne à l'homme la liberté, l'épanouissement personnel et l'indépendance.
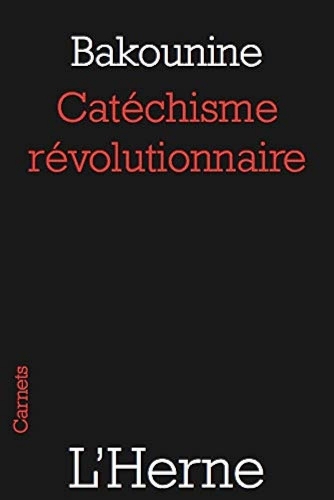
À la fin des années 1830, Bakounine est fasciné par les écrits de Hegel qui, selon lui, lui insuffle "une vie complètement nouvelle". Sur la base des doctrines du philosophe allemand, Michael publie un certain nombre de ses travaux sur l'esprit, la connaissance absolue, la réalité et la volonté de Dieu, etc. Inspiré par les enseignements de Hegel, Bakounine s'installe à Berlin en 1840 pour y recevoir une bonne éducation à l'allemande, mais il se désintéresse rapidement de la philosophie théorique et devient un véritable praticien de l'anarchisme, rejoignant les cercles des réformateurs européens, déplaçant "vers la gauche" ses opinions politiques.
Dès 1942, il publie un article intitulé "De la réaction en Allemagne", qui commence à refléter explicitement les idées de l'anarchisme auxquelles il restera fidèle pendant très longtemps: l'égalité sociale et les principes de liberté ne peuvent être atteints que par la destruction complète du modèle d'État politique existant. L'année suivante, Bakounine s'imprègne des idées communistes et publie un article dans lequel il affirme que "le communisme n'est pas une ombre sans vie. Il est né du peuple, et du peuple, une ombre ne peut jamais naître". Les idées plutôt radicales et critiques du "réformateur" ne sont pas du goût des autorités russes et Mikhaïl Bakounine devient littéralement un ennemi public dans son pays, si bien qu'un retour en Russie ne semble plus possible.
Au milieu des années 1840, l'anarchiste rencontre des théoriciens communistes, dont Marx. Ils deviendront bientôt des ennemis jurés pour toujours, mais nous y reviendrons plus tard.
Le rebelle en liberté : le rôle de Mikhaïl Bakounine dans les révolutions européennes de 1848-1849
Mikhaïl Aleksandrovitch a également joué un rôle majeur dans les soulèvements de libération en Pologne. C'est là qu'ont émergé ses idées de panslavisme - l'unification de tous les peuples slaves en une seule fédération. Selon Bakounine, pour construire un monde nouveau et libre, pour une pleine justice politique et sociale, il est nécessaire de couper les systèmes existants avec les racines, de tout détruire jusqu'au sol. Il pensait que grâce aux efforts conjoints des Slaves de l'Ouest et du Sud, il était possible de réaliser un changement en Russie: se libérer du "joug allemand" en renversant les dirigeants qui étaient les principaux ennemis du peuple slave.
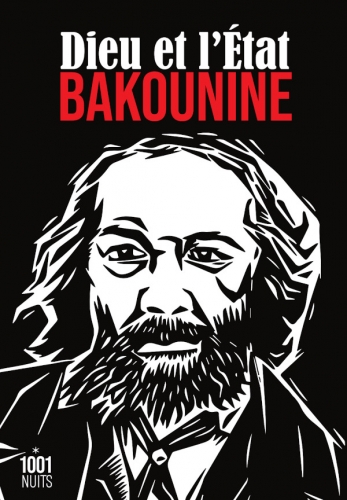
L'esprit de rébellion du maître russe des destinées de l'État a trouvé une application, non seulement dans les mots, mais aussi dans les actes. Bakounine attendait avec impatience la vague révolutionnaire en Europe, et il l'a finalement connue. En 1848, il participe activement à ce que l'on appelle le "printemps des nations", qui touche la France, l'Allemagne, la Pologne et d'autres pays. Le radicalisme de Mikhaïl Alexandrovitch a eu l'occasion de se manifester à Dresde. Le destin a voulu que ce noble russe, qui avait l'expérience du service militaire, se retrouve dans une ville saisie par un gouvernement provisoire. La légende veut qu'on lui ait demandé d'aider à organiser la défense et à stimuler l'esprit révolutionnaire des citoyens. Lorsque les troupes royales ont commencé à avancer, Bakounine a proposé des mesures de protection radicales: tout d'abord, accrocher de grandes œuvres d'art, dont la Madone Sixtine, sur les murs de la ville afin que les militaires, élevés dans l'amour et le respect de l'art et de l'histoire, n'osent pas tirer. Et s'ils avaient osé, ils auraient été traités de barbares et de vandales. Un peu plus tard, Mikhaïl Bakounine fait d'autres propositions: brûler les maisons des aristocrates locaux, faire sauter l'hôtel de ville et couper les arbres anciens qui gêneraient les troupes royales. Le gouvernement provisoire, cependant, décide de ne pas recourir aux idées du révolutionnaire russe et se rend sans combattre.
De quoi témoigne cette affaire, décrite plus tard dans les écrits de Herzen ? Tout d'abord, Bakounine pensait que le peuple russe était prêt pour la révolution, car il était pauvre et possédait déjà "les habitudes et les instincts d'une société démocratique", mais que les Européens devaient d'abord se débarrasser des "échos matériels du passé", dont les symboles sont les œuvres de Raphaël, le vieil hôtel de ville et les arbres centenaires. Et cela doit se faire rapidement, pas lentement.
Après cette tentative de renversement du gouvernement à Dresde, Bakounine est envoyé en exil, revient dans son pays et, après 8 ans d'emprisonnement, est envoyé en Sibérie, où il se marie puis s'enfuit en Europe via le Japon en 1861. L'année 1861 marque un nouveau chapitre dans ses activités philosophiques et pratiques. Au cours des 20 années suivantes, le bakounisme va littéralement envahir toutes les rues, même les plus reculées, des villes européennes, et Mikhaïl lui-même va devenir un symbole du mouvement socialiste.
Idées fondamentales de l'anarchisme, du fédéralisme et de l'État sans État
C'est au cours de cette période que se forge définitivement sa vision athée et matérialiste. Pour Bakounine, l'idéalisme conduit inévitablement "à l'organisation d'un despotisme grossier et à une exploitation mesquine et injuste sous la forme de l'Église et de l'État". Il semble que les opinions d'un homme sur de simples questions philosophiques changent parfois radicalement: jeune et encore immature, Bakounine restait fidèle à Dieu, voyant en lui la véritable liberté de l'homme. Mais au bout d'un certain temps, sous l'influence des idées communistes d'égalité et de fraternité, il a renoncé à la religion, montrant que la foi était l'une des manifestations d'une société déjà rassise, dépassée, opprimée, qui ne se tournait vers Dieu que pour supporter les conditions insupportables de la vie. En même temps, le philosophe pensait que la religion est une partie historique inhérente à toute nation et qu'elle doit être traitée avec soin pour ne pas lui nuire. "Avec l'aide de la religion, l'homme est un animal qui, sortant de l'animalité, fait le premier pas vers l'humanité", écrivait-il.
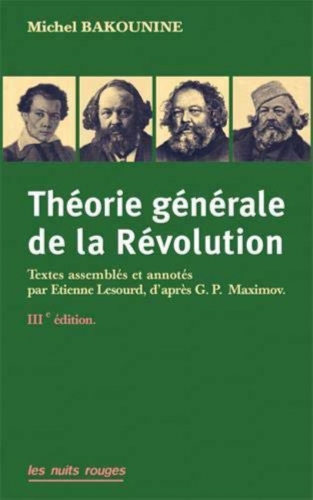
Il est également intéressant de noter qu'un farouche opposant aux lois et au contrôle de l'État n'a pas nié l'existence possible d'un gouvernement provincial (un parlement composé de deux chambres : des représentants de l'ensemble de la population et des communautés), d'une constitution et d'un tribunal. Les communautés réunies en fédérations devaient "coordonner leur propre organisation avec les principaux fondements de l'organisation provinciale et obtenir pour cela l'autorisation du parlement provincial". En même temps, "la loi communale conservait le droit de s'écarter sur des points mineurs de la loi provinciale, mais pas de ses fondements". Dans la construction de l'État, Bakounine a mis en avant le principe de la "pyramide inversée", où les principaux "pouvoirs décisifs sont concentrés localement". Dans le même temps, il ne nie pas l'existence possible d'une structure de pouvoir verticale et note que toutes les actions des communautés doivent servir les intérêts de l'État lui-même.
Les idées de Mikhaïl Alexandrovitch prévoyaient la création d'un gouvernement national qui rédigerait une constitution, tout comme les provinces, à condition que ces dernières puissent s'en écarter sur des points mineurs. Les pouvoirs du Parlement national auraient inclus le contrôle des activités de l'exécutif élu, la rédaction et l'adoption des lois, l'établissement de relations internationales avec d'autres pays, etc. Sur le même principe, une fédération internationale de pays a été envisagée.
Lutte pour l'Internationale : comment d'anciens amis et compagnons d'armes, Marx et Bakounine, sont devenus des ennemis jurés
L'histoire des relations difficiles entre Bakounine et Marx commence en 1864. Mikhaïl Alexandrovitch se rend en Italie pour diffuser les idées de l'Internationale, où il va à l'encontre de la philosophie du prolétariat et tente de créer sa propre "Société révolutionnaire internationale" secrète, où tous seraient frères. Elle repose sur l'idée de détruire tous les États européens, à l'exception de la Suisse, afin d'éliminer le modèle de pouvoir centralisé. Le plan consistait à créer des communautés qui s'uniraient en fédérations à différents niveaux. Parallèlement, l'anarchiste considérait nécessaire le pouvoir du peuple sous la forme d'une communauté autonome de tous les citoyens adultes, en élisant des représentants des différents fonctionnaires, mais avec la condition obligatoire de leur remplacement permanent, ce qui, selon Bakounine, ne donnerait pas un statut privilégié et garantirait les libertés démocratiques. Tous les aristocrates sont exclus, tous les partisans d'un quelconque privilège,...". Car le mot démocratie ne signifie rien d'autre que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire la masse entière des citoyens - et à l'heure actuelle, nous devons ajouter les citoyens qui composent la nation", écrit Mikhaïl Aleksandrovitch.
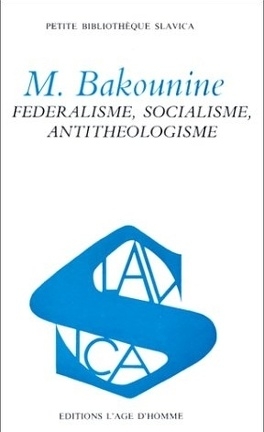 En 1868, Bakounine prépare un projet de "Fraternité internationale", dans lequel il formule les principes de base de l'anarchisme, qui impliquent "la destruction complète de tout État, de toute église, de toute institution religieuse, politique, bureaucratique, judiciaire, financière, policière, économique, universitaire et fiscale".
En 1868, Bakounine prépare un projet de "Fraternité internationale", dans lequel il formule les principes de base de l'anarchisme, qui impliquent "la destruction complète de tout État, de toute église, de toute institution religieuse, politique, bureaucratique, judiciaire, financière, policière, économique, universitaire et fiscale".
La transition vers le nouveau système devait être le résultat d'une révolution. Ses principaux moteurs, selon Bakounine, sont la paysannerie et la classe ouvrière, qui vouent une haine instinctive aux couches privilégiées de la société. Et leurs principaux outils sont la rébellion et la lutte pour la liberté. Élevé dans la pauvreté et l'esclavage, le peuple russe a une aversion pour l'État, car son principal désir est la terre libre, le travail commun et l'absence de bureaucratie et de propriété foncière. En même temps, seule une jeune intelligentsia révolutionnaire peut rassembler la paysannerie et la classe ouvrière et canaliser leur puissance dans une cause commune.
Il en résultera une société sans aucune autorité, où les gens se soumettront à l'autorité de l'opinion publique, et où les paysans et les ouvriers deviendront les seules classes existant en harmonie - "les uns sont propriétaires du capital et des instruments de production, les autres - de la terre, qu'ils cultivent de leurs mains ; les uns et les autres s'organisent, motivés par leurs besoins et leurs intérêts mutuels, également et en même temps absolument libres, nécessaires et naturels, se contrebalançant réciproquement".
La polémique de Bakounine avec Marx consistait principalement en des perspectives différentes. Tout d'abord, Mikhaïl Bakounine a déclaré que la dictature du prolétariat aboutirait au même résultat que celui auquel les révolutionnaires s'opposaient. En d'autres termes, le gouvernement et le régime politique changeraient, mais leur essence resterait la même, sauf que le pouvoir serait désormais concentré entre les mains du prolétariat. L'État est le vrai mal : "Là où commence l'État, finit la liberté individuelle, et vice versa... S'il y a État, il y a nécessairement domination, donc esclavage ; un État sans esclavage, ouvert ou déguisé, est impensable - c'est pourquoi nous sommes ennemis de l'État.
L'affrontement entre Bakounine et Marx culmine dans la tentative du premier de tirer à lui la couverture d'influence de l'Internationale. En fin de compte, la bataille d'idées s'est transformée en une guerre personnelle entre deux personnalités puissantes de l'époque. Marx estimait que les activités des bakounistes sapaient les idées de la dictature du prolétariat et, en 1972, les partisans de Mikhaïl Alexandrovitch ont été expulsés de l'Internationale.
Les adeptes contemporains du bakounisme
De nos jours, les idées du grand rebelle appartiennent au passé, bien que les adeptes de l'anarchisme russe existent toujours. Aujourd'hui, cependant, il ne s'agit pas seulement d'une alliance contre l'État, mais aussi d'une lutte idéologique contre certains problèmes mondiaux de l'humanité, tels que l'écologie et la protection de l'environnement. Dans le même temps, on observe une certaine crise parmi les anarchistes : il y a de moins en moins d'adeptes en raison du manque d'unité et d'intégrité du mouvement.
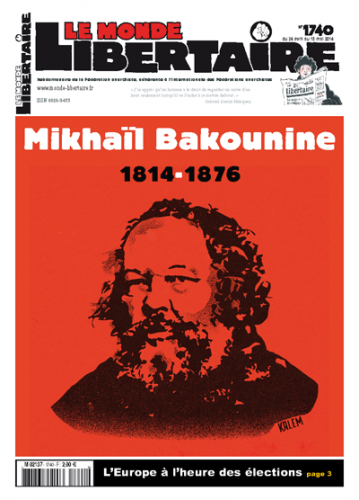
En Russie, l'Union anarchiste russe a joué un rôle important à cet égard, car elle a fondé ses idées sur l'anarchisme national et ethnique. En d'autres termes, il s'agit d'une association de personnes de la même nationalité vivant sur le même territoire. Cela inclut le panslavisme de Bakounine et l'idée d'anti-ethnicité de Kropotkine. Oui, les gens croient encore à l'accomplissement de la révolution, et les protestations et les révoltes en sont le principal outil. Mais au début du XXIe siècle, le mouvement des adeptes de Bakounine, de Kropotkine et d'autres philosophes et figures révolutionnaires s'est transformé en une sorte de sous-culture et, dans l'esprit de la plupart des Russes, il est désormais associé à l'impuissance et à l'anarchie. Comme au 19ème siècle, les adeptes de l'anarchisme se positionnent comme un mouvement en dehors de toute force politique, mais en même temps, ils ne sont pas encore devenus une force motrice sérieuse capable d'influencer l'esprit des jeunes et de la société dans son ensemble.
Les idées de Mikhaïl Bakounine sont-elles pertinentes aujourd'hui ? Probablement pas. Dans le contexte actuel de lutte politique permanente, il est nécessaire de disposer d'une autorité centralisée claire, capable de maintenir l'unité du peuple. Même si l'on peut dire que des tentatives de liberté totale ont eu lieu dans les années 1990, il s'agissait d'un défi sérieux à la pérennité de l'État.
Malheureusement, les idées utopiques sur l'existence de fédérations composées de communautés de personnes sont impossibles. On peut être d'accord ou non, mais nous vivons une période de "guerre froide", où chaque pays se bat pour ses propres ressources et intérêts plus que pour des vies humaines. Pour survivre, il faut non seulement s'unir, mais aussi éviter que l'État ne soit détruit par l'absorption de ses petites "communautés", comme lors du schisme féodal. L'appartenance à une nation ne fera qu'engendrer davantage de disputes et de conflits. Certes, la liberté fait partie intégrante de la société démocratique à laquelle chacun aspire aujourd'hui. Mais en même temps, l'émergence d'une plus grande liberté dans certains domaines s'accompagne aussi de l'émergence de plus grands interdits dans d'autres. L'existence de l'anarchisme dans le contexte moderne est donc fortement remise en question. Et qu'elle reste ouverte...
12:46 Publié dans Histoire, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, mikhail bakounine, bakounine, 19ème siècle, anarchisme, révolution, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 mai 2023
Engels en tant que théoricien militaire
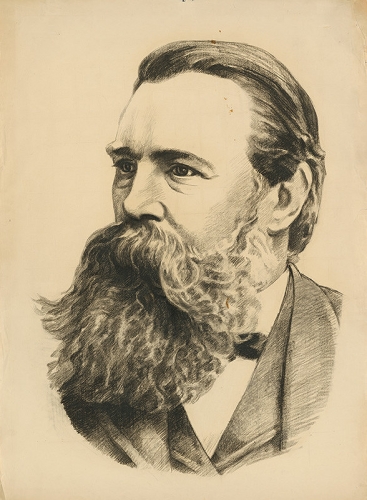
Engels en tant que théoricien militaire
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2023/04/30/engels-som-militarteoretiker/
À l'époque du socialisme réel, on parlait souvent de "Marx et Engels", mais aujourd'hui, ce dernier semble avoir été relégué à l'arrière-plan. Ce n'est pas tout à fait surprenant, car Marx avait souvent une profondeur d'analyse qui manquait à Engels, et c'est aussi quelque chose qu'Engels lui-même soulignait souvent. En même temps, le "marxisme" moderne est fortement marqué par Engels, qui était lui aussi un penseur de premier plan. Par ailleurs, bien que Marx et Engels aient tous deux été, selon la terminologie moderne, homophobes et racistes, il y avait chez Engels un nationalisme allemand qui a été repris par la social-démocratie allemande.
Un aspect intéressant d'Engels réside dans ses écrits sur la théorie militaire, un aspect qui a été transmis dans de nombreuses parties de la tradition politique qu'il a contribué à façonner. Engels a acquis une expérience dans ce domaine lors d'une rébellion ratée en 1849, au cours de laquelle il s'est forgé une réputation de chef militaire courageux et compétent. Il a étudié et écrit sur de nombreux conflits et soulèvements au cours de sa vie, depuis les soulèvements de 1848-1849 et les guerres coloniales jusqu'à la guerre de Crimée et la guerre de Sécession. En matière de théorie de la guerre, c'est Engels, et non Marx, qui a été le maître reconnu, ce qui est intéressant compte tenu des succès militaires des guérillas marxistes-léninistes au 20ème siècle. Engels était "le premier Clausewitz rouge" (il est cité 6 fois dans La théorie du partisan de Carl Schmitt, 47 fois dans Lénine et 40 fois dans Mao).
Le major Michael A Boden développe ce sujet dans son livre The First Red Clausewitz : Friedrich Engels And Early Socialist Military Theory (Le premier Clausewitz rouge : Friedrich Engels et la théorie militaire socialiste primitive). Il aborde, entre autres, le fait que l'accent a souvent été mis sur Engels en tant que théoricien stratégique et que ses connaissances au niveau tactique et opérationnel ont souvent été négligées. La guerre moderne, la science de la guerre, la nation et la guérilla sont quelques-uns des thèmes intéressants abordés dans l'ouvrage de Boden.
Engels s'intéressait sans surprise à la relation entre la société et la guerre, à la manière dont les changements dans les forces et les conditions de production conduisaient à des changements militaires. En ce qui concerne la guerre moderne, il a pu écrire que "la guerre moderne est le produit nécessaire de la Révolution française. Sa condition préalable est l'émancipation sociale et politique de la bourgeoisie et des petits paysans". Il constate que le soldat citoyen est un phénomène nouveau, qui a aussi des répercussions sur les rapports de force entre les classes. Pendant un temps, Engels a espéré qu'une grande guerre européenne pourrait déboucher sur une lutte des classes. En même temps, il était conscient que les guerres modernes avaient tendance à être plus inhumaines, compte tenu des éléments de haine de classe et de haine nationale. Il a également décrit la guerre comme une "force sociale ayant une dynamique propre".


Garibaldi. Chemises rouges formant les unités de combat garibaldistes.
Engels considérait la science de la guerre comme un phénomène nouveau, essayant activement et scientifiquement de développer une perspective et un ensemble de concepts pour ce phénomène. Ici aussi, il y avait un lien avec les relations de production ; il écrivait que "la nouvelle science de la guerre doit être tout autant un produit nécessaire des nouvelles relations sociales que la science de la guerre créée par la révolution et Napoléon était le résultat nécessaire des nouvelles relations engendrées par la révolution". Pour Engels, le caractère massif des armées est important, tout comme la mobilité et la rapidité. Garibaldi en est un exemple ; Engels écrit que "dans la guerre, et en particulier dans la guerre révolutionnaire, la rapidité d'action jusqu'à ce qu'un avantage décisif soit acquis est la première règle".
L'intérêt d'Engels pour les nations et le nationalisme est lié à l'approche scientifique de la guerre. Dans Les armées de l'Europe, il a compilé et analysé les conditions et les ressources des différentes armées. Il s'est penché sur des facteurs tels que les effectifs, la discipline, l'équipement et l'entraînement. Mais il a également abordé les caractéristiques nationales et raciales d'une manière qui serait totalement taboue aujourd'hui. Les Français sont décrits comme "une nation guerrière et pleine d'entrain, qui éprouve de la fierté pour ses défenseurs". L'armée autrichienne était, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, caractérisée par la diversité ; Engels écrivait que "c'est là que réside le point faible de cette armée". Il trouve la même faiblesse dans l'armée danoise, avec les éléments allemands de la région du Schleswig-Holstein, et dans l'armée turque. Il décrit les Allemands comme le peuple guerrier par excellence en Europe, "la constance délibérée des Allemands les rend particulièrement aptes au service de l'artillerie. Par ailleurs, ils comptent parmi les peuples les plus pugnaces du monde, appréciant la guerre pour elle-même et allant souvent la chercher à l'étranger lorsqu'ils ne peuvent pas l'avoir chez eux. Depuis les Landsknechte du moyen âge jusqu'aux légions étrangères actuelles de la France et de l'Angleterre, les Allemands ont toujours fourni la grande masse de ces mercenaires qui se battent pour le plaisir de se battre. Si les Français les dépassent en agilité et en vivacité d'attaque, si les Anglais sont leurs supérieurs en dureté et en capacité de résistance, les Allemands dépassent certainement toutes les autres nations européennes dans cette aptitude générale au devoir militaire qui fait d'eux de bons soldats en toutes circonstances". Il décrit les soldats russes comme étant à la fois courageux et maladroits, les Turcs comme étant paresseux, fatalistes et tellement racistes qu'ils refusent d'adopter les méthodes européennes. L'attitude d'Engels à l'égard des peuples slaves, à l'exception des Polonais, est probablement bien connue.
Il considérait le nationalisme comme une forte source de motivation, ainsi que comme un problème important pour les États multiculturels. Engels a écrit sur plusieurs soulèvements nationaux et guerres de libération, en lien avec son intérêt pour la guérilla. Boden écrit qu'Engels a été l'un des premiers à analyser ce phénomène. Il écrit dans La défaite des Piémontais que "le soulèvement de masse, la guerre révolutionnaire, les détachements de guérilla partout - c'est le seul moyen par lequel une petite nation peut vaincre une grande, par lequel une armée moins forte peut être mise en position de résister à une armée plus forte et mieux organisée. Les Espagnols l'ont prouvé en 1807-1802, les Hongrois le prouvent aujourd'hui également". Dès 1852, il écrit sur les défis du chef de partisan, soulignant à nouveau l'importance du mouvement et de l'initiative ("la défensive est la mort de tout soulèvement armé"). Parallèlement, il s'intéresse à la relation entre les classes et la guerre. Pendant la guerre de Sécession, il écrit que les Sudistes pauvres auraient pu s'engager dans une guérilla, mais qu'ils auraient alors eu les anciens propriétaires d'esclaves contre eux, "il ne fait guère de doute, il est vrai, que les éléments du white trash, comme les planteurs eux-mêmes appellent les "pauvres blancs", tenteront la guérilla et le brigandage. Une telle tentative, cependant, transformera très rapidement les planteurs possédants en unionistes. Ils appelleront eux-mêmes les troupes des Yankees à leur secours".
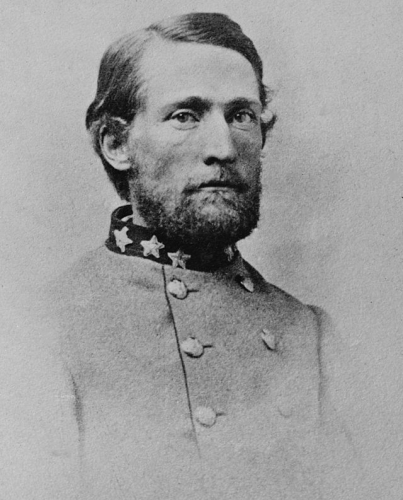
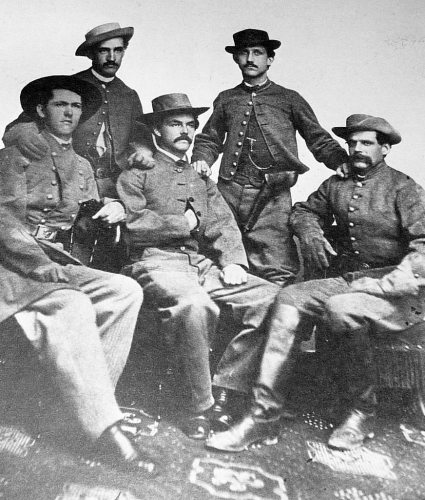
John S. Mosby, chef des pauvres sudistes qui auraient voulu entamer une guerre de guerilla.
Dans l'ensemble, Boden offre un aperçu lisible d'Engels en tant que théoricien militaire doué, avec des références à plusieurs articles théoriquement féconds, tous disponibles sur l'internet. Le théoricien de la guerre qu'est Engels n'apparaît pas non plus ici comme un déterministe ; la relation entre les conditions de production et la guerre est complexe, et de mauvais dirigeants peuvent détruire des conditions objectivement bonnes, du moins à court terme. Pour rappeler les contrastes entre "Marx et Engels" d'une part et la "gauche" d'aujourd'hui d'autre part, il est également utile de lire le théoricien militaire Engels. En ce qui concerne les caractéristiques nationales et raciales en tant que facteurs matériels, par exemple, il était plus proche de la droite alternative d'aujourd'hui que de la "gauche" contemporaine. Son analyse des relations sociales dans le Sud est également difficile à concilier avec la "critique blanche" (du "White nationalism") d'aujourd'hui. Mais il s'agit là d'une curiosité ; l'avantage durable réside dans la méthode d'Engels, qui intègre des facteurs tels que la nation, la classe, la motivation, la mobilité, le leadership et la technologie. L'importance relative de ces facteurs a peut-être quelque peu changé depuis le 19ème siècle, mais la valeur de l'approche demeure.
18:48 Publié dans Militaria, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich engels, théorie militaire, théorie politique, 19ème siècle, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 30 avril 2023
Edouard Drumont, Mgr Delassus et la montée du grand impérialisme américain

Edouard Drumont, Mgr Delassus et la montée du grand impérialisme américain
Nicolas Bonnal
On a déjà étudié Mgr Delassus et sa conjuration antichrétienne - et son étude sur l’américanisme qui montre que l’Amérique est sans doute une matrice et une république (une république ou un royaume comme celui d’Oz ?) antéchristique qui repose sur quatre piliers : le militarisme messianique d’essence biblique ; le matérialisme effroyable ; la subversion morale totale qui défie et renverse aujourd’hui toutes les civilisations (LGBTQ, BLM, Cancel culture, Green Deal, etc.). Quatrième pilier enfin : pire qu’Hiroshima, l’arme absolue semble être cette bombe informatique dont l’admirable et déjà oublié Paul Virilio (dernier penseur français d’importance) a parlé. L’éditeur de Virilio Galilée a d’ailleurs repris un de mes textes sur cet esprit fondamental.
Dans le tome deuxième de sa Conjuration Mgr Delassus cite Drumont (Drumont c’est comme Céline : on oublie ses propos sur les juifs et on se concentre sur le reste) sur la naissance de l’impérialisme gnostique des USA qui volent impunément – en arguant d’un attentat attribué à Ben Laden, pardon au gouvernement espagnol d’alors - Cuba et les Philippines pour faire de l’une un bordel (puis un paradis de sanctions communistes…) et de l’autre une colonie pénitentiaire (300.000 morts tout de même, voyez mon texte sur fr.sputniknews.com basé sur des historiens libertariens) puis capitaliste ad vitam (voyez le sort des ouvrières philippines dans film le Bourne Legacy avec Jeremy Renner par exemple).


Delassus donc :
« M. Edouard Drumont faisait tout récemment ces observations : « Ce dont il faut bien se pénétrer, c'est que les Etats- Unis d'aujourd'hui ne ressemblent plus du tout aux Etats-Unis d'il y a seulement vingt ans.
« II y a eu, surtout depuis la guerre avec l'Espagne, une transformation radicale des mœurs, des idées et des sentiments de ce pays. Les Etats-Unis étaient naguère une grande démocratie laborieuse et pacifique ; ils sont devenus peu à peu une démocratie militaire, orgueilleuse de sa force, avide d'agrandissements et de conquêtes; il n'y a peut-être pas dans le monde entier d'impérialisme plus ambitieux, plus résolu et plus tenace que l'impérialisme américain. Chez ce peuple, qui eût haussé les épaules autrefois si on lui eût parlé de la possibilité d'une guerre avec une puissance quelconque, il n'est question actuellement que de dissentiments, de conflits et d'aventures. »
On verra ou reverra à ce propos l’admirable Le Lion et le Vent de John Milius, avec Sean Connery, qui illustrait bien cette fièvre définitive d’impérialisme qui prendra fin (prochaine) avec le monde.
Drumont ajoute (je ne sais d’où sort ce texte –sans doute est-ce un article de son journal) :
« Remarquez également combien l'action diplomatique des Etats-Unis est différente de ce qu'elle était jadis. Au lieu de se borner à maintenir l'intangibilité de la doctrine de Monroe, la grande République a la prétention maintenant de jouer partout son rôle de puissance mondiale. Elle ne veut pas que nous intervenions dans les affaires américaines, mais elle intervient à chaque instant et à tout propos dans nos affaires d'Europe. On n'a pas oublié le mauvais goût et le sans-gêne avec lesquels Roosevelt, il y a deux ou trois ans, voulut s'immiscer dans les affaires intérieures de la Roumanie, à propos des Juifs. Il est vrai que les Etats-Unis sont en voie de devenir une puissance juive, puisque dans une seule ville, comme New- York, il y a près d'un million d'Hébreux I Ajoutez à cela la fermentation continue de toutes ces races juxtaposées, mais non fusionnées, qui bouillonnent perpétuellement sur ce vaste territoire, comme en une immense cuve : la question chinoise, la question japonaise, la question nègre, presque aussi aiguë aujourd'hui qu'elle l'était à la veille de la guerre de sécession. Tout cela fait ressembler la République américaine à un volcan gigantesque qui lance déjà des jets de fumée et des bouffées de lave, en attendant l'éruption qui ne peut manquer d'éclater tôt ou tard... »
Comme la république impérialiste des Romains qui unifia et détruisit les cultures antiques (Oswald Spengler en parle bien), l’empire détruit et unifie tout ; Delassus ajoute :
« C'est en Amérique surtout qu'a pris corps le projet de l’établissement d'une religion humanitaire, devant se substituer aux religions existantes. Depuis longtemps on y travaille à abaisser les barrières dogmatiques et à unifier les confessions de façon à favoriser les voies à l'humanitarisme. »
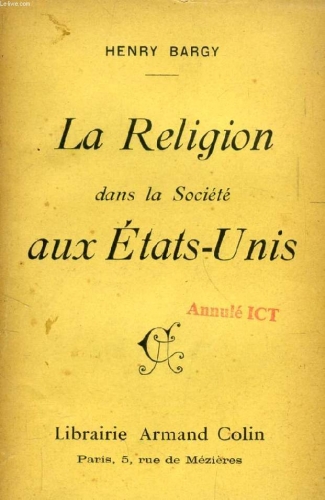
La liquidation du catholicisme romain par l’agent Bergoglio est une belle illustration. Et à propos de cette fusion des intérêts juifs et américains Delassus (qui cite beaucoup, et comme il a raison) cite l’historien Henry Bargy :
Il croit pouvoir poser ces deux assertions : « La République des Etats-Unis est, dans la pensée des Juifs d'Amérique, la Jérusalem future ». « L'Américain croit sa nation venue de Dieu ». Et il ajoute : Dans cette confiance patriotique des Américains, les Juifs ont reconnu la leur. Leur orgueil national est venu s'appuyer- sur celui de leurs nouveaux compatriotes. Les uns comme les autres attendent de leur race le salut de la terre (1). »
Avec des messies comme ça qui tiennent l’informatique, la presse et les billets de banque, nous sommes mal partis. Delassus annonce même le Grand Reset, simple application des idéaux socialistes et maçonniques. Mais découvrez son œuvre admirable.
PS : je découvre en terminant ce texte que Google devient inutilisable.
Bargy, dans son livre : La Religion dans la société aux Etats-Unis, dit : « La République des Etats-Unis est, dans la pensée des Juifs d'Amérique, la Jérusalem future. »
SOURCES :
https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Delassus/Conjur...
https://ia800309.us.archive.org/34/items/lamricanismeet00...
http://www.editions-galilee.fr/images/3/p_9782718600796.pdf
https://fr.sputniknews.africa/20170107/Cuba-USA-Philippin...
https://www.dedefensa.org/article/lamericanisation-et-not...
11:32 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edouard drumont, henri delassus, états-unis, 19ème siècle, impérialisme américain, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 18 avril 2023
Monseigneur Delassus et la conjuration antichrétienne des USA
Monseigneur Delassus et la conjuration antichrétienne des USA
Nicolas Bonnal
Tout le monde commence à comprendre que la menace mondiale numéro un est la menace américaine.
On dit que lorsque les USA conclurent leur plus ancien traité de paix avec le… Maroc, ils lui assurèrent qu’ils n’étaient pas chrétiens. Le Grand Architecte était passé par là. Une cinquantaine d’années plus tard, Baudelaire dénonce dans ses Propos sur Edgar Poe la menace américaine (voyez mes textes). Pour le plus grand poète du monde, elle est omniprésente cette menace américaine: avortement, lynchage, immoralité, violence (tueries de masse dans les théâtres !), rapacité (Greed…), optimisme dément, tout montre qu’on est déjà face à une puissance pathologique que l’exorbitante immigration européenne va rendre surpuissante dès le dernier tiers du dix-neuvième siècle: la population triple entre la Guerre de Sécession et 1914 - et même le progressiste Walt Whitman reconnaît vers 1870 (mon texte toujours) que ce pays n’est plus son Amérique. C’est déjà la ploutocratie impérialiste et raciste que dénoncera un siècle plus tard Etiemble, ce pays doté de la rage (Sartre lui-même) qui aujourd’hui, affaibli par la Chine et la Russie, est plus fou et boutefeu que jamais. Tous les grands esprits américains l’ont reconnu, Poe, Lovecraft, Twain, Fitzgerald et on sait qu’à la grande époque intellectuelle des USA l’élite littéraire (Henry James) ou spirituelle (T. S. Eliot) fuyait son pays comme le diable. Rappelons que le rejet des USA a toujours transcendé les différences politiques. Actuellement en France le débat est entre les pro-américains encore au pouvoir qui ruinent et fascisent le pays et les anti-américains. Il n’est pas ailleurs. Macron est juste un agent simple !
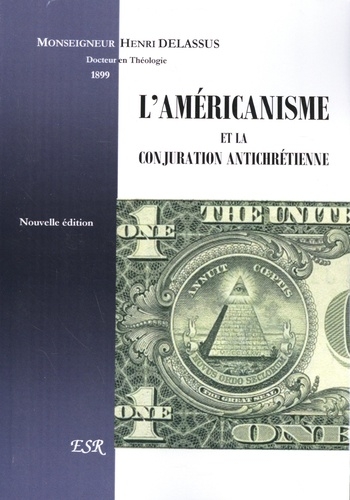
Je voulais juste ici rappeler Monseigneur Delassus, que Wikipédia insulte bien (quelle officine tout de même !), mais qui a publié un très bon livre sur l’américanisme à la fin du dix-neuvième siècle. Un peu comme Nietzsche ou Renan vers la même époque – voyez aussi mon Dostoïevski et la modernité occidentale, traduit désormais en roumain -, Delassus dénonce, en des termes virulents et chrétiens l’œuvre méphitique de ce pays-matrice destiné à tout envelopper et tout gober dans le monde. Aujourd’hui il semble qu’il se heurte enfin à une résistance culturelle, celles des anciens pays communistes et tiers-mondistes, seul l’Occident pur et dur européen acceptant de se laisser bouffer au sens littéral du terme par les sanctions ou le wokisme, le féminisme (qui effrayait Chesterton) ou le marxisme culturel (qui tétanisait Allan Bloom dans son extraordinaire Ame désarmée, que j’ai aussi recensée).
L’Amérique c’est le communisme foldingue avec les milliardaires aux manettes. Il me semble que le livre et le film (voyez mon livre sur la comédie musicale) les plus importants sont le Magicien d’Oz, opus qui évoque le totalitarisme qui émane de l’hypnose industrielle US (Baum était disciple de Blavatsky et théosophiste). Le Grand Reset c’est le moment ultime du totalitarisme américain reposant sur une faculté hypnotique sans égale (relire Duhamel). Il est à 100% américain. Qu’il s’agisse de Gates, de Fink ou de Morgan Stanley, nous sommes tous victimes de cette conspiration de milliardaires qui inspira Gustave Le Rouge et dont Jack London a très bien parlé.
Quelques extraits donc :
« Parmi tous les sujets d'inquiétude qu'offre à l'observateur l'état actuel du monde, le moindre n'est pas celui que nous présente l’Amérique du Nord. Elle venait à peine de naître, que déjà elle inspirait des défiances à J. de Maistre, le Voyant de ce siècle. Elle les justifie. »
Puis Delassus parle d’audace – certains diraient de chutzpah:
« Ce qui la caractérise, c'est l'audace. Elle a manifesté d'abord cette audace dans les entreprises industrielles et commerciales qui, dans leurs excès, détournent le regard de l'homme de ses fins dernières, et lui font envisager la jouissance et la richesse, qui en est le moyen, comme l'objet suprême de ses désirs et de son activité. Elle vient de la montrer dans les rapports internationaux, foulant aux pieds toutes les lois de la civilisation chrétienne pour s'emparer des possessions qu'elle convoitait. »
Puis on évoque ce messianisme américain (il y en eut un de français mais il n’était pas de taille) :
« On parle d'un catholicisme américain, et il fait son chemin.
Lisez : L'Américanisme a reçu de Dieu la mission de donner au monde entier cette leçon : Les temps sont venus de faire fi de l'héritage des aïeux : abolissez les frontières, jetez tous les peuples dans le creuset des droits de l'homme pour les fondre dans l’unité humanitaire, comme nous nous sommes fondus, nous, émigrés de tous les pays, dans l'unité américaine. Et la paix régnera dans le monde. Oui, la paix de l’esclavage sous la tyrannie d'un homme ou d'une race. »
Mais Delassus est isolé et le sait – et il note que les catholiques sont déjà d’accord (Baudelaire l’avait remarqué aussi !) :
« Comme toutes les autres idées des Américanistes, celle de l'abolition des frontières semble sourire à nos démocrates chrétiens. »
Le projet américain –mondialiste est unitaire et totalitaire ; il s’agit de tout contrôler avec la technologie (déjà…) ; Chesterton en parle dans Un nommé Jeudi (voyez mon livre sur les grands écrivains et la conspiration). Dans son admirable Conjuration antichrétienne Delassus ajoute :
« A la fin du XVIIIe siècle, ce projet de gouverner le genre humain tout entier, par une Convention unique, placée au centre du monde et composée des députés des Conventions établies dans les anciens royaumes réduits à l'état de départements, pouvait paraître fou. Mais aujourd'hui, à l'entrée du XXe siècle, où nous voyons le globe entier sillonné par les fils télégraphiques, les chemins de fer, et les steamers, le messie attendu par les Juifs pourrait facilement tenir le monde entier dans sa main, et le gouverner par une Convention centrale en rapport 'avec des Conventions locales. »
Il est difficile de nier un messianisme juif : voyez Isaïe, 60, et voyez ce qui arriva à de Gaulle. On n’est pas pour polémiquer.

Un des instruments du messianisme mondialiste fut Napoléon :
« On peut voir dans Deschamps, t. II, p. 150 et suiv., l'aide que la Convention, puis Napoléon, reçurent de la franc-maçonnerie en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Italie, pour essayer de former les Etats-Unis d'Europe, acheminement vers l'Etat-Humanité… »
Joseph de Maistre décrit comme Chateaubriand (voyez mon texte, qui est très lu depuis des années) un processus d’unification dans la deuxième soirée de Saint-Pétersbourg (ce n’est pas un hasard si elles sont de Saint-Pétersbourg ces soirées); et Delassus écrit à ce propos (l’unification du monde dans les années 1880 donc) :
« L'unification de l'Italie, l'unification de l'Allemagne, les ambitions des Etats-Unis, appelés peut-être à recueillir de l'Angleterre l'empire des mers, le mouvement qui agite l'Extrême-Orient font progresser de jour en jour, sur tous les points du globe, la marche vers l'unité politique. Avant cent ans, cinquante peut-être, deux ou trois empires, grossis par la « consumation » des nationalités de second ordre, pourront se heurter dans un conflit suprême pour laisser le vainqueur libre et maître de disposer à son gré des destinées du monde. »
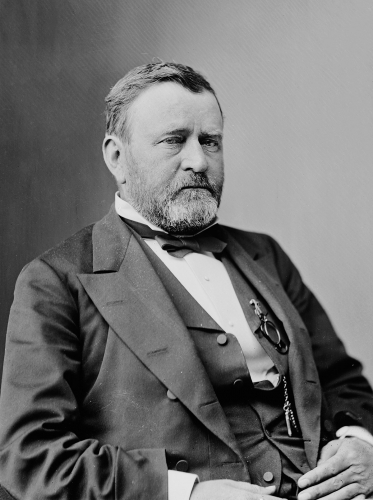
Je rappellerai mon texte sur l’appel mondialiste du président Grant en 1877. Grant attend même une fin des langues dans le monde: un sabir techno-English pour tout le monde. Il a une vision universaliste et messianique du futur de son pays, qui est aux antipodes de celle mettons de Poe ou de Jefferson – pour ne pas parler de Fenimore Cooper, farouche opposant au progrès.
La liquidation des patries est le but des Américains : il faut anéantir le monde, puisqu’il faut l’américaniser. Delassus :
« Renverser toutes les frontières, dit M. Claudia Janet dans la continuation de l'ouvrage du P. Deschamps, abolir toutes les nationalités, en commençant par les petites, pour ne faire qu'un seul Etat : effacer toute idée de patrie; rendre commune à toute la terre entière, qui appartient à tous; briser, par la ruse, par la force, tous les traités; tout préparer pour une vaste démocratie dont les races divers»1*, abruties par tous les genres d'immoralités, ne seront que des départements administrés par les hauts gradés et par l'Antéchrist, suprême dictateur devenu le seul dieu tel est le but des sociétés secrètes. »
L’idée que les races sont abruties par l’immoralité est très juste ; regardez ce qui nous arrive en ce moment. Sur ce thème lisez mon étude sur Mgr Gaume, autre prélat exceptionnel de ce siècle extralucide.
Le péril messianique et totalitaire est américain. Ce péril est cent fois plus dangereux que le communisme: l’Etat de Washington vient d’autoriser la fugue des enfants désirant devenirs transgenre. Les parents ne sont plus les parents.
Comme disait l’autre, la seule révolution qui ait réussi est l’américaine. Et les ploutocrates qui en sont sortis sont là pour nous le faire sentir. La bourse n’arrêtant pas de monter et le dollar se maintenant…
Sources :
https://kreuzgang.org/pdf/henri-delassus.l-americanisme-e...
https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Delassus/Conjur...
https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Delassus/Conjur...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Delassus
https://www.dedefensa.org/article/baudelaire-et-la-sauvag...
https://www.dedefensa.org/article/poe-et-baudelaire-face-...
https://strategika.fr/2023/01/28/walt-whitman-et-la-desti...
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/11/29/le-president...
https://www.dedefensa.org/article/trump-et-le-refus-migra...
https://www.amazon.fr/Dosto%C3%AFevski-modernit%C3%A9-occ...
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/10/08/j...
https://www.dedefensa.org/article/chateaubriand-et-la-con...
https://www.dedefensa.org/article/le-president-grant-et-l...
20:29 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri delassus, monseigneur delassus, etats-unis, histoire, 19ème siècle, américanisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 07 avril 2023
La guerre de Crimée (1853-1856) et la russophobie à travers les âges
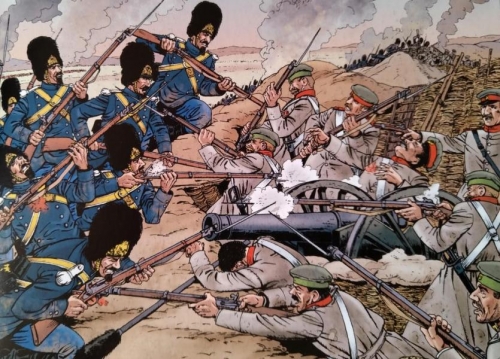
La guerre de Crimée (1853-1856) et la russophobie à travers les âges
Nicolas Bonnal
J’ai plusieurs fois évoqué la russophobie dans mon livre sur Dostoïevski ou dans mes textes publiés dans les médias russes (voir liens) ; elle est européenne cette russophobie, elle n’a pas attendu les Américains et elle est solidement enracinée. On peut dire qu’elle s’exprime une première fois dans la conquête de la Russie par Napoléon qui est ainsi décrit par Tolstoï dans Guerre et paix: c’est l’Europe et non la France (40% de la soldatesque) qui se jette à la gorge de la Russie. Chateaubriand (voyez mon texte) est totalement isolé quinze ans plus tard quand il demande à la diplomatie française de se rapprocher de la Russie et d’éviter les ombrageuses Autriche et Angleterre qui déclencheront les conflits qui en terminèrent avec notre civilisation (elle est morte notre civilisation à l’époque de Zweig ou Valéry, c’est son cadavre qui pue en ce moment).
La guerre de Crimée (1853-56, un million de victimes, de faim, de froid, de maladie, etc.), permet à l’Europe presque entière de se défouler. La France (comme toujours bonapartiste, militariste, autoritaire et humanitaire, lisez mon Exception française), l’Angleterre qui sacrifia tous les chrétiens (obsessionnelle habitude) d’Orient pour protéger son adorable empire ottoman (qu’elle sacrifia ensuite avec Lawrence et les sionistes), mais aussi la Sardaigne du très opportuniste Cavour, l’Autriche très ingrate (sauvée par Nicolas en 1848, mais qui mobilisa cent mille hommes) et d’une demi-douzaine d’autres nations font directement et indirectement la guerre à la Russie POUR DEFENDRE L’EMPIRE OTTOMAN. Le contrat chrétien est rompu par les Occidentaux, et la Grande Catherine s’en plaignait déjà.
Ici ce qui m’intéresse c’est de rappeler que tous les gouvernements de ce continent zombi approuvent systématiquement ce que font les Américains. Les Américains ont droit de vie et de mort sur toute cette planète et tout le monde est content en Europe. Vers 1850 c’est l’Europe occidentale – le couple franco-britannique - qui a ce droit (et refusera de le partager avec l’Allemagne) et qui, avant les USA, s’estime le messie des nations sur cette pauvre terre - pour la piller ou la détruire ou la moderniser...
Un historien russe de cette déjà triste époque s’en est rendu compte et il écrit au tzar Nicolas ; je traduis de Wikipédia anglais (tout arrive) :
« Mikhaïl Pogodin, professeur d'histoire à l'Université de Moscou, avait donné à Nicolas un résumé de la politique de la Russie envers les Slaves pendant la guerre. La réponse de Nicolas était remplie de griefs contre l'Occident. Nicolas partageait le sentiment de Pogodine que le rôle de la Russie en tant que protecteur des chrétiens orthodoxes dans l'Empire ottoman n'était pas compris et que la Russie était injustement traitée par l'Occident. Nicolas avait particulièrement approuvé le passage suivant:
« La France prend l'Algérie à la Turquie, et presque chaque année l'Angleterre annexe une autre principauté indienne : rien de tout cela ne perturbe l'équilibre des forces ; mais lorsque la Russie occupe la Moldavie et la Valachie, ne serait-ce que temporairement, cela perturbe l'équilibre des forces. La France occupe Rome et y séjourne plusieurs années en temps de paix : ce n'est rien ; mais la Russie ne songe qu'à occuper Constantinople, et la paix de l'Europe est menacée. Les Anglais déclarent la guerre aux Chinois, qui les ont, semble-t-il, offensés: personne n'a le droit d'intervenir; mais la Russie est obligée de demander la permission à l'Europe si elle se querelle avec son voisin. L'Angleterre menace la Grèce de soutenir les fausses prétentions d'un misérable Juif et brûle sa flotte: c'est une action licite; mais la Russie exige un traité pour protéger des millions de chrétiens, et cela est censé renforcer sa position à l'Est au détriment de l'équilibre des forces. On ne peut rien attendre de l'Occident que de la haine aveugle et de la méchanceté... (Commentaire en marge de Nicolas Ier : « C'est tout l'enjeu »).
C’est tiré du Mémorandum de Mikhail Pogodin à Nicolas Ier, 1853.

Je ne vais pas trop commenter : l’Occident a tous les droits, la Russie – ou qui que ce soit d’ailleurs – n’en a aucun. Le résultat désastreux de cette guerre mena ensuite où l’on sait. Et il faut comprendre une deuxième évidence : même faible, même risible, l’Occident a la rage et ne s’arrête jamais. Lisez notre livre de prières publié en 1852 par A. Stourdza : parce qu’à part les missiles rien ne peut arrêter ces imbéciles. Ces siècles de la Fin pour reprendre Bernanos sont les siècles de la colère des imbéciles fabriqués à la chaîne (télé ou autre) en Occident depuis l’invention d’un certain Gutenberg. Leur guerre n’en finira pas car elle n’a jamais cessé.
Sources principales :
https://www.dedefensa.org/article/de-gaulle-et-chateaubri...
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Pogodin
https://lesakerfrancophone.fr/custine-et-les-racines-du-c...
https://lesakerfrancophone.fr/de-leffondrement-de-la-russ...
https://www.amazon.fr/Autopsie-lexception-fran%C3%A7aise-...
https://www.amazon.fr/Dosto%C3%AFevski-modernit%C3%A9-occ...
https://fr.sputniknews.africa/search/?query=bonnal
https://www.amazon.fr/Livre-pri%C3%A8res-orthodoxes-Tradu...
23:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, occident, guerre de crimée, crimée, 19ème siècle, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 24 mars 2023
Leconte de Lisle et la colère poétique contre le monde moderne
![leconte-de-lisle-by-belpierre[228487].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/01/01/719387970.jpg)
Leconte de Lisle et la colère poétique contre le monde moderne
par Nicolas Bonnal
« Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein,/Plus vieux, plus décrépits que la terre inféconde,/Châtrés dès le berceau par le siècle assassin /De toute passion vigoureuse et profonde».
Une étude italienne rédigée en français par Yann Mortelette, talentueux et courageux universitaire, permet de redécouvrir ce poète méprisé mais curieux, païen, helléniste, rebelle, parnassien et enragé contre le monde moderne. Contemporain strict de Baudelaire, de Poe ou de Flaubert, sur lesquels j'ai écrit tant de textes (voyez mes recueils), Leconte de Lisle (1818-1894) en partage la rage.
Je citerai en vrac des vers méconnus ; sur la nature et sa destruction par la société industrielle voici ce qu'il écrit :
« Un air impur étreint le globe dépouillé
Des bois qui l’abritaient de leur manteau sublime;
Les monts sous des pieds vils ont abaissé leur cime;
Le sein mystérieux de la mer est souillé. »
Il voit la fin de la poésie arriver (voyez mes textes sur Pearson et Tolstoï qui comprennent qu'elle meurt à la fin du dix-neuvième, à Paris d'ailleurs) :
« Voici que le moment est proche où [les poètes] devront cesser de produire, sous peine de mort intellectuelle. […] Je suis invinciblement convaincu que telle sera bientôt, sans exception possible, la destinée inévitable de tous ceux qui refuseront d’annihiler leur nature au profit de je ne sais quelle alliance monstrueuse de la poésie et de l’industrie. »
Lisons un sonnet admirable tiré de ses poèmes barbares :
« Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein,
Plus vieux, plus décrépits que la terre inféconde,
Châtrés dès le berceau par le siècle assassin
De toute passion vigoureuse et profonde.
Votre cervelle est vide autant que votre sein,
Et vous avez souillé ce misérable monde
D’un sang si corrompu, d’un souffle si malsain,
Que la mort germe seule en cette boue immonde.
Hommes, tueurs de Dieux, les temps ne sont pas loin
Où, sur un grand tas d’or vautrés dans quelque coin,
Ayant rongé le sol nourricier jusqu’aux roches,
Ne sachant faire rien ni des jours ni des nuits,
Noyés dans le néant des suprêmes ennuis,
Vous mourrez bêtement en emplissant vos poches. »
Leconte de Lisle voit la notion de civilisation comme une chose occidentale inventée (cf. Guénon) et une réalité qui n’a pas progressé depuis l’Antiquité :
« En fait d’art original, le monde romain est au niveau des Daces et des Sarmates; le cycle chrétien tout entier est barbare. […] Que reste-t-il donc des siècles écoulés depuis la Grèce? Quelques individualités puissantes, quelques grandes œuvres sans lien et sans unité… »
C’est ce que dit Cochin sur l’art français après la Révolution. Il reste les grandes personnalités du début du dix-neuvième siècle puis peu à peu plus rien.
Comme Vigny cet aristocrate recommande le stoïcisme :
« La vie est ainsi faite, il nous la faut subir.
Le faible souffre et pleure, et l’insensé s’irrite;
Mais le plus sage en rit, sachant qu’il doit mourir. »
Dans une lettre inédite à Charles Bénézit du 12 septembre 1860, il écrit sur le déclin de l’art :
« Mon vieil ami, sois persuadé que je n’abandonne en aucune façon la cause de l’humanité. C’est l’humanité qui s’abandonne elle-même. À son aise! La poésie et l’art n’ont rien à faire dans le bourbier d’inepties et de lâchetés où elle s’enfonce d’heure en heure. Si la masse des soi-disant défenseurs de l’humanité est composée d’infectes brutes qui ont une horreur naturelle de la poésie et de l’art, ce n’est pas, ce me semble, une raison suffisante pour que nous devenions aussi bêtes qu’eux. D’ailleurs, on n’enseigne ni on ne convertit personne. »
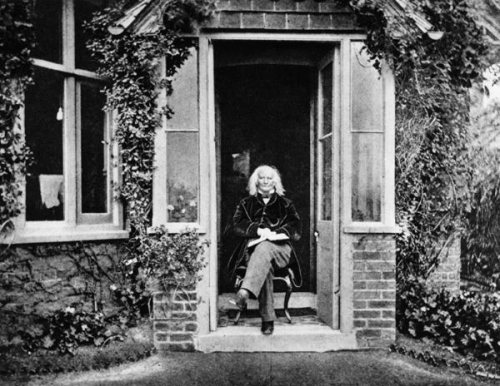
Il ajoute justement :
« On a renoncé fort sagement à la transmutation des métaux, et je crois qu’on ferait mieux de renoncer à la transmutation des âmes. La plus solennelle sottise qu’ait énoncée un homme de génie, est cette affirmation de Leibnitz: «L’éducation est la maîtresse de la vie». Hélas! l’éducation, ou rien, c’est exactement la même chose. […] Il y a des natures d’or et des natures de boue, et rien n’y fait; il y a des peuples qui ne seront jamais qu’une bande de laquais, vils par instinct et insolents par boutades. S’en mêle qui voudra; pour moi j’y ai renoncé, et je t’engage à en faire autant. Amen. »
Il décrit d’ailleurs le déclin de la poésie romantique devenue une bibliothèque rose avant la lettre (cf. Mme Bovary) :
« Le thème personnel et ses variations trop répétées ont épuisé l’attention; […] mais s’il est indispensable d’abandonner au plus vite cette voie étroite et banale, encore ne faut-il s’engager en un chemin plus difficile et dangereux que fortifié par l’étude et l’initiation. Ces épreuves expiatoires une fois subies, la langue poétique une fois assainie, les spéculations de l’esprit, les émotions de l’âme, les passions du cœur, perdront-elles de leur vérité et de leur énergie, quand elles disposeront de formes plus nettes et plus précises. »
Les Bretons ont rarement suscité l’admiration des écrivains. Lui n’est pas en reste – et, sur cette vie de province si française qui en a désespéré des dizaines, il écrit :
« Que le grand diable d’enfer emporte les sales populations de la province! Vous vous figurerez à grand-peine l’état d’abrutissement, d’ignorance et de stupidité naturelle de cette malheureuse Bretagne… »
Et de finir sur ces lignes rendues célèbres par notre bon vieux Lagarde et Michard :
« Que l’humanité est une sale et dégoûtante engeance! Que le peuple est stupide! C’est une éternelle race d’esclaves qui ne peut vivre sans bât et sans joug. »
C’est dans une lettre de 1848, adressée à un certain Ménard !
Le 22 août 1863, il écrit à Georges Lafenestre:
« Nous n’avons rien de commun avec la misérable race à laquelle nous appartenons pour le plus rude châtiment de nos péchés. Cuisiniers, généraux, danseuses, gandins, banquiers, acrobates, princes, avocats, assassins remarquables, huissiers, pianistes, notaires, gendarmes, chambellans, piqueurs, Legouvé père et fils, Scribe, Béranger, Ponsard et l’auteur du Pied qui remue trouvent grâce devant elle, mais non pas la poésie. »
Sa conception élitiste du poète va de pair avec sa crainte du nivellement et de l’uniformisation démocratiques. On est déjà dans la mondialisation et dans la grande liquidation des peuples et des cultures. Dans la préface des Poèmes et poésies, il s’interroge – comme le Chateaubriand de la Conclusion des mémoires d’outre-tombe :
« Que sera-ce donc si [les races] en arrivent à ne plus former qu’une même famille, comme se l’imagine partiellement la démocratie contemporaine, qu’une seule agglomération parlant une langue identique, ayant des intérêts sociaux et politiques solidaires, et ne se préoccupant que de les sauvegarder? Mais il est peu probable que cette espérance se réalise, malheureusement pour la paix, la liberté et le bien-être des peuples, heureusement pour les luttes morales et les conceptions de l’intelligence ».

Ecoutons l’universitaire Lavernette (surprenant, vraiment) :
« Son œuvre, qui passe en revue les civilisations les plus différentes, plaide en faveur d’une diversité culturelle que le poète juge menacée par l’égalitarisme moderne. Dans «Le Dernier des Maourys», le vieux chef indigène déclare à ceux qui sont venus coloniser ses terres:
Dans un dernier élan Leconte de Lisle écrit («Le Dernier des Maourys», Revue des deux mondes, 1er août 1889) :
« Puisque les nations de l’univers ancien
Se dispersent ainsi, Blancs, devant votre face;
Puisque votre pied lourd les broie et les efface;
Si les Dieux l’ont voulu, soit! Qu’il n’en reste rien! »
Oui, les blancs ont tout tué. Et comme disent Daniélou et Bruckberger il leur reste à se tuer eux-mêmes. Faisons-leur confiance : ils ne demandent qu’à s’exterminer avec les russes et les chinois et à refiler tous leurs avoirs à une poignée de riches américains.
Texte de YANN MORTELETTE disponible ici :
https://journals.openedition.org/studifrancesi/2945
Autres sources :
https://www.amazon.fr/Chroniques-sur-lHistoire-Nicolas-Bo...
https://www.amazon.fr/Pourquoi-monarchie-disparu-France-p...
https://www.dedefensa.org/article/chateaubriand-et-la-con...
https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/02/edgar-poe-et...
https://www.dedefensa.org/article/baudelaire-et-la-sauvag...
https://www.dedefensa.org/article/leon-tolstoi-et-les-joy...
20:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leconte de lisle, lettres, lettres françaises, littérature, poésie, littérature française, 19ème siècle, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 21 mars 2023
Maurice Joly et le grand engourdissement de la France
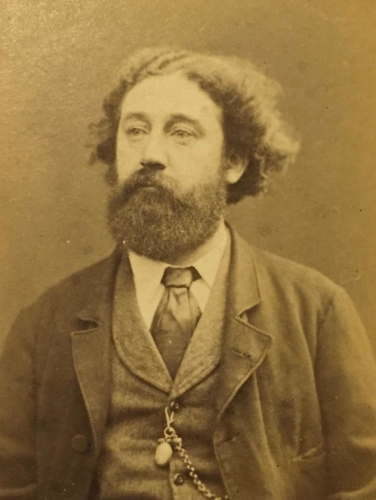
Maurice Joly et le grand engourdissement de la France
Par Nicolas Bonnal
« Un égoïsme dur et féroce était entré dans les mœurs en même temps qu’une froide démoralisation » : Maurice Joly et le grand engourdissement de la France vers 1860 (la Question brûlante)
Je poursuis mon enquête sur le présent permanent: un Etat fou et totalitaire, une masse toujours plus abrutie se rebellant vaguement de temps en temps. L’Etat totalitaire vient nous exterminer globalement et localement avec l’informatique maintenant, tout se passera comme à la parade.
C’est Flaubert qui dit après le putsch de Badinguet: « 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n’y a plus rien, qu’une tourbe canaille et imbécile. »
Régime autoritaire, retors et moderne, industriel et policier le Second Empire est l’inventeur du monde moderne. Marx ne s’y trompe pas, qui lui consacre son fabuleux Dix-Huit Brumaire.
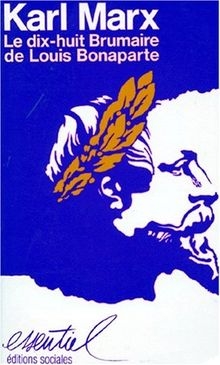
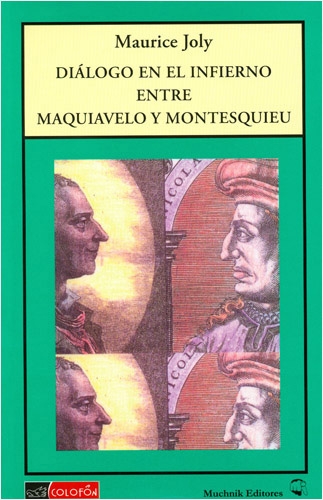
J’ai déjà parlé de Maurice Joly et des Entretiens qui auraient influencé les Protocoles. Un lecteur me conseille la Question brûlante sur Wiki source : c’est génial et cela ne fait que trente pages.
Joly écrit :
« Il ne faut pas s’étonner si ce noble pays est resté immobile pendant douze ans: las de vicissitudes politiques, épuisé d’agitations, désabusé de ses erreurs, il n’a pas encore eu le temps de refaire sa pensée; il se cherche et ne se trouve pas. Nourri dans le matérialisme des idées modernes, il a oublié momentanément qu’il avait une âme; il lui suffisait de vivre sous un gouvernement habile à protéger ses intérêts. »
Le peuple est déjà vieux et fatigué – il est saturé et désabusé : voyez mes Chroniques sur la fin de l’histoire qui commencent par Chateaubriand et sa fabuleuse conclusion des mémoires.
https://www.amazon.fr/Chroniques-sur-lHistoire-Nicolas-Bo...
Joly ajoute :
« D’où vient qu’il ne trouve rien autour de lui que des voix depuis longtemps asservies, et que lui-même, sans doute, il ne compte pas ? D’où vient que l’opinion ne se rallie pas, ne se manifeste pas, ne fait explosion nulle part ? Osons le dire : C’est qu’il n’y a pas d’opinion, c’est qu’il n’y a que des individus, c’est qu’il n’y a que des intérêts ; c’est que tous les ressorts de la France sont, non pas brisés, Dieu me garde de dire un tel mot, mais si profondément détendus, qu’il n’y a plus nulle part ni action ni pensée. Le mal est profond, il est terrible, il est pire que l’agitation peut-être, car l’agitation, c’est la vie du moins ; l’atonie, c’est le commencement de la mort. »
Drumont aussi parlera d’atonie vers 1885 quand il constate que, la république définitivement installée sur le cadavre du peuple, le froncé se moque de tout. Mais le cadavre social, français ou occidental, met du temps à pourrir, c’est tout.
Le sujet de cet essai c’est la réforme libérale voulue par Napoléon III :
« Cette prostration de l’esprit public ne devait point échapper à l’Empereur ; il n’entendait point sans doute régner sur des ombres. »
Le problème est qu’on a déjà une crise morale et religieuse : « toute idée religieuse était détruite, une haine sauvage animant les uns contre le culte de leur pays, une indifférence incurable formant chez les autres une sorte de plaie indolente ; les caractères étaient détrempés, les esprits avaient perdu tout ressort ; aussi l’art, qui n’est que l’expression d’une époque, était-il descendu au même niveau, montrant partout les froides empreintes d’un siècle sans génie ; la littérature avilie se traînait dans le ruisseau ; le théâtre, qui, lui aussi, est l’expression des mœurs, n’était plus qu’un réceptacle où l’ineptie donnait rendez-vous à la licence. »
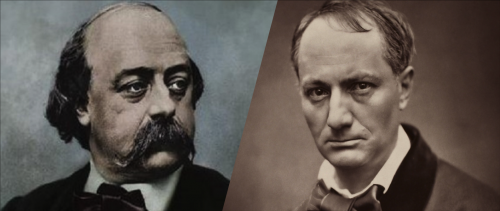
Après les fastes du romantisme la littérature décline ; il reste Flaubert et Baudelaire que l’on veut d’ailleurs envoyer en prison.
Comme Tocqueville ou Guénon – et même Jouvenel, Joly en veut à la monarchie d’avoir liquidé les Grands – les aristos ; on récolte la classe moyenne (qui se nourrit de l’Etat, explique Tocqueville) et la dictature bureaucratique ; haine pour la bourgeoisie :
« Le gouvernement de Louis XIV et celui de Richelieu furent étrangement imprévoyants, il faut en convenir, en favorisant sans mesure l’essor de la bourgeoisie : l’un en décapitant les restes de l’autocratie féodale, l’autre en ruinant la noblesse dans les fêtes et en l’asservissant au milieu du faste de sa cour. 1789 est le résultat final de leur politique. »
Effondrement du personnel politique :
« …en vain formait-on coalition sur coalition pour escalader le pouvoir et y faire arriver les plus agissants. Pas un homme solide ne se présentait en scène ; on ne voyait que des pygmées se montant sur le dos les uns des autres, et dégringolant aux grands éclats de rire de la foule. »
Joly, qui sous-estime la satanique résilience du bourgeois, éprouve plus de sympathie pour le peuple. Mais bon, le peuple: beaucoup d’appelés (sous les drapeaux), peu d’élus (à la Chambre !):
« Demandez donc aux masses déplorablement égarées de 48, si elles se sentaient incarnées dans la bourgeoisie comme le Saint-Esprit dans la Trinité. Non, la bourgeoisie n’est pas le peuple ; le peuple avec ses grands instincts, sa haute moralité, n’entend pas qu’on le confonde avec la bourgeoisie ; il veut être lui et il est lui, ne fût-ce que par cette distinction profonde qu’il n’a rien et que la bourgeoisie possède, qu’il vit de son travail quotidien et que la bourgeoisie est émancipée du labeur, qu’elle est parvenue et que lui cherche à parvenir… »
https://www.amazon.fr/gp/product/B0BW2B86X7/ref=dbs_a_def...
L’abêtissement général est déjà une évidence (voyez mon texte sur Maxime du Camp) :
« Les beaux ouvrages dont une foule de rares génies ont doté la France sont bien plus connus à l’étranger qu’ils ne le sont en France, où personne ne les lit ; des livres pleins de frivolité, de sottises et quelquefois de turpitudes, sont seuls en possession de la faveur publique. »
On est déjà avec cet individu distrait et lâche, dont parlera Julius Evola :
« Mais ce qui est plus grave, c’est une absence de volonté, un défaut de persévérance, une mobilité qui fait tout entreprendre et tout quitter. Le moindre obstacle décourage, la moindre adversité terrasse. »

Et nous sommes entourés de Macron et d’Attal – et de Dussopt :
« C’est plus que jamais le règne des petits hommes, des hommes d’antichambre, des hommes de coulisse ; il semble qu’une mystérieuse conspiration les pousse, les élève, les caresse, ce sont les mœurs du sérail. Où sont donc nos vertes franchises et notre vieil esprit gaulois ? »
Joly écrit même que « le peuple français n’ose plus moquer ouvertement tous ces Gitons... »
On essaie d’éviter le fisc (aujourd’hui seuls le peuvent les plus riches) : « la masse du public en France ne comprend seulement pas le principe de l’impôt ; on n’y satisfait qu’avec douleur ; pour beaucoup de gens, se soustraire aux charges de l’État n’est pas une mauvaise action, voler le gouvernement n’est pas voler, c’est reprendre son bien à un ennemi qui a toujours les mains dans vos poches. »
https://www.amazon.fr/gp/product/1973276747/ref=dbs_a_def...
Fin de l’opinion publique et des grands hommes :
« Non, je le répète, il n’y a pas d’opinion publique en France, je vais plus loin, je dis qu’il n’y a pas de libre-arbitre. À part quelques hommes qui se sont fait des principes et des idées personnelles à force d’étude et de méditation, le plus grand nombre vit sur une provision de lieux-communs qui passent de main en main comme de la monnaie. »
Avant la télé on est bien abruti par la presse. Car la galaxie Gutenberg aura fait de nous des couillons :
« Ce sont partout les mêmes mots, les mêmes phrases qui reviennent à l’oreille, et ces mots, ces phrases sont toutes faites depuis vingt ans. La Presse a habitué le public à prendre chaque jour sa pâtée d’idées toute formulées ; — voyez plutôt ce qui se passe : jamais le public ne jugera par lui-même un homme, un livre, une brochure ; la Presse lui dit : tel livre vient de paraître, c’est fort beau, il le lit ; la Presse lui dit : on joue ce soir telle pièce, c’est magnifique, il y court. Ainsi du reste. »
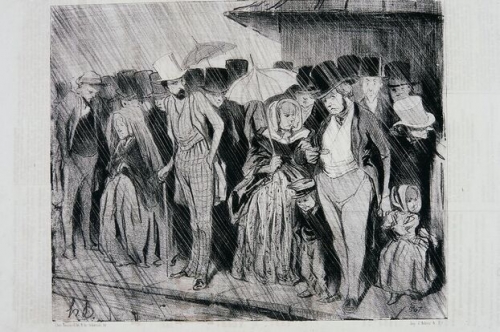
Le public cocu reste content : « et ce qu’il y a de plus fort, le public est trompé, dupé, on se rit de lui en face il croit, il croit toujours ; il lui suffit que les choses soient imprimées, sa déconvenue de la veille ne lui dessille pas les yeux le lendemain. »
Le grand engourdissement est là pour durer :
« Mais il est douteux que le pays sorte si tôt de son engourdissement. Nul mouvement d’opinion n’a précédé ni suivi cette crise, l’atonie persiste en présence du remède le plus salutaire : c’est un symptôme que le siège du mal est profond. »
Sources :
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Question_br%C3%BBlante
https://www.dedefensa.org/article/karl-marx-et-notre-etat...
https://www.dedefensa.org/article/gustave-flaubert-et-not...
https://www.dedefensa.org/article/chateaubriand-et-la-con...
https://www.dedefensa.org/article/maurice-joly-et-le-gouv...
https://www.dedefensa.org/article/bernanos-et-drumont-fac...
https://lesobservateurs.ch/2023/02/28/tocqueville-et-le-g...
https://www.dedefensa.org/article/maxime-du-camp-et-le-de...
19:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice joly, littérature, littérature française, 19ème siècle, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 11 décembre 2022
Tocqueville et le grand et coûteux avènement de la classe moyenne en France
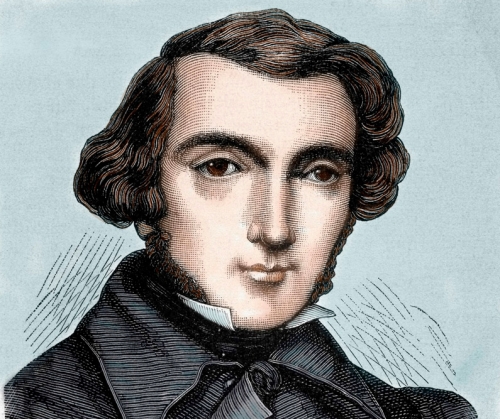
Tocqueville et le grand et coûteux avènement de la classe moyenne en France
Nicolas Bonnal
Lire et relire Tocqueville. Il a découvert avant tout le monde le peuple nouveau de Macron. C’est un peuple conforté, étatisé, subventionné, mais aussi socialiste, européen, belliqueux et progressiste en diable. Tocqueville comme Cournot sait que plus rien de grand ne nous attend après 1789. En 1848 il assiste écœuré et même ennuyé à la très actuelle révolution de 1848. Et il dit de notre histoire moderne dans ses splendides Souvenirs :
« Notre histoire, de 1789 à 1830, vue de loin et dans son ensemble, ne doit apparaître que comme le tableau d’une lutte acharnée entre l’ancien régime, ses traditions, ses souvenirs, ses espérances et ses hommes représentés par l’aristocratie, et la France nouvelle conduite par la classe moyenne. 1830 a clos cette première période de nos révolutions ou plutôt de notre révolution, car il n’y en a qu’une seule, révolution toujours la même à travers des fortunes diverses, que nos pères ont vu commencer et que, suivant toute vraisemblance, nous ne verrons pas finir. »
Et en 1830 triomphe de la classe moyenne qui est venu avec le culte étatique :
« En 1830, le triomphe de la classe moyenne avait été définitif et si complet que tous les pouvoirs politiques, toutes les franchises, toutes les prérogatives, le gouvernement tout entier se trouvèrent renfermés et comme entassés dans les limites étroites de cette seule classe, à l’exclusion, en droit, de tout ce qui était au-dessous d’elle et, en fait, de tout ce qui avait été au-dessus. Non seulement elle fut ainsi la directrice unique de la société, mais on peut dire qu’elle en devint la fermière. Elle se logea dans toutes les places, augmenta prodigieusement le nombre de celles-ci et s’habitua à vivre presque autant du Trésor public que de sa propre industrie. »
Flaubert a résumé aussi ces événements dans sa correspondance ; et Taine. Guénon en parle aussi de cette classe moyenne qui précipite la Fin de la Tradition en Occident – et qui gobe goulument Reset et vaccin.

Tocqueville évoque même, comme le Nietzsche du Zarathoustra, un « rapetissement » universel:
« A peine cet événement eut-il été accompli, qu’il se fit un très grand apaisement dans toutes les passions politiques, une sorte de rapetissement universel en toutes choses et un rapide développement de la richesse publique. L’esprit particulier de la classe moyenne devint l’esprit général du gouvernement ; il domina la politique extérieure aussi bien que les affaires du dedans : esprit actif, industrieux, souvent déshonnête, généralement rangé, téméraire quelquefois par vanité et par égoïsme, timide par tempérament, modéré en toute chose, excepté dans le goût du bien-être, et médiocre ; esprit, qui, mêlé à celui du peuple ou de l’aristocratie, peut faire merveille, mais qui, seul, ne produira jamais qu’un gouvernement sans vertu et sans grandeur. »
Médiocrité, malhonnêteté, vanité, toute notre histoire républicaine dont la finalité est un rabougrissement de la destinée du pays dont de Gaulle eut le dernier la vision. Il poursuit :
« Maîtresse de tout comme ne l’avait jamais été et ne le sera peut-être jamais aucune aristocratie, la classe moyenne, devenue le gouvernement, prit un air d’industrie privée ; elle se cantonna dans son pouvoir et, bientôt après, dans son égoïsme, chacun de ses membres songeant beaucoup plus à ses affaires privées qu’aux affaires publiques et à ses jouissances qu’à la grandeur de la nation. »
Mais le Français ne voulait pas de retour en arrière, pour rien au monde ; il est moins nostalgique encore que l’américain qui a les indiens ; il est content de son « égalité » :
« L'ancienne dynastie était profondément antipathique à la majorité du pays. Au milieu de cet alanguissement de toutes les passions politiques que la fatigue des révolutions et leurs vaines promesses ont produit, une seule passion reste vivace en France : c'est la haine de l'ancien régime et la défiance contre les anciennes classes privilégiées, qui le représentent aux yeux du peuple. Ce sentiment passe à travers les révolutions sans s'y dissoudre, comme l'eau de ces fontaines merveilleuses qui, suivant les anciens, passait au travers des flots de la mer sans s'y mêler et sans y disparaître. »
La haine des rois est permanente, voir le sort de Notre-Dame ; on n’a pas ici besoin de cancel culture made in USA.

Personne n’aime alors vraiment la république ; mais ces haines sont molles :
« La république était sans doute très difficile à maintenir, car ceux qui l'aimaient étaient, la plupart, incapables ou indignes de la diriger et ceux qui étaient en état de la conduire la détestaient. Mais elle était aussi assez difficile à abattre. La haine qu'on lui portait était une haine molle, comme toutes les passions que ressentait alors le pays. D'ailleurs, on réprouvait son gouvernement sans en aimer aucun autre. Trois partis, irréconciliables entre eux, plus ennemis les uns des autres qu'aucun d'eux ne l'était de la république, se disputaient l'avenir. De majorité, il n'y en avait pour rien. »
Toujours au même point, pas vrai ?
Tout le monde surtout veut déjà vivre de subventions et de manne publique (O Louis Blanc ! O ateliers nationaux ! O Bastiat !) :
« La vérité est, vérité déplorable, que le goût des fonctions publiques et le désir de vivre de l'impôt ne sont point chez nous une maladie particulière à un parti, c'est la grande et permanente infirmité de la nation elle-même ; c'est le produit combiné de la constitution démocratique de notre société civile et de la centralisation excessive de notre gouvernement ; c'est ce mal secret, qui a rongé tous les anciens pouvoirs et qui rongera de même tous les nouveaux. »
Une fois son confort assuré on peut divaguer socialo, woke ou autre.
Le grand esprit parlera « d’industrie de la place » dans son Ancien régime ; c’est Taine qui parle de cette profusion du bourgeois, espèce qui croît avec l’étatisme (La Fontaine et ses Fables, dernière expression de l’esprit français traditionnel).
Avec un peuple comme ça, pas de théorie du complot ; Tocqueville l’attaque impeccablement dans sa lettre au marquis de Circourt et dans sa correspondance avec Gobineau :
« C’est mal employer le temps que de rechercher quelles conspirations secrètes ont amené des événements de cette espèce. Les révolutions, qui s’accomplissent par émotion populaire, sont d’ordinaire plutôt désirées que préméditées. Tel qui se vante de les avoir machinées n’a fait qu’en tirer parti. Elles naissent spontanément d’une maladie générale des esprits amenée tout à coup à l’état de crise par une circonstance fortuite que personne n’a prévue ; et, quant aux prétendus inventeurs ou conducteurs de ces révolutions, ils n’inventent et ne conduisent rien ; leur seul mérite est celui des aventuriers qui ont découvert la plupart des terres inconnues. Oser aller toujours droit devant soi tant que le vent vous pousse. »
Et comme on citait Gobineau…
Arthur de Gobineau résume, assez génialement doit-on dire, le présent perpétuel des Français (Lettre de Téhéran adressée à Tocqueville, 29 novembre 1856) :
« Un peuple qui, avec la République, le gouvernement représentatif ou l’Empire, conservera toujours pieusement un amour immodéré pour l’intervention de l’Etat en toutes ses affaires, pour la gendarmerie, pour l’obéissance passive au collecteur, au (illisible), à l’ingénieur, qui ne comprend plus l’administration municipale, et pour qui la centralisation absolue et sans réplique est le dernier mot du bien, ce peuple-là, non seulement n’aura jamais d’institutions libres, mais ne comprendra même jamais ce que c’est. Au fond, il aura toujours le même gouvernement sous différents noms… »
Vite, un successeur à Macron…
https://fr.wikisource.org/wiki/Souvenirs_(Tocqueville)/Te...
18:24 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, 19ème siècle, tocqueville, alexis de tocqueville, nicolas bonnal, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 septembre 2022
La Russie face à l'Europe, géopolitique et panslavisme (Nicolas Danilevski)
16:33 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nikolaï danilevski, russie, 19ème siècle, panslavisme, philosophie, philosophie politique, philosophie de l'histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 septembre 2022
Le laboratoire politique de la France contemporaine

Le laboratoire politique de la France contemporaine
par Georges FELTIN-TRACOL
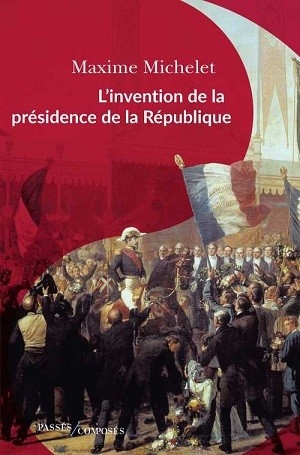 C’est au printemps 2022 en pleine campagne présidentielle que paraît un livre au titre étonnant : L’invention de la présidence de la République (1). Il ne s’agit pas d’une étude de droit constitutionnel, mais d’un essai d’histoire politique sur la plus brève et la plus méconnue des républiques françaises, la Deuxième (1848 – 1852).
C’est au printemps 2022 en pleine campagne présidentielle que paraît un livre au titre étonnant : L’invention de la présidence de la République (1). Il ne s’agit pas d’une étude de droit constitutionnel, mais d’un essai d’histoire politique sur la plus brève et la plus méconnue des républiques françaises, la Deuxième (1848 – 1852).
L’auteur, Maxime Michelet, examine quatre années décisives qui ont modelé le paysage politique jusqu’en 2017. Il en profite pour contester certaines interprétations institutionnelles viciées de l’historiographie républicaine sans toutefois toujours convaincre. En effet, on pense que la IIe République fut un régime présidentiel puisque le chef de l’État ne pouvait pas dissoudre la chambre. C’est inexact en raison des ambivalences de la constitution de 1848. L’assemblée monocamérale poursuit des pratiques parlementaires acquises sous la Seconde Restauration (1815 – 1830) et la Monarchie de Juillet (1830 – 1848). Elle vote régulièrement la défiance envers le cabinet ministériel et/ou certains de ses membres. « La constitution de 1848 accorde peu de pouvoirs à son premier magistrat » qui porte pour la première fois le titre de « président de la République ».
Toute la parole au peuple ?
À part le droit de nommer et de révoquer les ministres (art. 67), le président ne peut pas agir sans l’indispensable contreseing ministériel. Les constituants limitent sérieusement ses prérogatives. Élu pour quatre ans, il n’est pas rééligible. Le jour de son investiture, il est le seul à devoir prêter un serment de fidélité à la constitution devant les députés.
Maxime Michelet n’est pas constitutionnaliste. Certes, le président de la IIe République ne peut ni suspendre ni proroger l’Assemblée nationale législative. En revanche, il peut la convoquer (art. 32) ou « demander, par un message motivé, une nouvelle délibération (art. 58) ». À l’instar de son homologue outre-Atlantique, il ne dispose pas non plus de l’initiative législative directe. Mais, il « a le droit de faire présenter des projets de loi à l’Assemblée nationale par les ministres (art. 49) ». L’auteur oublie en outre que l’article 63 stipule que le chef de l’État « réside où siège l’Assemblée nationale, et ne peut sortir du territoire continental de la République sans y être autorisé par une loi ». L’auteur semble ainsi confondre le régime présidentiel ou « séparation institutionnelle des trois pouvoirs » du présidentialisme autoritaire (initiative législative de l’exécutif, droit de dissolution de l’assemblée, fixation de l’ordre du jour du Parlement, possibilité d’arrêter le budget par décret, etc.), voire d’un « présidentialisme parlementaire » en vigueur au Portugal et en Autriche où le président est élu au suffrage universel direct, mais dont la responsabilité de l’exécutif revient au chef du gouvernement. La Ve République française se définirait plutôt, après trois cohabitations (1986 – 1988, 1993 – 1995 et 1997 – 2002), comme un « système semi-présidentiel au parlementarisme rationalisé ».
Aux pouvoirs volontairement restreints, le président de la République détient néanmoins un atout considérable. Après bien des discussions et des tergiversations parmi les députés, il bénéficie de « l’autorité acquise par l’onction populaire ». Encore inspiré de l’exemple américain, les constituants de 1848 décident d’élire le président de la République au suffrage universel direct par tous les hommes âgés de 21 ans au moins. Le scrutin se passe en un seul tour (tour populaire). Pour être élu, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages dont un minimum de deux millions de voix, soit environ un tiers des inscrits. Si aucun candidat n’est élu, il revient à l’Assemblée législative d’élire le président parmi « les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix (art. 47) » (tour parlementaire) (2).
L’article 46 prévoit que l’élection présidentielle « a lieu de plein droit le deuxième dimanche du mois de mai », y compris si le président a été élu à une autre date. Les constituants rognent sciemment près de sept mois de présidence pour l’élu des 10 et 11 décembre 1848. Maxime Michelet note que « par le hasard de la date du décès de Georges Pompidou, les élections présidentielles ont lieu en mai depuis 1974, le second tour ayant lieu le premier (depuis 1995), le deuxième (1981 et 1988) ou le troisième dimanche dudit mois (1974). L’élection présidentielle de 1965 avait été organisée en décembre – tout comme celle de 1848 – tandis que celle de 1969 avait pris place en juin. En 2022, pour la première fois, le second tour prend place en avril ».
 Tous les publicistes de l’époque pronostiquent la victoire du général Cavaignac (photo). Militaire républicain modéré, Louis-Eugène Cavaignac dirige le pouvoir exécutif après avoir maté l’insurrection ouvrière parisienne de juin 1848. Il « demeurait à l’hôtel de Monaco - aujourd’hui hôtel de Matignon ». Élu président, le général Cavaignac en aurait fait son palais présidentiel. Mais il perd l’élection dès le tour populaire tout comme le général conservateur Nicolas Changarnier, les socialistes Alexandre-Auguste Ledru-Rollin et François Raspail et le républicain Alphonse de Lamartine. Avec 75 % des voix, le premier président de la République française est un homme de 40 ans : Louis-Napoléon Bonaparte. « L’héritier de l’Empire devient le premier des premiers magistrats de la République, porté à cette charge quelques jours plus tôt par les suffrages quasi unanimes du peuple français, déposés à l’occasion de la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Une expérience audacieuse qui ne se reproduisit plus en France avant 1965. » Mieux, Maxime Michelet le présente comme « le premier président de la Ve République ». En effet, « du point de vue des principes comme de la pratique, Louis-Napoléon Bonaparte a inventé la présidence de la République et, à considérer la prééminence du chef de l’État au sein de la constitution de 1958, on pourrait même oser une affirmation riche en paradoxes : Louis-Napoléon Bonaparte a fondé notre République ».
Tous les publicistes de l’époque pronostiquent la victoire du général Cavaignac (photo). Militaire républicain modéré, Louis-Eugène Cavaignac dirige le pouvoir exécutif après avoir maté l’insurrection ouvrière parisienne de juin 1848. Il « demeurait à l’hôtel de Monaco - aujourd’hui hôtel de Matignon ». Élu président, le général Cavaignac en aurait fait son palais présidentiel. Mais il perd l’élection dès le tour populaire tout comme le général conservateur Nicolas Changarnier, les socialistes Alexandre-Auguste Ledru-Rollin et François Raspail et le républicain Alphonse de Lamartine. Avec 75 % des voix, le premier président de la République française est un homme de 40 ans : Louis-Napoléon Bonaparte. « L’héritier de l’Empire devient le premier des premiers magistrats de la République, porté à cette charge quelques jours plus tôt par les suffrages quasi unanimes du peuple français, déposés à l’occasion de la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Une expérience audacieuse qui ne se reproduisit plus en France avant 1965. » Mieux, Maxime Michelet le présente comme « le premier président de la Ve République ». En effet, « du point de vue des principes comme de la pratique, Louis-Napoléon Bonaparte a inventé la présidence de la République et, à considérer la prééminence du chef de l’État au sein de la constitution de 1958, on pourrait même oser une affirmation riche en paradoxes : Louis-Napoléon Bonaparte a fondé notre République ».

Le choix de l’impartialité
Le nouveau dirigeant français inaugure des usages dont certains perdurent encore aujourd’hui. Il est « le premier locataire de l’Élysée ». Il y organise de grandes réceptions et invite les familles royalistes légitimistes et orléanistes les plus influentes, les membres du clan Bonaparte et un entourage présidentiel immédiat dont les fidélités sont « nées dans l’exil et les conspirations ». Connaissant mieux l’étranger que son pays natal, le président, bon locuteur en allemand, en anglais et en italien, visite au cours de son mandat la France et n’hésite pas à séjourner dans des départements politiquement hostiles. Les discours qu’il prononce accroissent sa notoriété auprès de la population. Petite anecdote savoureuse pour l’époque : sa maîtresse en titre, l’Anglaise Elizabeth-Ann Haryett alias Miss Harriet Howard (1823 – 1865) (tableau, ci-dessous), accompagne volontiers ce célibataire endurci pendant les voyages officiels...

En ces temps d’hypostase laïcarde, l’auteur signale que « par privilège particulier, le chef de l’État français possédait […] le droit de remettre la barrette cardinalice au nonce apostolique en France – l’ambassadeur du pape – lorsqu’il était nommé cardinal à l’issue de sa mission diplomatique: le dernier président de la République à remettre sa barrette à un cardinal sera le général de Gaulle en 1959 (et ainsi, en 1953, le président Auriol aura-t-il remis sa barrette au cardinal Roncalli, futur Jean XXIII ». Il mentionne enfin une « magistrature unique dans toute l’histoire républicaine de la France »: la vice-présidence de la République dont le titulaire s’appelle Henri Georges Boulay de La Meurthe (1797 - 1858). L’article 70 définit cette nouvelle fonction. Le vice-président de la République est nommé par l’Assemblée nationale, sur la présentation des trois candidats faite par le président (outre l’heureux élu, les deux autres sont le comte Achille Baraguey d'Hilliers et Alexandre-François Vivien). Président du Conseil d’État, le vice-président de la République remplace le président en cas d’empêchement et assure un court intérim.
Président des Amis de Napoléon III, Maxime Michelet entend réhabiliter la figure paradoxale du premier chef de l’État français élu au suffrage universel de l’histoire, du premier des présidents de la République et du dernier des monarques français. Il rappelle à toute fin utile que du 20 décembre 1848 au 2 septembre 1870, « Louis-Napoléon Bonaparte a présidé aux destinées de la France durant vingt et un ans et huit mois. À ce titre, il est l’homme politique contemporain à avoir exercé le plus longtemps la magistrature suprême, suivi de Louis-Philippe (dix-sept ans et deux mois), Napoléon Ier (quatorze ans et sept mois) et François Mitterrand (quatorze ans) ». Il ajoute que « loin de l’aventurier jouisseur et sans autre colonne vertébrale que la poursuite d’un confort luxueux financé par la nation, Louis-Napoléon est un homme d’État, porteur d’une véritable conception politique, acteur d’une trajectoire personnelle parmi les plus étonnantes du XIXe siècle et qu’il serait bien réducteur de caricaturer en vulgaire conspiration d’un escroc sanguinaire ».
Le « Prince-Président » a anticipé et compris les aspirations d’une partie non négligeable de l’électorat. « En 1848, qui mieux que l’héritier de Napoléon pouvait fonder en France la magistrature suprême ? Proclamer le principe de l’élection par le peuple, n’était-ce pas d’ailleurs déjà couronner le prince qui était l’incarnation de ses droits ? » Un solide argument, car les Bonaparte forment « la seule dynastie compatible avec les institutions républicaines. […] L’angle est celui d’une dynastie nationale, surgie de la Révolution et auréolée de gloire, vaincue par les armées étrangères ».
Très tôt, Louis-Napoléon se place au-dessus des clivages partisans et des antagonismes politiques. C’est un fait. Par exemple, aux législatives de 1849, de nombreux cantons qui l’ont massivement choisi se portent ensuite sur les républicains radicaux. Le canton de Saint-Pourçain dans l’Allier, qui avait voté à 84 % pour le prince impérial en décembre 1848, vote à 65 % pour les candidats de la Montagne démocrate-socialiste. Pour leur part, les droites (légitimiste, bonapartiste autoritaire, orléaniste et républicaine conservatrice) cherchent à se coordonner au sein d’un « comité de la rue de Poitiers ». Mais, « il est difficile de gouverner avec des hommes qui – issus des élites orléanistes – cachent difficilement leur mépris pour un aventurier qui, selon eux, ne doit son élection qu’au fétichisme des masses paysannes pour son nom ». Le nouveau président doit composer avec une assemblée méfiante et rétive à ses initiatives. Il commence par prendre des ministres compatibles avec la majorité de droite. Cependant, dès le 31 octobre 1849, il désigne un « gouvernement présidentiel ». Certes, « l’Assemblée demeure – sur le plan constitutionnel et politique – le cœur du pouvoir républicain. Face à elle se tient désormais un chef de l’État qui n’est plus seulement un président qui nomme le pouvoir exécutif et le délègue à ses ministres mais un président qui exerce le pouvoir exécutif à travers ses ministres, récupérant l’exercice d’un pouvoir que la lettre de l’article 43 de la constitution – comme l’esprit de l’élection du 10-Décembre – lui déléguait directement ». Sa présidence se marque de diverses combinaisons gouvernementales qui prennent en compte une lecture parlementaire de la constitution de 1848. Aux dépens d’un brumeux « parti du peuple », le président Bonaparte subit les pressions permanentes du « parti de l’Ordre » bourgeois et rentier dont Adolphe Thiers est l’un des principaux animateurs.
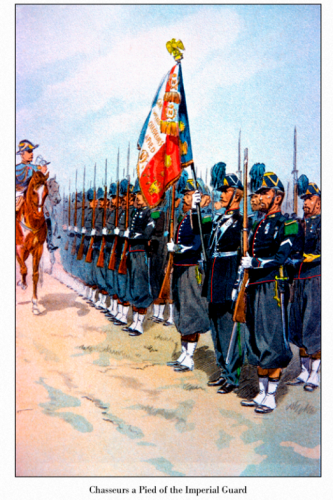
Concorde nationale et harmonie sociale
Malgré une situation politique compliquée, le chef de l’État engage une politique de rupture avec un certain ordre social établi. En tant qu’ancien prisonnier politique, il « est l’infatigable promoteur de l’amnistie » des Journées sanglantes de juin 1848. Il travaille sa stature régalienne. En tant que chef de l’armée, le président de la République exerce « une présidence napoléonienne »; il agit en « bienfaiteur des soldats »; il intervient en « grand prêtre de la mémoire napoléonienne » et organise « les charités présidentielles ». Maxime Michelet remarque qu’en politique, « le bonapartisme présidentiel est plus conservateur que le bonapartisme impérial, en partie car sa principale mission est de rétablir l’ordre et de promouvoir une révision de l’équilibre institutionnel ». Si c’est sous le Second Empire que « la loi du 9 juin 1853 fonde notre système de retraite », dès la IIe République, le président demande aux parlementaires d’accorder quelques avancées sociales réelles empreintes d’un esprit paternaliste. La loi du 18 juin 1850 autorise des caisses facultatives de retraite par capitalisation dans le secteur privé. La loi du 13 avril 1850 favorise « l’assainissement des logements insalubres ». La loi du 15 juillet 1850 légalise l’organisation du système mutualiste et des sociétés de secours mutuels. La loi du 22 janvier 1851 accorde l’assistance judiciaire gratuite aux plus démunis. Quant à la loi du 22 février 1851, elle concerne l’apprentissage, sa contractualisation, le temps de travail, les jours fériés, le repos dominical et le droit à l’instruction des apprentis.
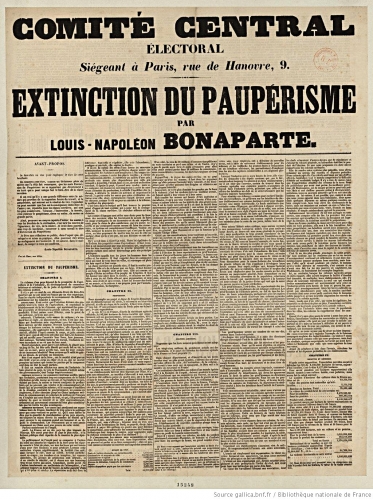
L’auteur prévient cependant que « plus qu’une dimension sociale, c’est une dimension populaire qui domine le mandat présidentiel de Louis-Napoléon Bonaparte ». N’est-il pas perçu comme un « prince rouge » ? N’a-t-il pas publié en 1844 De l’extinction du paupérisme dans le sillage de la pensée saint-simonienne ? Sur cette ligne équivoque, en janvier 1849, son cousin Pierre Bonaparte fonde et dirige un éphémère journal intitulé Le Socialisme napoléonien. Un autre cousin, le prince impérial Napoléon-Jérôme Bonaparte, dit « Plon-Plon », siège à l’Assemblée sur les bancs de l’extrême gauche républicaine et anti-cléricale.
Ces engagements ne sont pas paradoxaux. Tous les membres de la famille Bonaparte défendent « la mémoire impériale, porteur de souvenirs et de principes tant révolutionnaires que conservateurs ». À cet égard, le bonapartisme louis-napoléonien est une révolution conservatrice du premier âge industriel. Les historiens des idées politiques du XIXe siècle ont relevé la présence significative de cette expression. Le journal berlinois Die Volksstimme l’emploie dès 1848. Dans son édition du 20 décembre 1851 qui mentionne le coup d’État du 2 décembre, le journal suisse Le Genevois écrit: « Grâce à la Providence, une véritable révolution conservatrice s’accomplit en France par la discipline de l’armée et par la terreur qu’inspire l’anarchie. » « La souveraineté populaire et son incarnation en actes et en puissance, tel est le credo de Louis-Napoléon. » La souveraineté populaire et non la souveraineté nationale, nuance fondamentale entre le bonapartisme au XIXe siècle et le gaullisme au XXe siècle ! Contre les GAFAM et autres transnationales, le XXIe siècle ne verrait-il pas enfin une convergence de ces deux souverainetés plus ou moins conflictuelles vers une souveraineté nationale-populaire et son dépassement en souveraineté communautaire ?
Pour le futur Napoléon III, en 1848, « la candidature napoléonienne était celle d’un puissant mouvement populaire allant au-delà du clivage entre gauche et droite », car « l’élection présidentielle est […] la rencontre d’un peuple avec un prince, dont le nom est un principe ». Maxime Michelet parle de « réconciliation des principes bonapartistes et des principes républicains dans le creuset de la constitution gaullienne ».
Une république plébiscitaire héréditaire
La perspective de la fin du mandat présidentiel en 1852 incite le président à réclamer au moyen d’une pétition la révision de la constitution qui, par des blocages politiques et juridiques, ne se réalise pas. Pendant cette campagne pétitionnaire, le parti de l’Ordre envisage d’autres candidats pour l’échéance présidentielle à venir dont François d’Orléans, prince de Joinville, le dernier fils de Louis-Philippe. Il s’inquiète aussi de l’engouement du public pour le député démocrate-socialiste de la Creuse, Martin Nadaud, à peine âgé de 36 ans. Sa possible candidature à l’Élysée électrise le débat public. S’ajoute la perspective d’un double imbroglio politico-électoral. Le 9 mai, le président Bonaparte achèvera son mandat et sera remplacé par le vice-président de la République. Si Louis-Napoléon n’est pas réélu hors du champs constitutionnel ou si aucune majorité ne se dégage, l’élection reviendrait à l’Assemblée nationale. Mais laquelle ? Celle élue le 2 mai ou celle dont le mandat s’achève le 28 mai ? « On se retrouverait ainsi dans une situation absolument chaotique : un ancien président sans doute réélu illégalement, un vice-président exerçant la présidence par intérim, un futur président à désigner, une assemblée sortante toujours en fonction et une nouvelle assemblée impuissante mais à la composition déjà connue. »
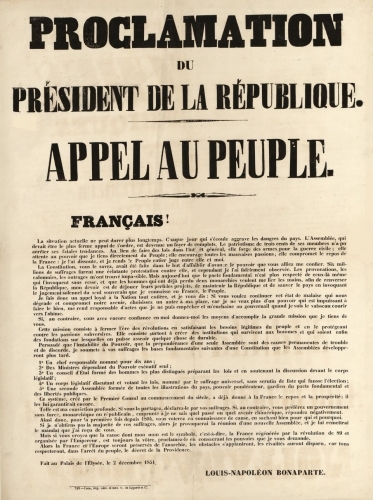
Louis-Napoléon Bonaparte prépare par conséquent un coup de force. Celui-ci aurait dû se produire dès le 17 septembre 1851, mais il est aussitôt reporté. L’action se déroule le 2 décembre 1851 dans le cadre de l’opération Rubicon. Malgré des résistances parfois violentes dans le Sud-Est et des débuts de jacqueries dans le Massif Central, le putsch présidentiel réussit. Le plébiscite des 21 et 22 décembre 1851 entérine une nouvelle constitution républicaine vraiment présidentialiste (présidence décennale, responsabilité plébiscitaire permanente devant le peuple, ministres responsables devant le président, monopole gouvernemental de l’initiative des lois, etc.). Après 1851, « le pouvoir de Louis-Napoléon n’est pas un simple autoritarisme autocratique mais un autoritarisme démocratique, sa puissance et sa prédominance au sein des institutions ne relevant pas tant de la personne du prince que du principe qu’il incarne ».
Moins d’un an plus tard, le plébiscite des 20 et 21 novembre 1852 établit un nouveau régime impérial. « En réalité, ce n’est ni une dynastie, ni une succession mais une dignité qui est rétablie. » Louis-Napoléon Bonaparte considère en effet que les droits dynastiques qu’il détient lui ont été conférés précédemment par le suffrage universel manifesté avec les consultations plébiscitaires de 1799, de 1802 et de 1804. L’auteur explique avec raison que « bien différente de la royauté, dont l’ordre de succession ne saurait être discuté puisque part intégrante de la légitimité, l’Empire est une monarchie contractuelle fondée sur un pacte explicite entre le souverain et le peuple. En ressuscitant la monarchie impériale, Louis-Napoléon rétablit de nouveau un principe (l’hérédité au sein de la famille de Napoléon) ainsi qu’au titre (empereur des Français) mais ne restaure pas une dynastie. Il instaure sa dynastie ». Le caractère contractuel de l’Empire sera réaffirmé après 1873 par le prétendant impérial, Louis-Napoléon (ou Napoléon IV pour les « impérialistes »), qui proposera que l’intronisation de chaque nouvel empereur des Français ne se fasse qu’après un accord plébiscitaire favorable. Le système bonapartiste s’apparente plus à une Res Publica héréditaire basée sur le consentement plébiscitaire du peuple.
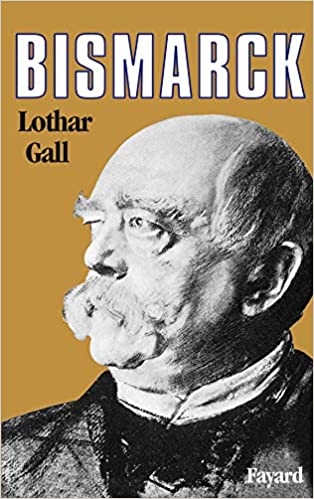 Ambassadeur de Prusse à Paris en 1862, Otto von Bismarck a-t-il pris conscience de la force du peuple dans la réalisation de son projet d’unité nationale allemande dans un sens conservateur, puis bien plus tard dans les avancées sociales légales ? L’un de ses biographes, Lothar Gall, a estimé que le futur « Chancelier de fer » agissait en « révolutionnaire blanc » (3). Serait-ce une anticipation ou une préfiguration de la Révolution conservatrice du premier tiers du XXe siècle (4) ?
Ambassadeur de Prusse à Paris en 1862, Otto von Bismarck a-t-il pris conscience de la force du peuple dans la réalisation de son projet d’unité nationale allemande dans un sens conservateur, puis bien plus tard dans les avancées sociales légales ? L’un de ses biographes, Lothar Gall, a estimé que le futur « Chancelier de fer » agissait en « révolutionnaire blanc » (3). Serait-ce une anticipation ou une préfiguration de la Révolution conservatrice du premier tiers du XXe siècle (4) ?
L’invention de la présidence de la République ne se contente pas de relater les péripéties politiques et parfois personnelles de la première présidence de la République française. Cet ouvrage remarquable montre un cas pratique de « troisième voie » entre la Réaction et la Révolution, une tentative assez aboutie de synthèse nationale autour des concepts d’Ordre politique, de Justice sociale et d’Égalité civique. À son tour biographe du troisième empereur des Français (5), Pierre Milza considérait la période « louis-napoléonienne » comme le grand moment illibéral de la France (6). Maxime Michelet ne reprend pas l’expression, mais il montre une politique adroite non pas du « juste milieu », mais de concorde nationale et sociale liant des mentalités traditionnelles au dynamisme de la modernité techno-scientifique européenne.
GF-T
Notes
1 : Maxime Michelet, L’invention de la présidence de la République. L’œuvre de Louis-Napoléon Bonaparte, préface d’Éric Anceau, Passés composés, 2022, 394 p., 24 €. Les citations en sont extraites.
2 : La Bolivie a appliqué ce mode de désignation présidentielle jusqu’en décembre 2005 quand Evo Morales gagna le scrutin dès le premier tour à 53,70 %.
3 : Lothar Gall, Bismarck. Le révolutionnaire blanc, Fayard, coll. « Histoire », 1984.
4 : En lisant Otto von Bismarck, Pensées et Souvenirs, présentation de Joseph Rovan, Calmann-Lévy, 1984, on comprend qu’entre 1851 et 1862, le Second Empire dans sa phase autoritaire rassure les diplomaties européennes.
5 : Rappelons que le fils de Napoléon Ier, Napoléon II, bien que mineur, régna de jure sur la France entre les 22 juin et 8 juillet 1815.
6 : Pierre Milza, Napoléon III, Perrin, 2004.
17:18 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, 19ème siècle, louis-napoléon bonaparte, napoléon iii, livre, iième république, 1848 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 août 2022
La fin du style : Nietzsche contre David Strauss
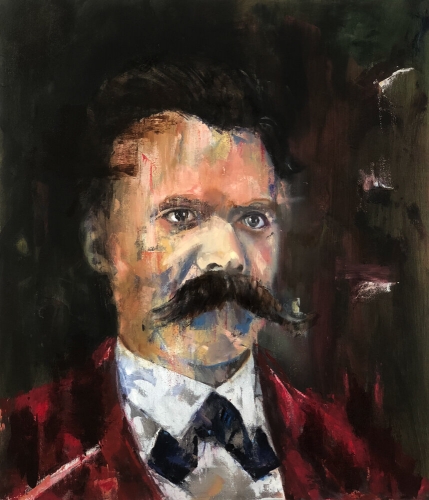
La fin du style : Nietzsche contre David Strauss
Nicolas Bonnal
Stupide dix-neuvième siècle : cette expression incorrecte qui fait fi de dizaines de critiques géniaux de la modernité (voyez mes Chroniques sur la Fin de l’Histoire) tombe à pic pour David Strauss, biographe du pauvre Jésus (atmosphère de Vatican II déjà) et inventeur du style journalistique teuton, style qui a le don d’énerver Nietzsche dans une de ses considérations inactuelles. Strauss incarne le crétin moderne avec son arrogance et sa légèreté, sa chutzpah et sa vulgarité.
Nietzsche, qui n’est pas précisément chrétien, écrit sur cette montée de la légèreté imbécile :
« Jésus devrait être présenté comme un exalté qui, de nos jours, échapperait difficilement au cabanon, et l’anecdote de la résurrection du Christ mériterait d’être qualifié de « charlatanisme historique ». — Laissons passer, pour une fois, tout cela pour y étudier la façon particulière de courage dont Strauss, notre « philistin classique », est capable. »
Remarquons que Nerval écrivait la même chose quarante ans avant : on enfermerait le Christ à Bicêtre. Et Nietzsche comme Nerval a fini à l’asile. Et d’évoquer ce fameux philistin (Strauss toujours) qui manque de respect à Schopenhauer :
« C’est ainsi que David Strauss, un véritable satisfait en face de nos conditions de culture, un philistin-type, parle une fois, avec des tournures de phrases caractéristiques de la « philosophie d’Arthur Schopenhauer, pleine d’esprit, il est vrai, mais souvent malsaine et peu profitable ». Car une circonstance fâcheuse veut que ce soit surtout sur ce qui est « malsain et peu profitable » que « l’esprit » aime à descendre avec une particulière sympathie et que le philistin lui-même, lorsqu’il lui arrive d’être loyal envers lui-même, éprouve en face des produits philosophiques que ses semblables mettent au jour quelque chose qui ressemble beaucoup à du manque d’esprit, bien que ce soit d’une philosophie saine et profitable. »

On voit apparaître le charabia de la langue. Nietzsche continue de se moquer de Strauss – qui est l’auteur alors de bestsellers en Allemagne (c’est le début du rétrécissement spirituel allemand prévu par Goethe lors d’un entretien avec Eckermann) :
« À vrai dire, il ne se pique pas véritablement, mais il se sert d’un moyen plus violent encore qu’il décrit ainsi : « Nous ouvrons Schopenhauer qui frappe notre idée au visage à chaque occasion » (p. 143). Or, une idée n’ayant pas de visage — fût-elle même l’idée de Strauss par rapport à l’univers — mais le visage pouvant tout au plus appartenir à celui qui a l’idée, le procédé se décompose en plusieurs actions. Strauss ouvre Schopenhauer lequel le frappe... au visage. Alors Strauss « réagit » dans un sens « religieux », c’est-à-dire qu’il se met à frapper à son tour sur Schopenhauer, il se répand en injures, parle d’absurdités, de blasphèmes, de scélératesses, déclare même que Schopenhauer n’avait pas toute sa raison. »
Strauss incarne selon Nietzsche notre descente aux enfers intellectuelle : le journalisme. Macron qui file un milliard ou presque à la presse a instinctivement compris de quoi il en retourne : pour imposer l’horreur, financer les journaux, ces fonctionnaires de l’opinion. Le journalisme comme plus tard la télé (cf. Godard) va recouvrir le monde :
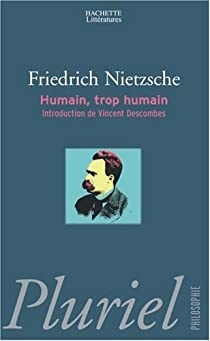 « Et, comme Strauss s’entend bien à employer les circonlocutions ! Que veut-il dire, quand il parle des études historiques qui aident à notre compréhension de la situation politique, si ce n’est ceci qu’il recommande la lecture des journaux ? Et en parlant de notre participation vivante à l’édification de l’Etat allemand, entend-t-il autre chose que notre séjour quotidien à la brasserie ? Une promenade au jardin zoologique n’est-elle pas le meilleur moyen vulgarisateur, par quoi nous élargissons notre connaissance de la nature ? Et enfin, le théâtre et le concert où nous puisons « des stimulants pour notre imagination et notre humour » qui nous satisfont « d’une façon parfaite ». Comme cela est dit avec esprit et dignité ! Voilà notre homme ! car son ciel est notre ciel. C’est ainsi que triomphe le philistin… »
« Et, comme Strauss s’entend bien à employer les circonlocutions ! Que veut-il dire, quand il parle des études historiques qui aident à notre compréhension de la situation politique, si ce n’est ceci qu’il recommande la lecture des journaux ? Et en parlant de notre participation vivante à l’édification de l’Etat allemand, entend-t-il autre chose que notre séjour quotidien à la brasserie ? Une promenade au jardin zoologique n’est-elle pas le meilleur moyen vulgarisateur, par quoi nous élargissons notre connaissance de la nature ? Et enfin, le théâtre et le concert où nous puisons « des stimulants pour notre imagination et notre humour » qui nous satisfont « d’une façon parfaite ». Comme cela est dit avec esprit et dignité ! Voilà notre homme ! car son ciel est notre ciel. C’est ainsi que triomphe le philistin… »
Nietzsche avec son coutumier génie visionnaire décrit déjà la vie ordinaire au sens guénonien de nos philistins (guerre, vaccin, végétarisme) :
« Mais de là nous nous dirigeons, heureux plus que jamais, dans le logis confortable des habitants de la villa. Nous trouvons ceux-ci au milieu de leurs femmes et de leurs enfants, lisant leurs journaux, occupés aux conversations politiques de tous les jours. Nous les entendons discourir durant un certain temps sur le mariage et le suffrage universel, la peine de mort ou les grèves ouvrières, et il ne nous semble pas qu’il fût possible de défiler plus vite le chapelet des opinions publiques. »
La presse oppresse ; elle fabrique et programme un citoyen mécanisé et dangereux ; l’usure de la langue prostituée des journaux aide à la fabrication de ce crétin ordinaire (pas de pain, pas de gaz, luttons contre la Russie !) :
— Il est certain qu’un Allemand d’aujourd’hui puise la majeure partie de ses lectures quotidiennes dans les écrits périodiques, journaux et revues, dont le langage s’insinue dans son oreille goutte à goutte, avec un perpétuel rappel des mêmes mots et des mêmes tournures de phrases. Et comme il utilise généralement pour cette lecture les heures où son esprit fatigué, de toute façon, n’est pas prédisposé à la résistance, son sens du langage se familiarise peu à peu avec cet allemand quotidien, et il lui arrive par ailleurs d’en regretter l’absence avec douleur. Mais les fabricants de ces journaux, d’accord en cela avec la nature de leurs occupations, sont le plus habitués à l’écume de ce langage journalistique. »
La prostitution du goût intellectuel rejoint le déclin du goût gastronomique ou musical :
« Au sens propre du mot, ils ont perdu toute espèce de goût, et il arrive tout au plus à leur palais de goûter, avec une sorte de volupté, ce qui est tout à fait corrompu et arbitraire. C’est ce qui explique le tutti unisono que l’on entonne, malgré ce relâchement et cet énervement général, chaque fois qu’un nouveau solécisme a été inventé. Avec ces impertinentes corruptions du langage, on exerce sa vengeance contre celui-ci, à cause de l’incroyable ennui qu’il provoque peu à peu chez ceux qui sont à sa solde. »
C’est la fin de la grammaire :
« La faute grammaticale, et c’est là ce qu’il y a de singulier, ne choque donc pas notre philistin, il la salue au contraire comme un charmant délassement dans le désert aride de l’allemand de tous les jours. Mais ce qui le blesse, c’est ce qui est véritablement productif. Chez l’écrivain-modèle ultra-moderne la syntaxe contournée, guindée ou complètement effilochée, le néologisme ridicule sont non seulement acceptés, on les lui compte encore comme un mérite, comme quelque chose de piquant. »
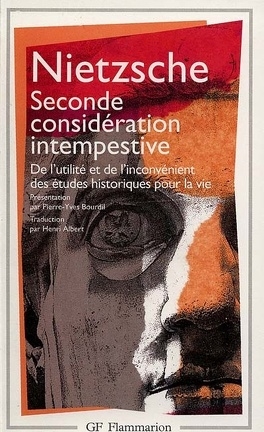 Le retournement des valeurs peut alors avoir lieu – dans le domaine grammatical :
Le retournement des valeurs peut alors avoir lieu – dans le domaine grammatical :
« Quand tout ce qui est plat, usé, sans force, vulgaire est accepté comme la règle, ce qui est mauvais et corrompu comme exception charmante, alors tout ce qui est vigoureux, noble et beau tombe dans le décri. »
Et cela rend impossible l’accès aux classiques :
« S’il est absolument impossible de faire de même avec l’allemand de Strauss, cela ne tient probablement pas au fait que sa langue est plus allemande que celle des deux autres, mais simplement à ceci qu’elle est embrouillée et illogique, tandis que chez Kant et chez Schopenhauer elle est pleine de simplicité et de grandeur… »
Dans Zarathoustra notre prophète tempêtera aussi contre les journaux. « Ils rendent leur bile et appellent cela des journaux »…
Source:
https://fr.wikisource.org/wiki/David_Strauss,_sectateur_e...
http://www.philotextes.info/spip/IMG/pdf/zarathoustra.pdf
http://www.dedefensa.org/article/de-platon-a-cnn-lenchain...
https://www.amazon.fr/Chroniques-sur-lHistoire-Nicolas-Bo...
https://www.dedefensa.org/article/goethe-et-les-entropies...
11:23 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : freidrich nietzsche, philosophie, presse, david strauss, 19ème siècle, allemagne, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 avril 2022
Bismarck entre tradition et innovation: les discours du chancelier de fer

Bismarck entre tradition et innovation: les discours du chancelier de fer
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/bismarck-tra-tradizione-e-innovazione-i-discorsi-del-cancelliere-di-ferro-giovanni-sessa/
Otto von Bismarck est sans aucun doute un personnage historique de grande importance. Ses choix politiques ont conditionné non seulement l'histoire de l'Allemagne moderne, mais aussi les événements de la première moitié du 20e siècle. Afin de mieux connaître l'homme et le chancelier, nous vous recommandons vivement la lecture d'un de ses livres, Kulturkampf. Discorsi politici, récemment en librairie par la maison d'édition Oaks (pour les commandes : info@oakseditrice.it, pp.291, €24.00). Le volume est enrichi par la préface clarifiante du germaniste Marino Freschi. Né en 1815, une année fatidique pour le destin de l'Europe, Bismarck, comme le note la préface, "est resté attaché aux racines de l'aristocratie foncière" (p. I). Dans sa jeunesse, ses débuts dans l'administration prussienne ne sont pas brillants. Il a été impliqué dans un certain nombre de scandales et a mené une vie inconvenante. Cependant, ce n'était qu'un moment passager: bientôt, la spiritualité piétiste, basée sur la dévotion mystique et visant l'éveil intérieur, s'enracine dans son âme.
 Dans les cercles piétistes, il a rencontré sa femme et quelques futurs collaborateurs. Parmi eux se trouvait von Roon, qui l'a introduit dans le cercle du futur Wilhelm I. Son éducation politique et culturelle a eu un impact sur sa vie. Son éducation politique et culturelle culmine dans sa fréquentation du cercle conservateur animé par les frères von Gerlach. Il acquiert une expérience administrative au niveau municipal et provincial jusqu'à ce que, après l'accession de Wilhelm Ier au trône en 1862, il soit appelé à la Diète de Francfort en tant que représentant du souverain. Ses discours étaient caractérisés par un esprit anti-révolutionnaire et démontraient ses qualités oratoires incontestables, comme le montre le livre que nous présentons ici. L'art oratoire de Bismarck, tout en montrant en maints endroits la vaste culture du chancelier, avec des références à Goethe, Lessing, Schiller, Heine, son auteur préféré plus que tout autre, était direct: " il était fondé sur la franchise et l'attaque [...] au-delà de toute pratique rhétorique" (p. III). Il a toujours été conscient du lien entre les choix de politique intérieure et étrangère, en raison de son long séjour en tant qu'ambassadeur à Saint-Pétersbourg et, pour une période plus courte, à Paris. Il se trouvait dans la capitale française lorsqu'il a été rappelé par le nouveau monarque, qui lui a confié la chancellerie.
Dans les cercles piétistes, il a rencontré sa femme et quelques futurs collaborateurs. Parmi eux se trouvait von Roon, qui l'a introduit dans le cercle du futur Wilhelm I. Son éducation politique et culturelle a eu un impact sur sa vie. Son éducation politique et culturelle culmine dans sa fréquentation du cercle conservateur animé par les frères von Gerlach. Il acquiert une expérience administrative au niveau municipal et provincial jusqu'à ce que, après l'accession de Wilhelm Ier au trône en 1862, il soit appelé à la Diète de Francfort en tant que représentant du souverain. Ses discours étaient caractérisés par un esprit anti-révolutionnaire et démontraient ses qualités oratoires incontestables, comme le montre le livre que nous présentons ici. L'art oratoire de Bismarck, tout en montrant en maints endroits la vaste culture du chancelier, avec des références à Goethe, Lessing, Schiller, Heine, son auteur préféré plus que tout autre, était direct: " il était fondé sur la franchise et l'attaque [...] au-delà de toute pratique rhétorique" (p. III). Il a toujours été conscient du lien entre les choix de politique intérieure et étrangère, en raison de son long séjour en tant qu'ambassadeur à Saint-Pétersbourg et, pour une période plus courte, à Paris. Il se trouvait dans la capitale française lorsqu'il a été rappelé par le nouveau monarque, qui lui a confié la chancellerie.
Dès son premier discours parlementaire, il a exprimé clairement ses idées. L'avenir de la Prusse "devait être réalisé non pas avec des discours, mais par "le fer et le feu", suggérant que l'unification allemande ne serait possible qu'avec une Prusse en armes" (p. V). En 1863, il soutient la répression tsariste des soulèvements polonais. L'opinion publique libérale se dresse alors, ce qui provoque l'affaiblissement politique de Bismarck pendant un moment et conduit à la réapparition des ambitions hégémoniques de François-Joseph.
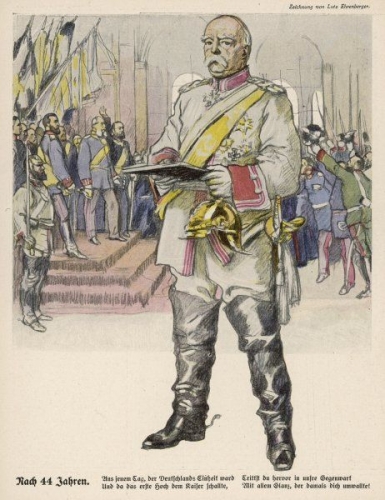
Avec l'habileté d'un grand stratège, le chancelier s'est rapproché de l'Autriche à l'occasion de la guerre avec le Danemark pour la crise des duchés de Schleswig et de Holstein, mais a ensuite fait déclarer la guerre à son allié dans ce qui est pour nous la troisième guerre d'indépendance: "L'empire séculaire des Habsbourg a été démantelé en quelques batailles" (p. VI). Après la victoire, le chancelier a eu le mérite d'apaiser le désir d'anéantir l'Autriche qui grandissait dans les milieux militaires. Afin de devenir la puissance hégémonique en Europe et de procéder à l'unification allemande, la France doit être vaincue. Le signal a été fourni par la crise dynastique espagnole. Bismarck modifie la dépêche d'Ems rédigée par Wilhelm Ier et lui donne une tournure péremptoire.
La France, malgré une tentative du prudent Thiers pour apaiser les esprits, déclare la guerre et subit une défaite retentissante. La nation française, pendant des décennies, a vu monter les esprits de la revanche alors qu'elle se sentait au bord de la fin: désemparée par la défaite militaire et les troubles de la Commune. Pendant ce temps, le Second Reich est en fait né. Wilhelm devient empereur d'Allemagne, couronné à Versailles le 18 janvier. Malgré cela, le chancelier n'a jamais baissé la garde contre la France, convaincu que seul un renforcement militaire allemand garantirait la stabilité politique sur le continent. Selon lui, l'Alsace et la Lorraine sont stratégiquement importantes pour la défense de l'Allemagne. Il devient ainsi un défenseur de l'autonomie alsacienne, déclarant: "plus les habitants de l'Alsace se sentiront alsaciens, plus ils cesseront d'utiliser le français" (p. XVI). Le Kulturkampf, mené contre l'Église catholique et le "Parti du Centre", aliène les sympathies des Alsaciens, fidèles à l'Église de Rome. Cette bataille était essentiellement un conflit de pouvoir: "c'est la lutte entre la monarchie et le sacerdoce [...] Le but qui a toujours clignoté devant les yeux de la papauté était la soumission du pouvoir séculier au spirituel" (p. XVIII). Bismarck, en tant que piétiste, voyait l'autorité divine incarnée par le roi.
Ce n'est qu'avec l'accession de Léon XIII à la papauté qu'un rapprochement s'opère entre les parties. Après s'être mis en congé de la politique, Bismarck fait un retour en force sur la scène publique avec la promulgation de lois anti-socialistes. Influencé par Lassalle et les "socialistes de la chaire", afin d'ôter toute marge de manœuvre aux sociaux-démocrates, il promeut une législation sociale d'avant-garde, annoncée dans son discours du 15 février 1884. En 1883, il avait introduit une loi prévoyant une assurance contre la maladie, en 1884 pour les accidents du travail, et en 1889 pour l'invalidité et la vieillesse. Une sorte de socialisme d'État, de "socialisme prussien", ou, comme l'a dit le chancelier, de "christianisme pratique".
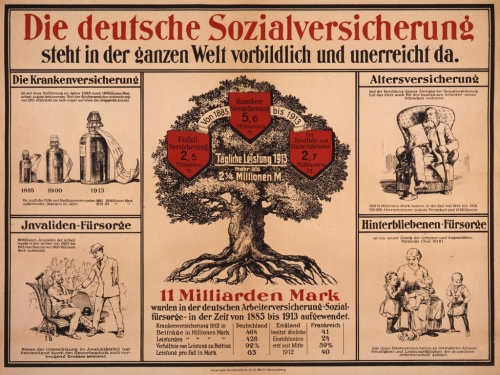
La politique de Bismarck évolue entre deux pôles, qu'il parvient à intégrer de manière dialectique, la tradition et l'innovation. Lorsque les milieux industriels allemands, qui auraient voulu que le Reich s'implique dans la politique coloniale, se sont débarrassés de lui, avec la complicité de Guillaume II, il a cédé la place, comme le confirme ce recueil de discours, celle d'un homme politique d'une grande profondeur, dont l'Europe aurait encore besoin.
Giovanni Sessa.
18:15 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bismarck, livre, histoire, allemagne, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 mars 2022
Les philistins de la culture, vrais barbares modernes (Friedrich Nietzsche)
00:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ego non, philosophie, friedrich nietzsche, allemagne, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 mars 2022
Astolphe de Custine et les racines du conflit entre Russes et Occidentaux
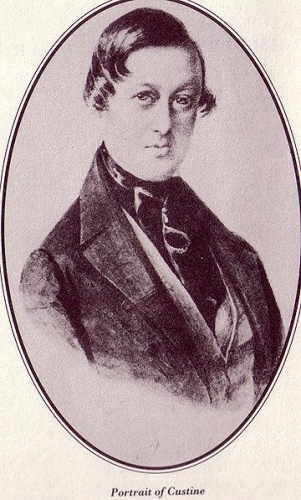
Astolphe de Custine et les racines du conflit entre Russes et Occidentaux
Nicolas Bonnal
Les lettres de Custine sont une démonstration géopolitique du présent permanent : dans les années 1830-40, le « monde moderne » se forme – et comme dit Guénon, au moment où on abuse du mot, la « civilisation » au sens réel et traditionnel disparaît.
A ce moment se crée le combat et le thème de la russophobie. Custine incarne cet ordre libéral à qui la Russie répugne. Et cela donne ces lignes sur le Russe :
«Le despotisme complet, tel qu'il règne chez nous, s'est fondé au moment où le servage s'abolissait dans le reste de l'Europe. Depuis l'invasion des Mongols, les Slaves, jusqu'alors l'un des peuples les plus libres du monde, sont devenus esclaves des vainqueurs d'abord, et ensuite de leurs propres princes. Le servage s'établit alors chez eux non-seulement comme un fait, mais comme une loi constitutive de la société. Il a dégradé la parole humaine en Russie, au point qu'elle n'y est plus considérée que comme un piège: notre gouvernement vit de mensonge, car la vérité fait peur au tyran comme à l'esclave. Aussi quelque peu qu'on parle en Russie, y parle-t-on encore trop, puisque dans ce pays tout discours est l'expression d'une hypocrisie religieuse ou politique".
«L'autocratie, qui n'est qu'une démocratie idolâtre, produit le nivellement tout comme la démocratie absolue le produit dans les républiques simples. »
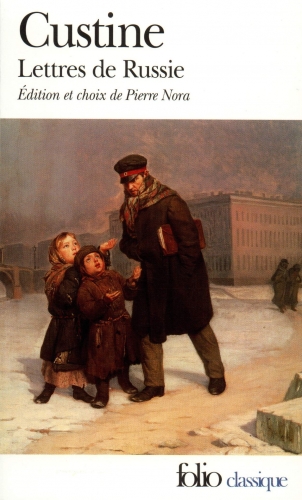
Custine voit déjà le futur « homo sovieticus » de Zinoviev et il décrit le russe comme un automate :
« Ce membre, fonctionnant d'après une volonté qui n'est pas en lui, vit autant qu'un rouage d'horloge; on appelle cela l'homme, en Russie… La vue de ces automates volontaires me fait peur; il y a quelque chose de surnaturel dans un individu réduit à l'état de pure machine. Si, dans les pays où les mécaniques abondent, le bois et le métal nous semblent avoir une âme, sous le despotisme les hommes nous semblent de bois; on se demande ce qu'ils peuvent faire de leur superflu de pensée, et l'on se sent mal à l'aise à l'idée de la force qu'il a fallu exercer contre des créatures intelligentes pour parvenir à en faire des choses; en Russie j'ai pitié des personnes, comme en Angleterre j'avais peur des machines. Là il ne manque aux créations de l'homme que la parole; ici la parole est de trop aux créatures de l'État. »
Petite pointe involontairement humoristique :
« Ces machines, incommodées d'une âme, sont, au reste, d'une politesse épouvantable; on voit qu'elles ont été ployées dès le berceau à la civilité comme au maniement des armes… »
On fait souvent de Poutine un grand joueur d’échecs. Custine écrit déjà :
« Cette population d'automates ressemble à la moitié d'une partie d'échecs, car un seul homme fait jouer toutes les pièces, et l'adversaire invisible, c'est l'humanité. On ne se meut, on ne respire ici que par une permission ou par un ordre impérial; aussi tout est-il sombre et contraint; le silence préside à la vie et la paralyse. Officiers, cochers, cosaques, serfs, courtisans, tous serviteurs du même maître avec des grades divers, obéissent aveuglément à une pensée qu'ils ignorent; c'est un chef-d'œuvre de discipline; mais la vue de ce bel ordre ne me satisfait pas du tout, parce que tant de régularité ne s'obtient que par l'absence complète d'indépendance. »
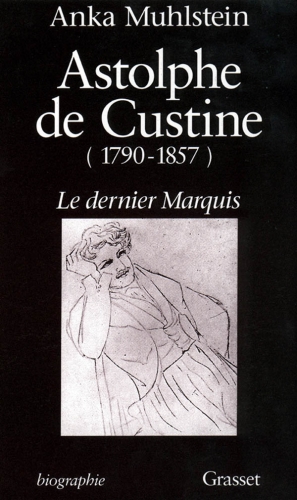
Un seul cerveau contrôle tout le monde :
« Parmi ce peuple privé de loisir et de volonté, on ne voit que des corps sans âmes, et l'on frémit en songeant que, pour une si grande multitude de bras et de jambes, il n'y a qu'une tête. »
Et Custine prévoit aussi la Révolution russe :
« Le pouvoir exorbitant et toujours croissant du maître est la trop juste punition de la faiblesse des grands. Dans l'histoire de Russie personne, hors l'Empereur, n'a fait son métier; la noblesse, le clergé, toutes les classes de la société se sont manqué à elles-mêmes. Un peuple opprimé a toujours mérité sa peine; la tyrannie est l'œuvre des nations. Ou le monde civilisé passera de nouveau avant cinquante ans sous le joug des barbares, ou la Russie subira une révolution plus terrible que ne le fut la révolution dont l'Occident de l'Europe ressent encore les effets. »
Ceci dit il prévoit une guerre avec supériorité russe à la clé :
« Lorsque notre démocratie cosmopolite, portant ses derniers fruits, aura fait de la guerre une chose odieuse à des populations entières, lorsque les nations, soi-disant les plus civilisées de la terre, auront achevé de s'énerver dans leurs débauches politiques, et que de chute en chute elles seront tombées dans le sommeil au dedans et dans le mépris au dehors, toute alliance étant reconnue impossible avec ces sociétés évanouies dans l'égoïsme, les écluses du Nord se lèveront de nouveau sur nous, alors nous subirons une dernière invasion non plus de barbares ignorants, mais de maîtres rusés, éclairés, plus éclairés que nous, car ils auront appris de nos propres excès comment on peut et l'on doit nous gouverner. »
Une génération plus tard Ernest Renan écrira à ce propos :
« Le Slave, dans cinquante ans, saura que c’est vous qui avez fait son nom synonyme d’esclave : il verra cette longue exploitation historique de sa race par la vôtre, et le nombre du Slave est le double du vôtre, et le Slave, comme le dragon de l’Apocalypse dont la queue balaye la troisième partie des étoiles, traînera un jour après lui le troupeau de l’Asie centrale, l’ancienne clientèle des Gengis Khan et Tamerlan. »
https://www.gutenberg.org/ebooks/25755
https://www.les4verites.com/culture-4v/1870-la-prophetie-...
11:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : russophobie, astolphe de custine, 19ème siècle, russie, france, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 février 2022
La nation, socle d'éternité à travers les générations (J. G. Fichte)
17:19 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ego non, philosophie, johann gottlob fichte, fichte, allemagne, 19ème siècle, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook