vendredi, 30 octobre 2015
Internet est-il la nouvelle frontière du néo-libéralisme ?...

Internet est-il la nouvelle frontière du néo-libéralisme?...
Entretien avec Evgeny Morozov
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Evgeny Morozov à Rue 89 et cueilli sur le site Les Crises. Chercheur et essayiste, Evgeny Morozov étudie les conséquences sociales et politiques des nouvelles technologie
Morozov : « Internet est la nouvelle frontière du néolibéralisme »
Selon le chercheur et essayiste Evgeny Morozov, la technologie sert le néolibéralisme et la domination des Etats-Unis. « Il faut considérer la Silicon Valley comme un projet politique et l’affronter en tant que tel », dit-il.
Evgeny Morozov s’est imposé en quelques années comme l’un des contempteurs les plus féroces de la Silicon Valley. A travers trois ouvrages – « The Net Delusion » (2011, non traduit en français), « Pour tout résoudre, cliquez ici » (2014, FYP éditions) et « Le Mirage numérique » (qui paraît ces jours-ci aux Prairies ordinaires) –, à travers une multitudes d’articles publiés dans la presse du monde entier et des interventions partout où on l’invite, il se fait le porteur d’une critique radicale envers la technologie en tant qu’elle sert la domination des Etats-Unis.
A 31 ans, originaire de Biélorussie, il apprend toutes les langues, donne l’impression d’avoir tout lu, ne se trouve pas beaucoup d’égal et maîtrise sa communication avec un mélange de charme et de froideur toujours désarmant.
L’écouter est une expérience stimulante car il pense largement et brasse aussi bien des références historiques de la pensée (Marx, Simondon…) que l’actualité la plus récente et la plus locale. On se demande toujours ce qui, dans ses propos, est de l’ordre de la posture, d’un agenda indécelable, ou de la virtuosité d’un esprit qui réfléchit très vite, et « worldwide » (à moins que ce soit tout ça ensemble).
Nous nous sommes retrouvés dans un aérogare de Roissy-Charles-de-Gaulle, il était entre deux avions. Nous avons erré pour trouver une salade niçoise, car il voulait absolument une salade niçoise.
Rue89 : Est-ce qu’on se trompe en ayant l’impression que vous êtes de plus en plus radical dans votre critique de la Silicon Valley ?
Evgeny Morozov : Non. Je suis en effet plus radical qu’au début. Mais parce que j’étais dans une forme de confusion, je doutais de ce qu’il fallait faire et penser. J’ai aujourd’hui dépassé cette confusion en comprenant que la Silicon Valley était au centre de ce qui nous arrive, qu’il fallait comprendre sa logique profonde, mais aussi l’intégrer dans un contexte plus large.
Or, la plupart des critiques ne font pas ce travail. Uber, Apple, Microsoft, Google, sont les conséquences de phénomènes de long terme, ils agissent au cœur de notre culture. Il faut bien comprendre que ces entreprises n’existeraient pas – et leur modèle consistant à valoriser nos données personnelles serait impossible – si toute une série de choses n’avaient pas eu lieu : par exemple, la privatisation des entreprises télécoms ou l’amoncellement de données par d’énormes chaînes de grands magasins.
Cette histoire, il faut la raconter de manière plus politique et plus radicale. Il faut traiter cela comme un ensemble, qui existe dans un certain contexte.
Et ce contexte, c’est, il faut le dire, le néolibéralisme. Internet est la nouvelle frontière du néolibéralisme.
Le travail critique de la Silicon Valley ne suffit pas. Il faut expliquer que le néolibéralisme qu’elle promeut n’est pas désirable. Il faut expliquer que :
- A : le néolibéralisme est un problème ;
- B : il y a des alternatives.
Il faut travailler à l’émergence d’une gauche qui se dresse contre ce néolibéralisme qui s’insinue notamment par les technologies.
Le travail que fait Podemos en Espagne est intéressant. Mais voir les plateformes seulement comme un moyen de se passer des anciens médias et de promouvoir un renouvellement démocratique ne suffit pas. Il faut aller plus en profondeur et comprendre comment les technologies agissent sur la politique, et ça, Podemos, comme tous les mouvements de gauche radicale en Europe, ne le fait pas.
Mais vous voyez des endroits où ce travail est fait ?
En Amérique latine, on voit émerger ce type de travail. En Argentine, en Bolivie, en Equateur, on peut en voir des ébauches.
En Equateur par exemple, où la question de la souveraineté est essentielle – notamment parce que l’économie reste très dépendante du dollar américain -,- on l’a vue s’articuler à un mouvement en faveur d’une souveraineté technologique.
Mais on ne voit pas de tels mouvements en Europe. C’est certain.
La Silicon Valley va au-delà de tout ce qu’on avait connu auparavant en termes d’impérialisme économique. La Silicon Valley dépasse largement ce qu’on considérait auparavant comme les paragons du néolibéralisme américain – McDonald’s par exemple – car elle affecte tous les secteurs de notre vie.
C’est pourquoi il faut imaginer un projet politique qui rénove en fond notre conception de la politique et de l’économie, un projet qui intègre la question des infrastructures en garantissant leur indépendance par rapport aux Etats-Unis.
Mais si je suis pessimiste quant à l’avenir de l’Europe, c’est moins à cause de son impensée technologique que de l’absence flagrante d’esprit de rébellion qui l’anime aujourd’hui.
Mais est-ce que votre dénonciation tous azimuts de la Silicon Valley ne surestime pas la place de la technologie dans nos vies ? Il y a bien des lieux de nos vies – et ô combien importants – qui ne sont pas ou peu affectés par la technologie…
Je me permets d’être un peu dramatique car je parle de choses fondamentales comme le travail, l’éducation, la santé, la sécurité, les assurances. Dans tous ces secteurs, des changements majeurs sont en train d’avoir lieu et cela va continuer. La nature humaine, ça n’est pas vraiment mon objet, je m’intéresse plus à ses conditions d’existence.
Et puis je suis obligé de constater que la plupart des changements que j’ai pu annoncés il y a quelques années sont en train d’avoir lieu. Donc je ne pense pas surestimer la force de la Silicon Valley.
D’ailleurs, ce ne sont pas les modes de vie que je critique. Ce qui m’intéresse, ce sont les discours de la Silicon Valley, ce sont les buts qu’elle se donne. Peu importe si, au moment où j’en parle, ce sont seulement 2% de la population qui utilisent un service. Il se peut qu’un jour, ce soient 20% de la population qui l’utilisent. Cette possibilité à elle seule justifie d’en faire la critique.
D’accord, mais en vous intéressant à des discours, ne prenez-vous pas le risque de leur donner trop de crédit ? Dans bien des cas, ce ne sont que des discours.
En effet, on peut toujours se dire que tout ça ne marchera pas. Mais ce n’est pas la bonne manière de faire. Car d’autres y croient.
Regardez par exemple ce qui se passe avec ce qu’on appelle les « smart cities ». Quand vous regardez dans le détail ce qui est vendu aux villes, c’est d’une pauvreté confondante. Le problème, c’est que les villes y croient et paient pour ça. Elles croient à cette idée du logiciel qui va faire que tout fonctionne mieux, et plus rationnellement. Donc si la technologie en elle-même ne marche pas vraiment, le discours, lui, fonctionne à plein. Et ce discours porte un agenda propre.
Il est intéressant de regarder ce qui s’est passé avec la reconnaissance faciale. Il y a presque quinze ans, dans la suite du 11 Septembre, les grandes entreprises sont allées vendre aux Etats le discours de la reconnaissance faciale comme solution à tous leurs problèmes de sécurité. Or, à l’époque, la reconnaissance faciale ne marchait absolument pas. Mais avec tout l’argent des contrats, ces entreprises ont investi dans la recherche, et aujourd’hui, la reconnaissance faciale marche. Et c’est un énorme problème. Il faut prendre en compte le caractère autoréalisateur du discours technologique.

Quelle stratégie adopter ?
Il faut considérer la Silicon Valley comme un projet politique, et l’affronter en tant que tel.
Ça veut donc dire qu’un projet politique concurrent sera forcément un projet technologique aussi ?
Oui, mais il n’existe pas d’alternative à Google qui puisse être fabriquée par Linux. La domination de Google ne provient pas seulement de sa part logicielle, mais aussi d’une infrastructure qui recueille et stocke les données, de capteurs et d’autres machines très matérielles. Une alternative ne peut pas seulement être logicielle, elle doit aussi être hardware.
Donc, à l’exception peut-être de la Chine, aucun Etat ne peut construire cette alternative à Google, ça ne peut être qu’un ensemble de pays.
Mais c’est un défi gigantesque parce qu’il comporte deux aspects :
- un aspect impérialiste : Facebook, Google, Apple, IBM sont très liés aux intérêts extérieurs des Etats-Unis. En son cœur même, la politique économique américaine dépend aujourd’hui de ces entreprises. Un réflexe d’ordre souverainiste se heurterait frontalement à ces intérêts et serait donc voué à l’échec car il n’existe aucun gouvernement aujourd’hui qui soit prêt à affronter les Etats-Unis ;
- un aspect philosophico-politique : on a pris l’habitude de parler de « post-capitalisme » en parlant de l’idéologie de la Silicon Valley, mais on devrait parler de « post-sociale-démocratie ».
Car quand on regarde comment fonctionne Uber – sans embaucher, en n’assumant aucune des fonctions de protection minimale du travailleur –, quand on regarde les processus d’individualisation des assurances de santé – où revient à la charge de l’assuré de contrôler ses paramètres de santé –, on s’aperçoit à quel point le marché est seul juge.
L’Etat non seulement l’accepte, mais se contente de réguler. Est complètement oubliée la solidarité, qui est au fondement de la sociale-démocratie. Qui sait encore que dans le prix que nous payons un taxi, une part – minime certes – sert à subventionner le transport des malvoyants ? Vous imaginez imposer ça à Uber….
Il faut lire le livre d’Alain Supiot, « La Gouvernance par les nombres » (Fayard, 2015), il a tout juste : nous sommes passés d’un capitalisme tempéré par un compromis social-démocrate à un capitalisme sans protection. C’est donc qu’on en a bien fini avec la sociale-démocratie.
Ce qui m’intrigue, si l’on suit votre raisonnement, c’est : comment on a accepté cela ?
Mais parce que la gauche en Europe est dévastée ! Il suffit de regarder comment, avec le feuilleton grec de cet été, les gauches européennes en ont appelé à la Commission européenne, qui n’est pas une grande défenseure des solidarités, pour sauver l’Europe.
Aujourd’hui, la gauche a fait sienne la logique de l’innovation et de la compétition, elle ne parle plus de justice ou d’égalité.
La Commission européenne est aujourd’hui – on le voit dans les négociations de l’accord Tafta – l’avocate d’un marché de la donnée libre, c’est incroyable ! Son unique objectif est de promouvoir la croissance économique. Si la vie privée est un obstacle à la croissance, il faut la faire sauter !
D’accord, mais je repose alors ma question : comment on en est venus à accepter cela ?
Certains l’ont fait avec plaisir, d’autres avec angoisse, la plupart avec confusion.
Car certains à gauche – notamment dans la gauche radicale – ont pu croire que la Silicon Valley était une alliée dans le mesure où ils avaient un ennemi commun en la personne des médias de masse. Il est facile de croire dans cette idée fausse que les technologies promues par la Silicon Valley permettront l’émergence d’un autre discours.
On a accepté cela comme on accepte toujours les idées dominantes, parce qu’on est convaincus. Ça vient parfois de très loin. L’Europe occidentale vit encore avec l’idée que les Américains ont été des libérateurs, qu’ils ont ensuite été ceux qui ont empêché le communisme de conquérir l’Europe. L’installation de la domination idéologique américaine – de McDonald’s à la Silicon Valley – s’est faite sur ce terreau.
Il y a beaucoup de confusion dans cette Histoire. Il faut donc théoriser la technologie dans un cadre géopolitique et économique global.
En Europe, on a tendance à faire une critique psychologique, philosophique (comme on peut le voir en France chez des gens comme Simondon ouStiegler). C’est très bien pour comprendre ce qui se passe dans les consciences. Mais il faut monter d’un niveau et regarder ce qui se passe dans les infrastructures, il faut élargir le point de vue.
Il faut oser répondre simplement à la question : Google, c’est bien ou pas ?
Aux Etats-Unis, on a tendance à répondre à la question sur un plan juridique, en imposant des concepts tels que la neutralité du Net. Mais qu’on s’appuie en Europe sur ce concept est encore un signe de la suprématie américaine car, au fond, la neutralité du Net prend racine dans l’idée de Roosevelt d’un Etat qui n’est là que pour réguler le marché d’un point de vue légal.
Il faut aller plus loin et voir comment nous avons succombé à une intériorisation de l’idéologie libérale jusque dans nos infrastructures technologiques.
Et c’est peut-être en Amérique latine, comme je vous le disais tout à l’heure, qu’on trouve la pensée la plus intéressante. Eux sont des marxistes qui n’ont pas lu Simondon. Ils se donnent la liberté de penser des alternatives.
Pour vous, le marxisme reste donc un cadre de pensée opérant aujourd’hui pour agir contre la Silicon Valley ?
En tant qu’il permet de penser les questions liées au travail ou à la valeur, oui. Ces concepts doivent être utilisés. Mais il ne s’agit pas de faire une transposition mécanique. Tout ce qui concerne les données – et qui est essentiel aujourd’hui – n’est évidemment pas dans Marx. Il faut le trouver ailleurs.
Evgeny Morozov (Rue 89, 4 octobre 2015)
00:05 Publié dans Economie, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, internet, entretien, informatique, e-business |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Diplomaţia lui Stalin

Diplomaţia lui Stalin
Ex: http://www.estica.eu
Istoria secolului nostru este învăţată din punctul de vedere american. La fel este şi în cazul celui de-al doilea Război Mondial, al Războiului Rece şi al Războiului din Golf. În optica americană, secolul XXI este “secolul american”, în care trebuie să se instaleze şi să se menţină o ordine mondială conform cu interesele americane, secol care este simultan “sfârşitul istoriei”, sfârşitul aventurii umane, sinteza definitivă a dialecticii istoriei. Francis Fukuyama, chiar înainte de războiul din Golf, afirma că odată cu căderea Cortinei de Fier şi sfârşitul “hegelianismului de stânga” pe care îl reprezenta URSS-ul, un singur model, cel al liberalismului american, va subzista secole de-a rândul. Cu condiţia ca niciun competitor să nu se zărească la orizont. De unde misiunea americană era aceea de a reacţiona rapid, mobilizând maximum de mijloace, contra oricărei veleităţi de a construi o ordine politică alternativă.
Cu câţiva ani înainte de Fukuyama, un autor germano-american, Theodore H. von Laue, pretindea că singura revoluţie veritabilă în lume şi în istorie era aceea a occidentalizării şi că toate revoluţiile politice non-occidentaliste, toate regimurile bazate pe alte principii decât cele în vogă în America, erau relicve ale trecutului, pe care numai nişte reacţionari perverşi le puteau adula, reacţionari pe care puterea americană, economică şi militară, urma să le măture rapid pentru a face loc unui hiper-liberalism de factură anglo-saxonă, debarasat de orice concurenţă.
Dacă hitlerismul este în mod general considerat ca o forţă reacţionară perversă faţă de care America a contribuit la eliminarea din Europa, se ştiu mai puţin motivele care l-au împins pe Truman şi pe protagoniştii atlantişti ai Războiului Rece să lupte contra stalinismului şi să facă din el un căpcăun ideologic, considerat explicit de către von Laue drept „reacţionar” în ciuda etichetei sale proprii de „progresist”. Această ambiguitate faţă de Stalin se explică prin alianţa americano-sovietică în timpul celui de-al Doilea Război mondial, când Stalin era supranumit în mod prietenos “Uncle Joe”. Cu toate acestea, de câţiva ani, numeroşi istorici revăd în mod inteligent poncifele pe care patruzeci şi cinci de ani de atlantism furibund le-au vehiculat în mass-media şi în cărţile noastre de istorie. Germanul Dirk Bavendamm a demonstrat în două lucrări meticuloase şi precise care au fost responsabilităţile lui Roosevelt în declanşarea conflictelor americano-japonez şi americano-german şi de asemenea care era duplicitatea preşedintelui american faţă de aliaţii săi ruşi. Valentin Falin, fostul ambasador al URSS-ului la Bonn, a publicat în Germania o lucrare de amintiri istorice şi de reflecţii istoriografice, în care acest briliant diplomat rus afirmă că Războiul Rece a început imediat după debarcarea anglo-americană din iunie 1944 pe plajele din Normandia: desfăşurându-şi armada lor navală şi aeriană, puterile occidentale duceau deja un război mai ales contra Uniunii Sovietice şi nu contra Germaniei muribunde.
O lectură atentă a mai multor lucrări recente consacrate multiplelor aspecte ale rezistenţei germane contra regimului hitlerist ne obligă să renunţăm definitiv la interpretarea istoriei celui de-al Doilea Război mondial şi a alianţei anglo-americano-sovietice după modelul convenţional. Ostilitatea faţă de Stalin după 1945 provine mai ales din faptul că Stalin înţelegea să practice o diplomaţie generală bazată pe relaţiile bilaterale între naţiuni, fără ca acestea să fie supervizate de o instanţă universală cum ar fi ONU. Apoi, după ce şi-a dat seama că cele două puteri anglo-saxone deciseseră singure la Casablanca să facă războiul excesiv cu Reich-ul, să declanşeze războiul total şi să ceară capitularea fără condiţii a Germaniei naţional-socialiste, Stalin s-a simţit exclus de aliaţii săi. Furios, el şi-a concentrat mânia în această frază bine ticluită, în aparenţă anodină, dar foarte semnificativă: „Hitlerii vin şi se duc, poporul şi statul german rămân”. Stalin nu considera naţional-socialismul hitlerist ca pe răul absolut sau chiar ca pe o esenţă netrecătoare, ci ca pe un accident al istoriei, o vicisitudine potrivnică Rusiei eterne, pe care armatele sovietice urmau pur şi simplu să caute s-o elimine. Dar, în logica diplomatică tradiţională, care îi aparţinea lui Stalin, în ciuda ideologiei mesianice marxiste, naţiunile nu pier: nu trebuie prin urmare să ceri o capitulare necondiţionată şi trebuie mereu să laşi poarta deschisă unor negocieri. În plin război, alianţele se pot schimba cu totul, aşa cum o arată clar istoria europeană. Stalin se mulţumeşte să ceară deschiderea unui al doilea front pentru a uşura misiunea armatelor sovietice şi a diminua pierderile de vieţi omeneşti în rândul ruşilor, dar acest front nu vine decât foarte târziu, ceea ce-i permite lui Valentin Falin să explice această întârziere ca pe primul act al Războiului Rece între puterile maritime anglo-saxone şi puterea continentală sovietică.
Această reticenţă a lui Stalin se explică şi prin contextul care a precedat imediat epilogul lungii bătălii de la Stalingrad şi debarcarea anglo-saxonă în Normandia. Când armatele lui Hitler şi ale aliaţilor săi slovaci, finlandezi, români şi unguri au intrat în URSS în 22 iunie 1941, sovieticii, oficial, au estimat că clauzele Pactului Molotov/Ribbentrop au fost trădate şi, în toamna lui 1942, după gigantica ofensivă victorioasă a armatelor germane în direcţia Caucazului, Moscova a fost constrânsă să sondeze adversarul său în vederea unei eventuale păci separate: Stalin dorea să se revină la termenii Pactului şi conta pe ajutorul japonezilor pentru a reconstitui, în masa continentală eurasiatică, acel „car cu patru cai” pe care i-l propusese Ribbentrop în septembrie 1940 (sau „Pactul Cvadripartit” între Reich, Italia, URSS şi Japonia). Stalin dorea o pace nulă: Wehrmacht-ul să se retragă dincolo de frontiera fixată de comun acord în 1939 şi URSS-ul să-şi panseze rănile. Mai mulţi agenţi au participat la aceste negocieri, ce au rămas în general secrete. Printre ei, Peter Kleist, ataşat în acelaşi timp de Cabinetul lui Ribbentrop şi de „Biroul Rosenberg”. Kleist, naţionalist german de tradiţie rusofilă în amintirea prieteniei dintre Prusia şi Ţari, va negocia la Stockholm, unde jocul diplomatic va fi strâns şi complex. În capitala suedeză, ruşii sunt deschişi la toate sugestiile; printre ei, ambasadoarea Kollontaï şi diplomatul Semionov. Kleist acţionează în numele Cabinetului Ribbentrop şi al Abwehr-ului lui Canaris (şi nu al „Biroului Rosenberg” care avea în vedere o balcanizare a URSS-ului şi crearea unui puternic stat ucrainean pentru a contrabalansa „Moscovia”). Al doilea protagonist al părţii germane a fost Edgar Klaus, un evreu din Riga care făcea legătura între sovietici şi Abwehr (el nu avea relaţii directe cu instanţele propriu-zis naţional socialiste).
În acest joc mai mult sau mai puţin triangular, sovieticii doreau revenirea la status-quo-ul de dinainte de 1939. Hitler a refuzat toate sugestiile lui Kleist şi a crezut că poate câştiga definitiv bătălia prin cucerirea Stalingradului, cheie a fluviului Volga, a Caucazului şi a Caspicii. Kleist, care ştia că o încetare a ostilităţilor cu Rusia ar fi permis Germaniei să rămână dominantă în Europa şi să-şi îndrepte toate forţele contra britanicilor şi americanilor, trece atunci de partea elementelor active ale rezistenţei anti-hitleriene, chiar dacă este personal dator instanţelor naţional-socialiste! Kleist îi contactează deci pe Adam von Trott zu Solz şi pe fostul ambasador al Reich-ului la Moscova, von der Schulenburg. El nu se adresează comuniştilor şi estimează, fără îndoială odată cu Canaris, că negocierile cu Stalin vor permite realizarea Europei lui Coudenhove-Kalergi (fără Anglia şi fără Rusia), pe care o visau de asemenea şi catolicii. Dar sovieticii nu se adresează nici ei aliaţilor lor teoretici şi privilegiaţi, comuniştii germani: ei pariază pe vechea gardă aristocratică, unde exista încă amintirea alianţei prusacilor şi ruşilor contra lui Napoleon, ca şi cea a neutralităţii tacite a germanilor în timpul Războiului Crimeii. Cum Hitler refuză orice negociere, Stalin, rezistenţa aristocratică, Abwehr-ul şi chiar o parte a gărzii sale pretoriene, SS-ul, decid că el trebuie să dispară. Aici trebuie văzută originea complotului care va duce la atentatul din 20 iulie 1944.
Dar după iarna lui 42-43, sovieticii au revenit la Stalingrad şi au distrus vârful de lance al Wehrmacht-ului, armata a şasea, care încercuia metropola de pe Volga. Partida germană a sovieticilor va fi atunci constituită de „Comitetul Germania Liberă”, cu mareşalul von Paulus şi cu ofiţeri ca von Seydlitz-Kurzbach, toţi prizonieri de război. Stalin nu avea în continuare încredere în comuniştii germani, din rândul cărora a eliminat ideologii nerealişti şi revoluţionarii maximalişti troţkişti, care au ignorat mereu deliberat, din orbire ideologică, noţiunea de „patrie” şi continuităţile istorice multiseculare; finalmente, dictatorul georgian nu l-a păstrat în rezervă, ca bun la toate, decât pe Pieck, un militant care nu şi-a pus niciodată prea multe întrebări. Pieck va face carieră în viitoarea RDG. Stalin nu visa nici un regim comunist pentru Germania post-hitleriană: el dorea o „ordine democratică forte”, cu o putere executivă mai marcată decât sub Republica de la Weimar. Această dorinţă politică a lui Stalin corespunde perfect alegerii sale iniţiale: pariul pe elitele militare, diplomatice şi politice conservatoare, provenind în majoritate din aristocraţie şi din Obrigkeitsstaat-ul[1] prusac. Democraţia germană, care trebuia să vină după Hitler, în opinia lui Stalin, urma să fie de ideologie conservatoare, cu o fluiditate democratică controlată, canalizată şi încadrată de un sistem de educaţie politică strictă.
Britanicii şi americanii au fost surprinşi: ei crezuseră că „Unchiul Joe” va înghiţi fără probleme politica lor maximalistă, ruptă total de uzanţele democratice în vigoare în Europa. Dar Stalin, ca şi Papa şi Bell, episcopul de Chichester, se opuneau principiului revoluţionar al predării necondiţionate pe care Churchill şi Roosevelt au vrut s-o impună Reich-ului (care va rămâne, cum gândea Stalin, în calitate de principiu politic în ciuda prezenţei efemere a unui Hitler). Dacă Roosevelt, făcând apel la dictatura mediatică pe care o controla bine în Statele Unite, a reuşit să-şi reducă adversarii la tăcere, indiferent de ideologie, Churchill a avut mai mari dificultăţi în Anglia. Principalul său adversar era acest Bell, episcop de Chichester. Pentru acesta din urmă, nu se punea problema de a reduce Germania la neant, căci Germania era patria lui Luther şi a protestantismului. Filosofiei predării necondiţionate a lui Churchill, Bell îi opunea noţiunea unei solidarităţi protestante şi-i punea în gardă pe omologii săi olandezi, danezi, norvegieni şi suedezi, ca şi pe interlocutorii săi din rezistenţa germană (Bonhoeffer, Schönfeld, von Moltke), pentru a face faţă belicismului exagerat al lui Churchill, care se exprima prin bombardarea masivă a obiectivelor civile, chiar şi în oraşe mici fără infrastructură industrială importantă. Pentru Bell, viitorul Germaniei nu era nici nazismul nici comunismul, ci o „ordine liberală şi democratică”. Această soluţie, preconizată de episcopul de Chichester, nu era evident acceptabilă de către naţionalismul german tradiţional: ea constituia o întoarcere subtilă la Kleinstaaterei, la mozaicul de state, principate şi ducate, pe care viziunile lui List, Wagner etc. şi pumnul lui Bismarck le şterseseră din centrul continentului nostru. „Ordinea democratică forte” sugerată de Stalin era mai acceptabilă pentru naţionaliştii germani, al căror obiectiv a fost mereu crearea unor instituţii şi a unei paidei puternice pentru a proteja poporul german, substanţa etnică germană, de propriile sale slăbiciuni politice, de lipsa simţului său de decizie, de particularismul său atavic şi de durerile sale morale incapacitante. Astăzi, evident, mulţi observatori naţionalişti constată că federalismul constituţiei din 1949 se înscrie poate destul de bine în tradiţia juridică constituţională germană, dar forma pe care a luat-o, în cursul istoriei RFG-ului, îi relevă natura sa de „concesie”. O concesie a puterilor anglo-saxone…

În faţa adversarilor capitulării necondiţionate din sânul coaliţiei antihitleriste, rezistenţa germană a rămas în ambiguitate: Beck şi von Hassel sunt pro-occidentali şi vor să urmeze cruciada anti-bolşevică, dar într-un sens creştin; Goerdeler şi von der Schulenburg sunt în favoarea unei păci separate cu Stalin. Claus von Stauffenberg, autorul atentatului din 20 iulie 1944 contra lui Hitler, provenea din cercurile poetico-ezoterice din München, unde poetul Stefan George juca un rol preponderent. Stauffenberg este un idealist, un „cavaler al Germaniei secrete”: el refuză să dialogheze cu „Comitetul Germania Liberă” al lui von Paulus şi von Seydlitz-Kurzbach: „nu putem avea încredere în proclamaţiile făcute din spatele sârmei ghimpate”.
Adepţii unei păci separate cu Stalin, adversari ai deschiderii unui front spre Est, au fost imediat atenţi la propunerile de pace sovietice emise de agenţii la post în Stockholm. Partizanii unei „partide nule” la Est sunt ideologic „anti-occidentali”, aparţinând cercurilor conservatoare rusofile (cum ar fi Juni-Klub sau acei Jungkonservativen din siajul lui Moeller van den Bruck), ligilor naţional-revoluţionare derivate din Wandervogel sau „naţionalismului soldăţesc”. Speranţa lor era de a vedea Wehrmacht-ul retrăgându-se în ordine din teritoriile cucerite în URSS şi de a se replia dincolo de linia de demarcaţie din octombrie 1939 în Polonia. În acest sens interpretează exegeţii contemporani ai operei lui Ernst Jünger faimosul său text de război intitulat „Note caucaziene”. Ernst Jünger percepe aici dificultăţile de a stabiliza un front în imensele stepe de dincolo de Don, unde gigantismul teritoriului interzice o reţea militară ermetică ca într-un peisaj central-european sau de tip picard-champenoise, muncit şi răsmuncit de generaţii şi generaţii de mici ţărani încăpăţânaţi care au ţesut teritoriul cu îngrădituri, proprietăţi, garduri şi construcţii de o rară densitate, permiţând armatelor să se prindă de teren, să se disimuleze sau să întindă ambuscade. Este foarte probabil ca Jünger să fi pledat pentru retragerea Wehrmacht-ului, sperând, în logica naţional-revoluţionară, care îi era proprie în anii 20 sau 30, şi unde rusofilia politico-diplomatică era foarte prezentă, ca forţele ruseşti şi germane, reconciliate, să interzică pentru totdeauna accesul în „Fortăreaţa Europa”, chiar în „Fortăreaţa Eurasia” puterilor talasocratice, care practică sistematic ceea ce Haushofer numea „politica anacondei”, pentru a sufoca orice veleitate de independenţă pe marginile litorale ale „Marelui Continent” (Europa, India, ţările arabe etc.).
Ernst Jünger redactează notele sale caucaziene în momentul în care Stalingradul cade şi armata a şasea este înecată în sânge, oroare şi zăpadă. Dar în ciuda victoriei de la Stalingrad, care le permite sovieticilor să bareze calea spre Caucaz şi Marea Caspică germanilor şi să impiedice orice manevră în amontele fluviului, Stalin urmează mai departe negocierile sale sperând în continuare să joace o „partidă nulă”. Sovieticii nu pun un termen demersurilor lor decât după întrevederile de la Teheran (28 noimebrie – 1 decembrie 1943). În acel moment, Jünger pare a se fi retras din rezistenţă. În celebrul său interviu din Spiegel din 1982, imediat după ce primise premiul Goethe la Frankfurt, el declara: „Atentatele întăresc regimurile pe care vor să le dărâme, mai ales dacă sunt ratate”. Jünger, fără îndoială ca şi Rommel, refuza logica atentatului. Ceea ce nu a fost cazul cu Claus von Stauffenberg. Deciziile luate de către aliaţii occidentali şi de către sovietici la Teheran au făcut imposibilă revenirea la punctul de pornire, adică la linia de demarcaţie din octombrie 1939 în Polonia. Sovieticii şi anglo-saxonii s-au pus de acord să „transporte dulapul polonez” spre Vest prin cedarea unei zone de ocupaţie permanentă în Silezia şi în Pomerania. În atari condiţii, naţionaliştii germani nu mai puteau negocia iar Stalin era din oficiu prins în logica maximalistă a lui Roosevelt, în vreme ce la început o refuzase. Poporul rus urma să plătească foarte scump această schimbare de politică, favorabilă americanilor.
După 1945, constatând că logica Războiului Rece vizează încercuirea şi izolarea Uniunii Sovietice pentru a o împiedica să ajungă la mările calde, Stalin a reiterat oferta sa Germaniei epuizate şi divizate: unificarea şi neutralitatea, adică libertatea de a-şi alege regimul politic după placul său, mai ales o „ordine democratică forte”. Acesta va fi obiectul „notelor lui Stalin” din 1952. Decesul prematur al Vojd-ului sovietic în 1953 nu a mai permis URSS-ului să continue să joace această carte germană. Hruşciov a denunţat stalinismul, a apăsat pe logica blocurilor pe care Stalin o refuzase şi nu a revenit la antiamericanism decât în momentul afacerii Berlinului (1961) şi a crizei din Cuba (1962). Nu se va mai vorbi despre „notele lui Stalin” decât înainte de perestroika, în timpul manifestaţiilor pacifiste din 1980-1983, când mai multe voci germane au reclamat afirmarea unei neutralităţi în afara oricărei logici de tip bloc. Unii emisari ai lui Gorbaciov vor mai vorbi despre acele note şi după 1985, mai ales germanistul Viatcheslav Dachitchev, care a luat cuvântul peste tot în Germania, chiar şi în câteva cercuri ultra-naţionaliste.
În lumina acestei noi istorii a rezistenţei germane şi a belicismului american, putem să înţelegem într-un mod diferit stalinismul şi anti-stalinismul. Acesta din urmă, de exemplu, serveşte la răspândirea unei mitologii politice false şi artificiale, al cărei obiectiv ultim este să respingă orice formă de concert internaţional bazat pe relaţiile bilaterale, să impună o logică a blocurilor sau o logică mondialistă prin intermediul acestui instrument rooseveltian care este ONU (Coreea, Congo, Irak: mereu fără Rusia!), să stigmatizeze din start orice raport bilateral între o putere medie europeană şi Rusia sovietică (Germania în 1952 şi Franţa lui De Gaulle după evenimentele din Algeria). Antistalinismul este o variantă a discursului mondialist. Diplomaţia stalinistă era, în felul ei şi într-un context foarte particular, păstrătoare a tradiţiilor diplomatice europene.
Bibliografie:
– Dirk BAVENDAMM, Roosevelts Weg zum Krieg. Amerikanische Politik 1914-1939, Herbig, München, 1983.
– Dirk BAVENDAMM, Roosevelts Krieg 1937-45 und das Rätsel von Pearl Harbour, Herbig, München, 1993.
– Valentin FALIN, Zweite Front. Die Interessenkonflikte in der Anti-Hitler-Koalition, Droemer-Knaur, München, 1995.
– Francis FUKUYAMA, La fin de l’histoire et le dernier homme, Flammarion, 1992.
– Klemens von KLEMPERER, German Resistance Against Hitler. The Search for Allies Abroad. 1938-1945, Oxford University Press/Clarendon Press, 1992-94.
– Theodore H. von LAUE, The World Revolution of Westernization. The Twentieth Century in Global Perspective, Oxford University Press, 1987.
– Jürgen SCHMÄDEKE/Peter STEINBACH (Hrsg.), Der Widerstand gegen den National-Sozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, Piper (SP n°1923), München, 1994.
Traducere: Vladimir Muscalu
Sursa: http://robertsteuckers.blogspot.ro/2011/12/normal-0-21-false-false-false_29.html
[1] Statul autoritar (n. tr.)
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, urss, staline, diplomatie, politique internationale, allemagne, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le fascisme : un « étymon spirituel » à découvrir ?

Le fascisme: un «étymon spirituel» à découvrir?
Sur le dernier ouvrage de Philippe Baillet
par Daniel COLOGNE
Note de la rédaction: Daniel Cologne rend ici hommage à Philippe Baillet qu'il a côtoyé notamment au "Cercle Culture & Liberté", structure qui a précédé la création de la revue évolienne "Totalité" (1977), dirigée ultérieurement par Georges Gondinet. Philippe Baillet, traducteur de Julius Evola, a été par la suite secrétaire de rédaction de "Nouvelle école", avant d'être évincé par le directeur de cette publication, qui pratiquait là son sport favori. L'intérêt du nouveau livre de Baillet réside surtout dans le fait qu'il rend hommage à Giorgio Locchi et poursuit la quête de ce dernier qui a donné à la "nouvelle droite" ses impulsions majeures avant d'être évincé de manière particulièrement inélégante par ce même directeur.
* * *
Parmi les rencontres que j’ai faites durant ma période parisienne (1977 – 1983), celle de Philippe Baillet fut pour moi une des plus enrichissantes.
Co-fondateur de la revue Totalité, Baillet est l’un des principales artisans de la réception de l’œuvre de Julius Evola dans les pays francophones.
Sa maîtrise de l’italien lui permet de lire dans le texte original et de traduire avec fidélité de nombreux auteurs transalpins, dont l’énumération impressionne au chapitre 2 de la première partie de l’ouvrage ici recensé : Le Parti de la Vie. Clercs et guerriers d’Europe et d’Asie.
Il s’agit d’un recueil de textes initialement parus dans divers périodiques, dont Rivarol et Écrits de Paris, où j’ai moi-même collaboré entre 1977 et 1979.
Je reste reconnaissant à Philippe Baillet de m’avoir accordé son amical soutien, non exempt de critique toujours courtoisie, lors d’une conférence que j’ai prononcé en février 1979 au Cercle Péguy de Lyon. Dans la salle, il y avait une charmante et prometteuse étudiante nommée Chantal Delsol. Cette soirée rhodanienne demeure parmi les plus beaux souvenirs de mon séjour dans l’Hexagone.
L’émotion nostalgique s’efface devant la rigueur comptable de l’index, où Evola est cité douze fois, Guénon apparaît à trois reprises et Coomaraswamy ne récolte qu’une seule mention, en note infra-paginale.
Revenu à Nietzsche « comme référence essentielle » après « un très long détour (p. 15) » par le « traditionalisme intégral » des trois penseurs susdits, Baillet semble toutefois toujours considérer Evola comme inspirateur incontournable dans la perspective de La Désintégration du Système.
L’ouvrage de Giorgio Freda était abondamment commenté vers 1975 dans les milieux nationalistes-révolutionnaires. Il ne contenait rien d’original. Tout y était originel. Présents dans la préface du livre de Freda, les deux adjectifs s’opposent aussi dans la conclusion du recueil de Baillet.
Celui-ci évoque la haute figure de Lao-tseu : « Le vrai taoïste, lui, est insouciant de sa propre insouciance, qu’il ne donne pas en spectacle pour paraître “ original ”. Il est bien plutôt tourné vers l’originel (p. 233, c’est Baillet qui souligne). »
Quand on se rappelle que Révolte contre le monde moderne s’ouvre sur un extrait du Tao tö king, on peut conclure que l’ombre d’Evola plane sur ce florilège divisé en deux parties inégales, la première (six chapitres) relevant de la littérature et de l’histoire des idées, la seconde (deux chapitres) d’orientation plus nettement philosophique.
Le cloisonnement n’est toutefois pas étanche. L’auteur nous remet en mémoire l’œuvre littéraire de Mishima, extraordinaire en regard de sa courte existence : « Près de quarante romans, vingt recueils de nouvelles, dix-huit pièces de théâtre et quelques essais (p. 183). »
Parallèlement, quelques-uns des écrivains français analysés dans la première partie ont été attirés par l’Extrême-Orient. Même André Malraux, « un cabotin qui rêvait de s’inscrire dans la lignée des grands esthètes armés (p. 112) », connut une période japonisante, controversée, il est vrai. Rappelons aussi que La Condition humaine se passe en Chine.
En Chine : tel est précisément le titre d’un « ouvrage remarquable et devenu très rare (p. 79) » d’Abel Bonnard, dont Philippe Baillet se plaît à exhumer quelques brillantes phrases aux allures de maximes. « La Mort nous cache le regret de quitter le monde dans le bonheur de quitter les hommes (p. 108). »
Pierre Drieu connut aussi ce que le Belge Firmin Vandenbosch appelle « la tentation de l’Orient ». À l’auteur du Feu Follet, qui dirigea la Nouvelle revue Française sous l’Occupation, Baillet concède « l’élégance et l’honnêteté du désespoir ». Elles « forcent l’estime, voire l’admiration, que ne mérite sans doute pas l’œuvre, avec son ton trop souvent sentencieux, son style parfois médiocre, ses essais très inégaux, dans lesquels les meilleures intuitions s’arrêtent la plupart du temps au stade de l’esquisse (p. 111) ».
Étendues à Gabriele d’Annunzio et Ezra Pound, sommairement négatives en ce qui concerne Louis Aragon, les considérations d’ordre littéraire ne constituent pas l’essentiel du message délivré par Philippe Baillet.
Les amateurs de rapprochements inattendus goûteront celui effectué entre Nietzsche et Lao-tseu partageant « une vision biocentrique du monde (p. 202) ». Dans le cadre de cette étonnante parenté entre « deux univers de pensée » et en dépit de leur « éloignement racial, temporel, spatial et civilisationnel (p. 216) », Philippe Baillet redéfinit l’idée tant débattue de « volonté de puissance », « catégorie ontologique suprême (p. 218) », « sens originaire (p. 225) » non réductible au simple vitalisme bergsonien.
La « volonté de puissance » est synonyme de la « persévérance dans l’être ». Une filiation philosophique directe relie dès lors Nietzsche et Heidegger, et peut-être, en amont de l’histoire de la pensée européenne, le Wille zur Macht de Nietzsche et le conatus de Spinoza. En tout cas, la « volonté de puissance » s’affranchit de tout rapetissement tel que voudrait lui faire subir une certaine critique guénonienne en la confondant avec le jaillissement de « l’élan vital », avec « la création incessante d’imprévisible nouveauté », avec un vitalisme priapique et éjaculatoire.
Ailleurs dans l’ouvrage, certains guénoniens sont implicitement ciblés dans la mesure où ils jugent toute révolution anti-moderne impossible en raison des conditions cosmiques défavorables. Ce point de vue revient à catamorphoser le « traditionalisme intégral » en un mythe démobilisateur. L’Histoire n’est pas un progrès linéaire, mais elle n’est pas davantage une décadence unidirectionnelle. Comme le répétait souvent notre regretté ami Dominique Venner, elle a sa part d’imprévu, même si une véritable « astrologie mondiale », apte à saisir la respiration du mouvement historique, pourrait y introduire une frange de prévisibilité.
En l’occurrence, l’important est de ne pas « déserter la lutte pour la défense de la cité en raison du dégoût que celle-ci nous inspire (p. 104) ». Il ne faut pas « attendre que tout s’arrange grâce à la divine Providence (p. 105) », par une sorte de retournement automatique inscrit dans la marbre de la fatalité, par une espèce de choc en retour ou d’effet boomerang contre la pesanteur plurimillénaire de l’Âge Sombre (Kali Yuga).
À défaut de compter sur une improbable metanoïa de ce type, vers où convient-il de tourner le regard d’une espérance en une « régénération de l’Histoire (p. 133) », face au « mouvement irréversible » (François Hollande) que veut lui imprimer le finalisme égalitaire ?
Ce n’est ni du Front national ni des divers partis « populistes » européens qu’il faut attendre une salutaire réaction contre ceux qui souhaitent suspendre le vol du temps, non pas comme Lamartine sur les rives romantiques du lac du Bourget, mais au bord du bourbier social-démocrate perçu comme « horizon indépassable ».
Je partage totalement le point de vue qu’exprime Baillet dans les lignes qui suivent et dans son jugement sur le parti lepéniste.
« Je tiens évidemment pour acquis que les lecteurs auxquels je m’adresse ne nourrissent pas l’illusion de penser que les différents mouvements “ populistes ” qui engrangent des succès électoraux dans l’Europe d’aujourd’hui sont une résurgence du phénomène fasciste (p. 161). »
Quant au Front national, il « entretient désormais le comble de la confusion » en se présentant comme « le défenseur par excellence du républicanisme et du laïcisme (p. 101) ».
Philippe Baillet nous invite à rechercher « l’essence du fascisme », selon l’expression de Giorgio Locchi, dont une conférence est retranscrite (pp. 164 à 182) entre les deux parties du livre. Il s’agit en quelque sorte de trouver pour le fascisme l’équivalent de ce que le grand critique littéraire allemand Leo Spitzer, fondateur de la stylistique, veut faire surgir dans sa lecture des écrivains : un « étymon spirituel ».
Philippe Baillet s’interroge à propos d’un « nouveau regard (p. 21) » que la science et la recherche universitaires semblent porter, depuis quelque temps, sur le national-socialisme.
Johann Chapoutot affirme que le national-socialisme est porteur d’une Kulturkritik « prolixe et plus argumentée qu’on ne le dit (p. 22) ».
Plusieurs expéditions scientifiques en Amazonie, au Libéria et au Tibet, la reconversion de Leni Riefenstahl comme cinéaste du Sud-Soudan : voilà autant de faits avérés qui plaident en faveur d’une ouverture du nazisme au monde non européen. Ces réalités « sont encore largement méconnues dans nos propres rangs, quand elles ne sont pas purement et simplement ignorées (p. 247) ».
En revanche, on ne peut que constater l’hostilité de « beaucoup de hauts responsables nationaux-socialistes […] à la postérité d’Abraham, aux serviteurs de la Loi, de la Croix et du Livre, bref à tout l’univers mental du “ sémitisme ” au sens le plus large (p. 29) ».
Dans le sillage de Giorgio Locchi, Philippe Baillet diagnostique une « tendance époquale (p. 136) » dont nous subissons les effets pernicieux depuis deux millénaires : un sémitisme lato sensu, un judéo-christiano-islamisme, auquel doit s’opposer une « tendance époquale » surhumaniste.
 Respectivement consacrés à Renzo de Felice et Giorgio Locchi, les chapitres 1 et 6 de la première partie posent les questions les plus fondamentales pour notre famille de pensée. Jusqu’où faire remonter la recherche de notre « moment zéro » (François Bousquet) ? Les étapes de la « tendance époquale » surhumaniste se succèdent-elles de manière continue ? Le fascisme lato sensu (dont le national-socialisme est provisoirement la forme la plus achevée) a-t-il été « prématuré (p. 142) », comme le laissent supposer certains passagers de Nietzsche prophétisant un interrègne nihiliste de deux siècles ?
Respectivement consacrés à Renzo de Felice et Giorgio Locchi, les chapitres 1 et 6 de la première partie posent les questions les plus fondamentales pour notre famille de pensée. Jusqu’où faire remonter la recherche de notre « moment zéro » (François Bousquet) ? Les étapes de la « tendance époquale » surhumaniste se succèdent-elles de manière continue ? Le fascisme lato sensu (dont le national-socialisme est provisoirement la forme la plus achevée) a-t-il été « prématuré (p. 142) », comme le laissent supposer certains passagers de Nietzsche prophétisant un interrègne nihiliste de deux siècles ?
Selon Locchi et Baillet, le « phénomène fasciste » de nature « transnationale et transpolitique (p. 136) » prend racine dans « la seconde moitié du XIXe siècle (p. 137) ». Baillet précise dès sa préface : « la grande réaction antirationaliste de la fin du XIXe siècle (p. 12) » marque l’origine du fascisme en tant qu’essence apte à « détrôner le cogito (p. 221) », cette formule finale soulignant la remarquable cohérence de l’auteur.
Mais pourquoi ne pas remonter encore plus loin, par exemple jusqu’à cet équivoque XVIIIe siècle qui préoccupe Renzo De Felice avant qu’il se spécialise dans la période mussolinienne ?
Car le siècle des prétendues « Lumières » et de l’Aufklarung ne fut pas seulement celui des philosophes néo-cartésiens instaurant « pour la première fois une culture de masse (p. 146) ». Il fut aussi celui des « illuminés » dont le « mysticisme révolutionnaire (p. 44) » fournit à l’historien l’occasion de réhabiliter « la dignité historiographique de l’irrationnel (p. 47) ». Le propos de De Felice est « d’insérer le “ fait mystique ” dans l’histoire, alors même que, selon lui, des tentatives dans ce sens n’ont été faites que par l’histoire littéraire à propos du Sturm und Drang et du romantisme (p. 44) ». Je rejoins Philippe Baillet dans son appel à compulser plus systématiquement les revues culturelles gravitant dans l’orbite du fascisme (allemand en l’occurrence) pour dévoiler certaines facettes d’un “ sens originaire ” ou d’un “ étymon spirituel ” chez Klinger, Lenz, Schiller, Herder, Hölderlin et Novalis, disait un jour Robert Steuckers cité en page 155. À titre anecdotique, je signale qu’un des plus brillants germanistes que j’ai croisés à l’Université libre de Bruxelles était d’origine togolaise et faisait une thèse de doctorat sur le Sturm und Drang.
Sur la « Révolution conservatrice », c’est bien entendu le travail de rassemblement d’Alain de Benoist (cité pages 134 et 155) qu’il faut saluer, tout en insistant sur un thème commun à Locchi et Baillet : la parfaite continuité de ce mouvement et du national-socialisme, même si certains « révolutionnaires-conservateurs (comme Armin Mohler, par exemple) ont « tenté de tourner les difficultés liées à cet incommode voisinage (p. 149) ».
Sous la forme du national-socialisme, la « tendance époquale surhumaniste » a-t-elle émergé trop tôt ? On peut le penser dans la mesure où la « tendance époquale » opposée, de nature « sémitique », n’était pas encore en état d’épuisement. Elle refait surface aujourd’hui dans « le panislamisme radicalisé », ses « formes exacerbées de ressentiment culturel » et sa « haine raciale patente (p. 161) ».
Le seul passage du livre de Baillet qui puisse laisser le lecteur sur sa faim est celui où l’islamisme est ainsi réduit à l’influence de facteurs psychologiques. Je conseille la lecture de l’analyse plus fine de François Bousquet, cité plus haut, dans la revue Éléments (n° 156, pp. 22 à 24).
Selon Bousquet, toute religion est coextensive d’un devenir historico-culturel et un exemple éloquent en est fourni par le Christianisme, qui peut être « interprété comme une métamorphose complexe de l’ancestrale religion païenne (p. 137) ». En l’occurrence, Baillet fait écho aux idées de Wagner, l’un des pôles de la « tendance époquale surhumaniste » (l’autre pôle étant évidemment Nietzsche).
Mais la mondialisation post-moderne favorise, par une sorte de mutation génétique, l’émergence de religions d’un type nouveau qui, à l’instar des « frères ennemis » de l’évangélisme et du salafisme, aspirent à renouer avec leur « moment zéro », leur origine immaculée, leur paléo-tradition non encore entachée par les vicissitudes de l’Histoire et les contraintes de ce que Charles Péguy appelle la nécessaire « racination » du spirituel dans le charnel.
À la lumière de l’article de Bousquet, le « panislamisme radicalisé » apparaît motivé par quelque chose de bien plus essentiel que la « haine » et le « ressentiment ».
Par ailleurs, une question mérite d’être posée : la recherche d’une essence fasciste « transpolitique » et « transnationale » (adjectif également utilisé par Bousquet dans son examen des « religions mutantes ») n’est-elle pas assimilable à la quête du « moment zéro », hors sol, hors temps et antérieur à toute « racination » ?
Rechercher l’essence du fascisme revient à découvrir son arché (le principe, l’origine) sans perdre de vue sa coextensivité à une genosis (le devenir).
C’est à dessein que j’emploie les termes inauguraux de l’Ancien Testament, car je ne suis convaincu, ni de la corrélation du « sémitisme » et de l’égalitarisme, ni de la désignation des monothéismes sémitiques comme ennemi global et principal.
Le mépris des Juifs pour les goyim, l’hostilité des Chrétiens envers les mécréants, l’aversion de l’Islam pour les infidèles sont analogues au dédain que peuvent ressentir les disciples de Nietzsche face aux « derniers hommes » qui se regardent en clignant de l’œil et se flattent d’avoir inventé le bonheur.
D’autre part, plutôt que « désigner l’ennemi », ne faut-il pas prioritairement identifier celui qui nous désigne comme ennemi ? À mes yeux, il ne fait pas de doute que c’est le laïcisme stupidement revendiqué par le Front national.
Quelle que soit l’étymologie basse-latine (laicus, commun, ordinaire) ou grecque (laos, le peuple, dont le pluriel laoi signifie « les soldats »), le laïcisme est à la fois égalitaire et profanateur.
D’un côté, il réduit les êtres humains à ce qu’ils ont de plus ordinaire en commun. De l’autre, il déclare une guerre permanente à tout ce qui relève du spirituel, du métaphysique, du cosmologique et du sacré.
René Guénon a très bien vu que l’égalitarisme ne serait qu’une première étape de la modernité. Dans un second temps sont appelées à émerger une « contre-hiérarchie » et une « parodie » de spiritualité. S’il faut éviter les pièges de l’apolitisme et du fatalisme tendus par certains guénoniens, il convient tout autant de garder en mémoire le message d’un maître à penser dont le diagnostic de « chaos social », entre autres analyses prémonitoires, se révèle d’une brûlante actualité.
Le mérite de Philippe Baillet est de dire clairement les choses : une révolution anti-moderne ne peut qu’être synonyme de rétablissement des valeurs d’ordre, d’hiérarchie et d’autorité. Je demeure réservé quant à l’adjectif « surhumaniste », trop nettement corollaire de la référence nietzschéenne, alors que la quête du « sens originaire » de la contre-modernité peut nous faire remonter au moins jusqu’au pré-romantisme, pour nous en tenir à l’aire culturelle allemande.
Nous autres révoltés contre le monde moderne devons poursuivre le combat contre la « tendance époquale » égalitaire qui est loin d’être épuisée. Mais il nous incombe aussi de nous préparer à l’affrontement décisif entre, d’une part l’élite « transnationale » de clercs et de guerriers tels que nous les présente Philippe Baillet, et d’autres part « l’hyper-classe mondialiste » (Pierre Le Vigan), dont il est encore aujourd’hui difficile de cerner les contours, mais qui incarnera davantage l’aspect profanateur du laïcisme que sa facette égalitaire, si tant est qu’il faille diviser l’action anti-traditionnelle en deux étapes successives. Égalitarisme et « contre-hiérarchie » apparaissent plutôt comme des phénomènes simultanés, dès qu’on y regarde d’un peu plus près.
Cet enchevêtrement complexe d’influences négatives rend d’autant plus urgente la tâche de redéfinir un fascisme essentialisé, capable de riposter aux formules lapidaires et diffamatoires – comme « l’islamo-fascisme » de Manuel Valls – qui visent à confondre dans la même brutalité tous les ennemis du Nouvel Ordre Mondial.
Mais une essence ne persévère dans l’Être que sous les conditions historiques, culturelles, géographiques, voire ethniques d’une substance qui, dans le livre de Philippe Baillet, hormis les pénétrantes ouvertures vers l’Extrême-Asie, épouse un vaste courant germanique continu : le Sturm und Drang, Nietzsche, Wagner, la « Révolution conservatrice » et le national-socialisme.
L’« étymon spirituel » de Leo Spitzer ne perdure qu’en s’incarnant dans « une race, un milieu, un moment », selon la formule d’Hippolyte Taine, qui fut également un grand critique littéraire.
À notre époque de désinformation calomnieuse, Philippe Baillet a le courage d’écrire que le national-socialisme est « la seule forme historique de révolte anti-égalitariste que le monde moderne ait connue (p. 15) ».
Le cadre limité de la présente recension ne permet pas de mettre au jour toute la richesse du livre de Philippe Baillet.
Il faudrait s’attarder davantage sur le chapitre consacré à Bernard Faÿ, dont l’itinéraire « conduit de l’avant-garde artistique et littéraire au pétainisme, des sympathies initiales pour Roosevelt à la collaboration avec des responsables de la SS dans le cadre du combat anti-maçonnique, d’un cosmopolitisme snob à la passion du redressement national (p. 116) ».
Il conviendrait de commenter plus en détail les pages remarquables qu’inspire à Philippe Baillet la lecture d’Abel Bonnard, pour qui « l’ordre est le nom social de la beauté (p. 92) ».
« Face à l’uniformisation croissante des modes de vie et des cultures, face à la laideur moderne qui s’étend partout, le clerc authentique est appelé à témoigner pour les valeurs de l’esprit, d’abord en se faisant le chantre de l’ordre et de la civilisation (p. 78) ».
Baillet décèle chez Bonnard un « penchant pour la poésie de l’ordre, que résumait si bien, au Japon, l’alliance du tranchant du sabre et de la pureté du chrysanthème dans l’âme du guerrier (p. 93) ».
La « ligne de force générale » que l’auteur a vu émerger, au fur et à mesure de la relecture et de la ré-écriture augmentée de ses articles initiaux, mériterait d’être approfondie.
Cette « ligne de force » ne renvoie « jamais, fondamentalement, à un discours, une spéculation, des concepts, des idéologies, une dialectique, mais à leurs opposés : un mythe, une vision du monde, des images, une esthétique (p. 12) ».
Ce culte de la Beauté, qui n’est pas sans rappeler la poésie d’Émile Verhaeren, pourtant compagnon de route du socialisme, cette nécessité de percevoir le Beau même « dans ce qui peut être tragique (p. 19) », cet esthétisme se combine à un « conservatisme vital (p. 199) », à une vigoureuse dénonciation du « caractère absolument suicidaire de toutes les idéologies prétendant faire abstraction des lois de la vie au profit d’un monde artificiel entièrement recomposé dans une perspective où l’homme est la mesure de toutes choses (p. 20) ».
La célèbre proposition de Protagoras fut vivement critiquée par Platon, dont La République et Les Lois figurent, comme le De Monarchia de Dante ou l’Arthashâstra indien, parmi les grands textes « qui ignorent superbement les anti-principes démocratiques (p. 85) ».
C’est également à ces sources antiques et médiévales que doivent s’abreuver tous les non-conformistes désireux de penser « par delà les clichés (p. 117) », de dépasser les clivages manichéens et de partir en quête d’une fascisme essentialisé, coextensif d’un mouvement historique bien plus ample que celui amorcé par les prétendues « Lumières ».
Philippe Baillet nous offre une chatoyante galerie de portraits de clercs et de guerriers dans un livre réunissant la cohésion de la pensée, la brillance de l’écriture et la magistrale organisation du savoir.
L’auteur a choisi de nous dévoiler le « versant ensoleillé (p. 24) » de la montagne au sommet de laquelle, sur un équivoque et périlleux chemin de crête, le fascisme a proposé un parcours politique et un itinéraire métapolitique.
Les voyageurs de haute altitude s’exposent fatalement à des chutes au fond du précipice, dans l’abîme de l’autre versant.
Philippe Baillet ne se voile pas la face lorsqu’il stigmatise, par exemple, « le traitement réservé aux prisonniers russes (p. 28) » par les nazis dans les territoires de l’Est occupés.
La caste médiatique aujourd’hui dominante aurait certes préféré d’autres illustrations des excès meurtriers où le fascisme allemand a basculé.
Mais ce livre ne s’adresse pas à cette caste experte en victimisation préférentielle.
Il interpelle plutôt tous les membres de notre famille de pensée conscients de ne pouvoir se permettre l’économie d’une étape intellectuelle en compagnie des régimes et mouvements anti-égalitaires du XXe siècle.
Daniel Cologne
• Philippe Baillet, Le Parti de la Vie. Clercs et guerriers d’Europe et d’Asie, Akribeia, Saint-Genis-Laval, 2015, 243 p., 22 € (à commander à Akribeia, 45/3, route de Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval).
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=4563
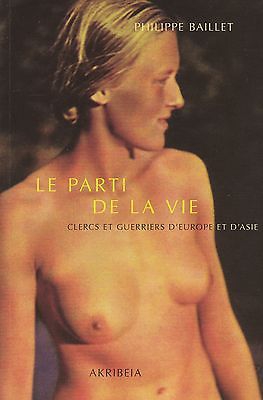 Le Parti de la vie
Le Parti de la vie
Clercs et guerriers d’Europe et d’Asie
Philippe Baillet
Le « parti de la vie » est constitué de tous ceux en qui sont encore présents et actifs les éléments originaires du réel occultés par la modernité : la voix de la race et du sang, les instincts élémentaires de légitime défense et de protection des siens, la solidarité ethnoraciale, la grande sagesse impersonnelle du corps, le sens de la beauté conforme aux types. Qu’il s’agisse de réalités méconnues du régime national-socialiste ou de l’anti-intellectualisme fasciste, de l’ordre en tant que « nom social de la beauté » chez Abel Bonnard ou de Giorgio Locchi insistant sur le caractère nécessairement « mythique » du discours surhumaniste, de l’intimité possible de la chair avec les idées selon Mishima ou de la nature « biocentrique » de la vision taoïste du monde, etc. – tout ici renvoie à une esthétique incarnée, radicalement étrangère à la postérité d’Abraham, aux serviteurs de la Loi, de la Croix et du Livre, aux « Trois Imposteurs » (Moïse, Jésus, Mahomet). Apparemment inactuel, ce livre explore donc avec rigueur le « versant ensoleillé » d’une Cause diffamée, enracinant ainsi les convictions dans la dynamique même des lois de la vie.
Contient un texte inédit en français de Giorgio Locchi.
Index.
248 p.
Pour commander:
http://www.akribeia.fr/akribeia/1712-le-parti-de-la-vie.html
00:05 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fascisme, philippe baillet, livre, philosophie, philosophie politique, giorgio locchi, nouvelle droite, tradition, julius evola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
«Cibergeopolítica, organizaciones y alma rusa» de Leonid Savin
Novedad editorial:
«Cibergeopolítica, organizaciones y alma rusa» de Leonid Savin
 Tenemos el placer de presentar a nuestros lectores una nueva obra que, como viene siendo costumbre en nuestras publicaciones, no tiene precedente alguno en lengua castellana. «Cibergeopolítica, organizaciones y alma rusa» de Leonid Savin, un prestigioso analista geopolítico y pensador ruso que lleva años haciendo importantes aportaciones en el ámbito de la geopolítica, una rama de la ciencia política con la que recientemente nos estamos familiarizando y cuyas categorías analíticas son del todo necesarias para comprender el mundo actual.Siguiendo la senda marcada por «La geopolítica de Rusia. De la revolución rusa a Putin» del gran politólogo y filósofo ruso Aleksandr Duguin queremos seguir explorando un campo del pensamiento político que consideramos poco conocido en España en general, y por extensión en toda la Europa occidental, donde desgraciadamente contamos con una visión limitada y con una escasa pluralidad de puntos de vista. Los mass media, desde su papel de difusores de las verdades oficiales, nos imponen un denso velo que actúa entre la realidad y nuestras percepciones de la misma.
Tenemos el placer de presentar a nuestros lectores una nueva obra que, como viene siendo costumbre en nuestras publicaciones, no tiene precedente alguno en lengua castellana. «Cibergeopolítica, organizaciones y alma rusa» de Leonid Savin, un prestigioso analista geopolítico y pensador ruso que lleva años haciendo importantes aportaciones en el ámbito de la geopolítica, una rama de la ciencia política con la que recientemente nos estamos familiarizando y cuyas categorías analíticas son del todo necesarias para comprender el mundo actual.Siguiendo la senda marcada por «La geopolítica de Rusia. De la revolución rusa a Putin» del gran politólogo y filósofo ruso Aleksandr Duguin queremos seguir explorando un campo del pensamiento político que consideramos poco conocido en España en general, y por extensión en toda la Europa occidental, donde desgraciadamente contamos con una visión limitada y con una escasa pluralidad de puntos de vista. Los mass media, desde su papel de difusores de las verdades oficiales, nos imponen un denso velo que actúa entre la realidad y nuestras percepciones de la misma.
De Savin, el autor que nos ocupa, cabe destacar su gran labor tanto como analista geopolítico como dentro del ámbito de la filosofía, que desde un denodado esfuerzo siempre está desarrollando nuevas obras sobre la situación geopolítica del mundo o sobre la situación de Rusia. Pluma y voz de diversos portales geopolíticos como geopolitika.ru y katehon.com, abiertos a la participación de nuevos analistas geopolíticos, filósofos, sociólogos, politólogos, etc., en ellos Leonid Savin escribe sobre los hechos actuales desde la perspectiva rusa y eurasianista, que cada vez resulta más conocida en lengua castellana por la gran expectación que levantan sus publicaciones, especialmente en distintos portales de habla hispana como «Página Transversal», donde han sido publicados algunos de sus trabajos. De modo que el pensamiento ruso ya no parece una cosa alejada del resto del mundo, sino un análisis diferente y completo de la realidad que concierne a todo el mundo por igual.
Entrando ya en la temática que sirve de propósito a este libro, esta es una obra que reúne elementos muy diversos, que pueden parecer heterogéneos, pero que sin embargo mantienen una unidad interna en su propósito y en la idea global de la misma: Desde la Cibergeopolítica —un concepto que puede resultarnos novedoso— Leonid Savin establece una serie de criterios e ideas entorno a la guerra y la geopolítica en un nuevo ámbito o espacio de combate, que no es otro que el de las redes sociales (englobadas en lo que se conoce como Web 2.0), medio desde el cual es posible llevar a cabo actividades muy efectivas tanto para dañar al enemigo como para controlar a la población. De modo que la irrupción del mundo cibernético (que no virtual, puesto que pese a no ser tangible, realmente existe) en el campo de la geopolítica está teniendo unas consecuencias decisivas en los nuevos enfoques de este campo de estudio. Las consecuencias de los nuevos usos tecnológicos y su papel ascendente lo vemos reflejado en la organización militar y el empleo de conceptos y técnicas como el «coaching» que nos descubren otras variables y elementos a tener en cuenta. No es casualidad que casos como el de Edward Snowden o Julian Assange hayan sido considerados tan relevantes para la geoestrategia norteamericana, sus aliados europeos occidentales y el resto de fuerzas que integran la órbita atlantista. Asimismo la regulación del ciberespacio y las leyes y normas internacionales que deben regir en el susodicho también han sido motivo de tensión y enfrentamiento entre las grandes potencias.
Podemos distinguir un segundo apartado, donde concurren una serie de reflexiones que podríamos ubicar más en un plano teórico, en lugar de aquel técnico del que nos hemos ocupado en el párrafo anterior, en el cual Savin profundiza en aspectos más intelectuales y culturales, y que se refieren a la lengua y espiritualidad de la Federación Rusa. Desde un interesante artículo donde nos remite a las teorías de Sorel y el sindicalismo revolucionario, hasta la geopolítica de la lengua rusa o la extensión y los matices que caracterizan al rico y variado universo de religiones y creencias del territorio ruso. En este contexto nos movemos más en el terreno de la geopolítica nacional de Rusia, de las confesiones religiosas y su particular relación con el Estado, las normas y regulaciones en el ejercicio de su práctica, la existencia de una pluralidad religiosa única en el mundo, o bien la importancia que es necesario conferir a esa religiosidad junto a la lengua, la genealogía de ambos conceptos, desde sus orígenes y posteriores desarrollos, la expansión por los vastos territorios que integran el territorio ruso y las relaciones existentes entre éstos conceptos y la propia configuración del poder político devienen como herramientas de conocimiento esenciales en la comprensión geopolítica de la Rusia actual. Evidentemente hay una mención especial del cristianismo ortodoxo, por ser la fe mayoritaria de los pueblos que integran Rusia, y las relaciones que vertebran la existencia de su jerarquía religiosa y eclesiástica respecto al estado ruso.
Igualmente podemos ver que en el contexto del análisis de los patrones religiosos y culturales de Rusia hay una dialéctica muy clara respecto al Occidente europeo —donde las formas de cultura y religiosidad se han visto notablemente erosionadas en su conjunto— el proyecto ilustrado, con todos sus atributos racionalistas y secularizadores, que han servido para vehiculizar toda una suerte de procesos destructivos en aquellos elementos más arraigados en la cultura de los pueblos. Dentro de este contexto, y entrando en la etapa de indefinición de la llamada posmodernidad, vemos cómo esta sociedad occidental se ha visto socavada por el multiculturalismo y la negación de aquellos patrones culturales y religiosos que formaban parte de las correspondientes identidades nacionales. El contraste entre el tratamiento del ámbito religioso en Rusia marca un importante contraste respecto a la Europa occidental, especialmente por las políticas activas desarrolladas por el estado ruso en ese contexto y la total integración de los preceptos religiosos a la cosmovisión de Rusia y los propios estamentos políticos.
Todo el conglomerado de artículos y reflexiones que integran el libro que presentamos a nuestros lectores cuentan con unas fuentes y conocimientos densos, bien pertrechados y que no están exentos de la carga ideológica que es inherente y característica de los postulados de la Cuarta Teoría Política, donde el propio Savin se alinea en la misma corriente de pensamiento que su homólogo Aleksandr Duguin, asumiendo un punto de vista crítico y el rechazo sin paliativos hacia la cosmovisión homogeneizadora que plantea el liberalismo y sus distintos apéndices y adláteres. En este sentido la dialéctica entre modernidad y antimodernidad también la vemos presente en el rechazo hacia la era actual de la Posmodernidad, una época de caos e indefinición, en la que la globalización y una serie de procesos derivados de ésta destruyen la esencia y fundamentos de cada cultura mediante el multiculturalismo, atacando cualquier vínculo profundo y enraizado con la idea de Comunidad, Tradición o Espiritualidad.
Por último, nos complace informaros que el libro ya está a la venta en Amazon o, si lo preferís nos lo podéis pedir por correo electrónico o comprárnoslo personalmente en las presentaciones del libro cuya celebración ya anunciaremos en nuestros canales habituales.
Fuente: Hipérbola Janus
00:05 Publié dans Géopolitique, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cybergéopolitique, géopolitique, livre, leonid savin |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un Etat multinational peut-il être viable?

Bernard Plouvier
Ex: http://metamag.fr
00:05 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etat multinational, définition, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie politique, etat composite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


