samedi, 20 février 2016
Jean Dutourd, l'anarcho-gaulliste

Jean Dutourd, l'anarcho-gaulliste
Lorsqu’on l’allait visiter dans son sombre appartement proche de l’Académie, il fallait traverser un salon vaste comme un hall de gare (de province), longer un couloir interminable, avant de pénétrer dans le bureau bibliothèque où il vous recevait, en veste d’intérieur écossaise, la bouffarde au bec, dans la compagnie de quelques milliers de livres impeccablement alignés sur les rayonnages. Un décor très britannique, boiseries, fauteuils de cuir, odeur de cire et de tabac blond, nuancé d’ordre monacal ou militaire. Le maître des lieux, du reste, avait un côté très British, et pas seulement pour la moustache et la pipe dignes du Colonel Bramble ou du Major Thompson.
Jean Dutourd était un vieux Gaulois ronchonneur tempéré par l’humour anglais et le goût du paradoxe chers à Jonathan Swift et à Oscar Wilde. En dépit de son inaltérable attachement à la mère patrie, « la France ma mère, qui s’est, en quinze siècles, façonné une âme plus belle et plus grande que toute autre nation », Dutourd renchérissait volontiers sur Godefroy, le héros de Courteline, qui soupire : « J’aime bien maman, mais crénom, qu’elle est agaçante ! » Bon fils, l’auteur des Horreurs de l’amour pouvait râler, mais ne la reniait pas, même quand elle faisait des bêtises, comme de désavouer de Gaulle en 1968 ou de porter Mitterrand au pouvoir en 1981.
Dans ces années-là, je le voyais souvent, car il était, pour les journalistes, un “bon client”. Depuis son élection à l’Académie française en 1978, à la suite du plasticage de son appartement, qui contribua beaucoup, disait-il en riant, à son élection, il s’autorisait une liberté de parole qui ne s’encombrait pas des prudences habituelles chez les habits verts. Il avait l’esprit caustique, la parole drue, la formule assassine, et n’épargnait personne, à commencer par les hommes de pouvoir et les belles âmes progressistes. Jamais il ne fut plus en verve que durant les deux septennats mitterrandiens où il publia le Socialisme à tête de linotte, le Spectre de la rose, la Gauche la plus bête du monde, le Septennat des vaches maigres, Journal des années de peste 1986-1991, la France considérée comme une maladie mais aussi Henri ou l’Éducation nationale, le Séminaire de Bordeaux, Ça bouge dans le prêt-à-porter, désopilante anthologie des clichés et des expressions à la mode dans le journalisme.
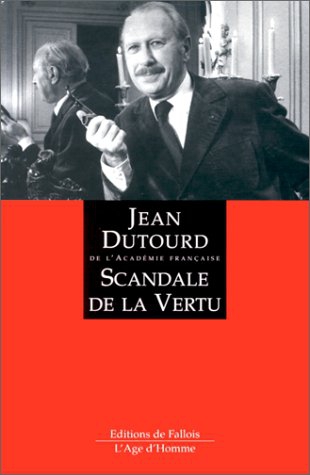 Du temps que le Général régnait sur la France, le gaulliste Dutourd était abreuvé d’injures, dont les moindres étaient : « nouveau Déroulède », « grosse bête », « patriote ringard ». On le vilipendait pour son « gros bon sens », sa prétendue « vulgarité », sa propension à se faire « le porte-parole de la majorité silencieuse ». « Pour être admis chez les gens intelligents, me disait-il, il fallait m’avoir traité d’imbécile ! » Du jour où les socialistes parvinrent au pouvoir, on le découvrit soudain moins bête qu’on ne le disait, et jamais il ne fut davantage invité sur les plateaux de télévision, où son flegme narquois et ses bons mots faisaient florès.
Du temps que le Général régnait sur la France, le gaulliste Dutourd était abreuvé d’injures, dont les moindres étaient : « nouveau Déroulède », « grosse bête », « patriote ringard ». On le vilipendait pour son « gros bon sens », sa prétendue « vulgarité », sa propension à se faire « le porte-parole de la majorité silencieuse ». « Pour être admis chez les gens intelligents, me disait-il, il fallait m’avoir traité d’imbécile ! » Du jour où les socialistes parvinrent au pouvoir, on le découvrit soudain moins bête qu’on ne le disait, et jamais il ne fut davantage invité sur les plateaux de télévision, où son flegme narquois et ses bons mots faisaient florès.
La politique, en réalité, ne l’intéressait que comme prétexte à exhaler ses humeurs. Il avait, reconnaissait-il, des sentiments plutôt que des idées politiques. Depuis le discours du 18 juin 1940, il n’avait jamais varié de ligne : “anarcho-gaulliste”, et le moins mauvais régime aurait été à ses yeux « une monarchie absolue tempérée par l’assassinat », selon une formule qu’il attribuait à Stendhal, attribution dont je ne suis pas sûr qu’elle soit exacte. Cet individualiste, qui s’inscrivait dans la lignée de ses maîtres, Montaigne, Voltaire, Stendhal et Chesterton, se méfiait de l’État-providence et de l’angélisme, ce « crime politique » qui conduit l’État à vouloir faire le bien du citoyen malgré lui : «Tous les gouvernements sont comme les bonnes femmes qui disent à un type: “Tu verras, je vais faire ton bonheur !” Instantanément, le type est terrorisé et se dit : “Elle va m’emmerder toute ma vie !” C’est la même chose en politique. »
Jean Dutourd était de ces dinosaures en voie de disparition qui ne s’excusent pas d’être français, n’admettent guère que l’“insolente nation” trahisse sa vocation à la grandeur, et ont souvent mal à leur pays. Il avait intitulé l’un de ses livres De la France considérée comme une maladie. Une expression qu’il tenait de sa belle-mère, qui répétait sans cesse : «J’ai mal à la France. » « Je crois, me confiait-il, que les Français ont toujours eu mal à la France. Depuis qu’il existe une littérature française, les écrivains ont des bleus à leur patrie. Peut-être à cause de l’hypertrophie de notre sens critique qui nous fait nous gratter sans cesse. Cela dit, il y a eu des périodes où les Français n’avaient pas trop mal à la France. Comme sous Louis XIV et Napoléon. C’était l’Europe qui avait mal, à ce moment-là.»
L’un des drames de notre pays résidait, selon lui, dans la disparition progressive du bon sens au profit de la prétention des soi-disant élites qui ne s’expriment plus que dans un sabir incompréhensible par le peuple, véritable attentat contre la clarté de notre idiome national. « Intellectuel n’est pas synonyme d’intelligent. Je dirais même qu’on est plutôt intelligent quand on n’est pas intellectuel. Les intellos sont la lie de la terre. Ils incarnent l’éternelle trahison des clercs. On est un artiste, un écrivain, un philosophe, mais pas un intellectuel ! Un intellectuel, c’est un de ces mauvais curés qui font tout pour vous dégoûter du bon Dieu. Bref, c’est affreux ! »
Il prétendait n’être qu’un homme de la rue qui sait écrire
S’il était volontiers disert sur la vie publique, l’homme, en revanche, était d’une discrétion rare sur sa vie privée : « Mon rêve, c’est de ne pas avoir de biographie, car celle-ci se construit toujours au détriment de l’oeuvre. Alors, pas de biographie. Comme Homère et comme Shakespeare…» Dans Jeannot, Mémoires d’un enfant, il avait arrêté ses Mémoires à l’âge de 11 ans, estimant que les décennies suivantes n’offraient rien de singulier. « Je suis un homme de la rue qui sait écrire. C’est la seule chose que je sache faire », confessait-il avec une fausse modestie goguenarde. Depuis le Complexe de César, son premier livre, déjà provocateur, publié en 1946, il n’avait cessé de publier avec une régularité horlogère, et un talent hors du commun. Il était de ces rares écrivains, comme Marcel Aymé, pour qui le français était une langue naturelle. À la fois très simple, très pure, et savante, mêlant la familiarité et les tournures recherchées héritées de ces classiques qu’il fréquentait assidûment.
Parmi les soixante-dix titres que laisse ce grognard en demi-solde, vaste panorama satirique de son époque, certains furent des succès considérables comme Au bon beurre (prix Interallié) et les Taxis de la Marne ; les autres témoignent d’une remarquable capacité à varier de registre, de Doucin aux Mémoires de Mary Watson, tout en reflétant une vision du monde à la fois sans illusions, autrement dit réactionnaire, et cocasse. Car Jean Dutourd était un moraliste qui avait l’élégance de la gaîté.
Bruno de Cessole
00:05 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommages, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, jean dutourd, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.