L’école française d’aujourd’hui repose sur deux idéologies délétères : un égalitarisme nivelant par le bas et un utilitarisme réduisant l’écolier au rôle d’apprenant en production et consommation. Deux paradigmes, mais une même conséquence : la progression de l’ignorance.
Deux types de critique sont généralement adressées à l’école. La première porte sur son idéologie égalitariste et sa malheureuse tendance à niveler par le bas les exigences, depuis l’OPA idéologique réalisée par la sociologie critique bourdieusienne.
L’autre problème est celui du triomphe d’une conception utilitariste et libérale de l’école. Épaulé par son modèle théorique de l’Homo oeconomicus, l’idéologie libérale a assigné à l’école un bien triste rôle : former des producteurs et des consommateurs. Là est toute la subtilité – et la perversité – du système libéral qui a pour tâche de former ces deux entités à première vue antithétique. Il s’agit pour l’école de produire – notons qu’elle est devenue un agent économique, producteur de services, comme les autres – à la fois un consommateur compulsif et hédoniste et un producteur efficient et rentable. Bien sûr une telle schizophrénie n’est pas tenable, si bien que cela mène aux inégalités colossales que l’on connaît entre producteurs se tuant à la tâche mais gagnant des monts d’or et des consommateurs peu éduqués, paresseux et aliénés.
Dans les deux cas, la priorité est plutôt de gagner de l’argent pour consommer toujours plus que d’acquérir un savoir.
Dépenser plutôt que penser
« Il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience » Jean Jaurès
Tout dans l’évolution de l’éducation ces dernières décennies semble montrer le triomphe d’une conception utilitariste de l’école. Comme l’écrit Christian Laval dans la Revue du MAUSS, pour les libéraux, « l’école a une fonction essentiellement économique, elle doit être au service de la compétitivité dans le cadre de la mondialisation et de “l’économie de la connaissance” […] L’école tend à devenir ainsi un ersatz d’entreprise dont l’objectif principal est la “production de capital humain” selon des voies gouvernées par le principe économique d’efficience. » Ainsi, on ajoute des heures de formation professionnalisante, de stages, de disciplines liées à l’entreprise, le nouveau Graal à atteindre. Finir ses études et entrer prestement sur le marché du travail deviennent les deux objectifs de l’école, pour qui l’élève représente un vrai poids financier.
Certes il n’est pas mauvais en soi que les élèves se familiarisent avec le monde du travail, ne serait-ce que pour qu’ils puissent s’orienter convenablement. Mais il n’est pas juste de penser qu’« une bonne école propose un enseignement pratique, des stages, un réseau et des cours d’anglais ! », comme l’écrit ironiquement Mathieu Detchessahar dans Le marché n’a pas de morale. Ce qui est problématique, c’est plutôt que cette formation se fait le plus souvent au détriment de ce qu’on nomme “humanités”, mais qui correspond plus exactement à la culture. Réduire drastiquement l’enseignement du latin et du grec peut paraître un excellent coup : il libère du temps pour des vrais matières, vraiment utiles. Detchessahar déplore ainsi que la culture soit de plus en plus perçue comme « le détour auquel on nous oblige encore mais que l’on espère le plus court possible avant d’attaquer le véritable enseignement : concret, professionnel, utile. »
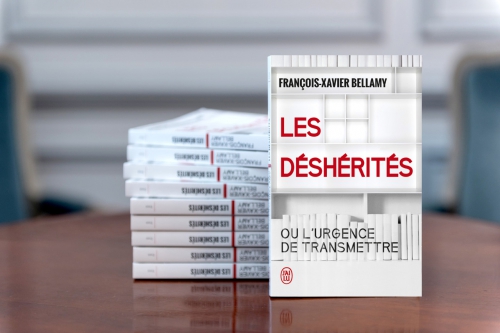
La nature même de la culture n’est pas d’être utile, mais d’être tout court. « C’est de la culture que nous avons à partager, dans sa gratuité première, que viendra toute la créativité, toute la liberté, toute l’humanité même du monde de demain. », écrit très justement sur son blog François-Xavier Bellamy, philosophe et auteur du remarqué Les déshérités. Ainsi, doit se comprendre le mépris de l’école libérale pour les travaux des mains et du cœur, Fabrice Hadjadj soulignant dans Puisque tout est en voie de destruction que « le savoir dont il s’agit ne prend ni corps ni âme, il ne s’intéresse ni aux mains ni au cœur de l’homme, mais il promet un job très rémunérateur, l’accès au monde de la consommation ainsi que des gadgets en grand nombre. C’est pourquoi, sous le règne des moyens sans fins, ces sciences applicables se maintiennent comme critère de sélection, tandis que recherche fondamentale, histoire et poterie, littérature et horticulture, ne cessent de déchoir. Certes, nul ne saigne pour elles, mais tout le monde devient exsangue. »
Déshumaniser
« Avoir ! Avoir ! Vous êtes tous comme ça, hein ? On ne vous a jamais appris à conjuguer le verbe être à l’ école ? Demande-toi ce que tu dois être plutôt que ce que tu peux avoir. » Étienne Davodeau, Le Constat (1996)
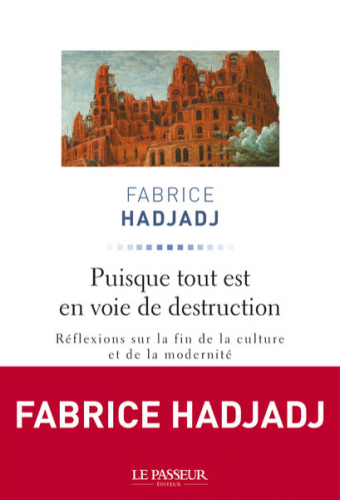 Or, on remarque qu’éduquer un élève pour qu’il développe son humanité, et ceci via sa culture, n’est absolument pas le but recherché par la logique éducative libérale. En effet, celle-ci est soumise à une contrainte évidente : pour former des consommateurs dociles, il faut développer leurs instincts et pulsions égoïstes – toutes choses inverses de l’éducation, de la raison, de l’humanité, de la culture en somme.
Or, on remarque qu’éduquer un élève pour qu’il développe son humanité, et ceci via sa culture, n’est absolument pas le but recherché par la logique éducative libérale. En effet, celle-ci est soumise à une contrainte évidente : pour former des consommateurs dociles, il faut développer leurs instincts et pulsions égoïstes – toutes choses inverses de l’éducation, de la raison, de l’humanité, de la culture en somme.
L’introduction progressive du numérique à l’école est l’exemple type d’une réforme inspirée par la logique éducative libérale. Familiariser les enfants avec le matériel numérique dès l’école peut apparaître une idée séduisante… si les enfants n’en usaient pas déjà bien trop chez eux ! Si l’école devient comme la famille, si on y fait la même chose, à quoi sert-elle ?
Dans Limite, Gaultier Bès présente Le Désastre de l’école numérique, un livre-enquête sur le numérique à l’école, citant un passage intéressant : « Pendant que certains cadres de la Silicon Valley inscrivent leurs enfants dans des écoles sans écrans, la France s’est lancée, sous prétexte de “modernité”, dans une numérisation de l’école à marche forcée – de la maternelle au lycée. Un ordinateur ou une tablette par enfant : la panacée ? Parlons plutôt de désastre. L’école numérique, c’est un choix pédagogique irrationnel, car on n’apprend pas mieux – et souvent moins bien – par l’intermédiaire d’écrans. C’est le gaspillage de ressources rares et la mise en décharge sauvage de déchets dangereux à l’autre bout de la planète. C’est une étonnante prise de risque sanitaire quand les effets des objets connectés sur les cerveaux des jeunes demeurent mal connus. C’est ignorer les risques psychosociaux qui pèsent sur des enfants déjà happés par le numérique. »
On sait la conséquence des délires de l’Éducation nationale – un délire qui a franchi un seuil encore inédit sous le ministère de Najat Vallaud-Belckacem : l’effondrement du niveau scolaire général. Dès lors, les politiques éducatives égalitaristes sont justifiées. La boucle est bouclée. Le libéralisme a rencontré l’égalitarisme, leurs deux projets se rejoignent dans leur acharnement à déconstruire l’école – ce qui ne produira néanmoins ni liberté ni égalité.
Ainsi, Bellamy peut écrire avec colère et tristesse : « La crise que traverse notre pays, sous toutes ses formes, est profondément liée à sa faillite éducative. S’il faut refaire l’école, c’est parce qu’elle est le premier lieu de notre défaite collective. Ne gardons qu’une seule statistique, l’une des plus récentes : l’enquête Cedre, publiée par le Ministère de l’Éducation nationale en juillet dernier, se concentrait cette année sur la maîtrise de la lecture. Cette enquête statistique officielle fait apparaître que, parmi tous les collégiens en fin de 3e, seul un quart d’entre eux peuvent être considérés comme “bon lecteurs”. De l’autre côté du spectre, 15 % des élèves “s’avèrent n’avoir pratiquement aucune maîtrise ou une maîtrise réduite des compétences langagières” ; cette situation, qui selon le ministère lui-même les rend “incapables de poursuivre leurs études”, concerne donc chaque année près de 125 000 jeunes… Entre les deux, des centaines de milliers d’autres naviguent dans le flou, ayant passé des milliers d’heures sur les bancs de nos classes sans avoir pu même devenir “bons lecteurs”. Cette pauvreté langagière, culturelle, intellectuelle est une bombe à retardement pour notre pays. »
Elie Collin
Nos Desserts :
- Dans le premier numéro de notre revue, on vous propose de rendre justice à Jean Jaurès – « Il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience » – avec un article de Romain Masson concevant l’éducation comme un apprentissage à la révolution
- Au Comptoir, on parlait déjà de la libéralisation de l’école en retraçant son histoire récente et les courants qui la traversent
- En 2015, on entamait une série d’articles sur la réforme des collèges avec Romain Masson : « Réforme des collèges : le savoir, fin de transmission »
- Une enseignante de français et de latin alarmait dans nos pages : « Garance Branca : “On est en train de créer une éducation à deux vitesses : une pour ceux qui peuvent payer, l’autre pour ceux qui ne peuvent pas” »
- On analysait aussi la libéralisation de l’école dans le prisme des formations proposées aux enseignants : « Pourquoi j’ai détesté mon après-midi de formation à l’Espé »
- À l’occasion de la sortie du livre Le désastre de l’école numérique : Plaidoyer pour une école sans écrans, on a discuté avec Karine Mauvilly qui nous disait : « L’école devient un objet économique »



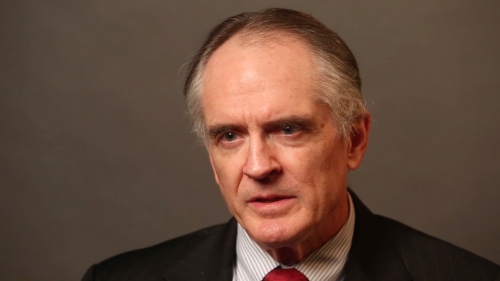

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
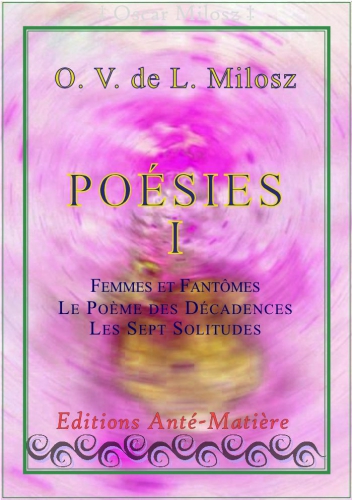 Si le propre des grands poètes est de demeurer longtemps méconnus avant de nous advenir en gloires et ensoleillements sans doute est-ce qu'ils entretiennent avec la profondeur du temps une relation privilégiée. Leurs œuvres venues de profond et de loin tardent à nous parvenir. Elles sont ce « Printemps revenu de ses lointains voyages », - revenu vers nous avec sa provende d'essences, d'ombres bleues, de pressentiments.
Si le propre des grands poètes est de demeurer longtemps méconnus avant de nous advenir en gloires et ensoleillements sans doute est-ce qu'ils entretiennent avec la profondeur du temps une relation privilégiée. Leurs œuvres venues de profond et de loin tardent à nous parvenir. Elles sont ce « Printemps revenu de ses lointains voyages », - revenu vers nous avec sa provende d'essences, d'ombres bleues, de pressentiments. 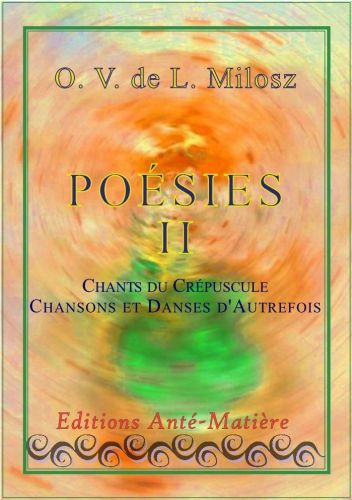 Ce temps n'est pas un temps linéaire, le temps de la succession, le temps historique mais le temps métahistorique, s'inscrivant dans une hiéro-histoire: c'est là tout le propos des Arcanes de Milosz. Ce savoir ne sera pas conquête arrogante, mais retour en nous de l'humilité, non pas savoir qui planifie, qui arraisonne le monde par outrecuidance, par outrance, mais retour à la simple dignité des êtres et des choses, des pierres, des feuillages, des océans, des oiseaux.
Ce temps n'est pas un temps linéaire, le temps de la succession, le temps historique mais le temps métahistorique, s'inscrivant dans une hiéro-histoire: c'est là tout le propos des Arcanes de Milosz. Ce savoir ne sera pas conquête arrogante, mais retour en nous de l'humilité, non pas savoir qui planifie, qui arraisonne le monde par outrecuidance, par outrance, mais retour à la simple dignité des êtres et des choses, des pierres, des feuillages, des océans, des oiseaux. 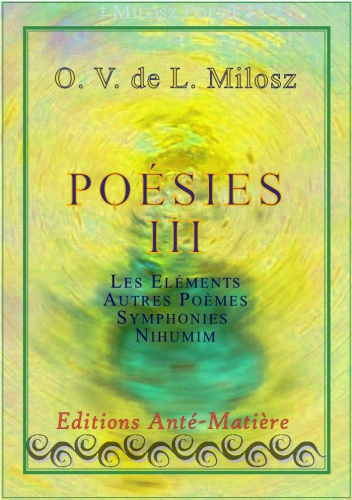 Certains hommes, plus que d'autres, par l'appartenance à une caste intérieure, sont prédisposés à entrer en relation avec le monde intermédiaire, là où apparaissent les Anges, les visions, les dieux. Ce mundus imaginalis, ce monde imaginal, fut la véritable patrie de Milosz comme elle fut celle de Gérard de Nerval ou de Ruzbéhân de Shîraz. Ce monde visionnaire n'a rien d'abstrus, de subjectif ni d'irréel. Il est, pour reprendre le paradoxe lumineux d'Henry Corbin « un suprasensible concret », - non pas la réalité, qui n'est jamais qu'une représentation, mais le réel, ensoleillé ou ténébreux, le réel en tant que mystère, source d'effroi, d'étonnement ou de ravissements sans fins.
Certains hommes, plus que d'autres, par l'appartenance à une caste intérieure, sont prédisposés à entrer en relation avec le monde intermédiaire, là où apparaissent les Anges, les visions, les dieux. Ce mundus imaginalis, ce monde imaginal, fut la véritable patrie de Milosz comme elle fut celle de Gérard de Nerval ou de Ruzbéhân de Shîraz. Ce monde visionnaire n'a rien d'abstrus, de subjectif ni d'irréel. Il est, pour reprendre le paradoxe lumineux d'Henry Corbin « un suprasensible concret », - non pas la réalité, qui n'est jamais qu'une représentation, mais le réel, ensoleillé ou ténébreux, le réel en tant que mystère, source d'effroi, d'étonnement ou de ravissements sans fins. 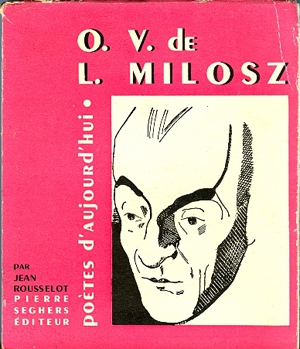 « Je regarde, écrit Milosz, et que vois-je ? La pureté surnage, le blanc et le bleu surnagent. L'esprit de jalousie, le maître de pollution, l'huile de rongement aveugle, lacrymale, plombée, dans la région basse est tombé. Lumière d'or chantée, tu te délivres. Viens épouse, venez enfants, nous allons vivre ! » A ce beau pressentiment répond, dans le même poème la voix de Béatrice: « Montjoie Saint-Denis, maître ! Les nôtres, rapides, rapides, ensoleillés ! Au maître des obscurs on fera rendre gorge. Vous George, Michel, claires têtes, saintes tempêtes d'ailes éployées, et toi si blanc d'amour sous l'argent et le lin... »
« Je regarde, écrit Milosz, et que vois-je ? La pureté surnage, le blanc et le bleu surnagent. L'esprit de jalousie, le maître de pollution, l'huile de rongement aveugle, lacrymale, plombée, dans la région basse est tombé. Lumière d'or chantée, tu te délivres. Viens épouse, venez enfants, nous allons vivre ! » A ce beau pressentiment répond, dans le même poème la voix de Béatrice: « Montjoie Saint-Denis, maître ! Les nôtres, rapides, rapides, ensoleillés ! Au maître des obscurs on fera rendre gorge. Vous George, Michel, claires têtes, saintes tempêtes d'ailes éployées, et toi si blanc d'amour sous l'argent et le lin... » 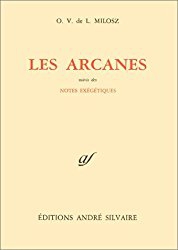 Contraires à l'œuvre et à la prière, de titanesques forces sont au travail pour nous distraire et nous soumettre. L'idéal guerroyant, chevaleresque, opposera au coup de force permanent du monde moderne, non pas une force contraire, qui serait son image inversée et sa caricature, mais une persistante douceur et d'infinies nuances.
Contraires à l'œuvre et à la prière, de titanesques forces sont au travail pour nous distraire et nous soumettre. L'idéal guerroyant, chevaleresque, opposera au coup de force permanent du monde moderne, non pas une force contraire, qui serait son image inversée et sa caricature, mais une persistante douceur et d'infinies nuances. 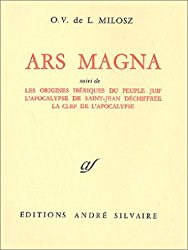 Le Noble Voyageur s'éloigne pour revenir. Il quitte la lettre pour cheminer vers l'aurore du sens, - qui viendra, en rosées alchimiques, se reposer sur la lettre pour l'enluminer. « Le monde, disaient les théologiens du Moyen-Age, est l'enluminure de l'écriture de Dieu ». Le voyage initiatique, la quête du Graal, qui n'est autre que la coupe du ciel retournée sur nos têtes, débute par l'expérience du trouble, de l'inquiétude, du vertige: « J'ai porté sur ma poitrine, écrit Milosz, le poids de la nuit, mon front a distillé une sueur de mur. J'ai tourné la roue d'épouvante de ceux qui partent et de ceux qui reviennent. Il ne reste de moi en maint endroit qu'un cercle d'or tombé dans une poignée de poussière. »
Le Noble Voyageur s'éloigne pour revenir. Il quitte la lettre pour cheminer vers l'aurore du sens, - qui viendra, en rosées alchimiques, se reposer sur la lettre pour l'enluminer. « Le monde, disaient les théologiens du Moyen-Age, est l'enluminure de l'écriture de Dieu ». Le voyage initiatique, la quête du Graal, qui n'est autre que la coupe du ciel retournée sur nos têtes, débute par l'expérience du trouble, de l'inquiétude, du vertige: « J'ai porté sur ma poitrine, écrit Milosz, le poids de la nuit, mon front a distillé une sueur de mur. J'ai tourné la roue d'épouvante de ceux qui partent et de ceux qui reviennent. Il ne reste de moi en maint endroit qu'un cercle d'or tombé dans une poignée de poussière. » 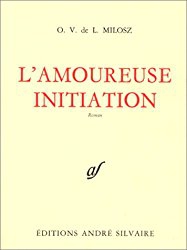 Le propre de la poésie est d'honorer le silence, - ce silence qui est en amont, antérieur, ce silence d'or qui tisse de ses fils toute musique, ce silence que les Muses savent écouter et qu'elles transmettent à leurs interprètes afin de faire entendre la vox cordis, la voix du cœur, qui vient de la profondeur du Temps.
Le propre de la poésie est d'honorer le silence, - ce silence qui est en amont, antérieur, ce silence d'or qui tisse de ses fils toute musique, ce silence que les Muses savent écouter et qu'elles transmettent à leurs interprètes afin de faire entendre la vox cordis, la voix du cœur, qui vient de la profondeur du Temps. 
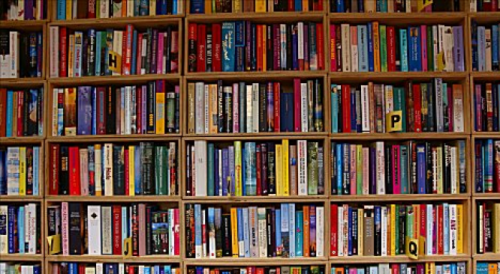
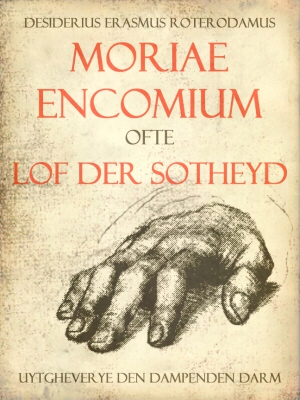 Lof der zotheid van Erasmus
Lof der zotheid van Erasmus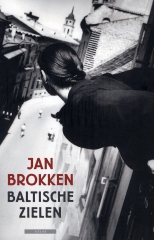 Baltische zielen van Jan Brokken
Baltische zielen van Jan Brokken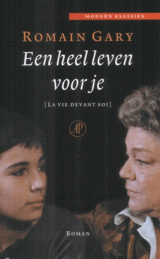 Een heel leven voor zich van Romain Gary
Een heel leven voor zich van Romain Gary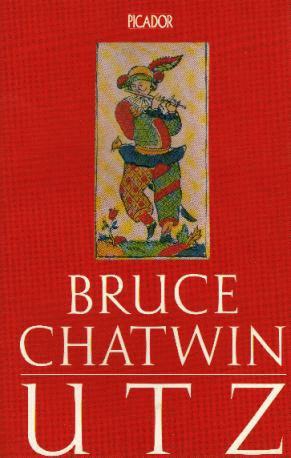 Utz van Bruce Chatwin
Utz van Bruce Chatwin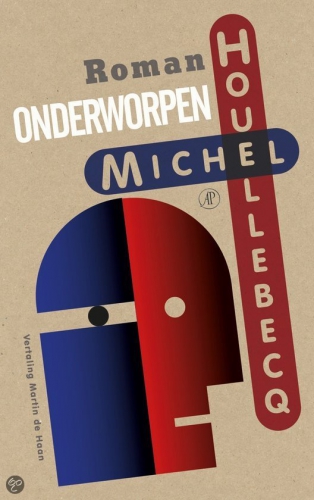 Onderworpen van Michel Houellebecq
Onderworpen van Michel Houellebecq