samedi, 11 mars 2017
Constantinople et Byzance de Léon Bloy

Constantinople et Byzance de Léon Bloy
Ex: http://www.juanasensio.com
Il faut commencer par bien comprendre que c'est par goût intime que Léon Bloy, de longues années durant, s'est intéressé à l'épopée byzantine, si haute en couleurs, le plus souvent fortes, atroces même. Publié en 1906 aux éditions de la Nouvelle Revue (1), ce texte puissant, qui nous livre bien des indications, nous le verrons, sur la conception bloyenne de la terrifiante histoire jamais rassasiée de sang, et pas seulement celui des pauvres, est une cavalcade furieuse qui mêle les peuples jouant à s'exterminer le plus souvent possible, et de toutes les façons possibles. C'est peu dire que Léon Bloy prend un malin plaisir à évoquer quelques atrocités commises dans cet âge barbare dont le spécialiste fut Gustave Schlumberger qui lui inspira ce texte. Ainsi : «Quand l'horrible mutilation fut achevée, le nobilissime, se levant de terre, sans l'aide de personne, montrant à tous ses orbites vides ruisselantes de sang, soutenu par quelques fidèles, s'entretint avec eux dans un calme si surprenant, un courage tellement surhumain, qu'il semblait indifférent» (p. 260, l'auteur souligne). C'est encore trop peu, Bloy le sait : «On peut aussi mentionner l'innocente espièglerie du jeune khalife d’Égypte Al-Zahir, faisant assembler dans une mosquée 2 600 jeunes filles et les faisant emmurer. Elles y périrent de faim et, durant six mois, leurs corps demeurèrent sans sépulture», Léon Bloy poursuivant en affirmant que «ces petites histoires ne sont rien auprès de ceci : En Arménie, un certain émir, longtemps prisonnier des impériaux et enfin délivré par les Seldjouik des vainqueurs, pour se venger des souffrances de sa captivité, fit creuser une fausse de la hauteur d'un homme. Il la fit remplir du sang des prisonniers qu'il donnait l'ordre de massacrer. Puis il y descendit et s'y baigna «pour noyer la rage dévorante de son cœur»» (p. 256, l'auteur souligne). Ailleurs, citant, comme il le fait à de très nombreuses reprises, le texte de l'historien Schlumberger, l'écrivain semble se délecter de l'effroi de cette scène : «Basile se résolut à frapper un coup terrible pour épouvanter ses adversaires opiniâtres et précipiter d'autant la fin de la résistance. À la prise des défilés de Cimbalongou, plus de 15 000 combattants bulgares étaient tombés vivants aux mains de ses soldats. Les chroniqueurs byzantins affirment qu'il fit crever les yeux à tous ces captifs et les renvoya ainsi mutilés à leurs compatriotes pour servir d'exemple. Par un raffinement inouï, pour chaque centaine d'aveugles on laissa un borgne, chargé de conduire ses compagnons» (p. 238).
Il faut commencer par bien comprendre que c'est par goût intime que Léon Bloy, de longues années durant, s'est intéressé à l'épopée byzantine, si haute en couleurs, le plus souvent fortes, atroces même. Publié en 1906 aux éditions de la Nouvelle Revue (1), ce texte puissant, qui nous livre bien des indications, nous le verrons, sur la conception bloyenne de la terrifiante histoire jamais rassasiée de sang, et pas seulement celui des pauvres, est une cavalcade furieuse qui mêle les peuples jouant à s'exterminer le plus souvent possible, et de toutes les façons possibles. C'est peu dire que Léon Bloy prend un malin plaisir à évoquer quelques atrocités commises dans cet âge barbare dont le spécialiste fut Gustave Schlumberger qui lui inspira ce texte. Ainsi : «Quand l'horrible mutilation fut achevée, le nobilissime, se levant de terre, sans l'aide de personne, montrant à tous ses orbites vides ruisselantes de sang, soutenu par quelques fidèles, s'entretint avec eux dans un calme si surprenant, un courage tellement surhumain, qu'il semblait indifférent» (p. 260, l'auteur souligne). C'est encore trop peu, Bloy le sait : «On peut aussi mentionner l'innocente espièglerie du jeune khalife d’Égypte Al-Zahir, faisant assembler dans une mosquée 2 600 jeunes filles et les faisant emmurer. Elles y périrent de faim et, durant six mois, leurs corps demeurèrent sans sépulture», Léon Bloy poursuivant en affirmant que «ces petites histoires ne sont rien auprès de ceci : En Arménie, un certain émir, longtemps prisonnier des impériaux et enfin délivré par les Seldjouik des vainqueurs, pour se venger des souffrances de sa captivité, fit creuser une fausse de la hauteur d'un homme. Il la fit remplir du sang des prisonniers qu'il donnait l'ordre de massacrer. Puis il y descendit et s'y baigna «pour noyer la rage dévorante de son cœur»» (p. 256, l'auteur souligne). Ailleurs, citant, comme il le fait à de très nombreuses reprises, le texte de l'historien Schlumberger, l'écrivain semble se délecter de l'effroi de cette scène : «Basile se résolut à frapper un coup terrible pour épouvanter ses adversaires opiniâtres et précipiter d'autant la fin de la résistance. À la prise des défilés de Cimbalongou, plus de 15 000 combattants bulgares étaient tombés vivants aux mains de ses soldats. Les chroniqueurs byzantins affirment qu'il fit crever les yeux à tous ces captifs et les renvoya ainsi mutilés à leurs compatriotes pour servir d'exemple. Par un raffinement inouï, pour chaque centaine d'aveugles on laissa un borgne, chargé de conduire ses compagnons» (p. 238).
Léon Bloy ne se prive pas d'en rajouter, écrivant ainsi qu'il a lu «quatre fois ce soi-disant premier tome de l'Épopée byzantine» et qu'il a fait cette lecture «non par zèle mais pour assouvir [s]es passions» (p. 202, l'auteur souligne). C'est peut-être aussi par goût sinon par passion que Léon Bloy entasse les cadavres et note plus d'une fois ces exemples d'atrocités, puisque, à ses yeux, ces dernières ne sont en fin de compte pas grand-chose devant l'imminence des «guerres d'extermination que notre sensibilité d'eunuques soi-disant chrétiens fait paraître inacceptables aujourd'hui» (p. 239), lesquelles, comme toujours chez cet écrivain portant constamment la main en visière sur l'horizon désespérément vide, ne sont que les préfigurations de l'Extermination finale, apocalyptique, qui nous ouvrira les portes de l'Enfer dégorgeant ses créatures les moins respectables. Il est temps d'ailleurs, grand temps, puisque le «bouillonnement est trop universel et l'heure semble trop venue où l'Esprit-Saint a promis de renouveler la face de la terre» (p. 171).
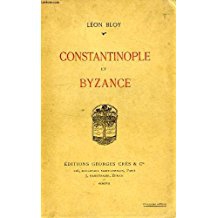 Ces atrocités, Léon Bloy les empile comme un gamin pressé de saisir le moment où sa construction de pièces de bois va commencer à vaciller, mais nous ne devons pas douter que l'écrivain, lui, s'il le pouvait, dresserait son horrible monument jusqu'au ciel, pour le fendre et laisser enfin couler le feu de l'Apocalypse. Ainsi le feu nettoierait une dernière fois cette fleuves de sang qui paraissent se jeter dans l'océan infini de la Douleur.
Ces atrocités, Léon Bloy les empile comme un gamin pressé de saisir le moment où sa construction de pièces de bois va commencer à vaciller, mais nous ne devons pas douter que l'écrivain, lui, s'il le pouvait, dresserait son horrible monument jusqu'au ciel, pour le fendre et laisser enfin couler le feu de l'Apocalypse. Ainsi le feu nettoierait une dernière fois cette fleuves de sang qui paraissent se jeter dans l'océan infini de la Douleur.C'est dans son Introduction à Constantinople et Byzance, écrite en 1917, que Léon Bloy relit son si étonnant texte et en confirme la portée apocalyptique, évidente dans une époque où les hommes se trouvent «au bord du gouffre, privés de foi et totalement dénués de la faculté de voir, également incapables d'aimer et de comprendre» : «Pourrait-on citer un valable mot sur la fameuse question d'Orient, depuis si longtemps qu'on en parle dans les livres ou les assemblées ? Une force mystérieuse, irrésistible, tourne le cœur de l'homme vers l'Orient qui fut son berceau» (p. 172), la rupture des sceaux étant en somme une espèce de retour au Paradis perdu (2), ce que l'écrivain confirme dans les toutes dernières lignes de cette Introduction en écrivant que : «Le monde aujourd'hui est convié à un spectacle identique. Les deux [la Bulgarie et Constantinople] périront ensemble vraisemblablement et il n'y aura plus d'obstacles sur la grande voie d'Asie qui mène à la vallée de Josaphat» (p. 173).
De toute façon, et chacune des notes ou presque que nous avons consacrées aux ouvrages de Léon Bloy nous l'a amplement montré, l'Histoire ne peut aller qu'à son terme, par essence apocalyptique puisque, nous dit superbement l'auteur, elle est «une préfiguration mystérieuse et prophétique du Drame de Dieu, analogue certainement à l'ensemble des images préfiguratrices qui constituent la Révélation biblique, impénétrable jusqu'à la grand-Messe du Calvaire», Bloy complétant cette étonnante définition en affirmant que si «la prophétie juive concernait la Rédemption», la «prophétie universelle de l'histoire concerne l'accomplissement de la Rédemption par l'avènement triomphal de l'Esprit-Saint» (p. 172), propos qui ne peuvent que nous rappeler les développements du Désespéré sur le Symbolisme en Histoire. Il serait peut-être intéressant d'étudier de possibles, bien que lointains rapports entre ces affirmations, pour le moins répétées, de Bloy, et la philosophie hégélienne de l'histoire, ne serait-ce que par le biais d'une lecture commune à ces deux auteurs, celle de Joachim de Flore.
Ces quelques extraits nous montrent amplement que l'Histoire, bien évidemment telle que la conçoit Léon Bloy, est le sujet véritable de son livre si haut en couleurs orientales. Ce qui frappe, en lisant cet écrivain, c'est qu'à ses yeux l'Histoire est tout bonnement incompréhensible bien davantage qu'absurde ou plutôt : c'est le fait de postuler l'existence d'une Histoire qui ne trahirait pas, dans le moindre de ses événements fût-il le plus anodin, la main invisible de Dieu, qui serait une profonde absurdité. Plus d'une fois, Léon Bloy affirme ainsi que, n'ayant «jamais observé que l'extérieur et le transitoire, nous ne comprenons absolument rien à des Gestes nouveaux et de surhumaine apparence qui n'ont d'analogue dans aucun passé et qui, déjà, semblent appartenir à quelque indiscernable Futur» (p. 172).
Que l'Histoire soit incompréhensible est une évidence mais, du moins, Léon Bloy se rassure quelque peu en se rangeant du côté des très rares élus capables de déchiffrer les signes les moins obvies, en se tenant soigneusement loin de «l'oraison funèbre du Bavardage universitaire». Même l'historien Schlumberger ne voit rien, malgré sa «constance d'Apache» et sa «sagacité de vieux Mohican couché sur la piste pour tirer quelque chose de ces ténèbres» (p. 178), et comment voir quoi que ce soit, du reste ? : «Il est certain que des événements immenses ont été complètement, je ne dis pas perdus, mais cachés, ce qui est plus ou moins affligeant. Cela dépend de ce que Dieu a mis au cœur et de l'idée qu'on se fait de l'histoire». Pourtant, on «sait quelque chose», car il n'existe pas «une période un peu longue dont on ne sache au moins quelques faits, ce qui est, si on veut, une espèce de miracle dans un tel engloutissement» (p. 215, l'auteur souligne). De toute façon, que faudrait-il penser, par exemple, «d'une histoire de France qui s'arrêterait brusquement, inexorablement, à Malplaquet pour ne reprendre qu'au retour des cendres de Napoléon, sans qu'il restât seulement la possibilité d'une hypothèse pour éclairer un pareil gouffre ? Eh bien !, continue Bloy, cela ne changerait rien à la Vie divine qui est la seule histoire et cela ne changerait rien non plus à cette intangible incertitude qu'étant des «images» de Dieu, nous sommes appelés à tout connaître» (pp. 215-6). Fantastique retournement, qui n'est paradoxal qu'en apparence, puisque Léon Bloy donne la clé de son herméneutique inspirée : «Tout ce qui s'est accompli sur la terre sera devant nos yeux quand il le faudra, devant nos vrais yeux invisibles et impérissables et ce sera un éblouissement du Paradis, d'apprendre enfin pourquoi certaines choses ne nous furent pas montrées». Si nous ne voyons rien ou si peu (3), nous verrons et saurons tout, puisque notre nature est conformée à celle de Dieu !
Un jour peut-être nous saurons tout mais, en attendant, notre perception est plongée dans les ténèbres, et l'Histoire nous demeure non seulement incompréhensible mais choquante : «On sait que Dieu est toujours adorable, mais comment le pénétrer ? Pourquoi ces interruptions brusques, ces avortements soudains ?», Bloy poursuivant en écrivant que la «gloire d'un Tzimiscès ou d'un saint Louis, par exemple, a l'air de correspondre humblement à la Gloire divine et voilà que Dieu met tout par terre», l'écrivain concluant son propos par ces paroles qui ne sembleront déroutantes qu'à celles et ceux qui ne l'ont pas lu, ou mal lu : «C'est un gouffre où se perd la raison de l'homme, Tzimiscès était condamné depuis des siècles» (p. 219), «les ténèbres déjà très denses résultant de la pénurie documentaire» étant «aggravées encore par l'obscurité intérieure de celui qui devrait les dissiper» (p. 227, à savoir l'historien lui-même bien sûr.
C'est dans le troisième chapitre de notre livre, consacré à l'implacable Basile II, «tueur de Bulgares», que Léon Bloy condense son propos, par le biais de l'exemple de ce grand homme (au sens que Carlyle donnait à ces termes, que nous pourrons sans trop de mal confondre avec celui de héro) qu'est Basile, «moine de la toute-puissance», qui n'eut «ni femme ni enfants», et qui «voulut toujours la même chose, ce qui est la plus grande force du monde, celle qui fait le plus ressembler un homme à un dieu» (pp. 230-1). Basile est fascinant, dont «les neuf dixièmes de ses prodigieuses guerres ne nous seront visibles que dans la lumière de Dieu» (p. 231), comme Napoléon aurait pu affirmer qu'il a été poussé vers un but qu'il ne connaissait pas et que, quand il l'aurait atteint, un atome aurait suffi pour l'abattre, ce que confirme Léon Bloy qui écrit : «Mais il paraît que Dieu avait assez de tous les projets des hommes et le trépas quasi soudain de ce Tueur «sonna le glas de la puissance byzantine dans la péninsule»» (p. 244). Une fois de plus, l'histoire de ce célèbre tueur de Bulgares nous demeure impénétrable, mais uniquement en apparence, puisque l'Histoire n'est rien de plus que le «palimpseste à peine surchargé» qui est en chacun de nous, «car nous sommes vraiment des ressemblances de Dieu et tout ce qui s'est accompli dans les siècles a laissé en nous son empreinte» (p. 233, l'auteur souligne), ce qui est absolument logique puisque nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, raison pour laquelle l'écrivain conclut ce passage par une image superbe : «Le dernier soupir de chaque homme est un vent violent qui ouvre ce livre où tout est écrit», merveilleuse mais aussi terrifiante façon de dire que l'homme est la créature la plus proche de Dieu qu'il est possible de rêver.
Cette compénétration est d'une autre espèce, qui fait directement allusion à l’Épitre aux Colossiens (en 1, 24), lorsque Bloy écrit que : «Quand on lit l'histoire de n'importe quel peuple, l'imagination chrétienne s'épouvante en songeant aux souffrances presque infinies, à ce déluge universel de souffrances qu'il a fallu que des centaines de millions d'hommes endurassent, tout le long des siècles, pour compléter «ce qui manque à la Passion de Jésus-Christ», selon la parole effroyablement mystérieuse de saint Paul aux Colossiens !» (p. 235), l'Histoire de l'homme n'étant rien de plus que celle de ses douleurs, que celle de la Douleur qui, brique après brique (4), bâtit un édifice infini dirait-on, puisqu'il doit s'ériger à la formidable hauteur du Christ en Croix, édifice infini, dont la construction est infinie, puisqu'il peut être détruit à tout moment : «Or, je l'ai dit, Dieu ne voulait plus de ce mime sanglant, il lui en fallait d'autres, tout aussi couverts de sang, mais ne risquant pas d'éblouir, pour que se préparassent l'abaissement extrême et la destruction de cet empire qui avait tant désobéi au Vicaire de Jésus-Christ !», la sagesse humaine, une fois de plus, étant «singulièrement déconcertée par l'impuissance caractéristique, manifeste, constitutive et capitulaire de la plupart des grands hommes à fonder n'importe quoi pouvant durer plus d'un jour» (p. 247).
L'Histoire telle que Léon Bloy la peint n'est donc rien de plus qu'une «continuelle réitération d'avortements», la petitesse n'étant pas moins demandée que la grandeur (Bloy met une majuscule à ces deux mots dans son texte) «dans le laboratoire des prodiges», où les «successions disparates ou désespérantes» s'opèrent «indiciblement dans un mode mystérieux et adoré, en vue de compensations ou de récupérations ineffables», cet ensemble de caractéristiques se concluant de façon grandiose, par un long passage que je cite dans son intégralité : «L'Histoire, phénomène ou illusion» qui est, de toutes, «la plus incompréhensible», insiste Léon Bloy, «est le déroulement d'une trame d'éternité sous des yeux temporels et transitoires. On croit voir d'énormes espaces, on ne voit pas à trois pas. Mon ami, mon frère tourne le coin de la rue. Je ne le vois plus que dans ma mémoire, qui est aussi mouvante et aussi profonde que la mer. J'en suis aussi séparé que par la mort. Il est toujours, je le sais bien, sous l’œil de Dieu, mais pour moi, il est tombé dans un gouffre. Ce coin de rue, c'est n'importe quel tournant de l'Histoire» (pp. 248-9).
Voici la suite, qui se passe de commentaires, tant elle ramasse de façon brutale, éclairante en somme (je pense ici à l'éclair plus qu'au fait d'éclairer) toute la pensée de l'écrivain : «Il y a aussi l'angoisse des cœurs magnanimes. Fils d'Adam, notre solidarité est infinie. De même que nous avons tous péché dans le premier désobéissant, nous continuons de pécher sans excuse dans tous les continuateurs de la Prévarication. De sorte qu'en ce négoce admirablement universel, il n'est pas une iniquité dont nous ne soyons à la fois les créanciers et les débiteurs. [...] Toutes les atrocités humaines, depuis le commencement, aussi bien que les plus saints actes, sont imputés avec justice à ce nouveau-né qui pleure en dormant dans son berceau. La postérité de dix siècles, non plus que l'immensité des espaces, ne saurait constituer un alibi pour des immortels et des fils de Dieu» (p. 249, l'auteur souligne).
Voici la conclusion de ce passage, qui relie cette étonnante vision à celui qui, plus que tout autre, aura dilaté sa pupille pour tenter d'apercevoir ce qui se trouve derrière l'horizon borné et plombé des autres hommes, et fait sien, dans chacun de ses textes, ce propos qu'il écrivit le 6 janvier 1910 dans son Journal au sujet de son livre sur Napoléon, «L'invisible par le Visible. Formule précise où il me semble que je pourrais tout enfermer» (cité dans notre ouvrage, p. 15, l'auteur souligne) : «L'histoire est pour moi comme une ruine où j'aurais vécu de la vie la plus intense avant qu'elle ne devînt une ruine. Sensation douloureuse et paradisiaque d'avoir mis son cœur dans des choses très anciennes qui paraissent ne plus exister. Je visite Byzance comme Schlumberger visitait les ruines d'Ani, capitale antique des rois d'Arménie, en soutenant de mes mains faibles, au-dessus de ce grand vestige de mon âme, tout le firmament étoilé».
Notes
(1) Sous un titre différent de celui que l'écrivain aura finalement retenu, pour l'édition Crès en 1917 : L’Épopée byzantine et Gustave Schlumberger. C'est par erreur que notre édition, cinquième tome des Œuvres de Léon Bloy, donne en première de couverture le titre Byzance et Constantinople.
(2) Le «Paradis récupéré» n'est en fin de compte que l'autre nom de l'Apocalypse, l'Histoire s'étirant de l'un à l'autre, du Paradis perdu au Paradis reconquis, comme un immense tissu tout imprimé de symboles en partie indéchiffrables : «C'est, en même temps, celui des grands hommes [Basile II] dont il fut le moins écrit, comme s'il y avait en lui un secret, comme s'il était le gardien formidable d'une des clefs de la symbolique Histoire au moyen desquelles doit s'ouvrir, un jour, le Paradis récupéré» (p. 176). Ailleurs, nous lisons que les hommes cherchent, «en pleurant et en égorgeant leurs frères», le «chemin du Paradis perdu» (p. 226).
(3) «Il est probable que, chaque jours nous passons à côté de l'Arbre de la Science du bien et du mal, sans même le voir, et cela est assurément un inestimable bienfait. Cependant Dieu qui a pitié de nos âmes curieuses permet que quelques fruits aux trois quarts mangés des vers soient ramassés dans son ombre par des impatients tels que Schlumberger qui n'ont pas le courage d'attendre la vision béatifique» (p. 216), Schlumberger et, bien sûr, Léon Bloy lui-même, monstre s'il en est d'impatience.
(4) Quelle superbe image que celle-ci ! : «On plaça, détail héroïque qui peint bien ces ardents seigneurs de la tente, sous la tête du cadavre couché dans sa litière, une brique faite de la poussière et de la sueur, qu'après chaque combat contre les chrétiens, avant le bain du soir, le strigile du masseur avait fait tomber de la peau de Seîf Eddaulèh» (p. 184, tout le passage est en italiques). Ce grand texte de Léon Bloy est riche de très belles images, dont je donne quelques exemples, comme celle-ci : «Les chevaux des émirs avaient mangé l'avoine sur les autels de toutes les basiliques de Syrie et les vases sacrés avaient servi à les désaltérer» (p. 192, ce passage étant entièrement en italiques). Encore, et l'écrivain ne s'y trompe pas : «Quelle scène, quelle exhibition en ce lieu, par cette nuit noire, dans cet ouragan de neige ! La multitude épouvantée, levant les yeux de toutes parts vers la sombre masse des bâtiments du Boucoléon, n'apercevait qu'un point lumineux qui attirait tous les regards; c'était ce groupe d'hommes, vivement éclairés par les torches fumeuses, agitant par ses longs cheveux encore noirs la tête ruisselante de sang du grand basileus Nicéphore» (p. 202, ce passage étant entièrement en italiques). Enfin : «À l'heure probable où Notre-Seigneur Jésus-Christ prêt à souffrir la Passion, avait dit à ses apôtres : «Ceci est mon corps, ceci est mon sang», il y eut dans la ville en flammes, 8 000 corps des fils géants de la steppe, couchés dans leur propre sang» (p. 210, l'auteur souligne).
19:00 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon bloy, livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.