mercredi, 05 janvier 2022
Luc-Olivier d'Algange: entretien avec André Murcie

Luc-Olivier d'Algange: entretien avec André Murcie
Entretien réalisé pour Littera-incitatus
Vous avez, cher Luc-Olivier d'Algange, publié naguère aux éditions Arma Artis, trois ouvrages, qui attendent actuellement (après le décès de Jean Marc Tapié de Céleyran, admirable éditeur, fondateur d'Arma Artis, dont il présidait, presque seul, aux destinées hautement philosophales) une réédition dont j'espère qu'elle sera aussi prochaine que possible. L'avis aux éditeurs audacieux est lancé ! Il s'agit de Fin Mars. Les hirondelles, qui est un recueil d’hommages à des auteurs et des lieux qui vous tiennent particulièrement à cœur, Terre lucide, écrit en collaboration avec Philippe Barthelet, sous-titré « entretiens sur les météores », et enfin, Le Chant de l’Ame du monde, qui s’achève par une Ode au Cinquième Empire, en hommage à Dominique de Roux. Il me semble que ces ouvrages, aussi distincts qu’ils soient par la forme, témoignent entre eux d’affinités et de résonances qui les inscrivent dans un même dessein. Pouvez-vous nous parler de ce dessein, autrement dit de ce qui, antérieur à votre écriture elle-même, suscite votre écriture, ou bien est-ce là s’aventurer dans une zone inviolable, radicalement inconnue, ou d’avance récusée théoriquement ?
Luc-Olivier d’Algange : - J’aime ce mot : dessein, que vous utilisez. Il me semble que notre temps, si planificateur, est aussi riche en « plans de carrière » qu’il est pauvre en desseins créateurs… Le dessein n’est pas un calcul sur l’avenir, et s’accorde fort bien avec ce que l’on peut nommer le hasard, la fortune, la chance ou la grâce. En écrivant, si l’on se tient à la disposition de ce qui advient on va littéralement Dieu sait où. Une grande part est laissée à l’aventure, « à la venvole » pour reprendre la formule de Philippe Barthelet.
Si l’écriture n’est pas seulement expression d’une pensée antérieure, si le langage est partie constituante et non seulement partie constitutive de la pensée, il s’en faut de beaucoup que l’œuvre ne soit qu’un « travail du texte ». En amont de notre langue, le Logos, qui se tient dans son royaume de silence, œuvre, à notre insu parfois, à notre délivrance et à notre souveraineté. En écrivant, nous sommes ses Servants. Une trame secrète se révèle peu à peu. Je ne puis me défendre de l’idée, peut-être étrange à la plupart des intellectuels modernes, que le livre que nous écrivons est déjà écrit dans quelque « registre de lumière », pour reprendre la formule des théosophes persans, dans un « suprasensible concret », que nos phrases tracées sur le papier (j’appartiens à ces archaïques qui s’offrent encore le luxe d’écrire avec de l’encre sur du papier) se révèlent par gradations, comme dans une lumière croissante. J’en veux pour preuve cette impression d’aurore fraîche, presque dure, qui environne le moment où nous allons commencer à écrire… Une phrase survient, et nous savons si peu où elle va nous conduire qu’il faut bien se rendre à l’évidence que nous ne sommes plus dans une activité susceptible d’être planifiée … Un ordre préside à ce chaos d’intuitions, une cohérence née de l’improvisation elle-même, et qui ne pouvait naître autrement. La notion d’inconscient, en l’occurrence, ne me paraît que partiellement opérante, et s’il s’agit bien d’un inconscient, je serais plutôt enclin à penser à l’inconscient de la langue française elle-même, sa part immergée, songeuse, étymologique, nervalienne, sa vérité héraldique, tisserande, qui, se servant de nous pour se révéler, nous tient littéralement à sa merci.

Tout cela pour vous dire que ni l’objectivité du travail stylistique, ni la subjectivité expressive ne me paraissent pouvoir rendre compte de ce qui est à l’œuvre. Ce qui se dit à travers nous nous appartient parce que nous lui appartenons, et cette appartenance, et là seulement intervient notre entendement singulier, nous libère, nous élargit, nous restitue à cette latitude humaine et divine que presque tout, dans le monde affairé où nous vivons, contribue à restreindre à l’extrême. Le Logos, en hauteur, en largeur et profondeur, dès lors que nous consentons à le servir avant de servir ce que nous croyons être nos compétences et notre subjectivité, nous ouvre à des vastitudes insoupçonnées. Ces vastitudes, plus encore que celles que l’espace visible, sont les espaces du temps.
Dans Fin Mars. Les hirondelles, dont le titre est un hommage à celui que Philippe Barthelet nomme « l’altissime Joseph Joubert », mon dessein fut de rendre le temps visible : temps des œuvres, des civilisations, et encore le temps comme attention, comme attente paraclétique, incandescente, telle qu’elle brûle dans les œuvres d’André Suarès ou de Dominique de Roux, ou, bien avant, dans celles de Ruzbehân de Shîraz, de Sohravardî, ou encore, d’une façon différente, chez Hölderlin ou Hermann Melville… Certaine oeuvres font date, elles participent des rythmes du temps, du renouveau du temps, et à partir d’elles si magnifiquement fidèles aux clartés antérieures, d’une certaine façon, tout recommence…. Et ce recommencement qui témoigne d’un au-delà du temps n’est lui-même qu’un retour à la vérité de l’être, c’est-à-dire à l’éclaircie de la toute-possibilité. Tout soudain, à relire ces auteurs, redevient possible ! Nous voici, les lisant, dans un usage sapientiel de la lecture, qui nous restitue à ce dont nous étions séparés par des illusions funestes… Voici l’inépuisable richesse du réel qui va de la substance la plus opaque à l’essence la plus lumineuse, en gradations infinies, dans ce chromatisme prodigieux dont surent si bien parler Ibn’Arabî et Jacob Böhme, mais aussi, d’une autre manière, ces écrivains, tels que Henri Bosco ou Henry Montaigu, qui, sourciers à l’écoute des ressources profondes de notre langue, en laissent circuler les vertus jusqu’aux plus hautes branches, aux plus fines, aux plus impondérables, les mieux accordées aux rumeurs célestes et aux puissances telluriques.
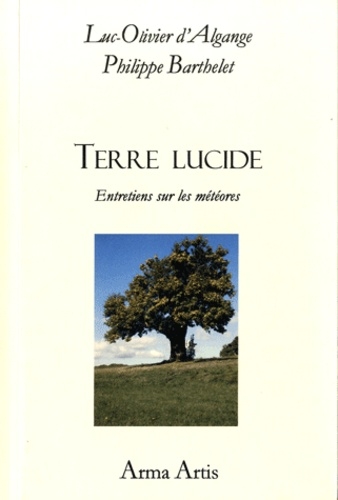
Nous voici précisément, il me semble, au cœur de votre ouvrage commun avec Philippe Barthelet, Terre Lucide, entretiens sur les météores. Il s’y dessine aussi un autre recours, celui de l’amitié, de la conversation, contre tous les systèmes et toutes les idéologies, ou plutôt, en dehors d’elles.
Luc-Olivier d’Algange : - Il y aurait peut-être une sorte de redondance à s’entretenir à propos d’un ouvrage qui est déjà un entretien, sinon à rappeler (comme hommage à ce qui me fut une chance rare) que Philippe Barthelet est, par ailleurs, l’auteur d’un vaste « roman de la langue française », qui s’ouvre, à chaque phrase, sur la plus exacte et la plus profonde méditation métaphysique. Le propre de notre ouvrage étant de ne pouvoir se résumer, de même que l’on ne peut résumer une promenade au bord d’un fleuve (et l’on sait aussi, par Héraclite, que « l’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve »), je laisse le lecteur, si le cœur lui en dit, à découverte de ce livre quelque peu maistrien et dont il pourra lui-même, dès lors notre invité, être à la guise le Comte, le Chevalier ou le Sénateur ! Disons seulement qu’en ces temps monomaniaques, idéologiques et puritains rien ne semble plus rare que les bonnes conversations, et je ne suis pas loin de penser que presque toutes les œuvres dignes d’êtres lues participent ou invitent à une conversation ; qu’elle soit, bien sûr, avec le lecteur, ou avec des prédécesseurs, voire avec les êtres et les choses les moins saisissables : nuées, nuances, météores, signes du ciel… En réalité, il n’y a pas de monologue, sauf chez les fous ou les Modernes. Toute œuvre est, par nature, dialogique
Le Chant de l’Ame du monde est-il, en suivant votre idée, un dialogue avec l’Ame du monde ?
Luc-Olivier d’Algange : - L’Ame du monde est ce qui rend possible les conversations. Elle est la lucidité de notre terre. C’est dire qu’elle n’a rien d’abstrait ; elle n’est pas davantage, s’il faut le préciser, une sorte de « world music » adaptée aux besoins euphorisants du village planétaire, quand bien même lui revient une prérogative irrécusable d’universalité : celle du cosmos, tel qu’il se figure sur le bouclier de Vulcain dont parle Virgile. L’Ame du monde est la Sophia… Entre le sensible et l’intelligible, elle recueille les éclats de l’un et de l’autre, dans leurs mouvements, leur ressacs, leurs réminiscences qui irisent la présence pure. L’Ame du monde ne se conceptualise pas. Elle affleure, elle transparaît, dansante comme à travers le feuillage bruissant, comme l’épiphanie de la lumière sur l’eau, vérité insaisissable et lustrale, réfractée et diffractée, en splendeur, là où adviennent les Anges et les dieux, ces réalités à la fois intérieures et extérieures. Mais les poèmes, je le crains, ne se résument pas davantage que les conversations…
L’impression nous vient que, les ayant écrit, vous n’avez pas particulièrement de commentaires à ajouter à vos livres, soit par humilité, soit que vous les considériez comme derrière vous, soit que vous en laissiez le propos à vos lecteurs… S’il ne vous déplaît pas, nous aimerions cependant poursuivre cet entretien par des considérations plus générales, politiques, poétiques, et métaphysiques, qui nous reconduiraient à ce qui a donné naissance à ces ouvrages… Et pour commencer, quels sont vos Maîtres ?
Luc-Olivier d’Algange : - Nos écrits ne sont pas toujours « derrière nous », ils sont peut-être lancés en avant, ce vers quoi nous cheminons ; ce qui rendrait d’autant plus difficile d’y revenir, d’en faire le commentaire, sans compter le ridicule à être son propre glossateur ! Et puis, le « monde culturel » me semble avoir tourné de telle façon que l’on cherche bien souvent à se faire une idée des ouvrages d’un auteur sans les lire. Alors autant ne pas abonder dans le sens de cette mauvaise paresse et s’attarder indûment sur ce qui a déjà été écrit, et qui le fut précisément, pour échapper à ces quelques opinions, abstractions ou généralités où les gens « informés » voudront les ensevelir ! En revanche, et j’en suis bien d’accord avec vous, parler de ses Maîtres est un devoir de gratitude, et surtout une joie qui renouvelle celle que nous avions à les lire.
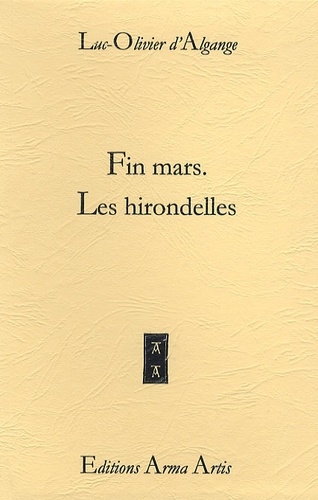
Je considère comme des Maîtres tous les auteurs qui m’ont appris quelque chose, et ils sont nombreux. Mais pour en distinguer quelques uns, outre ceux dont je parle dans Fin Mars. Les hirondelles, peut-être convient-il d’en revenir aux premiers en date, à ces lectures de l’adolescence, qui nous donnent des raisons d’être, nous confirment dans nos audaces, affermissent notre courage et notre intelligence. Au monde souvent mesquin et étriqué qui s’apprête à nous dévorer dans la tendreté de notre âge, ils opposent un contre-monde, qui n’est pas un refuge mais une exigence plus haute. Ceux-là sont des amis ; ils nous donnent des armes et nous montrent le monde plus grand, plus intense, plus aventureux. Car enfin, l’inanité est là, depuis notre adolescence : le monde devient un monde-machine, toutes les souverainetés sont corrodées, arasées. L’infantilisme et la bestialité triomphent sur tous les fronts, et après deux ou trois vagues de totalitarisme, depuis la Terreur de 1793, les hommes se sont si bien habitués à n’être que des « agents » et des « rouages », leur servitude volontaire est si bien intégrée à leur complexion, à leur physiologie même, que la survie de l’esprit humain, dans ses pouvoirs de discrimination et ses puissances poétiques, est devenue des plus aléatoires, alors même que la Machine, autrement dit, la société de contrôle (qui succède, pour tout arranger, aux sociétés de souveraineté et aux sociétés disciplinaires) travaille sans relâche à éliminer précisément toute chance d’être, toute chance, selon le mot d’Hölderlin « d’habiter en poète ». Deux maîtres donc : Villiers de L’Isle-Adam et Hölderlin.
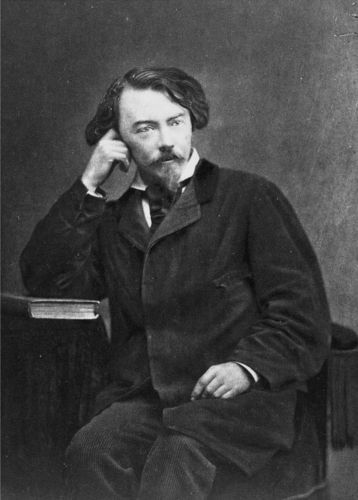
Villiers de L’Isle-Adam fut l’auteur qui m’arracha à ce qui me semblait devoir être une triste singularité. Il me vint à cet âge inquiet où il s’en faut de peu que nous ne concevions, non sans quelque effroi, être fort esseulés dans notre pensée. Certaines œuvres sont, pour ainsi dire, en forte teneur d’amitié spirituelle. Il semble qu’une main nous soit tendue, mais avec une arme, fraternellement, à nous qui étions désarmés. Une contradiction se trouvait résolue. Nous pouvions donc, en même temps, récuser la société et consentir à être les héritiers de la civilisation, porter un songe de splendeur et exercer nos sarcasmes à l’égard d’un monde qui s’acharnait en médiocrités despotiques à nous rendre la vie apeurée, misérable et banale. Refuser d’un même geste l’avilissement et le nihilisme, ne pas vivre en bête traquée, tout cela tient dans la dédicace de L’Eve future : « Aux railleurs, aux rêveurs ». Le rêve devenait ainsi, non plus une fuite, mais un Songe plus haut, fondateur, celui-là même dont naissent les civilisations. Les Contes Cruels anticipent, en tout point, et parfois à partir d’infimes indices, ce monde ridicule, malfaisant et sinistre que décrira plus tard, mais en l’ayant sous les yeux, Philippe Muray… Villiers de L’Isle-Adam, lui, nous donne l’alexipharmaque avant même que le poison ne ruisselât dans nos veines ! Magistrale leçon d’ironie guerroyante, ouverte à chaque phrase sur des hauteurs et des profondeurs métaphysiques ; humour cruel et fidélité pure, c’est-à-dire brûlante, à l’égard de ce qui, dans notre bref séjour ici-bas, nous tient dans la proximité ardente de la voix du cœur et de la beauté ; pessimisme alerte et joyeux ; ethos héroïque qui répond, avec la désinvolture aristocratique qui lui est propre à la mise-en-demeure d’Hölderlin : « A quoi bon des poètes en des temps de détresse ? » A quoi bon ? A rien du tout… Mais à l’entendre ainsi, dans la définition que Pessoa donne du Mythe, « ce rien qui est le tout », sceau invisible de cette visible empreinte qu’est le monde.

Nul, de façon plus radicale qu’Hölderlin, n’eut l’audace de se tenir en cet espace intermédiaire, à la fois éblouissant et ténébreux, mais aussi parfois clair d’une douce clarté et comme à l’ombre de feuillages orphiques, où le Mythe vient à la rencontre du réel pour en révéler la nature véritable. Hölderlin n’écrit pas à propos du Mythe, ses poèmes ne sont pas des poèmes mythologiques, au sens néo-classique ou romantique, mais des épiphanies survenues, de façon imprévisible, à l’intérieur de la langue allemande. Hölderlin parle de l’intérieur : il est le feu qui éclaire et consume. Le sacré, le Mythe sont, chez Hölderlin, des advenues, l’apparaître de l’apparition elle-même, qui naît au moment où nous naissons avec elle. C’est ainsi qu’il peut laisser transparaître l’une dans l’autre la figure du Christ et celle d’Apollon, c’est ainsi que sa poésie nous dit, du sacré, une profondeur en attente, qui, jusqu’à présent, fut à peine entrevue, c’est ainsi que le plus lointain, le plus antérieur, s’irise dans ses écrits comme une promesse encore insoupçonnée.
La plupart des œuvres, quand bien même s’amoncellent à leur sujet des thèses universitaires, n’ont pas encore été lues. Je veux dire que réduites au statut d’objets, un interdit à les lire n’a pas encore été levé. Etudiant les œuvres, les tenant à distance par des méthodes critiques, on s’épargne la chance et le risque d’en être ravi, c’est-à-dire dépossédé du rôle d’analyste auquel se complaisent nos arrogances intellectuelles. Au-delà même de l’expérience sensible et intelligible que nous pouvons avoir d’une œuvre, qui est déjà elle-même supérieure à la simple étude universitaire, une autre possibilité demeure « en réserve », selon la formule de Heidegger, qui est celle de la relation avec l’œuvre. C’est du passage de l’expérience à la relation, c’est à dire à la survenue d’une conversation dont témoignent à leur mesure Fin Mars. Les hirondelles, et, d’une façon plus directe encore, Terre Lucide. En son hiver, il me semble que notre civilisation est en attente d’un printemps herméneutique, d’une terre lucide annoncée par ces météores, ces « signes du ciel » que sont les œuvres des poètes.
Nous retrouvons dans ce printemps herméneutique, votre méditation sur les saisons, sur le retour, sur le temps qu’il fait et celui qui passe. Quel serait le « temps » de l’herméneutique ?
Luc-Olivier d’Algange : - L’herméneutique nous initie à une autre temporalité. Ni le cercle, ni la ligne droite mais une sorte de spirale qui, repassant par les mêmes points, nous porte plus haut. L’herméneutique, et que l’on entende bien sous ce vocable austère, un voyage odysséen et non un travail d’expert, fait apparaître dans une œuvre plus qu’à première vue. Ressaisissons notre bien : ne le laissons pas au seul usage des spécialistes. Les œuvres sont des signes d’intelligence que nous adresse l’aléthéia, la vérité qui n’est pas objet d’évaluation mais l’instant de sa propre révélation. Les abysses lumineuses des poèmes d’Hölderlin disposent nos entendements aux abysses lumineuses de l’instant qui est l’éternité même. Celle qui oscille dans les fleurs de cerisiers !
A chacun d’entre nous une œuvre reste à accomplir qui est de se réapproprier ce dont le monde-machine nous a exproprié : les paysages, les heures, les noces d’Eros et de Logos, la qualité et la dignité des êtres et des choses. Mais cette recouvrance si elle exige une décision résolue, n’implique nulle âpreté. Il ne s’agit pas d’être crispé sur son dû, mais de s’abandonner à ce qui nous appartient : ce temps qualifié, ces événements de l’âme. Nous reprenons possession du monde comme d’un texte sacré en refusant de le planifier, en lui laissant la chance de nous faire signe, en aiguisant notre entendement à percevoir ces subtiles invitations par-delà « le vacarme silencieux comme la mort » dont parlait Nietzsche.
Voyez comme les prétendants littéralistes préjugent dans les textes sacrés de la « vérité » qu’ils y veulent trouver pour ensuite l’administrer, et comme ils laissent peu de place à la surprise, et comme ils trahissent en réalité la lettre à laquelle la véritable herméneutique retourne, comme Ulysse après son périple. Toute opinion est fondamentaliste, hostile par ses prémisses et ses usages à l’aventure de l’esprit. S’il importe de ne jamais oublier que nous vivons sous le règne de l’Opinion, il importe encore davantage de ne pas se laisser subjuguer ou obnubiler par la terreur qu’il prétend nous inspirer. Ce qui n’est pas, fût-ce en néant dévorant, ne peut en aucune façon triompher de qui est, ni empêcher ce qui fut d’avoir été et de demeurer présent dans la présence, dans la délicieuse anamnésis dont l’essor se confond avec le pressentiment lui-même, avec ce qui crée et ce qui fonde.
La didactique coutumière, scolaire, oppose le platonisme et l’hédonisme, comme elle suppose que la philosophie platonicienne oppose le sensible et l’intelligible pour déprécier l’un au détriment de l’autre, alors qu’elle les hiérarchise, ce qui est tout différent ! Cette mésinterprétation banale de la pensée platonicienne procède de la difficulté que nous avons, nous autres modernes, à sortir d’une pensée de l’antagonisme. Hiérarchique, graduée, la pensée platonicienne récuse par avance l’antagonisme que les exégètes futurs y voudront introduire. Le sensible ni l’intelligible ne sont, en soi, préférables l’un à l’autre, ce ne sont pas des camps, des partis, mais des modes opératoires de notre compréhension du monde et dont les œuvres sont les noces ardentes.

Si l’on me dit qu’un hédonisme néoplatonicien est impossible, que la louange du sensible, la relation extatique avec le monde sensible est impensable par la célébration de l’Idée, de la Forme, eh bien soit : je l’invente, je la rend possible, je l’instaure, j’en fais la prémisse d’une philosophie nouvelle ! Mais, à dire vrai, je ne crois pas être si novateur, mais seulement l’héritier d’un courant philosophique moins connu, moins balisé, d’une façon de philosopher, d’un poien qui, à l’exemple de Plotin, de Sohravardî, de Ruzbehân de Shîraz, de Pic de la Mirandole, ou de Marsile Ficin, hiérarchise pour ne pas opposer, ce qui appartient au visible et ce qui appartient à l’invisible, l’un et l’autre n’étant que des moments différents de l’apparaître.
Cette tradition héliaque, métaphysique et patricienne, tenue à l’écart par une idéologie dominante, lunatique et matérialiste (celle précisément des « hallucinés de l’arrière-monde » dont parle Nietzsche) me semble non seulement devoir être défendue et illustrée, par l’exemple, par la beauté du geste, mais aussi en tant qu’art poétique et romanesque, si lassés de l’expression de la subjectivité, nos contemporains désirent à nouveau tenter la grande aventure des états multiples de l’être et de la conscience. De même que le printemps herméneutique éveille et discerne dans les textes les « états » et les « stations », les degrés et les plans d’interprétation différents, on peut espérer et imaginer un printemps poétique et romanesque où, à l’hiver du durcissement des certitudes, à l’aridité et aux froidures conceptuelles, formalistes ou vengeresses succéderait un ressaisissement du chant et de la vision.
« Ne servir que sa vision » écrivait Dominique de Roux, qui recommandait aussi de ne pas oublier notre exil fondamental, et que « nous sommes partout et toujours en territoire ennemi » : observation qu’il importe, il me semble, de ne pas prendre dans un sens pathétique, mais plutôt pragmatique, à la façon de Marc Aurèle. Chaque heure que nous sauvons de la confusion, de l’agitation, des promiscuités débilitantes, chaque heure sauvée de l’endormissement hypnotique du travail et des distractions, chacune de ces heures est une victoire : nous y retrouvons, sauvegardées et d’une fraîcheur castalienne la puissance, la beauté et bonté. Les mots ont le pouvoir de recréer ce qu’ils détruisent.
Que pouvez-vous nous dire à propos de cette tension entre le pouvoir créateur et le pouvoir destructeur du langage ?
Luc-Olivier d’Algange : - Les mots tuent, au propre et au figuré, et parfois d’ennui. Les totalitarismes nomment pour tuer en renversant la « logique » de la divine création qui nomme pour faire advenir à l’être. Le totalitarisme dédit ; son jargon est la mesure de sa perversion : ce qu’ont démontré, de façon magistrale, Orwell ou George Steiner. La définition du mal échappe aux moralisateurs pour autant qu’ils méconnaissent cette atteinte au Logos ou au Verbe. S’il est bien souvent question, dans Terre lucide, des ressources de la langue française, c’est qu’en elles s’avivent nos pensées. Par cette langue nous appartenons à une tradition qui nous libère de nos subjectivités outrancières et nous donne la latitude de penser, c’est-à-dire de peser le juste et l’injuste… Il n’est pire conformisme que celui du « non-conformisme » où chacun croit pouvoir penser par lui-même dans le déni de toute tradition et de tout héritage, et s’en trouve ainsi penser comme tout le monde, exactement selon le vœu des « prescripteurs » de la publicité. Les dogmes, les doctrines, laissaient encore la part à la critique, alors que le conformisme de l’informe est une glue, un totalitarisme sans issue, car il enferme chacun en lui-même… Bienvenue dans le monde du « chacun pour soi » où règne le grégarisme au suprême, où la bétaillisation de l’être humain se fonde non plus sur un despotisme discernable mais sur une servitude volontaire, oublieuse de sa volonté, relayée par la technique et devenue presque physiologique, au point qu’il n’est pas absurde parler d’une post-humanité, mais régressive, à la fois hyper-technologique, numérisée, clonée, et psychologiquement réduite à l’infantilisme. Le conformisme de l’informe devient ainsi le principal recours des faiblesses coalisées contre la singularité et la force, en meutes d’autant plus impitoyables qu’elles travaillent, comme l’écrivait Philippe Muray, pour « l’empire du Bien ».
Que reste-t-il alors des sentiments humains, une fois débarrassés des intempestives grandeurs ? La langue s’y étiole, l’entendement s’y rabougrit, la privation sensorielle s’instaure disposant la conscience à ne percevoir que des représentations secondes, au détriment de la présence réelle des êtres et des choses, présence réelle qui contient en elle les abysses et les hauteurs, une verticalité qui sacre l’Instant, notre seul bien… Le printemps herméneutique est à la pointe de chaque phrase lue ou écrite amoureusement ! Le printemps herméneutique est la floraison du Logos qui, à partir de ses racines, de ses étymologies, délivre la puissance du silence, de son cœur de feu, de sa vérité paraclétique.

Dans Fin Mars, les hirondelles, vous évoquez le Paraclet, à propos d’André Suarès, d’Henry Corbin et de Dominique de Roux. Pouvez-vous nous préciser ce qu’est le Paraclet, et son « règne » dont certaines œuvres vous semblent l’attente ardente ?
Luc-Olivier d’Algange: - Le Paraclet est l’Esprit-Saint, et le règne du Paraclet qui succède au règne du Fils, comme celui-ci succède au règne du Père, serait l’accomplissement de l’Alliance, l’accomplissement d’une liberté souveraine, d’une terre céleste, lucide… Cependant, je suis loin de prétendre à théoriser en ce domaine, et plus loin encore de comprendre comment s’inscrirait dans « l’histoire », cette succession de règnes qui, d’une certaine façon, m’apparaissent pour ainsi contemporains les uns des autres ; de même que dans l’écriture, qui se situe entre le silence et la parole, le silence de « ce qui n’est pas encore dit » et la parole dont on se souvient, le temps est bien davantage qu’une ligne droite, qu’une historicité déterminable et déterminante…. Entre le Logos rayonnant du silence de la toute-possibilité et la parole filiale, la parole en filiation spirituelle, le Paraclet gradue ses révélations dans notre conscience. Il est cet « entre-deux » entre ce qui est dit et celui qui reçoit la parole, cet espace intermédiaire et impondérable comme le sens lui-même qui s’offre à être traduit du silence.
Le temps a été créé avec le monde pour peupler de réminiscences les commencements sans fins. Chaque phrase que nous écrivons ne vaut d’être écrite que si, d’autorité, elle recommence le monde. Le Logos et le Verbe disent une même réalité cosmogonique. La poésie, à cet égard, consiste moins à ré-enchanter le monde qu’à lui ôter le voile qui nous le désenchante, qu’à l’arracher aux fictions misérables et sinistres qui font que la réalité, comme l’écrivait Rémy de Gourmont, finit par copier les mauvais romans : monde plat, sans syntaxe ni grammaire, mots réduits à leurs écorces mortes, sentiments et vertus réduits à l’apparence qu’ils donnent selon les normes du kitch, dérisoire ou titanesque… Le nouveau règne, celui dont parlait Stefan George, débute sitôt que l’on s’éveille de ce mauvais songe, de cette pensée stéréotypée, binaire, qui nous réduit à l’alternative ou au compromis. Et comme l’écrivait Rimbaud : « là tu te dégages, et voles selon. »
(Entretien réalisé par André Murcie pour Littera-incitatus)
13:45 Publié dans Entretiens, Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écriture, philosophie, entretien, andré murcie, luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.