samedi, 03 février 2024
25 ans plus tard - "Notre grande guerre est une guerre spirituelle. Notre grande dépression est notre vie" (Tyler Durden - Fight Club)
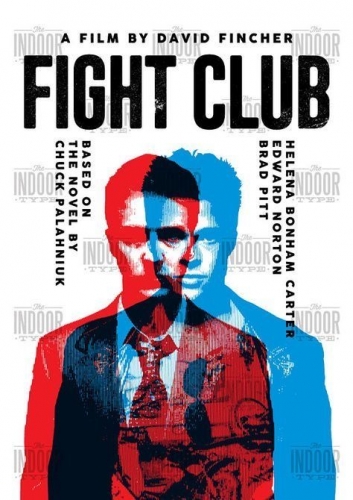
25 ans plus tard - "Notre grande guerre est une guerre spirituelle. Notre grande dépression est notre vie" (Tyler Durden - Fight Club)
Bernard Van Beuseghem
Source: Nieuwsbrief Knooppunt Delta, no 186, janvier 2024
Il y aura 25 ans cette année que Fight Club, adaptation cinématographique du roman culte de Chuck Palahniuk, est sorti en salles. Le film a suscité une énorme controverse en raison de sa violence, de la subversion du machisme par l'acteur principal Brad Pitt et de son humour noir déconcertant. L'un des éléments les plus choquants de cette grandiloquence cinématographique est sans aucun doute la provocation narrative dans laquelle l'excès de graisse des femmes aisées, aspiré par liposuccion, renaît sous la forme d'un rituel grotesque, celui des savons précieux. Satire macabre de la culture de consommation et de l'obsession de la perfection extérieure, le corps lui-même devient une marchandise, une sculpture d'autoglorification dans le temple dystopique du capitalisme. Des critiques influents comme Roger Ebert, lauréat du prix Pulitzer, l'ont qualifié de "film de stars le plus direct et le plus joyeusement fasciste depuis Death Wish". Alexander Walker l'a qualifié d'attaque intolérable contre la décence personnelle et la société elle-même.
Malgré la déception financière au box-office, Fight Club est devenu, grâce aux ventes de DVD, un film culte, une symphonie subversive qui, 25 ans plus tard, résonne encore dans les sombres cavernes de l'esprit cinéphile.
L'histoire
Même dans ce crépuscule contemporain, Fight Club conserve son pouvoir inéluctable, en tant qu'artefact d'une époque particulière: les années 1990. Une période imprégnée de "fin de l'histoire", où les idéologies ont très vaguement subsisté comme des graffitis effacés sur les murs de la conscience collective. L'apogée du capitalisme, sans contrepoids, s'est répandu à travers le monde comme une ombre imparable, et Fight Club est devenu un écho de cette époque, un reflet brut du vide existentiel qui s'est manifesté au milieu de la façade clinquante de l'excès consumériste.
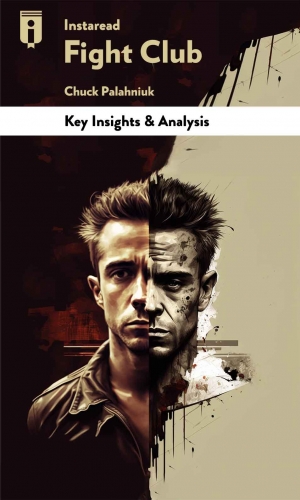
L'œuvre de Palahniuk et son pendant cinématographique pénètrent le cœur sinistre d'une époque où l'individu est pris dans les paradoxes de la liberté et de l'aliénation, dans un monde où le seul "club" qui sévit est celui des consommateurs. À la fin des années 1990 aux États-Unis, le consumérisme semble proliférer comme un cancer, une entité globale qui imprègne le tissu de la civilisation occidentale au point que la publicité ne se voit plus, mais qu'elle est devenue un élément incontournable de l'atmosphère, aussi invisible et omniprésent que l'air que nous respirons sans y penser. Le narrateur, un trentenaire anonyme, dépourvu d'identité et empêtré dans les réseaux de ce qu'il décrit cyniquement comme son "cocooning Ikea", lutte contre les nuits blanches, au cours desquelles l'obsession de la multinationale suédoise pour les meubles domine ses pensées comme un mantra irrésistible. Il chuchote au spectateur la vacuité désespérante de son existence, dans laquelle l'ombre de la superficialité agit comme un compagnon constant. Le narrateur, interprété par Edward Norton, travaille comme coordinateur de "rappel" et s'occupe des réclamations, ce qui l'oblige à beaucoup voyager professionnellement. Le spectateur assiste à une succession d'aéroports, de chambres d'hôtel et de bars. Tout se ressemble. Le lecteur attentif devrait regarder le début du film et lire les premières pages de ce livre-culte que fut Le Système à tuer les peuples de feu Guillaume Faye. On y trouve de fortes et curieuses similitudes (1).
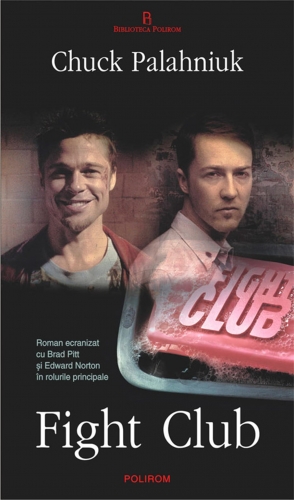
Il y règne un individualisme pathologique, où les émotions authentiques se noient dans un océan d'aliénation. Pour le narrateur, le réveil n'est pas une transition en douceur, mais plutôt une confrontation brutale avec la réalité déchirante d'un monde où les sens sont enivrés par l'odeur enivrante de la superficialité. Son voyage commence dans l'ombre de l'anonymat, là où les autres malades du cancer des testicules s'unissent comme des guerriers silencieux dans une guerre contre un ennemi invisible. Une métaphore, implacable et tranchante comme un couteau chirurgical, de la castration que subissent les hommes dans cette société contemporaine. À l'époque, la "masculinité toxique" n'avait pas encore été élue terme hipster de l'année.
Les rencontres avec ces guerriers anonymes constituent un rituel de renaissance, une initiation à un monde où les émotions brutes de l'existence humaine ne sont plus étouffées par le capitalisme. En embrassant des étrangers, le narrateur découvre une humanité perdue, une rébellion subtile contre l'isolement qui maintient l'homme moderne dans la prison qu'il s'est lui-même créée.
La conscience naissante de sa propre aliénation, comme un voile qui se lève lentement, prend vie. Son alter ego, Tyler Durden (Brad Pitt), prononce des mots qui résonnent comme un écho dans les cavernes de son âme: "Les objets que nous possédons nous possèdent en fin de compte". Une révélation qui dénoue les chaînes de la possession et de la consommation, dans laquelle le narrateur se reconnaît comme une marionnette entre les mains d'un jeu capitaliste qui détermine ce qu'il possède et, en fin de compte, ce qui le possède.
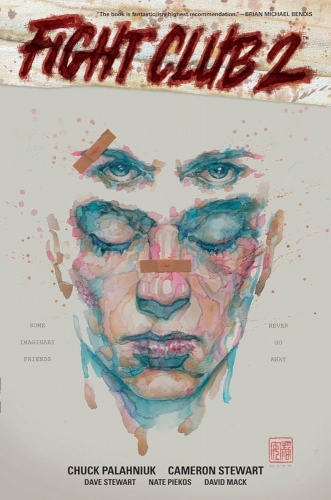
Dans ce cauchemar éveillé, le narrateur réalise que la véritable liberté ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la libération de l'âme de l'emprise étouffante du culte de la consommation. Il s'agit d'une quête d'authenticité dans un monde imprégné d'illusions, où l'étreinte d'un étranger peut avoir plus de sens que le confort apparent des possessions. Face à son propre démantèlement, le narrateur commence enfin à découvrir ce que signifie être vraiment humain, dans toute sa vulnérabilité et sa beauté.
Dans l'ombre d'un monde imprégné de dogmes capitalistes, le désir de libération germe comme une graine qui attend le bon moment pour pousser. La prise de conscience s'impose: l'identité, telle une marionnette suspendue aux ficelles des multinationales, doit être détruite pour laisser place à l'émergence d'une réalité nouvelle et brute. Mais l'esprit, englué dans l'alliance toxique du consumérisme et des antidépresseurs, se révèle un guide peu fiable dans cette quête d'une existence éveillée.
Ce n'est donc pas sur l'esprit qu'il faut agir en premier lieu, mais sur le corps prisonnier du cocon étouffant de la consommation et de l'apathie. C'est là que commence la catharsis de la chair, une renaissance radicale qui se déploie sous la forme du Fight Club. Le refoulement de pulsions longtemps cachées devient un volcan d'émotions brutes, où le narrateur et ses compagnons brisent les normes d'une civilisation occidentale dominée par le contrôle de soi et la retenue.
Le claquement des poings, le bruit des corps qui s'entrechoquent comme une symphonie de chaos non censuré, deviennent des rituels de rébellion contre les limites rigides d'une société qui étouffe la liberté individuelle. Dans la violence apparente du Fight Club, le narrateur découvre une forme paradoxale de maîtrise de soi, un retour aux instincts primitifs qui définissaient autrefois les humains avant qu'ils ne soient étouffés par les chaînes de la civilisation.

La phase du Fight Club est considérée comme une auto-inflammation rituelle qui réveille le corps et le libère des entraves qui le maintenaient en cage. Mais ce n'est qu'un prélude, un prélude à un projet plus vaste, le projet "Chaos". Ici, le corps est transformé en arme, un instrument qui suscite l'émotion et transcende la raison. Dans cette révolte de la chair et des sentiments, un nouvel ordre naît, non pas de la raison, mais des forces primitives qui sommeillent dans l'ombre de l'âme humaine.
Analyse et critique
Inévitablement, au fil des années, nous avons eu droit à d'innombrables analyses du livre et du film. Le philosophe et sociologue Herbert Marcuse (1898-1979) et même Friedrich Nietzsche (1844-1900) y ont été mêlés comme si de rien n'était. Certains l'ont qualifié de film contre la société de consommation et ont cité le philosophe français Jean Baudrillard (1929-2007). D'autres ont qualifié le film de nihiliste, de carrément fasciste et de reflet d'un national-socialisme "à venir". Bon, mais qu'est-ce qui ne l'est pas de nos jours ?
Ce que Fight Club nous apprend finalement, selon d'autres, c'est qu'un projet révolutionnaire sans vision réelle de ce que serait une société post-capitaliste est voué à l'échec. On fait souvent le parallèle avec le magistral Joker de Todd Philipps, sorti 20 ans plus tard. Après tout, le monde dépeint dans les deux films est aussi celui des masses à la recherche d'un leader autoritaire en temps de crise. Il est d'ailleurs frappant de constater qu'à la sortie de Joker, les opinions ont soudain commencé à changer. Soudain, il s'agissait d'un film "dangereux, sombre", etc.

Fight Club, dans toute sa gloire sardonique, embrasse la folie comme une rencontre avec l'essence brute et non polie de l'existence. Tyler Durden, tel un mentor démoniaque, chuchote des suggestions à l'oreille du narrateur, braquant les projecteurs sur l'hypocrisie de la façade humaine. "Soyez authentique dans le monde déshumanisant du capitalisme", peut-on lire dans la philosophie intrépide qui serpente dans le film comme un œil qui cligne de l'œil. Une philosophie qui semble moins destinée à plaire qu'à provoquer. Restons-en là.
Bernard Van Beuseghem
Notes:
(1) Guillaume Faye, Le Système à tuer les peuples,
Editions Copernic 1981, Paris, 189 pp.
ISBN-13 : 978-2859840693
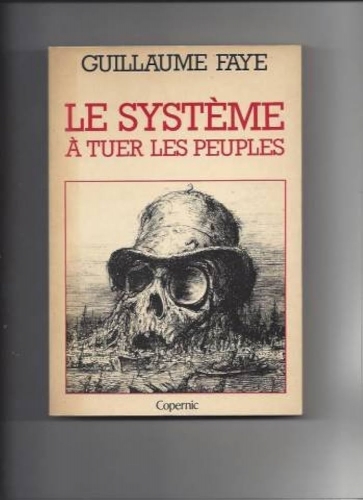
17:57 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, fight club, chuck palahniuk |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 mai 2015
Fight club : de la destruction de l’anonymat à l’âge des héros

Fight club : de la destruction de l’anonymat à l’âge des héros
Avant-propos :
Que cela soit volontaire ou non, l’histoire de Palahniuk, habilement adaptée sur écran par David Fincher, affiche clairement les ambitions d’une révolte radicale, de cette génération broyée entre les mâchoires de la modernité et de l’individualisme triomphant. Décrié à sa sortie comme un film d’inspiration fasciste, « Fight club » est devenu l’icône d’une certaine jeunesse, dévoyée, malheureuse, mais alerte, laquelle, peu à peu, a posé des mots sur ses maux.
S’il entre dans le registre de ces ouvrages d’« anticipation sociale », il est pourtant plus dans la description d’une réalité omniprésente que dans l’appréhension d’un futur incertain et c’est à ce titre qu’il inspira quelques travaux psychosociologiques, qui bien qu’insuffisants, n’en demeurèrent pas moins un appui potentiel à une étude sérieuse du sujet. De sorte que pour la réalisation de cet article, nous avons cru bon d’en étayer l’idée générale, bien que ces vulgaires précédents, tâcherons parodiques d’une véritable analyse, ne présentent au fond que les résidus d’un monde universitaire loin, très loin des préoccupations soulevées par Fincher et Palahniuk.
Partant de cette disjonction, deux professeurs, Jocelyn Lachance et Sébastien Dupont présentèrent dans « La temporalité dans les conduites à risque : l’exemple du film “Fight club” » une vision typiquement conventionnelle de l’œuvre – tout en se faisant gloire d’en faire une relecture originale. En effet, au-delà de la prétention à l’objectivité qui voile d’ordinaire les rendus universitaires, nous percevons sans mal l’avis des auteurs et la critique qu’ils opposent aux personnages, vus comme des adolescents en période de trouble intérieur.
Fight club serait ainsi, pour nos auteurs, la définition évidente du cheminement de l’adolescent en perte de repère, livré à lui même, à la recherche de sens et en marge de la temporalité. Tout se résumerait à un déséquilibre intérieur induisant une remise en question de la société de consommation.
Or pourquoi un déséquilibre est-il source d’une remise en question du mode de vie moderne ? Simplement, car ce mode de vie est par essence déséquilibré, aussi est-il naturel qu’il entretienne une action déstabilisante sur tout ce qu’il touche. Nous pourrions également nous questionner sur cette tendance à estimer que la négation de la civilisation occidentale moderne doive forcément tenir d’une triviale « révolte » adolescente et puérile, et non pas d’un simple constat d’échec qui aurait pu être conduit par n’importe quel intellectuel véritable. La réponse nous apparaîtrait clairement que le constat est trop amer, de sorte qu’il en devient gênant, et comme il est fort difficile à atténuer, le système s’attaque directement aux troubles fête, réduits à n’être que des « ados » déséquilibrés.
Que le personnage principal ait perdu son rapport à la temporalité ne nous paraît pas contestable,. Schizophrène, il ne sait plus s’il dort ou rêve. Cependant, pour notre part, loin de critiquer cette allégorie d’une totale libération du temps profane, nous la mettrons en avant comme relevant – en filigrane – d’une sorte de révélation.
Les deux universitaires nous disent ainsi que « Fight Club est également allégorique d’une autre dimension des comportements humains, celle des conduites à risque. […] Le personnage principal, qui est présenté au début du film comme un homme déprimé, en quête de sens, et que nous interprétons comme un adolescent tourmenté par la perte des repères de l’enfance, va ainsi bouleverser son existence en se livrant à plusieurs types de conduites à risque : les combats du Fight Club, la vitesse en voiture, les activités délictueuses (vols, menaces à main armée, vandalisme), une tentative de suicide, etc. »
Alors, si toute la critique présente dans l’ouvrage n’est réduite qu’à une simple « conduite à risque », interrogeons-nous sur ce risque ; celui de s’opposer par la violence, à la violence d’un mode de vie absurde et totalitaire, à une société s’étant saisie de la plus grande violence possible en tant qu’elle pourfend la civilisation. Ce que ces auteurs interprètent comme une somme de « conduite à risque » nous apparaît plutôt comme autant d’étapes rituelles d’une initiation balbutiante.
Or, si ce point de vue pourrait paraître badin chez certains, notre partialité ne nous fait souffrir d’aucun complexe face aux castrés de la demi-mesure et autre échanson, servant benoîtement le vin empoisonné de la modernité à toute une jeunesse ivre de diplômes. Si Fight Club, de même qu’American Psycho, ont su se présenter comme des anomalies inhérentes à la propagande hollywoodienne, peinant le vrai visage de la civilisation occidentale, celui du matérialisme aigu, nous doutons fort que quelques travaux universitaires puissent annihiler le dérangeant souvenir que laisse ce genre d’œuvre cinématographique. Car il perdure telle une fine graine déposée dans les esprits fertiles de toute une génération, qu’il s’agira ici de faire germer.
1) Évincement de la variable temporelle et rédemption
Le temps de l’homme moderne est, qu’il le veuille ou non, réglé comme une montre. Jamais celle-ci n’arrête sa course, attachant irrémédiablement l’espèce au temps profane ; dénué de toute transcendance et de toute reproduction d’actes primordiaux.
« Avec l’insomnie, plus rien n’est réel ! Tout devient lointain. Tout est une copie, d’une copie, d’une copie… » Tyler Durden
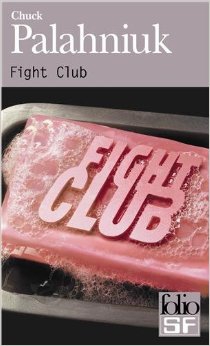 La première étape traversée par le personnage principal revient donc à s’en affranchir. On apprend doucement à prendre du recul, à concevoir l’apparente réalité comme une extrême relativité, une illusion dont Sigismond en traduirait ainsi les contours en tant que « […] nous sommes dans un monde si étrange que vivre ce n’est que rêver, et que l’expérience m’enseigne que l’homme qui vit rêve ce qu’il est, jusqu’au moment où il s’éveille. […] Dans ce monde, en conclusion, chacun rêve ce qu’il est, sans que personne s’en rende compte ». Pedro Caldéron, « La vie est un songe ».
La première étape traversée par le personnage principal revient donc à s’en affranchir. On apprend doucement à prendre du recul, à concevoir l’apparente réalité comme une extrême relativité, une illusion dont Sigismond en traduirait ainsi les contours en tant que « […] nous sommes dans un monde si étrange que vivre ce n’est que rêver, et que l’expérience m’enseigne que l’homme qui vit rêve ce qu’il est, jusqu’au moment où il s’éveille. […] Dans ce monde, en conclusion, chacun rêve ce qu’il est, sans que personne s’en rende compte ». Pedro Caldéron, « La vie est un songe ».
« Et alors il s’est passé quelques choses, je me suis laissé aller, dans un total oubli de moi même envahi par la nuit, le silence et la plénitude. J’avais trouvé la liberté. Perdre tout espoir, c’était cela la liberté », (Tyler Durden). Comment ne pas y voir une référence à l’inscription qui orne les portes des enfers que Dante expose dans la divine comédie ; perdre l’espoir est la première étape d’une élévation, ainsi que Dante plonge dans les enfers tout comme le prophète de l’Islam.
« Dans une adaptation de la légende musulmane, un loup et un lion barrent la route au pèlerin comme la panthère, le lion et la louve font reculer Dante… Virgile est envoyé à Dante et Gabriel à Mohammed par le Ciel ; tous deux, durant le voyage, satisfont à la curiosité du pèlerin. L’Enfer est annoncé dans les deux légendes par des signes identiques : tumulte violent et confus, rafale de feu… L’architecture de l’Enfer dantesque est calquée sur celle de l’Enfer musulman : tous deux sont un gigantesque entonnoir formé par une série d’étages, de degrés ou de marches circulaires qui descendent graduellement jusqu’au fond de la terre ; chacun d’eux recèle une catégorie de pécheurs, dont la culpabilité et la peine s’aggravent à mesure qu’ils habitent un cercle plus enfoncé. Chaque étage se subdivise en différents autres, affectés à des catégories variées de pécheurs enfin, ces deux Enfers sont situés tous les deux sous la ville de Jérusalem… Afin de se purifier au sortir de l’Enfer et de pouvoir s’élever vers le Paradis, Dante se soumet à une triple ablution. Une même triple ablution purifie les âmes dans la légende musulmane : avant de pénétrer dans le Ciel, elles sont plongées successivement dans les eaux des trois rivières qui fertilisent le jardin d’Abraham… »
Miguel Asîn Palacios, « La Escatologia musulmana en la Divina Comedia », Madrid, 1919.
La perte de l’espoir n’est d’ailleurs pas le seul signe de la descente aux enfers qu’entreprennent les membres du Fight Club, qui chaque soir glissent dans la noirceur des caves d’un infréquentable troquet. Il peut néanmoins apparaître troublant que pour s’élever, il faille ainsi tomber dans les arcanes des enfers, toutefois, si c’est là un moyen de s’épargner le vestibule des lâches dont nous rappelions dans un précédent billet qu’il est « cet état misérable […]celui des méchantes âmes des humains qui vivent sans infamie et sans louange et qui ne furent que pour eux mêmes […] Les cieux les chassent, pour n’être moins beaux et le profond enfer ne veut pas d’eux, car les damnés en auraient plus de gloire » (Dante, la descente aux enfers).
Ce « pèlerinage » se présente ainsi comme indispensable à la libération de son orgueil, de même qu’à l’observation de son enfer intérieur, il est telle une croisade contre les plus bas instincts de l’homme, caractérisés dans Fight club par la lutte interne qu’oppose le narrateur contre Tyler Durden, n’étant rien d’autre qu’une lutte pour l’existence. Le Fight club apparaît alors comme la mise en abîme de cette lutte interne du « soi » contre le « moi ».
« Qu’est-ce qui est pire, l’enfer ou rien du tout ? Ce n’est qu’après avoir été capturés et punis que nous pouvons être sauvés. » Tyler Durden.
Ainsi la première étape de l’élévation est donc la descente, dont le but est de gagner le grand Djihad ou la croisade intérieure ; de même que la rédemption nous apparaît comme la pierre angulaire de l’œuvre. De même, ne dirait-on pas que l’auteur ait voulu opter pour la souffrance virile, celle des hommes qui finissent par se haïr à mesure qu’ils aiment et acceptent leur mal ?
« S’améliorer soi-même c’est de la masturbation. C’est se détruire soi-même. » Avec cette phrase, Tyler Durden lance alors une vérité apparaissant telle une critique acerbe du culte individuel, physique, prôné par les médias. On entrevoit ainsi cette volonté d’autoflagellation détruisant le masque de l’indifférenciation.

Sur cette question, nous retrouvons également dans American Psycho de Bret Easton Ellis, un passage révélateur de la tendance actuelle au culte du moi et au résultat qu’il induit :
« J’habite au 11ème étage de la tour American Gardens, sur la 81ème rue ouest. Je m’appelle Patrick Bateman et j’ai 27 ans. Je prends grand soin de moi, en mangeant léger, et en faisant de l’exercice chaque jour. Au réveil si je suis légèrement bouffi, je m’applique des sachets de glace sur mon visage pendant mes abdos du matin. Je peux en faire 1000. Après avoir ôté le sachet de glace, j’applique une lotion désincrustante. Puis, sous la douche, j’utilise tout d’abord un gel moussant, puis un gommage corps au miel et aux amandes et un gommage pour le visage. Ensuite j’applique un masque à la menthe sauvage que je laisse pénétrer 10mn. Pendant ce temps là, je prépare la suite des hostilités. J’utilise toujours un after-shave sans alcool ou avec très peu d’alcool parce que ça irrite et dessèche la peau, alors vous vieillissez plus vite. Une crème reconstituante, suivie d’une crème contour des yeux, et pour finir, une crème protectrice hydratante. Il existe une image de Patrick Bateman, une sorte d’abstraction, mais je n’existe pas vraiment, ce n’est qu’une entité, quelque chose d’illusoire. Et bien que je puisse cacher mon regard froid, que vous puissiez me serrer la main et sentir ma chaire s’agripper à la votre, vous pourriez vous dire que nos vies sont comparables, mais je ne suis tout simplement… pas là ! »
2) De la destruction de l’anonymat dans l’« infra humain » vers l’anonymat du « supra humain »
L’anonyme dans nos sociétés contemporaines est en voie de dissolution, il n’est rien de plus qu’une statistique évoluant dans un rapport d’activité, noyé par un travail pétri de procédures.
« Nous voyons que l’ouvrier y est bien aussi anonyme, mais parce que ce qu’il produit n’exprime rien de lui-même et n’est pas même véritablement son œuvre, le rôle qu’il joue dans cette production étant purement “mécanique”. En somme, l’ouvrier comme tel n’a réellement pas de “nom” parce qu’il n’est, dans son travail, qu’une simple “unité” numérique sans qualités propres, qui pourrait être remplacée par toute autre “unité” équivalente, c’est-à-dire par un autre ouvrier quelconque, sans qu’il y ait rien de changé dans le produit de ce travail ; et ainsi ,[…] son activité n’a plus rien de proprement humain mais, bien loin de traduire ou tout au moins de refléter quelque chose de “supra-humain”, elle est au contraire réduite à l’“infra-humain” et elle tend même vers le plus bas degré de celui-ci, c’est-à-dire vers une modalité aussi complètement quantitative qu’il est possible de la réaliser dans le monde manifesté. Cette activité “mécanique” de l’ouvrier ne représente d’ailleurs qu’un cas particulier (le plus typique qu’on puisse constater en fait dans l’état actuel parce que l’industrie est le domaine où les conceptions modernes ont réussi à s’exprimer le plus complètement) de ce que le singulier “idéal” que nos contemporains voudraient arriver à faire de tous les individus humains et dans toutes les circonstances de leur existence ; c’est là une conséquence immédiate de la tendance dite “égalitaire”, ou en d’autres termes, de la tendance à l’uniformité, qui exige que ces individus ne soient traités que comme de simples “unités” numériques, réalisant ainsi l’“égalité” par en bas puisque c’est là le seul sens où elle puisse être réalisée “à la limite”, c’est-à-dire où il soit possible, sinon de l’atteindre tout à fait (car elle est contraire, comme nous l’avons vu, aux conditions mêmes de toute existence manifestée), du moins de s’en approcher de plus en plus et indéfiniment jusqu’à ce qu’on soit parvenu au « point d’arrêt » qui marquera la fin du monde actuel. »
René Guénon, «Le règne de la quantité », le double sens de l’anonymat
Le travail, passé du métier à la profession, nous transforme en ce qu’il y a de plus inférieur et l’avènement du néotaylorisme qui perdure dans le secteur tertiaire prouve, s’il en était besoin, qu’aucune évolution n’est apparue dans ce domaine. Or « vous n’êtes pas votre travail, vous n’êtes pas votre compte en banque, vous n’êtes pas votre voiture, vous n’êtes pas votre portefeuille, ni votre putain de treillis, vous êtes la merde de ce monde prête à servir à tout. »
Constat que nos universitaires appréhendent comme un comportement à risque, parcequ’il dérange leur propre confort intellectuel, en tant qu’il est le bilan de leurs illusions, ou de ce Paradis qui est en réalité notre enfer ; mais également parce qu’il fait trembler leur petit monde bourgeois et borné, renversant à lui seul leurs structures cognitives dévoyées par des siècles de limitation « infra-humaine ». En réalité ces individus ne présentent de risque que pour une certaine catégorie de notables, profitant alors d’une médiocrité qu’ils imposent arbitrairement à l’ensemble de leurs contemporains.
Nous voyons là un rejet du matérialisme et de cette équation qui transforme les hommes en les objets qui les environnent, car « les choses qu’on possède finissent par nous posséder ». Ainsi, disons-le avec Tyler Durden : « Je rejette tous les présupposés de la civilisation (modernes, NDA) et spécialement l’importance des possessions matérielles » et Chateaubriand lui répondra glorieusement qu’« un homme bien persuadé qu’il n’y a rien de nouveau en histoire perd le goût des innovations, goût que je regarde comme un des plus grands fléaux qui affligent l’Europe dans ce moment. L’enthousiasme vient de l’ignorance ; guérissez celle-ci, l’autre s’éteindra ; la connaissance des choses est un opium qui ne calme que trop l’exaltation. »
C’est un fait, que la négation de l’idéologie matérialiste, qui se retrouve aussi bien dans la propension à user du sentimentalisme que dans le scientisme ou le rationalisme, est un préalable à toute modification structurelle de nos êtres.
« L’individu se perd dans la “masse”, ou du moins il tend de plus en plus à s’y perdre ; […] dans la quantité pure, […], la séparation est à son maximum, puisque c’est là que réside le principe même de la “séparativité”, et l’être est d’ailleurs évidemment d’autant plus “séparé” et plus enfermé en lui-même que ses possibilités sont plus étroitement limitées, c’est-à-dire que son aspect essentiel comporte moins de qualités ; mais, en même temps, puisqu’il est d’autant moins distingué qualitativement au sein de la “masse”, il tend bien véritablement à s’y confondre. Ce mot de “confusion” est ici d’autant mieux approprié qu’il évoque l’indistinction toute potentielle du “chaos”, et c’est bien de cela qu’il s’agit en effet puisque l’individu tend à se réduire à son seul aspect substantiel, c’est-à-dire à ce que les scolastiques appelleraient une “matière sans forme” où tout est en puissance et où rien n’est en acte, si bien que le terme ultime, s’il pouvait être atteint, serait une véritable “dissolution” de tout ce qu’il y a de réalité positive dans l’individualité ; et en raison même de l’extrême opposition qui existe entre l’une et l’autre, cette confusion des êtres dans l’uniformité apparaît comme une sinistre et “satanique” parodie de leur fusion dans l’unité. »
[…]
Si nous nous demandons ce que devient l’individu dans de telles conditions, nous voyons que, en raison de la prédominance toujours plus accentuée en lui de la quantité sur la qualité, il est pour ainsi dire réduit à son seul aspect substantiel, à celui que la doctrine hindoue appelle rûpa (et en fait, il ne peut jamais perdre la forme, qui est ce qui définit l’individualité comme telle, sans perdre par là même toute existence), ce qui revient à dire qu’il n’est plus guère que ce que le langage courant appellerait un «corps sans âme», et cela au sens le plus littéral de cette expression. Dans un tel individu, en effet, l’aspect qualitatif ou essentiel a presque entièrement disparu (nous disons presque, parce que la limite ne peut jamais être atteinte en réalité) ; et comme cet aspect est précisément celui qui est désigné comme nâma, cet individu n’a véritablement plus de «nom» qui lui soit propre, parce qu’il est comme vidé des qualités que ce nom doit exprimer ; il est donc réellement «anonyme», mais au sens inférieur de ce mot. C’est là l’anonymat de la «masse» dont l’individu fait partie et dans laquelle il se perd, «masse» qui n’est qu’une collection de semblables individus, tous considérés comme autant d’«unités» arithmétiques pures et simples ; on peut bien compter de telles «unités», évaluant ainsi numériquement la collectivité qu’elles composent et qui, par définition, n’est elle-même qu’une quantité ; mais on ne peut aucunement donner à chacune d’elles une dénomination impliquant qu’elle se distingue des autres par quelque différence qualitative. »
René Guénon, «Le règne de la quantité », le double sens de l’anonymat
Aussi, le retour à l’acte dans les premiers pas de l’initiation présente dans l’œuvre, était donc de détruire l’anonymat « infra-humaine » , ceci par le refus d’une désintégration dans la masse. L’individu sans lien et déraciné se devait de renouer avec ses frères, et ce fut dans le fracas des os contre la chair, comme dans la douleur teintée des cris diffus d’une catharsis soulevant des lambeaux de poussière entremêlés du sang des siens.
Le Fight club s’est présenté comme le retour au « soi », que Socrate appréhende dans la formule du « connaît toi toi-même », or « comment tu peux te connaître si tu t’es jamais battu ? » répond Tyler Durden.

L’objectif est donc de déconnecter l’homme des limites qu’impose la société moderne, d’où la volonté du « lâché prise » qu’on perçoit durant l’épisode de la voiture ; s’il est vrai, comme disait Cicéron que « philosopher, c’est apprendre à mourir », l’on ne peut s’élever qu’en abandonnant toute peur de la mort. De même qu’il faut cesser d’être un enfant s’imaginant que tout n’arrive qu’aux autres, chantre d’un optimisme béat, de même dans un raisonnement absolu on pourrait dire que rien n’a d’importance, comme « l’être qui a atteint un état supra-individuel est, par là même, dégagé de toutes les conditions limitatives de l’individualité, c’est-à-dire qu’il est au-delà des déterminations de “nom et forme” (nâma-rûpa) qui constituent l’essence et la substance de cette individualité comme telle ; il est donc véritablement “anonyme” parce que en lui le “moi” s’est effacé et a complètement disparu devant le “Soi”. » (René Guénon, « Le règne de la quantité », le double sens de l’anonymat)
Néanmoins, loin de soutenir que les protagonistes réalisent une quelconque élévation spirituelle, il n’empêche que la chute dont ils étaient alors victime s’est stoppée net, de sorte qu’une récupération de la voie droite peut alors être possible. Car en s’extirpant de tous les préjugés modernes, par un solipsisme frisant parfois avec le nihilisme, l’homme du Fight club vint à chevaucher le tigre en se gardant de l’emprise d’un système mortifère. L’avènement de la marginalité, le contre-pied de la normalité et les concepts de bien et de mal, ont définitivement fait place à celui de justice.
3) Un retour à l’âge des héros ?
Nous disions que l’œuvre fraye avec le nihilisme, mais il ne va pas forcément jusqu’à la remise en question de toute signification et de tout but de l’existence humaine, il ne rend pas le monde comme fruit d’un hasard, tel que peuvent l’expliquer les dégénérés comme Stephen Hawking, mais s’arrête à l’expression rageuse d’un abandon de Dieu.
Pourtant, jamais son existence n’est niée, mais c’est finalement la volonté d’une vie simple qui l’emporte sur les spéculations métaphysiques :
« Dans le monde tel que je le vois, on chassera des élans dans des forets humides et rocailleuses du Rockfeller center. On portera des vêtements en cuir qui dureront la vie entière. On escaladera d’immenses lianes qui entoureront la tour sear. Et quand on baissera les yeux, on verra de minuscules silhouettes en train de piller du maïs ou de faire sécher de fines tranches de gibier sur l’aire de repos déserte d’une super-autoroute abandonnée. »
La mise en place d’un temps sacré apparaît comme une nécessité et renvoie à la réalisation des actes primordiaux ; les héros, ce sont les Grecs qui fabriquèrent les premiers savons avec les cendres des leurs soldats. Ce même savon, cette foi sortant des bourrelets d’une myriade de femmes obèses, gavées aux fast foods et découpées jusqu’à en faire sortir les précieuses graisses, va finalement faire exploser la société de consommation et avec elle le mode de vie moderne. Société dissoute dans le souffle d’une monnaie scripturale avalée par des lignes de codes n’ayant de réalité que parce qu’ils nichent dans des serveurs aux sous-sols de ces grandes machines à travailler.
Le résidu de la folie humaine va ironiquement faire s’envoler les piliers du système de domination et nous ramener à l’inconfort d’une société normale. Mais les idées modernes s’en iront-elles pour autant ? La mentalité cadavérique de l’anti-sacré fuira-t-elle le cœur des hommes ? Pour le savoir, il n’y a bien qu’une chose à faire… du savon.
Jérôme Carbriand
Étudiant en économie, j'ai outrepassé les limites de l'enseignement universitaire en m'intéressant aux post-keynesiens, j'ai en cela une solide maîtrise des réalités économiques. D'autre part, j'ai parallèlement voué un intérêt particulier à la lecture d'une grande partie de la philosophie occidentale dont l'incohérence générale m'a incité à étudier la "métaphysique". Dans cette voie, certains auteurs m'ont véritablement touché, c'est le cas de René Guénon, Julius Evola et Mircea Eliade. Que suis-je donc, sinon une Cassandre sans génie, dont le seul mérite aura été de tomber avant les autres, écrasé par une foule arrogante et aliénée. Je suis le mouton noir d'un troupeau aveugle, dont les yeux s'entrouvrent pour percevoir l'abîme dans lequel nous nous jetons. Je suis le cauchemar de la modernité et la honte de la Tradition pour avoir enduré la boue d'une époque aussi souillée.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fight club, chuck palahniuk, lettres, lettres américaines, littérature, littérature américaine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


