samedi, 06 mars 2021
Renzo de Felice: L'historien dans la Cité

Renzo de Felice: L'historien dans la Cité
Recension:
RENZO DE FELICE - L'Historien dans la cité.
Par Emilio GENTILE
Editions du Rocher, 2008, 237 pages.
Ex: https://vk.com/id596716950
(compte vk de Jean-Claude Cariou)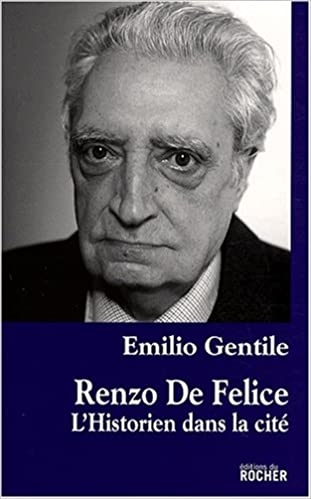 "En général l'historiographie a pour tâche de former l'image que le nation a d'elle-même et de situer l'homme dans la réalité historique (...). De nos jours, on hésite entre une idée de l'histoire comme magistra vitae et une sorte de méfiance généralisée envers elle sous prétexte qu'elle serait le fruit de manipulations et qu'on ne saurait donc s'y fier. En outre, l'historien s'acquitte de la tâche de satisfaire les curiosités les plus disparates, qui vont de la construction des navires à la façon dont les paysans du Moyen Âge faisaient l'amour. Je ne crois pas qu'on puisse accepter cette réduction du chercheur en histoire au rang d'appareil automatique destiné à satisfaire les curiosités des autres et ce parce que, dans ma manière de voir, la fonction principale de l'historien demeure de proposer une image de sa communauté nationale. L'affirmation suivant laquelle nous serions devant un type de problèmes dépassés, puisque nous nous acheminons vers l'intégration européenne, me parait très improductive. Je considère en fait qu'on ne saurait entrer dans une réalité différente sans connaître convenablement la sienne".
"En général l'historiographie a pour tâche de former l'image que le nation a d'elle-même et de situer l'homme dans la réalité historique (...). De nos jours, on hésite entre une idée de l'histoire comme magistra vitae et une sorte de méfiance généralisée envers elle sous prétexte qu'elle serait le fruit de manipulations et qu'on ne saurait donc s'y fier. En outre, l'historien s'acquitte de la tâche de satisfaire les curiosités les plus disparates, qui vont de la construction des navires à la façon dont les paysans du Moyen Âge faisaient l'amour. Je ne crois pas qu'on puisse accepter cette réduction du chercheur en histoire au rang d'appareil automatique destiné à satisfaire les curiosités des autres et ce parce que, dans ma manière de voir, la fonction principale de l'historien demeure de proposer une image de sa communauté nationale. L'affirmation suivant laquelle nous serions devant un type de problèmes dépassés, puisque nous nous acheminons vers l'intégration européenne, me parait très improductive. Je considère en fait qu'on ne saurait entrer dans une réalité différente sans connaître convenablement la sienne".
" Les discours moralisants appliqués à l'histoire, d'où qu'ils viennent et à quelques mobiles qu'ils obéissent, provoquent en moi un profond sentiment d'ennui, ils suscitent ma méfiance envers celui qui les prononce et m'amènent à conclure à un manque d'idées claires, sinon carrément à une énième forme de chantage intellectuel ou a un expédient pour introduire en contrebande des idées et des intérêts qu'on veut éviter d'exposer sous une forme directe. L'historien peut et parfois doit porter des jugements moraux; s'il ne veut pas trahir sa propre fonction ou se borner à faire du journalisme historique, il ne peut le faire, cependant, qu'après s'être acquitté de toutes les manières de son devoir propre d'enquêteur et de reconstructeur de la multiplicité des faits qui constituent la réalité d'une époque, d'un moment historique; or, j'entends au contraire souvent prononcer des jugements moraux sur des questions ignorées ou mal connues de celui qui les porte. Et ce n'est pas seulement superficiel et improductif sous le profil d'une vraie compréhension historique, c'est aussi peu éducatif et improductif" .
Renzo De Felice.

Emilio Gentile.
Elève du grand historien Renzo De Felice, dont les travaux ont renouvelé l'approche historienne du fascisme italien dans les années 1970, Emilio Gentile livre une biographie intellectuelle de son maître et ami disparu en 1996. Renzo De Felice a sans doute été l'historien italien du XXe siècle le plus connu en Italie et dans le monde, tant dans les milieux universitaires qu'auprès du grand public. Pendant trente ans, il a été au cœur des recherches sur le fascisme et des polémiques, vives et souvent virulentes, suscitées par ses cours, ses interviews et ses publications. Travailleur infatigable, auteur de nombreux ouvrages et surtout d'une monumentale ( mais malheureusement non terminée) biographie de Benito Mussolini, De Felice a, dès 1975, distingué nettement ce qui dans le fascisme relevait du " mouvement " et donc de sa nature révolutionnaire et ce qui renvoyait au " régime " et à des compromis avec la société existante, lui permettant ainsi de s'appuyer sur un fort consensus.
Pour avoir souligné la spécificité du totalitarisme italien face à ses deux homologues le communisme bolchevique et le national-socialisme, il fut accusé de vouloir réhabiliter le fascisme mussolinien alors que ses analyses étaient le fruit d'un travail phénoménal et d'une longue évolution historiographique issue d'une réflexion sur les conséquences de la Révolution française en Italie.
 De Felice ne répugnait pas à favoriser les remous autour d'une oeuvre savante et difficile qui, sans interventions médiatiques provocatrices, serait restée sans doute peu connue. Tout en évoluant fortement au fil de ses recherches sur la personnalité de Mussolini, sur un mouvement et un régime, il a eu l'occasion de souligner maintes fois tout ce qui sépare le fascisme italien du national-socialisme allemand et, à plus forte raison, du bolchevisme.
De Felice ne répugnait pas à favoriser les remous autour d'une oeuvre savante et difficile qui, sans interventions médiatiques provocatrices, serait restée sans doute peu connue. Tout en évoluant fortement au fil de ses recherches sur la personnalité de Mussolini, sur un mouvement et un régime, il a eu l'occasion de souligner maintes fois tout ce qui sépare le fascisme italien du national-socialisme allemand et, à plus forte raison, du bolchevisme.
Dans ses premier écrits, vers 1953, alors qu'il travaillait encore sur l'histoire du jacobinisme italien, ses réflexes de militant communiste et de marxiste (gramciste) qu'il resta jusqu'en 1956, étaient encore sensibles. Il s'en libéra peu à peu, découvrant que la supposée infrastructure économique et sociale des idées et des engagements conduisait à de graves erreurs. Il comprit que ce sont en réalité les représentations idéologiques et même "religieuses" des idéaux révolutionnaires qui expliquent les embrasements des foules et les choix des meneurs charismatiques.
Emilio Gentile souligne un autre aspect de la conception defelicienne de l'historiographie qui ne s'est jamais démentie: le refus du moralisme en tant que catégorie du jugement historique. "Les discours moralisants appliqués à l'histoire, d'où qu'ils viennent, provoquent en moi, dira De Felice, un sentiment d'ennui, ils suscitent ma méfiance envers qui les prononce et m'amènent à conclure à un expédient pour introduire en contrebande des idées et des intérêts qu'on veut éviter d'exposer directement".
De Felice n'a pas laissé de théorie explicite sur la méthode historique, mais il lui arriva souvent de préciser que le métier d'historien ne s'apprend pas dans les manuels de méthodologie, mais à travers l'expérience concrète de la recherche.
Sans pouvoir résumer des recherches toujours fines, on peut souligner qu'à partir de 1975, il a nettement distingué ce qui, dans le fascisme, relevait du "mouvement" et donc de sa nature révolutionnaire, et ce qui renvoyait au "régime", fait de compromis avec la société existante. C'est ce qui a permis longtemps à Mussolini de s'appuyer sur un consentement majoritaire.Un constat qui fut vertement reproché à De Felice par ses adversaires.
Au-delà de la biographie intellectuelle, Emilio Gentile s'attache à l'homme De Felice, concentré sur son métier d'historien, qu'il pratiquait avec une application monacale, loin du tumulte des médias et de l'action politique. Après un engagement de jeunesse dans les rangs communistes avec lequel il rompit dès l'écrasement de la révolution hongroise de 1956 par les chars soviétique, Renzo De Felice s'est révélé un homme affable, ouvert au dialogue, généreux en conseils et en aides à ses étudiants et ses jeunes collègues, et en même temps une personnalité complexe, mélange de fragilité et de détermination, de timidité et d'orgueil, dont le côté solitaire fut accentué en raison des polémiques violentes qu'il suscitait. Cet ouvrage est le beau portrait de l'un des grands historiens du XXe siècle.
00:08 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, italie, fascisme, renzo de felice, emilio gentile |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 29 août 2013
Emilio Gentile: Pour ou contre César?
Emilio Gentile: Pour ou contre César?
Pierre Le Vigan
Ex: http://metamag.fr
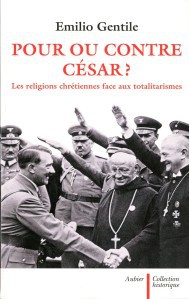 En 1938, le chanoine de Winchester écrivait que le totalitarisme, de droite ou de gauche, « c’est l’Antéchrist. C’est une révolution et une religion. » L’opposition entre le christianisme et le totalitarisme s’inscrit en fait à la suite d’une longue histoire. C’est le conflit entre religion et modernité.
En 1938, le chanoine de Winchester écrivait que le totalitarisme, de droite ou de gauche, « c’est l’Antéchrist. C’est une révolution et une religion. » L’opposition entre le christianisme et le totalitarisme s’inscrit en fait à la suite d’une longue histoire. C’est le conflit entre religion et modernité.
00:05 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : totalitarisme, religion, catholicisme, protestantisme, histoire, années 30, années 20, emilio gentile, allemagne, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


