vendredi, 21 janvier 2011
Ivan Illich, critique de la modernité industrielle
Ivan Illich, critique de la modernité industrielle
par Frédéric Dufoing
(Infréquentables, 11)
Ex: http://stalker.hautetfort.com/
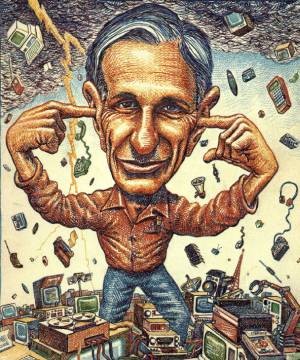 Né à Vienne en 1926, d’un père dalmate et d’une mère d’origine juive, et mort en toute discrétion en 2002 après avoir vécu entre les États-Unis, l’Allemagne et l’Amérique du sud; prêtre anticlérical, médiéviste joyeusement apatride, érudit étourdissant, sorte d’Épicure gyrovague, polyglotte, curieux, passionné, insaisissable, et touche-à-tout; critique radical, en pensée comme en acte, de la modernité industrielle, héritier de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul, inspirateur d’intellectuels comme Jean-Pierre Dupuy, Mike Singleton, Serge Latouche, Alain Caillé, André Gorz, Jean Robert ou encore des mouvements écologistes, décroissantistes et post-développementistes; hélas aussi figure de proue d’une certaine intelligentsia des années soixante qui ne feuilleta, en général, que Une Société sans école et ne retint de son travail que ce qui pouvait servir ses mauvaises humeurs adolescentes puis, plus tard, ses bonnes recettes libertariennes, Ivan Illich est sans conteste l’un des penseurs les plus originaux, les plus complets, les plus lucides ainsi que les plus mal lus du XXe siècle.
Né à Vienne en 1926, d’un père dalmate et d’une mère d’origine juive, et mort en toute discrétion en 2002 après avoir vécu entre les États-Unis, l’Allemagne et l’Amérique du sud; prêtre anticlérical, médiéviste joyeusement apatride, érudit étourdissant, sorte d’Épicure gyrovague, polyglotte, curieux, passionné, insaisissable, et touche-à-tout; critique radical, en pensée comme en acte, de la modernité industrielle, héritier de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul, inspirateur d’intellectuels comme Jean-Pierre Dupuy, Mike Singleton, Serge Latouche, Alain Caillé, André Gorz, Jean Robert ou encore des mouvements écologistes, décroissantistes et post-développementistes; hélas aussi figure de proue d’une certaine intelligentsia des années soixante qui ne feuilleta, en général, que Une Société sans école et ne retint de son travail que ce qui pouvait servir ses mauvaises humeurs adolescentes puis, plus tard, ses bonnes recettes libertariennes, Ivan Illich est sans conteste l’un des penseurs les plus originaux, les plus complets, les plus lucides ainsi que les plus mal lus du XXe siècle.
Il est surtout le plus dangereux. Car, de tous ceux qui critiquèrent la modernité – et en particulier la modernité industrielle – dans ses principes, et non pas dans ses seuls accidents, il est le seul qui, d’une part, se refusa d’étreindre les mythes décadentistes ou millénaristes pour éviter les mythes progressistes, et, d’autre part, attaqua la modernité sur deux fronts à la fois, l’un intérieur, décrivant, dénonçant, à la suite d’Ellul (mais dans une perspective plus laïque), les apories et absurdités de la modernité industrielle eu égard à ses propres fondements, l’autre extérieur, réintroduisant, par une réflexion sur la logique malsaine du développement, l’Autre dans la pensée occidentale. L’Autre. Non pas celui du module des ressources humaines de l’anthropologie coloniale ou post-coloniale; non pas cette machine à feed back obséquieux que lutinent les coopérants; non pas ce pion arithmétique, ce nu empantalonné dans ses besoins décrit dans les Droits de l’Homme; non pas ce miroir de marâtre dont la rationalité occidentale ne peut se passer depuis son avènement, mais cet inconnu familier, celui qui n’est pas nécessairement compréhensible mais qui est de toute façon, en soi, respectable – et a quelque chose à nous dire pourvu que l’on se taise et que l’on s’émerveille.
Mais il est une autre raison pour laquelle la pensée d’Illich est dangereuse : elle est humaniste. Non pas dans le sens où elle s’inscrirait dans le travail des auteurs de la Renaissance qui coupèrent l’Europe de ses racines méditerranéennes et la raison du raisonnable, plongèrent l’homme dans l’Homme, dans sa volonté de puissance et, derechef, dans le désir d’absence de limites, et qui enfin permirent tout ce que la modernité industrielle assume, accroît et assouvit au mépris de la personne comme de l’espèce humaine. C’est précisément contre cette logique que travaille la pensée du médiéviste, c’est à son fondement qu’elle s’attaque puisqu’il s’agit de rechercher et de défendre une humanité qui, au nom de la volonté de puissance, a perdu son identité avec sa liberté, se retrouve sans volonté, prisonnière de la puissance, d’une Raison ivre d’elle-même, d’organisations, de techniques qui la dépassent et dont elle n’est plus que l’outil, la marionnette – débile, idiote – de besoins, de désirs, se traînant de guichets en caisses enregistreuses en passant par l’habitacle de son automobile. Bien sûr, comme on l’a dit, on retrouve ici les intuitions et les analyses de Bernard Charbonneau (la critique de la totalisation sociale qu’amène la Grande Mue, c’est-à-dire le changement de paradigme sociétal qu’est l’industrialisation), de Jacques Ellul (l’analyse de la Technique et de la soumission des fins aux moyens, de toute considération à l’efficacité) et de nombreux auteurs du personnalisme des années trente, effrayés aussi bien par le totalitarisme que par le libéralisme; on retrouve de même des intuitions bernanosiennes (la modernité menace l’intimité spirituelle de l’individu), luddites (le refus de la religion technologique), peut-être aussi, quoique dans une moindre mesure, bergsoniennes. Mais, indéniablement, par son ouverture à un optique relativiste, sa finesse d’analyse et – ce qui peut sembler paradoxal – son souhait de rester pragmatique, de s’inscrire dans le concret, la pensée d’Illich est à la fois plus précise et plus fertile.
Nous nous proposons dans ce trop bref article de faire découvrir l’œuvre d’Illich. Autant préciser avec humilité qu’exposer une pensée si complexe, c’est bien évidemment la trahir et que, la plupart des grandes oeuvres étant victimes des vulgates, nous nous efforcerons de n’endommager celle d’Illich que par esprit de synthèse. Nous procéderons pour ainsi dire chronologiquement en exposant d’abord le travail le plus ancien – et le plus mal interprété – d’Illich, qui traite de la contre-productivité des institutions de la modernité industrielle, puis le travail de critique de la logique de développement de la société moderne.
Les plus pamphlétaires des essais d’Illich sont bien connus, mais fort mal lus; il s’agit de Une société sans école, Énergie et équité, La Convivialité et Némésis médicale. L’expropriation de la santé; il y élabore sa vision des seuils – aporétiques – de contre-productivité de quelques-unes des institutions de la modernité industrialisée. Il postule en effet que ces institutions, une fois arrivées à un certain niveau de développement, fonctionnent contre les objectifs qu’elles sont censées servir : l’école rend stupide, la vitesse ralentit, l’hôpital rend malade.
 Dans le premier, Une société sans école, Illich montre que l’école, comme institution, et «l’éducation» professionnalisée, comme logique de sociabilisation, non seulement nuisent à l’apprentissage et à la curiosité intellectuelle, mais surtout ont pour fonction véritable d’inscrire dans l’imaginaire collectif des valeurs qui justifient et légitiment les stratifications sociales en même temps qu’elles les font. Il ne s’agit pas seulement, à l’instar du travail de gauche «classique» de Bourdieu et Passeron, de montrer que l’école reproduit les inégalités sociales, donc qu’elle met en porte-à-faux, stigmatise et exclut les classes sociales défavorisées dont elle est censée favoriser l’ascension sociale, mais de démontrer que l’idée même de cette possibilité ou de cette nécessité d’ascension sociale par la scolarité permet, crée ces inégalités en opérant comme un indicateur d’infériorité sociale. Par ailleurs, l’école et les organismes d’éducation professionnels agissent en se substituant à toute une série d’organes d’éducation propres à la société civile ou aux familles, délégitimant les apprentissages qu’ils procurent. Elle est donc un moyen de contrôle social et non pas de libération des déterminations sociales. Les normes de l’éducation et du savoir, la légitimité de ce que l’on sait faire et de ce que l’on comprend se mettent donc à dépendre d’un programme et d’un jugement mécanique qui forment aussi un écran entre l’individu et sa propre survie ou sa propre valeur. Ce programme est celui de l’axe production/consommation sur lequel se fonde la modernité industrielle. «L’école est un rite initiatique qui fait entrer le néophyte dans la course sacrée à la consommation, c’est aussi un rite propitiatoire où les prêtres de l’alma mater sont les médiateurs entre les fidèles et les divinités de la puissance et du privilège. C’est enfin un rituel d’expiation qui ordonne de sacrifier les laissés-pour-compte, de les marquer au fer, de faire d’eux les boucs émissaires du sous-développement» (1).
Dans le premier, Une société sans école, Illich montre que l’école, comme institution, et «l’éducation» professionnalisée, comme logique de sociabilisation, non seulement nuisent à l’apprentissage et à la curiosité intellectuelle, mais surtout ont pour fonction véritable d’inscrire dans l’imaginaire collectif des valeurs qui justifient et légitiment les stratifications sociales en même temps qu’elles les font. Il ne s’agit pas seulement, à l’instar du travail de gauche «classique» de Bourdieu et Passeron, de montrer que l’école reproduit les inégalités sociales, donc qu’elle met en porte-à-faux, stigmatise et exclut les classes sociales défavorisées dont elle est censée favoriser l’ascension sociale, mais de démontrer que l’idée même de cette possibilité ou de cette nécessité d’ascension sociale par la scolarité permet, crée ces inégalités en opérant comme un indicateur d’infériorité sociale. Par ailleurs, l’école et les organismes d’éducation professionnels agissent en se substituant à toute une série d’organes d’éducation propres à la société civile ou aux familles, délégitimant les apprentissages qu’ils procurent. Elle est donc un moyen de contrôle social et non pas de libération des déterminations sociales. Les normes de l’éducation et du savoir, la légitimité de ce que l’on sait faire et de ce que l’on comprend se mettent donc à dépendre d’un programme et d’un jugement mécanique qui forment aussi un écran entre l’individu et sa propre survie ou sa propre valeur. Ce programme est celui de l’axe production/consommation sur lequel se fonde la modernité industrielle. «L’école est un rite initiatique qui fait entrer le néophyte dans la course sacrée à la consommation, c’est aussi un rite propitiatoire où les prêtres de l’alma mater sont les médiateurs entre les fidèles et les divinités de la puissance et du privilège. C’est enfin un rituel d’expiation qui ordonne de sacrifier les laissés-pour-compte, de les marquer au fer, de faire d’eux les boucs émissaires du sous-développement» (1).
Dans Énergie et équité, Illich procède à l’une de ses analyses les plus fécondes de la contre-productivité des institutions industrielles, en l’occurrence, celle des transports, autrement dit de la vitesse. En un mot comme en cent, une fois passé un certain seuil de puissance (évalué à 25 km/h), les outils usités pour se déplacer allongent les déplacements et font perdre du temps. En effet, à partir du moment où existent des instruments de déplacement puissants et généralisés (la voiture, par exemple), l’organisation des déplacements et des lieux de vie (ou de travail) va être absorbée par les exigences de ces instruments : les routes vont développer les distances comme la nécessité de les parcourir; les autres formes de mobilité vont disparaître; les exigences liées au temps et aux déplacements vont se resserrer. D’autre part, l’utilisation de ces instruments, rendue obligatoire par les changements du milieu qu’elle exige, dévore en heures de travail le temps soi-disant gagné par le «gain» de vitesse, si bien que si l’on soustrait au temps moyen gagné par la vitesse de la voiture les heures passées au travail pour payer cette même voiture, on roule à une vitesse située entre six et douze km/h – la vitesse de la marche à pied ou du vélo. Autrement dit, plus d’un tiers du temps de travail salarié est consacré à payer l’automobile qui permet, pour l’essentiel… de se rendre au travail ! De fait, l’utilisation de ces outils, et la dépense énorme d’énergie qu’elle demande, engendrent une perte de liberté, non seulement dans la capacité de se déplacer – puisque le monopole de l’automobile amène les embouteillages ou l’impossibilité de se déplacer autrement, et orientent les déplacements (les lieux où l’on se rend sont des lieux joignables par la route, donc tout le monde se rend dans les mêmes lieux d’un espace rendu homogène) – mais aussi enchaîne l’individu au salariat, lui dévore son temps. L’automobile ne répond pas à des besoins, elle crée des contraintes. Pire, elle crée de la distance puisque, chacun étant supposé (et donc obligé de) disposer d’une automobile, les lieux et le mode de vie vont être organisés selon les possibilités offertes par l’automobile : les lieux vont à la fois s’éloigner et s’homogénéiser puisqu’il faudra désormais ne se rendre que là où l’automobile le permet. On a là un excellent exemple de la logique technicienne, sur laquelle nous reviendrons avec Ellul et Anders, mais aussi de la mécanique moderne toute entière.
De plus, quoique Illich n’en traite que très peu, on pourrait aussi continuer son raisonnement en montrant les problèmes globaux induits par la généralisation de l’automobile : pollution et désordre climatique, problèmes de santé dus à cette pollution et au manque d’effort physique, stress, guerres énergétiques, etc.
Fondamentalement, l’automobile manifeste un déséquilibre, une démesure, une disproportion sur laquelle Illich revient dans toute son œuvre, et en particulier dans La Convivialité : la disproportion entre les sens, le corps (ici, l’énergie métabolique) et la technique (ici, l’énergie mécanique), laquelle engendre une forme de déréalisation quant à la relation au monde et à ses propres besoins. En effet, le point de vue d’Illich (comme d’ailleurs celui d’Ellul) est celui d’un chrétien fondant son appréhension de l’action humaine sur l’incarnation christique. Comme l’indique Daniel Cérézuelle, pour Illich, «la modernité progresse en procédant à une désincarnation croissante de l’existence et c’est pour cela qu’il en résulte une dépersonnalisation croissante de la vie et une perte croissante de maîtrise sur notre vie quotidienne, donc de liberté» (2). Les techniques et institutions modernes instaurent un rapport biaisé aux sens et au corps; elles brisent le lien intime entre le vécu physique, sensitif, charnel et les constructions de l’esprit; elles forment, comme aurait dit Bergson, une croûte entre l’homme et son milieu.
On le voit, au-delà de ce questionnement purement rationnel, voire économiste, pointent déjà des questionnements d’ordre moral, culturel et symbolique beaucoup plus vastes : ce sont bien quelques-unes des croyances fondamentales de la modernité industrielle (une certaine relation au temps (3), le salariat opposé à l’autonomie, etc.) qu’Illich remet en cause. Son exigence de proportionnalité est une exigence de limites. Il s’agit de montrer que, lorsque la volonté humaine perd cette considération des limites, ou ces limites elles-mêmes, elle s’annihile : la volonté n’est possible que dans le cadre de ces limites; si elles les combat ou en sort, elle se désagrège.
La Convivialité est sans conteste l’un des ouvrages les plus précieux du XXe siècle. Illich y intègre et y synthétise la critique du mode de production et de vie industriel, ses constats sur les seuils de contre-productivité des institutions modernes et ses valeurs relatives à l’autonomie individuelle comme « communautaire ». Il démontre que, collectivement, à l’échelle d’une société, non seulement les outils et institutions modernes se retournent contre leurs objectifs, les moyens contre les fins, les hommes perdant alors la maîtrise de leur destin, mais que de surcroît, une fois ces seuils passés, les hommes sacrifient leur autonomie à une mécanique qui les subsume, fonctionne presque sans eux, contre eux et qu’ils passent alors à côté de l’essentiel, ce qui a fait la vie de l’homme depuis l’aube de l’humanité. Concrètement, la modernité industrielle transforme la pauvreté en misère, l’esclave des hommes en esclave des machines, c’est-à-dire détruit en un même mouvement les capacités de survie en toute autonomie et rend dépendant (dans le sens d’une véritable «toxicomanie axiologique») d’un système incontrôlé, agissant au-delà des valeurs qui sont censées le fonder et sur lequel l’individu n’a aucun poids. Dans La Convivialité, Illich écrit : «Lorsqu’une activité outillée dépasse un seuil défini par l’échelle ad hoc, elle se retourne d’abord contre sa fin, puis menace de destruction le corps social tout entier» (4). Et il ajoute : «Il nous faut reconnaître l’existence d’échelles et de limites naturelles. L’équilibre de la vie se déploie dans plusieurs dimensions; fragile et complexe, il ne transgresse pas certaines bornes. Il y a des seuils à ne pas franchir. Il nous faut reconnaître que l’esclavage humain n’a pas été aboli par la machine, mais il en a reçu une figure nouvelle. Car, passé un certain seuil, l’outil, de serviteur, devient despote» (5).
Dans une perspective cette fois plus historique et plus exégétique qu’économique, Illich se penche, dans la deuxième partie de son œuvre, sur une logique qui transcende celle de l’État comme celle du marché, et qui place derechef sa pensée en amont des logiques et mythes libéraux ou socialistes : la construction moderne de la notion de besoin – au travers du processus de professionnalisation – et l’annihilation du vernaculaire, c’est-à-dire d’un ensemble de valeurs et de pratiques qui, malgré les problèmes qu’elles pouvaient poser, avaient au moins le mérite, d’une part, de préserver un relatif contrôle des individus sur leur propre destin – en les ancrant dans certaines limites – et, d’autre part, d’empêcher la sociabilité et les sociétés humaines de glisser hors de ce à quoi elles sont vouées. Analysant tour à tour le rapport à la langue et au texte (Du Lisible au visible : la naissance du texte), le rôle de la femme (Le Genre vernaculaire), le travail domestique opposé au travail salarié (Le Travail fantôme), la professionnalisation des tâches (Le Chômage créateur), le développement (Dans le miroir du passé), les sens (H2O ou les eaux de l’oubli), Illich déconstruit l’imaginaire moderne du développement et du progrès. Il décrit par quels processus historiques les modernes se sont peu à peu trouvés dépossédés de leur travail, de leur genre, de leur langue et, au fond, de leurs identité et désirs propres; comment la langue maternelle s’est trouvée normalisée, donc les gens expulsés de leurs mots, du sens; comment les genres ont disparu au profit des sexes; corrélativement, comment les femmes se sont trouvées enfermées dans une logique où, suite au processus de professionnalisation moderne, elles ont été privées des domaines qui leur étaient spécifiques et ont été pour ainsi dire rabattues sur un travail domestique devenu impraticable et dévalorisé puis sur un travail salarié où leur sont refusés à la fois le respect et une identité propre; comment l’étranger, l’Autre, est devenu un être défini par ses manques relatifs aux canons occidentaux, un sous-développé; comment le travail, les activités vernaculaires ont été absorbées par la division professionnelle du travail et le salariat; comment, enfin, les modernes ont vu leurs sens, leur aperception du réel appauvris autant qu’homogénéisés...
Mais revenons un instant sur les notions de besoin et de vernaculaire. En 1988, Illich publiait un texte court et dense intitulé L’Histoire des besoins (6). Pour lui, cette notion de besoin – qui correspond à une véritable addiction (7) – est intrinsèquement liée à l’idéologie du progrès, suivie, après la Seconde Guerre mondiale, par celle du développement. Naturalisée, devenue une évidence que personne ne songe à remettre en cause tant elle est liée à un imaginaire d’épanouissement, de bien-être ritualisé au travers des mécanismes de la consommation; opposée à des mythes (ceux mettant en scène des sociétés ou des périodes historiques de pénurie systématique et endémique, comme, pour les Lumières, le Moyen Âge ou, pour l’évolutionnisme colonial, les sociétés dites «primitives»), la notion de besoin nous habite au point d’être sans cesse invoquée et de faire l’objet de toutes les attentions politiques des États-nations comme des organismes internationaux, en particulier ceux créés durant l’après-Seconde Guerre mondiale. Illich montre que cette notion est implicitement liée à un processus de professionnalisation et que, surtout : «les nécessités appellent la soumission, les besoins la satisfaction. Les besoins tentent de nier la nécessité d’accepter l’inévitable distance entre le désir et la réalité et ne renvoient pas davantage à l’espoir que les désirs se réalisent» (8). Autrement dit, alors que la notion de nécessité renvoie non seulement à ce qui est essentiel à la survie mais aussi à ce qui est possible dans les limites des situations, des moyens dont on dispose ou du milieu où l’on se trouve, donc du réel, et implique une certaine humilité dans les désirs, la notion de besoin contient intrinsèquement un refus de la réalité, c’est-à-dire un refus de la finitude, des limites, de l’homme comme de la planète sur laquelle il vit. Pour les progressistes de la société industrielle, l’individu abstrait des Droits de l’Homme, unité nue, indéterminée, permettant l’arithmétique contractualiste des droits et des intérêts, est devenu, après la Seconde Guerre mondiale et le lancement du programme développementiste par le président Truman, un être de besoins, entièrement illimité par ses besoins et, de fait, ses manques. «Le phénomène humain ne se définit donc plus par ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous prenons ou rêvons, ni par les mythes que nous pouvons nous produire en nous extrayant de la rareté, mais par la mesure de ce dont nous manquons et, donc, dont nous avons besoin» (9). La vieille théorie évolutionniste peut ainsi être recyclée en une typologie, en une nouvelle hiérarchie, qui ne sera plus celle des races ou des cultures selon des traits moraux et esthétiques directs, mais du pouvoir – facilement quantifiable par les indicateurs économiques et statistiques – de satisfaction et, surtout, de détermination de ces besoins. Car qui détermine les besoins élabore les critères de jugement et de classement, donc de légitimation morale. Ici entre en scène le processus de professionnalisation, c’est-à-dire de perte d’autonomie (la capacité de faire les choses par soi-même sans passer par des institutions, des corps intermédiaires ou des normes artificielles et homogénéisantes) et d’autarcie (perte des communaux et de l’environnement permettant la survie) : déterminés, prescrits par des experts, des technocrates, c’est-à-dire, par une aristocratie prométhéenne, légitimée par ses démonstrations de puissance, son efficience dans le grand spectacle et les rites techniciens, les besoins sont sans fin et répondent de manière exponentielle à la logique induite par leur propre création.
Le processus moderne est, dans sa phase industrialiste, et par le fait d’un monopole (qui n’est pas seulement celui de la force) d’institutions comme l’État, l’école, etc., une opération de destruction idéologique – en termes de légitimité mais aussi de possibilité légale d’action concrète – de ce que les gens apprennent, savent et savent faire par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Concrètement, si quiconque veut modifier sa maison, il doit demander l’autorisation administrative à un organe bureaucratique, un plan à un architecte et acheter du matériel autorisé et normalisé chez un revendeur agréé. Il n’a plus ni le temps (son emploi salarié le lui vole), ni les capacités (il ne l’a plus appris de ses parents ou de sa communauté), ni la permission légale (l’État seul permet) de faire quoi que ce soit par lui-même. Il est obligé d’utiliser, de consommer les services obligatoires qu’offre la société moderne, par exemple, le marché (et sa logique) ou l’école pour devenir architecte ou ingénieur et apprendre comment on fait une maison, selon quels critères et quels besoins on la fait, comment on bricole, etc. Or ces services répondent ou sont censés répondre à des besoins pour la plupart artificiels et qui n’ont pour objectifs que de susciter d’autres besoins. On entre alors dans la logique du développement : «Fondamentalement, le développement implique le remplacement de compétences généralisées et d’activités de subsistance par l’emploi et la consommation de marchandises; il implique le monopole du travail rémunéré par rapport à toutes les autres formes de travail; enfin, il implique une réorganisation de l’environnement telle que l’espace, le temps, les ressources et les projets sont orientés vers la production et la consommation, tandis que les activités créatrices de valeurs d’usage, qui satisfont directement les besoins, stagnent et disparaissent» (10). Autrement dit, ce qui a constitué l’essentiel de la vie des hommes depuis leur apparition disparaît ou ne subsiste que sous une forme fantôme – terme qui montre une véritable inversion, voire une perversion culturelle puisque ce qui est le vivant même prend le visage de la mort.
On le voit, le développement est une mécanique de destruction doublée d’une mécanique de soumission; on y perd ce que l’on est en faveur d’une illusion de ce que l’on pourrait avoir. Les populations soumises à la logique du développement perdent ce que François Partant appelle les conditions de leur propre reproduction sociale (11). Elle est un énorme processus d’acculturation, non seulement de ceux qui la subissent, mais aussi de ceux qui la promeuvent. Elle détruit les cultures autant que les environnements à partir desquels elles s’étaient fondées, amenant une sorte de «nature artificielle», technicisée. «Le développement économique signifie également qu’au bout d’un moment il faut que les gens achètent la marchandise, parce que les conditions qui leur permettaient de vivre sans elle ont disparu de leur environnement social, physique ou culturel» (12). Le développement crée donc une dépendance aux institutions d’État, au marché, au salariat et aux technocrates; il rend impossibles mais aussi – ce qui est pire – inconcevables les activités de subsistance et d’échange (matériels et spirituels) autonomes liées à l’existence de communaux (13) et de traditions, de cultures locales transmises sans «intermédiaires artificiels», répondant aux nécessités directes d’individus intégrés dans un milieu donné. Ces activités, Illich les appelle vernaculaires. Dans la mesure où le développement «est un programme guidé par une conception écologiquement irréalisable du contrôle de l’homme sur la nature, et par une tentative anthropologiquement perverse de remplacer le terrain culturel, avec ses accidents heureux ou malheureux, par un milieu stérile où officient des professionnels» (14), il nuit à l’ensemble de l’humanité et, d’abord, aux plus faibles. En effet, ils sont les premiers à payer une telle logique, dans la mesure où ils se voient enlever les capacités de survie en faveur d’une intégration dans un système économique aux délices duquel ils n’auront jamais accès; ainsi la pauvreté devient-elle misère et la perte d’autonomie perte d’autarcie. En plus d’être globalement et par nature néfaste, le développement est donc aussi inéquitable, tant socialement que vis-à-vis des femmes.
Sous sa forme industrielle, la modernité est à la fois aporétique et déréalisante. Aporétique car, sous prétexte de libérer l’individu et l’humanité toute entière des contraintes de la nature, de la tradition, de la mort, de Dieu ou du hasard, voire du principe même de l’existence de limites, elle les vend, les voue et les soumet à la volonté de puissance, à la domination des moyens sur les fins, les amenant de ce fait à organiser confortablement leur propre destruction. Déréalisante car ce quelle permet, ce n’est pas un contrôle de l’homme sur son milieu, ou de l’individu sur la société dans laquelle il vit, en somme l’émancipation sous la forme de la fin (d’ailleurs fantasmée) des limites et des contraintes, mais bien la création d’un milieu artificiel, d’un laboratoire, d’un réel artefact clinique, isolé du monde et de l’Autre; un réel artefact qui emprisonne l’individu, détruit sa sociabilité comme son intériorité, le transforme en un objet, un automate seulement disponible, mobilisable. La puissance, dit Illich à la suite d’Épicure, tue la liberté; c’est pourquoi il faut y renoncer.
Notes
(1) Ivan Illich, Œuvres complètes, volume1 (Fayard, 2004), p. 263.
(2) D. Cerezuelle, De l’exigence d’incarnation à la critique de la technique chez Jacques Ellul, Bernard Charbonneau et Ivan Illich, in P. Troude-Chastenet (sous la direction de), Jacques Ellul. Penseur sans frontière (L’Esprit du Temps, 2005), p. 239.
(3) On se référera aussi au fameux Traité du sablier d’Ernst Jünger.
(4) I. Illich, Œuvres complètes, volume1, op. cit., pp. 454-455.
(5) Ibid., p. 456.
(6) I. Illich, L’Histoire des besoins, in La Perte des sens (Favard, 2003), pp. 71-105.
(7) Ibid., p.75.
(8) Ibid., id.
(9) Ibid., p.78.
(10) I. Illich, Le Travail fantôme, in Œuvres complètes, volume 2, op. cit., p. 107.
(11) F. Partant, La Fin du développement. Naissance d’une alternative ? (Saint-Amant-Montrond, Babel, 1997).
(12) I. Illich, Le Travail fantôme, op. cit., p. 96.
(13) Le terme provient des analyses de Karl Polanyi; il désigne, en résumé, les ressources, les lieux et les activités de survie qui ne relèvent ni de l’État ni du marché. Pour plus de précision à ce propos, voir K. Polanyi, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps (Gallimard, coll. NRF, 1998).
(14) I. Illich, Le Travail fantôme, op. cit., p. 113. Dans les sociétés où le vernaculaire dominerait, «l’individu qui a choisi son indépendance et son horizon tire de ce qu’il a fait et fabrique pour son usage immédiat plus de satisfaction que ne lui en procureraient les produits fournis par des esclaves ou des machines. C’est là un type de programme culturel nécessairement modeste. Les gens vont aussi loin qu’ils le peuvent dans la voie de l’autosubsistance, produisant au mieux de leur capacité, échangeant leur excédent avec leurs voisins, se passant, dans toute la mesure du possible, des produits du travail salarié», p. 103.
L’auteur
Frédéric Dufoing est né en 1973 à Liège, en Belgique. Philosophe et politologue de formation, il dirige, avec Frédéric Saenen, la revue Jibrile et a publié de nombreux articles, entretiens (avec Philippe Muray, Serge Latouche, Jacques Vergès, etc.), pamphlets, critiques et chroniques concernant – notamment – l'éthique des techniques, la pensée d'Ivan Illich et celle de Jacques Ellul. Il prépare actuellement un ouvrage consacré à l'écologisme radical.
00:18 Publié dans Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, psychologie, sociologie, ivan illich, théorie politique, sciences politiques, politologie, hommages, modernité, industrialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


