La société actuelle, qui considère le bien-être comme une fin en soi, a de plus en plus tendance à se présenter comme un horizon historique indépassable. Pareille prétention constitue une parodie de l’âge d’or et de l’état édénique évoqués par les mythologies et les religions, une contrefaçon des « îles bienheureuses » entrevues par le Zarathoustra de Nietzsche. Même si c’était « l’ombre de Dionysos » (Michel Maffesoli) qui bercerait le monde post-moderne avec la sérénade du « oui à la vie », il ne faudrait pas oublier que « celle-ci, sous ses formes les plus hautes, est toujours ennoblie par les qualités proprement apolliniennes de discipline, d’ordre, de hiérarchie et de maîtrise » (p. 147. Les citations suivies d’un numéro de page sont extraites du livre recensé).
 Voici l’un des nombreux points culminants du livre de Philippe Baillet, tant par l’élégance de l’écriture que par la pertinence de la pensée. Recueil d’articles parus entre 1988 et 2010 dans Catholica, Le Choc du Mois, La Nef et La Nouvelle Revue d’Histoire, florilège de textes étalés sur deux décennies et complété par un essai inédit fournissant son titre à l’ensemble, cet ouvrage est marqué par une peu commune aptitude à l’organisation du savoir.
Voici l’un des nombreux points culminants du livre de Philippe Baillet, tant par l’élégance de l’écriture que par la pertinence de la pensée. Recueil d’articles parus entre 1988 et 2010 dans Catholica, Le Choc du Mois, La Nef et La Nouvelle Revue d’Histoire, florilège de textes étalés sur deux décennies et complété par un essai inédit fournissant son titre à l’ensemble, cet ouvrage est marqué par une peu commune aptitude à l’organisation du savoir.
Prenant parfois pour point de départ la biographie d’un auteur (comme par exemple Ernst Kantorowicz, que je ne connaissais que de nom), la recension embrasse peu à peu d’autres livres, dont Philippe Baillet tire la « substantifique moelle » avec une rare cohérence, sans s’écarter du sujet initial et en déployant cette qualité essentielle du journaliste, dont Maurice Bardèche me fit part en 1975, lorsqu’il m’encouragea à poser ma candidature à Valeurs Actuelles : la capacité de traiter un dossier.
Je ne vois rien d’inconvenant à émettre quelques considérations d’ordre autobiographique, puisque Philippe Baillet le fait lui-même dans sa préface et dans son hommage à Bernard Dubant, qui devait avoir à peu près le même âge que moi et dont j’apprends ainsi le décès avec tristesse.
Rien d’étonnant à ce que Bernard Dubant se soit intéressé dès 1975 à Donoso Cortés, auquel Philippe Baillet consacre deux chapitres de son recueil, tout en louant le rôle d’éveilleur de son ami disparu : « il fut d’ailleurs le premier à appeler mon attention sur l’importance du penseur espagnol » (p. 158). Tous deux se sont également rencontrés sur les figures atypiques du théâtre français que sont Antonin Artaud et Alfred Jarry, chapitres terminaux de l’ouvrage, le texte sur l’auteur d’Ubu-Roi étant dû à Lucien Renart alias Bernard Dubant.
J’ai personnellement connu Philippe Baillet entre 1977 et 1979 et, s’il n’avait pas pris place à la tribune du colloque évolien dont il parle en page 159, c’était pour nous réserver, lors du débat qui suivit, une intelligente et vigoureuse intervention sur le guerrier vietcong et le Tupamaro d’Uruguay, à ses yeux plus proches de l’héroïsme évolien que les rodomontades pseudo-chevaleresques dont beaucoup de jeunes « nationalistes révolutionnaires » se gargarisaient à l’époque.
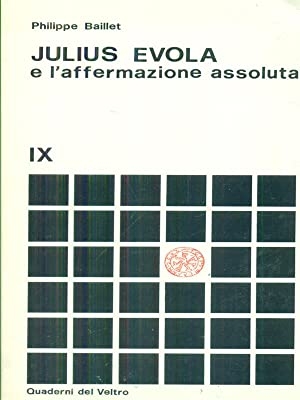 Je garde de Philippe Baillet le souvenir d’un homme d’allure plutôt discrète, mais qui savait, lorsque les circonstances s’y prêtaient, éblouir par une érudition surprenante chez un jeune homme de 27 ans, comme en ce samedi après-midi de janvier 1978 en compagnie d’Yvonne Caroutch et Arnold Waldstein, ou forcer la sympathie par sa franchise, comme à Lyon en février 1979, lorsqu’après ma conférence au Cercle Péguy, nous nous sommes retrouvés entourés de jeunes filles catholiques qui n’étaient pas forcément pour lui (et pour moi encore moins !) un auditoire conquis d’avance.
Je garde de Philippe Baillet le souvenir d’un homme d’allure plutôt discrète, mais qui savait, lorsque les circonstances s’y prêtaient, éblouir par une érudition surprenante chez un jeune homme de 27 ans, comme en ce samedi après-midi de janvier 1978 en compagnie d’Yvonne Caroutch et Arnold Waldstein, ou forcer la sympathie par sa franchise, comme à Lyon en février 1979, lorsqu’après ma conférence au Cercle Péguy, nous nous sommes retrouvés entourés de jeunes filles catholiques qui n’étaient pas forcément pour lui (et pour moi encore moins !) un auditoire conquis d’avance.
Je m’en vais clore les paragraphes des souvenirs à la fois en contant une anecdote amusante et en abordant les choses sérieuses, parmi lesquelles le choix du titre. Philippe Baillet écrit : « À l’âge de quinze, vingt ou trente ans, même quand on est viscéralement de droite, quand on déteste sans moyen terme le monde né avec la Révolution française, on succombe presque toujours à la magie des mots et l’on se dit « révolutionnaire », en croyant que l’emploi d’un mot plutôt que d’un autre est parfaitement anodin. J’ai moi-même connu cette ivresse, mais il y a longtemps que je suis dégrisé » (p. 15).
Yves Bataille, Georges Gondinet et moi-même étions loin d’être dessoûlés lorsque, réunis autour d’une succulente galette des Rois en janvier 1978, nous nous vantions à tour de rôle d’être des « révolutionnaires professionnels ». Philippe Baillet n’était pas présent ce soir-là. Le quatrième convive était Éric Vatré, qui attendait patiemment son tour de présenter sa carte de visite, et qui déclina in fine son identité en ces termes : « un contre-révolutionnaire professionnel ».
« Voilà pour la “ contre-révolution ”. Et “ blanche ” parce que nous sommes confrontés depuis longtemps déjà à des ennemis porteurs d’un projet funeste » (Ibid.). Pour définir ce projet, Philippe Baillet a recours à Jules Monnerot. Ce projet consiste à « modifier la teneur de la population française » et en une « opération grandiose d’invasion acceptée », écrit l’auteur de Racisme et identité nationale dans un numéro spécial de la revue Itinéraires (1990).
Philippe Baillet ajoute que « notre seule chance de survie est liée à l’apparition d’un nouveau type humain de race blanche dans les guerres civilisationnelles et ethniques qui s’annoncent » (p. 16).
On pourrait s’étonner de voir un homme pétri de pensée évolienne accorder tant d’importance à la nation française, mais l’amplification immédiate du sujet remet l’auteur dans le sillage de Dominique Venner et de son brillant éditorial de La Nouvelle Revue d’Histoire (n° 49) : c’est l’Europe qui est en « dormition » et que doit réveiller un chevalier pareil à celui des contes de Perrault et de Grimm redonnant vie à la « Belle au bois dormant ».
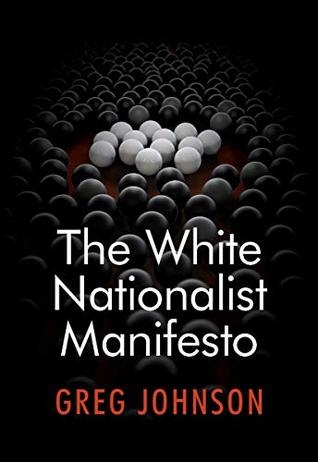 Philippe Baillet va plus loin. Selon lui, la menace pèse sur l’Occident tout entier. L’essai de plus de vingt pages qui donne son intitulé au livre aborde la « radicalisation du conservatisme » et l’« émergence de la Droite » racialiste ” aux États-Unis » (p. 87). Ce texte inédit est probablement récent, puisque la recension des livres bien connus de Samuel Huntington date de 2005, corrobore le vœu d’une « contre-révolution blanche » et atteste l’état actuel de la pensée de l’auteur.
Philippe Baillet va plus loin. Selon lui, la menace pèse sur l’Occident tout entier. L’essai de plus de vingt pages qui donne son intitulé au livre aborde la « radicalisation du conservatisme » et l’« émergence de la Droite » racialiste ” aux États-Unis » (p. 87). Ce texte inédit est probablement récent, puisque la recension des livres bien connus de Samuel Huntington date de 2005, corrobore le vœu d’une « contre-révolution blanche » et atteste l’état actuel de la pensée de l’auteur.
Philippe Baillet se distingue de la doxa droitiste française caractérisée par un « anti-américanisme rabique, systématique, aveugle » (p. 107), « comme si les Américains blancs devaient expier jusqu’à la fin des temps le fait d’être nés dans une culture issue du protestantisme dissident » (p. 108).
Reconnaître l’existence d’« esprits libres d’outre-Atlantique » (p. 62) n’est pas incompatible avec la désignation des États-Unis comme ennemi géopolitique principal, ainsi que l’affirme à plusieurs reprises une livraison récente d’Éléments (n° 136). Je remarque d’ailleurs que Philippe Baillet confirme son soutien au Choc du mois, bien que la nouvelle mouture de cet organe de presse soit moins radicale que la précédente. « L’influence indirecte d’Alain de Benoist y est de plus en plus perceptible » (p. 10).
Pour Alain de Benoist, la bourgeoisie est au plan social ce que sont les États-Unis au niveau géo-politique : l’ennemi principal. Mais qu’est-ce que le bourgeois ? L’homme « qui pense bassement » et que fustige Gustave Flaubert ? Le « cochon qui aspire à mourir de vieillesse » tout en s’abêtissant que vilipendent Léon Bloy et Jacques Brel ? Philippe Baillet fait sienne la formule de Donoso Cortés. La bourgeoisie doit être pourfendue en tant que « classe discuteuse » (p. 32). Il ne s’en cache d’ailleurs pas : « Il s’agit, grâce à certaines armes intellectuelles, de se préparer au combat, non au débat » (p. 13). Il exècre les discussions des plateaux télévisuels, sans règles préalables et sans objectif clairement fixé, dont chacun repart avec les mêmes entraves et préjugés que ceux qu’il apportait en passant au maquillage.
Est-on pour autant en présence d’un polémiste « au couteau entre les dents » ? Certes non. Le projet évoqué plus haut est monstrueux, mais ses adeptes ne sont pas forcément des monstres. « Écraser une secte n’est pas imiter ses fureurs, sa rage sanguinaire et l’homicide enthousiasme dont elle enivre ses apôtres » (p. 22). Ainsi parle l’abbé Augustin Barruel, dont Philippe Baillet loue l’indispensable distinction entre la bataille des idées et la destruction des hommes.
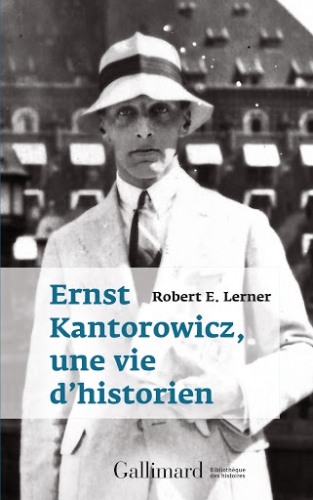 L’article hyper-critique consacré à « Israël et ses extrêmes » (p. 117) fait immédiatement suite à un légitime éloge « des grands érudits juifs modernes » : Kantorowicz déjà cité, Marc Bloch, Raymond Aron, Aby Warburg. Parmi les « représentants du peuple juif » dignes d’inspirer notre admiration, et au rebours d’un autre a priori encore trop rageusement enraciné chez bon nombre d’entre nous, Philippe Baillet mentionne « tous ceux qui, libraires spécialisés dans l’ancien ou éditeurs d’ouvrages à faible tirage et à vente lente, sont en quelque sorte les artisans de la haute culture, ceux qui, par exemple dans des domaines comme l’orientalisme, en ont assuré la pérennité matérielle, chose de plus en plus difficile aujourd’hui » (p. 116).
L’article hyper-critique consacré à « Israël et ses extrêmes » (p. 117) fait immédiatement suite à un légitime éloge « des grands érudits juifs modernes » : Kantorowicz déjà cité, Marc Bloch, Raymond Aron, Aby Warburg. Parmi les « représentants du peuple juif » dignes d’inspirer notre admiration, et au rebours d’un autre a priori encore trop rageusement enraciné chez bon nombre d’entre nous, Philippe Baillet mentionne « tous ceux qui, libraires spécialisés dans l’ancien ou éditeurs d’ouvrages à faible tirage et à vente lente, sont en quelque sorte les artisans de la haute culture, ceux qui, par exemple dans des domaines comme l’orientalisme, en ont assuré la pérennité matérielle, chose de plus en plus difficile aujourd’hui » (p. 116).
Je ne cache pas que, de prime abord, une certaine perplexité m’a saisi en voyant Philippe Baillet se rallier « à la cause du peuple blanc » (p. 79), comme l’ex-libéral Samuel Huntington aujourd’hui « au soir de sa vie » (p. 85). Ceux qui n’ont pas notre couleur de peau seraient-ils tous inaptes à devenir, eux aussi, des « artisans de la haute culture » ? René Guénon et Julius Evola ne nous auraient-ils délivré du biologisme que pour nous y faire retomber, par une sorte de régression, sous l’empire de l’une ou l’autre projection statistique assignant à notre race un statut de minorité dans un quart de siècle ?
Mais Philippe Baillet précise que « pour Huntington, l’identité nationale américaine repose sur deux piliers, la culture et la religion, non sur la race » (p. 84). Aux Européens de méditer ce message, même si le patrimoine religieux y est plus diversifié qu’aux États-Unis. Outre-Atlantique, Huntington défend l’importance de la culture anglo-protestante. De ce côté-ci de l’océan, l’unité religieuse ne semble pouvoir se faire qu’au prix d’un « œcuménisme libéral » (Nikos Vardhikas), c’est-à-dire d’une sorte de consensus-ratatouille, où catholiques, orthodoxes et réformés se tairaient sur les sujets qui fâchent et seraient ramenés à leur plus petit commun dénominateur.
Dès lors, les Européens doivent plutôt miser sur leur unité culturelle et, s’ils intègrent le concept de « race », ce ne peut en aucun cas se faire dans l’acception « pseudo-biologique » (Christian Vandermotten) d’aujourd’hui, mais au sens évolien de « race de l’esprit », ou dans la perspective d’un vieux fond anthropologique se référant à « une histoire singulièrement lointaine » (André Siegfried).
Philippe Baillet évoque « la mise au pas de toute pensée vraiment libre » (p. 115) par le nazisme qui a ainsi contraint à l’exil plusieurs historiens allemands d’origine juive : Mosse, Laqueur, Stern, dont il déplore l’inexistence ou le caractère tardif des traductions en français (p. 66).
Le brillantissime article de 2010 « Sur deux approches de l’idéologie nazie » (p. 63) prouve que l’étape la plus récente du Denkweg de Philippe Baillet n’est entachée d’aucun repli crispé sur une position nationaliste et raciste.
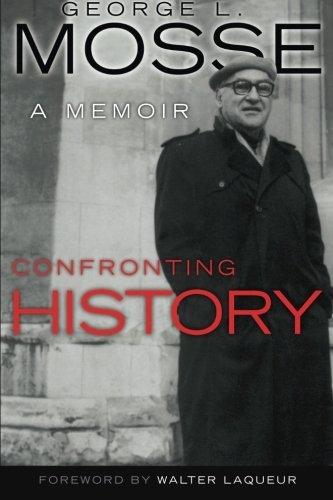 Au détriment de l’« indigeste pavé prétentieux et très décevant » (p. 76) d’un universitaire français, Philippe Baillet privilégie l’analyse de George L. Mosse, autre « esprit libre d’outre-Atlantique ». Ce dernier voit dans le mouvement völkisch une des plus profondes « racines intellectuelles du Troisième Reich ». Il y décèle une « conception essentiellement culturelle […] de l’État-nation », en réaction contre « l’industrialisation à marche forcée » de l’Allemagne et « à cause de la très longue et tortueuse édification de l’unité politique » (p. 69).
Au détriment de l’« indigeste pavé prétentieux et très décevant » (p. 76) d’un universitaire français, Philippe Baillet privilégie l’analyse de George L. Mosse, autre « esprit libre d’outre-Atlantique ». Ce dernier voit dans le mouvement völkisch une des plus profondes « racines intellectuelles du Troisième Reich ». Il y décèle une « conception essentiellement culturelle […] de l’État-nation », en réaction contre « l’industrialisation à marche forcée » de l’Allemagne et « à cause de la très longue et tortueuse édification de l’unité politique » (p. 69).
Philippe Baillet nous fait découvrir cet historien américain d’origine juive allemande, dont l’œuvre vient à peine d’être traduite en français, près d’un demi-siècle après sa publication originale (1964). Il se fait l’écho de l’auteur d’Intellectual Origins of the Third Reich en rappelant comment les nazis s’inscrivirent dans la continuité du mouvement völkisch, mais au prix d’une terrible simplification, d’une catamorphose des Juifs en symboles dégradants (les « rats », les « bacilles ») et d’un détournement de la « révolution allemande » dans le sens d’une « révolution antijuive » (p. 72).
Les grandes tragédies humaines, les guerres du XXe siècle, les éventuels conflits ethniques et civilisationnels de demain : tout cela peut générer un « nouveau type humain » (p. 16), mais pas nécessairement apparenté au kshatriya. Certes, des tranchées de 14-18, ont émergé Drieu, Barbusse, Evola, Jünger, et Hitler lui-même gazé à l’ypérite sur le front de l’Yser. Mais si l’on regarde par exemple les écrivains belges sortis de la « boue des Flandres », on découvre plutôt des figures apparentées au brahmane. L’un d’eux intitule son roman de guerre Mes cloîtres dans la tempête, répondant ainsi aux Orages d’acier. Le poète José Gers part en quête de sagesse vers un Jardin des Hespérides via l’aventure maritime. Ses voyages vers le Sud lui font adopter l’Afrique, tant maghrébine que subsaharienne, comme une seconde patrie. Nulle tentation d’un totalitarisme « de gauche » ou « de droite » chez cet aventurier iréniste, pas plus que chez son ami le peintre René Devos, engagé volontaire en 1915, à l’âge de 18 ans, chantre pictural de la féminité, cette « Floride à jamais inexplorée ». Rien de « fasciste » ou de « communiste » non plus chez le délicat Constant Burniaux, brancardier bénévole dès 1914 (il a 22 ans), auteur du récit Les Brancardiers, puis de poèmes exaltant les choses simples de la vie, cette enfance perpétuelle pourvoyeuse de nostalgie dont « nul ne guérit » (Jean Ferrat). Il n’est donc pas sûr qu’à l’éventuel « horizon de fumée et de feu » (Milosz) se lèveraient forcément de nouveaux « purs » et durs, forgerons du Nouvel Ordre de demain.
De même qu’entre occidentalisation et modernisation dans le sillage de Samuel Huntington, Philippe Baillet démasque la prétendue synonymie des concepts de « progrès » et de « révolution » à la faveur de sa très fine analyse d’Augusto Del Noce (pp. 137 à 147).
Dans la pensée de ce philosophe italien, une loi cyclique devrait avoir une résonance toute particulière chez les évoliens et les guénoniens. Cette loi « veut que les grands courants de pensée […] reproduisent toujours, dans leur phase terminale, leurs traits originels, mais sous une forme accentuée » (p. 141). Philippe Baillet donne ensuite la parole à Del Noce : « L’idéologie spontanée de la bourgeoisie est le matérialisme pur, le positivisme exclusivement attentif aux faits bruts, la négation de toute présence d’un sens qui transcende le phénomène immédiat ».
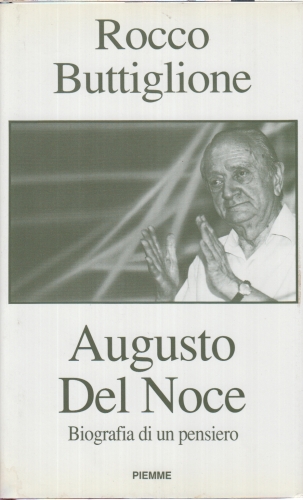 Del Noce décrit ainsi « l’irreligion naturelle » qui caractérise la société actuelle et avec laquelle « on passe même du rejet, qui est encore le signe paradoxal d’un certain intérêt, à l’indifférentisme complet » (p. 138) sur le plan religieux.
Del Noce décrit ainsi « l’irreligion naturelle » qui caractérise la société actuelle et avec laquelle « on passe même du rejet, qui est encore le signe paradoxal d’un certain intérêt, à l’indifférentisme complet » (p. 138) sur le plan religieux.
Si le cycle bourgeois entre dans sa « phase terminale », les temps à venir peuvent donc être qualifiés de « post-bourgeois », d’où l’intitulé de ma recension. Pour le terme « passeports », je me suis inspiré du titre d’un livre de Jean Biès, dont j’ai rendu compte vers 1982 je ne sais plus exactement où, peut-être dans la revue Totalité, dont Philippe Baillet mentionne la fondation en page 160.
Il serait intéressant d’approfondir la confrontation du « bourgeoisisme » tel que l’envisage Del Noce avec les cyclologies de René Guénon et de Julius Evola.
Le cycle « bourgeois » selon Del Noce serait comparable à la « première phase de l’action antitraditionnelle » selon Guénon. Toutefois s’y glissent déjà les sous-phases ou les micro-cycles caractérisés, d’une part par le compromis de l’esprit bourgeois avec le christianisme (compromis dont la bourgeoisie n’a plus besoin aujourd’hui), d’autre part par les parodies de spiritualité des totalitarismes (communisme, fascisme, nazisme), qui relèvent déjà de la « seconde phase de l’action antitraditionnelle » (Guénon) et que Del Noce appelle « la période sacrée de la sécularisation » (p. 142), l’irreligion d’aujourd’hui en étant la « période profane » (p.1 43).
Quant à Julius Evola, sa loi de « régression des castes dominantes » (version décadentiste des théories de Pareto et de Michels) devrait impliquer dans le futur un réveil du communisme, à moins que, sur les ruines des désastreuses expériences des totalitarismes « rouges », surgisse rapidement le type humain du « cinquième État » qui impose sa domination. Ce serait alors dans un livre comme Explorations. Hommes et problèmes (Éditions Pardès, traduction de Philippe Baillet) qu’il faudrait chercher, du point de vue évolien, les « passeports pour des temps post-bourgeois ».
Le problème est loin d’être simple. Relisons à nouveau Del Noce, intelligemment cité par Philippe Baillet. « C’est pourquoi l’on remarque ce paradoxe qui fait que la vitalité, de matière qui doit être vaincue et transfigurée par les valeurs, est elle-même élevée au rang de valeur, et même devient mesure de toute autre valeur » (p. 140).
Je souscris entièrement à ces lignes, mais ce culte de la vitalité me paraît renvoyer à la « seconde phase de l’action antitraditionnelle » selon Guénon : « seconde phase » se mêlant alors à la première, ainsi qu’en témoigne par exemple la critique que fait Guénon du vitalisme de son contemporain Bergson. Tout cela se passe bien avant « les années 1960 » (Ibid.), mais le vitalisme connaît effectivement un regain durant cette décennie à travers le mouvement New Age.
Le chapitre concerné reste muet sur le point de départ du cycle bourgeois. Puisqu’il a été question du « monde né de la Révolution française », on peut situer ce point de départ dans l’œuvre de Denis Diderot, véritable écrivain-fétiche de certains universitaires bruxellois, dont l’influence commence heureusement à être contrebalancée, comme je le montrerai plus loin, par d’autres références propres à une génération de plus jeunes professeurs.
Encore ne faut-il pas oublier que le fils du coutelier de Langres, aussi conseiller de Catherine II de Russie, se dédouble dans Le Neveu de Rameau en un Moi rationaliste et un Lui où le professeur Maurice Lefebvre voit un pré-romantique.
Mais cela ne contredit pas la théorie de Del Noce, car on peut considérer que le matérialisme à l’état brut, trait originel du Diderot de la Lettre sur les Aveugles, revient aujourd’hui sous la forme accentuée de la fin de cycle, sans tolérer désormais aucune contre-partie « romantique ».
Voici une autre formulation de Del Noce que doivent méditer tous ceux qui sont convaincus d’être dans un « inter-règne », comme le répète inlassablement et avec raison Alain de Benoist. Décrivant « la situation actuelle », Del Noce écrit : « mort des anciens idéaux, mais dans le même temps aveu que de nouveaux idéaux ne peuvent pas naître » (cité par Philippe Baillet, p. 143).
Tel est du moins l’« aveu » que le Système veut nous arracher. Une évidence n’en demeure pas moins. Précisément parce que nous sommes dans un « inter-règne », il est difficile de cerner les contours des « nouveaux idéaux », de désigner l’ennemi de demain, de braquer le projecteur sur celui qui, demain, nous désignera comme ennemi.
Plusieurs rédacteurs d’Éléments (n° 136) évoquent le « capitalisme post-bourgeois » et donc forcément « post-prolétarien ». Mais alors, s’agit-il encore de « capitalisme » ? Ne faut-il pas in fine recourir au meilleur Guénon, celui de la « révolte du kshatriya » ? Le plus grand danger n’est-il pas incarné par le kshatriya émancipé de la supériorité du brahmane, c’est-à-dire par la vitalité dionysiaque refusant de se laisser ennoblir par les valeurs apolliniennes ? La nouvelle classe dominante ne serait-elle pas composée de ce type humain posant « un regard-pirate sur l’Univers » (Frank-Albert Duquesne), recruté parmi les renégats de toutes races et de toutes les traditions, de même que le type humain qu’il faut lui opposer doit émaner de tous les horizons ethniques et culturels ?
Malgré l’ampleur de son index et de son apparat critique, Philippe Baillet ne cite Guénon que cinq fois : une fois en bas de page, deux fois dans l’article sur Artaud, deux fois en liaison avec Bernard Dubant et Jean-Claude Cuin, un autre ami trop tôt disparu.
L’auteur a choisi d’insister sur le péril qui menace l’homme blanc sans prôner pour autant une quelconque supériorité de celui-ci. Écoutons-le à nouveau répercuter l’avertissement d’Huntington. « L’Occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs, sa religion étaient supérieures […], mais plutôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée. Les Occidentaux l’oublient souvent, mais les non-Occidentaux jamais » (cité p. 81).
La présente recension touche à sa fin et j’espère n’avoir oublié de mentionner aucun des chapitres. Chacun correspond à un mérite particulier de l’auteur. Certains s’attaquent à des sujets de moi quasi inconnus. C’est dire si je m’incline avec respect devant l’immense culture de Philippe Baillet, autodidacte qui a su se faire accepter dans certains milieux universitaires, ainsi qu’en témoigne en 2007 sa collaboration à des mélanges dédiés à Jean-Pierre Laurant septuagénaire.
Philippe Baillet est le principal artisan de la réception de Julius Evola dans l’espace francophone. Son parfait bilinguisme italo-français lui permet d’aborder dans le texte original et de nous restituer fidèlement la pensée de grands politologues transalpins. Toujours soucieux de faire la part des choses, il peut juger la traduction d’Evola par Pierre Pascal « calamiteuse » tout en rendant hommage à l’auteur de la Chanson de Robert Brasillach (p. 56).
Son article sur Boris Souvarine fut publié avant les livres de Jean-Louis Panné et François Furet, à une époque où « il était de bon ton de taire les liens très étroits, après 1945, [de Boris Souvarine] avec d’anciens collabos » (p. 53).
Il faut un indéniable courage intellectuel pour affronter le « sujet maudit » des Protocoles des Sages de Sion (p. 43) sous l’angle évolien de l’alternative « authenticité – véracité » (p. 48). La question n’est pas de savoir si ce texte est authentique. On sait qu’il s’agit d’un faux. En revanche, on est en droit de s’interroger sur la plausibilité de réalisation de son programme, celui-ci pouvant d’ailleurs être concocté en un tout autre milieu que celui d’une loge « judéo-maçonnique ».
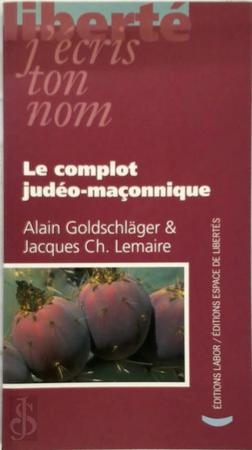 Titulaire d’une agrégation en philosophie et lettres de l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles, émanation du Grand Orient de Belgique), je suis bien placé pour savoir comment on risque de se désagréger sous l’effet de la quasi permanente « leçon de conformisme » dispensée par « les cliques universitaires et leur structure féodale » (p. 77).
Titulaire d’une agrégation en philosophie et lettres de l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles, émanation du Grand Orient de Belgique), je suis bien placé pour savoir comment on risque de se désagréger sous l’effet de la quasi permanente « leçon de conformisme » dispensée par « les cliques universitaires et leur structure féodale » (p. 77).
La situation me semble toutefois moins désespérée à l’U.L.B., où l’on édite et enseigne depuis peu Roberto Michels et André Siegfried. Même parmi les professeurs soixante-huitards, dont certains furent mes compagnons de promotion (tels que Jacques Lemaire et Alain Goldschläger, dont j’ai recensé le livre sur le « complotisme »), Philippe Baillet aurait trouvé en Jacques Sojcher, dissertant sur « la crise de la vérité » dans la philosophie moderne, un interlocuteur plus valable qu’André Comte-Sponville à propos du « perspectivisme » (p. 128) de Nietzsche, pour qui « les évidences élémentaires sont déjà des masques ou des filtres » (p. 129).
Ce fut pour moi un plaisir et un honneur de rendre compte du livre de Philippe Baillet. Me revient en mémoire un restaurant asiatique où nous étions attablés avec Bernard Dubant. Je me rappelle deux convives sympathiques, prodigieusement intéressants, non dénués d’un humour dont ils saupoudraient de manière bien dosée leur conversation d’érudits. Avec ce recueil d’articles témoignant de près d’un quart de siècle de recherches, Philippe Baillet s’érige en essayiste accompli, de lecture agréable et à la documentation fouillée. Il incite notre famille intellectuelle à se libérer de certains de ses a priori. Il nous indique le chemin d’une authentique pensée libre, tandis que de fallacieux « libres-penseurs », porteurs auto-proclamés de douteuses « lumières », cherchent à nous mener tout droit à l’impasse. Philippe Baillet est de ces éveilleurs dont nous avons un urgent besoin. Grâce lui soit rendue, ainsi qu’à son éditeur, de nous léguer cet excellent florilège.
Daniel Cologne
• Philippe Baillet, Pour la Contre-Révolution blanche. Portraits fidèles et lectures sans entraves, Éditions Akribeia, 2010, 188 p., 18 € (+ 5 € de port). À commander : Akribeia, 45/3, route de Vourles, F – 69230 Saint-Genis-Laval.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg