jeudi, 31 janvier 2008
Synergies Européennes: vie du mouvement (déc.07 - janv. 08)

Synergies Européennes – Décembre 2007/Janvier 2008
http://euro-synergies.hautetfort.com
Vie du mouvement
SINT-PIETERS-LEEUW / PAYOTTENLAND : Le 1 décembre 2007 s’est tenu le congrès annuel des associations identitaires, où a eu lieu un débat entre Alain Soral (ex-communiste devenu frontiste) et Eddy Hermy (ancien maoïste et ex-blokker en Flandre, qui appelle aujourd’hui à la restauration d’un nouveau solidarisme populaire) ; le débat entre ces deux personnalités fut animé par Robert Steuckers. Un rapport sur ce débat a été rédigé d’abord en langue néerlandaise (cf. 4 déc. 2007 sur http://euro-synergies.hautetfort.com ) puis a été traduit en français par Georges Hupin, président de la Bannière Terre & Peuple de Wallonie (cf. infra). L’intérêt du débat est de montrer l’inanité des oppositions entre anciennes gauches et anciennes droites face à un ennemi commun qui est le néo-libéralisme et la globalisation, perspective déjà mise en exergue par Roger Garaudy et Jean-Marie Domenach (revue « Esprit »), juste avant le scandale dit des « rouges/bruns », qui fut déclenché par « Le Monde » à Paris en 1993. L’établissement, avec ses « chiens de garde » étiquetés de « gauche » mais dépourvus de toute audace politique, pour reprendre la terminologie polémique de Serge Halimi, ne voulait pas de la convergence rêvée par Garaudy, déjà bien avant son exclusion du PCF, comme l’atteste d’ailleurs clairement son œuvre philosophique. Notons aussi que ce débat entre identitaires et anciens militants communistes et maoïstes, dans le beau Payottenland brabançon, suivait de quelques jours un débat analogue tenu à Vienne, sous les auspices de l’hebdomadaire « zur Zeit », où le journaliste Dimitrij Grieb publiait simultanément un article d’introduction générale à la problématique du passage des anciens soixante-huitards dans le camp identitaire en Allemagne et en Autriche, suivi de deux entretiens : 1) avec l’ancien socialiste autrichien et secrétaire du Chancelier Kreisky, Günther Rehak (qui avait pris la parole avec Scrinzi et Steuckers à Vienne le 28 octobre 2007) ; et 2) avec le Prof. Bernd Rabehl, ancien bras droit de Rudi Dutschke.
LIMA / PEROU : Parution, le 2 décembre 2007, sur le blog du Professeur péruvien Eduardo Hernando Nieto d’un texte déjà ancien de Robert Steuckers consacré à la figure du frère d’Ernst Jünger, Friedrich-Georg. Intitulé en espagnol « La Perfeccion de la Tecnica : F. G. Jünger », ce texte est accessible sur : http://eduardohernandonieto.blogspot.com . Précisons que ce blog, d’un intérêt cardinal pour nous tous, recèle une véritable mine d’or d’articles sur Léo Strauss, Carl Schmitt, Erich Voegelin, Julius Evola, etc. Pour en savoir plus, se référer à la fiche que consacre l’encyclopédie « Wikipedia », version française, à la personnalité et l’œuvre d’E. H. Nieto. Le texte de Steuckers sur F. G. Jünger est une nouvelle mouture en langue castillane de son étude parue en 1992 dans l’ « Encyclopédie des Œuvres Philosophiques » des Presses Universitaires de France. Il avait aussi servi de base à un exposé lors de l’Université d’été du GRECE, près d’Aix-en-Provence, en 1991.
BRUXELLES : Pierre Emile Blairon, directeur de la revue « Hyperborée », publiée en Provence, est venu animer un dîner-débat à Bruxelles, le 21 décembre 2007. Il a présenté les derniers numéros de sa publication, notamment le n°5, où Paul-Georges Sansonetti analyse les symboles et figures du Chaudron de Gundestrup ; Paul Catsaras évoque les sept degrés de l’ordre mithriaque. Le Professeur Jean Haudry, dans une contribution très fouillée, comme d’habitude, et intitulée « Du ciel de pierre au ciel dans la pierre », retrace les fondements même de la cosmogonie indo-européenne, à partir des recherches antérieures de Roth, Schmidt, Reichelt, Hopkins, Biezais, Maher, Arena, Huld, Lazzeroni, Crevatin, Gamkrelidze et Ivanov. Cette étude magistrale sera poursuivie dans les numéros prochains d’ « Hyperborée ». Alain Cagnat, dans la rubrique « Notre Europe », évoque de manière assez exhaustive et poignante « Chypre d’Aphrodite à Attila », déplorant le vandalisme effroyable qui a suivi l’invasion turque de l’île en 1974. Pierre Emile Blairon signe un article sur Jean Giono, avant de republier un article de cet écrivain provençal, titré « Le bourdonnement des abeilles ». Ludovic Dorant signe « De la signification véritable de la ‘tête de Maure’ du drapeau corse ». Lors de cette soirée bruxelloise du 21 décembre, Blairon a également présenté au public la thèse originale qui sous-tend son avant-dernier ouvrage : « La Dame en signe blanc – Marie-Madeleine, la déesse des origines », où l’on trouve surtout une hypothèse nouvelle sur la bataille ayant opposé les légions romaines, réorganisées par Marius, aux Cimbres, Teutons et Ambrons dans la région d’Aix-en-Provence (Aquae Sextiae) en 102 av. notre ère. Cette soirée a servi à faire connaître également l’ouvrage de Paul-Georges Sansonetti, « Chevalerie du Graal et Lumière de Gloire », paru à Menton en 2002 aux éditions Exèdre. La notion de « Lumière de Gloire », issue tant des traditions perses (« Kvarnah ») que du cycle arthurien, partiellement introduit par les cavaliers sarmates de Rome dans les Iles Britanniques, intéresse tous ceux qui, par tâtonnements successifs, entendent, à terme, relancer l’idéal des « Perséides » qui avait animé Marc. Eemans et René Baert, fondateurs, avant-guerre, de la revue « Hermès ». Référence d’ « Hyperborée » : www.hyperboreemagazine.fr (service librairie à partir du site).
LILLE : Le 22 décembre 2007, à l’invitation de la Bannière Terre & Peuple de Flandre-Hainaut-Artois, présidée par Pierre Loubry, Robert Steuckers a présenté, en la résumant, son étude parue sur les sites « be.altermedia.info » et « fravahr.com » consacrée à l’histoire, l’actualité et la géopolitique du fait iranien. Cette conférence solsticiale avait pour but de cerner l’enjeu de six faisceaux de faits relatifs à l’histoire iranienne : 1) les prémisses proto-historiques de l’histoire iranienne » ; 2) La constance territoriale de l’Empire perse (de -1600 à nos jours), avec la notion de périphérie septentrionale (la Bactrie) où se massaient, avant l’arrivée des Huns et des Turco-Mongols les peuples nomades indo-européens qui régénéraient l’Empire à intervalles réguliers ; 3) La longue lutte entre Rome et les Parthes, puis entre la Perse et Byzance, jusqu’à l’épuisement de ces deux puissances et l’avènement de l’islam ; 4) La conquête islamique de la Perse, de sa périphérie septentrionale jusqu’à la bataille de Talas en 751 ; le maintien d’une spécificité perse après cette conquête, avec les Samanides, les Bouyyides et Mahmoud de Ghazni ; la renaissance culturelle persane avec Ferdowsi, Omar Khayyam et la mystique de Sohrawardi ; 5) Le 16ième siècle des Séfévides ; 6) le déclin définitif de l’ancienne puissance persane après Nader Shah Afschar (1729-1747). La seconde partie de l’exposé concernait l’Iran moderne sous les Shahs de la dynastie Qadjar, les interventions britanniques et la volonté de Londres de n’autoriser aucune expansion persane en direction de l’Afghanistan dès 1837 ; le rôle subversif des Babis constitutionalistes soutenus par les Britanniques. Steuckers a ensuite évoqué la renaissance iranienne sous l’impulsion de Reza Khan Pahlavi, les événements très importants de la seconde guerre mondiale en Iran, le règne chahuté de son fils Mohammed Reza Shah Pahlavi avec l’affaire Mossadegh, la crise de l’OPEP, les projets de « révolution blanche », la révolution islamiste soutenue au départ par les Etats-Unis (ce que l’on a tendance à oublier aujourd’hui !!). Dans cette dernière partie de son exposé, Steuckers a surtout utilisé deux documents fort négligés par les historiens, observateurs et journalistes actuels : les mémoires du dernier Shah et celles de son ancien ministre de l’éducation Houchang Nahavandi, mort en exil à Bruxelles récemment.
BRUXELLES : Sous la direction de Robert Steuckers, lecture critique, le 27 décembre 2007, pour quelques stagiaires bruxellois, liégeois et lillois, du petit livre de Régis Debray, « L’obscénité démocratique », où l’ancien compagnon du Che et ministre de Mitterrand, en dépit d’un charabia républicaniste français qui échauffe nos oreilles de bons Impériaux, plaide en faveur d’une majesté et de pompes étatiques, ce qui le rapproche de Carl Schmitt, grand avocat de la représentation et de la visibilité du pouvoir direct (et de l’Eglise dans sa « forme catholique »). Sans cette nécessaire visibilité, le pouvoir est occulté, devient « potestas indirecta », ce que Schmitt désapprouve, car derrière toute « potestas indirecta » il subodore complots et intrigues anti-démocratiques. Pour Debray, le pouvoir doit découler de l’assemblée, du parlement, du peuple et non pas de médias qui décident de ce qui est bon ou mauvais pour le bien public, en dehors de toute visibilité publique.
PARIS : Le 23 décembre 2007, le site consacré en France à l’œuvre politique du Président russe actuel, Vladimir Poutine, a repris in extenso le texte sur l’Iran de Robert Steuckers, affiché antérieurement sur « be.altermedia.info » et « fravahr.com » (rédigé par des Iraniens en exil). Référence : http://vladimir-poutine.activblog.com/article-205018.html...
LIEGE / VERVIERS : Les stagiaires principautaires de l’école des cadres, animé cette fois par Luc Moulinat, ont eu pour lecture en novembre-décembre le travail de Matthieu Baumier, « La démocratie totalitaire – Penser la modernité post-démocratique », paru aux Presses de la Renaissance en 2007. La teneur de cet ouvrage se situe bien dans le sillage de Bernanos, ce qui relie le travail de nos amis liégeois et verviétois à celui de nos amis du Brabant wallon (cf. infra). Pour Baumier, la post-démocratie, qui est notre régime monstrueux et irréaliste actuel, inverse le réel du monde et le réel de la Personne humaine, précipitant nos sociétés dans le vide et la vacuité totale.
BRUXELLES : Le 30 décembre 2007, Ivan de Duve lance sur le net une excellente recension du dernier livre de Jean Parvulesco, intitulé « Dans la forêt de Fontainebleau », que nous afficherons dès que possible sur notre propre site http://euro-synergies.hautetfort.com dans la rubrique consacrée à Jean Parvulesco. Le livre est paru aux éditions « Alexipharmaque ».
GAND : Dans les cercles « synergétistes » de Gand, fonctionnant en langue néerlandaise, les stagiaires ont étudié l’œuvre de Mircea Eliade, en particulier « Le sacré et le profane ». Selon les principes de fonctionnement, jadis mis au point par Philippe Banoy, les stagiaires doivent lire les classiques directement dans le texte, afin d’avoir des bases solides pour poursuivre ultérieurement leur quête intellectuelle. On apprend que le résultat du travail de nos amis gantois, soit une conférence sur Eliade clé sur porte, sera bientôt « exporté » à Leuven ! Viralité synergétiste oblige !
BUDAPEST : Le site hongrois www.antidogma.hu a publié le 29 décembre 2007 quelques extraits d’un entretien de Robert Steuckers sur les événements et la géopolitique du Moyen et du Proche-Orient sous le titre de « Irany Mezopotàmia – Iszlam terfoglalàs az amerikai strategiai jà tszma tükrében ».
NANTES : Le site « voxnr.com », animé par l’infatigable Christian Bouchet, publie fin décembre trois textes issus des travaux de « Synergies Européennes » : 1) La traduction française de l’entretien avec Bernd Rabehl, ancien bras droit de Rudi Dutschke à Berlin, qu’avait réalisé Dimitrij Grieb pour l’hebdomadaire viennois « zur Zeit » ; 2) L’excellent texte de l’orientaliste flamand, qui signe la rubrique « Ex Oriente Lux » dans l’hebdomadaire anversois « ‘t Pallieterke », sur les Sikhs et la Khalsa ; 3) l’article historique de Saverio Borgheresi sur la conquête américaine des Philippines, paru préalablement dans le quotidien romain « Rinascita » (dont Bouchet est le correspondant en France). Référence : http://www.voxnr.com .
BRABANT WALLON : Dans ce « Roman Païs » de l’ancien duché impérial du Brabant, sous la dynamique impulsion de Max Steens, qui aime sortir des sentiers battus, même ceux qui ne sont battus que par les « nôtres », trois thématiques ont été mises en exergue depuis novembre 2007 : 1) Une relecture innovante de Georges Bernanos, dans le sillage que nous avait indiqué Laurent Schang, il y a quelques années ; Steens a proposé aux stagiaires et sympathisants de relire les textes d’après la seconde guerre mondiale, notamment certaines conférences de 1946, où notre écrivain français, pourtant hostile au fascisme et au nazisme pendant la deuxième « grande conflagration », ne salue pas la victoire de l’américanisme et du bolchevisme (pour reprendre la terminologie de Heidegger) et constate avec effroi l’abomination dans laquelle sera très vite jeté notre monde : celui-ci sera concentrationnaire car la démocratie moderne participe, selon Bernanos, de la même perversité concentrationnaire que le nazisme qu’elle a si vigoureusement combattu. L’administration bureaucratique, hypertrophiée et obèse (Baudrillard) qu’elle génère, tel un cancer, est le reflet le plus patent de cette perversité concentrationnaire. 2) Vu la forte concentration de romanistes et de philosophes issus de Louvain-la-Neuve dans le cercle des amis de Steens, la deuxième thématique est l’œuvre de René Girard, « Mensonge romantique et vérité romanesque ». Pourquoi mobiliser Girard ? Lubie de Steens ? Non, répond-il, avec la véhémence enthousiaste qu’on lui connaît : Girard a entamé une recherche sur la mimésis et le désir triangulaire (que l’on retrouve chez Freud et Hegel), présents dans les œuvres, classiques autant que cardinales, de Cervantès, Stendhal, Proust, Dostoïevski. L’objectif est de former, bien évidemment, des professeurs de français, de morale laïque ou de religion, capables de dire autre chose à leurs étudiants (en dépit de l’effondrement culturel actuel) que les banalités imposées par le nouvel univers concentrationnaire à drapeau démocratique, que dénonçait Bernanos. 3) La troisième thématique repose sur un ouvrage moins vaste mais très pertinent, celui de Richard Millet, « Désenchantement de la littérature », où l’auteur dénonce et fustige l’effondrement de l’école et de la langue, avec force références à Nietzsche et Heidegger. Pour Millet, cette chute cataclysmique entraîne une mutation ontologique de l’être humain.
DUISBURG / RUHRGEBIET : Le 5 janvier 2008, forum de discussion islamique (sunnite) www.ahlu-sunnah.de publie en enregistrement vocal deux conférences tenues lors du congrès de la « Gesellschaft für freie Publizistik » de 2006, celle, remarquable de Safet Babic (« Historische Angriffe der Türken gegen Europa am Beispiel Bosniens ») et celle de Robert Steuckers, intitulée « Kampf der Kulturen ». Ce titre peut faire penser qu’il s’agit de digressions sur le travail de Samuel Huntington, dans une perspective néo-conservatrice. Il n’en est rien. Cette conférence visait à dénoncer l’ennemi principal, c’est-à-dire les Etats-Unis, dans la perspective schmittienne de « raumfremde Macht », de « puissance étrangère à notre espace européen/eurasien », mais, simultanément, de dresser la liste des alliés musulmans des Etats-Unis, en l’occurrence certains filons dérivés de matrices hanbalites et wahhabites qui n’ont eu de cesse de ruiner les puissances musulmanes intelligemment syncrétistes ou de détruire les ressorts du nationalisme arabe issus de la pensée politique et pratique de Michel Aflaq, de Gamal Abdel Nasser et de Saddam Hussein, un nationalisme qui pouvait, lui, être un allié de l’Europe, contrairement aux avatars du hanbalisme et du wahhabisme qui ont plus d’un trait commun avec le fondamentalisme puritain, formant le socle de l’américanisme le plus agressif, ce qui explique l’alliance entre ces extrémismes religieux, monothéistes et messianiques, contre toute autre façon de concevoir la politique. Dans le contexte allemand, les arguments de Steuckers rejoignent en gros ceux de Peter Scholl-Latour. Dans le contexte français, ils rejoignent ceux de toute une série de géopolitologues qui ont analysé l’histoire de la Turquie (dont Jean-Paul Roux), de l’Iran (Roux également, ainsi que Bernard Hourcade) ou de l’Arabie Saoudite. Le texte de la conférence (du moins la version écrite à paraître) contient une analyse assez fouillée de l’histoire de ce pays et du wahhabisme, qui puise notamment dans l’œuvre de Benoist-Méchin. On trouve les deux conférence de Babic et Steuckers directement sur http://www.file-upload.net
MADRID : La version espagnole de l’encyclopédie en ligne « Wikipedia » consacre une entrée asses brève au général et géopolitologue autrichien Heinrich Jordis von Lohausen, avec comme document le texte de Robert Steuckers, ayant servi d’éditorial au numéro de « Vouloir » sur la géopolitique et dédié au Général. Ce texte est intitulé « Hommage au Général-Baron Heinrich Jordis von Lohausen à l’occasion de son 90ième anniversaire ». Source : http://es.wikipedia.org/
BRUXELLES : Parution du 293ième numéro du « Bulletin célinien », œuvre de l’infatigable Marc Laudelout, avec, notamment, les contributions suivantes : P. L. MOUDENC, « Albert Paraz, 50 ans après » ; Marc LAUDELOUT, « Jacques Brenner et Dominique de Roux » ; Marc LAUDELOUT, « P. A. Cousteau, Céline et la Quatrième République » ; Marc LAUDELOUT, « La mort de Montandon » ; Frédéric SAENEN, « Les revues littéraires sous l’Occupation » ; Jean-Paul LOUIS, « L’Année Céline 2006 » ; etc. Adresses : Bulletin Célinien, BP 70, B-1000 Bruxelles 22 – Belgique ; celinebc@skynet.be ; site : http://louisferdinandceline.free.fr/
LOZANNE : Parution du n°34 de la revue « Terre & Peuple », dirigée par Pierre Vial. Les thématiques centrales de ce numéro seront discutées lors des soirées organisées par le mouvement « T&P » à Bruxelles, Liège ou Charleroi. Nous retiendrons pour notre part les articles suivants : Jean HAUDRY, « La cruche de Brno » ; Dr. Pierre COSTAZ, « La Déesse-Mère de Notre Dame de la Vie » ; H. P. FALAVIGNA, « La prise d’otages de Beslan et les perspectives d’avenir de la politique russe » ; Tomislav SUNIC, « L’histoire victimaire comme identité négative » (cf. http://doctorsunic.netfirms.com ). Le dossier central de ce numéro étant consacré aux Balkans et au Kosovo, les débats qui tourneront autour de cette publication nous permettrons de réactiver toute la documentation que « Synergies Européennes » a rassemblée sur la géopolitique et l’histoire de cette région d’Europe.
BRUXELLES : Le numéro 74 de « Renaissance Européenne », organe de « T&P-Wallonie », reproduit un texte de « Synergies Européennes » : celui de Günther Deschner, intitulé « La CIA en Allemagne », dénonçant les manipulations et les coups tordus des services secrets américains en Allemagne de l’Ouest, pendant et après la Guerre Froide. L’original allemand était paru en janvier 2007 dans l’hebdomadaire berlinois « Junge Freiheit ». Signalons aussi que « Renaissance Européenne » n°74 nous livre un compte-rendu détaillé sur le colloque identitaire de Sint-Pieters-Leeuw (cf. supra) du 1 décembre 2007. Il reproduit en traduction française un compte-rendu rédigé par un de nos amis gantois ; le texte de Pierre Vial, qui a été lu en son absence ; l’allocution de Kris Roman, dirigeant de l’association « Eurorus ». Signalons encore d’amples recensions des revues « Terre & Peuple » (n°33) et « Hyperborée » (cf. supra) (n°5). Adresse : Renaissance Européenne, Secrétariat, Avenue G. Mullie 55/13, 1200 Bruxelles.
PARIS : Le 7 janvier 2007, le site http://vertusetcombat.unblog.fr fait paraître à son tour le texte de « Moestasjrik », pseudo (*) bien plaisant de l’orientaliste flamand qui œuvre dans la rédaction du « ‘t Pallieterke », sur les Sikhs et la Khalsa. Rappelons que le site « Vertus et Combat » a déjà publié plus d’un texte émanant des anciennes publications de « Synergies Européennes », ainsi que de nouveaux textes, diffusés sur le net.
(*) en français la traduction de ce pseudonyme équivaudrait à « Riri la Moustache ».
RIJKS-VLAANDEREN / FLANDRE IMPERIALE : Basé en Flandre Impériale, dans le triangle Alost/Termonde/Erembodegem, patrie de Marc. Eemans, le site multilingue « European Friends of Russia » fait paraître le 8 janvier 2008 un texte de Robert Steuckers intitulé « Restauration poutinienne et nouvelles perspectives géopolitiques ». Référence : http://efr.skynetblogs.be
DENDERMONDE (TERMONDE) : Le site « Eurorus », animé par Kris Roman, publie en date du 8 janvier 2008, le texte de Robert Steuckers, « Restauration poutinienne et nouvelles perspectives géopolitiques ». Ce texte est ensuite repris en date du 28 janvier 2008. Référence : http://eurorus-altermedia.info
PARIS : Le 9 janvier 2008, le site http://vertusetcombat.unblog.fr publie un texte de Robert Steuckers, datant de 1991 : « Individu ou Communauté ? A propos de la querelle qui oppose le GRECE au Club de l’Horloge ». Ce texte prévient contre toutes les dérives libérales fondées sur la méthodologie individualiste chère à Hayek. Il rappelle également les stratégies sociales gaulliennes de l’intéressement et de la participation.
PARIS : Le site de la revue « Vouloir », qui collationne également les archives de l’EROE des années 80, publie le 10 janvier 2008, le texte de Saverio Borgheresi, « Quand les Philippines devinrent colonie américaine », paru naguère dans le quotidien romain « Rinascita ». Ensuite, même jour, « Le fascisme entre Orient et Occident » de Michelangelo Ingrassia, paru en 2000 dans le mensuel romain « Area ». Le 9 janvier, le site avait affiché « La symbolique politique du Loup » de Karlheinz Weissmann, paru auparavant dans l’hebdo berlinois « Junge Freiheit ». Le site de « Vouloir » prend le relais de « Synergies/France » à Paris. Références : http://vouloir.hautetfort.com . Signalons également que ces textes sont repris sur un autre site : http://technocrati.com/blogs/vouloir.hautetfort.com...
PARIS : Le 10 janvier 2008, le site « Catalaxia » (http://constitutiolibertatis.hautetfort.com...) fait paraître sur la grande toile un texte diffusé en traduction française par « Synergies Européennes » : « Ernst Kantorowicz, biographe de Frédéric II de Hohenstaufen », dû à la plume de Stefan Pietschmann et paru en 2000 dans les colonnes de l’hebdomadaire berlinois « Junge Freiheit ». Ce texte doit servir d’introduction à la longue étude qu’avait préparée Max Steens pour l’Université d’été 2000 de « Synergies Européennes », tenue à Groppello di Gavirate en Lombardie. Cette étude est régulièrement présentée aux stagiaires de « Synergies Européennes ».
STRASBOURG : Le site alsacien de l’agence de presse « novopress » (http://alsace.novopress.info ) a repris, le 13 janvier 2008, l’entretien accordé à Dimitrij Grieb, de l’hebdo viennois « zur Zeit », par le Professeur Bernd Rabehl, ancien bras droit de Rudi Dutschke. Cet entretien avait été traduit par Robert Steuckers et déjà diffusé par « voxnr.com » (cf. supra).
GAND : Le 13 janvier 2008, le site officiel des étudiants nationalistes flamands (NSV), http://www.nationalisme.info/archieven/2008/01.html... publie dans sa rubrique « Archives » un entretien que Robert Steuckers avait accordé il y a quelques années à la revue flamande « Branding » sur la question turque. Intitulé « Turkije behoort niet tot de EU ». Cet entretien, au fond, n’est plus fort actuel car, à la suite des derniers événements en Irak, notamment dans le Kurdistan irakien, la position de la Turquie a changé. Nous étions contraints de la fustiger avec fougue au moment de l’invasion otanesque des Balkans, où le tandem Clinton / Albright envisageait, avec l’aide d’Ankara, de forger la fameuse « dorsale verte » ou « dorsale islamique » entre la Mer de Marmara et l’Adriatique, ce qui était fondamentalement contraire aux intérêts géopolitiques et géostratégiques de l’Europe. C’était un retour du facteur ottoman dans le sud-est de notre sous-continent. La présence américaine en Irak, et surtout dans la région de Mossoul qui revient de droit à la Turquie, a changé la donne : l’opinion publique turque n’est plus guère américanophile et l’anti-américanisme turc constitue un système conceptuel intéressant à suivre. L’entretien de Steuckers à « Branding » évoque toutefois l’accord qui pourrait émerger entre une Europe redevenue « impériale » et la Turquie sur Mossoul mais sans développer cet argument et sans parler du nouvel anti-américanisme turc.
PARIS : Le 15 janvier 2008, le site http://vertusetcombat.unblog.fr affiche un texte diffusé par « Synergies Européennes » : « Globalisation, néo-libéralisme et ‘homme flexible’ » de Brigitte Sob. L’original était paru dans l’hebdomadaire viennois « zur Zeit », fin 2007.
LISBONNE : Le 15 janvier 2008, le site http://pt.novopress.info publie sous le titre de « Cronica belga : Um português na « 4ième fête de l’identité » un reportage du journaliste Duarte Branquinho sur le colloque tenu le 1 décembre 2007 à Sint-Pieters-Leeuw, avec la présence d’Alain Soral et d’Eddy Hermy (cf. supra). Il est aussitôt repris, le même jour, par un autre site portugais, http://penaeespada.blogspot.com .
PARIS : Le 16 janvier 2008, le site http://www.insolent.fr/2008/01/maurras-pre-put.html... publie une étude intéressante de Jean-Gilles Malliarakis, intitulée « Maurras, père putatif des souverainistes. Mais l’ont-ils seulement lu ? ». Cette étude critique du souverainisme français contemporain a le mérite de venir de France et d’être issu d’une plume (et d’une voix…) qui ne ménage jamais ses efforts pour défendre et sa patrie française et sa grande patrie européenne. Elle doit être lue et relue, surtout aux « écoles de cadres ».
AMSTERDAM : Le 17 janvier 2008, le site http://nl.novopress.info republie un entretien déjà fort ancien que Robert Steuckers avait accordé à la revue étudiante flamande « Branding », sur le question, turque (« Turkije behoort niet tot de EU » / « La Turquie n’a rien à faire dans l’UE ») (cf. supra).
PARIS : Le 17 janvier 2008, le site français http://vertusetcombat.unblog.fr affiche la liste de tous les nouveaux articles disponibles sur le site http://euro-synergies.hautetfort.com entre le 1 et le 31 décembre 2007.
PARIS : Le très beau site de stratégie et de questions militaires, « Theatrum Belli » (http://theatrumbelli.hautetfort.com) reprend un texte diffusé récemment par « Synergies Européennes », dû à la plume de Karl Weinhold, célébrant l’appel, en janvier 1919, à former un parlement indépendantiste irlandais en dépit du refus des autorités britanniques.
LIEGE / VERVIERS : Pour janvier-février, regroupés autour de Xavier Hottepont et Philippe Banoy, les stagiaires liégeois et verviétois de l’école des cadres auront pour tâche de lire un texte court et classique de Marcel De Corte, intitulé « De la dissociété », paru aux éditions Remi Perrin, et de comparer la teneur et les arguments de l’opuscule dense de De Corte, qui fut, rappelons-le, professeur de philosophie à l’Université d’Etat de Liège, à ceux avancés par un livre actuel, au ton bien moins traditionaliste et où l’on trouve assez souvent des accents propres à la « gauche plurielle », celui de Jacques Généreux, « La Dissociété », paru au Seuil en octobre 2006. Généreux pose comme thèse principale que les sociétés authentiques, c’est-à-dire celles qui ne sont pas disloquées par le phénomène de la ‘dissociété’, sont soudées par la solidarité et le primat du bien commun. Solidarité et bien commun qu’il entend faire revivre sinon restaurer. Dans la perspective d’un nouvel engouement pour l’idéal de solidarisme en Flandre aujourd’hui, la lecture de ces deux ouvrages nous paraît intéressante voire impérative. A noter également que les équipes de Bruxelles et de Flandre Impériale préparent, sur la même thématique, une journée de lecture sur le livre de Marie-Claude Blais, « La solidarité – Histoire d’une idée », Gallimard, 2007. Livre qui sera lu conjointement aux pages sur cette même thématique de la solidarité, parues dans l’œuvre encyclopédique de Sirinelli sur les droites en France.
12:50 Publié dans Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jeunes filles porte-bannière

Willy FRESON:
SOUS L'EGIDE DE WOTAN: les jeunes filles porte-étendard dans les tribus germaniques
Les démocraties égalitaires contemporaines nous avaient déjà gratifiés de la guerre totale, c'est-à-dire de la guerre pour tous. Depuis peu, en Europe, elles ont peaufiné leur logique maniaque, en étendant aux femmes le douteux 'droit' de porter l'uniforme et les armes.
Y a-t-il là un quelconque souci d'affermir l'institution militaire et policière ? Ou de répondre à une impérieuse nécessité de défense nationale ? En aucune façon, bien sûr. Seules des considérations idéologiques obsessionnelles ont présidé à cette nouvelle et mirifique avancée des 'droits imprescriptibles'. Sur le thème 'Les femmes et la guerre', on lira dans La Nouvelle Revue d'Histoire (n°2, sept-oct 2002) le compte-rendu du livre de l'auteur israélien Martin van Creveld et la table ronde qui lui est consacrée. Les femmes en armes constituent donc un sujet d'actualité qu'on ne saurait ignorer, puisque désormais cet intéressant spectacle s'offre quotidiennement dans nos rues, avec, il est vrai, d'autres réalisations de cette modernité qui fait le charme de la vie urbaine.
Cependant, mon propos ne sera pas d'épiloguer plus longuement sur le présent et l'avenir de la question, mais bien plutôt de saisir le prétexte de ce point d'actualité, pour en évoquer certains aspects anciens. Que peut dire l'historien sur les femmes et la guerre, dans le lointain passé des peuples européens, c'est-à-dire bien avant que le chaos de la 'modernité' ne déstructure ces derniers ? Certes, le champ d'investigation est vaste, mais les sources ne répondent pas toujours à l'attente. Néanmoins, les textes, et plus encore l'archéologie, offrent parfois des ressources inattendues. Par exemple, dans le cas du monde germanique ancien, l'information est d'origine romaine. C'est donc d'abord, par-dessus les épaules des légionnaires, que nous aurons l'occasion de contempler les cadavres meurtris de femmes germaniques tuées au combat, en compagnie de leurs congénères masculins.
Le choc des grandes invasions barbares
Dion Cassius, sénateur romain originaire d'Asie Mineure, écrivit en grec, vers 230 de notre ère, une Histoire romaine, qui constitue une de nos sources principales sur le sujet. Son oeuvre, comme tant d'autres, nous est malheureusement parvenue mutilée par les siècles. C'est dommage, car il y rapportait des événements qui lui avaient été contemporains, entre autres l'épisode fameux connu sous le nom de 'Guerre des Marcomans', premier acte des Grandes Invasions, qui allaient semer le chaos dans l'Empire et mettre à jamais l'Europe en miettes. Cette geste sanglante peut se résumer ainsi: de 166 à 180, les peuples barbares du centre de l'Europe s'ébranlèrent de proche en proche et franchirent en masse les frontières de l'Empire romain, sur le Danube et dans les Carpates. En 170, les Balkans et la Grèce furent razziés. La même année, des bandes germaniques firent même irruption en Vénétie, semant une terreur d'autant plus incontrôlée que l'Italie n'avait plus subi d'invasion étrangère depuis près de trois siècles. Ce passé, lointain déjà, avait été témoin de la ruée des Cimbres et de leurs alliés, premiers Germains à avoir pris d'assaut le monde méditerranéen.
Dans les deux cas, la machine de guerre romaine vint à bout des envahisseurs, mais au prix de combats meurtriers et de lourdes pertes. Dès 171, l'empereur Marc-Aurèle prenait ses quartiers à Carnuntum, sur le Danube -non loin de l'actuelle Bratislava- et ses troupes rejetaient l'ennemi sur l'autre rive. Puis, l'année suivante, les armées romaines franchirent le fleuve et occupèrent le pays des Marcomans et celui des Quades (Moravie et Slovaquie). C'étaient les principaux meneurs de la coalition barbare, qui comprenait une foule de peuples, dont les Lombards, les Vandales, les Hermundures, les Daces 'libres' et les Sarmates. Ce ne fut pas sans mal. Progressant dans l'axe de la 'route de l'ambre', immémoriale liaison entre l'Adriatique et la Baltique, les légions menèrent durant des années une lutte sans merci contre un adversaire féroce, une éreintante guérilla entre monts de Bohème et vallées des Carpates.
Du tumulte de ces combats témoignent les scènes pathétiques de la Colonne Aurélienne, à Rome, et les inscriptions mentionnant nombre de généraux romains tués dans les batailles, et les couches de cendres, dégagées par les archéologues, sur les sites des villages germaniques au nord du Danube. Quant aux sources littéraires, elles sont d'une maigreur déplorable, eu égard à l'importance cruciale de ces événements pour l'histoire subséquente de l'Europe. Sur le sujet, Dion Cassius est un témoin irremplaçable, bien que le récit qu'il fit du règne de Marc-Aurèle ne subsiste plus qu'à l'état de bribes. C'est précisément un de ces fragments que je prendrai comme point de départ, pour introduire quelques réflexions sur un aspect peu connu, mais assez singulier, de la vie sociale des anciens peuples d'Europe.
Des cadavres de femmes en armes
Il s'agit de onze mots préservés par l'abréviateur byzantin Xiliphin (Dion, 71, 3, 2/Boissevain, III, 251) et qu'on peut traduire comme suit: 'parmi les cadavres des Barbares, on trouva même des femmes en armes'. C'est là un des rares témoignages littéraires antiques qui nous présente des femmes combattantes, intégrées dans un groupe de guerriers, ceci dans le contexte des guerres du 2e siècle évoqué plus haut. Manifestement, l'anecdote a été préservée parce qu'elle rapportait un trait curieux, éminemment barbare, qui choquait l'entendement des Anciens. La tradition grecque voyait, d'ailleurs, dans la guerre au féminin un fait exotique propre à distinguer le civilisé du non-civilisé. Elle n'appréhendait le phénomène qu'au travers de la légende des Amazones, fiction littéraire souvent exploitée, mais qui reposait sur une réalité historique mal comprise et enracinée dans le milieu des nomades iraniens (Scythes, Alano-Sarmates).
Une distinction s'impose cependant. Mon propos porte sur les femmes guerrières, c'est-à-dire sur celles qui portaient les armes et participaient aux combats dans les rangs des formations militaires traditionnelles de leurs ethnies, de manière quasi-institutionnelle. Ce phénomène est peu mentionné dans les textes. Ceux-ci sont, par contre, plus prolixes lorsqu'il s'agit de mettre en scène des femmes -mères, épouses ou filles- sortant de leur rôle naturel et participant peu ou prou aux combats, avant tout sous la pression d'événements contraignants. Un cas célèbre est celui des femmes cimbres, dans la plaine du Pô, en 101 avant notre ère. Plutarque et Orose nous les décrivent, hurlantes et gesticulantes, tentant de rétablir une ligne de défense sur le cercle de leurs chariots, alors que les rangs des Cimbres viennent d'être enfoncés par les légions du consul Marius. Le récit de la bataille s'achève sur un massacre général et sur le spectacle des soldats romains lancés au pas de course, qui égorgeant et décapitant les malheureuses, avant d'assister au suicide des survivantes, exécutant leurs propres enfants. L'année précédente, les femmes des Ambrons s'étaient comportées avec une semblable détermination face aux soldats du même Marius. On se rappellera aussi le rôle de soutien joué par les femmes bituriges, lors de l'assaut tenté par les légionnaires de César sur Avaricum (Bourges).
Des guerrières avérées
Tout autre est évidemment le cas des guerrières avérées, qui participent en première ligne et qui, en toute hypothèse, jouent un rôle particulier dans l'organisation des contingents germaniques. Ce rôle n'a sans doute fait que croître à la faveur des grands mouvements de peuples guerriers, qui se déploient en Europe centrale et orientale dès la veille des Guerres Marcomanniques et qui connaîtront leurs paroxysmes au 3e et au 5e siècles. Ainsi, cent ans après la contre-offensive victorieuse de Marc-Aurèle, la situation stratégique de l'Empire romain s'est considérablement détériorée. Durant une bonne part du 3e siècle, un ouragan d'assauts répétés s'est déchaîné sur toute la frontière européenne, depuis la mer du Nord jusqu'au piémont du Caucase. En particulier, la puissante confédération gothique, issue des régions baltiques, s'est établie alors en Ukraine et Roumanie actuelles, lançant, à partir de là, de profondes razzias vers les Balkans, l'Asie Mineure, l'Egée et même la Méditerranée orientale. La situation ne fut rétablie, en partie, que par les puissantes contre-offensives menées par les empereurs Claude 'le Gothique' et Aurélien.
Ce dernier s'illustra, entre autres, par de nombreuses victoires et par un triomphe fameux à Rome, en 274, où figurèrent les rebelles Tétricus et Zénobie, le dernier empereur 'gaulois' et la célèbre reine de Palmyre. Mais surtout, nous rapporte l'Histoire Auguste (Aurélien, 34, 34,1), on fit aussi défiler dix femmes dont il s'était emparé -alors que beaucoup avaient été tuées- tandis qu'elles combattaient, habillées en hommes, parmi les Goths, une pancarte indiquant qu'elles appartenaient à la race des Amazones. Cette mention, plus explicite que celle de Dion, intègre tous les éléments évoqués plus haut: des guerrières combattant avec les hommes dans le même appareil, assimilées aux Amazones -cadre de référence obligé de la culture antique- et présentées comme une curiosité dans le défilé des captifs, avant de finir en anecdote piquante dans les récits de l'historiographie gréco-latine.
Les rumeurs de cette tradition perdureront durant des générations, puisqu'on en retrouve encore l'écho, à la fin du 8e siècle, chez Paul Diacre, qui écrit: On raconte que, lors d'une expédition avec leur roi, les Lombards, arrivés à un fleuve, s'en virent bloquer la traversée par les Amazones et que Lamissio fit le coup de poing avec la plus forte d'entre elles et la tua, se gagnant l'éloge et la gloire et procurant le passage aux Lombards (..). Cette partie du récit ne repose sans doute que sur une vérité bien mince. Tous ceux qui connaissent ces vieilles histoires savent bien que le peuple des Amazones a été détruit bien avant que ces faits aient pu se produire; à moins peut-être que, dans ces lieux mal connus et à peine mentionnés par l'hitoriographie où sont censés s'être déroulés ces événements, n'aient existé jusqu'à cette date des femmes de ce genre. J'ai effectivement, moi aussi, entendu dire qu'un peuple de ces femmes existe encore aujourd'hui dans les profondeurs de la Germanie. (Histoire des Lombards, 1, 15). Rappelons que ces lignes furent écrites par un auteur, lui-même d'origine lombarde, qui était un familier de Charles le Grand, alors que celui-ci menait ses guerres de terreur contre les Saxons demeurés 'païens'.
Des cadavres qui parlent
Si on a vite épuisé les ressources de la tradition littéraire -que je me suis efforcé de replacer dans leur contexte historique-, on se console sans peine avec les données de l'archéologie, laquelle fournit sans conteste le clou de la documentation. Le sol européen a, en effet, livré une catégorie toute particulière de fossiles humains, dans un état de conservation remarquable. Il s'agit de la série dite 'hommes des tourbières' (Moorleichen, Bog peoples, Moseliget), collection impressionnante de cadavres, conservés grâce aux conditions physico-chimiques favorables du milieu des tourbières d'Europe centrale et septentrionale. Un dénombrement, effectué en 1975, arrivait au chiffre de 1.620 cas, mis au jour principalement en Allemagne et au Danemark (4 cas en Belgique). Les découvertes n'ont pas cessé depuis, avec, par exemple, l'homme de Lindow Moss, en Angleterre (un druide, semble-t-il) ou le cas, spécial, de l'homme des glaces, 'Ötzi', au Tyrol. J'ai personnellement le souvenir poignant de la jeune fille de Windeby, que j'ai longuement contemplée au château Gottorf, à Schleswig. De cette collection, une série limitée de cas -mais néanmoins significative- relève de notre propos.
- Il y a tout d'abord trois cadavres de jeunes filles, trouvés dans le Halverder Moor (arr. de Tecklenburg, Westphalie) et qui datent des environs de 350 avant notre ère. Elles reposaient en compagnie de huit jeunes hommes, équipés de boucliers, d'épées et de lances, les filles ajoutant à cet appareil des arcs et des flèches. Les hommes portaient de longs pantalons de laine. Leurs compagnes complétaient cette tenue de vestes sans manches. Les onze corps étaient percés de coups.
- A Spelle, non loin du site précédent, mais en Basse-Saxe (arr. de Lingen), on a découvert seize corps portant des blessures de combat, dont ceux de deux filles âgées de 18 à 20 ans. Les morts reposaient avec leurs épées et des boucliers brisés, les filles avaient en sus des arcs et des flèches. A côté de chacune d'elles gisait une lance doublée d'une hampe fichée verticalement et dont l'extrémité supérieure était pourrie, montrant que les bois avaient été intentionnellement visibles en surface. Les faits datent du tournant de notre ère.
- Dans le Bruchbergmoor, à l'ouest des monts du Harz (Bad Grund, Basse-Saxe), on a exhumé trois hommes et quatre jeunes filles, armées et habillées comme leurs compagnons, dont l'un portait un collier garni d'une pièce d'or à l'effigie d'un empereur romain. Les sept individus avaient succombé à des coups d'épée.
- Le Kapermoor (Gollensdorf, arr. d'Osterburg, Saxe) a livré les corps d'une jeune fille et de deux hommes. Tous trois portaient des pantalons de cuir -la fille avec une veste. Ils avaient des blessures infligées de taille à l'épée. L'étrange demoiselle tenait une lance dans la main droite. Elle portait une épée à la hanche et elle était recouverte d'un bouclier brisé. Le fer de ses armes était incrusté de signes runiques damasquinés d'argent. L'ensemble a été daté du début du 3e siècle.
- Est particulièrement remarquable le corps d'une jeune fille retrouvé à Dätgen l (près de Rendsburg, Schleswig-Holstein) et qui date des environs de l'an 600 de notre ère. La jeune fille, vêtue de cuir, reposait sur un bouclier quadrangulaire aux bords arrondis. Dans sa main, elle portait une lance sur laquelle -fait singulier- avait été fiché un chapeau de feutre. Elle reposait criblée de flèches, aux côtés de six hommes, eux aussi percés de flèches et de coups d'épées.
- Tout aussi insolite est le cas de la jeune fille du Haselmoor (Kochel, arr. de Bad Tölz, Bavière), daté du 7e siècle. Elle tenait des deux mains une forte hampe de bois, présentant sur le haut de profondes entailles et tranchée d'un puissant coup de taille un peu au-dessus de sa tête. L'autopsie minutieuse du corps a révélé un hymen encore intact. La jouvencelle et le jeune homme étendu à ses côtés portaient comme vêtement des pantalons de cuir et des chaussures basses à lacets, complété pour la fille d'une veste de cuir sans manche. Les corps, frappés de coups d'épée, reposaient sur des boucliers tendus de cuir.
- Enfin, signalons le cas de la jeune fille de Linum (arr. de l'Osthavelland, Brandebourg). Elle portait une épée fixée à une ceinture serrant un pantalon de cuir, dans lequel était rentré une longue veste de laine sans manches. Dans sa main, elle tenait un arc. Tout près, un carquois était encore pourvu de quelques flèches. Elle avait été atteinte de plusieurs de ces traits.
Des vierges porte-bannière ?
L'interprétation de cet ensemble de faits bien documentés requiert prudence et nuance. Parmi tous ces corps de jeunes femmes, il faut sans doute faire une différence entre celles qui combattirent en nombre plus ou moins important dans les rangs des hommes, sans qu'on puisse, dans l'état de nos sources, préciser les modalités de leur rôle, et, d'autre part, celles qui semblent avoir exercé individuellement une fonction spécifique dans un cadre, par ailleurs, masculin. Le premier cas se rencontre à des titres divers et dans des contextes variés chez certains peuples, anciens ou non. Le second cas, dont relèvent les trouvailles de Dätgen l et Haselmoor, mérite plus d'attention, car il peut être éclairé par des données nettement plus récentes.
En effet, durant tout le dernier siècle du moyen âge, les Frisons du pays de Wursten, à l'embouchure de la Weser, avaient défendu leurs libertés contre les convoitises des évêques de Brême. La bataille décisive n'avait été livrée qu'en 1517, sur le Wreeder Siel. Le porte-enseigne de l'armée frisonne n'était autre qu'une jeune fille, qui se fit tuer en tentant de préserver jusqu'au bout son enseigne, la heirfona. Ce mot frison signifie 'la fille de l'armée' et désigne aussi bien la porteuse de l'emblème que l'enseigne elle-même. Cette dernière consistait, chez les Frisons du moyen âge, en une hampe de bois surmontée d'un chapeau sur-dimensionné. De tels couvre-chefs ont été retrouvés par deux fois en Frise Orientale et l'expression coutumière appelant au rassemblement du peuple se disait thene hôd upstêta, "dresser le chapeau". On ne s'avancera donc pas trop en concluant que les jeunes filles de Dätgen et de Haselmoor furent, elles aussi, des porte-enseigne de troupes guerrières, la seconde ayant manifestement subi le même sort que la heirfona frisonne: massacrée en cherchant à sauver son enseigne, dont le sommet -avec le chapeau ?- fut tranché par les assaillants.
Donne-nous la vaillance au combat
Dans tous les cas, il est important de noter qu'il s'agit de très jeunes filles, probablement vierges comme semble le confirmer le rapport médical du Haselmoor. Ce détail oriente plutôt vers une signification religieuse liée au culte de Wotan. Ce dieu, polymorphe et multifonctionnel, avait pris, en effet, depuis les 2e et 1er siècles avant notre ère, un caractère de plus en plus belliqueux, pour apparaître finalement comme le dieu par excellence de la guerre. Les Gefolgschaften, continuant les compagnonnages celtiques, se placèrent tout naturellement sous son égide et les guerriers morts au combat bénéficièrent de toute sa bienveillance. Ainsi, Wotan les accueillait auprès de lui dans le 'Valhalle' et, par ailleurs, ne se privait pas d'intervenir à son gré sur les champs de bataille, pour influer aussi bien sur les destins collectifs que sur le sort des individus. Mais il agissait à distance, par l'intermédiaire de figures féminines, les Valkyries. A l'origine, démons funèbres chargés de 'choisir les morts' (ce que signifie leur nom), ces fidèles du dieu borgne furent, par la suite, perçues comme de jeunes vierges guerrières, soutenant les mortels dans les combats et guidant les héros morts vers le Valhalle, où elles assuraient le service.
Dès lors, la 'militarisation' croissante des sociétés germaniques, durant les siècles de l'Empire romain, a dû entraîner l'incorporation d'un certain nombre de jeunes femmes dans les associations guerrières qui se regroupaient autour de chefs renommés. Héroïnes en herbe, n'est-il pas vraisemblable que ces femmes aient espéré suivre leurs compagnons, par delà la mort, pour rejoindre les banquets tumultueux du Valhalle -et pour devenir de nouvelles Valkyries ? L'hypothèse a toute chance de se vérifier, au moins dans le type de la heirfona dont la virginité avait sans aucun doute valeur sacrée, conférant force et protection à la troupe ainsi vouée au dieu de la guerre. Est en tout cas remarquable la pérennité de cette tradition païenne, jusqu'au sortir du moyen âge chrétien ! Songeons que la heirfona frisonne tomba l'année même où un moine fanatique nommé Luther afficha ses récriminations à Wittenberg, départ de la 'Réforme' et coup bas à la Renaissance !
Sans conteste, la documentation disponible aujourd'hui, toute fragmentaire et énigmatique qu'elle soit, permet de mieux discerner le rôle persistant que joua l'élément féminin dans l'organisation guerrière des peuples germaniques. Ce rôle peut être qualifié d'organique, puisqu'étroitement associé, en toute complémentarité, à la vie politique et religieuse de la communauté ethnique: la guerre restait une affaire d'hommes, mais un ensemble de représentations mentales, dont le détail nous échappe, faisait qu'un certain nombre de femmes étaient amenées -sous des conditions précises- à participer aux activités guerrières. Si maintenant on passe d'une marge de la vielle Germanie à une autre, de la Frise à la Lorraine, on ne pourra pas se retenir d'évoquer l'exemple d'une autre pucelle, apparue comme par enchantement dans 'l'Histoire de France', pour entraîner d'autres bandes armées dans le sillage de son étendard. Insolite dans le cadre chrétien français, Jeanne d'Arc ne pourrait-elle être un avatar occidental de la heirfona germanique, surgissant elle aussi de la plus profonde mémoire européenne ? La question mériterait un examen attentif. Je ne bouderai pas, en tout cas, la secrète jubilation d'entrevoir, derrière la sainte de Domrémy, l'ombre formidable du dieu borgne aux corbeaux, l'Odin des sagas scandinaves.
Willy Fréson
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 30 janvier 2008
Entretien avec Michel Mohrt

Entretien avec Michel MOHRT
http://www.reflechiretagir.com
L’écrivain Michel Mohrt, membre de l’Académie Française, nous a fait l’honneur de nous recevoir. Elégant dans tous les sens du terme, d’une gentillesse et d’une simplicité à toute épreuve, il revient pour nous sur toute une vie de bruit et de fureur qu’il a observée avec son œil de peintre. Moteur !
R&A : Aujourd’hui, nous parlons beaucoup de l’Europe. Dans l’un de vos articles (De bonne et de mauvaise humeur, Le Rocher, 1999), vous disiez que vous aviez compris la nécessité de faire l’Europe en 1940. Pourquoi ?
Michel Mohrt : Quand on a vécu la défaite de 1940 comme moi… Enfin, je l’ai vécu un peu différemment puisque j’étais dans les Alpes, face aux Italiens et non aux Allemands. J’ai quand même ressenti terriblement la catastrophe de la défaite. J’ai pensé que la France n’était plus le grand pays que j’avais connu et espéré après la victoire de la première Guerre Mondiale. Déjà, dès 1930, j’avais compris que la France était un pays en décadence. La IIIe République ne la préparait pas à cette guerre qui est arrivée. Je sentais que la France allait perdre ses colonies, ce qui arriva peu de temps après. Elle n’avait qu’une chance, c’est d’appartenir à une entité politique plus grande qu’elle-même et où elle pourrait jouer un rôle important : l’Europe. Je n’ai pas cru dès 1940 (et je ne l’ai pas entendu d’ailleurs) au message de De Gaulle. Je pense que de Gaulle a été un homme politique extrêmement habile mais il n’a nullement détruit les effets malheureux de la défaite de 40.
R&A : En fait, vous vous êtes posé les mêmes questions que Renan et bon nombre d’intellectuels français au lendemain de Sedan. Ce fut d’ailleurs l’objet de votre livre Les Intellectuels français devant la défaite de 1870 (Gallimard, 1944 - réédition Editions du Capucin, 2004)…
Michel Mohrt : Exactement. Les gens qui viennent de relire mon livre à la faveur de sa réédition m’ont dit qu’il n’avait pas vieilli et qu’il était toujours d’actualité. En effet, on voit que les Renan, les Taine, au lendemain de 1870, ont dit que la France devait faire des réformes qu’elle n’arrive toujours pas à faire. D’où ce besoin d’Europe.
R&A : De plus, il y a en Europe une unité de civilisation plurimillénaire…
Michel Mohrt : Oui, c’est ce qui fait que je me suis senti tout à fait européen dès 1940. Et je le suis resté. Ce pourquoi aussi, je ne suis pas aujourd’hui pour l’entrée de la Turquie dans l’Europe. Je suis aussi attaché à l’Europe chrétienne. Il suffit de traverser la France en chemin de fer pour voir ses villages avec leurs clochers.
R&A : Dans vos livres, vous préférez observer, témoigner que vous engager. Je pense notamment à votre roman Mon royaume pour un cheval où vous expliquez cette attitude en rendant aussi hommage à l’engagement de votre ami Bassompierre. C’est un trait de votre caractère de vous méfier de ces aventures politiques ?
Michel Mohrt : En effet… D’abord, je n’aime pas la foule. Je me rappelle, en 1940, quand on a fait le SOL (Service d’Ordre Légionnaire), très vite, je me suis dépris de ce mouvement auquel j’adhérais au début car je n’aime pas la foule, perdre mon temps avec des palabres qui n’aboutissent à rien. Je me sens un observateur, un romancier. Et le roman suppose un décalage par rapport aux évènements que l’on veut raconter. J’ai toujours pris de la distance vis-à-vis des évènements et de mes propres engagements qui sont demeurés purement intellectuels d’une certaine façon. Je n’ai pas voulu m’impliquer dans un mouvement politique quelconque et je ne le ferai toujours pas.
R&A : Tout en témoignant ainsi par le biais du roman, vous avez quand même une indéniable estime pour « cette race d’hommes faite pour vivre entre hommes, race de moines et de soldats durs à eux-mêmes comme aux autres, race de demi-soldes, éternelle race des héros, des terroristes et des saints ». A travers Bargemont (double romanesque de Bassompierre dans Mon royaume pour un cheval), vous rendez hommage à l’amitié mais aussi au courage d’hommes comme lui…
Michel Mohrt : Bassompierre était un ami avec qui j’ai fait la guerre. Il commandait le Fort de la Colmiane dans les Alpes, juste au dessus de la Vésubie. Moi, je commandais une section d’éclaireurs-skieurs devant ce fort. Nous nous sommes vus beaucoup après la Drôle de Guerre, en attendant l’invasion allemande. C’est lui, avec quelques autres, qui a fondé le SOL. Très vite, j’ai pris cette distance mais j’ai continué à le voir durant l’Occupation. Et quand il m’a appris qu’il partait sur le Front de l’Est avec la LVF, cela ne m’a pas étonné car il l’a fait par anti-communisme. Aujourd’hui, on a oublié qu’à l’époque, le communisme apparaissait comme le vrai et principal danger. Sans les troupes alliées en Europe d’ailleurs, nous aurions eu le communisme en France. De Gaulle a été obligé de pactiser avec eux et de prendre Thorez qui s’était courageusement planqué à Moscou, en quittant l’armée pendant la guerre. J’ai dit à Bassompierre de laisser cela aux gens qui n’avaient rien dans la tête et qu’on avait besoin de gens comme lui pour refaire la France. Mais non, il voulait mettre son action en rapport direct avec ses idées. C’était très courageux de sa part d’entrer dans la LVF, d’accepter de porter l’uniforme allemand avec toutefois l’écusson tricolore.
R&A : Vous étiez au Canada lorsqu’il a été fusillé…
Michel Mohrt : Hélas ! A cette époque, on ne traversait pas l’Atlantique en quelques heures. Le bateau mettait 5 à 9 jours. J’ai regretté mais son avocat m’a dit que mon témoignage n’aurait servi à rien. Tous ses anciens compagnons d’armes qui avaient servi sous ses ordres dans les Alpes dirent quel homme admirable il avait été, en pure perte puisqu’il fut fusillé.
R&A : Vous avez dit que « le devoir de mémoire ne consiste pas à perpétuer les drames, à attiser les haines qui ont dressé les uns contres les autres les fils d’un même pays. Ce devoir c’est d’apaiser les discordes et de rassembler ceux que la mort a déjà unis. » Dans vos articles, vous avez célébré le courage des brigadistes internationaux, partis aider les républicains espagnols. Par contre, croyez-vous qu’un jour, les bobos du Nouvel Observateur ou BHL reconnaîtront à leur tour la pureté de l’engagement des soldats de la Charlemagne comme Bassompierre ou assistons-nous à « un Nuremberg permanent dans l’Europe » comme vous l’avez écrit, toujours 50 ans après ? Que pensez-vous de cette supercherie intellectuelle qui fait des uns des héros et des autres des salauds ?
Michel Mohrt : C’est le politiquement correct. On ne reproche pas, en effet, aux gens d’avoir été communistes alors que l’on sait l’effroyable bilan humain du communisme. Des gens comme Bassompierre se sont battus par idéalisme. J’avais écrit cet article que vous citez après une déclaration de Mitterrand en Allemagne où il disait très justement qu’il y a eu deux sortes de Français à cette époque : ceux qui ont voulu être dans l’action et les autres. Mitterrand et moi étions ces autres. Bassompierre, lui, a voulu s’engager. Mitterrand avait ajouté que, quelque soit l’uniforme sous lequel ils se sont battus, nous devions le reconnaître.
R&A : Ce qui montre qu’avec un bilan politique aussi catastrophique, Mitterrand était sur ce sujet plus lucide et courageux que Chirac et, bien entendu, beaucoup plus cultivé, avec des goûts littéraires très marqués à droite…
Michel Mohrt : Mitterrand avait été vichyssois. Sa formation fut la même que la mienne. Il a été chez les curés puis militant à droite (avec l’Action Française) puis il a été vichyssois. Ce n’est que parce qu’il avait une ambition politique qu’il a compris qu’il devait finir à gauche.
R&A : Pompidou l’avait bien défini en disant qu’il était « l’aventurier de sa propre ambition ».
Michel Mohrt : C’est une très bonne formule en effet. Il a compris qu’il fallait devenir résistant. Comme l’ont compris beaucoup de Français qui avaient été vichyssois.
R&A : Comment expliquez-vous ce basculement politique du monde intellectuel de l’Après-guerre, après l’Epuration en fait…
Michel Mohrt : Déjà, la gauche et la droite ne veulent plus dire grand chose. La « droite » et la « gauche » gouvernent en fait au centre et font des politiques difficilement distinguables. En 1981, Mitterrand et Mauroy ont voulu faire une politique réellement de gauche. Ca a duré deux ans et, pour moi, Mitterrand l’a fait exprès pour montrer que la chose était impossible. La France ne peut pas rester à rebours contre le reste du monde.
R&A : Pour revenir à ce que nous disions d’hommes comme Bassompierre, un roman comme les Réprouvés de Von Salomon vous avait-il plu ?
Michel Mohrt : J’avais lu cela au début de la guerre. J’ai trouvé que c’était très beau. La France est un peu responsable, comme Bainville l’a montré dans Les Conséquences politiques de la paix. Le Traîté de Versailles était trop faible pour ce qu’il avait de dur. Notamment vis-à-vis de l’Allemagne et je comprends que Salomon n’ait pas pu accepter cette humiliation et cette occupation française sur son sol.
R&A : La Bretagne tient une grande place dans vos livres (Le Serviteur fidèle, Les Moyens du bord, La Prison maritime)…
Michel Mohrt : Je suis breton. En dépit de mon nom d’origine germanique, mon grand-père paternel avait épousé une bretonne qui parlait très bien le breton d’ailleurs. Il l’écrivait aussi et avait même eu une correspondance avec un barde (Taldyr). Puis leur fils, mon père, a épousé une bretonne 100%, de Brest. Je suis donc plus qu’aux trois-quarts breton par le sang et je suis né en Bretagne que je n’ai quittée qu’à 23 ans pour aller dans le midi, pour voir autre chose. Mais je me sens profondément breton. Ma famille avait une maison à Locquirec, sur les Cotes d’Armor. Maison où je vais toujours. C’est dans la baie de Lannion que j’ai appris à naviguer et je suis 100% breton. J’y vais souvent, je parle un peu breton.
R&A : Que pensez-vous des gens, comme ceux de Breizh Atao hier, qui luttent pour une Bretagne plus forte et reconnue ?
Michel Mohrt : Je les comprends même si je n’ai jamais cru que la Bretagne pouvait devenir indépendante. Par contre, un certain provincialisme oui. L’Europe va permettre à des pays comme la Bretagne, la Corse, la Savoie, le Pays Basque de retrouver une partie de leur identité. Je le crois profondément. Les Bretons ont une langue qui n’a cependant pas donné de grands ouvrages littéraires. Ils ont eu la chance de pouvoir s’exprimer en français mais cela date d’après la reine Anne. Depuis, la Bretagne est française et je pense que c’est tant mieux pour elle car elle est quand même restée la Bretagne. Dans ma jeunesse, on se sentait très loin de Paris, à Brest ou Morlaix, au bout de la terre (Finistère). On se sentait un peu abandonné et donc c’est là qu’est né Breizh Atao. Je les ai d’ailleurs côtoyés quand je faisais mes études de Droit à Rennes. J’ai souvent discuté avec eux tout en leur disant que leur idéologie était à mon avis irréalisable. J’étais par contre ravi qu’ils aient fait sauter devant la mairie de Rennes une statue représentant la Bretagne à genoux devant la France ! Ce sont des nuances tout cela. Je n’ai jamais cru que la Bretagne pouvait ou avait intérêt à devenir indépendante. Le breton est une langue celtique. Il est d’ailleurs émouvant qu’il n’y ait qu’un seul mot en breton pour désigner deux couleurs, le bleu et le vert : glass. Pour un pays qui est entouré de mer, et ce sont les couleurs de la mer, je trouve cela très beau.
R&A : Une mer qui ne vous sépare pas tant que cela de vos cousins celtiques. Vous devez vous sentir un peu chez vous au Pays de Galles (la langue déjà) ou en Irlande ?
Michel Mohrt : La côte ouest de l’Irlande est la même que la côte bretonne. Bien sûr que je me sens tout à fait chez moi là-bas. Sans aucun doute. J’aime beaucoup l’Irlande, le Connemara notamment. Ce dernier ressemble d’ailleurs à mes Côtes d’Armor qui sont restées assez sauvages, qui n’ont pas été abîmées par le béton (par rapport au sud de la Bretagne). Cette côte qui va de Saint-Malo jusqu’à Brest est vraiment très très belle. Je l’ai faite en bateau bien des fois. Cela dit, il y avait chez moi (il est mort aujourd’hui) un palmier !
R&A : Vous disez que « nous assistons à la mort de l’art oratoire dans les prétoires, dans les églises, dans les assemblées politiques » que vous reliez avec raison avec la mort des humanités. N’a-t-on pas aujourd’hui un désert idéologique où l’économique a tué le politique ?
Michel Mohrt : La diminution du latin et du grec, qui sont des langues oratoires, a été pour beaucoup dans la décadence de l’art oratoire. Il n’y a plus qu’à l’Académie que l’éloquence garde un certain sens. L’éloquence a disparu, même chez les avocats (même s’il en reste quelques grands) ou chez les prêtres où il n’y a plus de sermons. Le ton est devenu celui de la télévision. On dit les choses rapidement, n’importe comment, dans un mauvais français truffé d’anglicismes.
R&A : C’est la mort de Cicéron et Bossuet…
Michel Mohrt : Hélas oui. Curieusement, par opposition à cette décadence de la langue parlée, il y a chez maintenant chez de jeunes écrivains une certaine préciosité de la langue écrite. Cela m’a frappé dans des romans récents.
R&A : Malgré votre attachement à notre langue, vous avez beaucoup apprécié et popularisé la littérature anglo-saxonne, notamment Faulkner. Et un roman comme L’Ours des Adirondacks est très américain…
Michel Mohrt : J’ai personnellement été plus influencé par Hemingway que par Faulkner. Quoique mon roman Le Serviteur fidèle (qui vient de ressortir chez Albin Michel) avait été qualifié par le critique Jean-Louis Bory de faulknerien.
R&A : La Bretagne c’est votre Oxford à vous…
Michel Mohrt : Oui, c’est mon Sud ! Cela dit, ces romanciers américains avaient eux-mêmes été inspirés par les romanciers anglais du XVIIIe siècle. Les premiers romans étaient épistolaires. Un roman par lettres c’est un roman parlé. Simplement, les lettres remplacent les voix.
R&A : Avant, il y avait eu Madame de Lafayette et sa Princesse de Clèves…
Michel Mohrt : Madame de Lafayette, en effet, ainsi que les Liaisons dangereuses de Laclos. C’était très fréquent les romans épistolaires à cette époque. Je suis venu de plus en plus, au travers d’Hemingway, au dialogue. Mon dernier roman, On liquide et on s’en va, est tellement dialogué qu’il n’est pas un roman. Je l’ai d’ailleurs qualifié de sotie.
R&A : D’autres Américains vous ont-ils influencé également ? Miller, Steinbeck, Dos Passos ?
Michel Mohrt : Steinbeck moins qu’Hemingway. Miller non. Dos Passos non plus : il a beaucoup influencé Sartre par contre.
R&A : Et les auteurs français ?
Michel Mohrt : Tout d’abord Flaubert. Avec mon roman le plus important (La Guerre civile), j’ai voulu faire l’équivalent pour mon époque de L’Education sentimentale.
R&A : Stendhal, ce souffle épique, ce style ?
Michel Mohrt : Ah oui, Stendhal, le mouvement rapide, la sensibilité qui galope. Que l’on puisse lire dans le Chasseur Vert trois fois dans la même page « Madame de Chastelet était charmante… Madame de Chastelet était très charmante… Elle était vraiment très charmante », eh bien, cela ne me gêne pas. Car c’est enlevé par un mouvement de grande rapidité. Pour moi, un style c’est une voix. Si un romancier n’a pas le courage de faire comme Stendhal, il n’écrira pas de roman.
R&A : Vous rejoignez le point de vue d’un Céline qui disait que le style c’est tout. Céline, c’est quelqu’un qui vous touche ?
Michel Mohrt : Ah oui beaucoup, beaucoup. Surtout le Voyage.
R&A : Vous aviez consacré votre premier livre à un hommage à Montherlant. Vous l’avez connu ?
Michel Mohrt : Je l’ai en effet connu à la suite de ce livre. Mon livre l’avait touché. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, c’était un homme très simple et ouvert. J’ai souvent déjeuné avec lui, quelquefois à Paris lorsque j’arrivais à passer de la zone sud à la zone occupée. Nous mangions au Voltaire. La conversation était facile avec lui. Pas du tout comme on l’imagine, le menton haut sur la cravate. Maintenant, écrire un livre sur un auteur, c’est un peu le tuer, se débarrasser d’une influence.
R&A : Un adieu à sa jeunesse en quelque sorte…
Michel Mohrt : Oui, Montherlant m’a moins marqué ensuite. J’avais été davantage touché avant la guerre par ses textes lyriques (Tombeau pour les morts de Verdun, Service inutile, Mors et vita…) que par les Jeunes filles. Service inutile a beaucoup marqué bon nombre de gens de ma génération.
R&A : Plutôt que Montherlant, on vous aurait davantage vu près de Drieu qui, comme vous, est très anglais (Mémoires de Dirk Raspe), élégant voire dandy et grand amateur de femmes… Il vous correspond plus que Montherlant.
Michel Mohrt : En effet ! J’ai été marqué par Drieu aussi. C’est une question de chance aussi. j’ai découvert ses romans plus tard. J’ai même rencontré Drieu une fois. C’était quelques mois avant la fin de la guerre et donc son suicide. Je me rappellerai toujours cette après-midi passée dans son appartement qui était juste derrière les Invalides. Il avait une vue superbe sur le dôme des Invalides et sur Montmartre dans le lointain. Je venais alors d’écrire un article sur L’Homme à cheval. Je venais de le découvrir pour ainsi dire. On s’est très bien entendu. A la fin de cet après-midi, il allait rejoindre des amis aux Champs-Elysées pour aller au cinéma. Je me rappelle encore de ses derniers mots. Il s’est retourné sur le quai du métro et il m’a lancé : « Alors on se revoit ! Où on se voit souvent où on ne se voit jamais. »
R&A : C’est une belle formule ! Et son roman qui vous a le plus marqué ?
Michel Mohrt : L’Homme à cheval donc et Rêveuse bourgeoisie qui tombait sur beaucoup des problèmes que je connaissais moi-même. Quant à Gilles, je l’avais dans ma cantine durant la Drôle de Guerre.
R&A : Comme les Pensées de Pascal pour Drieu ! Et chez les écrivains depuis 1945, qui aimez-vous ?
Michel Mohrt : Ca m’est difficile de répondre. Ce sont mes contemporains. Ce sont les anciens qui m’ont influencé, comme pour tout écrivain. J’aime bien entendu mon ami Michel Déon. Ceci dit, je n’étais pas un Hussard. J’étais plus vieux de 10 ans qu’eux. Eux n’ont pas fait la guerre…
R&A : Ce sont les fameux 20 ans en 45 !
Michel Mohrt : Oui, et la guerre est une expérience qui a beaucoup compté pour notre génération. Avant, j’avais terminé un service de 3 ans en 1939 puis la guerre a éclatée. De sorte que je suis resté 4 ans sous l’uniforme. C’est beaucoup 4 ans dans la vie d’un homme, surtout entre 24 et 28 ans ! Ca compte ! C’est une époque où quelques années de différence comptaient presque autant qu’une génération. Nous avions ressenti la défaite plus cruellement qu’eux et puis nous en avions assez des armes. J’avais donné et j’avais envie d’écrire, de travailler. Cette différence d’âge fut énorme : « Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà » !
R&A : Vous vous intéressez au cinéma ?
Michel Mohrt : J’ai fait de la critique de cinéma au Figaro pendant longtemps. J’ai assisté aux débuts du parlant après avoir connu le cinéma muet. Maintenant, je n’y vais plus. Je regarde la télévision. Je vais même vous avouer que j’attends avec impatience le samedi soir pour revoir la fameuse série Dallas. C’est remarquablement fait, astucieux. J’adore J.R. qui est devenu mon ami de la semaine.
R&A : C’était la première série soap c’est vrai à arriver sur nos écrans européens… Et la musique ?
Michel Mohrt : La musique m’a beaucoup aidé, notamment à vivre sous l’Occupation. Le Quatuor LowenGoethe qui a donné tous les quatuors de Beethoven m’a énormément touché. J’aime beaucoup la musique, tout particulièrement la musique de chambre. La chanson française me barbe. J’en suis resté à Charles Trénet. J’ai bien aimé le jazz aussi et les negro-spirituals. J’adore les chansons de mer. J’en connais des tas que je pourrais vous chanter. Mon ami François-Régis Bastide m’avait dit que j’étais un taureau et que la partie importante du taureau (astrologique) est le cou. Il paraît que le taureau aime chanter. Dans mon cas, c’est tout à fait vrai. Je me rappelle même avoir chanté en breton, notamment un soir avec Pierre-Jakez Hélias.
R&A : On parle de mer. Vous avez eu une tendresse pour les flibustiers, ces gentilhommes de fortune ?
Michel Mohrt : Oh bien sûr ! LE roman qui m’a le plus marqué de toute ma vie et que j’ai voulu imiter dans la Prison maritime c’est L’Ile au Trésor de Stevenson.
R&A : Qui n’a pas rêvé sur ce livre !
Michel Mohrt : Je l’ai lu et relu. C’est mon père qui me l’avait donné. Il a beaucoup compté pour ma formation littéraire.
R&A : Pour finir cet entretien, que pensez-vous de notre monde moderne ?
Michel Mohrt : Je n’en pense que du mal. L’autre jour, j’ai vu le débat actuel sur le mariage des homosexuels. Il y a quelque temps, j’aurais pris cela à la rigolade. Mais là, ça m’a foutu le cafard. J’étais triste. Dans quel monde va-t-on vivre demain ? Je viens de fêter mes 90 ans et je n’ai qu’une envie c’est de m’en aller lorsque je vois où nous en sommes arrivés !
R&A : Et l’immigration qui dénature notre Europe ?
Michel Mohrt : Malheureusement j’ai bien peur qu’il ne soit trop tard. On s’est battu à Poitiers et l’Espagne a retrouvé sa terre après la Reconquista. Mais là, nous vivons une autre conquête de manière pacifique. Si j’étais plus jeune, je fuirais en Californie, dans cette Amérique où j’ai vécu 7 ans (on dit d’ailleurs que pour bien connaître un pays, il faut y payer ses impôts et y tomber amoureux, ce que j’ai fait là-bas !). La côte ouest de la Californie ressemble assez curieusement à la côte ouest de la Corse qui est superbe. La France et l’Europe me déçoivent de ce côté là. Heureusement que sur mes Côtes d’Armor, rien n’a bougé. Je déteste Paris.
Recueilli par Pierre Gillieth, Réfléchir & Agir n°18, automne 2004
00:20 Publié dans Entretiens, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 janvier 2008
De ondraaglijke lichtheid van het zgn. antifascistisch discours

DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN HET ZGN. ANTIFASCISTISCH DISCOURS
door Peter LOGGHE
Voor De Standaard der Letteren van 7 augustus 2003 vat G. Van den Berghe het boek van Peter Godman over de katholieke inquisitie samen, en heeft het daarin in volgende bewoordingen over de heren inquisitoren : “Daaruit blijkt dat in zijn ogen de wereld werd beheerst door de strijd tussen goed en kwaad, en dat de Kerk en haar vertegenwoordigers die twee polen feilloos van elkaar konden onderscheiden. De kerkelijke elite voelde zich hoog verheven boven de “eenvoudigen en ongeletterden” (simplices et idiotae), die ze moesten leiden, onderrichten en behoeden voor foute interpretaties van de bijbel”. En verder : “(Ze) zagen het katholicisme als een belegerde vesting die ze uit alle macht moesten verdedigen. De waarheid was één en ondeelbaar, en werd vastgelegd door de Kerk. Alles wat daarvan afweek was ketterij, verraad aan God, majesteitsschennis”. En tenslotte : “De congregatie werkte ongecoördineerd en chaotisch. Het ene lid verbood wat het andere gedoogde. Enkelen bezaten de geestelijke souplesse en intellectuele scherpte om subtiele overwegingen te maken maar de meesten konden alleen de hakbijl hanteren”.
Godman, die Van den Berghe bespreekt, heeft het, zoals gezegd, over de inquisitie. Nu is het allang bon ton om in de katholieke pers de katholieke inquisitie te veroordelen, enige moed is hiertoe niet meer vereist, onze kranten lopen daarmee geen enkel risico, integendeel, vanuit bepaalde vrijzinnige hoek kunnen ze zelfs handgeklap en schouderklopjes ontvangen. Maar het vergt véél meer moed om dezelfde toon aan te slaan tegen de zgn. antifascistische inquisitie. Want, geachte lezers, vervangt u de woorden “God” door “Marx”, “Kerk” door “het stalinistisch communisme”, “ketters” door “fascisten”, en “(ze)” en “kerkelijke elite” door de “antifascisten” en u leest deze tekst als een treffende beschrijving van het zgn. antifascistisch kamp. In België, in Nederland, Duitsland, Frankrijk, in gans Europa.
De tactiek van het zgn. antifascistisch kamp is heel duidelijk : alles wat afwijkt van het dogmatisch marxisme wordt – in een geleidelijk proces weliswaar – gelijkgeschakeld met het verfoeilijke “fascisme”, te beginnen met wat men gespierd rechts zou kunnen noemen en eindigend bij allerlei rechtsliberale en conservatief-christelijke groepjes en clubjes. Althans, voor zover men hen hun gangen laat gaan. . De methoden zijn gekend : criminalisering, stigmatisering van andersdenkenden. Niet alleen de politieke en culturele uitingen van “andersdenken” moeten worden verboden, maar zelfs de gedachten, zelfs het politiek denken moet worden gestroomlijnd, zodat afwijkingen van de zuivere leer zelfs niet meer kunnen worden gedacht. Hier is al een tijdje aan de gang, wat ook in Duitsland – en dan vooral in het Bundesland Nordrhein-Westpfalen – met het begrip “nieuw rechts” aan de gang is. “Fascisme, zoals nieuw rechts, schrijft Dieter Stein in de uitgave 30 (van 3 tot 18 juli) van 2003 van het conservatieve weekblad Junge Freiheit, is een kauwgom, waar letterlijk alles kan worden ondergebracht, wat ook maar enigszins bedreigend voor de ingenomen machtspositie kan zijn”. Hij denkt dan aan “de inzichten van Amerikaanse communautaristen over sociale verbanden, de ideeën van de Britse adel over de Franse revolutie, Franse Gaullisten die nadenken over soevereiniteit en Deense rechtse liberalen over het migratieprobleem”. Wij kunnen hieraan toevoegen : De inzichten van Vlaams-nationalisten over Vlaamse onafhankelijkheid en hoe die te behalen op korte of middellange termijn. Dit alles vatten de heren zgn. antifascisten allemaal onder de hoed “rechts-extreem”, dus fascistisch en moet bestreden of verboden worden. De bedoeling is voor hoofdredacteur Stein duidelijk : rechtsintellectuele en conservatieve stromingen het etiket “rechts-extreem” opkleven, zodat men de gedachten kan verbieden, zonder de feitelijke discussie te moeten aangaan. Een zeer comfortabele positie : zo kunnen ze elk debat weigeren, want het gaat toch maar om “fascisten”.
Mark Grammens schrijft in Journaal nr. 341 van 17 mei 2001 kort, bondig maar daarom niet minder correct : “Men kan in een democratie geen mensen diskwalificeren omdat ze andere ideeën aanhangen”. Het gedachtemisdrijf is in wezen een kenmerk van totalitaire regimes, en hoort dus niet thuis in een echte democratie. Maar wat is er aan democratie overgebleven als bepaalde prominente leden van de zgn. progressieve pers – let wel : zonder dat ze hierop door andere weldenkenden worden aangesproken – kunnen schrijven : “De kiezer heeft altijd gelijk, luidt een mooi democratisch axioma, ik ben het daar niet langer mee eens” (Yves Desmet in De Morgen van 14 oktober 2000) ? Dit lijkt toch wel op een eerste aardige paradox in het zgn. antifascistisch discours : het aanwenden van fascistische methoden om een zgn. antifascistisch, maar in wezen totalitair regime te vestigen. De kaste van hogepriesters is al gewijd, nu alleen nog het volk vinden om de kerk te vullen. En dan is de vergelijking tussen zgn. antifascisten en de inquisitie toch al zo moeilijk niet meer, of vergis ik mij ?
Waar komt dit antifascisme vandaan ? Als je onderzoekt wie allemaal met dit scheldwoord wordt belaagd, Britse conservatieven, Vlaamse separatisten, Deense antifiscalisten, dan kan je niet om deze tweede paradox van het zgn. antifascistisch discours heen : het is een inhoudsloos woord geworden. En de geschiedenis van het zgn. antifascisme schetst dezelfde, gewaardeerde Mark Grammens in zijn Journaal als volgt in (pag. 2779) :
“Ervan uitgaande dat het fascisme van alle Europese diktaturen uit de eerste helft van de 20e eeuw waarschijnlijk de zachtaardigste was – en zelfs, samen met de diktatuur van Franco in Spanje, niet eens racistisch – vanwaar komt dan de omzetting van het begrip “fascisme” in een scheldwoord ? Dit is het gevolg van weer zo’n taboe in onze geschiedschrijving, namelijk het door Stalin via de Komintern aan zijn volgelingen in de wereld in de dertiger jaren gegeven bevel om hun pijlen niet te richten op het nationaal-socialisme, maar wel het “fascisme” tot enige en absolute vijand te maken. Was de reden hiervoor dat Stalin reeds met de gedachte van een bondgenootschap met het nationaal-socialisme speelde (het Ribbentrop-Molotov pakt van 1939) ? Neen, volgens de beschikbare gegevens was het alleen maar zijn vermoedelijk wel terechte vrees dat “nationaal-socialisme” door de opinie beschouwd kon worden als “socialisme” en dat aanvallen op dat regime dus onrechtstreeks en wellicht ten dele onbewust zijn socialisme konden benadelen. “Fascisme”, hoewel eveneens voortgekomen uit het socialisme, bevatte voor het dom gehouden volk die samenhang niet. Wie dus vandaag zijn tegenstander “fascist” noemt, terwijl die tegenstander geen Italiaan is, geen voorstander van een “corporatistische” staat, en geen andere specifieke denkbeelden van het fascisme aanhangt, - misschien zelfs, in tegenstelling tot de echte fascisten, racistisch is – is in wezen een stalinist : hij voert postuum de bevelen van Stalin uit.”
Natuurlijk moet men ook de slotformulering van Mark Grammens die het gebruik van het scheldwoord “fascisme” in de Vlaams-Belgische politiek een absurditeit noemt, volledig onderschrijven. Vermeende racisten als “fascisten” uitspuwen is stupied, lachwekkend wordt het als men Vlaamse separatisten eveneens met het scheldwoord “fascisten” bedenkt. Vlaamse separatisten streven naar het uiteenvallen van België, en Italiaanse fascisten streefden juist het tegenovergestelde na. In dit verband kan men het scheldwoord “fascisme” het best toepassen op de Groenen van Agalev en Ecolo en op de gehele Belgische intelligentsia die de lof en grootheid van het Belgische vaderland bezingt.
U heeft het al begrepen, lezer, fascisme is een scheldwoord geworden. In België dient dit scheldwoord als cement, als bindmiddel in een toch wel zeer vreemde coalitie van zeer tegenstrijdige krachten, maar die één zaak gemeen hebben : het heropleven en het voortbestaan van het Nederlands volksdeel, dat men Vlaanderen heet, bestrijden. Dit andere Vlaanderen bezit een oud vrijbuitersmentaliteit, is koppig en wil niet weten van allerlei opgelegde dogma’s. Des te erger voor dit Vlaanderen !
Maar we moeten onze blik niet eens verengen tot Vlaanderen om dezelfde strategie, dezelfde tactiek waar te nemen om elke conservatief, elke identitaire stroming te criminaliseren en te stigmatiseren. Dit is een Europese strategie. En dan is het verdraaid nuttig naar Europese figuren te kunnen verwijzen, die het voorgekauwde dogmatisch-marxistisch schema door elkaar hebben gehaald. Ik roep graag enkele getuigen à décharge op, figuren van Europees niveau. Zij hebben het zgn. antifascistisch spelletje grondig dooreen gehaald, en het past daarom even bij hen stil te staan.
EERSTE GETUIGE à décharge : Armin Mohler, de puzzellegger, de regenfluiter
Armin Mohler, ver buiten de Duitse staatsgrenzen bekend als auteur van het standaardwerk over de conservatieve revolutie (Die konservative Revolution in Deutschland 1918-1932 – Ein Handbuch) stierf op 4 juli 2003. Geboren in Basel (Zwitserland) in 1920 was hij in zijn jeugd duidelijk links georiënteerd. Hij onderging ook invloeden van Spengler, Nietzsche, Jünger. Even papte hij aan met het nationaal-socialisme en ging zelfs clandestien de grens over om in de Waffen-SS dienst te nemen, plan dat echter niet doorging. Ook werd hem heel snel de tegenstelling duidelijk tussen het nationaal-socialistisch apparaat en zijn conservatief-revolutionaire idealistische voorstellingen. Dan maar van het ongemak een deugd gemaakt : hij studeerde uiteindelijk af bij de professoren Karl Jaspers en Herman Schumacher over de conservatieve revolutie.
Eigenlijk moeten wij Armin Mohler enorm erkentelijk zijn : het begrip conservatieve revolutie werd door hem succesvol gelanceerd en blijft als begrip tot op vandaag overeind. Volgens Stephan Breuer is Mohler op die manier verantwoordelijk voor dit succesvolle begrip dat het ook in wetenschappelijke kringen heeft gemaakt. Het is ironisch dat deze term, die nu vaak door de hogepriesters van het zgn. antifascistisch geloof wordt verbonden aan het fascisme, juist door Armin Mohler werd geponeerd om duidelijk te maken dat er duidelijke verschillen bestonden tussen de conservatief-rechtse en/of jong-nationalistische krachten in het tussenoorlogse Duitsland en het aanstormende nationaal-socialisme en dat, als er van overlappingen tussen beide “kampen” kan worden gesproken, deze verbindingen zeker en misschien uitgebreider bestonden tussen andere politieke krachten (sociaal-democraten, liberalen, etc.) en het nationaal-socialisme.
Mohler omschreef het heterogene gezelschap van jongconservatieven, Völkischen, nationaal-revolutionairen, Bündischen en Landvolkbewegung als Konservative Revolution en zag hun eenheid in de strijd tegen de liberale decadentie en de universalistische tendensen van het moderne. Karl Heinz Weissmann herhaalt Armin Mohler in Junge Freiheit als hij schrijft : “Voor de Achsenzeit was het conservatief streven gericht op het verleden, daarna op de toekomst. Voordien is het erop geconcentreerd het overgeleverde te bewaren, of zelfs de verloren gegane toestand te herstellen. De Achsenzeit is voor de conservatief een tijd van ontnuchtering. Hij ziet dat bepaalde groepen een status quo hebben geschapen, die voor hen niet acceptabel is, en dat vroegere toestanden niet meer herstelbaar zijn. Zijn blik wendt zich voorwaarts”.
Onder invloed van de historicus Zeev Sternhell zou Armin Mohler iets later tot het besluit komen dat niet de Eerste Wereldoorlog of de bolsjewistische revolutie het echte lontmoment geweest waren voor de conservatieve revolutie, maar wel het feit dat het wegvallen van de toepasbaarheid van de termen “links” en “rechts” bij veel mensen voor reacties had gezorgd, en zij hierna stellingen begonnen te nemen die nu eens “links” en dan weer “rechts” waren. Men kan het ook anders omschrijven : ontgoochelden van links en rechts vonden zich in nieuwe positioneringen, die Zeev Sternhell als “fascisme” omschreef en Mohler juister als “konservatieve revolutie” bepaalt. Mohler doorstak het ballonnetje van rechts = conservatief = fascisme.
Laten wij Mohler echter niet de geschiedenis ingaan als alleen maar de auteur van een razend interessant handboek. Hij was secretaris van Ernst Jünger tot 1953 en als journalist voor enkele Zwitserse en Duitse dagbladen actief in Parijs. In 1961 leidde hij de Carl Friedrich von Siemensstiftung (tot 1981), een culturele kring met enorme uitstraling. Uit zijn Franse tijd hield hij een oprechte bewondering over voor het Gaullisme en hij probeerde vruchteloos de waarde van dit buitenlandse voorbeeld in de Duitse pers te brengen. Hij ging zwaar te keer tegen de Vergangenheitsbewältigung in Duitsland en stelde de onbehoorlijke vraag waartoe ze moest dienen. (Was die Deutschen fürchten en Der Nasenring behandelen dit thema uitvoerig). Mohler wees met scherpe pen op het soevereiniteitsdeficit en schaamde zich er niet voor uit te halen naar de VSA, zijn voornaamste vijand. Hij was niet in de eerste plaats anticommunist, wat hem onderscheidde van zovele (bange) Duitse conservatieven. Vijandschappen legde hij slechts na lang wikken en wegen vast, als we Karl Heinz Weissmann mogen geloven. Links viel hij aan niet omwille van haar neomarxisme, maar “wel omwille van haar steriliteit, haar neiging om de heropvoeding (van de Duitsers, red.) verder te zetten en haar hedonisme die elke cultuurscheppende ascese kapot maakt”.
Armin Mohler hield niet erg van het woord conservatief, omdat iedereen wel iets wil behouden of bewaren. Hij vond meer inhoud in rechts : rechts wil niet conserveren, het gaat er in werkelijkheid om toestanden te creëren, nieuw te creëren, waarvan het loont ze te bewaren.
Zijn laatste grote omslag kwam er met de Franse Nouvelle Droite (en hier kan misschien ook even opgemerkt dat Armin Mohler de Deltastichting en TekoS heeft gekend – ik verwijs naar het afscheidsartikel van Luc Pauwels in het ledenblad van de Delta-Stichting). Eén van de zaken die hem op filosofisch vlak verbond met de (toen) jonge Fransman Alain de Benoist was het nominalisme, waarover in TEKOS nummer 109 in vertaling een bijdrage werd afgedrukt. Nominalisme, een begrip en een inhoud die zoveel conservatieven irriteerden – zoals Mohler ook op andere manieren op conservatieven kon inhakken en hen irriteren : het onburgerlijke, ja zelfs het antiburgerlijke bij Mohler, zijn vitaliteit, zijn capaciteit om te begeesteren, zijn scherp oordeel en soms té scherp woord. Links of rechts : het kon Mohler eigenlijk niet veel schelen, als ze hun ding maar goed verdedigden.
Mohler heeft zijn droom, een professoraat politieke wetenschappen opnemen, nooit kunnen waarmaken. Veel uitgeverijen sloten voor hem hun deuren. In 1967 werd hem de Adenauerprijs toegekend en ontketende een bepaalde pers een heksenjacht tegen hem
Is hij mislukt in zijn leven ? Mohler, zo besluit Weissmann zijn artikel in Junge Freiheit, wees graag op auteurs die onduidelijke maar aanwijsbare invloeden op het leven hebben. “Regenfluiters” worden ze genoemd, maar het zijn eigenlijk vogels die met hun gefluit een storm aankondigen. Armin Mohler behoort tot het gild van de regenfluiters. Zo zei Mohler zelf : “Ze waarschuwen voor de komende vernietiging, maar ze wensen op geen enkele manier een terugkeer naar de goede oude tijd. Hun doel is niet het bewaren van hetgeen reeds land over zijn tijd heen is, maar het vasthouden aan het wezenlijke”. Mohler wees op het wezenlijke, wees op Europa, op onze cultuur, en dat had niets met “fascisme” te doen. De getuigenis van Armin Mohler zal van wezenlijk belang blijven in onze strijd .
TWEEDE GETUIGE à décharge : Ernst Niekisch, de taboebreker
Het complexe en niet alledaagse leven van Ernst Niekisch, zijn ideeën en de evolutie van zijn ideeën vormen één groot démenti van de ondraaglijke lichtheid van het zgn. antifascistisch discours : conservatief = rechtse zak = antisociaal = fascisme. Het blijft daarom boeiend enkele facetten en feiten aan het papier toe te vertrouwen en wij baseren ons hiervoor op de inleiding van Alain de Benoist van de Franse vertaling van Ernst Niekisch, Adolf Hitler – une fatalité allemande, Pardès, Puiseaux, 1991, ISBN 2 – 86714-093-5.
Niekisch gaat door voor één van de heftigste tegenstanders van het nationaal-socialisme en is een epigoon van wat men het nationaalbolsjewisme heeft genoemd. Hij werd geboren in Silezië in 1889 en zal in Berlijn sterven in 1967. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is hij instructeur van jonge rekruten en Feldwebel in een gevangenenkamp in München. Hij leest er Marx en sluit zich aan bij de sociaal-democraten. Op 18 november 1918 verneemt hij dat de republiek in München door Kurt Eisner is uitgeroepen, dat soldaten in Augsburg hun raden zouden willen aanduiden. De sociaal-democraten aarzelen en besluiten dan Niekisch naar de kazerne te sturen. Uren later is hij de voorzitter van de soldaten- en arbeidersraad, zit in het centraal comité van Beieren en zal zelfs afgevaardigde worden in het nationaal congres in Berlijn. Na de moord op Eisner, op 21 februari 1919, zal hij de beweging even leiden, en heeft hij oa. gesprekken met Rathenau, in de hoop de beweging nog te kunnen redden. Hij zal zich verzetten tegen de pogingen van de anarchisten Landauer en Mühsam om een tweede, communistische revolutie uit te lokken, want hij vindt het sovjetsysteem voor Beieren niet geschikt – een ruraal gebied. De witte terreur zal ook Niekisch niet sparen en hij wordt tot 2 jaar opsluiting veroordeeld Hij ontdekt er Spengler en leert er het primaat van de buitenlandse politiek erkennen, hij deduceert er dat een sociale revolutie eerst een nationale revolutie onderstelt. En bij Pruisische auteurs snuift hij de Pruisische geest op.
In 1922 ontmoeten wij Niekisch in Berlijn, de stad waar hij steeds naartoe wilde. Hij is er secretaris van de jeugdafdeling van de Duitse Textielvakvereniging (met 70 000 leden) en gaat er vrij snel de strijd aan met de reformistische vleugel van de partij. Hij wil een nieuwe intellectuele lijn voor de partij en pleit voor een verregaande identificatie van de arbeidersklasse met de staat en tegen de capitulatie t.o.v. Frankrijk en het Dawesplan, dat zal leiden tot een grote inmenging van het Amerikaanse bankwezen in Duitsland. De Duitse sociaal-democratische partij moet “de weerstand van het Duitse volk groeperen tegen het Westers imperialisme”. Hij poneert de quasi-identiteit van volks en staat. Staat en volk zijn één, een eenheid die boven de veranderingen van tijden staat, ook omdat zij niet één generatie vertegenwoordigt, maar alle. Dit is iets wat het uitsluitend politieke karakter van het liberalisme niet kan begrijpen, noteert Niekisch.
In Grundfragen deutscher Aussenpolitik (1925) verdedigt Ernst Niekisch de idee van klassentegenstellingen, maar onderstreept hij terzelfdertijd het primaat van de buitenlandse politiek, waar de klassentegenstellingen slechts secundair zijn. Als men de Russische revolutie slechts ziet als een sociaal revolutionaire gebeurtenis, dan merkt men het essentiële niet op. Men kan haar slechts begrijpen vanuit het licht van de buitenlandse politiek. En Niekisch hamert hier reeds op een nagel, die hij later nog herhaaldelijk zal beslaan : hij roept Duitsland op om weerstand te bieden tegen de “gerichtheid op het Westen”, gerichtheid die tegengesteld is aan de echte Duitse belangen. En door haar oriëntatie op het Westen versterkt de SPD (sociaal-democraten) het kapitalisme. Met deze stellingen heeft hij succes bij de Hofgeismarkreis, een kring van SPD’ers die proberen de nationale idee en het socialisme te verzoenen, en het is met deze kring dat hij het tijdschrift zal starten, Widerstand (vanaf 1926) dat hem befaamd zal maken. Met de medewerking van August Winnig krijgt het blad een nationaal-revolutionair karakter, Winnig riep de arbeiders op om deel te nemen aan de nationale opstand en stelde dat de vijand niet de patroon of de werkgever was, maar het internationaal financieel kapitaal. Jongconservatieven, neo-nationalisten, paramilitaire groepen met als voornaamste Oberland, Bündische groepen zullen de ideeën van Niekisch nu leren kennen, en uit bvb. de Bündische groepen, met hun ideeën over “Bündisch socialisme” zullen heel wat latere nationaal-bolsjewisten komen.
Belangrijk voor Niekisch is ook zijn ontmoeting met Ernst Jünger, die voor Widerstand enkele belangrijke bijdragen zal schrijven, maar die zich toch nooit nationaal-bolsjewist zal noemen. Hij heeft wel invloed op het blad en zal het in de richting duwen van een “nieuw aristocratisme”, geïnspireerd door een “heroïsch realisme”.
1928-1930 : De Widerstandskringen nemen uitbreiding, zowel op het vlak van medewerkers als op het vlak van invloed onderaan. A. Paul Weber, van wie we hier enkele tekeningen afdrukken, verleent zijn medewerking en de filosoof Hugo Fischer zet zijn schouders mee onder de onderneming. In 1928 wordt een uitgeverij opgericht, de Widerstandsverlag.
Het valt niet te ontkennen dat dit nationaalbolsjewisme tevens een hernieuwing betekent van de aloude “Ostorientierung”, maar nu tevens verbonden met een nieuwe ideologie in het Oosten, het bolsjewisme. Nationaalbolsjewisten wilden een gerichtheid op het Oosten, eerder dan op de Rijnlandse gebieden. En : voor hen is het Verdrag van Versailles een instrument van de liberaalkapitalistische bourgeois om de oorlog tegen Duitsland verder te zetten en haar op een blijvende manier te knechten. Het kapitalisme is het systeem van de onderdrukker en toevallig ook het economisch stelsel van het Westen. Duitsland moet dus een Schicksalsgemeinschaft vormen met Rusland.
Binnen de totaliteit van de Konservative Revolution zorgde dit wel voor moeilijkheden : hoe een natuurlijke “Ostorientierung” verzoenen met een noodzakelijke kritiek op het marxisme ? Twee sleutelideeën zullen hierbij helpen :
1. De overtuiging dat er heel wat gemeenschappelijke punten bestaan tussen bolsjewisme en Pruisische stijl – een sterke staat, gehiërarchiseerd, de wil om het burgerlijke parasietendom te vernietigen.
2. En de idee dat het bolsjewisme vooral een Russische beweging is, waarvan het internationaal marxisme maar een façade is.
Maar er bleef toch steeds een ambiguïteit bestaan binnen de conservatieve beweging : voor de enen was de bolsjewistische revolutie niets anders dan de radicale vorm van kosmopolitisme, anderen zagen 1917 dan weer als een elektrische schok, noodzakelijk om de Russen opnieuw een gevoel van eigenwaarde te geven. “Elk volk heeft zijn eigen socialisme” zou Moeller van den Bruck schrijven, met als onderliggende idee dat elk volk zijn eigen revolutie heeft, en dat elke revolutie ook door het volk wordt gekleurd. Nog anderen zien in het marxisme een soort nageboorte van het kapitalisme en achtten het dus niet in staat om dit kapitalisme afdoende te bestrijden. Vele nationaalrevolutionairen echter blijven de affiniteiten onderstrepen : het bolsjewisme is een idealistische beweging, gericht op een ethiek, een ethiek van de arbeid, het offer, het primaat van de collectiviteit op de enkeling. Vanaf 1927 wordt in deze kringen de Russische revolutie dan ook als een mogelijk voorbeeld van nationale en sociale herstructurering beschouwd. Widerstand zal in 1928 Stalin zelfs gelukwensen met de dood van Trotsky en zijn pogingen om de nationale orde en eenheid in Rusland te versterken. Niet alle nationaalrevolutionairen gaan even ver, en sommigen gaan nog verder. Karl O. Paetel, die in 1941 asiel zoekt in New York, en in 1963 een anthologie over de Beat generation zal schrijven, staat volledig achter de klassenstrijd.
In 1929 schrijft Niekisch met Jünger een artikel waarin zij pleiten voor een samenwerking met de communisten, op voorwaarde dat het marxisme zich zou keren tegen de gevestigde Weimarorde. Het wordt een dovemansgesprek, want voor de nationalisten zijn de marxisten nog maar halverwege, en voor de marxisten is het al even duidelijk : als de nationalisten werkelijk zo begaan zijn met het lot van de arbeiders, moeten ze maar gewoon marxisten worden.
In 1930 werkt Niekisch opnieuw hard in de richting van een nieuwe “Ostorientierung” : hij maakt duidelijk dat de Duitser geen slaaf of Rus moet worden, maar dat het gaat om een noodzakelijke coalitie. Rusland, voegt hij er aan toe, is niet liberaal, is niet parlementair en is niet democratisch. Zijn ideeën slaan vooral aan in Bündische kringen en bij het Oberlandkorps (vrijkorps). Niekisch mag regelmatig op bijeenkomsten het woord voeren, maar zijn minder gemakkelijk karakter veroorzaakt scheuren, en hij besluit zijn eigen kringen op te richten – wat daadwerkelijk gebeurt vanaf 1930-31, de zgn. Widerstandskringen. Het totaal aan effectieven schat Uwe Sauermann (een na-oorlogs publicist) op 5000, maar de invloed is vele malen groter. Louis Dupeux schat het totaal aan nationaalbolsjewisten op ongeveer 25 000. De invloed van Niekisch is vooral aantoonbaar bij jongeren, die worden aangesproken door zijn radicalisme, zijn scherpe formuleringen. Anderen verwijten hem dan weer zijn gebrek aan soepelheid, zijn moeilijk karakter. Hij was m.a.w. geen practisch politicus. Hij trok begeesterde leerlingen aan, maar kon nooit massa’s volgelingen verzamelen.
Nog een woord over de verhouding van Ernst Niekisch en het nationaal-socialisme. Hij was ongetwijfeld een van de eersten om te waarschuwen voor het nationaal-socialisme, reeds in 1927. Niet alleen omwille van haar jodenpolitiek, maar ook omdat het nationaal-socialisme vastzit in een fanatiek anticommunisme en haar “Ostorientierung” niets anders is dan expansionisme en imperialisme. Een politieke leer, die het ras als het beslissende element van haar politiek beleid maakt, beschouwt Niekisch niet als Duits, maar als Beiers, zuiders en katholiek. Begin 1932 brengt hij zijn brochure Hitler – ein deutsches Verhängnis op de markt, waarin hij zijn waarschuwingen nog eens herhaalt. Het boekje haalt een oplage van 40 000 exemplaren. Sebastian Haffner ziet Niekisch en Hitler als twee volmaakte antipoden, die maar één gemeenschappelijk punt hadden : hun haat voor de Weimarrepubliek.
In de lente van 1932 neemt Niekisch nog deel aan een studiereis naar de Sovjet-Unie op uitnodiging van een arbeidsgroep voor de studie van planeconomie (Arplan), hij heeft er contact met Karl Radek, en schrijft bij thuiskomst nog een lovend artikel over de Sovjet-Unie, waarin hij pleit voor de collectivisatie als een mogelijke sociale organisatievorm die “de moordende effecten van de techniek het best kan beheersen”.
Niekisch wordt – zoals iedereen – in snelheid gepakt door de machtsgreep van Hitler, “een persoonlijk succes voor de man, een mislukking voor het nationaal-socialisme” vindt hij. Hij noemt hem ook “der Talentlose”. Op 20 december 1934 wordt Widerstand verboden, en Niekisch wordt de verklaarde vijand van de NSDAP. Ondanks politiecontrole slaagt hij er nog in enkele binnen- en buitenlandse reizen te maken. Hij blaast de rijksgedachte nieuw leven in als laatste poging om het racisme van het nationaal-socialisme een alternatief te bieden. Zijn laatste brochure Die dritte Imperiale Figur en Im Dickicht der Pakte worden door de Gestapo opgespoord. Op 22 maart 1937 wordt hij, samen met een zeventigtal van zijn medestanders, aangehouden en op 10 januari 1939 volgt het oordeel : hij wordt veroordeeld wegens hoogverraad, zijn bezittingen worden aangeslagen en hij verliest zijn burgerrechten. In 1945 wordt hij door de Amerikanen bevrijd, hij wordt lid van de (West-Duitse) KPD en hij wordt professor aan de Humboldt-universiteit in het oostelijke deel van Berlijn. Hij noemt zich voortaan democraat en progressief, hij valt opnieuw de westelijke orientering aan van de BRD en staat op een strikt neutralisme, maar hij blijft streven naar een herenigd Duitsland.
Niekisch een fascist ? Voor Sebastian Haffner is hij een revolutionair socialist, Armin Mohler beschrijft hem als de meest radicale nationalist. Alain de Benoist sluit zijn inleiding als volgt af : Niekisch werd gevangengezet onder Weimar, onder Hitler, uitgespuwd door de overheden van de BRD en veracht door de DDR. Zijn fundamentele idee blijft dat nationale bevrijding en socialistische revolutie samengaan. De paradox is dat Niekisch de URSS bewonderde door juist die redenen, waarvoor ze werd verafschuwd door haar tegenstanders, en voor de omgekeerde redenen, waarvoor ze werd bejubeld door haar bewonderaars. Natuurlijk heeft Niekisch zich veel illusies gemaakt over de Sovjet-Unie, maar hij heeft het toch op enkele punten bij het rechte eind : is het vanop afstand bekeken niet zo dat het Stalinistische Rusland eerder moet worden gekwalificeerd als een nationaal-bolsjewistische staat ? En opent een nieuwe Duits-Russische samenwerking geen perspectieven voor morgen ?
CONCLUSIE
Er is geen fascistische dreiging in Vlaanderen, in Nederland, in Europa. Een logische vraag blijft dus gesteld : waarom is er dan een zgn. antifascisme ? De twee getuigen à décharge moeten de druk op dit zgn. antifascistisch kamp verhogen om eindelijk eens hierover de discussie aan te gaan.
00:35 Publié dans Définitions, Manipulations médiatiques, Nouvelle Droite, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Shambala: la Voie du Guerrier
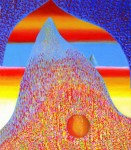
Shambhala : la voie du guerrier
Le tibétain Chögyam Trungpa fut le premier à apporter la sagesse de son pays en Occident. Il fonda ainsi de nombreux centres bouddhistes. Il enseigna aussi "la voie du guerrier" ou pratique Shambhala, un enseignement basé sur des traditions antérieures à la venue du Bouddhisme au Tibet. Son élève et ami Jeremy Hayward vient de publier Le monde sacré de Shambhala que l'éditeur résume ainsi: « La pratique Shambhala appelle "voie du guerrier" l'effort consenti pour vivre pleinement, chaque jour. Agir en guerrier ou en guerrière, c'est oser vivre avec authenticité, douceur et courage, même quand des obstacles internes nous empêchent d'atteindre notre véritable potentiel. Ce guide pratique, qui va de pair avec le classique Shambhala: la voie sacrée du guerrier (Points Sagesses, Seuil), est le premier ouvrage à proposer point par point des instructions sur l'art du guerrier de Shambhala. Alliant la pratique bouddhique de l'attention à des enseignements chamaniques pré-bouddhiques, l'apprentissage Shambhala enseigne les méthodes pour invoquer de puissantes énergies naturelles en vue d'une transformation personnelle et collective. La voie du guerrier n'a pas pour objectif le retrait du monde. Elle veut, au contraire, en faire un lieu plus propice à l'éveil pour soi et pour autrui. Pour atteindre cette fin, les enseignements Shambhala considèrent que tout —y compris les engagements que peuvent être la carrière ou la vie familiale— fait partie de la voie. Sur le chemin du guerrier, on apprend à unir l'esprit, le corps et les émotions en un tout harmonieux. Dans Le monde sacré de Shambhala, Jeremy Hayward éclaire la forte et élégante philosophie Shambhala par le biais de lignes directrices éminemment pratiques, de méditations, d'intuitions, d'anecdotes et d'exercices d'attention ». Ce livre permettra aux rêveurs qui se croient des guerriers, parce qu'ils ont lu Saint-Loup ou Evola, d'aborder réellement la voie du Guerrier (JdB).
Jeremy HAYWARD, Le monde sacré de Shambhala, Editions du Seuil, 1998, 364 pages, 148 FF.
00:25 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 janvier 2008
Joseph Conrad, voyageur au bout de l'être

Frédéric SCHRAMME:
Joseph Conrad, le voyageur au bout de l'être
On ne peut évoquer l'aventure en littérature sans se pencher sur le cas Conrad. Mais, avec lui, on s'éloigne radicalement des romans de marins de Stevenson et la seule île au trésor est celle de l'esprit, le trois-mâts, conquérant des sept mers devient le véhicule de la pensée de Conrad et le prétexte pour une aventure introspective.
Joseph Conrad aimait à se définir comme un romancier qui a été capitaine au long cours plutôt que comme un capitaine en retraite écrivant des romans, son expérience de la vie maritime ne constituant en réalité qu'une trame de fond pour une œuvre d'une autre nature. Ainsi, bien que la fiction de son œuvre épouse largement la réalité des événements vécus par lui ou portés à sa connaissance, son récit est avant tout celui de la vie intérieure, des sentiments et des sensations d'une humanité confrontée aux forces naturelles et de ce qui en résulte. Si l'œuvre de Joseph Conrad parcours toutes les mers du globe, la véritable aventure est celle d'une âme mise à nu et de sa place dans le monde, consciente de ses possibilités, rongée par le doute et libre de ses choix. C'est cette dimension de l'homme où la réflexion précède l'action qui est la véritable mesure du « vrai » dans la pensée de Conrad et lui-même sait « qu'un auteur vit dans son œuvre. Il est là, seule réalité d 'un monde fictif; parmi des choses, des événements, des gens imaginaires. En, les décrivant, il ne fait que se décrire lui-même. »
Si la forme de l'œuvre conradienne est une retranscription de son expérience maritime, le fond est imagination pure car « Ce n'est que dans l'imagination des hommes que toute vérité trouve une réelle et indéniable existence. L'imagination, non l'invention, est la maîtresse de l’art comme de la vie ». Et comme : « L'inspiration vient de la terre, qui a un passé, une histoire, un avenir, non du ciel froid et immuable », l'appréhension du monde qui en résulte est soumise à une identité culturelle définie et non à une Raison universellement innée. Donc, si à la lumière de la vie de l'homme s'étire l'ombre de sa pensée, il convient de jeter un regard sur ses origines:
Des origines polonaises et nationales-révolutionnaires
De son vrai nom Teodor Jozef Konrad Korzeniowski, il naît en 1857 à Terechowa, ville polonaise alors sous administration russe, dans une famille catholique et activiste patriote, précision qui serait un pléonasme concernant les Polonais (et les Irlandais) selon Jean Mabire, il est déporté en même temps que ses parents en Sibérie et deviendra orphelin à l'âge de onze ans. Recueilli par un oncle maternel, il s'embarque à dix-sept ans comme matelot à bord d'un voilier. Lié au milieu des activistes carlistes, du nom du prétendant légitimiste à la succession d'Espagne, il s'adonnera à la contrebande d'armes et tirera de cet épisode de sa vie matière à un roman d'inspiration largement autobiographique: La flèche d'or. Après être devenu lieutenant, il obtient la nationalité britannique, retourne pour quelques mois en Pologne où il est accueilli chaleureusement, passe son brevet de capitaine, débarque définitivement après avoir passé une vingtaine d'années sur les mers et devient écrivain. En tant que sujet britannique, Conrad choisira de s'exprimer dans la langue de Shakespeare, choix qui lui imposera une véritable torture intellectuelle pour chaque phrase sortie du néant. Sa carrière littéraire dure une trentaine d'années environ et il meurt en 1924 et est enterré à Cantorbéry.
Passé directement de l'état de victime dans une société sous administration étrangère à celui d'acteur dans une civilisation impérialiste et colonisatrice, de la solitude contrainte par la suspicion d'état à celle des voyages en mer et surtout de la précarité d'un destin soumis à des événements incertains - I'incertitude précaire du moment se révélant souvent être propice au dévoilement des âmes et des comportements - Conrad peut développer une scrupuleuse capacité d'observation du monde des hommes, adoptant le ton d'un relativisme neutre et radical passé à l'aune d'un détachement moral, le détachement désignant en fait une réalité aussi étrangère à celle de l'indifférence que peut l'être celle de neutralité à la modération, la tiédeur, l'esprit de conciliation d'un conformisme bien-pensant. C'est sur l'axe qui va du neutre, qui ne s'engage pas, au radical, qui ne transige pas sur l'essentiel, que prend place l'expression de la libre pensée de l'exilé polonais devenu voyageur anglais, se gardant la possibilité de passer de l'un à l'autre au gré des conditions et des difficultés rencontrées.
Une valeur cardinale : la fidélité
Si l'absence d'un véritable engagement envers une quelconque idéologie a permis à certains de ses biographes de dénier à Conrad la possession de la moindre pensée cohérente, tout au plus de quelques vagues opinions, c'est en réalité le scepticisme qui est le point central, la pierre d'achoppement de la perspective conradienne. Mais ce scepticisme, loin d'entraîner l'aigreur et la désespérance est en fait le catalyseur lui permettant de jeter un regard contemplatif sur un « univers conçu comme un pur spectacle » et capable de dépasser le réel ou l'apparent pour atteindre le vrai. « Le scepticisme, le tonique des esprits, le tonique de la vie, l'agent de la vérité - la voie de l’art et du salut ». Mais si pour le biographe Albert Guérard, « Une vision moralisante et conservatrice de la vie était pour Conrad une seconde nature et tenait en échec un fort penchant au scepticisme et de forts élans de révolte » ; le scepticisme est également le moyen pour Conrad d'éviter l'écueil des vérités absolues d'une société victorienne mercantile, sûre d'elle-même et dominatrice, et dont les lois sont à l'opposé des convictions de Conrad puisque, comme il le déclare : « Ceux qui me lisent savent ma conviction que le monde, le monde temporel, repose sur quelques idées très simples, si simples qu'elles doivent être aussi vieilles que lui. Il repose notamment, entre autres choses, sur l'idée de fidélité. ». Cette fidélité, qui est la cause de tout engagement durable, mais aussi celle qui lui permet de maintenir un lien avec la tradition des siens et leur combat, comme le marin perdu en mer se cramponne à la bouée de sauvetage, fidélité entière et totale, même si ses compatriotes lui ont souvent reproché son exil volontaire hors de sa patrie d'origine car, pour Conrad, « La fidélité à une tradition particulière persiste à travers les événements d'une existence qui ne lui est pas liée, tout en suivant scrupuleusement le chemin tracé par une impulsion inexplicable » et dans les abords de ce chemin se démarque « Une vue impartiale de l'humanité à tous ses degrés de splendeur et de misère, jointe à un respect particulier pour les droits des non-privilégiés de ce monde, non pour des raisons mystiques, mais par simple solidarité et par un honorable esprit d'entraide, fut le caractère dominant de l'atmosphère intellectuelle et morale des maisons qui abritèrent mon enfance hasardeuse et constitua l’objet d'une conviction sereine et profonde, durable et cohérente, aussi éloignée que possible de cet humanitarisme qui semble seulement l'effet d'un déséquilibre nerveux ou d'une conscience morbide ».
La fidélité et la solidarité, lois fondamentales pour la survie des marins en mer, marquées dans leur cœur plutôt qu'au fronton des capitaineries, sont également nécessaires à l’écrivain en quête de vérité et, dans tous les cas, garants contre l'individualisme, l’indépendance égoïste, l’idée que l'homme serait une unité se suffisant à elle-même mue par des motifs de concurrence, qui donne l'utilitarisme en éthique et le libéralisme en économie (Jacques Berthoud, cf. bibliographie).
Le sens de l’honneur
Avec la fidélité et la solidarité, c'est le sens de l'honneur qui est l'un des thèmes majeurs de la pensée de Conrad puisqu'il reviendra à plusieurs reprises parmi les romans les plus importants de l'auteur. Le premier d'entre eux, La folie Almayer est le récit de la déchéance d'un marchand néerlandais promis à un bel avenir mais qui, au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans les terres inconnues, se déshonore et devient la risée de tout le comptoir colonial, finit par vendre de la poudre à ceux qui contestent la présence des siens et meurt, seul et dérisoire dans l'attente d'un hypothétique coup du sort censé le mettre en présence d'un trésor. D'honneur perdu, il est encore question dans Lord Jim, I'histoire d'un jeune marin, commandant en second d'un navire rempli de passagers qu'il abandonne lâchement à leur sort et qui se défend des accusations portées contre lui devant Marlow, personnage récurent, probable alter ego de Conrad, solidaire de l'accusé malgré son ironie et sa distanciation.
D'une manière générale, les récits de Conrad sont matières propices à dévoiler toute une galerie de personnages présents pour évoquer toutes les gammes de comportement possible sous ces degrés de latitude et leurs contradictions mutuelles. Par exemple, la fille d'Almayer, métisse indonésienne, incarnation symbolique du choix donné à tous entre une civilisation marchande occidentale rendue précaire par la concurrence et celle, tout aussi précaire mais bien plus gratifiante des guerriers (malais en l'occurrence). Mais si le discours de Conrad n'a pas sa place dans le débat sur l'inégalité des races, il réduit à néant également celui sur l'éventuelle supériorité d'une civilisation sur les autres, maladie honteuse de la social-démocratie occidentale et des héritiers universalistes de Jules Ferry, d'autant qu'il est étranger à tout exotisme rousseauiste.
L’homme moderne indifférent et inconséquent
D'ailleurs, chez Conrad, les Européens sont autant guerriers (sans aucun rapport avec le citoyen conscrit, habituelle chair à canons des guerres économiques qui le dépassent) que les Malais peuvent être domestiques, comme en témoigne Tom Lingard, légataire d'Almayer, et, à l'opposé de Chester, marchand invétéré invitant le lord Jim aux promesses de richesse d'une île à guano, le personnage du Dr Stein, véritable entomologiste de choc, explorateur et guerrier capable de se défendre lui et les siens, philosophe à ses heures et initiateur de la réintégration du jeune lieutenant dans son honneur et que certains ont rapproché de la figure de Merlin ou de Prospero. On le voit, le monde issu de l'imaginaire conradien, donc représentation vitale du vrai, est celui des opposés qui réfute le modèle universel d'un monde des contraires forcément manichéens et qui ne peut aboutir qu'à la diabolisation de l'un des éléments par son antagoniste. Chez Conrad, le choix est toujours possible sans exclusion (le Dr Stein est également commerçant) et va jusqu'aux figures extrêmes représentées dans Au cœur des ténèbres sous les yeux de Marlow par Kurz, guerrier retombé dans le primitivisme et par le directeur du comptoir congolais, fonctionnaire comptable zélé et déshumanisé. Mais des deux, c'est paradoxalement Kurz qui, au long du récit, garde à l'esprit la prégnance de l'esprit occidental tandis que le directeur, homme pratique et technocratique est transposable dans toutes les civilisations sans que son caractère en soit affecté. Mais si Kurz est coupable de trahir la civilisation européenne en l'abandonnant, le directeur est un homme qui a su régresser avec son temps pour devenir le prototype de l'homme moderne indifférent et inconséquent, archétype de la civilisation du Progrès.
L'œuvre du romancier Conrad est donc d'abord celle d'un penseur de l'homme et de ses contradictions. S'il annonce déjà Céline et sa description dans Voyage au bout de la nuit, de la déliquescence de la civilisation européenne sous les tropiques, il demeure fondamentalement optimiste en faisant également sienne la vision nietzschéenne de l’homme, ce ruisseau chargé des alluvions de ses vices et de ses faiblesses cherchant parfois à atteindre à son embouchure la mer de la surhumanité. Mais Conrad n'est ni juge, ni parti et ce qui découle de son œuvre c'est avant tout le choix, celui qui est donné à la plupart de ses personnages et notamment à Marlow, double imaginaire (selon sa propre définition de l’imaginaire) de l'auteur qui, au cours de ses pérégrinations, est amené à observer et à évaluer les hommes et par cet intermédiaire, à faire évoluer son propre caractère pour faire surnager le vaisseau de son propre esprit sur les mers de la contradiction. C'est la garantie de ce choix, qui évite à l'homme de sombrer avec les esprits suffisants et « La troupe vaste de ceux qui manquent complètement d'imagination, de ces êtres au regard vide et aveugle desquels [...] l'univers entier s'évanouit dans un néant total », totalement inaptes à atteindre « notre véritable tâche à nous, les hommes, dont les jours sont comptés sur cette terre, lieu d'opinions contradictoires [...] Tâche où le destin n'a peut-être rien engagé de nous que notre conscience, douée de voix af in de témoigner véridiquement du miracle visible, de la terreur obsédante, de la passion infinie et de la sérénité sans limite; de la loi suprême et du mystère immuable du spectacle sublime ».
Frédéric SCHRAMME.
BIBLIOGRAPHIE
Joseph Conrad:
◊ Des souvenirs; récits, Gallimard 1912
◊ La folie Almayer; roman, Gallimard 1919
◊ Lord Jim; roman, Gallimard 1921
◊ Au cœur des ténèbres; nouvelles, Gallimard 1925
◊ La flèche d'or; roman, Gallimard 1918Jacques Berthoud:
◊ Joseph Conrad: Au cœur de l'œuvre; Criterion 1992.
00:10 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 27 janvier 2008
E. E. Dwinger: sens de la souffrance

Ulli BAUMGARTEN:
Edwin Erich Dwinger: donner un sens à la souffrance
Au cours de sa jeunesse, il arrive de tomber sur les livres de certains écrivains qui vous impressionnent tellement que leur œuvre ne vous quitte jamais plus. Edwin Erich Dwinger, écrivain très célèbre sous la République de Weimar, qui fut, à côté de Werner Beumelburg, le principal écrivain du « nationalisme soldatique » (soldatischer Nationalismus), appartient aujourd’hui à la catégorie peu enviée des écrivains oubliés de l’entre-deux-guerres. Même si certains de ces livres ont été réédités, il y a quelques années, son nom ne dit plus rien à personne, y compris dans les rangs du néo-conservatisme néo-nationaliste, où, forcément, on ne lit plus ses livres. A tort !
Edwin Erich Dwinger est né le 23 avril 1898 à Lübeck, fils d’une mère russe et d’un officier allemand. Pendant toute sa vie, il a été tiraillé entre l’Allemagne et la Russie. Comme pour beaucoup de jeunes Allemands de sa génération, la première guerre mondiale sera l’événement central de son existence. Il se porte volontaire en 1915. Les années de guerre le marqueront tellement qu’à sa profession de paysan, librement choisie, il ajoutera celle d’écrivain, mu par le désir ardent de raconter son vécu de combattant et d’y identifier sa patrie, l’Allemagne.
Après un bref engagement sur le front russe, le jeune aspirant d’un régiment de dragons, âgé de 17 ans est grièvement blessé et pris prisonnier par les soldats du Tsar. Avec ses camarades, il aboutit au terrible camp de prisonniers de Totzkoïe, dont des milliers de soldats allemands ne reviendront jamais. L’administration du camp est inhumaine : les détenus meurent du typhus ou, plus simplement et plus cruellement, de faim. Dans la première partie de sa trilogie « Die deutsche Passion » (= La passion allemande), intitulée « Armee hinter Stacheldraht » (= Une armée derrière les barbelés), Dwinger tente de donner un sens à cette souffrance indicible, provoquée par la brutalité de l’administration du camp ; il écrit : « Tout homme qui n’est pas capable de sa sacrifier pour une idée, de quelque nature qu’elle soit, n’est pas un homme au sens le plus élevé (…). Nous subissons ici, ce qui fait de l’homme un homme : souffrir pour une idée ». Les survivants de cet enfer sur la Terre finiront par être transportés plus à l’Est, aux confins de la Chine. Bien que la guerre entre le Reich et la Russie se soit terminée en 1917, les prisonniers de guerre allemands, devenus jouets aux mains des Blancs et des Rouges, sont maintenus dans les camps. Les derniers ne seront libérés qu’en 1921.
Entre Blancs et Rouges
Dwinger réussit toutefois à s’échapper du camp en 1919, mais est repris prisonnier par les Blancs anti-bolcheviques, et placé devant l’alternative : ou la mort ou l’engagement dans la lutte contre les communistes. Dans le deuxième volume de sa trilogie, « Zwischen Weiß und Rot » (= Entre Blanc et Rouge), Dwinger décrit la pire et la plus brutale des guerres, la guerre civile. Il y décrit les atrocités commises par les uns et les autres, ciselant les phrases les plus poignantes de son œuvre. Au début des années 20, l’Europe a eu peur du bolchevisme mais en a également été fascinée. La peur du bolchevisme explique l’émergence de partis radicaux de droite. Seuls ceux qui ont vécu le destin du peuple russe en ces années terribles de la guerre civile entre Blancs et Rouges peut comprendre de tels sentiments.
La défaite de l’armée de Koltchak, à laquelle le malgré-lui Dwinger appartenait, signifia l’effondrement définitif de la résistance anti-bolchevique. Dwinger se retrouve une nouvelle fois dans un camp de prisonnier. Il s’évade et peut, à l’été 1920, franchir la frontière allemande. D’heureuses circonstances lui permettent d’acquérir un emploi d’intendant dans une grande propriété de Prusse orientale. Quelques-uns de ces camarades y ont également trouvé refuge et ont essayé d’y démarrer une carrière de paysan-défricheur. Dwinger décrit les troubles de ces années, avec la cession forcée de territoires allemands et l’inflation galopante, dans le troisième volume de sa trilogie « Wir rufen Deutschland » (= Nous appelons l’Allemagne). Cette trilogie, parue entre 1929 et 1932, a assis la réputation d’écrivain de Dwinger.
La majeure partie de son œuvre complète, comptant plus de trente livres totalisant près de deux millions de volumes, est consacrée aux rapports germano-russes. Ainsi, par exemple, « Die letzten Reiter » (= Les derniers cavaliers), livre paru en 1935. L’auteur y décrit la tragédie des Pays Baltes et de la caste dominante allemande qui y était installée depuis plus de 700 ans. Cette caste avait participé à l’éclosion culturelle et à l’essor économique de cette région d’Europe. « Und Gott schweigt ? » (= Et Dieu se tait ?), paru en 1936, est également un ouvrage très connu de Dwinger. Il y décrit les impressions d’un jeune communiste, qui émigre en 1933 en Russie, mais est horrifié par la situation de la Russie bolchevique, se transforme progressivement en militant anti-communiste et revient en Allemagne.
Dwinger et la politique slave du IIIième Reich
Vu ses origines et ses expériences vécues, vu cette double imprégnation biologique et existentielle, Dwinger est resté pendant toute sa vie un anti-communiste convaincu, mais, sous le Troisième Reich, n’a jamais accepté la politique slave de l’Etat national-socialiste. Dwinger voulait donner aux peuples de Russie une place équivalente, des droits égaux et un rôle égal, à celui des Allemands. Pour cette raison, les rapports entre Dwinger et les détenteurs du pouvoir nationaux-socialistes ont toujours été ambigus. En tant que représentant du mouvement littéraire du « nationalisme soldatique », il appartenait davantage au camp national-révolutionnaire qu’à celui des protagonistes de la politique raciale du IIIième Reich. Cependant Dwinger n’a pas résisté à l’appel de Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Pendant la campagne de Russie, il devient SS-Obersturmbannführer et surtout conseiller spécial de Himmler pour les questions soviétiques.
Mais la carrière de Dwinger s’est poursuivie aussi en dehors du cadre SS. Dès 1933, il était devenu membre de la section littéraire de l’Académie Prussienne des Arts et « Sénateur culturel du Reich » (Reichskultursenator), une fonction avant tout honorifique, non assortie d’un quelconque pouvoir dans la scène culturelle de l’Etat national-socialiste, plurielle et divisée en factions antagonistes. Toutefois, ces positions de natures académique ou politique nous permettent de douter du rôle de « résistant » que Dwinger s’était donné après 1945. Dans la procédure de dénazification qu’il a subie, ses juges lui ont toutefois accordé « un grand courage à plusieurs reprises » ; il aurait été « jusqu’au bout du possible ».
Après la seconde guerre mondiale, Dwinger a connu encore une fois le succès littéraire, avec son livre « Wenn die Dämme brechen » (= Lorsque les barrages cèdent), paru en 1950, où il décrit l’effondrement de la Prusse orientale. Le 17 décembre 1981, Dwinger meurt ; avec lui disparaît un écrivain allemand qui a incarné, comme aucun autre, les liens tragiques entre l’Allemagne et la Russie. Certes, il serait bien trop simple de décrire Dwinger comme le contraire de Remarque, de la réduire à une sorte d’anti-Remarque. Mais sans le succès mondial de Remarque, avec « A l’Ouest rien de nouveau », et sans le rejet unanime de ce livre par le camp nationaliste sous Weimar, les ouvrages de Dwinger n’auraient pas connu le succès qu’ils ont eu.
Ulli BAUMGARTEN.
(texte issu de Junge Freiheit, n°23/1999).
00:20 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 janvier 2008
Menno ter Braak

26 janvier 1902: Naissance à Eibergen aux Pays-Bas du critique et philosophe néerlandais Menno ter Braak. Nietzschéen de pure eau, Menno ter Braak va systématiquement s’attaquer aux préciosités incrustées dans la littérature, en se montrant souvent brusque et cassant. Cette activité d’arracheur de masques et de fioritures lexicales lui vaudra le surnom de “Conscience de la littérature hollandaise”. Fondateur du magazine littéraire Forum en 1931, il mènera une guerre sans pitié contre l’esthétisme ampoulé qui alourdit, à ses yeux, la littérature néerlandaise depuis les années 1880. Deux critères seulement trouvent grâce à ses yeux : l’intégrité et l’originalité. Il exprime le fondement de sa pensée dans Het carnaval der burgers (= Le carnaval des bourgeois), publié en 1930. Son nietzschéisme le conduit à haïr les gesticulations politiques et les dogmes idéologiques et religieux (cf. Politicus zonder partij ; = Homme politique sans parti). Son horreur des mouvements de masse le conduit à se suicider peu après l’entrée des troupes allemandes aux Pays-Bas en mai 1940.
00:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Traité de Karlowitz

Le Traité de Karlowitz
26 janvier 1699 : Les Ottomans signent le Traité de Karlowitz qui sanctionne les victoires d’Eugène de Savoie. Après que les Polonais du Roi Jean Sobieski aient dégagé Vienne, le 12 septembre 1683, qui avaient été assiégée par les Ottomans depuis le 13 juillet, la victoire change de camp. Les Européens reprennent du poil de la bête et passent à la contre-offensive. La guerre durera en fait jusqu’en 1699. L’Europe constitue la Sainte Ligue (Autriche, Pologne, Venise, Russie), instrument de sa contre-attaque. En 1686, le Duc Charles de Lorraine écrase les Turcs à Mohacz, vengeant ainsi la défaite, au même endroit, des Hongrois en 1526. Les Autrichiens libèrent Budapest. La libération de la Croatie peut commencer. La lutte sera dure. Sous l’impulsion du vizir Mustafa Köprölü, un Albanais converti, les Ottomans résistent et relancent une offensive en direction de la Save et du Danube en 1690, aidé par des Hongrois renégats, regroupés autour du vassal ottoman Tekely (Tököly). Le Vizir mourra au combat et son successeur Mustafa II, après quelques succès initiaux, subit revers sur revers : le 11 septembre 1697, ses armées sont écrasées par les Autrichiens à Zenta (Senta) dans la Voïvodine actuelle. La Croatie, la Hongrie et la Transylvanie sont libérées définitivement : plus aucun janissaire ou auxiliaire tatar n’y mettra les pieds ou les sabots de sa monture. Les Turcs ne respecteront pas le traité : ils reprendront les hostilités en 1715-1716 mais subiront de terribles défaites, notamment à Petrovaradin le 5 août 1716. Ils perdront Timisoara (Temesvar/Temeschburg) et Belgrade (enlevée par des soldats hutois). Le Traité de Passarovitz du 21 juillet 1718 les obligent à rendre le Banat, la Valachie occidentale et la Serbie septentrionale. Les Turcs vont alors aller affronter les Perses dans une guerre de treize ans (1723-1736). Les Autrichiens en profiteront pour tenter de reprendre la Bosnie et libérer la Bulgarie, mais se heurteront à une résistance inattendue, appuyée en secret par la France, qui joue là sa toute dernière carte pro-ottomane ; après la défaite autrichienne de Gratzker, les territoires récupérés par le Traité de Passarovitz redeviendront turcs (en vertu du Traité de Belgrade du 18 septembre 1739). Les Serbes croupiront encore longtemps sous le joug ottoman et accusent les Autrichiens de les avoir laissé tomber. Les enjeux des trois traités (Karlowitz, Passarovitz et Belgrade) nous permettent de comprendre le fond des affaires balkaniques, y compris celles de la dernière décennie du 20ième siècle. Des pages d’histoire à méditer.
Source : Jean-Paul Roux, « Un choc de religions – La longue guerre de l’islam et de la chrétienté – 622/2007 », Fayard, 2007.
00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Sur Herbert Marcuse
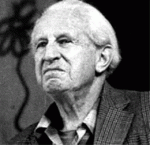
Werner Olles:
Herbert Marcuse, philosophe néo-marxiste de mai 68
Il y a tout juste vingt ans mourrait Herbert Marcuse, le penseur utopiste de la Nouvelle Gauche soixante-huitarde. Werner Olles, ancien agitateur des barricades allemandes à la fin des années 60, fait le point et rappelle l’engouement de sa génération pour Eros et la civilisation et L’Homme unidimensionnel.
Marcuse nous disait : « Je pense qu’il existe pour les minorités opprimées et dominées un droit naturel à la résistance, à utiliser des moyens extra-légaux dès que les moyens légaux s’avèrent insuffisants. La loi et l’ordre sont toujours et partout la loi et l’ordre de ceux que protègent les hiérarchies établies. Il me paraît insensé d’en appeler à l’autorité absolue de cette loi et de cet ordre face à ceux qui souffrent sous cette loi et cet ordre et les combattent, non pas pour en tirer des avantages personnels ou pour assouvir une vengeance personnelle, mais tout simplement parce qu’ils veulent être des hommes. Il n’y a pas d’autre juge au-dessus d’eux sauf les autorités établies, la police et leur propre conscience. Lorsqu’ils font usage de la violence, ils n’amorcent pas un nouvel enchaînement d’actes violents, mais brisent les institutions établies. Comme on pourra les frapper, ils connaissent les risques qu’ils prennent, et quand ils ont la volonté de se révolter, aucun tiers n’est en droit de leur prêcher la modération, encore moins les éducateurs et les intellectuels ».
Ces quelques phrases sur la « tolérance répressive », tirées de sa « Critique de la tolérance pure » ont eu un impact considérable et durable sur le mouvement étudiant de 1968. Dès mai 1966, Herbert Marcuse, professeur de philosophie sociale à l’Université de Californie à San Diego, avait prononcé la conférence principale lors d’un congrès sur la guerre du Vietnam tenu à l’Université de Francfort à l’invitation du SDS (le mouvement des étudiants gauchistes allemands de l’époque). Devant 2200 personnes, Marcuse constatait que « toutes les dimensions de l’existence humaine, qu’elles soient privées ou publiques étaient livrées aux forces sociales dominantes » et que le système ne connaissait plus aucun « facteurs extérieurs ». « La politique intérieure, dont la continuation est la politique extérieure, mobilise et contrôle l’intériorité de l’homme, sa structure pulsionnelle, sa pensée et ses sentiments ; elle contrôle la spontanéité elle-même et, corollaire de cette nature globale et totale du système, l’opposition n’est plus d’abord politique, idéologique, socialiste (…). Ce qui domine, c’est le refus spontané de la jeunesse d’opposition de participer, de jouer le jeu, c’est son dégoût pour le style de vie de la « société du superflu » (…). Seule cette négation pourra s’articuler, seul cet élément négatif sera la base de la solidarité et non pas son but : il est la négation de la négativité totale qui compénètre la « société du superflu ».
Dutschke défendait l’attitude de l’intellectuel
En juillet 1967, Marcuse, devant 3000 personnes entassées dans les auditoires bourrés de la Freie Universität de Berlin-Ouest, prononçait sa série de conférences en quatre volets, « La fin de l’Utopie ». Sans cesse interrompu par les applaudissements des étudiants, le penseur dissident du néo-marxisme explicitait une fois de plus ses positions sur le « problème de la violence dans l’opposition ». Lors de la troisième soirée, une discussion a eu lieu sous la direction du philosophe et théologien Jacob Taubes : y participaient plusieurs membres du SDS, dont Hans-Jürgen Krahl, Rudi Dutschke, Peter Furth et Wolfgang Lefèvre, ainsi que les professeur d’université sociaux-démocrates Richard Löwenthal et Alexander Schwan. Ils engagèrent tous un débat avec Marcuse sur le thème : « Morale et politique dans la société d’abondance ». Lors de la quatrième soirée, Marcuse, Dutschke, Peter Gäng, Bahman Nirumand et Klaus Meschkat ont discuté du « Vietnam : le tiers-monde et l’opposition dans les métropoles ». Ce fut surtout Marcuse qui tenta de donner une explication de cette question en parlant du rôle que pouvaient jouer les intellectuels dans le processus d’éclosion et de consolidation des mouvements de libération dans les métropoles. Pour Marcuse, le rôle des intellectuels consiste à éclairer les masses en révolte en « reliant la théorie et la pratique politique ». Il proclama également la constitution « d’une anti-politique dirigée contre la politique dominante ».
Mais un an plus tard, toujours dans le grand auditoire de l’Université Libre de Berlin, il essuie le refus concentré des étudiants, lorsqu’il prononce sa conférence sur « l’histoire, la transcendance et la mutation sociale » ; il dit clairement aux activistes de la Nouvelle Gauche qu’il ne songe nullement à donner sans détour des conseils pour organiser la révolution ni a y participer. Plus tard, Rudi Dutschke a dit qu’il comprenait l’attitude de Marcuse à l’époque. Il l’a défendu âprement face aux critiques acerbes des étudiants les plus radicaux qui voulaient infléchir le processus révolutionnaire dans une seule dimension, celle, exagérée, de la guerre civile.
Herbert Marcuse, mélange génial de Marxe, Freud et Isaïe, penseur éclectique, subjectiviste et néo-marxiste, figure du père dans la révolution culturelle de 68, est né le 19 juillet 1898 dans une famille de la grande bourgeoisie juive de Berlin. Devenu membre de la SPD sociale-démocrate, il appartenait aux courants vitalistes des jeunes socialistes, proche du mouvement de jeunesse. Après l’assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, il quitte la SPD et adhère à l’USPD (les socialistes indépendants plus radicaux et révolutionnaires). En 1918, il est membre d’un conseil de soldat à Berlin-Reinickendorf. Ensuite, il s’en va étudier à Berlin et à Fribourg, où il passe son doctorat en rédigeant une thèse sur Schiller. A Fribourg, il a été pendant un certain temps l’assistant de Heidegger. Mais les éléments nettement conservateurs de la pensée de Marcuse ne lui viennent pas directement de Heidegger mais d’une lecture très attentive de Hans Freyer, dont l’ouvrage Theorie des gegenwärtigen Zeitalters (= Théorie du temps présent) a fortement imprégné les thèses exposées plus tard dans L’Homme unidimensionnel. Pedro Domo démontre dans Herrschaft und Geschichte. Zur Gesellschaftstheorie Freyers und Marcuses (= Domination et histoire. A propos de la théorie de la société chez Freyer et Marcuse) que l’influence de Freyer s’est exercée sur Marcuse tout au long de sa vie. Même affirmation chez un autre analyste, Wolfgang Trautmann (in : Gegenwart und Zukunft der Industriegesellschaft. Ein Vergleich der soziologischen Theorien Hans Freyers und Herbert Marcuses ; = Présent et avenir de la société industrielle. Comparaison des théories sociologiques de Hans Freyer et de Herbert Marcuse). A cette influence de Freyer dans la composante conservatrice de Marcuse, il faut ajouter le véritable culte qu’il vouait à Schiller, héritage de la vénération que lui vouait le mouvement de jeunesse socialiste au tournant du siècle. Ce culte de Schiller a très vraisemblablement entraîné le mépris quasi féodal de Marcuse pour les sciences, la technique et la démocratie. Kolakowski l’a d’ailleurs décrit comme « le prophète d’un anarchisme romantique sous une forme hyper-irrationnelle ».
En effet, Marcuse propageait un « socialisme des oisifs ». Dans leur recherche d’un sujet révolutionnaire après la fin du marxisme et du progrès, les intellectuels de la classe moyenne aisée et les franges politisées du Lumpenproletariat ont fini par rencontrer cet idéologue de l’obscurantisme, qui constituait une symbiose entre Marx et Freud. En bout de piste, cela a donné l’utopie de la Nouvelle Gauche. Marcuse interprétait toutefois Marx à l’aide de critères pré-marxistes ; il voyait en lui un sociologue et non un économiste scientifique. Ensuite, il voyait en Freud un « adepte sceptique des Lumières ». Ce mélange a produit finalement cette idéologie de 68, caractérisée par le non sérieux relatif de la vie de l’éternel étudiant.
Cohn-Bendit a diffamé Marcuse en l’accusant d’être un agent de la CIA
Herbert Marcuse a quitté l’Allemagne sous la République de Weimar, en 1932, quand les nationaux-socialistes n’avaient pas encore pris le pouvoir. Il émigre aux Etats-Unis. Il y devint conseiller en guerre psychologique à l’Office of Strategic Services (OSS), une organisation militaire qui a préfiguré la CIA. C’est de cette époque que datent les études que l’on appelle « analyse de l’ennemi ». Le passé de Marcuse à l’OSS a induit Daniel Cohn-Bendit, un jour, à diffamer Marcuse, qu’il a accusé à Rome d’être un agent de la CIA, ce qui est objectivement faux.
Plus tard, Marcuse a enseigné la philosophie à l’Université d’Etat en Californie à San Diego. En ce temps-là, il vivait à La Jolla en Californie. A l’âge de 81 ans, le 29 juillet 1979, il meurt à Starnberg en Allemagne, à la suite d’une thrombose. Aujourd’hui, notre intention ne saurait être de récupérer et de redécouvrir Marcuse dans un sens « conservateur-révolutionnaire ». La pensée de ce néo-marxiste a été beaucoup trop influencée par la mystification de la révolution mondiale, même s’il ne plaçait plus aucun espoir dans la classe ouvrière, mais, au contraire, dans les groupes marginalisés de la société, refusant toujours davantage le système.
Ensuite, autre volet de la pensée de Marcuse : il concevait la « société technologique » de plus en plus comme un moyen d’asservir le prolétariat ; celui-ci était de toute façon lié au système capitaliste de la satisfaction et de l’élargissement des besoins. Dans un tel contexte, la position du prolétariat est purement défensive. L’économie, pour Marcuse, est toujours une économie politique qui ne produit jamais une « économie psychologique ». L’économie dominante gère les besoins que réclame le système, jusqu’aux pulsions les plus élémentaires.
Puisque le capitalisme a absorbé le « potentiel révolutionnaire » et que l’ère révolutionnaire du prolétariat est définitivement passée, n’explique pas pourquoi la « théorie critique » et la « praxis politique » n’ont pas coïncidé partout. Pourtant Marcuse voyait dans l’indépendance nationale un facteur positif. Il soutenait la guérilla nationale-communiste au Vietnam, corollaire de sa définition des Etats-Unis comme « héritiers historiques du fascisme ». Aucun immigrant n’avait formulé auparavant une critique aussi acerbe contre la politique américaine. Mais Marcuse n’avalisait pas pour autant la politique soviétique, qui convergeait de plus en plus avec celle des Etats-Unis. Il la qualifia un jour de « honteuse », ce qui lui a valu la haine tenace des gauches fidèles à Moscou. Il était cependant assez réaliste pour reconnaître que la Nouvelle Gauche n’allait jamais devenir un mouvement de masse. Raison pour laquelle il a limité sa thématique aux perspectives pluri-dimensionnelles de la théorie dialectique, visant la suppression de la « société d’abondance », le prise de conscience psychologique et sensitive de la répression dans les métropoles occidentales et de l’oppression flagrante et impérialiste des peuples du tiers-monde.
Par ailleurs, Marcuse prônait l’instauration d’un « pré-censure », qu’il nommait avec euphémisme un « idéal platonicien », et une dictature provisoire de la gauche, qu’il baptisait « éducation » (Erziehung), et qui devait préparer l’avènement d’une « société humaine ». Dans l’existence qui attendait les hommes au sein de cette « société humaine », le rois-philosophes d’inspiration platonicienne devaient veiller sans discontinuité à ce qu’il n’y ait plus jamais de guerre, de cruauté, d’agressivité, de stupidité, de brutalité et de racisme. Dès que cette hydre à têtes multiples se manifestait, les rois-philosophes devaient intervenir et sévir. Ainsi, l’utopie deviendrait possible, elle serait une société véritablement libre. Cette vision marcusienne contredit toutefois à terme son idéal libertaire d’inspiration nietzschéenne, héritée du mouvement de jeunesse. La “pré-censure” et l’“éducation” indiquent une contradiction majeure dans cette pensée subversive de gauche.
Max Horkheimer a reproché à Marcuse de se retrancher derrière le concept « d’homme nouveau ». Horkheimer s’insurgeait avec véhémence contre la domination du principe de plaisir et contre l’idée naïve qu’une société de masse puisse vivre sans aucune contrainte. De la pensée de Marcuse, il restera donc cette dénonciation de la rationalité technologique comme expression de l’arbitraire, tendant vers le totalitarisme. Sa thèse disant que « la technologie livre la grande rationalisation pour la non-liberté de l’homme » est restée actuelle et réelle. Elle exprime clairement les sentiments d’un philosophe qui a vécu et pensé la crise de l’existence humaine comme une crise de la philosophie. Restent également sa critique de la « société unidimensionnelle », de la liberté illusoire (qui risque de chavirer dans « le déluge de scepticisme »). Unidimensionnalité et liberté illusoire ont conduit à des quiproquos philosophiques terribles dont souffrent encore nos sociétés de masses modernes.
Le « grand refus » de Marcuse
Le « grand refus » de Marcuse n’offrait toutefois pas de contre-modèle concret à l’unidimensionnalité du capitalisme tardif. Il n’a pas été capable de générer une conception de la vie, un « oikos » alternatif, susceptible d’offrir à l’individu un éventail de possibilités afin d’échapper ou de résister à « la destruction totale et incessante des besoins de l’homme dans la conscience même de l’homme » (Hans-Jürgen Krahl). Telle a bien été la plus grande faiblesse de cet éclectique qui n’a pas pu se corriger, même dans la lutte collective pour l’émancipation menée par la Nouvelle Gauche (pour laquelle Marcuse a toujours témoigné sa sympathie). La raison de cet enlisement provient de ce que les contradictions quotidiennes du système capitaliste tardif ne se reflètent plus dans la conscience des masses. La subtilité des rapports de domination finit par conditionner la psychologie même des hommes.
Ainsi, la répression assortie de l’accord tacite entre le facteur subjectif et le maintien tel quel de la réalité de classe, dans un système de pouvoir très complexe, anonyme et technocratique, a conduit à l’échec du mouvement de 68.
Werner OLLES.
(texte issu de Junge Freiheit, n°31-32/1999).
00:05 Publié dans Philosophie, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 janvier 2008
Léon IV le Khazar

25 janvier 749, naissance du Basileus byzantin Léon IV le Khazar. Il doit son nom à l’origine khazar de sa mère, fils du Khan de ce peuple d’Asie centrale qui avait envahi l’Ukraine. Il oscilla entre icônophobie et icônophilie tout au long de son règne, mais ne changea rien, fondamentalement, à la politique anti-icônes de son père. Sur le plan militaire, il fut celui qui forgea une alliance avec les Bulgares du Khan Telerig et qui conduisit trois campagnes pour repousser les Arabes auxquels il infligea deux défaites retentissantes à Germanicia en Cilicie en 778 et l’autre dans le thème des Arméniaques en 780. La même année, il meurt à 30 ans de la maladie du charbon, ce qui met abruptement fin à un règne qui s’annonçait glorieux, où Byzance aurait pu reprendre l’offensive en direction de la Syrie et de la Palestine.
00:30 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Joseph Görres

25 janvier 1776, naissance à Coblence en Rhénanie du philosophe Joseph Görres.
Au début de sa grande carrière de penseur politique et de théologien, il montre un enthousiasme pour la révolution française et pour le “Club des Jacobins” qui sévit dans sa ville natale, bientôt annexée à la “République”. Il part à Paris pour plaider cette annexion de la Rhénanie mais revient dégoûté des mœurs politiques parisiennes.
Görres avait imaginé que la révolution allait avoir un effet bénéfique sur le plan éthique. Elle n’a généré pourtant que corruption et déni de droit et de justice. Pendant la première décennie du 19ième siècle, il se retire, entièrement désillusionné, de la politique et s’adonne aux études philosophiques, pour découvrir la “Naturphilosophie” de Schelling, le renouveau romantique allemand et la pensée mystique médiévale, ce qui l’amène, tout naturellement, à rejeter les principes secs et froids de la pseudo-pensée des “Lumières”.
Dès 1814, il fonde le journal “Rheinischer Merkur”, autour duquel se forme un club politique original, critique à l’endroit des folies révolutionnaires, mais non adepte de la restauration pure et simple. Au nom d’une pensée romantique, organique et mystique, il critique sévèrement cette volonté arbitraire de restauration. Son journal est interdit et il est contraint à l’exil, en Suisse et en Alsace.
Rappelé par le roi de Bavière à Munich, pour une fonction d’enseignant, il y approfondit ses études sur la mystique et sur l’œuvre de Saint François d’Assise. La vie de Görres est donc un itinéraire intéressant, dans la mesure où il prouve que les philosophades des Lumières ne valent que ce qu’elles valent, c’est-à-dire pas grand chose sinon rien, et que le recours à l’essence de l’Europe passe par une redécouverte du patrimoine mystique. Pour en savoir plus, cf.: www.bautz.de
00:25 Publié dans Histoire, Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pu Yi sur le trône impérial chinois

Le jeune Prince Pu Yi sur le trône impérial de Chine
25 janvier 1900 : Le jeune Prince Pu Yi, âgé de neuf ans, est installé sur le trône impérial de Chine. Il sera le « dernier Empereur ». Onze ans plus tard, Sun Yatsen proclame la république, isole le jeune prince dans la Cité interdite. Il ne retrouvera un rôle politique que sur le trône du Mandchoukouo, un Etat situé sur le territoire de la Mandchourie et dirigé par les Japonais qui voient en lui une réserve de matières premières et un tremplin pour une expansion continentale en direction de la Mongolie et du Sud de la Chine (Nankin). Ce projet continental du Japon heurtait les intérêts russes et constitua, dès la première décennie du 20ième siècle, l’un des motifs de la guerre russo-japonaise de 1905. Pendant la seconde guerre mondiale, le Japon opta plutôt pour une expansion vers la Chine du Sud et vers le Pacifique : ce qui explique, d’une part, la neutralité soviétique à son égard, du moins jusqu’aux dernières semaines de la guerre et, d’autre part, la grande guerre navale et aéronavale entre l’Empire du Soleil Levant et les Etats-Unis, qui entendaient garder le Pacifique et le marché chinois potentiel comme leur propre chasse gardée. Pu Yi fut capturé par les Soviétiques lors de l’invasion de la Mandchourie en 1945, que Staline comptait annexer à l’URSS ; il sera livré aux maoïstes qui le rééduqueront et feront de lui un simple jardinier. Un film exceptionnel a été consacré à sa tragique et poignante existence ; il porte le titre : « Le dernier Empereur ». A voir et à revoir.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 24 janvier 2008
J. de Pange, fédéraliste européen

Colloque de "Synergies Européennes"-France, Château de Pange/Lorraine, 26 septembre 1998,
Intervention de Laurent SCHANG
Le Comte Jean de Pange, défenseur du régionalisme et théoricien du fédéralisme européen
"C'est alors que Jean de Pange revint sur une de ses thèses favorites qui, bien plus tard, devait devenir réalité; le rôle de la Lorraine dans la restructuration de l'Europe. Alors que personne ne pouvait encore prévoir l'action qu'exercerait un jour Robert Schuman, Jean de Pange pressentait déjà, avec la vision prophétique qui est le propre des grands historiens et littérateurs, que ce serait de la Lorraine que partirait le renouveau d'un continent, cette réunion des Francs de l'Est et de l'Ouest, sans laquelle notre monde, inévitablement, serait voué au suicide (...) L'action politique de Robert Schuman eût été difficilement réalisable si des penseurs n'avaient pas préparé sa voie. Parmi ceux-ci, Jean de Pange occupe une place d'honneur".
L'hommage rendu en quelques mots choisis à la mémoire du comte de Pange est de l'archiduc Othon de Habsbourg, préfacier de l'ouvrage L'Auguste Maison de Lorraine, paru en 1996, neuf ans après la disparition de Jean de Pange. Vibrant et élogieux, ce témoignage, provenant d'une aussi auguste personne que l'actuel héritier de la double couronne et représentant de la prestigieuse famille Habsbourg-Lorraine, reflète quelle autorité intellectuelle et spirituelle put être Jean de Pange durant l'entre-deux-guerres. Si bien qu'à défaut de revêtir le titre de père de l'Europe, tout du moins ses biographes peuvent-ils lui appliquer, aux côtés de Richard Coudenhove-Kalergi et Denis de Rougemont, celui de "parrain" de l'Union Européenne. Et le relatif anonymat dont recouvre aujourd'hui notre époque ingrate l'œuvre pourtant dense et abondante de Jean de Pange ne saurait faire oublier combien prégnante fut son action auprès des milieux intellectuels progressistes en faveur des Etats-Unis d'Europe.
Du traité de Versailles au traité de Munich, ce sont vingt ans de militantisme au service de l'idéal supranational et fédéraliste, éternelle Cassandre au milieu des égoïsmes nationalistes et des prétentions utopistes de la Société des Nations.
Un ardent militant de la réconciliation franco-allemande
Fils, petit-fils et arrière petit-fils de lorrains, de ses racines découle son engagement. Jean de Pange fut un ardent militant de la réconciliation franco-allemande : nul n'est plus conscient que lui de la mission historique qui incombe à la Lorraine. "Prophète du passé et prophète de l'avenir" selon l'heureuse formule de Jean Guitton, nourri de culture aristocratique, catholique, cosmopolite et viennoise, la pensée de Jean de Pange est un fil tendu par delà les générations et les distances entre son patriotisme lotharingien et sa fidélité pour la famille des Habsbourg-Lorraine. Une dynastie gardienne de l'idéal indépassable d'un ordre supranational européen qu'il conçoit comme rayonnement spirituel.
Dans son livre-testament, Les Meules de Dieu, il écrit: "L'Empire autrichien, par sa constitution même, était incompatible avec le principe des nationalités. Aucune des nationalités qui le composaient n'était assez forte pour dominer les autres, et toutes n'étaient reliées entre elles que par le loyalisme dynastique, par la fidélité au prince lorrain qui était devenu empereur". Témoin de la haine vouée aux Habsbourg par la République Française, il ne lui pardonnera jamais d'avoir aveuglément démantelé par pur souci idéologique le pôle de stabilité du continent, libérant en Europe Centrale toutes les passions nationalistes qui de la première guerre civile européenne allait provoquer la seconde, et toutes ses conséquences désastreuses. Marqué par l'écartèlement de l'Alsace-Lorraine entre la France et l'Allemagne, meurtri par la chute de la famille impériale d'Autriche, Jean de Pange décèle parmi les premiers la nocivité du nationalisme jacobin, géniteur monstrueux des pseudo-empires napoléonien et bismarckien.
Fin connaisseur de l'histoire européenne, habitué dès l'enfance à penser à l'échelle continentale, il développe, à partir de 1918, une œuvre dont il forme le projet ambitieux qu'elle sera, sinon le moteur, le ferment d'une réflexion nouvelle sur le principe impérial, fondée sur sa double relation aux espaces rhénan et danubien, et dépassement des nationalismes belliqueux pour une fédération nouvelle des peuples européens de l'Atlantique à l'Oural. Epicentre successif de l'Austrasie, de la Lotharingie, de la Bourgogne, foyer d'une double culture unique puisée aux sources de la rencontre germano-latine et transportée jusqu'à Vienne au cœur de la Mitteleuropa, la Lorraine trouve sa vocation, libérée du carcan des frontières: "L'Alsace-Lorraine ne doit-elle pas nous aider à élargir notre nationalisme, à nous élever jusqu'à l'esprit européen? Pour cela, il faut lui laisser la pleine conscience d'elle-même". Homme de contemplation, ancré dans son présent, fidèle au passé mais aussi penseur pour l'avenir, Jean de Pange se veut acteur engagé dans le devenir du continent, qu'il veut riche de sa pluralité, et fort de son unité transcendante. Pareil idéal, de surcroît servi par une plume de belle qualité, ne pouvait que lui susciter, comme à tout visionnaire, au moins autant d'inimitiés que de sympathies. Car pour oser affirmer, en plein choc des nationalismes, que l'Europe ne fut jamais aussi grande que frappée du sceau impérial, la chute du second précipitant le déclin de la première, il fallait être mû d'une foi et d'un optimisme qui aujourd'hui encore forcent le respect, à moins de cent jours de l'entrée dans l'Union Monétaire Européenne.
Une éducation européenne
Le château de Pange étend sa majestueuse silhouette de pierre le long de la Nied française, sur une terre à mi-parcours de la place de Metz et de la frontière allemande. Le sol sur lequel reposent ses fondations a vu défiler les premières tribus celtiques, les légions romaines montant vers le limes, les peuplades germaniques, les armées des rois de France et du Saint Empire Romain Germanique, les bandes de reîtres croates, suédois, espagnols. Vassaux des ducs de Lorraine, les seigneurs du lieu ont, des siècles durant, tourné leur regard vers Vienne avant de reconnaître la suzeraineté versaillaise sur leur domaine. Plate-forme de rencontre et d'enrichissement mutuel des peuples d'Europe de part et d'autre du Rhin du haut Moyen-Age à la Renaissance, le poids de l'histoire a également assigné à la Lorraine la lourde charge de figurer la ligne de fracture entre deux blocs hostiles issus du réveil des nationalismes, la France, royaume puis république, et l'Allemagne, monarchique à Vienne, impériale à Berlin.
Du traité de Verdun en 843, qui marque l'éclatement de l'Empire de Charlemagne et brise le rêve européen de la République Chrétienne, au traité de Francfort en 1871, qui lie pour 47 ans le sort de l'Alsace-Lorraine à celui de la Prusse, et dont découlera en droite ligne le suicide de 14-18 et le traité de Versailles, c'est toute l'histoire de l'Europe qui se joue en Lorraine sur plus d'un millénaire.
L'étroitesse des liens entretenus par l'histoire de Lorraine avec le destin de l'Europe, le jeune Jean de Pange la ressent avec d'autant plus d'acuité qu'il est lui-même descendant d'une vieille famille du pays, anoblie au XVIIIème siècle par Stanislas Leczinsky, duc de Lorraine et de Bar. Fils cadet, Jean de Pange ne sera jamais propriétaire de la résidence familiale, ce qui ne l'empêchera pas d'en faire le point de départ de toute sa réflexion politique.
Né à Paris en 1888 parmi les émigrés de 1871, la mutation de son père, capitaine d'artillerie, à Vienne en tant qu'attaché militaire, lui fait entrevoir les délices de l'empire danubien, cependant qu'il prend conscience de la parenté austro-lorraine. L'Empereur François-Joseph lui apparaît d'abord comme le dernier duc de Lorraine. Sur les pentes du Kahlenberg, l'enfant rêveur revit ce jour de septembre 1683 où le duc Charles de Lorraine et ses armées bousculèrent les Turcs du Grand Vizir Kara Mustapha et libérèrent Vienne assiégée, sauvant l'Empire et l'Europe du joug ottoman. Un Empire dont son petit-fils François devait hériter en épousant Marie-Thérèse, scellant la destinée des Habsbourg-Lorraine, pour le meilleur de l'Europe.
Du Traité de Westphalie à la frontière rigide sur le Rhin
De retour en France, après avoir ambitionné une carrière militaire, Jean de Pange décide, par goût pour l'histoire médiévale, de suivre les cours de l'Ecole des Chartes, et consacre sa thèse au duc Ferri III de Lorraine, contemporain des rois de France Louis IX et Philippe le Bel. Baignant dans le milieu revanchard parisien, la lecture de la brochure de son professeur Lavisse, intitulée La question d'Alsace dans une âme alsacienne, l'incite à étudier plus en détail la politique de Richelieu sur les pays rhénans. Plus que l'acte d'annexion des régions de Lorraine et d'Alsace au royaume de France, le traité de Westphalie lui apparaît, à rebours des historiens de son temps, comme le révélateur de la mission historique des "marches de l'Est".
"Contrairement à l'opinion courue, encouragée par les historiens allemands, écrit-il dans Les meules de Dieu, Richelieu n'a jamais eu l'intention d'annexer l'Alsace". Ayant préservé toutes leurs libertés au terme du traité de Reuil signé par Louis XIV en 1653, les nouvelles provinces ne constituent pas une fin en soi pour la monarchie mais ouvrent les voies de la pénétration politique, intellectuelle, économique et artistique dans le corps germanique. Le Rhin ne deviendra frontière rigide qu'avec la Révolution Française et son cortège d'idéologie nationaliste, anticléricale et expansionniste, ouvrant à son tour la voie dans les guerres napoléoniennes au pangermanisme qui conduira finalement l'Europe vers les deux cataclysmes du XXème siècle.
Lorrain de sang, Français de nationalité et Habsbourgeois de cœur, l'annexion de la Lorraine l'amène à s'interroger sur le concept de patrie: "N'oublions pas que la Lorraine est avant tout une patrie spirituelle. Il serait impossible de lui assigner des limites géographiques, ni une capitale. En effet, d'où la Lorraine —c'est-à-dire la Lotharingie— tire-t-elle son nom? Ce n'est pas, comme la plupart de nos provinces, de la population qui l'habite. C'est d'un des arrière-petit-fils de Charlemagne, de Lothaire II, fils de l'Empereur Lothaire qui s'était fait attribuer pour sa part d'héritage une longue bande de territoire reliant Aix-la-Chapelle à Rome, la capitale politique à la capitale religieuse. Un génie inconscient traçait ainsi à la Lorraine son rôle: créer une zone intermédiaire entre le monde roman et le monde germanique, où les deux cultures pussent se pénétrer mutuellement en vue d'une collaboration féconde. Ainsi dès le règne de Lothaire, s'institue le régime de la "Fraternité" ou de la "Concorde", véritable Sainte Alliance où des princes issus du même sang se réunissent pour travailler ensemble au bien commun de leurs peuples. Cette grande tradition ne s'effaça jamais de la mémoire des souverains qui, des Pays-Bas à la Lombardie, avaient recueilli l'héritage de Lothaire".
Le mouvement lotharingiste
Son propos, résolument à contre-courant en un temps où la IIIème République pleure le martyr de sa chère Lorraine perdue, s'inscrit dans le sillon du phénomène lotharingiste. Apparu dans les années 1830, le lotharingisme place au centre de ses préoccupations l'histoire, insistant sur la longue tradition d'indépendance de la Lorraine, réunie à la France que depuis le XVIIIème siècle et riche de ses coutumes, de ses lois, de sa nombreuse noblesse. Le mouvement lotharingiste connaîtra son apogée en 1865 avec la parution du très moderne "projet de décentralisation", appelé aussi « Programme de Nancy », mais en proie à l'hostilité de l'administration et des ligues nationalistes, il ne survivra pas au siècle et s'étiolera dans l'indifférence générale. Imprégné des lectures du prince de la jeunesse, son compatriote lorrain Maurice Barrès, Jean de Pange mêle son volontarisme d'un déterminisme raisonné, plus retenu que celui prodigué par l'auteur des Déracinés: "L'obligation de s'attacher à la terre est très vivante en Lorraine, se confondant avec le culte des morts, qui est l'expression la plus profonde de l'âme lorraine. La thèse des Déracinés de Barrès est qu'il faut respecter la croissance ininterrompue par laquelle les organes s'adaptent à leurs nouvelles fonctions: "Ne jamais détruire, continuer" (...) Oui, la race de Lorraine est accoutumée à mourir en témoignage de sa foi. Elle croit à la justice immanente, au ressort caché qui, tôt ou tard, rétablit l'équilibre rompu par la violence. Comme Antigone, elle ne pense pas que les décrets d'un mortel aient assez de force pour prévaloir sur les lois non écrites, toujours vivantes et dont nul ne connaît l'origine".
Il se distingue ainsi des théories positivistes de son maître, refusant selon son expression de faire des vivants les prisonniers des morts. Décelant déjà chez Barrès l'influence des romantiques allemands, Jean de Pange met en évidence les risques de subordination de la personne à sa race mythifiée, étouffant ses potentialités créatrices sous le poids d'un passé sclérosé. Une philosophie politique fondée sur le principe fallacieux de l'identité raciale et linguistique, Jean de Pange ne l'ignore pas, à l'origine du drame alsacien-lorrain. "Ainsi se développe peu à peu en moi, dès ma jeunesse, le sentiment que l'Etat est peu de chose, que notre lien avec lui est toujours révocable, que ce qui compte, c'est le clan, le petit groupe d'hommes liés entre eux par des attaches héréditaires et tenant au sol par la même racine nourricière".
Mobilisé en 1914
Foisonnante, sa pensée jeune mais déjà très sûre se heurte partout aux antagonismes idéologiques qui minent la paix en Europe. Pacifiste résolu, c'est sans surprise qu'il se retrouve mobilisé à l'été de 1914, lieutenant de réserve dans un régiment de cavalerie. Patriote lorrain, sa guerre sera celle du droit, jamais celle des peuples européens. Partout sur les champs de bataille, il traînera dans son paquetage un exemplaire du Faust de Goethe.
Poursuivant malgré tout ses prises de notes, son journal présente une singulière similitude avec ce que consigne dans le camp adverse son alter ego, Ernst Jünger: "Nous sommes condamnés à nourrir la guerre, qui, comme une hydre monstrueuse, est accroupie sur les nations. Il n'y a plus de Français, d'Anglais, d'Allemands, d'Italiens, il n'y a plus que des soldats. Dans tout l'Occident, les combattants ne forment plus qu'un peuple immense, qui a les mêmes mœurs, le même état d'esprit, qui ne vit plus que pour tuer, et qui, par-dessus les tranchées, se sent uni par la fraternité des armes et de la souffrance (...). Cependant il faut faire notre métier".
Versé dans les troupes d'assaut, il pénètre le 24 octobre à la tête d'une poignée d'hommes dans le fort de Douaumont qu'il reconquiert de haute lutte sur ses occupants allemands. Un fait d'armes vite éclipsé dans son esprit lorsqu'il apprend le 21 novembre 1916, consterné, la mort dans sa 86ème année de l'Empereur François-Joseph en son palais de Schoenbrunn. Le couronnement de son petit-neveu, Charles Ier, ravive en lui l'espoir d'une négociation de paix, rapidement démenti par l'intransigeance française. Entre une paix de compromis et la prolongation de la guerre, la République a tranché.
Pressentant la victoire finale des Alliés, il s'enquiert de l'état d'esprit des élus alsaciens et présage de l'impact qu'aurait la préservation de l'autonomisme alsacien sur les structures administratives françaises. "Strasbourg s'est habituée à être une capitale régionale; elle ne se résignera pas à être un chef-lieu de préfecture comme les autres, où l'on mènera une vie ennuyeuse et étriquée". La concrétisation des libertés régionales contenues dans le programme de Nancy lui paraît soudain envisageable, transporté par le besoin de renouveau inhérent à l'euphorie de chaque fin de guerre. D'autant plus que les régionalistes se découvrent en le Maréchal Lyautey un allié charismatique, tout auréolé de sa gloire coloniale.
La politique rhénane, nouveau Regnum Francorum
Parce que "c'est l'Alsace-Lorraine qui donne à cette guerre son sens. C'est pour elle que le monde doit saigner, jusqu'à l'épuisement et c'est par elle que nous devons nous renouveler", la restitution de l'Alsace-Lorraine implique aux yeux de Jean de Pange un rapprochement franco-allemand dont elle serait le centre. Le 11 novembre1918 s'annonce riche de promesses pour l'avenir. Mais la joie sera de courte durée. Sa guerre fut celle de la Lorraine contre la Prusse, militariste, autoritaire et bureaucratique, non celle contre l'Allemagne, la vraie, celle qu'il aime de toutes ses forces, intellectuelle, artistique, monde des libertés et des idées. Et moins encore contre l'Autriche-Hongrie. La signature du traité de Versailles, qui entérine le démantèlement de l'empire danubien, est, dans ces circonstances, vécu comme une déchirure, inaugurant pour lui le temps des désillusions. Ce sont désormais plusieurs Alsace-Lorraine qui recouvrent l'empire démembré, et autant de casus belli au cœur d'une Europe dont les vieilles puissances coloniales sont exsangues, l'Allemagne déchirée, humiliée mais invaincue, et la Russie des tsars mise à feu et à sang par la révolution bolchevique.
Mais pour l'heure, c'est la question de l'Alsace-Lorraine qui retient toute l'attention du capitaine démobilisé. Car là aussi la politique française s'avère désastreuse. Tandis que Au service de l'Allemagne, ouvrage de Maurice Barrès paru avant-guerre, avait ouvert Jean de Pange à la mission des provinces annexées, sa rencontre avec les élus autonomistes du Landtag de Strasbourg le confirme dans sa conviction que "c'est en développant toutes les virtualités de l'âme alsacienne et de l'âme lorraine que les deux provinces rempliront le mieux leur destinée". Le droit des petits pays à s'administrer eux-mêmes dans le cadre d'une République Française décentralisée, et intégrée au plan européen dans une plus vaste fédération des états, projet défendu par Aristide Briand à la Société des Nations, n'est-ce pas là la forme moderne de l'idée impériale? Il écrit: « Le grand drame des relations franco-allemandes et, on peut le dire, de l'histoire européenne, c'est que les Français, depuis 150 ans, ont oublié jusqu'au sens du mot fédéralisme. Pour eux, c'est "l'autonomisme" qu'ils confondent avec le séparatisme ». Or, "l'Alsace est la pierre de touche du régime, car elle nous invite à réformer à la fois notre politique intérieure et notre politique extérieure". Au lieu de quoi, Clémenceau puis Poincaré privilégient répression policière et réintégration brutale des populations locales, inconscients du crime qu'ils commettent, non seulement pour l'Alsace-Lorraine, mais pour l'Europe. Priver Strasbourg de sa vocation germanique, et de là européenne, c'est s'interdire toute coopération avec la nouvelle Allemagne. Sans se décontenancer, Jean de Pange prend contact avec le Maréchal Lyautey et s'engage totalement dans la promotion de la politique rhénane, qu'encourage en Allemagne le jeune Conrad Adenauer. A travers ce projet, c'est de la résurrection de la Lotharingie qu'il s'agit pour Jean de Pange, et plus loin de l'Europe fédérée sur son modèle.
Le Maréchal Lyautey
Véritable projet de civilisation, Jean de Pange entend gagner à lui les esprits les plus réticents par la peur de la menace soviétique, contre quoi il suggère de former un nouveau Kulturfront, un "front de la culture" de Cologne à Vienne par Munich, qui fortifierait les aspirations fédéralistes en Allemagne et Europe centrale resolidarisées. De là à recomposer l'ensemble impérial danubien, il n'y aurait qu'un pas vite franchi.
Lyautey, patriote lorrain lui aussi, incarne la figure idéale du chef de demain pour Jean de Pange, catholique bien sûr, européen convaincu, habile négociateur, persuasif mais l'esprit conciliant, autant "de qualités qui auraient pu lui permettre de jouer un grand rôle en Alsace, dans la Sarre et dans l'Europe d'après guerre, si elles n'avaient pas éveillé la méfiance des maîtres du jour". Suscitant l'appui de Barrès, il ne peut que constater son divorce d'avec l'écrivain, qui vient de publier le Génie du Rhin, et dont le nationalisme missionnaire refuse le principe rénovateur de l'humanisme rhénan. Les civilisations latine et germanique sont irréductiblement antagonistes, le Rhin est le fossé qui les sépare. Toute portée spirituelle, constate, amer, Jean de Pange, échappe au Génie du Rhin. Seule peut-être la voix de Barrès eût-elle pu infléchir la Chambre Bleu Horizon qui, de Paris, prend la résolution derrière Poincaré d'occuper la Ruhr, en sanction du retard dans les réparations de guerre. Mais en 1923 Barrès, vieilli, éreinté, se sait au bout de sa vie. En janvier, les troupes françaises pénètrent la rive gauche du Rhin, mettant brusquement fin à la politique rhénane de Jean de Pange.
Un jeune nationaliste allemand, Leo Schlageter, est fusillé, aussitôt récupéré par un agitateur d'origine autrichienne, Adolf Hitler. Le culte de Schlageter, héros de la résistance à l'occupation française, servira de tremplin à la NSDAP. Pour Jean de Pange, comme pour l'Europe, s'ouvre une ère nouvelle, celle des états totalitaires contre l'idée fédérale.
Une Fédération Européenne de Confédérations
Quand dix ans plus tard, l'ancien tribun bavarois accède à la chancellerie du Reich, Jean de Pange note dans son carnet: "Je me dis ce soir que l'Allemagne, avec sa révolution nationale, est en train de suivre le chemin où la France est entrée il y a 150 ans. Les mêmes causes auront les mêmes effets: nivellement des classes (les nazis s'en réjouissent comme autrefois les conventionnels), stérilisation de la culture et appauvrissement. Il est vrai que dans les premiers temps cette concentration des pouvoirs donne une force, un élan extraordinaire, mais au prix d'un épuisement rapide. La révolution égalitaire ouvre toujours la voie de la décadence". Depuis quinze ans que Jean de Pange œuvre à l'union d'une grande Europe fédérale, pacifique, supranationale, où l'Allemagne recouvrerait la place d'honneur qui lui revient dans le concert international, cette nomination sonne comme un aveu d'échec. Soudain semble renaître dans le IIIème Reich toutes les tares du second, démultipliées. L'Allemagne des masses, toujours plus à gauche dans sa politique intérieure, est toujours plus à droite en politique extérieure. L'Europe fédérale avait déjà un ennemi à ses portes, dans l'URSS stalinienne, elle en a maintenant un dans ses fondations, avec le IIIème Reich. Pour ne pas avoir saisi l'occasion de s'unifier au sortir du précédent conflit, les nations européennes, impuissantes, semblent prêtes à s'engouffrer dans un nouveau brasier.
L'étincelle qu'attend le régime hitlérien pour allumer son feu se produit en 1935, à l'occasion du plébiscite sarrois. Toutes les grandes idées qui ont mobilisé Jean de Pange depuis l'enfance sont en jeu dans ces élections dont le résultat décidera du sort de l'Europe. Hitler sait qu'une victoire aux élections légitimerait la poursuite de ses revendications sur l'Autriche, les Sudètes, la Pologne.
"Chacun sait que le sort de l'Autriche est lié à celui de la Sarre, et que la chute de Sarrebrück entraînera celle de Vienne". Et c'est non sans inquiétude que Jean de Pange note que les motifs des revendications de Hitler sur l'Autriche sont les mêmes que ceux de Bismarck sur l’Alsace-Lorraine: la parenté de langue et l'identité raciale. Mais un non massif au plébiscite, et tout le IIIème Reich s'effondre. Ironie du sort, l'aide, inespérée, viendra de France, en la personne du ministre des Affaires Etrangères Pierre Laval, qui poussera les Sarrois en faveur du oui. Sarrebrück, d'étymologiquement "Pont sur la Sarre" devient le tombeau du rêve fédéraliste.
Une république fédérale de modèle suisse
Publiant régulièrement des articles dans la presse catholique, Jean de Pange accentue sa participation et collabore à La Revue des Deux Mondes, Le Journal des Débats, Le Petit Parisien mais aussi Marianne et L'Aube. En Sarre, deux conceptions du monde se sont affrontées, celle de la dictature et celle de la Société des Nations. Cette dernière ayant été désavouée, Jean de Pange prend acte de sa caducité, "mot vide par la faute de ses auteurs (qui) ont voulu la réaliser sous la forme de l'universalisme, c'est-à-dire de l'égalité absolue entre tous les Etats de la planète". Mais face au nazisme, l'union doit faire la force: "Il ne faut associer que des Etats unis par l'identité des intérêts et la communauté des aspirations. L'Europe prend l'habitude de tourner autour de l'axe Paris-Londres. On veut donc commencer par une fédération franco-britannique sur laquelle d'autres prendront leur point d'appui". Sous la menace allemande, le chancelier Schussnigg réinvente la "monarchie sociale" et on s'attend d'ici peu à ce qu'il rappelle le jeune archiduc Othon de Habsbourg. Jean de Pange écrit: "Si on ne veut plus des Habsbourg-Lorraine, gardons au moins les nations de l'ancien empire en une république fédérale sur un modèle suisse: confédération danubienne ou Etats Unis d'Europe centrale".
L'idée d'une fédération de confédérations germe à nouveau dans quelques esprits dont Hermann Rauschning, Otto Strasser et Jean de Pange. Sur le modèle du Commonwealth, qui oppose le pouvoir légitime fondé sur l'équité et la vérité chrétienne à l'Etat totalitaire et plébiscitaire (Jean de Pange parlera de "Société des Nations consacrée"), des pourparlers s'engagent en vue d'une union de l'Autriche, de la Hongrie et de la Bohême. Mais la Tchécoslovaquie du président Bénès s'y oppose avec virulence et, plaidant sa cause à Londres, fait échouer l'entente. En 1916 déjà, le même Bénès avait publié une brochure, intitulée "Détruisez l'Autriche", où il réclamait l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne. Un désir concrétisé en 1938 mais que Hitler, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, étendra à la Tchécoslovaquie.
Bientôt l'Allemagne réclame le plébiscite sur Eupen, Malmédy et l'Alsace-Moselle. Jean de Pange poursuit ses activités au sein du Service National Autrichien installé à Paris et, en relation avec le Vatican, recueille les réfugiés d'Europe Centrale. La débâcle du 10 mai 1940 le prend de court cependant qu'il plaide pour une fédération franco-anglaise à laquelle s'ajouterait après-guerre la fédération danubienne et une Allemagne fédéralisée, non plus frédéricienne mais thérésienne (= de Marie-Thérèse). Juste avant d'être arrêté, prenant position pour le Général de Gaulle contre le Maréchal Pétain, pour l'idéal contre le sol, il a le temps de consigner dans son journal ces quelques mots: "Les Français ne croient plus à la fédération. C'est la cause de notre déclin".
Emprisonné dans les geôles gestapistes sous l'inculpation de "haute trahison" (Hochverrat), ce qui ne manque pas de l'étonner, Jean de Pange signe sa déclaration de cellule le 18 juin 1941, plutôt une profession de foi:
"Je déclare véritable en ma foi de gentilhomme:
1° Que les interrogatoires précédents ont clairement prouvé l'hostilité de mes idées et de mon activité à l'égard du national-socialisme (...) J'étais seulement un ami de l'ancienne Allemagne.
2° Mon but politique était la création d'une Confédération danubienne sous la direction de la maison de Habsbourg et par la suite la fédération de l'Allemagne sous la direction monarchique dans le cadre d'une Europe fédéralisée (...)
3° L'histoire prouve les avantages immanents de la fédération pour un peuple (...)"
Jean de Pange restera sous les verrous jusqu'à la fin de la guerre.
De l’Empire Médian à l’Europe de Strasbourg
Othon de Habsbourg, toujours en préface de L'Auguste Maison de Lorraine, écrivait: "Profondément ancré dans son sol lorrain, Jean de Pange a chanté dans ses écrits la grandeur de l'Empire Médian, de ces terres de Lotharingie, de Bourgogne, des Pays-Bas, qui à travers l'histoire ont formé l'axe de la pensée, de la culture et de la politique européenne". Lorsque le 7 mars 1949, le premier Conseil de l'Europe se réunit à Strasbourg autour du ministre des affaires étrangères français Robert Schuman, trente ans après que lui-même ait exhorté depuis Strasbourg à la création d'une République Rhénane, Jean de Pange voit là la consécration de ses efforts: "Strasbourg, qui, au cours de sa longue histoire a souffert d'être un objet de discorde entre les peuples guerriers de l'Europe, va devenir le centre d'un nouvel effort de conciliation et d'unité (...) En choisissant Strasbourg comme siège du Conseil de l'Europe (ils) ont reconnu que l'Alsace par sa double culture était prédestinée à être le foyer de l'esprit européen". Soucieux de doter l'Europe d'une âme commune où la jeunesse retrouverait ses propres aspirations, Jean de Pange se lance dans la rédaction de son dernier livre, L'esprit international. Il n'aura pas le loisir de l'achever. Le 20 juillet 1957, âgé seulement de 69 ans, Jean de Pange s'éteint, au terme d'une vie consacrée à l'unité de l'Europe. Son corps repose au cimetière de Pange, sur cette terre qu'il a tant aimée.
La majorité des penseurs politiques lorrains de son temps auront conçu la Lorraine comme une région frontière: Poincaré, Lebrun, Maginot. Tous sauf lui. "Son idée européenne est le fruit de ses racines lorraines, de son enfance autrichienne, de sa culture internationale, de ses deux guerres, l'une comme soldat, l'autre comme prisonnier", ainsi que le résume son neveu, Roland de Pange. Jean de Pange aura profondément révéré l'Allemagne cosmopolite, fédéraliste, fidèle à son génie profond. Homme du XVIIIème siècle, seule cette Allemagne pouvait lui convenir. Quant à sa Lorraine, qu'on peut affirmer plus messine que nancéienne, elle se trouve aujourd'hui au cœur de l'Union Européenne.
A l'heure où l'enthousiasme européen semble s'émousser sous le poids des contingences économiques, Jean de Pange nous rappelle que l'Europe est avant tout le plus grand idéal qu'ait jamais porté la civilisation. En épigraphe du chapitre Europe de son livre Mes Prisons, Jean de Pange notait, reprenant Nietzsche: "Les idées qui transformeront le monde avancent à pas de colombe".
Laurent SCHANG.
00:50 Publié dans Histoire, Hommages, Terroirs et racines, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 23 janvier 2008
Van Creveld: la transformation de la guerre

Van Creveld : la transformation de la guerre
Dans leur collection « L'Art de la guerre », les éditions du Rocher publient La transformation de la guerre de Martin Van Creveld. Enseignant l'histoire à l’Université Hébraïque de Jérusalem, l'auteur remet en cause l'hypothèse de Clausewitz “faisant du conflit armé un phénomène rationnel”, reflet de l'intérêt national et “poursuite de la politique par d'autres moyens”. Il écrit dans l'épilogue: « Il n'est tout simplement pas vrai que la guerre n'est qu'un moyen pour atteindre une fin; ni que les peuples se battent nécessairement pour atteindre tel ou tel objectif. C'est plutôt le contraire qui est vrai: les peuples choisissent souvent tel ou tel objectif comme prétexte pour se battre. S'il est permis de douter de l'utilité de la guerre pour parvenir à tel ou tel objectif pratique, on ne peut douter, en revanche, de son pouvoir de distraction, d'inspiration ou de fascination. La guerre est la vie écrite en majuscules. Dans ce bas monde, la guerre seule permet et exige tout à la fois la mise en œuvre de toutes les facultés humaines, les plus hautes comme les plus basses. La brutalité, la dureté, le courage et détermination, la force pure que la stratégie considère comme nécessaire à la conduite de conflits armés constituent en même temps ses causes. Littérature, art, sport et histoire l'illustrent de façon éloquente. Ce n'est pas en demeurant dans leur foyer auprès de leurs femmes et de leurs familles que les hommes atteignent la liberté, le bonheur, la joie, et même le délire et l'extase. Au point que, assez souvent, ils sont trop heureux de dire adieu à leurs proches les plus chers pour partir en guerre! » (PM)
Martin VAN CREVELD, La transformation de la guerre, Editions du Rocher, 1998, 318 pages, 165 FF.
00:50 Publié dans Défense, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Entretien avec Thomas Molnar

Entretien avec Thomas Molnar :
Crise spirituelle, mondialisme et Europe
Q. : Pour vous la disparition du spirituel et du sacré dans notre société a-t-elle pour cause la modernité ?
ThM : Je préfère inverser les termes et dire que la modernité se définit comme la disparition du spirituel et du sacré dans notre société. Il s'agit d'un réseau de pensée qui s'est substitué graduellement —peu importe le moment du débat historique— aux réseaux traditionnels et en a redéfini les termes et la signification.
Q. : Comment l'Eglise universelle peut-elle s'opposer au mondialisme ?
ThM : Elle ne s'y oppose guère sauf dans certains cas et certains moments, et là aussi d'une manière plutôt inefficace. Ayant accepté, avec enthousiasme ou résignation, sa nouvelle position de lobby (depuis Vatican II), l'Eglise s'intègre à la société civile, ses présupposés philosophiques, sa mentalité, sa politique. Un jour, un changement pourra, bien sûr, intervenir, mais pas avant que la structure de la société civile elle-même ne démontre ses propres insuffisances. Donc, le changement ne viendra pas de l'Eglise dont le personnel perd la foi et se bureaucratise. Dans l'avenir prévisible, les grandes initiatives culturelles et spirituelles n'émaneront pas de l'Eglise. Plus ou moins consciente de cette réalité, l'Eglise se rallie en ce moment au mondialisme, religion nouvelle des siècles devant nous.
Q. : S'opposer au modernisme et au mondialisme, n'est-ce pas refuser le progrès ?
ThM : Le mondialisme rétrécit le progrès, il ne s'identifie plus à lui. C'est que la bureaucratie universelle et ses immenses lourdeurs et notoires incompétences bloquent les initiatives dont la source ultime est l'individu, le petit groupe, la continuité, l'indépendance régionale, enfin la souveraineté de l'Etat face aux pressions impérialistes et idéologiques. Aujourd'hui, le "progrès" (terme particulièrement pauvre et ne recouvrant aucune réalité intelligible) s'inverse, la société perd ses assises, l'anarchie règne. Nous allons vers le phalanstère sans âme. Bientôt viendra l'épuisement technologique, car l'élan nécessaire pour toute chose humaine même matérielle, s'amoindrira, s'essoufflera. L'homme désacralisé ne connaît que la routine, assassine de l'âme.
Q. : A vous lire, il semble que le sacré n'est pas divin. Pouvez-vous expliquer cette approche ?
ThM : Le sacré n'est pas divin dans le sens "substantiel" du mot ; il médiatise le divin, il l'active en quelque sorte. D'abord, le sacré change d'une religion à l'autre, il attire et ordonne d'autres groupes humains (Chartres a été bâtie sur un lieu déjà sacré pour les druides, mais ces sacrés superposés n'expriment pas la même "sacralité"). Le sacré nous révèle la présence divine, cependant le lieu, le temps, les objets, les actes sacralisateurs varient.
Q. : Croyez-vous à une régénération du spirituel et du sacré en France et en Europe ?
ThM : Il n'existe pas de technique de régénération spirituelle technique que l'on utilise à volonté. L'Europe vit aujourd'hui à l'ombre des Etats-Unis ; elle importe les idées et les choses dont elle pense avoir besoin. Elle est donc menée par la mode qui est le déchet de la civilisation d'outre-mer. Bref, l'Europe ne croit pas à sa propre identité, et encore moins à ce qui la dépasse : une transcendance ou un telos. "L'unité" européenne n'est qu'un leurre, on joue à l'Amérique, on fait semblant d'être adulte. En réalité, on tourne le dos au passé gréco-chrétien et le plus grotesque de tout, on veut désespérément devenir un "creuset", rêve américain qui agonise déjà là-bas.
Tout cela n'exclut pas la régénération, qui part toujours d'un élan inédit, de la méditation d'un petit groupe. Aussi ne sommes-nous pas capables de le prévoir, de faire des projets, en un mot de décider du choix d'une technique efficace. Sans parler du fait que la structure démocratique neutralise les éventuels grands esprits qui nous sortiraient du marasme. Sur le marché des soi-disant "valeurs", on nous impose la plus chétive, les fausses valeurs qui court-circuitent les meilleures volontés et les talents authentiques. Si le sacré a une chance de resurgir sur le sol européen, le premier signe en sera le NON à l'imitation. Ce que je dis n'est pas nouveau, mais force m'est de constater dans les "deux Europes", Est et Ouest, l'impression du déjà-vu : l'Europe, dans son ensemble c'est Athènes plongée dans la décadence et l'Amérique, nouvelle Rome, mais d'ores et déjà à son déclin. La régénération ne peut être qu'imprévue.
Q. : Sans ce renouveau spirituel, que peut-il se passer en France et Europe ?
A court terme, des possibilités politiques existent, et la France pourrait y apporter sa part. L'Europe qui se prépare sera germanique et anglo-saxonne, la surpuissance de la moitié nord se trouve déjà programmée. Or, c'est la rupture de l'équilibre historique, car la latinitas n'a jamais été à tel point refoulée que de nos jours. La France pourrait donc redevenir l'atelier politico-culturel de la nouvelle Europe, grâce à son esprit et son intelligence des réalités dans leurs profondeurs. Bientôt, l'Europe en aura assez des nouveaux maîtres qui apportent l'esprit de géométrie, la bureaucratie la plus lourde, la mécanisation de l'âme. La France doit être celle qui crie « Halte ! » et, pour cela, pénétrer le continent, porteuse et l'alternative.
(propos recueillis par Xavier CHENESEAU ; celui-ci en détient le © ; pour toute reproduction ou traduction, lui écrire via la rédaction).
Notre invité en quelques livres :
1968 - Sartre, philosophe de la contestation
1970 - La gauche vue d'en face
1972 - La contre révolution
1974 - L'animal politique
1976 - Dieu et la connaissance du réel
1976 - Le socialisme sans visage
1978 - Le modèle défiguré, l'Amérique de Tocqueville à Carter
1982 - Le Dieu immanent
1982 - L'Eclipse du sacré
1990 - L'Europe entre parenthèses
1991 - L'américanologie, le triomphe d'un modèle planétaire ?
1991 - L'hégémonie libérale
1996 - La modernité et ses antidotes
A signaler la parution prochaine, aux Editions l'Age d'Homme, de deux nouveaux ouvrages de Thomas Molnar : Moi, Symmaque et L'âme et la machine.
00:40 Publié dans Entretiens, Philosophie, Politique, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
1516: Mort de Ferdinand le Catholique

Mort de Ferdinand le Catholique
23 janvier 1516 : Mort à 64 ans de Ferdinand le Catholique qui fut Roi d’Aragon à partir de 1479 et Régent de Castille à partir de 1507. Dans son troisième et ultime testament, rédigé un jour avant son décès, il désigne comme Régent de Castille le Cardinal Cisneros, qui devra exercer ces fonctions jusqu’à la pleine maturité de son petit-fils Charles, le futur Charles-Quint. Ferdinand avait chassé les Maures de Grenade en 1492 et les Français de Navarre en 1512 ; il avait également amorcé une politique méditerranéenne, destinée à ré-européaniser cette Mer du milieu. Ses armées avaient aussi pris la ville d’Oran et sa région le 18 mai 1509 ; cette victoire militaire contre les pirates et les esclavagistes barbaresques donne le droit à l’ensemble impérial européen, hispano-germano-bourguignon, de posséder cette terre en toute exclusivité ; d’autant plus que, trois siècles plus tard, des soldats issus de nos régions avaient participé à la conquête française de l’Algérie à l’époque de Léopold I ; qu’une colonisation flamande y avait été prévue mais non traduite dans les faits à cause de la perfidie française ; que cette partie de l’Algérie a été pour l’essentiel colonisée par des Espagnols, que la belle armée française a laissé massacrer en grand nombre, sans lever le moindre petit doigt, par les rebelles algériens au moment de l’indépendance de ce pays barbaresque. On voit que les comptes ne sont pas réglés… Et que toute puissance qui ne s’aligne pas respectueusement sur les projets de Ferdinand et de Charles-Quint ne génère que le désordre, le chaos et la barbarie. Ce qui leur ôte le droit au respect et à l’existence et que tant qu’ils existent de facto, nous ne devons les considérer que comme des anomalies ou des incongruités.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 22 janvier 2008
Sur Ernst Kantorowicz

Stefan PIETSCHMANN :
Ernst Kantorowicz, biographe de Frédéric II de Hohenstaufen
„Vivet et non vivit“ (= Il vit et n’a pas vécu). A la fin de sa monumentale monographie consacrée à Frédéric II, Ernst Kantorowicz a placé cette citation latine, car il était indubitablement animé par une intention mystique : le mythe de l’Empereur Hohenstaufen, figure clef, est rappelé ainsi à la vie, au-delà des siècles, au-delà de la mort physique. Dès la parution de ce maître ouvrage en 1927, Ernst Kantorowicz acquiert d’un coup la célébrité.
Ernst Hartwig Kantorowicz, né en mai 1895 à Posen, est issu d’une vieille famille juive en vue. Après avoir passé son « Abitur » en 1913, il entame des études d’ingénieur commercial à Hambourg, afin de pouvoir, plus tard, gérer l’entreprise familiale, une fabrique de spiritueux. Dès qu’éclate la première guerre mondiale, Kantorowicz se présente comme volontaire au 20ième Régiment d’Artillerie de campagne de Posnanie, où il servira jusqu’à la fin des hostilités. Il revient du combat la poitrine constellée de décorations. En mai 1918, il s’était inscrit à l’Université de Berlin, en faculté de philosophie. C’est dans la capitale qu’il vécut la révolution, ce qui l’amena à retourner dans sa province natale de Posnanie, pour s’engager immédiatement dans un Corps Franc, dont le but était de défendre les revendications allemandes dans cette région de l’Est du Reich. Au cours du printemps 1919, il est engagé contre les Spartakistes à Berlin, et puis, en mai, alors qu’il étudie les sciences économiques, contre la République des Conseils à Munich.
Il déménage ensuite à Heidelberg. Il fait connaissance avec le poète Stefan George et, immédiatement après avoir remis sa thèse de doctorat (sur « L’essence des associations musulmanes d’artisans »), se consacre au thème de sa vie : la figure de l’Empereur Frédéric II de Hohenstaufen.
Indubitablement, il a été amené à ce choix, inspiré par les poèmes de Stefan George. Dans son poème « Rom-Fahrer », George avait averti ses disciples en faisant allusion au destin tragique de l’Empereur Frédéric II et de son petit-fils Konradin. « La grandeur des grandeurs de Frédéric, véritable nostalgie des peuples » est une nouvelle fois évoquée dans le poème « Die Gräber in Speier ». George y rappelle la figure de ce petit-fils de Béatrice de Bourgogne, dont la tombe est à Spire (Speyer) ; elle avait été la seconde épouse de Frédéric Barberousse. George voyait dans le règne de Frédéric II revivre la politique générale des Empereurs germaniques issus de ces premières lignées que furent les Carolingiens, les Ottoniens et les Saliens, une politique générale couplée au sens impérial et romain de l’Etat, à la culture grecque et orientale.
La fin des grands temps
Dans ses « Conversations avec Stefan George », Edith Landmann fait dire au poète ce qu’il ressentait face à la figure de Frédéric II, des Allemands en général. Question d’Edith Landmann : «Vous avez évoqué le passage de la belle ère allemande médiévale à l’époque plus prosaïque de Rudolf von Habsburg… ». Réponse de George : « Ce Rudolf était déjà un roi bourgeois. Avec lui, c’est autre chose. Les grands temps sont passés. C’est insaisissable, ce qui s’est passé là ; pourra-t-on jamais revenir au-delà de cette césure ? La meilleure explication de ce passage me semble celle-ci : à certaines époques, les dieux visitent un pays et quand ils repartent, les hauts temps s’évanouissent ». Le « Frédéric II » d’Ernst Kantorowicz décrit le déclin des Staufen, et fait de cette description une lecture si captivante, qu’elle ne laisse aucun lecteur indifférent. « Quelle impression cela a fait sur les Italiens, la mort de ce bel homme ! Les Allemands, en revanche, lui ont comme tapé sur l’épaule, en lui demandant de restreindre ses élans et en lui disant : tu aurais mieux fait de rester au pays, voilà ce qui arrive quand on ne le fait pas ». « Cette phrase, écrit Edith Landmann, m’est restée gravée dans la mémoire… ».
Stefan George disait de Kantorowicz qu’il était « ce que les Français nomment un ‘Chevalier’ » et, ajoutait-il, « il était si entièrement ‘Chevalier’, qu’on ne s’en apercevait plus ». Homme du monde, très élégant dans le choix de ses vêtements, dans sa gestuelle quotidienne, dans son langage ; il avait tout, dit le germaniste Boehringer, d’un escrimeur, virtuose du fleuret. « Son intelligence, qui avait la faculté de pénétrer profondément en toute matière, se doublait d’une étonnante capacité à percevoir les choses dans leurs interrelations ; c’est sur ces facultés intellectuelles-là que repose sa vision et sa présentation si grandioses et si vivantes de l’histoire ».
Le livre consacré à Frédéric II de Hohenstaufen, Kantorowicz l’a écrit, pour l’essentiel, dans son appartement de Heidelberg, charmante petite ville universitaire où George, lui aussi, tenait ses quartiers à l’époque, du moins pendant quelques étés jusqu’en 1926. Plusieurs passages du livre en témoignent. Stefan George et les frères von Stauffenberg en ont corrigé les épreuves et négocié sa publication auprès des éditeurs.
L’Allemagne secrète à Naples et à Palerme
Le livre contient une sorte de préambule, dont le style et la teneur sont typiques du Cercle de Stefan George : « Lorsqu’en mai 1924, le Royaume d’Italie a célébré le 700ième anniversaire de la fondation de l’Université de Naples, que Frédéric II de Hohenstaufen avait fondée, on a trouvé, au pied du sarcophage de l’Empereur, dans la cathédrale de Palerme, une couronne portant l’inscription suivante : ‘A ses empereurs et héros, l’Allemagne secrète’ (= Das Geheime Deutschland) ». Cette couronne et ce bandeau votif avaient été déposés, selon toute vraisemblance, par des amis de George, qui séjournaient vers Pâques 1924 à Palerme : parmi eux, il y avait Ernst Kantorowicz. Son mérite demeurera, d’avoir ramené au présent la figure sublime de Frédéric II, grâce aux stupéfiantes facultés de son intelligence critique, à la pertinence profonde de son questionnement. L’Etat, construit en Sicile par Frédéric II, fondé et gouverné par le truchement de la Constitution de Melfi, selon les lois de la raison, se référait à l’antiquité, jugée en son temps « païenne ». Ce « paganisme » antique et ce recours à la raison politique contribuèrent à faire de lui, pour ses ennemis, un « hérétique ». Il n’y avait pourtant rien d’autre d’ « hérétique », chez lui, que d’être simplement en avance sur son temps. Quelques siècles plus tard, personne n’aurait parlé de ‘stupor mundi’, en faisant référence à l’œuvre qu’il avait bâtie. Frédéric II nous interpelle, nous et nos contemporains, dans tous les domaines qu’il a touchés, tout simplement parce que sa pensée, sa sensibilité, sa volonté et son action anticipaient les époques qui allaient advenir, après l’ère proprement médiévale.
En décembre 1933, Stefan George meurt à Minusio en Suisse, sur un territoire politiquement neutre, afin d’échapper aux honneurs que n’auraient pas manqué de lui réserver le nouveau régime national-socialiste. La veillée funèbre du poète fut assumée par Ernst Kantorowicz, Claus von Stauffenberg et quelques autres. Il faut rappeler ici que c’est justement Kantorowicz, et non pas seulement Stefan George, qui a conforté les trois frères von Stauffenberg dans la certitude, mythique, qu’ils étaient les descendants des Staufer et donc, possédaient un sang royal.
Les différends d’ordre idéologique avaient pourtant déjà profondément divisé l’ « Etat », c’est-à-dire le Cercle de George, ce que ressentaient tout particulièrement les amis, sympathisants et membres de confession israélite qui étaient restés en Allemagne entre 1936 et 1938. Tout en ressassant ses souvenirs sur ces clivages qui divisaient cruellement le Cercle, Edgar Salin expliqua plus tard à Berlin, en quelques lignes poignantes, les sentiments de Kantorowicz, qui venait, lui, d’émigrer aux Etats-Unis en 1938 : « Il avait été profondément marqué par l’affliction générale qui avait uni dans la douleur tous ceux qui firent partie du Cercle mais avaient été séparés par les circonstances politiques. Mais lorsqu’il se hissa dans le train pour quitter la Suisse, il vit, à une autre fenêtre du wagon, un des ‘amis’ lever le bras à la nouvelle mode qui régnait alors en Allemagne, et deux autres, plus jeunes, répondant à son salut depuis le quai, de la même manière ». Ces deux jeunes hommes étaient ceux qui avaient soigné et aidé George, dans les derniers mois de sa vie, à Minusio.
En novembre 1938, Kantorowicz réussit à quitter l’Allemagne, grâce à son ami le Comte Albrecht von Bernstorff, qui fut assassiné en 1945 dans la prison de Berlin Moabit. En passant d’abord par l’Angleterre, son exil finit par le conduire aux Etats-Unis où il enseigna, dès 1939, à l’Université de Berkeley.
Refus des injonctions maccarthystes
En 1951, une fois de plus, Kantorowicz agit de cette manière chevaleresque, qu’admirait tant chez lui Stefan George : c’était à l’époque où sévissait la commission McCarthy. Comme en Allemagne en 1933, Kantorowicz demeura fidèle à lui-même et refusa de prêter le serment d’allégeance et de loyauté que les Etats-Unis exigeaient des professeurs. Il fut licencié sur le champ.
On est touché de constater combien les traces de la vision politico-mythique de George persistent dans l’œuvre de Kantorowicz, tant d’années après la mort du poète. Kantorowicz est resté fidèle à l’ « Allemagne secrète », à ce Reich de mystères et de mythes. Dans ses derniers ouvrages, il prouve encore qu’il ne cesse de servir ces mythes, d’explorer et d’étayer les concepts éducateurs et pédagogiques préconisés par le Cercle de Stefan George. A partir de l’automne 1951, il travaille à l’ « Institute for Advanced Study » à Princeton. En 1957, le deuxième de ses deux ouvrages majeurs sort de presse, intitulé « The King’s Two Bodies », « Les deux corps du Roi », qui ne fut traduit en allemand qu’en 1991 ! C’est un immense travail synoptique, composé d’innombrables pièces formant, toutes ensemble, une magnifique mosaïque, qui n’est pas toujours aisée à comprendre dans chacun de ses éléments. Tentons de cerner le noyau même de ce maître ouvrage en donnant ses sources principales : le point de départ de la quête de Kantorowicz se situe dans la « doctrine des deux natures » de l’église primitive, où le Christ est à la fois Dieu et homme ; ensuite dans les oeuvres des juristes de Cour anglais de l’époque des Tudor, qui avaient élaboré une « christologie royale » très sophistiquée.
En 1963, Ernst Kantorowicz rejoint Stefan George dans la mort. Il avait été un grand historien juif et allemand et aussi un patriote animé par une foi nationale infaillible.
Stefan PIETSCHMANN.
(article paru dans l’hebdomadaire berlinois « Junge Freiheit », n°30/2000 ; trad. franç. : Robert Steuckers).
01:00 Publié dans Hommages, Philosophie, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Bruno Kreisky

22 janvier 1911: Naissance à Vienne de Bruno Kreisky au sein d’une riche famille juive de la capitale de l’Empire austro-hongrois. Rapidement, le jeune Kreisky va rompre avec l’idéologie et la judaïté familiales, en adhérant notamment au mouvement des “Jeunes socialistes”, qui professaient un socialisme hostile à tout dogmatisme et à toute doctrine figée.
En 1934, quand, tour à tour, socialistes marxistes puis nationaux-socialistes, tentent d’abattre la première république autrichienne, il se retrouve en prison. De même, en 1938, au moment de l’Anschluß, il connaît une nouvelle fois la paille humide des cachots viennois. En 1940, il émigre en Suède, où il devient l’ami d’un autre exilé, appelé à devenir célèbre: Willy Brandt.
Après la seconde guerre mondiale, il développera, dans le cadre de la deuxième république autrichienne, une politique nettement arabophile, en dépit de ses origines juives. Par ailleurs, son séjour en Suède l’induit à adopter le modèle socialiste scandinave. Cette option lui permet d’élargir considérablement la base du parti socialiste autrichien, la SPÖ. Pendant treize ans, les socialistes pourront gouverner seuls la république alpine. L’économie tourne, l’Autriche retrouve une certaine prospérité.
Mais si Kreisky a su donner cohérence au socialisme autrichien dans ses dimensions économiques et sociales, son oeuvre politique la plus emblématique reste une diplomatie de troisième voie, de non-alignement. Elle impliquait donc une ouverture au monde arabe et aux autres petites puissances non alignées, ainsi qu’une volonté de surmonter la césure du Rideau de fer, par exemple, en nouant des relations avec la RDA.
En 1975, le Colonel Khadafi reçoit Kreisky en Libye. En 1982, Kreisky reçoit le Colonel libyen à Vienne, indiquant par là clairement que l’Autriche ne cesserait pas de faire valoir sa neutralité sur la scène internationale, notamment en ne tenant jamais compte des injonctions de Washington. Ni de celles de Tel Aviv. Faut-il y voir la raison d’une série d’attentats terroristes perpétrés en Autriche, notamment contre des synagogues ? Sur ce fond fait d’explosions et d’horreurs, Kreisky est l’objet d’une tentative d’assassinat, mais, à partir de 1980, sa santé décline, il quitte la scène politique et meurt à Vienne, sa ville natale, le 29 juillet 1990.
Kreisky a incarné la troisième voie autrichienne, comme le conservateur catholique Waldheim, également victime d’une campagne de haine internationale, et comme Jörg Haider, autre figure, libérale-populiste celle-là, qui a suscité à son tour la haine des médias aux ordres, notamment pour sa volonté de s’ouvrir à l’Irak baathiste.
Si un homme politique autrichien, fût-il juif, socialiste, conservateur-chrétien ou libéral-populiste, entend mener une politique autrichienne, il sera immanquablement la cible des médias orwelliens : une succession de faits historiques le prouve, faits qui devraient faire réfléchir les “hommes de gauche”, notamment socialistes, si prompts à hurler de concert avec CNN ou d’autres chaînes, quand il s’agit de Waldheim et de Haider, alors que leur compagnon de combat Kreisky, ami de Willy Brandt, avait exactement les mêmes positions que ses deux compatriotes non socialistes que nous venons de nommer.
Mais les socialistes actuels, comme les libéraux qui ont la lâcheté de suivre aveuglément un pitre comme Louis Michel, sont des socialistes amnésiques, des socialistes opportunistes, des socialistes de carnaval ou, pour être encore plus précis, des socialistes de Gay Prides… (Robert Steuckers).
00:30 Publié dans Affaires européennes, Histoire, Hommages, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 janvier 2008
1919: premier Dàil Eireann

21 janvier 1919 : première session du parlement libre irlandais
Karl WEINHOLD :
Le premier pas vers l’indépendance irlandaise
Dans les actualités de ces dernières décennies, le conflit d’Irlande du Nord a été très souvent évoqué, démontrant par là que la lutte pour la liberté sur l’Ile Verte n’est pas encore véritablement terminée. Il y a près de 90 ans, l’appel à constituer « l’assemblée de l’Irlande », le « Dàil Eireann », marquait un premier pas vers l’indépendance pour le pays.
L’Ile Verte, colonisée depuis le 16ième siècle par l’Angleterre, après avoir été pendant tout le moyen âge un foyer européen d’érudition et de foi, n’avait au fond jamais accepté la perte de son autodétermination. En 1800, le Parlement local irlandais avait été supprimé et l’autorisation, pour les députés irlandais de siéger à Westminster, ne compensait pas entièrement cette perte d’autonomie. Ce qui engendra, pendant tout le 19ième siècle, plusieurs révoltes populaires. En 1870, Isaac Butt crée le « Home Rule Mouvement » ou, traduit en termes français actuels, le « Mouvement pour l’autodétermination de la patrie (irlandaise) », qui portera très vite le nom de « Irish Party » et conquerra la majorité des sièges irlandais aux Communes (House of Commons). Le successeur de Butt, Parnell, répondit au refus de tout compromis de la part des autorités anglaises par des exigences de plus en plus tranchées ; ce qui amena à l’Irish Party plus des trois quarts des suffrages. Malgré ces succès électoraux, le gouvernement britannique ne se montrait pas prêt à des concessions, aussi infimes soient-elles. La « Home Rule Bill » (la loi sur l’autodétermination), pourtant dûment promise, fut suspendue en 1914, sous prétexte que l’Etat était en guerre.
Lors de la révolte de Pâques 1916, où ce furent surtout les habitants de Dublin qui entrèrent en lice, 1315 personnes furent tuées ou blessées. Mais à partir de ce soulèvement, la « République irlandaise », proclamée par les rebelles, ne cessa plus d’être à l’ordre du jour de la politique. Ce fut surtout l’exécution systématique des chefs de l’insurrection qui créa dans tous les pays une vague de solidarité avec les martyrs. En 1918, le Sinn Fein, un parti qui militait (et milite toujours) pour l’indépendance de l’Irlande, gagne aux élections 73 des 105 sièges irlandais à Westminster.
Parmi les points essentiels du programme et du manifeste électoral du Sinn Fein, figurait la volonté de constituer un Parlement irlandais, semblable à celui qui fut dissous en 1800. Lorsque la nouvelle chambre des Communes britanniques s’assembla pour la première fois, les députés du Sinn Fein refusèrent de prendre leurs sièges. Le 21 janvier 1919, vingt-sept d’entre eux -les autres étaient emprisonnés ou devaient se cacher- se rassemblèrent à Dublin pour créer le « Dàil Eireann ». Ils demandèrent aux autres nouveaux élus irlandais de se joindre à eux et exprimèrent leur ferme décision de constituer de facto le gouvernement d’une Irlande indépendante. Eamon de Valera fut choisi comme Président. L’assemblée accepta la proclamation de la République, lue lors de l’insurrection de Pâques 1916, et déclara l’indépendance du pays. L’assemblée nomma ensuite des fonctionnaires et envoya une délégation à Versailles pour participer aux négociations de paix. Grâce à un travail intensif de propagande aux Etats-Unis et au soutien des Irlandais qui y avaient émigré, la communauté internationale prit conscience de la situation. Ainsi l’indépendance irlandaise prenait ses contours, du moins symboliquement.
Les autorités britanniques, après une phase d’hésitation et d’indécision, réagirent en tentant de faire emprisonner les membres du Parlement irlandais. La délégation envoyée à Paris fut refoulée sans ménagement, après que Wilson ait accepté le point de vue britannique. Le 11 septembre 1919, l’ « Assemblée d’Irlande » fut déclarée illégale. Incapables de se défendre ou de passer à l’offensive, faisant erronément confiance au « désir de dialogue » des Britanniques, les députés irlandais, à l’instar de leurs homologues du Parlement démocratique de Francfort pendant la révolution de 1848, durent céder devant la force. Mais la brièveté de l’existence de ce Parlement irlandais avait malgré tout infléchi le cours de l’histoire.
Par la force des choses, l’élimination de l’assemblée populaire irlandaise provoqua l’émergence de mouvements militarisés. L’ « Army of the Irish Republic », qui deviendra l’IRA, devint bien vite l’avant-garde, très populaire, des intérêts nationaux. Des milliers d’hommes prirent les armes et étendirent les actions de résistance isolées, perpétrées jusqu’alors, pour en faire une guérilla générale. Deux ans plus tard, le Premier Ministre britannique Lloyd George se voyait contraint de négocier avec l’équipe qui formait le gouvernement irlandais plongé dans l’illégalité depuis septembre 1919. Toutefois, Lloyd George fut le vainqueur des négociations : il réussit à obliger les Irlandais à faire bon nombre de concessions. Le 26 décembre 1921, une délégation irlandaise signe les « Articles of Agreement », fort contestés, où l’on avait évité, expressis verbis, de prendre position quant au « Dàil Eireann ». Vingt-six comtés irlandais obtinrent leur autonomie, avec le statut de « dominion » au sein du Commonwealth britannique. Six autres comtés au nord-est de l’Ile, en Ulster, furent détachés de l’ensemble et maintenus dans le Royaume-Uni.
Même après l’indépendance définitive de l’Irlande, la partition de l’Ile constitue encore et toujours un foyer de crise, de désordre et de conflit. Les événements de ces dernières décennies nous montrent que le conflit n’a rien perdu de son acuité. L’Union Européenne devra à terme se pencher sur la question irlandaise, exactement comme elle a été obligée de régler la question de la division allemande en 1989. En conclusion, nous pouvons dire que les vicissitudes de l’histoire, en Irlande comme en Allemagne, présentent bien des similitudes pour qui sait observer : les deux pays ont subi des dominations étrangères et l’histoire de leurs parlements a connu beaucoup de rebondissements.
Karl WEINHOLD.
(article paru dans « Junge Freiheit », n°4/1994 ; trad. franç. : Robert Steuckers).
01:00 Publié dans Affaires européennes, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Over Oswald Spengler (NL)

TEKOS:
Over de actualiteit van Oswald SPENGLER
De Duitse denker Oswald Spengler (1880-1936) weet al vanaf de Eerste Wereldoorlog conservatieve cultuurcritici te inspireren. Tegenwoordig wordt hij zelfs als "groene" onheilsprofeet omarmd. Het oude Europa is gevoeliger voor cultuurpessimisme dan voor het "vooruitgangsgeloof", schrijft de germanist Jerker Spits.
De oude dame Europa lijkt om de zoveel jaren vatbaar voor de koorts van het cultuurpessimisme. Ook nu weer is er sprake van een herleving. Hedendaagse conservatieve denkers mogen daarbij graag teruggrijpen op de Duitse filosoof Oswald Spengler, die als geen ander verlangde naar een herstel van oude tradities die in de moderne maatschappij verloren waren gegaan.
In zijn jonge jaren was Oswald Spengler een romanticus. Maar zoals veel Duitse dichters en denkers ontwaakte hij aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. "Ik verbaas me er nog steeds over", zou hij later schrijven, "hoe ik tot mijn vijfentwintigste in een droom leefde. Hulpeloos, angstig, maar toch gelukkig. Wat heb ik toen niet allemaal opgeschreven!"
Na de oorlog eiste Spengler van zijn land een radicale en meedogenloze aanpassing aan de rationele, technische tijd. Hij treurde niet langer om wat verloren ging. De mens moest de nieuwe krachten van zijn tijd omarmen. Vanaf zijn dertigste zou hij zijn tijdgenoten provoceren met een loflied op de techniek. "Voor de prachtige, zeer intellectuele vormen van een snel stoomschip of een staalfabriek geef ik alle rommel van de huidige kunstnijverheid inclusief schilderkunst en architectuur weg.”
Spengler leefde als privégeleerde in München. Hij meed de artistieke kringen van de Beierse hoofdstad. Zijn zelfgekozen isolement en afkeer van de Münchense bohémien is opmerkelijk als je bedenkt welke grootheden zich daar in die tijd ophielden: de schrijvers Thomas en Heinrich Mann, de dichters Stefan George en Rainer Maria Rilke, de kunstenaars Alfred Kubin, Franz von Stuck, Wassily Kandinsky, Paul Klee. Maar geen van hen beschouwde Spengler als zijn gelijke. Ook in Thomas Mann zag Spengler een decadente romanticus, een kunstenaar die niet met zijn tijd was meegegaan. Werk ging bij hem sowieso voor vriendschap. In de gedachtenwisseling met artistieke tijdgenoten was hij niet bijzonder geïnteresseerd. Ik spreek nog liever met een meisje dat ik van de straat pluk, dan met die kunstenaarsbende.”
 Spengler vereenzaamde, al wekten verspreid verschenen voorstudies van zijn nieuwe boek "Der Untergang des Abendlandes" veel belangstelling. In dit magnum opus wilde hij alle grote vragen van zijn tijd beantwoorden. Naar eigen zeggen ging het in "Der Untergang" om de natuurlijke, door allen donker voorvoelde filosofie van deze tijd. Wiskunde, oorlog, Rembrandt, poëzie, taal – in Spenglers ogen smolt de wereldgeschiedenis samen. Hij zag daarin een eeuwige Gestaltung en Umgestaltung, een wonderbaarlijk worden en vergaan van organische vormen. Culturen, levende wezens van de hoogste orde, groeien in een verheven doelloosheid op zoals bloemen op een veld. Ze behoren net als planten en dieren tot de levendige natuur.”
Spengler vereenzaamde, al wekten verspreid verschenen voorstudies van zijn nieuwe boek "Der Untergang des Abendlandes" veel belangstelling. In dit magnum opus wilde hij alle grote vragen van zijn tijd beantwoorden. Naar eigen zeggen ging het in "Der Untergang" om de natuurlijke, door allen donker voorvoelde filosofie van deze tijd. Wiskunde, oorlog, Rembrandt, poëzie, taal – in Spenglers ogen smolt de wereldgeschiedenis samen. Hij zag daarin een eeuwige Gestaltung en Umgestaltung, een wonderbaarlijk worden en vergaan van organische vormen. Culturen, levende wezens van de hoogste orde, groeien in een verheven doelloosheid op zoals bloemen op een veld. Ze behoren net als planten en dieren tot de levendige natuur.”
De mens moest volgens hem zijn leven aanpassen aan de ontwikkelingsfase van de cultuur. De belangen van het individu waren ondergeschikt aan het collectief waartoe hij behoorde.
"Der Untergang" gaat uit van het onderscheid tussen Kultur en Zivilisation. Spengler volgde hierin een specifiek Duitse traditie die sinds het einde van de negentiende eeuw vorm had gekregen. In de Eerste Wereldoorlog zagen jonge Duitsers zich als de verdedigers van de "ideeën van 1914" – de cultuur. Zij verdedigden die tegenover de "ideeën van 1789" – de civilisatie. Duitsland moest naast een oorlog ook een geestelijke strijd voeren: tegen Russische barbaren in het Oosten en tegen materialisme en winstdenken in het Westen. Duitsland zou het Westen moeten redden van de Angelsaksische kruideniersgeest en ontspoorde vrijheid. De "civilisatie" van langs elkaar levende individuen stond tegenover de "cultuur" waarin de mens de band met de gemeenschap, het verleden en de eigen natie levend houdt.
Spengler was verklaard tegenstander van de Zivilisation. Kwantiteit zou het daarin afleggen van kwaliteit. De Gemeinschaft zou plaats maken voor de Gesellschaft. De mens zou een "intellectuele nomade" worden, omdat hij niet langer leefde in het besef onderdeel van een gemeenschap te zijn.
Dit wereldbeeld was in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog niet ongewoon. Ook Thomas Mann verklaarde in zijn "Betrachtungen eines Unpolitischen" (1918) dat democratie, politiek zelf "het Duitse wezen" vreemd is. Mann schreef "De Duitse aard, dat is cultuur, ziel, vrijheid en niet civilisatie, maatschappij, stemrecht, literatuur." Later schreef de Nobelprijswinnaar niet zonder ironie: De overwinning van Engeland en Amerika bezegelt en beëindigt het lot van onze ouder wordende cultuur. Wat nu volgt, is de Angelsaksische wereldheerschappij, dat betekent de volmaakte civilisatie. Waarom niet? Men kan er comfortabel in leven.”
Maar niet iedereen kon deze stap nemen. Het Duitse Bildungsbürgertum klampte zich vast aan de Duitse Kultur – en vond in Spengler zijn intellectuele leidsman.
Oswald Spengler was overtuigd van zijn missie. Ik had als kind al het idee dat ik een soort van Messias moest worden. Een nieuwe zonnereligie stichten, een nieuw Duitsland, een nieuwe Weltanschauung.” Van valse bescheidenheid had Spengler geen last: Ik schrijf het beste Duits, dat op dit moment in boeken te lezen is.”
In zijn brieven en dagboekaantekeningen lijkt hij zijn grote voorbeeld Friedrich Nietzsche naar de kroon te willen steken. En net als zijn voornaamste inspirator werd Spengler geplaagd door langdurige depressies. Niemand weet wat het betekent met zulke ideeën te vechten, waarvan de bittere ernst de zelfmoord dichterbij brengt, dagenlang geen woord te spreken, geen ander mens te zien. En dan, in de uiterste terneergeslagenheid, wijn, muziek of een paar schrijvers (Shakespeare, Baudelaire, Hoffmann) te hebben. Wat heb ik door die eenzaamheid niet verloren! Hoeveel energie, die ik anders aan andere dingen had kunnen besteden!”
Toen het eerste deel van "Der Untergang des Abendlandes" in 1918 verscheen, raakte intellectueel Duitsland in Spenglers ban. Alle belangrijke Duitse intellectuelen namen kennis van het boek. Thomas Mann prees het in de hoogste bewoordingen. De filosoof Georg Simmel noemde het de belangrijkste geschiedenis van de filosofie sinds Hegel”. Kritiek was er uit de hoek van egyptologen en oriëntalisten die zich beklaagden over onnauwkeurigheden in Spenglers beschrijving van de wereldgeschiedenis. Maar de honderdduizenden lezers schoven deze professorale kritiek spottend terzijde. Het ging hen niet om de verschillen tussen de vijfde en zesde Egyptische dynastie.
Het Duitse Bildungsbürgertum had omstreeks 1920 het idee dat er na Goethe, Schiller en Nietzsche een verval was ingetreden. In de ogen van veel lezers was er geen andere auteur dan Oswald Spengler die dit zo treffend wist te verwoorden. Al snel werden hem leerstoelen aangeboden. Spengler wees deze handreikingen vriendelijk maar beslist af. Hij wilde geen gewone geleerde zijn. Intellectuele vrijheid ging bij hem boven maatschappelijke status. Bovendien verafschuwde Spengler de academische filosofie van zijn tijd haast net zo hevig als Schopenhauer dit een eeuw voor hem had gedaan. "Filosofische vakwetenschap is filosofische onzin.”
Veel lezers duidden Spenglers boek als een schets van de ondergang van de westerse wereld. Alsof Spengler vol nostalgie zou hebben teruggeblikt op verloren erfgoed. Maar van deze romantische visie wilde Spengler na de Eerste Wereldoorlog juist afscheid nemen.
In de jaren twintig vroeg een rijke Duitse Spengler om raad: waar moest zij, nu de westerse wereld spoedig zou ondergaan, haar aandelen onderbrengen? Al in 1921 klaagde Spengler over het modewoord ’ondergang’ als gevolg van zijn titelkeuze. (Het is veelzeggend dat het woord ontbreekt in de oorspronkelijke titel van het werk: "Konservativ und liberal".) Hij schreef immers niet alleen over wat verdween, maar ook over wat nieuw was en de toekomst zou bepalen.
Spengler zag de wereld om hem heen veranderen. Bildung, geestelijke aristocratie en esthetische fijnzinnigheid verdwenen in een maatschappij die voor de wetten van de markt boog. De mens, het door Goethe en Humboldt geprezen vrije en zelfbewuste individu, ging op in de massa, werd gereduceerd tot consument en arbeidskracht.
Tussen de werkelijkheid van alledag en de idealen van de Duitse gymnasia gaapte volgens Spengler een onoverbrugbare kloof. De opkomst van de massamaatschappij, de groeiende rol van volkse sentimenten baarden hem zorgen. De moderne massamedia zouden de mens een illusie van vrijheid geven, maar hem in werkelijkheid op geraffineerde wijze tot slaaf maken. Eens durfde men niet vrij te denken; nu mag men het, maar kan het niet meer.”
Niet zonder reden wordt Oscar Spengler wel beschouwd als een van de "geestelijke wegbereiders" van het nationaal-socialisme. Daarmee deelde hij immers de afkeer van de slappe Weimarrepubliek en de voorliefde voor het krachtige Pruisendom. Maar vrijwel onmiddellijk na de machtsovername van Hitler in 1933 viel de filosoof in ongenade. En ook Spengler zelf nam al snel afstand van het nieuwe regime, in zijn boek "Jahre der Entscheidung". Wat de nationaal-socialisten bovenal in Spengler hinderde was zijn afwijzing van ieder vooruitgangsidealisme. Het gevolg was dat zijn boeken en denkbeelden niet meer in het openbaar genoemd mochten worden.
Zijn ster verbleekte. Op 8 mei 1936, kort voor zijn 56ste verjaardag, stierf hij aan een hartaanval. Na 1945 raakte de filosoof meer en meer in vergetelheid.
In de optimistische jaren negentig, na de val van het communisme, leek de ondergang van het Avondland verder weg dan ooit. Francis Fukuyama voorspelde in "Het einde van de geschiedenis" de verdere zegetocht van de westerse democratie en het liberalisme.
Na 11 september 2001 kwam hier verandering in. Er bleken andere culturen die de westerse hegemonie betwistten. En in het Avondland zelf ging de aandacht steeds meer uit naar de schaduwzijden van de massademocratie. Mondigheid zou zijn ontaard in brutaliteit en schaamteloosheid, het ter discussie stellen van autoriteit zou burgers hebben wijsgemaakt dat regels altijd en overal moeten worden aangevochten, de "massacultuur" zou de democratie "verzwelgen".
Het werk van Spengler werd langzaam herontdekt. Ook onder hedendaagse cultuurfilosofen leeft kritiek op de massacultuur, op de genivelleerde maatschappij, waarin de meerderheid niet alleen beslist over de zetels in het parlement, maar ook over de collectieve moraal. En je hoeft Spenglers antwoorden – een vlucht naar voren, de "roofdiermens" als de enig mogelijk overgebleven "hogere" vorm van leven – niet te beamen om de geldigheid van zijn tijdsdiagnose te onderkennen.
Een groeiend aantal intellectuelen staat wantrouwend tegenover de wil en de smaak van de massa. Zij richten hun pijlen op de mondiale "gelijkschakeling". Overal verschijnen dezelfde merken, dezelfde levensstijlen, eenzelfde vrijgevochten manier van denken, verdwijnen tradities ten gunste van geldelijk gewin of persoonlijke geldingsdrang.
De Nederlandse filosoof Ad Verbrugge spreekt in zijn bestseller "Tijd van onbehagen" in vergelijkbare termen als Spengler over de schaduwzijden van globalisering en de ongeremde werking van de vrije markt. Soms met nogal overtrokken commentaar. Zo is de huidige liberale consumptiemaatschappij volgens Verbrugge even totalitair als het fascisme en het communisme”.
Ook voor de Franse filosoof Alain Finkielkraut is de moderne massacultuur gespeend van alle grote gedachten – een geestelijk barbarendom, maar burgerlijk en comfortabel ingericht, zoals Spengler het al beschreef. De waarschuwende roep van Spengler is eveneens bij Finkielkraut hoorbaar: nog teert het Westen op zijn rijke verleden, maar eens zal de beschaving, als zij niet door haar culturele elite verdedigd wordt, onder daverend geruis ineenstorten. Dankbaar grijpt Finkielkraut de plunderingen van jonge Arabieren in de Parijse voorsteden aan: de barbaren staan aan de poorten van de stad.
Sommigen zien in deze conservatief geïnspireerde cultuurkritiek een terugkeer naar riskante denkpatronen en een hang naar obscurantisme. Zij bekritiseren de hang naar traditie, naar oude zekerheden, de revitalisering van het christelijk geloof, de terugkeer naar het denken over geschiedenis als "heilsgeschiedenis".
En de affiniteit met Spenglers tijdsdiagnose blijft geenszins beperkt tot conservatieve denkers. Al in 1997 haalde De Groene Amsterdammer Spengler van zolder, om te waarschuwen tegen een "pulpdemocratie" waarin "de emoties van de massa regeren". De banvloek die progressieve intellectuelen na de Tweede Wereldoorlog over Duitse denkers uitspraken, is gebroken. Ook in Duitsland zelf is er sprake van een hernieuwde belangstelling voor Spengler, onder wetenschappers én bij filosofen als Peter Sloterdijk.
De laatste jaren wordt Spengler ook gezien als een ’groene’ onheilsprofeet avant la lettre. Voorzag hij niet al in 1918 de "ondergang" van onze leefomgeving, waarschuwde hij dus eigenlijk niet al voor de opwarming van de aarde en de gekkekoeienziekte? De receptie van zijn werk is daarmee terug bij af. Hij is niet meer dan de leverancier van een trefwoord waaraan je je eigen angsten kunt verbinden.
Toch blijft Spengler een ongemakkelijk denker. Vooral zijn instinctieve afkeer van het verstand is problematisch. Hij enthousiasmeert en vervoert méér dan dat hij overtuigt. Spengler was een metafysicus en zag zichzelf als dichter-filosoof. Hij hechtte meer waarde aan een esthetische blik dan aan strenge logica. Tijdgenoten zagen in hem niet ten onrechte een nieuwe Nietzsche, met alle gevaren van dien.
Als een van de eerste Europese filosofen richtte Spengler zijn blik op niet-westerse culturen en voorspelde hun opkomst. Maar voor de steeds belangrijker rol van Amerika bleef hij blind. Hij voorzag niet dat uitgerekend de door hem zo verafschuwde massademocratie en vrije markt een wereldmacht zou voortbrengen.
Johan Huizinga merkte al op dat het Angelsaksische deel van de wereld slechts in geringe mate gevoelig is voor ondergangsfantasieën. Ook nu lijkt het oude Europa gevoeliger voor een spengleriaans cultuurpessimisme dan voor een vooruitgangsgeloof zoals dit door Fukuyama werd uitgedragen en door de huidige Amerikaanse president wordt gekoesterd. Aan de horizon van George W. Bush gloort een universele civilisatie naar Amerikaans model.
Fukuyama schijnt intussen zijn bekomst te hebben gekregen van het neoconservatieve geloof van zijn president. Zijn verre Duitse voorganger was er al langer van overtuigd dat alleen opkomst en ondergang werkelijk bestaan. Wie een keer over het Forum van Rome heeft gewandeld, moet beseffen dat het geloof in een eeuwig voordurende vooruitgang een waanbeeld is”.
De Nederlandse schrijver en essayist Menno ter Braak (1902-1940) bezocht in maart 1935 een lezing van Oswald Spengler aan de Leidse universiteit. De zaal zat "propvol". Men was dus gekomen om Oswald Spengler te zien, meer nog dan om hem te horen waarschijnlijk. Het zijn vaak de philosophen van de heroische ondergang der cultuur, die het meeste publiek trekken, omdat zij profeteren.” Een briljant spreker was Spengler volgens Ter Braak niet. Hij spreekt zoals zijn gehele uiterlijk is: als een superieure schoolmeester, die zijn publiek iets doceert. Geen enkel effect, ook geen spoor van rhetoriek; bijna onbeweeglijk staat Spengler achter de lessenaar. [...] Even knipperen de oogleden, als er duizend jaar achteloos in de zaal worden geslingerd; een handbeweging is dat niet eens waard.”
Na Spenglers overlijden, een klein jaar later, schrijft Ter Braak: Zijn dood betekent voor Europa het verlies van een onafhankelijke geest, een onverzoenlijke aristocraat van de militaire soort, die zijn verachting voor de massa en de massabijeenkomst [...] eens uitdrukte door de woorden: "Den Neandertaler sieht man in jeder Volksversammlung". Het is dit soort stramme aristocratie, die langzaam maar zeker romantisch wordt en uitsterft. In Spengler beleefde zij een verbintenis met de geest en het aesthetisch raffinement, die vermoedelijk na hem niet vaak meer zal voorkomen.
00:45 Publié dans Hommages, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Conférence de Londres de 1930

21 janvier 1930: La conférence de Londres vise à réduire l’armement naval dans le monde. L’Italie exige d’avoir la parité avec la France. Cette conférence est la suite logique du Traité de Washington de 1922, qui visait à asseoir une hégémonie totale des puissances thalassocratiques anglo-saxonnes sur le reste des nations du monde. Ce traité de Washington est une réponse britannique et américaine à la politique de Tirpitz, car l’Allemagne est privée de tous moyens navals, et une application directe des principes énoncés par l’Amiral américain Alfred Thayer Mahan, historien des puissances navales anglaise et française au 18ième siècle et à l’époque napoléonienne. Ni la France ni l’Allemagne ne devaient encore disposer de flottes suffisamment puissantes pour pouvoir défier les thalassocraties.
00:35 Publié dans Affaires européennes, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 20 janvier 2008
Ludwig von Mises: vérités et erreurs

Ludwig von Mises, une critique libérale-capitaliste de l'économie dirigée-
Un mélange de vérités et d'erreurs
par Noël RIVIERE
00:55 Publié dans Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Du déclin de l'Europe

Brigitte SOB :
Du déclin de l'Europe : de Nietzsche à Rohrmoser
Les prophètes du déclin restent hautement appréciés. Pour eux, c’est toujours la haute conjoncture. Même les politiciens sont désormais obligés de le concéder : notre culture est frappée d’un processus de décadence inéluctable ; ainsi, par exemple, en Autriche, Jörg Haider avait écrit dans son premier livre politique : la culture, aujourd’hui, sous toutes ses formes, a perdu contenu et limites et chavire dans un « syncrétisme difficile à comprendre ». Haider souffrait-il de voir l’Europe en proie à un déclin culturel, lorsqu’il est devenu un patriote autrichien pétri de conservatisme chrétien (ce qu’il n’était pas auparavant) ?
Le fait est qu’il partage désormais sa souffrance face à la décadence européenne avec un professeur de philosophie allemand, Günter Rohrmoser. Autre fait évident : déjà Nietzsche avait prophétisé l’effondrement de la morale et de la culture. Or, on peut considérer Nietzsche comme le premier représentant de cette « conscience de la crise » au sein de la culture occidentale. Pour Nietzsche, les racines de la crise se situent dans un état de choses clairement observable : l’homme moderne est en face de traditions qui ne cessent de se dissoudre. Par l’irruption dans son quotidien de cultures différentes, cet homme moderne dispose d’une plus vaste marge de manœuvre, peut jouer et composer avec des expériences plus diversifiées, mais, simultanément, cesse d’avoir des liens solides et inébranlables avec sa propre culture, son propre héritage culturel.
Le fondement de l’analyse nietzschéenne du monde contemporain, c’est de constater la dissolution de tous les liens qu’entretenait l’homme avec le monde et son environnement. Nous vivons ainsi dans un « monde en voie d’égalisation », de nivellement : « Comme tous les styles en art se juxtaposent et se répètent, de même tous les degrés et types de morale, de mœurs et de cultures s’alignent les uns à côté des autres. C’est l’ère du nivellement, c’est sa fierté, mais aussi, sa souffrance ». Ce processus est l’avènement d’un relativisme général des valeurs et des cultures, qui, selon Nietzsche, conduit tout droit au nihilisme : les anciennes valeurs culturelles perdent leur fonction liante, la morale s’effondre.
Spengler, plus tard, a partagé cette vision. Après que l’Europe ait accompli ce qu’elle portait en son cœur profond et épuisé toutes ses potentialités, plus aucune avancée n’était possible. Telle est la quintessence de la morphologie culturelle de notre continent. D’après Spengler, une logique de l’histoire est à l’œuvre, qui s’applique à toutes les cultures : toutes subissent la loi organique de la naissance, de la jeunesse, de la maturité et de la mort. Toutes les cultures, sans exception, vivent ces lois de la biologie, explique Spengler. Elles croissent, mûrissent, entrent en déclin et meurent. Vu que la « fin des temps » s’annonce pour l’Occident, l’homo europaeus, selon Spengler, n’a plus qu’une chose à faire : accepter son destin.
Récemment, quelques penseurs chrétiens-conservateurs ont repris cette thématique : dans le débat sur le déclin des valeurs et de la culture, Günter Rohrmoser constate que le christianisme en Europe est entré dans sa phase de crise la plus profonde. Cette crise s’exprime dans le fait que les parents ne sont plus prêts à éduquer leurs enfants selon « les mœurs et les canons chrétiens ». Rohrmoser en déduit le déclin de l’Occident : la crise s’accentuera, l’atomisation interne des sociétés se poursuivra, le déclin de la culture progressera.
Rohrmoser avance la doctrine que la perte de l’éthique chrétienne conduit au déclin de la société et de la culture. Car l’éthique et la morale chrétiennes avaient une signification cardinale non seulement pour la vie de l’individu, mais aussi et surtout constituaient des critères objectifs permettant de mesurer la capacité de survie ou la propension au déclin des peuples, cultures et sociétés. De ce fait, Rohrmoser en appelle à un renouveau spirituel et éthique de facture chrétienne, afin de sauver l’Europe du déclin. Problème : peut-on objectivement mettre sur le même pied le déclin général de l’Europe et le déclin de la foi chrétienne en Europe ? La crise du christianisme est-elle une crise de la culture européenne ? Car, en effet, tout nous permet d’affirmer que, sans le christianisme, l’Europe aurait également connu une éthique constituante de son identité, le terme « éthique » dérivant de la philosophie grecque, païenne et pré-chrétienne.
Cette problématique nous permet de rappeler les thèses de Sigrid Hunke, exprimées dans La vraie religion de l’Europe et dans Vom Untergang des Abendlandes zum Anfang Europas (non traduit ; = «Du déclin de l’Occident à l’avènement de l’Europe »). Sigrid Hunke s’oppose tout aussi bien aux prophètes chrétiens de la fin des temps qu’à l’idéologie américaine du New Age. Pour elle, il faut avant toute chose dépasser la calamité dualiste qui s’est abattue sur l’Europe et que nous ont apporté le christianisme (et la gnose radicale). Le dualisme distingue l’esprit de la matière, l’intelligence et l’émotion, la nature et la raison, introduit une césure radicale entre eux. Alors que l’homme, à l’origine, est essentiellement unité et holicité. Telle est la loi première de l’anthropologie et il faut la restaurer dans tous les domaines de la culture européenne, afin de faire éclore une nouvelle renaissance. C’est dans les ruines des vieilles structures dualistes, au milieu des antagonismes fallacieux et dangereux que le dualisme a provoqués, qu’un développement nouveau germera, dit Hunke, que l’Europe retrouvera son essence et redonnera du sens à l’ensemble de nos peuples.
Qui a raison : Spengler, Hunke, Nietzsche ou Rohrmoser ? Aucun d’eux sans doute. Sans doute la plus grande erreur de la culture européenne a été de se considérer comme absolue. Prétention inimaginable. Hybris ?
Brigitte SOB.
00:20 Publié dans Affaires européennes, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 janvier 2008
R. Sennett : l'homme flexible

Brigitte SOB :
Globalisation, néo-libéralisme et « homme flexible »
Les analyses du sociologue américain Richard Sennett
La globalisation exige la flexibilité. La notion des « flexibilité » est aussi le terme magique dont raffole l’économie néo-libérale, qui salue le processus de globalisation comme un défi positif. Cette notion de « flexibilité » est issue, au départ, de l’empirisme des naturalistes : on tire profit de l’expérience, par exemple, en constatant que les arbres ploient sous la force du vent mais qu’après la tempête ils reprennent leur forme originale. La « flexibilité » est non seulement posée comme l’antonyme du « fixisme », de la « rigidité » ou de l’absence de vitalité, mais, dans le cadre de l’idéologie néo-libérale, comme le synonyme de la « liberté » ; dans ce sens, la flexibilité apporte de nouveaux défis, de nouvelles exigences, de nouveaux boulots qui exigent des déménagements fréquents et des délocalisations : l’homme flexible devient ainsi un « perpetuum mobile » au sein de l’économie globale. Tout « perpetuum mobile » est une construction qui, une fois mise en marche, demeure éternellement en mouvement, ce qui, d’après les lois fondamentales de la thermodynamique, est une impossibilité.
Le grand sociologue américain contemporain, critique des fondements de notre culture libérale, Richard Sennett, défend la thèse que cet artifice qu’est l’homme flexible ne peut survivre biologiquement sur le long terme. Pour Sennett, les questions fondamentales qui s’adressent aujourd’hui à l’économie politique et à la science politique sont les suivantes : 1) dans quelle mesure peut-on permettre au système économique de plier, ployer et tordre littéralement l’homme, pour satisfaire ses besoins d’expansion ? ; 2) l’Etat a-t-il le droit de « donner aux hommes, à ses citoyens, cette flexibilité propre aux arbres, de façon à ce qu’ils ne se brisent pas, du moins en théorie, face aux coups permanents que lui assènent les changements imposés par la nouvelle économie néo-libérale et globaliste » ? Sennett ne voit pas du tout comment s’ouvriraient les portes de la liberté si les hommes deviennent flexibles comme le veut l’économie globalitaire. Bien au contraire : l’homme flexible ne sera ni libre ni plus libre mais basculera dans l’impuissance à maîtriser et gérer son destin. Dans un contexte existentiel, dominé par l’économique, on exige sans cesse de faire face à de la nouveauté et à des changements, ce qui rend impossibles les liens sur le long terme : « La profession, le lieu de résidence, la position sociale, la famille, tout est désormais soumis aux exigences hasardeuses de la vie économique ; la vie personnelle de l’individu soumis à de telles pressions apparaît comme une mosaïque éparse et sans cohérence, dépourvue de but et incompréhensible, insaisissable. Le résultat n’est donc pas un surcroît de liberté, mais un sentiment profond d’impuissance, d’isolement et de perte de sens », écrit Sennett.
L’économie à l’ère de la globalisation est marquée par le court terme. Ce court terme exige de l’homme flexible d’être toujours prêt à changer, si besoin s’en faut, de travail, de cadre de travail, d’emploi et de domicile. Ce court terme est contraire, dit Sennett, à l’essence de l’être humain, car la constitution ontologique et psychologique de l’homme repose sur la longue durée, sur la sécurité que celle-ci procure, sur la continuité de mêmes modèles. La thèse centrale de Sennett est dès lors la suivante : la « flexibilisation » du monde du travail détruit l’homme en ses fondements ontologiques : des valeurs comme la fidélité et la responsabilité perdent automatiquement leur sens et leur signification, en même temps que toute éthique du travail ; des vertus comme la faculté de renoncer à la satisfaction immédiate des besoins au profit d’objectifs sur le long terme, disparaît.
Remarquons que Sennett insiste toujours pour dire que la tradition politique de sa famille, du moins depuis ses grands parents, s’ancre dans les réseaux de la gauche américaine. En dépit des évolutions ou involutions des gauches aujourd’hui, notamment en Europe, Sennett demeure fidèle à des valeurs comme la fidélité, la loyauté, la confiance, l’esprit de décision et surtout à celles de la famille et de la communauté.
Richard Sennett est né en 1943 à Chicago. Il a passé sa jeunesse dans les quartiers pauvres de la ville. Après avoir obtenu son diplôme en 1964, Sennett a œuvré à Harvard, à Yale, à Rome et à Washington. Aujourd’hui, Sennett vit à Londres et enseigne la sociologie et l’histoire à la célèbre « London School of Economics ». Il a acquis la célébrité grâce à plusieurs ouvrages comme « La tyrannie de l’intimité », « L’homme flexible » et « La culture du nouveau capitalisme », tous traduits en allemand de 1986 à 2005.
Dans ses livres, ce sociologue désormais célèbre participe aux grands débats sur les effets de l’économie globale sur nos sociétés. Avec un courage étonnant, il défend des idées jugées totalement inactuelles, qui ont pourtant fait de ses livres des best-sellers à l’échelle planétaire et lui ont conféré une notoriété internationale. Sennett critique en effet les involutions de nos sociétés telles l’isolement progressif des individus, la perte de toute orientation dans la jungle sociale et l’impuissance de l’homme contemporain ; de même, il ne ménage pas ses critiques sur la superficialité et l’instabilité des relations interpersonnelles qui ne cessent de croître. Il défend des valeurs telles la fidélité, le sens du devoir, le sens du but à atteindre dans la vie et l’esprit de décision ; ce sont là toutes des valeurs qui postulent que l’homme conserve son caractère naturel qui lui permet d’envisager calmement la longue durée. Sennett perçoit bien la contradiction dans laquelle le « capitalisme de la flexibilité » plonge l’homme des temps présents : « Comment peut-on protéger les relations familiales contre ces comportements basés sur le court terme, contre cette rage de toujours tout remettre en question et surtout contre ce manque chronique de loyauté et de sens communautaire, qui caractérisent le monde actuel du travail ? ».
Le « visage caméléonique » de l’économie parie aujourd’hui sur les seules capacités de l’homme à s’adapter : dans ce cas, une valeur comme la loyauté peut devenir un piège et freiner l’adaptation exigée. Le monde du travail promeut la « force qui réside dans la faiblesse des liens sociaux » et « les formes éphémères » de communauté. « Si l’on transpose cela sur la famille, cela signifie, dans une société entièrement vouée à la flexibilité : reste en mouvement, ne te lie pas et ne fais aucun sacrifice ». Sennett estime qu’une telle évolution de nos sociétés est totalement erronée, constitue une menace pour le genre humain et nous interpelle en ce sens : « Comment peut-on viser des objectifs à long terme dans une société fixée exclusivement sur le court terme ? Comment pourra-t-on maintenir des liens sociaux sur la longue durée ? Comment un être humain dans une telle société, qui ne se compose plus que d’épisodes et de fragments épars et diffus, pourra-t-il opérer une synthèse de son existence, raconter en un récit cohérent son identité et sa vie personnelle ? ».
Sennett contre également l’opinion largement répandue qui veut que les Etats-Unis soient une « démocratie de consommateurs ». A rebours de cette idée toute faite, Sennett défend la thèse que les citoyens américains sont désormais complètement désorientés face aux différences réelles qui divisent leur société. Les Américains sont tellement obsédés par l’individualisme qu’ils considèrent, souvent inconsciemment, que les masses ne méritent aucun intérêt en tant qu’ensembles humains. Pour cette raison, il est important aux Etats-Unis de se poser comme détaché des masses ou des collectivités, de s’élever au-dessus d’elles : « Le besoin de statut s’exprime d’une manière très personnelle : on veut être respecté en tant qu’individu », écrit Sennett. D’après lui, les Américains veulent que l’on juge leur position dans la société selon leur race ou leur ascendance, ce qui remplace souvent la conscience de classe qui subsiste en Europe. Critiquant les évolutions de la société américaine actuelle, Sennett dénonce la polarisation entre riches et pauvres qui ne cesse de croître aux Etats-Unis, alors que la classe moyenne s’amenuise de plus en plus, ce qui génère un sentiment général d’angoisse, de désorientation, d’instabilité et d’insécurité qui touche de vastes strates de la population. Face à ces phénomènes inquiétants, prospère une petite caste de profiteurs de la flexibilité, se hissant au-dessus d’une énorme masse de perdants.
Pour Sennett, Bill Gates, fondateur de Microsoft, constitue l’exemple paradigmatique d’un « boss de l’économie flexible » : bien que les produits de Microsoft soient, d’après Sennett, de « qualité moyenne », ils débouchent très rapidement sur le marché, pour disparaître aussi vite. Sennett cite une phrase significative de Bill Gates, pour stigmatiser son attitude face au travail : « Au lieu de s’immobiliser soi-même dans un travail aux contours bien délimités, … on devrait au contraire se mouvoir dans un réseau de possibilités ». Cette volonté d’imposer une adaptabilité flexibiliste chez Bill Gates démontre surtout, selon Sennett, que le fondateur de Microsoft est prêt, si la situation l’exige, à détruire ce qu’il a créé. D’autres réflexions de Sennett méritent également le détour : notamment celles qui concernent les systèmes d’éducation dans les pays industriels. Ces systèmes d’éducation, d’enseignement et de formation produisent un surnombre de travailleurs hautement qualifiés. Ceci nous conduit aux problèmes du chômage et du sous-emploi, où les victimes de ces effets pervers sont confrontées en permanence à un sentiment d’inutilité sociale.
Les conclusions de Sennett sont claires : les sociétés, dont les ressortissants sont majoritairement désorientés et doivent faire face à un trop grand sentiment d’inutilité sociale, et au sein desquelles des valeurs comme la confiance, la fiabilité, la fidélité, la loyauté et le sens de la responsabilité sont minées, brocardées et éradiquées en toute conscience, risquent, sur le long terme, de mettre leur existence même en péril.
Brigitte SOB.
(article paru dans l’hebdomadaire viennois « zur Zeit », n°51-52/2007 ; traduction française : Robert Steuckers).
00:55 Publié dans Economie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


