mardi, 01 janvier 2008
Sur Sir Oswald Mosley

Sur Sir Oswald Mosley
Richard Thurlow, pour le compte de l’éditeur londonien I. B. Tauris, vient de publier une nouvelle histoire du mouvement fasciste britannique, centré autour des « Black Shirts » de Sir Oswald Mosley. Outre une histoire générale de ce mouvement, né de la grande crise économique qui a secoué l’Angleterre à la fin des années 20 et au début des années 30, le livre de Thurlow aborde l’histoire personnelle de Mosley après 1940-45. Interné en 1940 pour raisons de sécurité, Mosley, écrit Thurlow, a utilisé son repos forcé en prison ou en résidence surveillée, pour lire énormément. Thurlow signale ainsi qu’il a appris la langue allemande et s’est intéressé à l’histoire de la Grèce antique. Cet intérêt a notamment renforcé son classicisme, son engouement pour les formes dites « classiques » de notre civilisation. La correspondance avec son fils Nicholas témoigne de son intérêt pour l’évolutionnisme non matérialiste, s’enracinant dans la psychologie de Jung et la nouvelle physique de Jeans et Eddington. De ces lectures éparses, Mosley déduit une théorie de l’homme de « pensée et d’action » (« Thought-Deed Man »), opposé à cette « volonté de confort », qui prévalait dans l’ethos puritain du capitalisme britannique et de sa classe dominante.
Pendant ces quelques années de réclusion forcée, Mosley a cessé d’être un nationaliste britannique pour se muer en Européen. La figure du Faust de Goethe, le wagnérisme revu par George Bernard Shaw et la philosophie de Nietzsche se sont combinés dans l’esprit de Mosley. Celui-ci estimait que, chez Faust, la quête de beauté et d’achèvement, ne pouvait se réaliser que par un effort constant, sans repos, et que si une sorte de satisfaction béate remplaçait cette quête, l’évolution personnelle de l’homme arrêtait sa marche, et qu’alors, l’extinction et la mort survenaient. La fébrilité incessante, propre de l’homme (surtout de l’homme faustien), devait être canalisée vers des objectifs positifs, socialement et politiquement utiles et féconds. Les travers de l’homme pouvaient dès lors être mobilisés pour atteindre un « Bien », surtout par le truchement de l’art et de l’action. Mosley a donc développé une vision faustienne de l’homme européen, qui s’est superposée à la vision nietzschéenne du surhomme. Son « Thought-Deed-Man » devait servir d’anthropologie fondamentale à l’Europe unie du futur. Thurlow montre que Mosley s’est efforcé de concevoir une vision positive de l’homme, de communiquer une éthique constructive à ses militants, tandis qu’une bonne part des rescapés du fascisme britannique basculait dans les théories de la conspiration et du complot (généralement « judéo-maçonnique »).
Autre volet intéressant dans l’étude de Thurlow : le débat sur l’internement et la libération de Mosley pendant la seconde guerre mondiale en Grande-Bretagne. Le principe de liberté de conscience, d’opinion et de parole est sacré en droit britannique. De ce fait, l’internement des fascistes en 1940 a suscité des réactions variées et somme toute assez mitigées. Mosley, citoyen britannique issu de la classe dominante, ne pouvait juridiquement pas être interné pour ses opinions, mais uniquement, le cas échéant, pour des actes concrets de sabotage ou de trahison, mais il n’en avait pas commis… En novembre 1943, le monde politique britannique connaît une crise sérieuse quand on parle de relâcher Mosley. Les communistes, à l’époque assez puissants et forts de l’alliance qui lie Londres à Moscou, tentent de provoquer une crise, excitent les émotions, ce qui menace la production de guerre. Thurlow rappelle que, généralement, la gauche s’insurgeait avant la guerre avec véhémence contre toute action gouvernementale visant à restreindre les libertés civiles. En novembre 43, en revanche, dans le cas de Mosley et de ses compagnons, les communistes et le « Council for Civil Liberties » (qu’ils contrôlaient partiellement), militaient pour maintenir l’ex-chef du BUF (British Union of Fascists) en détention. Harold Nicholson, membre du « Council for Civil Liberties », démissionne, car il n’accepte pas la position de la majorité de ce conseil dans l’affaire Mosley : pour Nicholson, il était illogique qu’un tel organisme, visant à défendre les libertés civiles des citoyens, appuyât le maintien en détention d’un citoyen sans jugement. Trente-huit autres membres du Council suivirent Nicholson. Ils estimaient qu’en 1940, on pouvait comprendre l’internement de Mosley et des fascistes, vu les menaces allemandes pesant directement sur le territoire britannique, mais qu’en 1943, la fortune de guerre avait changé de camp et les Allemands ne menaçaient plus l’Angleterre d’une invasion. Ensuite, Nicholson et ses amis jugeaient la position des communistes particulièrement hypocrite, dans la mesure où ils avaient, eux aussi, milité contre la guerre en même temps que Mosley. Ils étaient donc tout aussi coupables que lui, et cela, jusqu’en juin 1941, où, du jour au lendemain, ils s’étaient mués en super-patriotes !
Chez les socialistes, les attitudes furent variées. Dès 1940, le député travailliste Richard Stokes, d’Ipswich, réclame la libération de Mosley et de ses amis parce que leur détention enfreint le principe de respect absolu des libertés civiles. Aux yeux de ces travaillistes, Mosley devait soit être jugé comme traître soit immédiatement libéré. Mais, la base des syndicats, travaillée par les communistes, adresse deux lettres à Herbert Morrison, président des « trade unions », lui précisant que la libération de Mosley porterait un coup au moral des civils, parce que le leader de la BUF avait fini par symboliser le fascisme et le nazisme contre lesquels les ouvriers britanniques avaient été incités à combattre par un travail accru, des sacrifices sociaux et des cadences infernales. Quant au gouvernement conservateur de Churchill, son souci était de ne pas apporter d’eau au moulin des neutralistes américains, fortement représentés dans l’opinion d’Outre-Atlantique. En effet, il pouvait paraître incongru de faire officiellement la guerre à la tyrannie fasciste ou nazie, alors que des citoyens britanniques croupissaient en prison sans avoir été jugés. L’artifice juridique pour libérer Mosley et bon nombre de ses compagnons a été de rappeler que l’article DR18b, qui permettait temporairement l’isolement de personnes dangereuses pour la sécurité de l’Etat en temps de guerre, stipulait que la santé des prisonniers ne pouvait jamais être mise en danger. Mosley, atteint d’une phlébite, pouvant avoir des conséquences graves, devait donc être relaxé. De plus, il avait considérablement maigri, ce qui suscitait l’inquiétude des médecins. Les communistes organisèrent des manifestations dans Londres et ailleurs, mais les grèves dont ils avaient menacé le gouvernement n’eurent pas lieu. L’Union Soviétique avait besoin de matériel américain et britannique pour faire face aux troupes allemandes.
Benoît DUCARME.
Richard THURLOW, Fascism in Britain. From Oswald Mosley’s Blackshirts to the National Front, I. B. Tauris, London, 1998, 298 pages, ISBN 1-86064-337-X.
00:45 Publié dans Biographie, Histoire, Livre, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 30 décembre 2007
Quand les Philippines devinrent une colonie US

Saverio BORGHERESI :
Quand les Philippines devinrent une colonie américaine
Pour comprendre la problématique de la guerre hispano-américaine de 1898 et de la conquête et de la soumission des Philippines par les Etats-Unis, méditons d’abord cet extrait d’un discours du Président américain William McKinley, tenu en 1899 :
« J’ai parcouru les corridors et les pièces de la Maison Blanche, nuit après nuit et je n’ai pas honte de vous dire, Messieurs, qu’en plus d’une occasion je suis tombé à genoux et j’ai prié le Dieu tout puissant pour qu’il m’accorde sa lumière et me guide. Et, une nuit, à une heure tardive, je ne sais comment, mais c’est arrivé, j’en suis venu aux conclusions suivantes : nous ne pouvons en aucun cas rendre les îles des Philippines à l’Espagne parce que ce serait un acte vil et déshonorant ; nous ne pouvons pas davantage les confier à la France ou à l’Allemagne, car elles sont nos concurrents commerciaux en Orient et ce serait, en plus, un mauvais choix, qui diminuerait notre prestige international ; nous ne pouvons pas non plus les abandonner à elles-mêmes parce qu’elles ne sont pas en mesure de se doter d’un gouvernement autonome et sombreraient rapidement dans l’anarchie ou tomberaient sous la houlette d’un gouvernement étranger pire encore que celui de l’Espagne ; il ne nous reste donc plus rien d’autre à faire que de les occuper et d’instruire les Philippins, de les élever au-dessus de leur triste condition actuelle, de les civiliser, de les christianiser et, avec l’aide de Dieu, de faire de notre mieux pour les aider car ils sont nos frères pour qui le Christ est aussi mort sur la croix ».
L’idée que McKinley avait derrière la tête, en dépit de ce discours « généreux », était d’envoyer l’armée américaine tuer un maximum d’indépendantistes philippins, de brûler leurs villages, de les soumettre à la torture et de jeter les bases d’une colonie destinée à être exploitée de fond en comble jusqu’à la fin des temps. Après le conflit hispano-américain de 1898, les Espagnols furent chassés des Philippines, par une action commune des forces américaines et des rebelles locaux.
Les Philippins, sous la houlette du charismatique Andrès Bonifacio, avaient déjà proclamé leur indépendance, mais ni les Espagnols ni les Américains, ne l’avaient reconnue. L’Espagne fut contrainte de confier l’archipel pacifique aux Etats-Unis, contre un paiement de vingt millions de dollars, sans tenir compte des décisions prises par les populations autochtones.
Les groupes de libération avaient déjà assumé le pouvoir sur tout le territoire national, à l’exception de Manille où la garnison espagnole ne s’est rendue qu’aux seuls Américains.
Dans les mois qui ont suivi, les Américains renforcèrent considérablement leurs effectifs dans l’archipel, où ils concentrèrent finalement une armée de 115.000 hommes. Leur objectif déclaré était d’établir un régime colonial aux Philippines. La situation était de plus en plus tendue, ce qui conduisit à l’explosion à Manille, le 4 février 1899, après un bref affrontement entre Philippins et soldats américains. Le jour suivant, le conflit s’est étendu à toute la ville, provoquant la mort de deux mille Philippins et de deux cents Américains.
Après cet incident, le Président Aguinaldo proposa au Général Otis une trêve unilatérale, que les Américains refusèrent immédiatement. McKinley ordonna tout de suite la capture d’Aguinaldo, l’accusant de « banditisme ». McKinley ne déclara jamais la guerre aux Philippines parce qu’il considérait qu’elles étaient déjà entièrement possession des Etats-Unis. A la fin du mois de février 1899, les yankees réussissent à pacifier Manille et ses environs, obligeant l’armée philippine à se retirer vers le nord. A la suite de ce retrait, les forces américaines commencèrent une offensive de grande envergure et battirent les Philippins à Quingao en avril, à Zapoté en juin et à Tirad en décembre.
Au cours de cette première année de guerre, les troupes philippines subirent de terribles revers sur le plan militaire, en perdant notamment leurs plus valeureux généraux comme Gregorio del Pilar et Antonio Luna. Les commandants de l’armée philippine, pour faire face à l’écrasante supériorité des Américains, décidèrent d’adopter de nouvelles tactiques militaires pour éliminer leur présence dans l’archipel. Ils organisèrent des sabotages, de brèves escarmouches, pendant les années qui suivirent leurs défaites. Au cours des quatre premiers mois de l’année 1900, cinq cents militaires américains perdirent la vie dans des actions de guérilla. Les Philippins enregistrèrent alors de petites victoires militaires à Paye, à Catubig, à Makahambus, à Pulag, à Balangigga et à Mabitac.
Pour faire face aux succès des rebelles philippins, les Américains organisèrent de féroces répressions au détriment de la population civile. La majorité des militaires engagés dans cette guerre avaient eu l’habitude de nier totalement les droits des gens, étant donné qu’ils étaient souvent des vétérans des guerres indiennes. Les mêmes tactiques, jadis utilisées contre les Amérindiens, furent mises en œuvre contre les malheureux Philippins : des villages entiers furent détruits, sympathisants et chefs locaux furent éliminés. Les Américains créèrent ensuite des camps d’internement où furent reclus les Philippins, pour y mourir d’inanition.
La tactique yankee parvint à miner les bases des mouvements indépendantistes locaux. Le 23 mars 1901, à cause de l’aide apportée aux envahisseurs par des traîtres indigènes, le Président Aguinaldo est capturé à proximité de Palan. Une semaine plus tard, à Manille, Aguinaldo fut contraint de jurer obéissance aux Etats-Unis et d’appeler les Philippins à déposer les armes.
La capture du Président fut un coup dur pour la résistance populaire, mais les événements ultérieurs ne se déroulèrent pas comme l’avaient espéré les Américains. L’armée de libération lança une terrible contre-attaque, concentrant ses coups principalement dans la région de Batagans. Certes, cette contre-attaque victorieuse n’entama pas la supériorité militaire américaine. Les pertes chez les Marines furent insignifiantes. Mais elle fit comprendre à Washington que la guerre n’était pas finie. Le Général Bell répondit avec une férocité accrue à la renaissance armée du mouvement indépendantiste, en renforçant toutes les mesures répressives contre les insurgés. En 1903, les indépendantistes durent faire face à de graves problèmes logistiques et financiers, face à un ennemi trop puissant. Les dernières troupes rebelles se rendirent donc aux envahisseurs.
Quelques nationalistes philippins n’acceptèrent pas cette reddition et continuèrent la guérilla pendant plus de dix ans. Siméon Ola, qui dirigeait ces groupes d’inconditionnels dans la région de Bicol, fut battu le 25 avril. Il fut le dernier général vaincu en rase campagne. Le reste de ces groupes armés était constitué de milices paysannes, recrutées parmi les plus pauvres des ruraux, et menées par des chefs messianiques qui se référaient tout autant aux traditions animistes qu’au catholicisme importé par les Espagnols. En 1913, la milice commandée par Dionisio Sequela, mieux connu sous le surnom de Papa Isio, dépose les armes la dernière, mettant ainsi fin à la guerre entre Philippins et Américains.
Ce conflit a causé la mort de plus d’un million de personnes (90% de victimes civiles). Les Américains, pour sauver les apparences de la « démocratie » qu’ils importaient, instaurèrent une « Assemblée nationale » composée surtout de latifundistes. En 1946, les Etats-Unis concédèrent l’indépendance aux Philippines, mais continuèrent à exercer une influence prépondérante sur le pays, surtout sur la vie économique et politique.
Saverio BORGHERESI.
(article paru dans « Rinascita », Rome, 23 novembre 2007; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:35 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Fondation du MSI

Fondation du MSI
30 décembre 1946 : Fondation à Rome du « Mouvement Social Italien », que les médias ne cesseront de qualifier de « néo-fasciste ». Ce mouvement connaîtra bon nombre de vicissitudes au cours de son histoire, créera un espace politico-culturel vivant qui culminera avec la revue « Area » qui paraît toujours, avant de se transformer sous l’impulsion de Gianfranco Fini en une « Alliance Nationale », qui reprend certes des positions du MSI mais les complète ou les édulcore de référents gaullistes (l’option pour un régime présidentialiste) ou républicains à l’américaine (avec la mascotte « éléphant » lors d’une campagne électorale). Cette modernisation ne fait pas l’unanimité, même si elle fait incontestablement la majorité : Fini est accusé de « trahison » et le parti « Fiamma Tricolore » reprend à son compte le décorum et l’esprit du premier MSI. La formation AN de Fini entrera dans un gouvernement de coalition de centre-droit après la victoire électorale du mouvement « Forza Italia » du milliardaire Berlusconi, qui balaie les vieux partis historiques de la République d’après 1945. L’AN fait désormais partie intégrante du paysage politique italien.
00:30 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 décembre 2007
Les Sikhs et la Khalsa

Moestasjrik / ‘t Pallieterke :
Les Sikhs et la Khalsa
On discute actuellement au Parlement belge du droit des Sikhs au port de leur dague traditionnelle, le « kirpaan ». Le terme, désignant cette arme blanche, dérive du mot « kripa », qui signifie la « grâce » ; les Sikhs actuels affirment qu’il ne portent cette dague que pour se défendre ou pour protéger les faibles contre toute agression et jamais pour commettre eux-mêmes des agressions. Les Sikhs bénéficient du privilège de porter cette arme, vecteur de paix selon leur tradition, en Inde, leur patrie, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays du Commonwealth. Ce privilège ne découle pas de l’idéologie des Lumières dans sa nouvelle mouture multiculturaliste mais de la position dont jouissaient déjà les Sikhs dans l’Empire britannique car ils s’étaient alliés aux Anglais dès l’époque de la grande révolte des Indes en 1857.
La région, d’où les Sikhs sont originaires, venait alors d’être conquise par les Britanniques et les peuples indigènes se souvenaient de la supériorité militaire de leurs conquérants. Les Sikhs ne partageaient pas l’optimisme des autres Indiens qui pensaient pouvoir submerger facilement les Britanniques, peu nombreux, en jetant dans la bataille la masse innombrable de leurs combattants. Ensuite, les insurgés indiens de 1857 avaient élu le dernier « padeshah », ou dernier empereur mogol, comme chef de leur révolte, l’indolent Bahadur Shah Zafar, souverain nominal du résidu d’empire qui était, de fait, sous le contrôle réel des Britanniques. La dynastie mogol était l’ennemie héréditaire des Sikhs : raison pour laquelle ceux-ci choisirent le camp britannique. Les Sikhs sauvèrent la vie d’administrateurs britanniques, de leurs épouses et enfants. Après le rétablissement de la puissance britannique, ils furent récompensés de leur fidélité en pouvant faire carrière dans l’armée coloniale ; ils servirent partout : du Kenya à Singapour et à Hong Kong. Dans l’album de Tintin, « Le Lotus Bleu », on voit des Sikhs dans les unités de maintien de l’ordre de la concession internationale de Shanghai.
Les « disciples »
Le sikhisme est une école fondée par le gourou Nanak (1469-1539), inspirateur d’un courant dévotionnel à l’intérieur du culte de Vishnou et de ses réincarnations Rama et Krishna. Le terme « Sikh » signifie donc « disciple », en l’occurrence disciple du Maître Nanak. Pendant la vie de ce dernier, le Sultanat de Delhi -régime d’occupation qui confirme les pires stéréotypes sur l’islam sanguinaire- fut éradiqué par le conquérant ouzbek Babar, descendant tout à la fois de Genghis Khan et de Timour Lenk (ou « Tamerlan »). Babar fondit en 1526 l’Empire Mogol qui, au départ, poursuivit la politique de terreur du Sultanat de Delhi contre les « incroyants ». Sous le règne du petit-fils de Babar, Akbar, cette politique fut abrogée et remplacée par un régime plus tolérant. Pendant un siècle environ, l’Inde vécut ainsi sous un régime de réelle tolérance jusqu’à ce que le Padeshah Aurangzeb se remit à serrer la vis vers 1668. Toutefois le cinquième gourou des Sikhs connut la mort du martyr en 1606. Il avait compilé un certain nombre de vers pieux de Nanak et d’autres poètes hindous pour un faire une anthologie portant pour titre « Gourou Granth » ; la cour mogol apprit que ce livre contenait quelques propos anti-islamiques. Ce fut considéré comme intolérable : le gourou fut torturé pendant cinq jours jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Le neuvième gourou des Sikhs fut lui aussi exécuté après qu’il ait refusé de se convertir à l’islam. Son fils, le gourou Govind Singh, décida que de telles exécutions ne pouvaient plus avoir lieu dans l’avenir et constitua en 1699 une milice pour lutter contre le pouvoir musulman. C’est ce que nous rapporte la légende mais, toutefois, il convient de dire que la vérité historique est moins binaire. Les Sikhs eux-mêmes n’avaient jamais cherché la confrontation : ce furent les Mogols qui rompirent l’équilibre et l’entente entre confessions en faisant exécuter les chefs spirituels qu’ils jugeaient « mécréants ». Les Sikhs retrouvèrent assez rapidement les faveurs de la Cour mogol. Plus d’un gourou sikh devint le conseiller ou le confident des empereurs ou des princes héritiers, notamment le père de Govind, avant que celui-ci ne tombe en disgrâce, et Govind lui-même après s’être péniblement extrait de cet état de disgrâce.
Malgré ces périodes de connivence, le gourou Govind, au beau milieu de son magistère, entre 1699 et 1705, était bel et bien en conflit avec le régime mogol musulman. La confrontation ne fut pas glorieuse pour lui : il fut poursuivi, chassé, défait ; deux de ses quatre fils tombèrent au combat ; les deux autres furent capturés puis torturés à mort. Govind n’a donc pas eu de postérité biologique directe : il décida que la lignée des gourous sikhs était définitivement achevée et que le seul gourou, dorénavant, devait être le livre « Gourou Granth ». Bon nombre de ses disciples lui tournèrent le dos, à cause de sa direction malheureuse. Finalement, il envoya au Padeshah Aurangzeb une lettre, où il émit quelques critiques -raison pour laquelle les Sikhs le considèrent comme courageux et appellent sa lettre « Zafar-Nama », la « lettre de la victoire »- mais, en fin de compte, il y offrit sa soumission. Il devint un courtisan du prince héritier Bahadur Shah. Parce que le gouverneur mogol, qui avait battu Govind, se sentait menacé par l’amitié qui liait ce dernier au nouveau Padeshah, il le fit assassiner en 1708. Govind fut ainsi le troisième gourou à périr d’une main musulmane, ce qui contribua, bien évidemment, à consolider la haine profonde qu’éprouvent les Sikhs à l’endroit des musulmans, une haine qui fut réactivée en 1947 lorsqu’ils furent expulsés en masse du Pakistan, nouvel Etat islamique issu de la décolonisation du sous-continent indien.
Ce n’est donc qu’après la mort de Govind que le sikhisme prit l’initiative militaire de combattre le pouvoir musulman. Banda Bairagi, homme de confiance de Govind, mena une insurrection, qui fut écrasée dans le sang. Mais, sur ces entrefaites, la puissance mogol se vit brisée par un facteur nouveau, venu du sud, les Marathes hindous. L’Empire mogol n’eut plus qu’une existence nominale, tandis que le véritable pouvoir était exercé par les Marathes, qui le tiendront jusqu’à leur défaite de 1818 face aux Britanniques. Dans la région des Sikhs, il y eut donc subitement, à cause de la défaite des Mogols face aux Marathes, un vide de pouvoir, leur permettant de proclamer leur propre Etat, qui résista à l’avance des Britanniques jusqu’en 1849.
Les cinq « K »
Malgré ses déboires militaires, le gourou Govind demeurera dans l’histoire pour avoir, en 1699, réorganisé une partie des Sikhs en un ordre militaire, la Khalsa (de l’arabe « khalis », signifiant « pur »). Lors d’un rassemblement, il aurait dit -mais la narration de cette assemblée date de 1751 et est donc peu fiable- qu’il avait besoin de quelqu’un qui soit prêt à donner sa vie. Un premier volontaire se présenta : c’était un homme appartenant à la même caste que les dix gourous qui s’étaient succédé depuis Nanak.
Ce volontaire s’engouffra dans une tente en compagnie de Govind. Le gourou en sortit un peu plus tard, un sabre ensanglanté à la main. Malgré le suspens pesant sur l’assemblée, un deuxième volontaire se présenta et entra dans la tente, puis un troisième. Après un manège identique avec cinq volontaires au total, le gourou sortit de la tente, avec les cinq volontaires, désormais appelés les « cinq favoris », se tenant par la main, tous bien vivants, rayonnant dans leurs habits et leurs turbans orange. Ils appartenaient à cinq différentes castes et venaient de cinq régions différentes, symbolisant par là même l’unité des Sikhs.
Les membres de la Khalsa, qui devinrent l’élite « normante » de la communauté sikh, doivent se tenir à toute une série de règles. Ainsi, ils ne peuvent pas épouser une femme musulmane ni manger de la viande « halal » (c’est-à-dire de la viande pure selon les critères de l’abattage rituel islamique). Cette disposition de la Khalsa pourrait avoir un réel impact sur nos sociétés devenues multiculturelles : nos enfants sont contraints, désormais, de manger de la nourriture « halal », dans les cantines scolaires sous prétexte que cela ne fait aucune différence pour eux, alors que leurs condisciples musulmans, eux, ne peuvent pas manger de viande « non halal ». Mais que doit faire dès lors l’enfant d’immigrés sikhs ? Pour eux, cette nourriture « halal » constitue un interdit alimentaire, quoique de manière inverse : il leur est rigoureusement interdit d’en absorber ! Toute école « progressiste », qui fait de la multiculturalité islamocentrée une obligation absolue à respecter, et qui fait cuire des plats « halal » pour l’ensemble de ses élèves, mais ne prend évidemment pas la peine de faire cuire des plats « non halal » pour les élèves chrétiens ou laïcs, lesquels doivent ipso facto renoncer à leur cuisine traditionnelle, devra à l’avenir, du moins si elle veut respecter les critères pluralistes de la multiculturalité, faire cuire des plats non halal pour d’éventuels élèves sikhs, faute de quoi leurs discours multiculturels apparaîtraient pour de la pure farce ou pour une islamisation déguisée, ce qui serait une option monoculturelle et non plus multiculturelle.
Les membres de la Khalsa ne peuvent jamais camoufler leur identité en portant des vêtements banals. Il faut qu’ils soient reconnaissables en portant la barbe et un certain type de turban, en portant également le titre honorifique du guerrier « Singh » (= « lion ») et en respectant la règle des cinq « K » : « Kesha » pour « cheveux », lesquels ne peuvent être coupés ; « Kangha » pour « peigne », afin de pouvoir porter leurs longues chevelures de manière ordonnée et soignée, à la différence de la pilosité désordonnée des ascètes hindous (le sikhisme est contre le renoncement au monde et le célibat monacal) ; « Kara » pour le bracelet d’acier ; « Katchtchiha » pour le pantalon knickerbockers sur le modèle militaire britannique ; et enfin, « Kirpaan », pour la fameuse dague, que les autorités indiennes et britanniques permettent de porter, aujourd’hui encore.
Renoncer au port de cette arme blanche est donc inacceptable pour les Sikhs membres de la Khalsa. Etre en mesure de se défendre par les armes est pour eux une obligation.
Moestasjrik/’t Pallieterke, 19 décembre 2007 (trad. franç.: Robert Steuckers).
00:30 Publié dans Histoire, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 26 décembre 2007
Idée nationale et liberté

Prof. Dieter Langewiesche : l’idée nationale génère la liberté…
Professeur d’histoire à Tübingen et lauréat du Prix Leibniz en 1996, Dieter Langewiesche, aujourd’hui âgé de 64 ans, s’est spécialisé dans l’histoire du libéralisme et du nationalisme en Allemagne. Il est un Européen convaincu, estime que l’Europe doit se construire en dépassant les petits nationalismes du passé. Néanmoins, il ne partage pas l’hostilité gratuite des idéologies dominantes aux nationalismes démocratiques et libertaires d’antan. Sa thèse est la suivante : la xénophobie et l’esprit guerrier, qui se dégageaient des nationalismes de libération du 19ième siècle sont des éléments constitutifs du politique, dont on ne peut ignorer les apports. Dans le n°4/2007 de l’hebdomadaire « Der Spiegel », le Prof. Langewiesche explicite ses thèses dans un long entretien, accordé aux journalistes Martin Doerry et Klaus Wiegrefe, à l’occasion d’une série d’articles à paraître sur l’ « invention des Allemands » (Die Erfindung der Deutschen), soit sur le processus de formation de la nation allemande.
Voici ces thèses :
Les nations dégagées de l’étau soviétique après la disparition du Rideau de Fer ont réactivé spontanément un nationalisme, tout simplement parce qu’il est légitime de refuser toute immixtion venue de l’extérieur, de voisins trop puissants, surtout quand cette immixtion s’est avéré désastreuse sur bien des plans.
La nation (et partant l’idée nationale) est un instrument commode pour partager les ressources du pays entre les nationaux, ressources qui sont évidemment économiques mais aussi culturelles. L’idée nationale sert à donner accès à tous à la culture et à la formation scolaire, universitaire et para-scolaire. La liberté, que croyaient obtenir Slovaques, Ukrainiens ou Slovènes, est une vertu politique qui permet, elle aussi, d’allouer correctement les ressources du pays aux nationaux. Idéal de liberté et idée nationale vont de paire. L’idée nationale est quasi synonyme de « souveraineté populaire ».
L’idée nationale a été, de toutes les idées politiques avancées par les Européens au cours des deux derniers siècles écoulés, la plus mobilisatrice. C’est elle qui a fait bouger les masses, les a sorties de leur léthargie politique.
Il n’y a pas d’alternative à l’idée nationale, si l’on veut créer un pays, ressusciter l’émergence d’un Etat national. Les pays qui ne génèrent pas d’idée nationale se décomposent en groupes d’autre nature, comme les tribus, incapables de produire une conscience d’appartenance qui va au-delà de leurs propres limites. De plus, sans idée nationale, avec le seul stade tribal de la conscience politique, il est impossible de faire éclore des systèmes institutionnels viables sur le long terme.
Certes, quand l’idée nationale se mue en nationalisme agressif, l’Etat, qui en dérive, devient une véritable machine à agresser ses voisins. Mais il est impossible de prendre prétexte de cette dérive, pour condamner l’idée nationale en soi, car rien ni personne ne peut trier et séparer proprement les bons des mauvais éléments du complexe idée nationale/nationalisme.
L’introspection que postule la création d’un Etat, d’institutions politiques et culturelles positives, induit nécessairement à se démarquer de l’Autre, de l’extérieur. Ce travail d’introspection a été jugé « irrationnel » par une certaine historiographie : cette posture intellectuelle est fausse. Ce travail, dit Langewiesche, est bel et bien rationnel. Car sans introspection, sans repli sur les limites de ce qu’est la nation, il est impossible de déterminer qui vote pour le Parlement, qui a droit à quoi dans le partage des ressources nationales. Langewiesche est conscient que les Etats où vivent plusieurs minorités importantes ont souvent pratiqué l’exclusion de ces dernières, ce qui a entraîné d’autres problèmes (ndlr : qui sont récurrents : il suffit de lire les limites que s’impose le nouveau groupe IST/Identité, Souveraineté, Transparence, au Parlement Européen, vu les litiges entres Roumains centralistes et minorités hongroises, allemandes et autres, litiges que n’acceptent pas les Autrichiens notamment).
Le danger que recèle l’idée nationale, quand elle se mue en nationalisme, est de ne pas pouvoir terminer les guerres entamées, contrairement à ce qui se passait à l’époque des « guerres de forme ». Le processus propagandiste de mobilisation des masses a provoqué des conflagrations telles que les classes dirigeantes ont dû justifier les pertes énormes, en évoquant le caractère sacré de la guerre en cours. Dans une telle situation, faire la paix sans avoir gagné la guerre s’avère particulièrement difficile.
Les nations ont pour ciment principal la conscience historique. Elles sont des communautés de souvenirs, dont on ne peut aisément se soustraire, sans se renier intimement. Pour Elias Canetti, auquel se réfère Langewiesche, les nations sont des communautés de sentiments partagés.
L’idée nationale, bien qu’unificatrice, ne gomme pas nécessairement les autres forces politiques ou religieuses présentes. Celles-ci demeurent sous-jacentes, susceptibles de se re-dynamiser. Mais sans l’idée nationale, ces forces provoqueraient des dissensions civiles graves. Dans l’Allemagne d’après 1945, on a voulu remplacer cette idée nationale par un « patriotisme constitutionnel », par une fidélité à un texte abstrait, celui de la « loi fondamentale » de 1949. Cependant, en cas de crise importante, ce patriotisme constitutionnel s’avèrerait bien insuffisant. Le « Verfassungspatriotismus » de Dolf Sternberger et de Jürgen Habermas ne génère pas suffisamment de « force liante ».
Ernst Gellner estime que l’idée nationale est une construction artificielle, née dans le cerveau des intellectuels du 19ième siècle. Pour Langewiesche, cet argument de Gellner est pertinent, mais seulement dans la mesure où l’on peut constater que l’émergence des faits nationaux et nationalitaires n’était pas une fatalité, inscrite dans les astres. Langewiesche cite alors l’exemple de la France, première nation nationaliste moderne, où les masses paysannes n’ont pas été intégrées dans l’ensemble national avant la fin du 19ième (ndlr : les émeutes, bagarres et accrochages contre la loi Combe le prouvent encore dans la première décennie du 20ième siècle ; ce sera la fusion des masses paysannes dans l’armée à partir de 1914 qui inclura cette masse rurale hexagonale dans le fait national). En France, poursuit Langewiesche, le paysannat se référait à d’autres appartenances : régionales ou locales. Les intellectuels, en effet, parlaient de la nation, comme d’un tout intégré ou à intégrer le plus rapidement possible. En Allemagne, l’idée nationale a certes été répandue par des intellectuels (Fichte, Arndt) mais aussi par des chanteurs itinérants, des pratiquants de la gymnastique populaire (Jahn) et des compagnies de « Schütze » (ndlr : en Belgique : des « serments d’arbalétriers », mais ceux-ci n’ont jamais revêtu une quelconque influence politique ; en revanche, les concours de chants ont eu, en Flandre, une importance capitale dans l’éclosion de la conscience nationale flamande ; nous avons d’ailleurs toujours la « Vlaams Nationaal-Zangfeest » à Anvers chaque année en avril). La culture populaire, non intellectuelle, a donc servi de ciment à l’idée nationale allemande.
Le Zollverein (l’Union Douanière) allemande de 1834 lève des barrières internes, processus qui fait éclore un sentiment de communauté chez les industriels, négociants et compagnons de toute l’Allemagne. L’UE pourrait avoir un effet analogue en Europe dans les prochaines décennies.
L’idée nationale demeure l’antidote majeur aux effets pervers de la globalisation contemporaine, et si elle ne parvient pas à les atténuer, elle perdra la force liante qu’elle a toujours eue.
(résumé par Robert Steuckers de l’entretien accordé par le Prof. Dieter Langewiesche au « Spiegel », n°4/2007).
00:30 Publié dans Affaires européennes, Définitions, Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 25 décembre 2007
1745: Paix de Dresde

25 décembre 1745 : Signature de la Paix de Dresde entre la Prusse, l’Autriche et la Saxe. Elle met fin à la deuxième guerre de Silésie, que l’Autriche avait tenté de récupérer par la force des armes. Tant que l’Autriche possédait la Silésie, elle avait accès, via le haut bassin de l’Oder, à la Baltique. Elle pouvait prétendre à terme réaliser le vœu du Roi de la Bohème médiévale, Ottokar II Przmysl, c’est-à-dire former un royaume centre-européen, unissant sous une seule autorité, tous les territoires entre la Baltique et l’Adriatique. La Prusse de Frédéric II s’opposait à une présence autrichienne dans les bassins fluviaux parallèles de la plaine d’Allemagne du Nord et contestait la souveraineté de Vienne en Silésie (bassin de l’Oder) et en Bohème (bassin de l’Elbe).
Lors de l’affrontement de 1745, les victoires successives des armes prussiennes à Soor et à Kesseldorf, et l’occupation consécutive de Dresde, capitale de la Saxe, le 17 décembre 1745, contraignent les Saxons et les Autrichiens à négocier. La Prusse de Frédéric II préfère, elle aussi, une solution négociée, à une poursuite de la guerre, car elle craint une intervention russe en faveur de l’Autriche et de la Saxe. Les Anglais ne pouvaient pas intervenir aux côtés de la Prusse car la révolte de l’Ecosse mobilisait toute l’attention du gouvernement de Londres et toutes les troupes disponibles. L’Autriche préférait quitter le théâtre d’opérations du Nord de l’Europe pour affronter les Français, alliés à l’Espagne des nouveaux Bourbons, en Italie et dans les Pays-Bas. Conclusion : à la suite de la Paix de Dresde, la Prusse conserve la Silésie mais reconnaît l’Empereur Charles, époux de Marie-Thérèse. La Saxe ne s’en sort pas trop bien : elle doit payer un million de thaler de dédommagement à la Prusse.
00:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 décembre 2007
1979: les troupes soviétiques en Afghanistan

24 décembre 1979 : Les troupes soviétiques entrent en Afghanistan
Le 27 avril 1978, le « Parti Démocratique Populaire d’Afghanistan » avait pris le pouvoir sous la direction de Muhammad Taraki. Le pays se rapproche de l’URSS afin de parfaire un programme de réformes sociale, surtout dans les domaines de l’éducation et de la réforme agraire. Notons, au passage, que l’Afghanistan avait bien dû se tourner vers l’URSS, les puissances anglo-saxonnes, qui soutenaient alors Khomeiny, voyaient d’un mauvais œil les tentatives iraniennes de venir en aide aux Afghans.
Ce nouveau régime, en observant la situation chaotique dans laquelle se débattait l’Iran, met immédiatement les agitateurs religieux au pas. La CIA décide tout de suite de soutenir une trentaine de groupes de moudjahhidins. La situation devient alors bien vite critique. Dans les troubles qui agitent l’Afghanistan, Taraki est assassiné. En septembre 1979, Hafizullah Amin prend le pouvoir, ce qui déclenche une guerre civile, amenant, le 24 décembre, les troupes soviétiques à intervenir, pour rétablir l’ordre. Amin est exécuté. Babrak Karmal accède alors au pouvoir et demande à Brejnev l’appui permanent de troupes soviétiques. Ce qui lui est accordé. L’Occident capitaliste (l’américanosphère) et l’Islam radical condamnent l’intervention et forgent une alliance qui durera jusqu’aux attentats du 11 septembre (qui n’y mettront fin qu’en apparence).
Le 21 mars 1980, les Afghans hostiles aux Soviétiques forment une « Alliance islamique pour la liberté de l’Afghanistan », qui comprends des fondamentalistes et des monarchistes. Cette alliance, dont le nom contient les vocables « islamistes », pour plaire aux bailleurs de fonds saoudiens, et « liberté », pour plaire aux Américains, comptait sept partis islamistes, dont quatre étaient jugés fondamentalistes et trois, plus ou moins modérés. Ces partis installent leur QG sur le territoire pakistanais voisin. Dans la longue guerre qui s’ensuivra, les services pakistanais, dont surtout l’ISI, recevront et distribueront l’argent et les armes venus des Etats-Unis, d’Arabie Saoudite et d’organisations « privées » arabo-musulmanes.
Zbigniew Brzezinski, artisan de cette stratégie, avouera, dans un entretien accordé au « Monde », que la version officielle d’une aide aux moudjahhidins à partir de 1980 est fausse. D’après le stratège, c’est le 3 juillet 1979 que la décision a été prise d’armer les moudjahhidins, pour attirer l’URSS dans un piège, afin de la déstabiliser par une opération coûteuse et de lui donner une mauvaise image médiatique, tant dans le monde arabo-musulman que dans l’américanosphère.
00:20 Publié dans Affaires européennes, Défense, Eurasisme, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 23 décembre 2007
1861: Création de la Principauté de Roumanie

23 décembre 1861 : Création de la Principauté de Roumanie
Les assemblées représentatives de la Valachie et de la Moldavie sont réunies en un seul parlement, dont le siège est fixé à Bucarest dès février 1862. Alexandre-Jean Cuza devient Prince de Roumanie et obtient l’investiture du Sultan ottoman, qui demeure le suzerain en titre des provinces valaques et moldaves. Dans la foulée, l’église orthodoxe roumaine proclame son autocéphalie, malgré la réticence du Patriarche de Constantinople, qui ne l’acceptera qu’en 1885.
Cuza est issu d’une famille de boyards. Il a toujours défendu l’unité des « principautés danubiennes » (Valachie et Moldavie). Quand il devient Prince de Valachie le 5 février 1859, la Roumanie est unifiée de facto. Sur le plan politique, Cuza n’obtiendra pas l’assentiment des masses populaires et paysannes, qui lui reprochaient son idéologie libérale et occidentale. Le 22 février 1866, il est contraint d’abdiquer. Charles de Hohenzollern-Sigmaringen deviendra, immédiatement après cet incident, Roi de Roumanie sous le nom de Carol I (26 mars 1866). A.J. Cuza quittera la Roumanie définitivement et connaîtra l’exil jusqu’à sa mort, survenue à Heidelberg le 15 mai 1893.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 22 décembre 2007
Volonté française d'annexer la Sarre
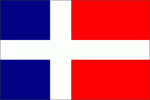
Drapeau sarrois imposé par les troupes d'occupation française en vue d'une annexion que refusait le peuple
Volonté française d'annexer la Sarre
22 décembre 1946 : La France manifeste clairement son intention d’annexer la Sarre allemande. Elle l’isole, en ce 22 décembre 1946, des autres territoires allemands par un cordon douanier qui se veut hermétique. Cette politique d’agression reçoit l’approbation des Britanniques et des Américains mais non des Soviétiques. Molotov entend se tenir aux décisions prises à Potsdam et refuse l’intégration économique de la Sarre à la France, prélude à son annexion pure et simple. Rappelons que la Sarre a été envahie par les armées révolutionnaires en même temps que les Pays-Bas autrichiens. L’Autriche ne reconnaîtra le fait accompli de l’annexion de la rive gauche du Rhin que lors du Traité de Campo Formio en 1797 et après avoir reçu en compensation la Lombardie et la Vénétie. En 1814 quand l’Ogre est vaincu une première fois et envoyé à l’Ile d’Elbe, la France garde la Sarre, déchue au rang de vulgaire « département », mais la perd en 1815 après Waterloo, en même temps que les forteresses de Philippeville et Mariembourg, qui reviennent ainsi dans le giron des Pays-Bas méridionaux. Au cours du 19ième siècle, l’obsession ne sera pas tant la Sarre que le Luxembourg, qu’il faudra protéger des visées expansionnistes de Napoléon III. Ni 1918 ni 1945 ne permettront d’annexer la Sarre qui restera allemande en dépit de tout.
00:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jean Tulard

22 décembre 1933 : Naissance de Jean Tulard
Historien français, spécialiste de l’ère napoléonienne. Professeur à la Sorbonne et à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, directeur de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Jean Tulard est surtout connu pour ses études sur l’ère révolutionnaire et bonapartiste en France. A ce titre, il préside l’Institut Napoléon.
Certes, dans notre pays, le bonapartisme est quasi inexistant et Napoléon a toujours fait figure de croquemitaine : c’est celui qui enrôlait nos paysans de force pour les envoyer aux quatre coins de l’Europe combattre des peuples qui nous paraissaient bien sympathiques. Les comptines que fredonnait mon grand-père, en me faisant sauter sur ses genoux, évoquaient l’ « Ogre », bref un personnage fort éloigné des images d’Epinal que l’on ressasse encore et toujours en France. Jean Tulard, pourtant, n’est pas un auteur qui fait continuellement l’apologie de Napoléon. Loin de là !
Dans un ouvrage remarquable de concision et de clarté, intitulé Les révolutions de 1789 à 1851 (Fayard, 1985), Tulard tire le juste bilan de cette époque, qui court de 1789 à 1848 et à l’avènement du futur Napoléon III. La thèse centrale de cet ouvrage est la suivante : « Sur le plan politique, la déstabilisation de 1789 a été si forte que l’équilibre paraît impossible à trouver ». Tulard montre toutes les impasses auxquelles la France a été acculée, et avec elle l’Europe, à la suite de cette révolution. Tulard reste donc un auteur à lire.
Dans le livre que nous mentionnons, les pages sur l’installation d’une censure et sur la mise au pas d’une « culture officielle » sont à méditer (pp. 238-239), sur fond de « correction politique » obligatoire aujourd’hui. Autre chapitre intéressant, celui sur la campagne d’Espagne, commencement de la fin pour Napoléon (pp. 241-244), où celui-ci, comme l’a d’ailleurs reconnu et observé Clausewitz, est battu par le peuple, qui ne veut pas du fatras liberticide de sa révolution qui avance en brandissant frauduleusement le drapeau de la « liberté ». Tulard nous offre donc un regard sceptique sur les révolutions et surtout sur l’idéologie bourgeoise et égalitaire qu’elles ont véhiculée (Robert Steuckers).
00:15 Publié dans Biographie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 21 décembre 2007
1879: Naissance de Staline
21 décembre 1879 : Naissance de Staline
 Naissance en Géorgie de Joseph Vissarionovitch Dougachvili, qui sera connu sous le nom de Staline, l’Homme de fer. Né dans le foyer d’un cordonnier géorgien et d’une Ossète (Ekaterine Geladse), dont les ancêtres étaient serfs, il fut quasiment le seul leader bolchevique à être issu d’un milieu aussi modeste. Après une scolarité brillante, il est admis au séminaire orthodoxe de Tiflis, une école connue pour son opposition au tsarisme. Dans le cadre de cette école, il entre en contact avec des propagandistes marxistes dès l’âge de quinze ans, qui lui communiquent des ouvrages, souvent français, interdits de lecture en Russie (Letourneau, Victor Hugo). A dix-huit ans, le jeune Joseph est actif dans les cercles socialistes géorgiens, ce qui conduit à son exclusion du séminaire en 1899.
Naissance en Géorgie de Joseph Vissarionovitch Dougachvili, qui sera connu sous le nom de Staline, l’Homme de fer. Né dans le foyer d’un cordonnier géorgien et d’une Ossète (Ekaterine Geladse), dont les ancêtres étaient serfs, il fut quasiment le seul leader bolchevique à être issu d’un milieu aussi modeste. Après une scolarité brillante, il est admis au séminaire orthodoxe de Tiflis, une école connue pour son opposition au tsarisme. Dans le cadre de cette école, il entre en contact avec des propagandistes marxistes dès l’âge de quinze ans, qui lui communiquent des ouvrages, souvent français, interdits de lecture en Russie (Letourneau, Victor Hugo). A dix-huit ans, le jeune Joseph est actif dans les cercles socialistes géorgiens, ce qui conduit à son exclusion du séminaire en 1899.
Certes, son activisme avait motivé cette exclusion, mais aussi quelques solides échecs dans des examens importants, ratés parce qu’il avait été trop zélé dans son militantisme. Il finira par être arrêté une première fois en 1902, à la suite d’une manifestation à Batoum. Plusieurs relégations en Sibérie s’ensuivront, assorties d’autant d’évasions successives, qui le conduiront à un premier exil en Autriche-Hongrie en 1912 (Cracovie et Vienne). Entre-temps, il avait rencontré Lénine en 1905 et suivi son option « bolchevique », lors du schisme entre minimalistes et maximalistes au sein du mouvement social-démocrate russe.
L’option maximaliste bolchevique, contrairement à l’option minimaliste « menchevique », visait l’organisation d’une révolution violente, portée par des « révolutionnaires professionnels ». Pour financer cette révolution, Joseph Dougachvili organise des braquages de banques ; le plus célèbre de ces braquages eut lieu à Tiflis en 1907, où les bolcheviques parviennent à dérober la somme de 250.000 roubles. Arrêté à son retour en Russie fin 1912, il vivra en exil forcé, de 1913 à 1917, à Touroukhansk, où il restera cois, sans chercher à s’évader, pour ne pas être incorporé de force dans l’armée russe combattant les Allemands, les Autrichiens et les Turcs. Il revient de cet exil sibérien en 1917, accompagné de Lev Kamenev, son compagnon de détention. Il est nommé membre du « Comité exécutif central » des bolcheviques à la suite du Congrès panrusse des Soviets de juin 1917.
Le 7 novembre 1917, après le triomphe des bolcheviques, il devient Commissaire du Peuple aux Nationalités, alors que les nationalités non russes de l’Empire faisaient sécession et proclamaient leur indépendance. Les Bolcheviques ne contrôlaient plus qu’un espace correspondant peu ou prou à la Moscovie du temps d’Ivan le Terrible. Les seules nationalités qui se joignirent à la révolution furent les Tatars et les Bachkirs. Au départ de la Moscovie et des régions voisines du Tatarstan et du Bachkortostan, les Bolcheviques devront reconquérir les terres de l’ancien Empire russe, aux mains des troupes blanches, des armées ethniques sécessionnistes et de troupes alliées envoyées à la rescousse. En juin 1918, Staline parvient à reconquérir le cours inférieur de la Volga, dont la ville de Tsaritsyn qui deviendra Stalingrad en 1925. Au départ de cette position clef sur la Volga, Staline entreprendra la reconquête du Caucase ; cette reconquête s’effectuera en plusieurs étapes : en février 1920, tous les peuples du Caucase septentrional sont incorporés dans l’Union Soviétique, à la suite d’une révolte générale contre le général blanc Denikine. Les Tchétchènes se révolteront ensuite contre les Soviétiques, ce qui induisit Staline à prononcer ce discours, qu’on relira avec étonnement, sur fond de la crise tchétchène actuelle : « Chaque peuple –les Tchétchènes, les Ingouches, les Ossètes, les Kabardines, les Balkars- doivent avoir leurs propres soviets. S’ils peuvent apporter la preuve que la Charia est nécessaire pour parvenir à cette fin, alors j’autorise la Charia. Si l’on peut m’apporter la preuve que les organes de la Tcheka ne comprennent pas le mode de vie propre et les autres particularités de la population et ne s’y adaptent pas, alors, il est clair que des changements devront intervenir dans cette région » (Discours tenu aux peuples de la région du Terek, 17 novembre 1920). Un mois plus tard, l’ensemble du Caucase, sauf la Géorgie, tombe aux mains des troupes soviétiques de Staline.
En février 1921, avec l’appui de son ami de jeunesse Sergo Ordchonikidse, la Géorgie, à son tour, entre dans le nouvel ordre soviétique. Cette victoire de Staline dans le Terek et le Caucase font de lui un héros respecté de la nouvelle Union Soviétique. Lénine est malade. Le pouvoir est détenu par une sorte de triumvirat, comprenant Staline, Kamenev et Zinoviev, tous trois hostiles à l’autre homme fort du régime, Léon Trotski. Staline se concentrera sur la consolidation de l’appareil bolchevique : ce qui amènera en bout de course à l’élimination de facto de Trotski, qui partira en exil au Turkestan puis à l’étranger en 1927, et au limogeage de Kamenev et Zinoviev dès 1926 (ils seront éliminés lors des purges de 1937). Staline devient alors maître absolu de l’URSS. Il inaugure sa politique de « socialisme dans un seul pays », soit la réorganisation de l’URSS, et rejette l’idée d’une « révolution mondiale » préalable, le credo de Trotski, tout simplement parce qu’une telle révolution exigerait des moyens que ne possède pas la Russie soviétique exsangue et épuisée. Mondialiser la révolution la condamnerait à l’échec rapide devant les forces anti-bolchevistes du monde entier, et notamment de l’Empire britannique.
De 1927 à 1938, le pays connaîtra la collectivisation forcée, avec l’élimination de la classe paysanne des « koulaks », et la persécution inlassable des dissidents, trotskistes et opposants à Staline, avec un instrument policier, le NKVD. Staline semble avoir poursuivi l’objectif de restaurer l’ancien Empire des Tsars sur toute l’étendue territoriale qui fut la sienne avant 1917 : guerre contre la Pologne et Pacte germano-soviétique, conquête de la Bessarabie, guerre contre la Finlande, succès diplomatiques à Yalta, annexion de la Ruthénie subcarpathique. Seule la Finlande a échappé à l’annexion directe. De même que la « Pologne du Congrès ».
Vainqueur avec l’appui américain en 1945, il reçoit une bonne moitié de l’Europe, afin de la maintenir dans le frigo et de l’arracher aux industries ouest-européennes, et surtout à la machine économique allemande, pour empêcher toute ré-émergence d’un concurrent pour les Etats-Unis sur la rive eurasienne de l’Atlantique Nord. Autre objectif de cette générosité de Roosevelt : fermer l’artère danubienne et empêcher toute projection européenne vers la Mer Noire.
Le seul intérêt de l’ère stalinienne après 1945, réside dans la volonté de contrer l’internationalisme américain (appuyé par les dissidences trotskistes, qui deviendront « néo-conservatrices » avec l’avènement de Reagan et de Bush-le-père, tout en contaminant les démocrates américains sous Clinton). Autre coup de théâtre diplomatique intéressant : les notes de 1952, où Staline propose la réunification de l’Allemagne et sa neutralisation. La proposition était intéressante et aurait permis plus tôt un envol de l’Europe occidentale hors de toute immixtion américaine. On imagine aisément l’aubaine qu’aurait été une Allemagne neutre, au moment où De Gaulle se désengageait de l’OTAN, après les troubles d’Algérie. Staline meurt, probablement empoisonné, le 5 mars 1953 à Kuntzevo près de Moscou (Robert STEUCKERS).
00:10 Publié dans Biographie, Eurasisme, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 20 décembre 2007
1522: Soliman s'empare de Rhodes

20 décembre 1522 : Soliman le Magnifique s’empare de Rhodes
Soliman le Magnifique s’empare de la place forte de l’Ile de Rhodes en Méditerranée orientale. Elle restera aux mains des Turcs pendant 390 ans. Rhodes avait déjà subi deux occupations musulmanes, par les Sarrasins, de 653 à 658 et de 717 à 718, à l’époque ou Byzance encaissait les premières attaques musulmanes. Les Croisés avaient fait de Rhodes une étape indispensable à leurs expéditions et perçu l’importance de l’île pour le trafic en Méditerranée et pour la logistique maritime. En 1309, les Chevaliers Hospitaliers en font une forteresse imprenable, abritant une flotte impressionnante, tenant en respect Turcs, Arabes et Mamelouks en Méditerranée orientale.
Après la chute de Constantinople, l’île permettra de tenir tête aux Ottomans pendant sept décennies. Mais la pression est trop forte, sur terre comme sur mer, et François I trahit l’Europe. En 1522, la garnison est contrainte de capituler honorablement. Pendant la période turque, l’île, jadis fleuron militaire et culturel, périclitera considérablement : elle sera ravagée par des pestes terribles, sa population grecque émigrera ; elle subira un régime de rigueur et une répression effroyable lors de la guerre d’indépendance de la Grèce entre 1821 et 1829. Rhodes restera donc turque jusqu’en 1912, année où la flotte et l’armée italiennes, bien coordonnées, s’empareront de l’île.
Le régime italien (1912-1943) redonnera du lustre à l’île abandonnée et martyre : les Italiens y construiront des routes, des écoles et organiseront d’importantes fouilles archéologiques (alors que le passé non islamique avait été considéré par les Turcs comme dépourvu d’intérêt). Rome en fait également une base navale et aérienne considérable, permettant aux excellents avions militaires italiens d’avoir un rayon d’action couvrant les côtes de l’Egypte, du Liban et de la Palestine. L’Encyclopedia Britannica reconnaît aujourd’hui l’excellence de la gestion italienne de Rhodes. En 1947, l’île est rattachée à la Grèce.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 18 décembre 2007
1932: Mussolini inaugure Littoria

18 décembre 1932 : Mussolini inaugure Littoria
Mussolini inaugure une ville entièrement nouvelle, baptisée Littoria, dans le Latium à l’emplacement des fameux « marais pontins », enfin asséchés après avoir répandu pendant des siècles le paludisme dans la région située entre Rome et la Méditerranée. Asséchée par les travaux dirigés par le grand ingénieur italien Arrigo Serpieri, la région des anciens marais pontins, dont la surface est de 60.000 hectares, sera divisée en 3000 exploitations pour des familles pauvres, généralement issues du Mezzogiorno. L’assèchement des marais pontins fait partie d’un vaste projet italien et fasciste à l’époque, dénommé « Bonification Intégrale ». Il visait à récupérer dans la péninsule italique quelque 5.700.000 hectares de terres arables pour en faire bénéficier au total 78.000 familles qui, de ce fait, n’auraient plus été contraintes d’émigrer vers l’Argentine ou les Etats-Unis. L’Italie gardait ainsi ses forces vives.
Retenons aussi que les marais pontins avaient été le tombeau de 6000 Lorrains expulsés de leur patrie au 18ième siècle après l’annexion de ce duché impérial à la France, qui avait installé le fantoche Stanislas à Nancy, où il a construit une place, certes fort belle, qui porte encore son nom. Mais cette place, tant vantée, tant mise en exergue, est le cadeau pervers et artificieux, destiné à masquer l’horreur quotidienne qui s’est abattue sur les Lorrains. Revers de la médaille : les paysans lorrains sont écrasés d’impôts, contraints de vendre leurs exploitations à des paysans venus de Champagne et d’Ile-de-France qui sont, eux, exemptés de toutes taxes. C’est une forme d’épuration ethnique avant la lettre. Le Pape de l’époque avait accueilli les réfugiés lorrains dans les marais pontins, où la malaria les avait décimés. D’autres Lorrains partiront vers le Banat serbe et roumain, où ils garniront la frontière contre les Ottomans. On parlera le roman de Lorraine dans ces régions balkaniques jusqu’en 1945, où, assimilés aux Allemands, les Lorrains seront massacrés et les survivants chassés. Robert Schumann les autorisera à revenir en Lorraine.
01:00 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Panturquisme et pantouranisme

Sur le panturquisme et le pantouranisme
Entretien avec le Prof. Dr. Dr. Heinrich Paul Koch (Université de Vienne, Autriche)
Le Prof. Heinrich Paul Koch, détenteur de deux doctorats, s’est surtout rendu célèbre en Autriche et dans l’espace linguistique germanique grâce à sa thèse sur « les légendes du déluge dans le monde ouralo-altaïque » (1997). Il est un spécialiste des études historiques, préhistoriques et proto-historiques, de philologie finno-ougrienne et d’ethnologie. Jusqu’en 1996, le Prof. Koch, né en 1931 à Pressburg (Bratislava), avait enseigné la chimie pharmaceutique à l’Université de Vienne et la biopharmacie à l’Université de Cincinnati en Ohio aux Etats-Unis. Outre des centaines d’articles et d’essais, le Prof. Koch est l’auteur de huit livres.
Le panturquisme, que l’on appelle parfois aussi le pantouranisme, vise l’unité de tous les peuples turcs, leur rassemblement au sein d’un seul Etat. Dès 1839, se constitue en Turquie une « Société Touranienne » qui se fixe comme objectif de fonder un « Empire du Touran ». En 1915, les Jeunes Turcs, qui dirigent le gouvernement de l’Empire ottoman, déclarent que leur objectif de guerre est l’unité de tous les peuples turcs. Aujourd’hui encore, la Turquie revendique pour elle-même le rôle de diriger l’ensemble des peuples turcs, qui comptent quelque 250 millions d’âmes, sur des territoires qui s’étendent jusqu’aux confins de la Chine et jusqu’aux coins les plus reculés de la Sibérie. Le Prof. Dr. Dr. Heinrich P. Koch s’est intéressé très vivement à l’histoire de l’idéologie touranienne et, plus particulièrement, aux adeptes hongrois de cette idéologie. Car on oublie qu’en Hongrie aussi, en 1918, s’est constituée une « Société Touranienne », qui se fixait pour objectif de réunir tous les « Touraniens ». L’entretien que nous donne le Prof. Koch vise à nous éclairer sur les tenants et aboutissants de cette idéologie.
L’idée touranienne
Q. : Prof. Koch, quels sont les fondements du touranisme ?
HPK : Par touranisme l’on entend, la plupart du temps, le mouvement panturquiste dont le but est de réunir tous les peuples turcs. Le touranisme, au sens le plus large, va beaucoup plus loin : à la base de cette idéologie, nous trouvons la théorie de l’ascendance commune des peuples finno-ougriens et turcs, qui serait un peuple matriciel unique d’Asie centrale, issu d’une région située entre l’Oural et l’Altaï. La désignation collective « touranide » servirait de référence à tous les peuples non-indo-européens et non-sémitiques de l’Ancien Monde. Sous la désignation de « touranides », on rassemble, par un élargissement audacieux, outre les Turcs de l’ancien empire ottoman et outre les peuples turcs d’Asie centrale (soit les Azerbaïdjanais, les Oghuzes, les Tchouvaches, les Turco-Tatars, les Toungouzes, les Ouïghours, les Ouzbeks, etc.), les Japonais, les Chinois, les Coréens et les Tibétains. Les langues de tous ces peuples sont désignées, encore aujourd’hui, sous le nom de « langues touraniennes », alors qu’en fait elles n’ont que très peu de traits communs ; ainsi, le hongrois et le turc, n’ont que peu de racines communes et n’on comme point commun que le fait d’être des langues agglutinantes. La linguistique moderne a réfuté depuis longtemps l’appartenance à une famille commune des langues ouralo-altaïques.
Le « pays des Turcs »
Q. : Malgré cela, le touranisme a fait un nombre croissant d’adeptes en Hongrie pendant la première guerre mondiale…
HPK : Effectivement. Ce mouvement visait à détacher la Hongrie de l’Europe et de la ramener dans l’orbite asiatique. Après l’ère prospère des Germains et des Slaves, viendrait, disaient les touranistes, l’heure des Touraniens – dont le territoire s’étendrait de la Hongrie au Japon, ou, selon leurs propres mots, « de Theben jusqu’à Tokyo ». Par Theben, ils entendaient la localité à l’embouchure de la rivière March.
Le touranisme doit son nom à une plaine, une dépression, nommée « Touran », comme contrepartie du haut plateau iranien, qu’elle jouxte au Nord-Est. En réalité, « Touran » est le terme persan pour désigner le Turkestan, ce qui signifie le « Pays des Turcs ». L’énorme région du « Touran » est aux quatre cinquièmes constitué de déserts, mais est très riche en pétrole et en gaz naturel. Aujourd’hui, ce pays de « Touran » est divisé entre trois Etats : le Turkménistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan.
Q. : Quelle a été l’importance du touranisme en Hongrie ?
HPK : Le premier président de la « Société Touranienne » en Hongrie a été le Comte Pàl Teleki, qui disait de lui-même : « Je suis un Asiate et fier de l’être ». Le Comte Teleki a été deux fois ministre des affaires étrangères et, en 1920-21 puis entre 1939 jusqu’à son suicide en 1941, premier ministre de Hongrie. La production la plus connue de ce courant d’idées ont été les « Chants touraniens » d’Arpàd Zempléni. Il appelait les Allemands de Hongrie des « diables aryens » et avait travaillé dès 1910 à leur expulsion, qui aura lieu en 1945.
Dans les années 40, l’idée du touranisme était très répandue dans l’intelligentsia hongroise. Eugen Cholnoky, Président de la « Société touranienne » à partir de 1941, avait déjà été, pendant l’entre-deux-guerres, « Grand Vizir » de l’ « Alliance touranienne ». Cette dernière était un mouvement de rénovation particulièrement agressif à l’égard des Allemands, des Tziganes et des Juifs.
Honneur à Attila, roi des Huns
Q. : Comment l’idée touranienne a-t-elle pu se diffuser à une telle ampleur ?
HPK : Déjà au 13ième siècle, le chroniqueur médiéval hongrois Simon Kézai faisait des Huns asiatiques du 5ième siècle les ancêtres directs des Magyars. Aujourd’hui encore, Attila, le roi des Huns (mort en 453) est honoré en Hongrie.
A l’époque baroque, le Cardinal Péter Pàzmàny (mort en 1637) voyait dans la fraternité païenne entre Hongrois et Turcs la raison réelle de l’absence de résistance de ses contemporains face à l’ennemi extérieur ottoman.
L’historien chauvin Istvàn Horvàt a accentué à l’extrême cette notion de fraternité asiatique en tenant les Magyars pour apparentés aux Scythes, aux Assyriens, aux Pélasges, aux Parthes et aux Arabes de l’antiquité. Il répète et confirme l’ascendance hunnique des Hongrois, mais ne voulait rien entendre de la parenté réelle qui liait ces derniers aux Finnois. Le Comte Istvàn Széchenyi voulait, pour sa part, établir une parenté entre les anciens Magyars et les Sumériens, c’est-à-dire le premier peuple de culture qui a émergé en Mésopotamie.
Q. : La couronne royale hongroise recèle des composantes d’origine proche-orientale…
HPK : La couronne dite de « Saint Etienne » se compose de deux parties, celle que le Pape Sylvestre II a envoyé au roi Etienne, le futur Saint Etienne, et que l’on appelle aussi la « corona latina », et, ensuite, celle que le roi Géza I a reçue de l’Empereur byzantin Michel Ducas, soit la « corona graeca ». La réunion de ces deux parties est perçue par les Touraniens comme le symbole de la division Est-Ouest, qui divise aussi l’âme magyare. C’est cette division dont les Touraniens veulent se débarrasser. Ils voulaient se détacher de l’Occident et retourner à la grandeur touranienne afin de servir de fondement et de réveil à la conscience nationale hongroise. La nation magyare serait, dans cette optique, l’incarnation glorieuse de la « race des seigneurs » touranienne.
Q. : Qu’en disaient, mis à part les peuples réellement turcs, les autres « candidats » invités à communier dans l’idéal pantouranien ?
HPK : Les Finnois et les Estoniens refusaient clairement de se considérer comme des Asiatiques. Les Japonais, les Chinois ou les Coréens riaient d’être ainsi étiquetés « touraniens ».
Les pertes hongroises sous la domination turque
Q. : Avait-on dès lors oublié, en Hongrie, que les fonctionnaires et la soldatesque turcs avaient systématiquement pillé le pays au cours des deux cents années qu’y avaient duré les guerres contre les Ottomans ?
HPK : Oui. Et l’on avait oublié aussi que les Allemands, alliés à la Maison des Habsbourgs, avaient libéré la Hongrie du joug turc. On essaya même, dans la foulée, de leur mettre sur le dos l’annihilation de larges strates de la population hongroise pendant la période de domination turque. En 1941, on parlait par exemple des 200 années d’ « oppression autrichienne », période égale à celle de la domination ottomane. Pourtant les faits sont têtus : la population hongroise s’est réduite de 3,2 millions d’habitants à 1,1 million pendant l’occupation turque, tandis que sous l’ère des Habsbourgs, elle a crû de 1,1 million à 9,2 millions.
Les Allemands, les Slaves et les Juifs ne devaient avoir plus aucune place dans une Hongrie redevenue pleinement « touranienne ». C’est ainsi que Teleki, tandis qu’il exerçait les fonctions de premier ministre, fit passer en 1920 les premières lois antisémites de l’Europe contemporaine.
Après la défaite allemande à Stalingrad, la propagande touraniste reprit vigueur. Après l’effondrement du Reich, les « chasseurs touraniens » (« Turàni Vadàszok ») exigèrent l’ « évacuation définitive de tous les Souabes ». L’exigence d’une expulsion ou d’une élimination physique de tous les non Magyars dans l’ancien espace géographique hongrois avait déjà été exigée dès 1939. Les communistes magyars sous la direction de Matyàs Ràkosi refusèrent toutefois le racisme des surexcités touranistes. Le touranisme en Hongrie a donc été résolument germanophobe, mais aussi antisémite. On doit constater avec tristesse que ces idées aberrantes on joué un rôle essentiel dans l’expulsion des Allemands de souche, installés en Hongrie, après la seconde guerre mondiale.
(entretien paru dans DNZ, n°43, octobre 2005; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:45 Publié dans Entretiens, Eurasisme, Géopolitique, Histoire, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'oléoduc de l'Amitié
L'oléoduc de l'Amitié
18 décembre 1959 : Signature à Moscou d’un accord entre l’URSS, la Pologne et la RDA pour inaugurer « l’oléoduc de l’amitié », destiné à acheminer du pétrole soviétique vers les territoires baltiques et centre-européens des deux petites puissances du COMECON, contrôlées par Moscou. L’actuel projet d’un système de gazoducs et d’oléoducs, baptisé « North Stream », n’est que la réactualisation de ce projet de 1959, dans un contexte qui n’est plus celui de la guerre froide ni celui d’une position forte de Moscou. Les Etats-Unis, en tablant aujourd’hui sur les gouvernements corrompus des petits pays de la « Nouvelle Europe », déploient des efforts considérables pour torpiller la réalisation définitive de cet oléoduc nord-européen, dont la construction avait été décidée après les accords signés entre l’ancien Chancelier allemand Gerhard Schröder et Vladimir Poutine, aux temps bénis, mais si brefs, de l’Axe Paris/Berlin/Moscou. La leçon à tirer de ce petit rappel : les Etats-Unis, quel que soit le contexte idéologique en acte, cherchent à nuire aux échanges inter-européens, échanges continentaux, pour leur substituer des échanges venus de la mer, qu’ils contrôlent avec leurs alliés britanniques. Rapelons tout de même que les officines de désinformation anglo-saxonnes avaient démonisé Nicolas II avant la conclusion de l’Entente, comme elles diaboliseront plus tard Staline, Brejnev et Poutine.
00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 17 décembre 2007
1928: le "Mémorandum Clark"
17 décembre 1928 : Le “Mémorandum Clark”
 |
| Frank B. Kellogg acceptant le Prix Nobel de la Paix. Oslo, 1930. (Source: Minnesota Historical Soc.) |
Aux Etats-Unis, le Mémorandum Clark désavoue le fameux corollaire Roosevelt et la Doctrine de Monroe. Rappelons que le corollaire Roosevelt permettait aux Etats-Unis de mener des guerres, même à outrance (« Big Stick Policy »), contre toute puissance européenne qui se maintiendrait, ou interviendrait, dans le Nouveau Monde et contre toute puissance ibéro-américaine qui entendrait mener une politique nationale originale et indépendante. Le Mémorandum Clark est donc une pétition de principe réellement pacifiste dans un environnement international, où, après 1918, l’objectif est d’empêcher toute guerre d’agression à l’avenir, mais où les démarches des pacifistes apparents annoncent paradoxalement l’extension à l’infini des concepts juridiques de « guerre », d’« agression » et de « guerre d’agression », permettant de définir comme « agression » de simples demandes de modification du statu quo international décidé par les vainqueurs ou par les plus puissants du moment.
Dans ce contexte, Frank B. Kellogg, juriste et diplomate américain, et son collègue Shotwell, tentaient, à la fin des années vingt, surtout en l’année 1928, de formuler une nouvelle définition de la guerre d’agression : celle-ci ne devait plus seulement se définir comme le franchissement effectif d’une frontière par des armées régulières, mandatées par un gouvernement en place, mais comme la simple intention de modifier le statu quo international, même par des moyens non guerriers ! Cette interprétation du droit de la guerre et du droit des gens conduit évidemment à déclarer agresseur un Etat aux moyens militaires limités voire dérisoires, auquel on prêtera de « mauvaises » intentions, car ces « mauvaises » intentions seront déclarées « agressives », et constitueront donc un « acte d’agression », donc, par translation, un recours illicite à la guerre, laquelle est condamnée par la SdN. Cet Etat « mal intentionné » sera posé comme un « agresseur », au même titre qu’un autre Etat qui aura envahi de facto un pays voisin, et subira dès lors les foudres des instances internationales en général et des Etats-Unis en particulier.
C’est donc à la fin des années 20 du 20ième siècle que les méthodes, avec lesquelles on a démonisé la Serbie et l’Irak, sont nées. L’Etat contestataire de l’ordre mondial, ou de la volonté des Etats-Unis définie comme seule correcte, devient, même si ses critiques sont modestes ou partielles, ipso facto un Etat-voyou, « pirate » ou hors-la-loi (outlaw), contre lequel tous les coups seront permis et contre la population duquel les règles humanitaires ne seront pas de mise. On voit ce que cela a donné. Du corollaire Roosevelt, belliciste sans fard, au pacifisme apparent de Wilson puis aux idées de Shotwell et aux subtilités hypocrites des Doctrines Kellogg et Stimson (le successeur de Kellogg), puis, enfin, aux justifications aussi boiteuses que tonitruantes des Administrations Bush Senior, Clinton et Bush Junior et aux théories des néo-conservateurs, il y a continuité parfaite, il y a même réchauffement du même vieux plat de lentilles.
L’histoire de cette continuité malsaine devrait faire l’objet de la formation permanente de nos diplomates. Le juriste Carl Schmitt avait analysé les intentions américaines, dissimulées derrière un langage pacifiste médiatisable. Son œuvre est donc, en ce domaine aussi, incontournable (source : Günter Maschke, « Frank B. Kellogg siegt am Golf. Völkerrechtsgeschichtliche Rückblicke anlässlich der ersten Krieges des Pazifismus », in : Etappe, Nr. 7 u. 8, Bonn, 1992) (Robert Steuckers).
00:55 Publié dans Affaires européennes, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Message révolutionnaire de Nasser
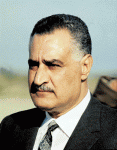
Le message révolutionnaire de Gamal Abd El Nasser
Le 23 juillet 2002 était le cinquantième anniversaire de la chute de la monarchie morbide et corrompue qui "gouvernait" l'Egypte. Elle fut aussitôt remplacée par un régime de libération nationale, qui a dégager le pays de la tutelle étrangère, qui a œuvré pour que le peuple arabe, partagé entre de nombreux Etats puisse se réunir dans un ensemble grand-arabe, harmonisé par un socialisme de facture nationale.
L'ascension de Nasser
Parmi les révolutionnaires qui débarrassent l'Egypte de sa monarchie corrompue, nous trouvons un officier de 34 ans: Gamal Abd El Nasser. Né dans une famille modeste du Sud de l'Egypte, il adhère aux principes et aux valeurs du nationalisme révolutionnaire dans sa jeunesse. Pendant la seconde guerre mondiale, il sympathise, de même que ses camarades, avec les Allemands. Ces jeunes officiers admirent le "renard du désert", le Feldmarschall Erwin Rommel; ils espèrent que cet Allemand audacieux vaincra l'Empire britannique en Afrique du Nord, car Londres place de facto l'Egypte, pourtant théoriquement indépendante, sous sa tutelle. Pendant la guerre contre Israël en 1948, Nasser se révèle comme l'un des plus courageux officiers de l'armée égyptienne et acquiert le surnom de "Tigre de Falluyah". Il est grièvement blessé.
Après la révolution de 1952, Nasser devient véritablement le chef de son peuple qui lui voue une vénération sans fard. Il représente également le mouvement des peuples non alignés, espoir de tous les peuples colonisés du monde, soumis aux diktats de puissances coloniales étrangères. Nasser meurt en 1970. Bon nombre des principes énoncés à l'époque par Nasser restent parfaitement actuels, surtout aux yeux de ceux qui, à gauche, critiquent à juste titre le "capitalisme sans frein" et la "globalisation néo-libérale".
L'Egypte et l'Allemagne
Les rapports germano-égyptiens reposent en ultime instance sur un événement historique, le même que celui qui a motivé l'action planifiée par les jeunes officiers révolutionnaires autour de Nasser, qui voulaient donner un autre destin à l'Egypte et à tout le monde arabe. Dix ans avant cette révolution, alors que l'armée germano-italienne de Rommel pénétrait en Egypte en 1942, Churchill, conscient du danger et des sympathies pro-allemandes des masses égyptiennes, lance un ultimatum: si l'Egypte ne se range pas immédiatement aux côtés de Londres et ne met pas un terme aux mouvements pro-allemands, l'Angleterre prendra toutes les mesures militaires pour "discipliner" le pays. L'armée égyptienne, mal équipée, ne pouvait absolument pas tenir tête aux Britanniques. Elle dut s'incliner. Pour bien montrer leur puissance militaire, les Anglais font encercler le palais du Roi Farouk par des blindés.
Le chef de l'état-major général égyptien, Aziz Ali al-Misri, qui était germanophile, le Premier Ministre Ali Maher (qui reprit brièvement son poste après la révolution de 1952), de même que bon nombre de leurs amis, ont été immédiatement internés par les Britanniques. Un groupe de jeunes soldats, dont Nasser, ont tenté, sans succès, de libérer Maher par un coup de force. Sadat, qui faisait à l'époque la liaison entre le mouvement arabe de libération et l'Afrika Korps de Rommel, participera également à la révolution nassérienne de 1952. En 1970, il sera son successeur à la tête de l'Etat égyptien. Les Anglais l'internent également en 1942. De la même façon, un an auparavant, Churchill fit décapiter un autre Etat arabe, par des mesures encore plus brutales: l'Irak pro-allemand de Rachid Ali el-Gailani. Dans ses souvenirs, Sadat fustige le comportement brutal des Anglais en Egypte et en Irak pendant la seconde guerre mondiale: il le décrit comme un mépris affiché, scandaleux et inacceptable du droit à l'auto-détermination.
L'Egypte révolutionnaire a toujours fait montre d'un respect profond et d'une admiration pour les soldats de la Wehrmacht; par exemple : le premier président du gouvernement révolutionnaire, Nagib, rédige en allemand un message de salutation en avril 1954 à l'adresse d'une organisation de vétérans de l'arme parachutiste allemande, assorti de sa photo et de sa signature personnelle. Les vétérans ont publié ce document à l'époque. En voici le texte : «Lorsque je salue mes parachutistes égyptiens, je salue en même temps votre commandant en chef, le Colonel-Général Student, ainsi que vous tous, qui avez combattu pour votre patrie au sein des formations parachutistes allemandes, dans l'espoir que les traditions de cette arme demeurent valides pour tous les temps». Le Général Kurt Student, qui est évoqué ici, était celui qui avait conquis la Crète au départ du ciel en 1941; en 1944, il était devenu le Commandant en chef de la Première armée parachutiste de la Wehrmacht; fin avril 1945, il devenait Commandant en chef du Groupe d'Armée "Vistule".
En Egypte, les mausolées et monuments pour les soldats allemands du désert sont nombreux; les dirigeants du pays, surtout Sadat, ont toujours manifesté clairement leur admiration pour les guerriers venus de Germanie. Le monument en l'honneur des soldats, morts en servant dans l'Afrika Korps à El Alamein, ainsi que le monument en l'honneur de Rommel à Tel el Eissa en témoignent. En 1989, on a restauré, non loin d'El Alamein, un monument en forme de pyramide à la gloire du pilote et as allemand que l'on appelait l'"étoile de l'Afrique"; on y lit en langues allemande, arabe et italienne: «C'est ici qu'est mort, invaincu, le Capitaine H. J. Marseille, le 30 septembre 1942».
Les succès intérieurs du nassérisme, l'opposition de l'étranger
Après que Gamal Abd el Nasser ait remplacé le Général Nagib à la tête du gouvernement révolutionnaire, le peuple l'élit Président d'Etat en 1956. Son gouvernement fut autoritaire; il jugula les menées de l'opposition en arguant qu'elle était "dirigée de l'extérieur", ce qui était vrai dans de très nombreux cas. Nasser procéda à des nombreuses réformes importantes en politique intérieure, surtout en ce qui concerne l'enseignement, la formation universitaire et la santé; il procéda également à une réforme agraire au profit des paysans pauvres; il a élargi l'espace habitable du pays en prenant des mesures d'irrigation de grande ampleur. Ces réformes ont fait de lui l'idole des masses. Sur le plan extérieur, Nasser s'est efforcé de parfaire l'unité des Arabes, notamment en forgeant l'Union avec la Syrie et le Yémen, considérée comme la première étape dans le rassemblement de tous les Arabes au sein d'un même état. Le projet a certes connu l'échec, mais suscité beaucoup d'espoirs. Nasser abat également les structures de domination étrangères qui demeuraient présentes dans la vie politique et économique égyptienne, de manière ouverte ou camouflée. Il convient de citer ici la nationalisation du Canal de Suez. Toutes ces mesures ont fait de Nasser un héros populaire dans tous les pays arabes.
Mais très rapidement après la révolution de 1952, des forces étrangères se coalisent contre la nouvelle Egypte. Pendant l'été de 1954, des agents des services secrets israéliens organisent une série d'attentats à la bombe au Caire; en février 1955, un commando israélien attaque Gaza. En 1956, les forces conjuguées d'Israël, de la Grande-Bretagne et de la France attaquent l'Egypte dans la zone du Canal de Suez. En faisant appel à l'ONU, Nasser oblige les agresseurs à se retirer. En 1967, éclate la guerre des Six Jours. Le monde occidental a toujours tenté de faire accroire l'idée qu'Israël lançait ainsi une guerre préventive pour annuler l'effet de surprise d'un plan égyptien et syrien visant à détruire l'Etat hébreu. En 1997, pourtant, le quotidien israélien Yediot Ahronot publie l'aveu de Moshé Dayan, à l'époque Ministre israélien de la défense: 80% des actions militaires syriennes ont été provoquées par Israël.
Face à l'attitude pro-israélienne militante des Etats-Unis, Nasser n'a pas eu d'autre solution que de se rapprocher de l'Union Soviétique. En même temps, il s'efforçait, sur la scène internationale, en tant que chef charismatique des "non alignés", de trouver une alternative viable au système bipolaire, conséquence de la seconde guerre mondiale, où seuls Moscou et Washington menaient le jeu.
Un "Raïs" légendaire
Après la lourde défaite subite par l'Egypte en 1967, Nasser avait décidé de se retirer du pouvoir, mais un vague sans précédent d'enthousiasme populaire, qui voyait en lui "le seul et vrai chef du pays", il accepte de rester en fonction. Ce qu'il fera jusqu'à sa mort en 1970. Arnold Hottinger, journaliste du quotidien helvétique Neue Zürcher Zeitung, écrit: «En dépit de tout, Nasser est resté l'homme auquel les peuples arabes et égyptien ont conservé leur confiance». Ce correspondant au Caire du journal suisse évoque plus en profondeur la personnalité de Nasser, dans son article célébrant le cinquantième anniversaire de la révolution égyptienne: «Nasser reste toujours, aux yeux de la grande majorité des Egyptiens, et aussi de la plupart des autres Arabes, le plus grand homme d'Etat que le monde arabe a produit depuis la fin de l'époque coloniale». Les jeunes Egyptiens parlent encore et toujours du "Raïs", du "Chef". Et quand on leur demande: «Comment, tu es si jeune, tu n'as pas vécu à son époque!». Ils répondent : «C'est à son époque que j'aurais voulu vivre».
Viktor STARK.
(DNZ/München - n°32, 2 août 2002).
00:40 Publié dans Histoire, Hommages, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 16 décembre 2007
L'Egypte sous protectorat

Drapeau égyptien en 1914
L'Egypte sous protectorat
16 décembre 1914 : Pour éviter que l’Egypte, théoriquement sous souveraineté ottomane, ne passe sous contrôle de l’Allemagne, alliée au Sultan d’Istanbul, les Britanniques, juste après avoir proclamé la loi martiale et expulsé tous les citoyens allemands et autrichiens vers Malte, déclarent l’Egypte protectorat de Londres et la dépouillent de toutes les prérogatives autonomes qu’elle pouvait encore détenir, au moins formellement, coincée qu’elle était entre la souveraineté, devenue toute théorique, de la Sublime Porte, et la présence militaire britannique depuis 1882, dans les villes, les ports et le long du Canal de Suez. Le khédive Habbas Hilmi, favorable à l’alliance germano-turque, est démis de ses fonctions et remplacé par son oncle anglophile, Hussein Kamel. L’Egypte perd toute autonomie sur les plans militaire et diplomatique. Cette transformation de l’Egypte en protectorat et la rupture des derniers liens organiques entre le pays et la Sublime Porte constituent une humiliation profonde, à la base de toutes les revendications nationalistes ultérieures, dont Gamal Abdel Nasser sera la figure de proue.
00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 15 décembre 2007
1055: Toghrul Bey s'empare de Bagdad

15 décembre 1055: Toghrul Beg s’empare de Bagdad. Toghrul Beg, chef militaire turc très compétent, s’empare de la ville arabe de Bagdad. La personnalité de ce chef de guerre turc est fascinante. Sa biographie nous permet de comprendre la dynamique géopolitique qui secoue depuis des siècles l’Asie centrale pour se répercuter sur l’Egypte, l’Anatolie et les rives du Golfe Persique. Elle nous permet aussi de comprendre le clivage conflictuel qui oppose encore Chiites et Sunnites, donc de comprendre les scénarios qui se jouent aujourd’hui en Irak.
Toghrul Beg est né en 990. Il fut le fondateur de la dynastie seldjouk qui régna du onzième au quatorzième siècle sur l’Iran conquis, sur l’Irak, la Syrie et l’Anatolie. Toghrul Beg était le petit-fils de Seldjouk, chef des tribus turques Ogüz, dont l’habitat premier se situait dans la région de Jand en Asie centrale. Ces tribus turques avaient suivi le mouvement habituel des peuples nomadisants de la région. Avant eux, les peuples cavaliers indo-européens, partis d’Ukraine, s’étaient élancés vers les hauts plateaux d’Iran ou vers l’Inde. Après la disparition des Indo-Européens d’Asie centrale (dont les Tokhariens), les peuples turco-hunniques prendront le relais et suivront exactement les mêmes itinéraires.
Les Ogüz, comme avant eux les Mèdes, les Parthes et les Perses, entreront d’abord en Transoxiane (désormais islamisée) en 1016 et se mettront au service du Prince de Boukhara, un Turc karakhanide. Les Turcs, tous ensemble, devront faire face à la vigoureuse réaction iranienne, conduite par le fameux chef de guerre Mahmoud de Ghazni. Victorieux, celui-ci oblige les tribus turques à se replier vers le Khwarezm, région située au sud-est de la Mer d’Aral. A la mort du grand chef iranien, les Turcs reprendront immédiatement l’offensive vers 1028-1029 et conquerront le nord de l’Iran. Toghrul, son frère Tchaghri et son oncle Arslan conjuguent leurs efforts et concentrent leurs forces, battent Massoud, le fils peu compétent de Mahmoud de Ghazni. Le sort de la Perse est réglé. Le pays est désormais sous la coupe des peuples cavaliers turcs venus d’Asie centrale. Et le restera longtemps. Toghrul occupe alors le haut plateau iranien, base d’attaque de tous les peuples conquérants que la région a connus. Il développe une méthode de conquête systématique : les hordes tribales de cavaliers conquièrent le terrain. Toghrul arrive et se propose de l’administrer rationnellement.
De 1040 à 1044, il conquiert les régions circum-caspiennes de l’Iran, puis le pays autour d’Ispahan. A partir de 1049, il donne l’assaut à l’Empire byzantin, tournant délibérément les énergies des tribus turques d’Asie centrale vers des territoires non musulmans. En 1055, il s’empare de Bagdad, où les Abbassides sunnites avaient dû se soumettre en 945, contre leur gré, aux Bouyides chiites et iranisés. Les Sunnites accueillent donc Toghrul en libérateur et le proclament Sultan, avec, pour mission, de battre les Fatimides chiites d’Egypte. Nous avons là affaire à un projet sunnite d’unir l’islam autour du califat abbasside, désormais dirigé par des Turcs, et d’éliminer le chiisme.
La situation devient extrêmement complexe. Toghrul doit faire face à de multiples récriminations et révoltes : les Turcs et Turkmènes d’Ibrahim Inal sont mécontents, les Bouyides chiites relèvent la tête, les tribus arabes de Mésopotamie se rebiffent contre un pouvoir turc qu’elles ne supportent plus, les Fatimides en profitent pour intervenir. Toghrul parvient tout de même à battre la coalition hétéroclite de ses adversaires. Il impose au Proche-Orient la loi seldjoukide. Ce qui crée aussitôt une menace pour Byzance, qui fera appel à la papauté pour contrer la « race étrangère qui s’est introduite dans la Romania », comme l’expliquera, en ces termes mêmes, Urbain II à Clermont-Ferrand, quand il fera appel aux chevaliers d’Europe occidentale.
La biographie de Toghrul Beg nous montre que les clivages qui divisent le Proche- et le Moyen-Orient sont toujours les mêmes et qu’ils n’ont pas perdu de leur vigueur. Les Américains, poussés par les cénacles néo-conservateurs, n’ont pas assez tenu compte de cette complexité, pourtant si bien expliquée dans quantité de livres d’histoire anglo-saxons (dont ceux de l’historien et orientaliste John Man). Ils n’ont pas compris ni voulu voir que cette complexité et ces antagonismes n’étaient pas des souvenirs d’un passé définitivement révolu, mais étaient bel et bien vivants, actuels, percutants. D’où le constat d’échec de l’entreprise de conquête de l’Irak, posé très récemment à Washington.
00:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 14 décembre 2007
Amundsen au Pôle Sud
14 décembre 1911: Le navigateur et explorateur norvégien Roald Amundsen arrive le premier au Pôle Sud.
 Né le 16 juillet 1872 à Borge près d’Oslo, il recevra une formation de docteur en médecine. Il accompagne l’expédition belge en Antarctique qui fut la première expédition européenne à passer un hiver entier dans ce continent glacial austral. Amundsen franchira le premier le Passage du Nord-Ouest d’est en ouest à bord d’un navire qu’il a équipé, le Gjöa. Cette expédition prendra trois ans (de 1903 à 1906). Après avoir appris que l’Américain Robert E. Peary avait atteint le Pôle Nord le premier, alors que c’était un projet qu’il caressait lui-même, il met le cap sur le Pôle Sud en guise d’alternative, et y établit sa base. Celle-ci se situe à 60 miles plus près du centre du continent antarctique que celle installée par ses concurrents britanniques menés par Robert Falcon Scott. Amundsen réussit alors l’exploit d’atteindre le centre de l’Antarctique avec quatre compagnons, montés sur traîneaux tirés par 52 chiens. L’expédition en traîneaux sur les neiges et la terre ferme du continent antarctique a duré du 11 octobre au 14 décembre 1911. Après ces équipées en bateaux et en traîneaux, Amundsen, comme bon nombre d’Européens de son époque, tente l’aventure aérienne. Il veut traverser les pôles par les airs. En 1926, avec l’Américain Lincoln Ellsworth et l’ingénieur italien en aéronautique Umberto Nobile, il franchit l’Arctique en dirigeable en partant des Spitsberg, archipel norvégien au-delà du Cercle glacial arctique. Ils arriveront en Alaska. En 1928, Amundsen perd la vie en voulant secourir son ami Umberto Nobile, dont le dirigeable s’était écrasé près de l’archipel Spitsberg.
Né le 16 juillet 1872 à Borge près d’Oslo, il recevra une formation de docteur en médecine. Il accompagne l’expédition belge en Antarctique qui fut la première expédition européenne à passer un hiver entier dans ce continent glacial austral. Amundsen franchira le premier le Passage du Nord-Ouest d’est en ouest à bord d’un navire qu’il a équipé, le Gjöa. Cette expédition prendra trois ans (de 1903 à 1906). Après avoir appris que l’Américain Robert E. Peary avait atteint le Pôle Nord le premier, alors que c’était un projet qu’il caressait lui-même, il met le cap sur le Pôle Sud en guise d’alternative, et y établit sa base. Celle-ci se situe à 60 miles plus près du centre du continent antarctique que celle installée par ses concurrents britanniques menés par Robert Falcon Scott. Amundsen réussit alors l’exploit d’atteindre le centre de l’Antarctique avec quatre compagnons, montés sur traîneaux tirés par 52 chiens. L’expédition en traîneaux sur les neiges et la terre ferme du continent antarctique a duré du 11 octobre au 14 décembre 1911. Après ces équipées en bateaux et en traîneaux, Amundsen, comme bon nombre d’Européens de son époque, tente l’aventure aérienne. Il veut traverser les pôles par les airs. En 1926, avec l’Américain Lincoln Ellsworth et l’ingénieur italien en aéronautique Umberto Nobile, il franchit l’Arctique en dirigeable en partant des Spitsberg, archipel norvégien au-delà du Cercle glacial arctique. Ils arriveront en Alaska. En 1928, Amundsen perd la vie en voulant secourir son ami Umberto Nobile, dont le dirigeable s’était écrasé près de l’archipel Spitsberg.
00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 13 décembre 2007
1084: Süleyman Shah s'empare d'Antioche

13 décembre 1084: Le chef de guerre turc Süleyman Shah s’empare de la grande ville proche-orientale d’Antioche, clef de l’Anatolie et port méditerranéen important. Les troupes musulmanes turques s’approchent à grands pas de Byzance. Süleyman s’était déjà emparé de Konya au centre de l’Anatolie, provoquant par cette victoire un exode des Arméniens vers les côtes de Cilicie. Les succès de Süleyman favorisent également la victoire du parti militaire et de l’aristocratie provinciale de l’empire byzantin, coincé entre une offensive normande en Thessalie (Grèce) et les Seldjoukides de Süleyman. Pour éviter d’être pris ainsi en tenaille, le Basileus Alexis I Comnène tente de se rapprocher de la Papauté et des Vénitiens, ce qui amènera en bout de course à la première croisade, réaction européenne face à l’offensive turque, qui vient de débouler sur les côtes orientales de la Méditerranée.
En Espagne, en 1085, une croisade européenne avant la lettre, avait apporté son appui à Alphonse VI de Castille, qui enlève Tolède, centre névralgique de la péninsule ibérique. L’année 1085 est donc une année cruciale, qui marque en un certain sens le réveil de l’Europe. Les Almoravides de Youssouf Ben Tashfin tenteront certes de reprendre pied en Espagne, mais sans reconquérir la position stratégique primordiale qu’est Tolède. Youssouf prendra Valence, avant d’essuyer une vigoureuse contre-offensive d’un roi bien sympathique : Alphonse I le Batailleur de Navarre et d’Aragon, descendu de ses belles montagnes pyrénéennes pour affronter l’ennemi, qui, tenace, attaquera et contre-attaquera pendant encore près de deux siècles. En 1085 aussi périt à Rome le Pape Grégoire VII, qui avait déclenché la querelle des investitures en voulant émasculer l’Empire. Henri IV, qui avait subi l’humiliation de Canossa, s’était vengé, avait marché sur Rome, qui ne fut sauvée in extremis que par l’intervention des Normands. Urbain II, successeur du sinistre Grégoire VII, sera à peine plus conciliant, bien que plus lucide en appelant à la Croisade. Ni la reconquête des territoires conquis par les Seldjoukides et des Almoravides ni la réconciliation avec Byzance ne furent possibles avec ces papes apprentis sorciers qui voulaient ignorer les ressorts militaires et spirituels (kshatriaques) de l’impérialité germanique. L’Europe en paie les conséquences aujourd’hui encore.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 12 décembre 2007
1932: relations Japon/URSS

12 décembre 1932: Le Japon et l’URSS renouent des relations diplomatiques. Mais le contexte international en Extrême Orient est particulièrement tendu. Les Japonais venaient d’envahir la Mandchourie et de prendre cette province chinoise sous leur protection totale, organisant un Etat à leur entière dévotion, à la tête duquel ils placeront Pu-Yi, dernier enfant de la dynastie mandchoue qui avait régné sur la Chine jusqu’à la proclamation de la république en 1911, sous l’impulsion du Dr. Sun Ya-tsen.
La présence japonaise en Mandchourie, le long du fleuve Amour et de la dernière portion de la voie de chemin de fer transsibérienne constituait une menace pour la région de Vladivostok et pour toute la Sibérie transbaïkalienne (à l’Est du Lac Baïkal). Staline craignait que les Japonais ne fassent alliance avec les nationalistes chinois de Tchang Kaï-chek, en couvrant ainsi leurs arrières dans le sud, pour pouvoir avancer leurs pions en direction de l’Est sibérien soviétique et de la Mongolie Extérieure. Moscou voyait avec inquiétude l’émergence d’un « bloc jaune », capable de lancer des opérations de conquêtes en Sibérie et en Asie centrale. De 1932 à 1937, la région a connu quelques années d’incertitude. En 1937, le Japon abandonne toute visée sur le Nord et attaque le Guomindang nationaliste de Tchang Kaï-chek, signalant par la même occasion que ses intérêts le portent désormais vers le Sud.
Dans le conflit sino-nippon, l’URSS se déclare neutre, signe un pacte de non-agression avec la Chine et laisse le Japon poursuivre ses opérations en pays han. En 1945, les troupes soviétiques envahiront la Mandchourie, la pilleront pour rééquiper l’Ouest du pays ravagé par l’invasion de l’Axe puis la quitteront pour la laisser aux Chinois. Des incidents de frontières assez graves ponctueront l’ère brejnevienne, ou les deux armées rouges s’affronteront. Les Soviétiques auront l’avantage.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 décembre 2007
1994: Première guerre de Tchétchénie

11 décembre 1994: Déclenchement de la première guerre de Tchétchénie. Le 1 novembre 1991, la Tchétchénie, ancienne région autonome de l’URSS, se déclare indépendante unilatéralement, rompt tout lien fédératif avec la Russie. Le Président de la nouvelle entité est Djokhar Doudaïev.
Immédiatement après cette proclamation d’indépendance, un régime de terreur s’installe, contraignant de 200.000 à 300.000 personnes, surtout de nationalité russe ou ossète, à opter pour la voie de l’exil. Pour une région autonome qui comptait à peine un million à un million et demi d’habitants, c’est une saignée démographique impressionnante, donnant la pleine mesure de la terreur qui y fut pratiquée. Tous les principes de droit y furent abrogés, la criminalité organisée prit le contrôle du pays. Sous l’impulsion du Premier Secrétaire du Conseil de Sécurité de la Fédération de Russie, Oleg Lobov, Eltsine donne l’ordre d’intervenir militairement dans la région pour y rétablir l’ordre. 40.000 soldats russes, mal équipés et mal instruits, marchent sur Grosny, la capitale.
En avril 1995, après la destruction de Grosny par l’artillerie russe, les troupes d’Eltsine ne contrôlent que 80% du territoire de la Tchétchénie. C’est alors que la guerre prend le visage hideux qu’elle ne cessera plus d’exhiber. Le terrorisme tchétchène, plus que tout autre, entend ne rien respecter des conventions humanitaires traditionnelles : ainsi, en juin 1995, une bande emmenée par Chamil Bassaïev s’attaque, dans le sud de la Russie, à un hôpital, prenant un millier d’otages parmi les patients et le personnel médical et para-médical. L’horreur absolue ! La Russie d’Eltsine capitule, cède et met un terme à toutes les opérations militaires. Les hostilités cessent le 30 juillet 1995, après signature d’un accord. Seuls 6000 soldats russes demeurent en Tchétchénie.
Mais des francs-tireurs tchétchènes, plus extrémistes encore, poursuivent leur œuvre de mort : le 9 janvier 1996, un autre hôpital est attaqué et un village du Daghestan est occupé. Les troupes russes interviennent et détruisent le village, transformé en bastion par les terroristes. Finalement, après de nombreux soubresauts, le Général Lebed finit par obtenir un véritable cessez-le-feu, en août 1996. Les derniers soldats russes se retirent en janvier 1997. La paix ne durera pas deux ans. En 1999, quand la crise des Balkans atteint son paroxysme et que les aviations de l’OTAN s’apprêtent à bombarder les ponts du Danube à Belgrade, le terrorisme tchétchène fait diversion au Daghestan, fait sauter des immeubles de rapport à Moscou et place des bombes dans le métro. Les victimes civiles sont innombrables. Le scénario est campé pour que commence la deuxième guerre de Tchétchénie, où l’horreur sera plus indicible encore : les terroristes de Bassaïev, animé par l’idéologie haineuse du wahhabisme (prêché par nos imams de garage), s’attaqueront à un théâtre de Moscou et à l’école de Beslan en Ossétie, massacrant plus de 300 enfants innocents.
Ce sont de telles horreurs que le quotidien « Le Soir » de Bruxelles nous demande d’applaudir à longueur de colonne, au nom d’un humanisme, style ULB. On a envie de vomir. Et on vomit.
00:40 Publié dans Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (9) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 10 décembre 2007
1991: Indépendance du Nagorny-Karabagh

10 décembre 1991: L’enclave arménienne d’Azerbaïdjan, le Nagorny-Karabagh se déclare indépendante. Le Nagorny-Karabagh est le nom russe, plus courant, de ce qu’il convient désormais d’appeler en français le « Haut-Karabagh », terme linguistiquement mixte, « bagh » signifiant « jardin » en langue persane, et « kara », « noir » en turc. « Karabagh » signifie dès lors « Jardin noir ». C’est un territoire de 5000 km2, dont la capitale est Stepanakert. Les Arméniens, qui peuplent cette région montagneuse du Caucase méridionale, préfèrent lui donner désormais le nom d’ « Artsakh ».
L’histoire contemporaine de cette région commence au Traité de Versailles, de sinistre mémoire, où, contrairement aux peuples d’Europe centrale et orientale, les Arméniens, pour s’être révoltés contre les Turcs, obtiennent des avantages. Ils reçoivent un pays désenclavé, avec une large fenêtre sur la Mer Noire. Mais dès 1921, les troupes bien aguerries et bien commandées de Mustafa Kemal Atatürk battent les Arméniens, conquièrent l’Arménie occidentale et le pays de Van, coupent l’Arménie résiduaire de la mer en conquérant la côte pontique, ramenant tout cet ensemble territorial dans le giron turc. Les Arméniens sont contraints de demander la protection de la Russie, devenue bolchevique. C’est ainsi que s’est créée une « République socialiste soviétique d’Arménie », qui sera bien vite dissoute, pour être incluse dans une vaste entité, la « République socialiste soviétique de Transcaucasie », laquelle sera à son tour dissoute en 1936, année où une nouvelle fois, les Soviétiques créent une « République socialiste soviétique d’Arménie », distincte des autres entités sud-caucasiennes.
Cette république existera jusqu’au 21 septembre 1991, où, dans le sillage de la dissolution de l’URSS, elle se proclame indépendante. Dans toute cette effervescence, le Haut-Karabagh, bien que peuplé d’Arméniens, avait été inclus dans la « République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan ». Dans l’optique des Soviétiques, à l’époque, il fallait amadouer les peuples turcs d’Asie centrale pour qu’ils rejoignent le grand projet révolutionnaire communiste. Staline, alors chef du « Bureau Caucasien » du Comité central du parti bolchevique, avait imposé cette cession du Haut Karabagh aux Azéris, qui en firent toutefois une région autonome dans leur république.
Dès la fin de la période de la perestroïka de Gorbatchev, les Arméniens du Haut Karabagh avaient proclamé la sécession d’avec l’Azerbaïdjan le 12 juin 1988. Les Azéris avaient réagi avec une violence extrême, déclenchant des pogroms sanglants, notamment à Soumgait et à Bakou, où des centaines d’Arméniens avaient été massacrés. Les Azéris suppriment également le statut d’autonomie que Staline avait octroyé aux Arméniens du Haut Karabagh. Dès 1991, l’Arménie et les montagnards du « Jardin noir » passent à l’offensive, vengent les victimes des atroces pogroms azéris et obtiennent la victoire, au prix de 17.000 soldats arméniens tués au combat. La Russie avait appuyé l’Arménie et, le 8 mai 1992, l’armée arménienne était entrée dans la ville de Choucha, scellant la défaite des Azéris, soutenus par la Turquie et les Etats-Unis.
Le 12 mai 1994, la Russie obtient qu’une trêve soit signée. Alors que les peuples européens perdent sur toute la ligne, reculent face à l’alliance islamo-yankee, la victoire arménienne est le seul succès enregistré au cours de ces deux dernières décennies. En effet, les troupes arméniennes ont conquis le territoire azéri situé entre l’enclave du Haut Karabagh et la frontière arménienne, poussant la frontière plus à l’Est, au détriment d’un peuple turc. La haine que vouent Turcs et Azéris à l’endroit des Arméniens, vient du fait que ce peuple européen, depuis les invasions seldjoukides, a toujours tenu tête au flux ininterrompu des nomades turcs venus du fin fond de l’Asie et occupent un territoire qui peut éventuellement servir de verrou à cette expansion.
La présence de l’Arménie dans le Caucase méridional empêche la continuité territoriale, dont rêvent les Turcs, et qui devrait s’étendre de l’Adriatique à la Muraille de Chine. La question arménienne, et, partant, celle du Haut Karabagh, amène des pays comme la Grèce et l’Iran à soutenir l’Arménie et à se rapprocher de la Russie, car ni Grecs ni Arméniens ni Russes ni Iraniens, unis par une solidarité indo-européenne, n’ont intérêt à ce que la continuité territoriale des pantouraniens soit un jour une réalité politique.
Notons que sur la pression des Etats-Unis et des lobbies pro-américains, l’UE condamne l’occupation de territoires azéris par les Arméniens et refuse de reconnaître la courageuse république d’Artsakh, sous prétexte qu’elle a fait sécession. Mais quand des souteneurs et des trafiquants de drogues albanais, financés par l’Arabie Saoudite, font sécession au Kosovo, l’UE applaudit, verse des subsides et des torrents de larmes. Au Kosovo, c’est une bonne sécession parce que les sécessionnistes sont financés par l’Arabie Saoudite. En Artsakh, c’est une mauvaise sécession parce que cela contrarie les pogromistes turcs. Deux poids, deux mesures.
00:35 Publié dans Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Comment la folie d'Erasme sauva notre civilisation

Karel VEREYCKEN
Comment la folie d'Erasme sauva notre civilisation
00:10 Publié dans Affaires européennes, Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


