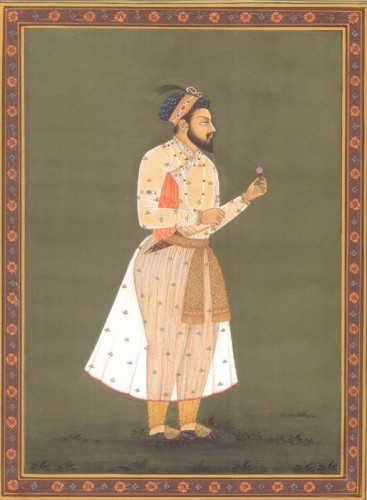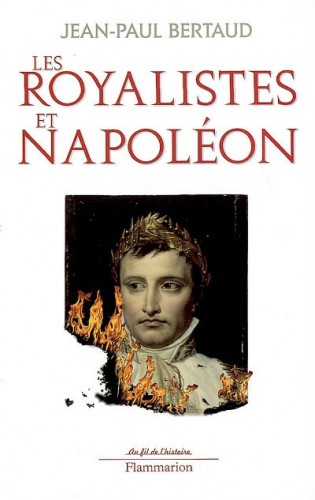mardi, 11 août 2009
Les communistes belges dans la collaboration jusqu'au 22 juin 1941
Les communistes belges dans la collaboration jusqu'au 22 juin 1941
Beaucoup plus important avant la guerre et dans l'immédiat après- guerre que dans les années 50, 60 et 70, le PCB, aujourd'hui disparu, qui n'a plus ni journaux ni parlementaires, était, comme son «grand frère» français, totalement inféodé à la politique de Moscou. C'était Bereï, délégué à Bruxelles de l'URSS, qui commandait, qui décidait, qui dictait les lignes de conduite. Dès la signature du pacte Ribbentrop-Molotov d'août 1939, l'anti-nazisme est mis au placard. De l'Allemagne, les militants journalistes ne disent plus ni du bien ni du mal. Le Professeur Jacques Willequet a repéré, dans son livre (1), toutes les tirades en faveur du bloc germano-russe qu'ont publiées les organes communistes La Voix du Peuple, Uilenspiegel, Clarté, Espoir, Temps Nouveaux, Jeunesse Nouvelle, Drapeau Rouge, Liberté, De Strijd, Het Vlaamsche Volk. «Commencer la guerre pour anéantir l'hitlérisme, c'est accepter une politique de sottise criminelle» (Het Vlaamsche Volk, 14 oct. 39). Les alertes de novembre 39 et de janvier 40, où les Allemands testent les capacités de l'armée belge et de sa DCA, sont qualifiées «d'invention des services secrets britanniques». La Finlande, qui résiste héroïquement aux armées de Staline pendant l'hiver 39-40, est la «patrie des gardes blancs» et sa défaite, une victoire du prolétariat. Les journaux communistes accueillent la victoire allemande de mai-juin 1940 comme une délivrance. Le député communiste liégeois Julien Lahaut circule dans le sud de la France, dans une grosse voiture prêtée par les services allemands, pour récupérer les Belges dispersés par l'exode ou internés dans les camps français, après avoir été arrêtés par la Sûreté du Royaume (parmi eux: anarchistes, communistes, rexistes et nationalistes flamands, ces derniers étant largement majoritaires). A ceux qui l'écoutent, Julien Lahaut déclare, d'après Léon Degrelle, lui-même détenu, et selon l'historien officiel de l'Ecole Royale Militaire, Henri Bernard: «Le national-socialisme réalise toutes nos aspirations démocratiques» (dans un discours prononcé à Villeneuve-sur-Lot, fin juin 40). Le journal La Voix du Peuple, organe des communistes bruxellois, ressuscite dès le lendemain de la prise de Bruxelles, mais est interdit le 23 juin; à Anvers, Uilenspiegel paraît dès le 2 juin 1940 et ne disparaît que le 1er mars 1941. La spécialité des jounraux communistes, fidèles aux clauses du pacte germano-soviétique, sera de fulminer contre les Anglais. Le gouvernement exilé en Angleterre est un ramassis de «laquais de la Cité de Londres et des 200 familles», qui, de srucroît, «ont souillé le blason du Roi» (ce qui, sous la plume d'un militant communiste, est assez étonnant, puisque les communistes s'opposeront avec la dernière énergie au retour du monarque après 1945 et que Julien Lahaut criera «Vive la République!», au moment de la prestation de serment de Baudouin 1er; Lahaut sera mystérieusement assassiné par des inconnus, sur le pas de sa porte, quelques semaines plus tard...). Le 16 juin 1940, Uilenspiegel se félicite de l'entrée des troupes de Mussolini dans les Alpes françaises: «cela hâtera la débâcle des impérialistes». Le même journal, le 21 juillet 40, applaudit aux propositions de paix de Hitler, en concluant: «Plus vite les boutefeux occidentaux seront battus, mieux cela vaudra». En septembre 1940, La Vérité se félicite du fait que l'URSS ait supprimé «ce foyer de guerre né de Versailles qu'était la Pologne des seigneurs»; et il ajoute: «Les fauteurs de guerre anglo-français et leurs valets, les chefs de la social-démocratie, rejetèrent dédaigneusement les propositions allemandes appuyées à l'époque par l'URSS». Le 15 janvier 1941, Clarté insulte les troupes belges recrutées à Londres: c'est une «Légion Etrangère» destinée à servir «les magnats britanniques auxquels [le gouvernement Spaak-Pierlot de Londres] a déjà livré le Congo» (et voilà les communistes défendant le colonialisme belge, pourtant ultra-capitaliste dans ses pratiques!). Liberté et Drapeau Rouge se félicitent de la révolte anti-britannique de Rachid Ali en Irak, des mouvements indépendantistes indiens qui sabotent le recrutement de troupes aux Indes, de la disparition de la Yougoslavie, et de l'occupation de la Grèce (qui avait eu le tort d'abriter des troupes britanniques «menaçant l'URSS»!) (éditions de mai 1941).
Mais ces vigoureuses tirades pro-allemandes et anti-britanniques se feront moins enthousiastes pour plusieurs motifs: 1) les autorités d'occupation sont conservatrices et refusent toutes concessions d'ordre social; 2) les Allemands se servent des stocks belges de vivres et de matières premières, accentuant la précarité dans les couches les plus pauvres de la population; 3) les divergences entre Allemands et Soviétiques se font sentir; ce qui conduit certains chefs communistes à suivre les mots d'ordre consignés dans un article prémonitoire, paru avant mai 40, de Temps Nouveaux (n°2, 1940), où on lit: «Ce qu'il faut souhaiter, c'est une paix juste et durable, par un accord entre les deux plus fortes puissances du globe: les Etats-Unis et l'URSS». Finalement, la presse communiste affirmera que «l'avenir n'appartient ni à Hitler ni à Churchill». Ou, comme l'exprime un titre sans ambigüité de Liberté (14 avril 41): «Churchill ou Hitler? Les travailleurs ne choisissent pas entre la peste et le choléra»; 4) Les communistes, tout comme les socialistes de l'UTMI, sont furieux de voir que les Allemands donnent les postes-clef aux militants des partis autoritaires de droite, Nationalistes flamands du VNV et Rexistes de Degrelle. Les Rouges se sentent floués.
Le 22 juin 1941, le pacte germano-soviétique a vécu. Les communistes poursuivront dès lors les mots d'ordre parus dans Temps Nouveaux: alliance avec Roosevelt et Staline, contre les vieilles puissances européennes.
Raoul FOLCREY.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, communisme, belgique, belgicana, collaboration, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 10 août 2009
La gauche et la collaboration en Belgique: De Man, les syndicats et le Front du Travail

De Man (debout) avec Emile Vandervelde avant la guerre
La gauche et la collaboration en Belgique
De Man, les syndicats et le Front du Travail
par Raoul FOLCREY
La collaboration de gauche en Belgique? Elle prend son envol avec le manifeste que Henri De Man, chef de file du Parti Ouvrier Belge (POB), publie et diffuse dès le 28 juin 1940. De Man (1885-1953) a été agitateur socialiste dès l'âge de 17 ans, polyglotte, correspondant en Belgique de la social-démocratie allemande et des travaillistes britanniques avant 1914, volontaire de guerre, diplomate au service du Roi Albert 1er, professeur à Francfort avant le nazisme, initiateur du mouvement planiste en Europe dans les années 30, ministre, président du POB; avec une telle biographie, il a été sans conteste l'une des figures les plus marquantes du socialisme marxiste européen. Hérétique du marxisme, sa vision du socialisme n'est pas matérialiste, elle repose sur les mobiles psychologiques des masses frustrées, aspirant à la dignité. Le socialisme, dans ce sens, est une formidable revendication d'ordre éthique. Ascète, sportif, De Man, issu de la bonne bourgeoisie anversoise, n'a jamais aimé le luxe. Le socialisme, déduit-il de cette option personnelle, ne doit pas embourgeoiser les masses mais leur apporter le nécessaire et les rendre spartiates.
Avec son fameux Plan du Travail de Noël 1933, De Man donne au socialisme une impulsion volontariste et morale qui séduira les masses, les détournera du communisme et du fascisme. Les intellectuels contestataires français, ceux que Loubet del Bayle a nommé les «non-conformistes des années 30», s'enthousiasmeront pour le Plan et pour ses implications éthiques. Pour l'équipe d'Esprit (regroupée autour d'Emmanuel Mounier), d'Ordre Nouveau (Robert Aron et A. Dandieu), de Lutte des Jeunes (Bertrand de Jouvenel), de l'Homme Nouveau (Roditi), De Man devient une sorte de prophète. Côté socialiste, en France, ce sera surtout le groupe «Révolution Constructive» (avec Georges Lefranc, Robert Marjolin, etc.) qui se fera la caisse de résonnance des idées de Henri De Man. Pierre Ganivet, alias Achille Dauphin-Meunier, adopte également le planisme demanien dans sa revue syndicaliste révolutionnaire L'Homme réel. Au sein du parti, Léon Blum craint le Plan du Travail:
- parce qu'il risque de diviser le parti;
- parce qu'il implique une économie mixte et tend à préserver voire à consolider le secteur libre de l'économie;
- parce qu'il crée une sorte de «régime intermédiaire» entre le capitalisme et le socialisme;
- parce que la critique du parlementarisme, implicite chez De Man, rapproche son socialisme du fascisme.
Pour Déat, les idées planistes, exposées notamment par De Man à l'Abbaye de Pontigny (septembre 1934), reflètent un pragmatisme de la liberté, une approche de l'économie et de la société proche du New Deal de Roosevelt, et ne relèvent nullement du vieux réformise social-démocrate. Le planisme, avait affirmé Déat dans l'Homme Nouveau (n°6, juin 1934), n'impliquait aucune politique de compromis ou de compromissions car il était essentiellement révolutionnaire: il voulait agir sur les structures et les institutions et les modifier de fond en comble. Presqu'au même moment, se tenait un Congrès socialiste à Toulouse: la plupart des mandats de «Révolution Constructive» s'alignent sur les propositions de Blum, sauf deux délégués, parmi lesquels Georges Soulès, alias Raymond Abellio, représentant le département de la Drôme. Georges Valois, proudhonien un moment proche de l'AF, est hostile à De Man, sans doute pour des motifs personnels, mais accentue, par ses publications, l'impact du courant para-planiste ou dirigiste en France.
Or, à cette époque, pour bouleverser les institutions, pour jouer sur les «structures», pour parfaire un plan, de quelque nature qu'il soit, il faut un pouvoir autoritaire. Il faut inaugurer l'«ère des directeurs». Pratique «directoriale», planification, etc. ne sont guère possible dans un régime parlementaire où tout est soumis à discussion. Les socialistes éthiques, ascètes et spartiates, anti-bourgeois et combatifs, méprisaient souverainement les parlottes parlementaires qui ne résolvaient rien, n'arrachaient pas à la misère les familles ouvrières frappées par le chômage et la récession. Dans son terrible livre, La Cohue de 40, Léon Degrelle croque avec la férocité qu'on lui connaît, un portrait du socialisme belge en déliquescence et de De Man, surplombant cet aréopage de «vieux lendores adipeux, aux visages brouillés, pareils à des tartes aux abricots qui ont trop coulé dans la vitrine» (p. 175). De Man, et les plus jeunes militants et intellectuels du parti, avaient pedu la foi dans la religion démocratique.
Dès le déclenchement des hostilités, en septembre 1939, De Man opte personnellement contre la guerre, pour la neutralité absolue de la Belgique, proclamée par le Roi dès octobre 1936. Fin 1939, avec l'appui de quelques jeunes militants flamands, dont Edgard Delvo, il fonde une revue, Leiding (Direction), ouvertement orientée vers les conceptions totalitaires de l'époque, dit Degrelle. Il serait peut-être plus juste de dire que le socialisme planiste y devenait plus intransigeant et voulait unir, sans plus perdre de temps, les citoyens lassés du parlementarisme en un front uni, rassemblé derrière la personne du Roi Léopold III.
Après l'effondrement de mai-juin 1940, De Man publie un «manifeste aux membres du POB», où figurent deux phrases qui lui ont été reprochées: «Pour les classes laborieuses et pour le socialisme, cet effondrement d'un monde décrépit, loin d'être un désastre, est une délivrance»; «[le verdict de la guerre] est clair. Il condamne les régimes où les discours remplacent les actes, où les responsabilités s'éparpillent dans le bavardage des assemblées, où le slogan de la liberté individuelle sert d'oreiller à l'égoïsme conservateur. Il appelle une époque où une élite, préférant la vie dangereuse et rapide à la vie facile et lente, et cherchant la responsabilité au lieu de la fuir, bâtira un monde nouveau».
Ces phrases tonifiantes, aux mâles accents, étaient suivies d'un appel à construire le socialisme dans un cadre nouveau. Cet appel a été entendu. De toutes pièces, De Man commence par créer un syndicat unique, l'UTMI (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels), officiellement constitué le 22 novembre 1940, après d'âpres discussions avec le représentant du Front du Travail allemand, le Dr. Voss. De Man, ami du Roi, voulait sauvegarder l'unité belge: son syndicat serait dès lors unitaire, ne serait pas scindé en une aile flamande et une aile wallonne. Le Dr. Voss, visant l'éclatement du cadre belge en deux entités plus facilement absorbables par le Reich, impose la présence des nationalistes flamands du VNV dans le comité central composé de socialistes, de démocrates-chrétiens, de syndicalistes libéraux. Edgard Delvo, ancien socialiste, auteur d'un ouvrage préfacé par De Man et paru à Anvers en 1939, collaborateur de Leiding, la revue neutraliste hostile à toute participation belge aux côtés des Anglais et des Français, théoricien d'un «socialisme démocratique» ou plutôt d'un populisme socialiste, est l'homme du VNV au sein de ce comité. En 1942, poussé par les services du Front du Travail allemand, Delvo deviendra le maître absolu de l'UTMI. Ce coup de force des nationalistes provoque la rupture entre De Man et son syndicat: l'ancien chef du POB quitte Bruxelles et se réfugie en Haute-Savoie, grâce à l'aide d'Otto Abetz. Il sera désormais un «cavalier seul». Les socialistes, les libéraux et les jocistes quittent l'UTMI en 1942, laissant à Delvo les effectifs nationalistes flamands et wallons, peu nombreux mais très résolus.
En Wallonie, dès la parution du Manifeste du 28 juin 1940, plusieurs journalistes socialistes deviennent du jour au lendemain des zélotes enragés de la collaboration. Ainsi, le Journal de Charleroi, organe socialiste bon teint depuis des décennies, était édité par une société dont l'aristocratique famille Bufquin des Essarts étaient largement propriétaire. Dès les premiers jours de juin 40, un rédacteur du journal, J. Spilette s'empare du journal et le fait paraître dès le 6, avant même d'avoir créé une nouvelle société, ce qu'il fera le 8. En novembre 1940, Spilette, avançant ses pions sans sourciller, s'était emparé de toute la petite presse de la province du Hainaut et augmentait les ventes. Els De Bens, une germaniste spécialisée dans l'histoire de la presse belge sous l'occupation, écrit que l'influence de De Man était prépondérante dans le journal. Spilette défendait, envers et contre les injonctions des autorités allemandes, les positions de De Man: syndicat unique, augmentation des salaires, etc. Spilette baptisait «national-socialisme» la forme néo-demaniste de socialisme qu'il affichait dans son quotidien. Ensuite, rompant avec De Man, Spilette et ses collaborateurs passent, non pas à la collaboration modérée ou à la collaboration rexiste/degrellienne, mais à la collaboration maximaliste, regroupée dans une association au nom évocateur: l'AGRA, soit «Amis du Grand Reich Allemand». L'AGRA, dont le recrutement était essentiellement composé de gens de gauche, s'opposait au rexisme de Degrelle, marqué par un héritage catholique. Les deux formations finiront par s'entendre en coordonnant leurs efforts pour recruter des hommes pour le NSKK. Le 18 octobre 1941, le Journal de Charleroi fait de la surenchère: il publie un manifeste corsé, celui du Mouvement National-Socialiste wallon, où il est question de créer un «Etat raciste» wallon. Spilette appelle ses concitoyens à rejoindre cette formation «authentiquement socialiste».
A Liège, le quotidien La Légia, après avoir été dirigé par des citoyens allemands, tombe entre les mains de Pierre Hubermont, écrivain, lauréat d'un prix de «littérature prolétarienne» à Paris en 1931, pour son roman Treize hommes dans la mine. Les Allemands ou Belges de langue ou de souche allemandes, actionnaires de la société ou rédacteurs du journal, entendaient germaniser totalement le quotidien. Pierre Hubermont entend, lui, défendre un enracinement wallon, socialiste et modérément germanophile. Cette option, il la défendra dans une série de journaux culturels à plus petit tirage, édités par la «Communauté Culturelle Wallonne» (CCW). Parmi ces journaux, La Wallonie, revue culturelle de bon niveau. Dans ses éditoriaux, Hubermont jette les bases idéologiques d'une collaboration germano-wallonne: défense de l'originalité wallonne, rappel du passé millénaire commun entre Wallons et Allemands, critique de la politique française visant, depuis Richelieu, à annexer la rive gauche du Rhin, défense de l'UTMI et de ses spécificités syndicales.
Fin 1943, les services de la SS envoient un certain Dr. Sommer en Wallonie pour mettre sur pied des structures censées dépasser le maximalisme de l'AGRA. Parmi elles: la Deutsch-Wallonische Arbeitsgemeinschaft, en abrégé DEWAG, dirigée par un certain Ernest Ernaelsteen. Ce sera un échec. Malgré l'appui financier de la SS. DEWAG tentera de se donner une base en noyautant les «cercles wallons» de R. De Moor (AGRA), foyers de détente des ouvriers wallons en Allemagne, et les «maisons wallonnes», dirigée par Paul Garain, président de l'UTMI wallonne, qui pactisera avec Rex.
Quelles conclusion tirer de ce bref sommaire de la «collaboration de gauche»? Quelles ont pu être les motivations de ces hommes, et plus particulièrement de De Man, de Delvo et d'Hubermont (de son vrai nom Joseph Jumeau)?
La réponse se trouve dans un mémoire rédigé par la soeur d'Hubermont, A. Jumeau, pour demander sa libération. Mlle Jumeau analyse les motivations de son frère, demeuré toujours socialiste dans l'âme. «Une cause pour laquelle mon frère restait fanatiquement attaché, en dehors des questions d'humanisme, était celle de l'Europe. Il était d'ailleurs Européen dans la mesure où il était humaniste, considérant l'Europe comme la Patrie de l'humanisme (...) Cette cause européenne avait été celle du socialisme depuis ses débuts. L'internationalisme du 19° siècle n'était-il pas surtout européen et pro-germanique? L'expérience de 1914-1918 n'avait pas guéri les partis socialistes de leur germanophilie (...). ... la direction du parti socialiste était pro-allemande. Et, au moment de l'occupation de la Ruhr, ..., [mon frère] a dû aligner son opinion sur celle de Vandervelde (ndlr: chef du parti socialiste belge) et de De Brouckère (ndlr: autre leader socialiste), qui étaient opposés aux mesures de sanctions contre l'Allemagne. Le peuple (ndlr: journal officiel du POB), jusqu'en 1933, c'est-à-dire jusqu'à la prise du pouvoir par Hitler, a pris délibérément et systématiquement fait et cause pour l'Allemagne, dans toutes les controverses internationales. Il a systématiquement préconisé le désarmement de la France et de la Belgique, alors que tout démontrait la volonté de l'Allemagne de prendre sa revanche. Mon frère (...) n'avait pu du jour au lendemain opérer le retournement qui fut celui des politiciens socialistes. Pour lui, si l'Allemagne avait été une victime du traité de Versailles avant 1933, elle l'était aussi après 1933 (...). Et si la cause de l'unité européenne était bonne avant 1933, lorsque Briand s'en faisait le champion, elle l'était toujours après 1933, même lorsque les Allemands la reprenaient à leur compte (...). [Mon frère] partait de l'idée que la Belgique avait toujours été le champ de bataille des puissances européennes rivales et que la fin des guerres européennes, que l'unification de l'Europe, ferait ipso facto la prospérité de la Belgique».
Tels étaient bien les ingrédients humanistes et internationalistes des réflexes partagés par De Man, Delvo et Hubermont. Même s'ils n'ont pas pris les mêmes options sur le plan pratique: De Man et Hubermont sont partisans de l'unité belge, le premier, ami du Roi, étant centraliste, le second, conscient des différences fondamentales entre Flamands et Wallons, étant fédéraliste; Delvo sacrifie l'unité belge et rêve, avec ses camarades nationalistes flamands, à une grande confédération des nations germaniques et scandinaves, regroupées autour de l'Allemagne (ce point de vue était partagé par Quisling en Norvège et Rost van Tonningen aux Pays-Bas). Mais dans les trois cas, nous percevons 1) une hostilité aux guerres inter-européennes, comme chez Briand, Stresemann et De Brinon; 2) une volonté de créer une force politique internationale, capable d'intégrer les nationalismes sans en gommer les spécificités; une inter-nationale comportant forcément plusieurs nations solidaires; Delvo croira trouver cet internationalisme dans le Front du Travail allemand du Dr. Ley; 3) une aspiration à bâtir un socialisme en prise directe avec le peuple et ses sentiments.
De Man connaîtra l'exil en Suisse, sans que Bruxelles n'ose réclamer son extradition, car son procès découvrirait la couronne. Delvo sera condamné à mort par contumace, vivra en exil en Allemagne pendant vingt-cinq ans, reviendra à Bruxelles et rédigera trois livres pour expliquer son action. Hubermont, lourdement condamné, sortira de prison et vivra presque centenaire, oublié de tous.
Raoul FOLCREY.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, gauches, socialisme, collaboration, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, belgique, belgicana, syndicalisme, planisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 09 août 2009
El genocidio de Hiroshima
El genocidio de Hiroshima
Hace 64 años el presidente Truman ordeno lanzar la primera bomba atomica contra la humanidad, cometiendo un genocidio que aun no se ha juzgado en ningun tribunal internacional
 El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos asesino a mas de 200.000 civiles en la ciudad de Hiroshima, lanzando contra ella la primera bomba nuclear utilizada como arma de guerra en la historia de la humanidad, y tres dias despues sucedio lo mismo en Nagasaki. Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque solo la mitad había fallecido los días de los bombardeos y el resto por heridas incurables o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación.
El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos asesino a mas de 200.000 civiles en la ciudad de Hiroshima, lanzando contra ella la primera bomba nuclear utilizada como arma de guerra en la historia de la humanidad, y tres dias despues sucedio lo mismo en Nagasaki. Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque solo la mitad había fallecido los días de los bombardeos y el resto por heridas incurables o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación.
El presidente Harry S. Truman, quien ordeno el bombardeo, no lo hizo para acabar con la guerra y la escasa resistencia de Japon. Los mismos japoneses estaban intentando negociar la paz, y habian pedido la mediacion a Stalin. Antes de que la URSS pudiera aceptarla, EE.UU. se encargo de que las negociaciones de paz no tuvieran lugar y Japon se entregara a una rendicion incondicional. Japon ya estaba practicamente vencido, y la escusa de que la bomba se lanzo para evitar “mas muertes de civiles”, como cinicamente aseguro Truman, se desarma cuando miramos los miles de japoneses inocentes que murieron con los lanzamientos. En ningun caso hubieran muerto tantos si la guerra hubiera durado dos meses mas.
Estados Unidos demostro con el uso de la bomba atomica la calidad humana de sus dirigentes, su personalidad genocida. La Segunda Guerra Mundial pasara a la historia no solo por el holocausto perpetrado por los nazis, contra judios, gitanos, comunistas y homosexuales (entre otros), sino tambien por la extrema crueldad de Estados Unidos, que entonces demostro que la vida humana no le importa lo mas minimo, actitud que ha continuado de diversas formas asesinas hasta hoy dia.
El genocidio de Hiroshima y Nagasaki no ha sido juzgado por ningun tribunal internacional todavia, porque los genocidas fueron los vencedores en esta ocasion. No hubo Tribunal de Nuremberg para Truman y sus secuaces. Pero la historia, a pesar de las justificaciones que han inventado los medios de comunicacion actuando de silenciador moral, no deja de mostrarnos lo horrible de los actos de los que son capaces de utilizar cualquier metodo para lograr sus fines materiales.
Con una hipocresia que hiela toda capacidad de sentimiento, que indigna hasta a las piedras, los EEUU han venido acusando a todos sus enemigos de asesinos, crueles genocidas, o tiranos, mientras que ellos, tras el silenciador de la opinion publica, creada por los escribanos y voceros del sistema, muy bien pagados, continuan orgullosos de sus crimenes y ejecutándolos, de una manera u otra, hasta el presente y a lo largo de todo el planeta.
Aunque de sus horrendos y continuos crimenes el asesinato de 220.000 japoneses de un golpe, (sin contar las secuelas radioactivas producidas en los pocos supervivientes), el genocidio producido por el lanzamiento de las dos unicas bombas nucleares lanzadas hasta hoy contra la humanidad, es, si cabe, el mas ilustrativo de la verdadera naturaleza criminal del imperio yankee y del corazon podrido de sus primeros peones, los presidentes de Estados Unidos (independientemente del color de su piel).
Jose Luis Forneo
Extraído de CuestiónateloTodo.
00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, japon, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, armes nucléaires, bombe atomique, pacifique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 08 août 2009
1979: Guerres secrètes au Moyent Orient
1979: Guerres secrètes au Moyen Orient

L’incroyable année 1979 a vu se succéder des événements qui ont changé le cours de notre histoire : révolution iranienne, accords de Camp David, prise d’otages de La Mecque et de l’ambassade américaine à Téhéran, et enfin, invasion soviétique de l’Afghanistan… Voici comment, pendant cette période, la France a cru pouvoir manipuler l’ayatollah Khomeiny et prendre en Iran la place des Américains, comment le Mossad a organisé, en pleine révolution islamique, l’exode clandestin de dizaines de milliers de Juifs iraniens, et comment le royaume saoudien a fait appel au GIGN français pour libérer les lieux saints de l’islam occupés par des terroristes avec, à la clé, une récompense inattendue. On lève ici le voile sur les complicités occidentales qui ont permis au Pakistan, bien avant l’Iran, de mettre sur pied le premier programme nucléaire islamique et l’on découvre de quelle manière les services de renseignement saoudiens et pakistanais ont organisé les réseaux de financement et d’armement d’intégristes prêts à se retourner contre l’Occident. Les services secrets de tous bords – CIA, Sdece, Mossad… – et les présidents Carter et Giscard d’Estaing ont joué dans cette époque agitée un rôle crucial et parfois trouble, entraînant une série de réactions en chaîne. En quelques mois, le Moyen-Orient a basculé, et le monde entier avec lui, favorisant l’avènement d’un islamisme radical aujourd’hui florissant.
Yvonnick Denoël est éditeur et historien. Il a notamment publié Le livre noir de la CIA (Nouveau Monde éditions, 2007).
Disponible sur Amazon
14:32 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, années 70, géopolitique, moyen orient, guerre, iran |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 29 juillet 2009
Réflexions sur le destin de Dara Shukoh
Réflexions sur le destin de Dara Shukoh
Un musulman peut-il être tolérant? Faire preuve de tolérance d’esprit? Etre sincèrement intéressé aux autres cultures? Oui, bien sûr, il existe indubitablement de tels musulmans. La seconde question que nous posons: quel a été leur sort?
Dara Shukoh (1615-1659) était le fils aîné de l’Empereur moghol Shah Jahan et de son épouse favorite Mumtaz Mahal. Lorsque celle-ci mourut à la suite de son quatorzième accouchement, son époux fit construire pour elle un superbe monument funéraire, en dehors de sa capitale Agra, le fameux Taj Mahal. Après l’achèvement du bâtiment, il fit trancher la main à tous les maîtres d’oeuvre de cette merveille architecturale, de façon à ce qu’ils ne puissent pas en reproduire de pareilles ailleurs. Le Prince héritier Dara Shukoh reçut une bonne éducation, large d’esprit, que nous aurions qualifié d’“humaniste” en Europe. Il devint adepte du soufisme, une branche mystique à l’intérieur de l’islam. Il était un élève du saint soufi Mian Mir de Lahore. En disant cela, je n’ai pas dit grand chose car le soufisme présente un vaste éventail de variétés et de tendances.
On dit souvent que le soufisme est plus tolérant et plus large d’esprit que l’islam ortohdoxe. C’est partiellement vrai. Certains soufis ont été d’effroyables fanatiques. Comme, par exemple, Mouïnouddin Tchichti qui, en tant qu’espion, a préparé la plus sanglante invasion de l’Inde par Mohammed Ghori (en 1192). Même Faridouddin Attar, connu comme doux poète, a écrit un chant à la louange de Mahmoud de Ghazni, autre grand massacreur d’“infidèles”. Dara Shukoh lui, était d’une toute autre trempe. Il cherchait une base commune à l’hindouïsme et à l’islam. Dans ce but, il traduisit pour la toute première fois en persan les textes qui forment le noyau de la philosophie indienne, les Upanishads (“l’enseignement confidentiel”). Il expliqua les conclusions de ses recherches dans un ouvrage intitulé “Madschma al-Bahrain”, ou “Le confluent de deux mers”. Oui, concluait-il, de fait, l’hindouïsme et l’islam dans sa variante soufie, sont une seule et même chose. Tous deux valorisent l’“unité de l’Etre”. En posant ces conclusions, Dara Shukoh donnait une base philosophique à la politique que menait la dynastie moghole depuis près d’un siècle: faire cohabiter dans l’harmonie hindous et musulmans en arrondissant les angles du principe musulman d’inégalité entre croyants et idolâtres. Contrairement au régime tyrannique et fanatique du Sultanat de Delhi (1206 à 1526), qui avait sans cesse été confronté à des révoltes hindoues et des vendettas entre divers partis musulmans, l’Empire moghol, à partir du grand-père de Dara Shukoh, Akbar (1556-1605), reposait sur un compromis avec les Hindous, notamment par l’abrogation de l’impôt de tolérance que devaient payer tous les non-musulmans, par l’autorisation de rebâtir les temples qui avaient été détruits et par l’intronisation de princes hindous dans l’appareil administratif de l’Empire. Ces princes devaient servir de contre-poids pour le régime du Padishah (l’Empereur moghol), qui avait bien des ennemis dans le camp musulman: certains seigneurs et les clercs les plus radicaux, sous la houlette de Ahmad Sirhindi (mort en 1624), qui condamnaient sa politique de compromis. Le plus jeune frère de Dara Shukoh, Aurangzeb, appartenait, lui, à l’école de Sirhindi. Aurangzeb fulminait contre la politique d’apaisement de Dara Shukoh, avec son principe de dialogue inter-religieux et sa valorisation de la spiritualité par-delà l’exotérisme des pratiquants. Aurangzeb reprochait également à son frère de pratiquer l’art de la peinture et de favoriser les arts de la scène. Reproduire le visage humain est explicitement interdit par la religion islamique, bien que les princes les plus éclairés l’aient toujours toléré, du moins tant qu’on ne cherchait pas à peindre ou dessiner Dieu ou le Prophète.
Aurangzeb était un homme de stricte obédience. Il fit tout ce qu’il put pour décourager des pratiques non islamiques comme le théâtre, la danse et la musique. Plus tard, quand il fut devenu Padishah, il congédia les musiciens de la cour; ceux-ci manifestèrent alors devant le palais, en trimbalant un cerceuil pour simuler l’enterrement de la Muse. Aurangzeb leur cria alors de l’enterrer bien profondément pour qu’il n’ait plus jamais à entendre parler d’elle dans l’avenir. Il voulait ainsi se montrer féal disciple du Prophète qui se bouchait les oreilles lorsqu’il entendait jouer de la musique. Ce fut donc Aurangzeb qui devint Padishah et non Dara Shukoh. En 1657, Shah Jahan tomba malade et, aussitôt, une querelle éclata entre ses quatre fils pour sa succession. Dara Shukoh, qui était l’aîné donc le prince héritier en titre, bénéficiait du soutien de son père. Dans un premier temps, il vainquit son frère, Shah Shuja, qui s’était proclamé Padishah. Mais il fut vaincu à son tour le 8 juin 1658, lors de la Bataille de Samogarh, près d’Agra, où il faisait face aux troupes d’Aurangzeb. Dara Shukoh put prendre la fuite et commencer à lever une nouvelle armée lorsqu’un traître le livra à son frère. Les juges islamiques le condamnèrent à mort pour hérésie. On le couvrit de chaînes, on le promena à travers la ville pour l’humilier et on le tortura jusqu’à ce que mort s’ensuive. De sa propre main, Aurangzeb trancha la tête de Dara Shukoh, son frère, et l’envoya à leur père, qu’il avait fait enfermer dans une tour, où il resta les huit dernières années de sa vie, avec toutefois une faveur: il bénéficiait d’une vue sur le Taj Mahal. Le monument dédié à l’amour...
“Moestasjrik”/ “ ’t Pallieterke” (Anvers, 21 juin 2006, trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, histoire, islam, dialogue interculturel, tolérance, hindouïsme, soufisme, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 juillet 2009
Le débarquement à Dieppe fut-il un fiasco?

Erich KÖRNER-LAKATOS:
Le débarquement à Dieppe fut-il un fiasco?
19 août 1942: dans le courant de l’après-midi la “radio grande-allemande” annonce une nouvelle depuis le quartier général du Führer, le Werwolf, situé alors près de Vinnitza en Ukraine. Après l’habituel morceau de musique, les auditeurs apprennent par leur poste qu’une “invasion” vient d’échouer à l’Ouest.
“Le Commandement suprême de la Wehrmacht fait savoir qu’un débarquement de grande ampleur de troupes anglaises, américaines, canadiennes et gaullistes, dont les effectifs s’élèvent à une division pour la première vague, a eu lieu dans les premières heures de la matinée près de Dieppe sur la côte française de la Manche; cette tentative de débarquement a bénéficié de l’appui de forces navales et aériennes importantes et a été soutenue par des blindés; les forces allemandes chargées de défendre la côte ont brisé l’élan de l’ennemi qui avait essuyé des pertes élevées et sanglantes (...)”.
Un mois plus tôt, le 22 juillet 1942, Staline avait exigé, sur le ton de l’ultimatum, que ses alliés occidentaux ouvrissent un second front. En effet, le dictateur soviétique venait d’encaisser l’offensive estivale du groupe d’armées allemandes “Süd”: ses défenses étaient profondément ébranlées et il demandait qu’une offensive à l’Ouest soulage ses propres troupes. Ce sera surtout son représentant à Washington, son ancien ministre des affaires étrangères, Maxime Litvinov, qui insistera pour que les Occidentaux prennent des mesures concrètes. Winston Churchill temporise, promet aux Russes qu’il agira dans un an, car un débarquement exige des préparations de grande ampleur. La première tentative de s’incruster sur le sol français sera donc ce débarquement offensif, tenté sur les côtes normandes de la Manche, près de Dieppe.
Cette petite ville se situe dans le département de Seine-Maritime, à environ cent kilomètres au nord-est du Havre. Dès le départ, la tentative de débarquement des Alliés, dont le nom de code était “Jubilee”, connut la malchance. Une partie des trois à quatre cents navires de débarquement rencontra, quand la nuit était encore noire, un convoi de la marine allemande, chargé de surveiller le littoral. Elle perdit ainsi d’emblée tout effet de surprise.
A six heures du matin, le débarquement commence en trois endroits. 6100 hommes mettent pied à terre, pour la plupart appartenant à la 2ème Division canadienne du Général Roberts. Des unités de commandos de la Royal Navy les assistent.
L’ensemble de l’opération s’effectue sous un parapluie aérien de centaines de Spitfires et Hurricanes. Mais les attaquants se heurtent à une forte résistance, à laquelle ils ne s’attendaient pas: celle des hommes du 71ème Régiment d’infanterie du Lieutenant-Colonel allemand Bartel. L’artillerie côtière allemande est bien placée et les chasseurs Focke-Wulf procurent un appui-feu appréciable.
Les Canadiens sont plus nombreux mais inexpérimentés: ils ne font pas le poids devant les soldats éprouvés de la Wehrmacht dans les combats rapprochés le long des plages. Dans le ciel, toutefois, aucun des deux camps n’a le dessus: les Anglais, les Polonais exilés et les Américains perdent 98 avions, tandis que les Allemands en perdent 91. Vers midi, les Canadiens doivent déjà se replier; leurs chefs décident que le réembarquement aura lieu vers 15 h. Peu parmi les soldats débarqués retourneront ce jour-là en Angleterre, seulement un petit tiers. 1179 attaquants (dont près de 900 Canadiens) tomberont au combat; 2190 seront prisonniers, dont 60 officiers canadiens. Six cents prisonniers sont blessés et soignés sur place. Les Alliés perdent 28 chars et de nombreux navires de débarquement, ainsi que quatre destroyers et sept navires de transport. La Wehrmacht annonce 311 morts ou disparus et 280 blessés.
Officiellement, Londres tente de minimiser l’échec de Dieppe comme étant “un exercice armé de reconnaissance”. Pour les Allemands, en revanche, ce 19 août est la journée qui a prouvé que le Mur de l’Atlantique pouvait tenir, sans qu’il ne faille, insistait le haut commandement de la Wehrmacht, engager des réserves supplémentaires, constituées de troupes aguerries.
Mais cette propagande allemande cachait la vérité: l’aventure de Dieppe n’est nullement l’échec allié qu’elle a décrit pour les besoins de la cause. L’objectif de l’Opération “Jubilee” n’était pas d’ouvrir un second front à l’Ouest comme le réclamait Staline (pour le faire, il aurait fallu des effectifs bien supérieurs à ceux d’une simple division); ce n’était pas davantage un exercice général en prévision du débarquement de 1944, car on aurait pu le faire à bien moindre prix en Angleterre sous la forme de manoeuvres. Non: l’objectif de “Jubilee” n’était ni plus ni moins “Freya”, la plus moderne des stations radar allemandes, installée près de Dieppe. Son rayon d’action dépassait les 200 km et couvrait une bonne partie de l’Angleterre, ce qui permettait aux Allemands de détecter le décollage des escadres de bombardiers alliés immédiatement après leur envol.
C’est pour mener à bien ce coup de main contre “Freya” que les Britanniques ont déployé cette opération commando surdimensionnée. Le personnage-clef de l’opération est un Canadien de 28 ans, d’origine juive-polonaise, Jack Nissenthal. Il était un expert en radar particulièrement doué. Il s’est retrouvé à la pointe des opérations, tout à l’avant, où cela “pétait” le plus. Il était l’un des rares savants qui connaissaient en tous ses détails la technologie alliée des radars. Lors du débarquement de Dieppe, il était flanqué de dix soldats d’élite, non seulement pour sa protection mais pour celle du savoir-faire allié en matières de radar, car ces hommes ont reçu aussi pour mission complémentaire —et comme ordre strict— de ne pas laisser Nissenthal tomber vivant aux mains des Allemands. Nissenthal avait d’ailleurs reçu à cette fin une capsule de cyanure.
Nissenthal, homme de beaucoup d’allant, athlétique et impétueux, est parvenu, sous une pluie de balles allemandes, en perdant sept de ses gardes-du-corps, à approcher par deux fois l’appareil “Freya” et d’en démonter d’importantes composantes qui ont fourni aux Alliés des connaissances précieuses sur les techniques radar allemandes.
Grâce à Dieppe et à Nissenthal, les attaques à grande échelle des bombardiers anglo-saxons sur l’Allemagne ont été rendues possible car les savants alliés avaient constaté qu’il suffisait de tromper les radars allemands en lançant de simple bandes de feuilles d’aluminium. L’effroyable attaque contre Hambourg, qui dura trois jours en 1943 et fut baptisée l’“Opération Gomorrhe”, eut lieu sans que les Allemands n’aient pu organisé la moindre défense sérieuse de la ville hanséatique.
Vu dans cette optique, le fiasco apparent de Dieppe est en réalité un succès préparé avec audace et obtenu au prix fort. C’est une entreprise de type “troupe d’assaut” qui a obligé par la suite les Allemands à garnir davantage le Mur de l’Atlantique, avec des forces qui leur ont cruellement manqué ailleurs.
Bien entendu, dans le contexte de l’époque, la propagande allemande ne pouvait voir l’affaire sous un tel angle. Dans les actualités allemandes, la “bataille victorieuse” de Dieppe a pris une ampleur considérable: on la passait et la repassait inlassablement au cinéma avant le film de fiction. En plus, les producteurs de reportages de guerre, issus des “PK” (les “compagnies de propagande”),ont publié une sorte de recueil, intitulé “Dieppe – die Bewährung des Küstenwestwalles” (= “Dieppe – Comment le Mur de la côte occidentale a tenu”).
Erich KÖRNER-LAKATOS.
(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°49/2005, trad. franç. : Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : secon, de guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre, militaria, années 40, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 14 juillet 2009
Le rôle du Vatican dans l'élaboration du Traité de Versailles

SYNERGIES EUROPÉENNES - Septembre 1986
Le rôle du Vatican dans l'élaboration du "Diktat" de Versailles
C'est un document très curieux qu'a réédité la Faksimile Verlag de Brème. Rédigé par un certain "Mannhart", ce texte, datant de 1938, accuse le Vatican d'avoir voulu la destruction de l'Allemagne prusso-centrée, née du génie politique de Bismarck. Procédant systématiquement, "Mannhart" a épluché toute la presse allemande, vaticane, italienne et française pour étayer sa thèse. Son travail a ceci d'intéressant qu'il aide à mettre en exergue les manigances d'Adenauer, catholique rhénan francophile. Et ainsi d'expliquer quelque peu la division actuelle de l'Allemagne, voulue dans les années 50 par le calamiteux ex-bourgmestre de Cologne.
Si en août 1914 le Vatican de Pie X souhaite la victoire de l'Autriche-Hongrie, puissance catholique, contre les Serbes et les Russes orthodoxes, le vent tournera à Rome en octobre 1914 quand le Cardinal Gasparri devient "Secrétaire d'Etat du Vatican", au-trement dit Ministre des Affaires Etrangères de l'Eglise. Le 7 janvier 1915, dans un journal américain, le New York Herald, les intentions de Gasparri apparaissent, à peine déguisées, pour la première fois: détacher les provinces catholiques de l'Allemagne du Sud de la Prusse protestante. Pour obtenir l'élimination du protestantisme en Allemagne septentrionale, donc pour "déprussianisé" l'ensemble créé par Bismarck, l'Eglise sera prête à tout, en tablant sur l'impérialisme français et en abandonnant l'Autriche-Hongrie. C'est parmi les partisans de cette "géopolitique" catholique que Clémenceau trouvera, en Allemagne, des alliés pour sa politique. A Versailles, le Vatican appuyera les annexions en faveur des nations catholiques, la France, la Belgique, l'Italie et la Pologne mais déplorera le démantèlement de la Monarchie austro-hongroise. Par la suite, ce jugement ambigu se maintiendra: anti-allemand à l'Ouest (en France et en Belgique, où la querelle se complique par l'avènement du mouvement flamand) et anti-bolchévique, c'est-à-dire anti-russe et relativement pro-allemand en Europe Centrale et en Europe de l'Est. "Mannhart" décrit avec minutie les complots du parti ultra-montain en Allemagne pendant la guerre.
Mannhart, Verrat um Gottes Lohn? Hintergründe des Diktates von Ver-sailles, Faksimile-Verlag, Bremen, 1985, 104 S., 13 DM.
Adresse: Faksimile-Verlag,
Postfach 66 01 80, D-2800 Bremen 66.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vatican, première guerre mondiale, histoire, versailles, diplomatie, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 07 juillet 2009
Bibliographie sur les événements de "Yougoslavie"
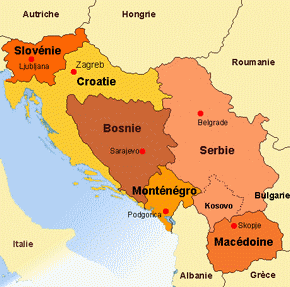
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992
Bibliographie sur les événements de «Yougoslavie»
Pour comprendre la question croate
Walter SCHNEEFUSS, Die Kroaten und ihre Geschichte, Wilhelm Goldmann Verlag, Leipzig, 1942.
Cet ouvrage a paru pendant la guerre, au moment où l'Allemagne hitlérienne soutenait l'Etat oustachiste d'Ante Pavélic. Son analyse de la réalité politique, par conséquent, est marquée par ce contexte et n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. En revanche, son esquisse de l'histoire de la Croatie, depuis l'arrivée des premières tribus croates, en passant par les époques byzantines, italiennes, ottomanes et hongroises est l'une des présentations les plus claires de la question qui ait jamais été publiée en Europe de l'Ouest. L'auteur reconnaît les erreurs des administrations autrichienne et hongroise en Croatie, ce qui a suscité des désirs d'unification yougo-slave chez les intellectuels croates. Mais ces aspirations ont été dénaturées par la monarchie des Karageorgevitch. Les Croates ont alors revendiqué leur indépendance. Un livre à rechercher chez les bouquinistes!
Wolfgang LIBAL, Das Ende Jugoslawiens. Chronik einer Selbstzerstörung, Europaverlag, Wien/Zürich, 1991, 176 S., DM 29,-/öS 198,-. ISBN 3-203-51135-5.
Correspondant de plusieurs agences de presse et journaux allemands, suisses et autrichiens, Wolfgang Libal (né en 1912) est l'un des plus éminents spécialistes ès-affaires balkaniques de langue allemande. Son verdict: la «Seconde Yougoslavie» de Tito est morte. Elle vient de connaître le même sort que la «Première Yougoslavie» des Karageorgevitch. Elle a succombé à ses contradictions internes. Aucun des peuples de l'espace sud-slave n'a accepté l'hégémonie serbe puis serbo-communiste. Le poids du passé, des différences de tous ordres forgées au cours des siècles qui nous ont précédés, a pesé plus lourd que la volonté politique d'unir cette région d'Europe. Le livre de Libal retrace les péripéties de la vie politique et parlementaire yougoslave de 1918 à 1934, date de l'assassinat à Marseille du Roi Alexandre par les Macédoniens et les Oustachistes de Pavelic. Dans les querelles entre centralistes et fédéralistes, séparatistes et royalistes, nous retrouvons tous les clivages de l'espace yougoslave.
Jens REUTER, «Der Bürgerkrieg in Jugoslawien. Kriegsmüdigkeit, Kriegspsychose und Wirtschaftsverfall», in Europa Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik, 1991/Nr. 24, 25.12.1991.
Bimensuel édité par la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Verlag für Internationale Politik, Bonn (Adenauerallee 131, D-5300 Bonn). ISSN 0014-2476.
L'auteur examine l'état des «mouvements pour la paix» (la «Marche des Mères», la «Caravane de la Paix», le «Referendum contre la guerre», etc.) en Serbie et en Voïvodine. Le gros de la population est hostile à la guerre. Mais le gouvernement tolère les parades de Tchetniks armés dans les rues et sur les places de marché de Belgrade. Le commerce des armes est libre et les partisans serbes peuvent vendre le produit de leurs pillages sur les marchés. Mais 30% seulement des réservistes serbes ont rejoint leurs unités lors de la mobilisation de l'automne 1991. A Belgrade, moins de 10%! Au Monténégro, 40% des rappelés ont répondu. A Zagreb, règne une psychose paralysante: les irréguliers serbes ne campent pas loin de la capitale croate.
Reuter se penche ensuite sur le problème des désertions, au début de l'automne 91: Bosniaques et Macédoniens ne veulent plus servir dans l'armée fédérale. En Macédoine, les fonctionnaires font disparaître les listes d'appelés; quelques jours plus tard, le Président macédonien Kiro Gligorov et son parlement décident officiellement de ne plus envoyer de soldats dans l'armée fédérale. La situation économique est catastrophique: en Serbie, la planche à billets fonctionne sans interruption, annonçant une inflation sans précédent; la Serbie a néanmoins pu dégager de substantiels surplus agricoles; en Croatie, l'économie est bloquée à cause des combats; la Slovénie a perdu 23% de son marché, qui était auparavant inter-yougoslave.
Wolfgang WAGNER, «Acht Lehren aus dem Fall Jugoslawien», in Europa Archiv. Zeitschrift für internationale Politik, 1992/2, 25.1.1992 (réf. et adresse ci-dessus).
Wagner énonce huit leçons de la crise yougoslave.
1. Quand l'Europe était partagée en deux blocs, elle vivait davantage en paix qu'à l'heure actuelle, où cette confrontation globale a disparu.
2. Les élections libres ne sont plus une garantie de voir les peuples vivre côte à côte en harmonie.
3. Il est faux de croire que la guerre a cessé d'être perçue comme moyen de la politique en Europe, malgré les expériences tragiques des deux guerres mondiales.
4. Les Etats-Unis ne veulent pas intervenir en Europe. Ils estiment que c'est le rôle des Européens de faire respecter les grands principes humanitaires dans les Balkans.
5. L'idée qu'il faut intervenir dans les affaires intérieures d'un Etat qui ne respecte pas les droits de l'homme reste une pure vue de l'esprit. Les réalités politiques continuent à s'imposer, dans toutes leurs dimensions tragiques, en dépit de ce vœu pieux, lancinant depuis la SDN.
6. Les moyens d'empêcher toute effusion de sang dans un conflit politique demeurent faibles.
7. Vu leur impuissance à agir et à résoudre les conflits, les gouvernements cherchent des dérivatifs humanitaires ou diplomatiques, non pas pour résoudre les problèmes par d'autres voies mais pour éviter qu'on ne leur reproche leur inaction.
8. Ni l'Europe ni le monde ne disposent d'une organisation internationale capable d'enrayer et d'arrêter les conflits contre la volonté de leurs protagonistes.
Waldemar HUMMER u. Peter HILPOLD, «Die Jugoslawien-Krise als ethnischer Konflikt», in Europa Archiv. Zeitschrift für internationale Politik, 1992/4, 25.2.1992.
Les auteurs partent du constat qu'en dépit des expulsions massives de minorités (surtout allemandes) après 1945, les conflits inter-ethniques en Europe demeurent aigus. La crise «yougoslave» en est la plus sanglante illustration. Tito avait réussi à maintenir l'équilibre entre les différents peuples de Yougoslavie en introduisant des mécanismes de rotation du personnel politique et administratif. Mais cet équilibre était précaire. Dès la mort du Maréchal, les troubles ont commencé au Kosovo, conduisant, par la suite, Belgrade à réduire l'autonomie accordée en 1963 à cette province ethniquement albanaise à 90%. Hummer et Hilpold analysent les textes de la nouvelle constitution croate et constatent que les règles de protection des minorités, telles qu'elles ont été élaborées par les instances européennes, sont respectées. La constitution croate prévoit également l'autonomie des communes de la Krajina, où les Serbes sont majoritaires. Les Serbes, opposés au nouvel Etat fédéral croate, contestent le principe de territorialité qui préside à l'attribution ou à la non-attribution des droits de minorité, comme l'emploi de la langue serbe (rédigée en caractères cyrilliques). Pour eux, l'emploi de la langue serbe devrait être possible partout sur le territoire de la Croatie indépendante. Ensuite, les droits des minorités doivent reposer sur le principe de réciprocité: si l'Etat A accorde des droits à la minorité B, majoritaire dans l'Etat B voisin, cet Etat B doit accorder les mêmes droits à la minorité A, majoritaire dans l'Etat A. Les Croates sont prêts à accorder ces droits aux Serbes de Croatie, à la condition que les Croates de Serbie jouissent exactement des mêmes droits. Les Slovènes ont exigé de l'Italie qu'elle accorde les mêmes droits aux 100.000 Slovènes d'Italie qu'accorde la Slovénie aux 3000 Italiens qui résident sur son territoire. Rome a refusé!
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, yougoslavie, balkans, bibliographie, histoire, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 06 juillet 2009
Wann war das Dritte Reich?
Wann war das Dritte Reich?
Betrachtungen zu Beginn und Ende der Imperii auf deutschem Boden
von Richard G. Kerschhofer - http://www.ostpreussen.de/
Von wann bis wann existierte das Dritte Reich. Von 1933 bis 1945, werden viele sagen und vielleicht ergänzen, von der Machtergreifung am 30. Januar 1933 bis zur Kapitulation am 9. Mai 1945. Leider unrichtig, wie zu zeigen ist. Außerdem ist Hitlers Bestellung zum Reichskanzler nicht „die Machtergreifung“, denn die war ein Vorgang, der lange vor 1933 begonnen hatte und sich danach noch fortsetzte. Bis alle gleichgeschaltet oder ausgeschaltet waren.
Begonnen haben kann das Dritte Reich erst nach dem Ende des Zweiten Reiches – doch wann war das? Ebenfalls eine schwierige Frage. Der Anfang hingegen ist eindeutig: Das Zweite Reich, das „Wilhelminische Deutschland“, begann am 18. Januar 1871, als König Wilhelm I. von Preußen zum Deutschen Kaiser ausgerufen wurde.
Ebenso eindeutig sind die Eckdaten beim „Ersten Reich“, auch „Altes Reich“ genannt. Es begann am 2. Februar 962, als der zum deutschen König gewählte Sachsenherzog Otto I. von Papst Johannes XII. in Rom zum Kaiser gekrönt wurde. Dieses Reich ist später als „Sacrum Imperium“ belegt, dann als „Sacrum Romanum Imperium“ – Heiliges Römisches Reich – und am Beginn der Neuzeit wurde „deutscher Nation“ hinzugefügt. Es endete am 6. August 1806, als Kaiser Franz II. die Reichskrone niederlegte. Er hatte bereits 1804 das Erzherzogtum Österreich zum Kaisertum gemacht und war Kaiser Franz I. von Österreich geworden. Aber durfte der Kaiser das Reich beenden? Ob er durfte oder nicht – er mußte, auf Druck Napoleons.
Das Alte Reich war kein Nationalstaat, nicht einmal ein Staat im modernen Sinn – und schon lange vor Napoleon nur mehr eine Fiktion. Goethe läßt in Auerbachs Keller den einen Saufkumpan ein Spottlied auf dieses Reich anstimmen. Ein anderer bringt ihn zum Schweigen: „Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied.“ Aber das wahrhaft Garstige war der dynastische Egoismus deutscher Fürsten, der das Reich in den Untergang trieb und die Anrainer zum Raub von Reichsgebiet einlud.
Das Erste Reich nannte sich nie „Erstes Reich“, denn kein Reich nimmt an, daß danach noch eines kommt. Auch das Zweite Reich nannte sich nicht „Zweites Reich“, denn für die allermeisten war es keine Wiedergeburt des Ersten Reiches. Es war ein weltliches Reich, keines „von Gottes Gnaden“, und es verkörperte nur die „kleindeutsche Lösung“, war also eher ein „großpreußisches Reich“.
Woher stammen dann die Ausdrücke „Erstes Reich“, „Zweites Reich“, „Drittes Reich“ und „Tausendjähriges Reich“? Sie kommen allesamt aus der Religion. Sie hängen zusammen mit dem „Millenarismus“ (lateinisch) oder „Chiliasmus“ (griechisch), mit dem Glauben an die Wiederkunft des Messias. Für „Drittes Reich“ steht auch „Tausendjähriges Reich“ – wobei „tausendjährig“ nach Ablauf des ersten Jahrtausends nicht mehr wörtlich genommen wurde, sondern soviel wie „ewig“ bedeuten sollte.
Erstmals in politischem Sinn verwendete diese Ausdrücke der deutsche Kulturhistoriker und Politiktheoretiker Arthur MOELLER VAN DEN BRUCK in seinem Buch „Das dritte Reich“ (1923). „Parteigenosse“ war er keiner und er starb schon 1925. Ob man ihn als „Wegbereiter“ bezeichnen kann, ist Geschmackssache, aber sicher erleichterte er die Arbeit nationalsozialistischer Ideologen. „Drittes Reich“ und „Tausendjähriges Reich“ paßten trefflich in das mythisch-mystische Gedankengebäude, das der religionsartigen Überhöhung einer durchaus weltlichen Politik diente. „Drittes Reich“ wird heute zwar pauschal für die NS-Zeit verwendet, war aber nicht mehr als ein Schlagwort der Propaganda. Es hatte nie ein Territorium und war nie ein Völkerrechtssubjekt.
Eines ist noch offen: Wann endete das Zweite Reich? Sicher nicht 1918, wie das die Nationalsozialisten sahen. Denn 1918 wie 1933/34 änderte sich jeweils nur die Regierungsform. 1938 entstand ein „Großdeutsches Reich“, das beinahe den großdeutschen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts entsprach. Aber auch wenn im „Anschluß-Gesetz“ (RGBl Nr. 28 vom 18.3.1938) „Großdeutsches Volksreich“ steht – völkerrechtlich blieb es wie 1918 das „Deutsche Reich“.
Der Ausdruck „Drittes Reich“ war jetzt nicht mehr erwünscht und ab 10. Juli 1939 auf Weisung von Goebbels den Medien sogar untersagt. „Großdeutsches Reich“ findet sich im Gesetz zur Einverleibung der Rest-Tschechoslowakei (RGBl Nr. 47 vom 16.3.1939) und in anderen amtlichen Texten. Jener Erlaß der Reichskanzlei, der das Deutsche Reich auch formell in „Großdeutsches Reich“ umbenannte (RK 7669 E vom 26. Juni 1943), wurde aber nicht mehr publiziert. „Großdeutsches Reich“ stand nur auf den Briefmarken.
Anders als das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wurde das Deutsche Reich nie durch irgendeinen Formalakt für beendet erklärt – nicht durch die Kapitulation, nicht durch die Besatzungsmächte, nicht durch Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, ja nicht einmal durch den „Zwei-Plus-Vier-Vertrag“. So wurde die Bundesrepublik zwar Rechtsnachfolgerin des nie für tot erklärten Reiches – mit allen daraus erwachsenen Nachteilen. Friedensvertrag gibt es aber keinen. Und auch Österreich hat nur einen „Staatsvertrag“ mit Einschränkungen der Souveränität, darunter das „Anschlußverbot“.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, histoire, troisième reich, années 20, années 30, années 40, europe centrale, définition, empire, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Opération Barbarossa: forces en présences et conclusions à tirer

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Opération Barbarossa: les forces en présence et les conclusions qu'on peut en tirer
par Joachim F. WEBER
Un matin d'été, 3 h 30. La nuit est sombre du Cap Nord à la Mer Noire. Tout d'un coup, l'air est déchiré par le fracas assourdissant des canons. Des milliers d'obus forment une pluie d'acier et martèlent le versant soviétique de cette frontière. Les positions avancées de l'Armée rouge sont matraquées. Et quand les premières lueurs du jour apparaissent, la Wehrmacht allemande et ses alliés franchissent la frontière et pénètrent en URSS.
C'était le 22 juin 1941. Un jour historique où l'Allemagne a joué son destin. La lutte âpre qui commence en ce jour va se terminer un peu moins de quatre années plus tard, dans les ruines de la capitale allemande, à Berlin. Pendant 45 ans, on nous a répété que cette défaite était le juste salaire, bien mérité, de l'acte que nous avions commis ce 22 juin. L'historiographie des vainqueurs de 1945 et de leur clientèle parmi les vaincus a présenté pendant plusieurs décennies l' comme une guerre d'extermination minutieusement planifiée, perpétrée par des parjures qui n'avaient pas respecté le pacte qui nous liait à notre voisine de l'Est. Les historiens qui osaient émettre des opinions différentes de celles imposées par cette sotériologie officielle n'ont pas rigolé pendant quarante-cinq ans! Mais aujourd'hui, alors que l'ordre établi à Yalta s'effondre, de gros lambeaux de légende s'en vont également en quenouille. En cette année 1991, cinquante ans après les événements, on pourrait pourtant examiner les tenants et aboutissants de cette guerre et de ses prolégomènes sans s'encombrer du moindre dogme. En effet, on est impressionné par le grand nombre d'indices qui tendent à réfuter la thèse officielle d'une attaque délibérée et injustifiée contre une Union Soviétique qui ne s'y attendait pas. Ces indices sont tellement nombreux qu'on peut se demander comment des historiens osent encore défendre cette thèse officielle, sans craindre de ne plus être pris au sérieux. Nous savons désormais assez de choses sur ce qui s'est passé avant juin 1941, pour ne plus avoir honte de dire que l'attaque allemande du 22 juin a bel et bien été une guerre préventive.
Un vieux débat
Pourtant ce débat pour savoir si l' a été une attaque délibérée ou une guerre préventive n'est ni nouveau ni original. Les deux positions se reflétaient déjà dans les déclarations officielles des antagonistes dès le début du conflit. Le débat est donc aussi ancien que l'affrontement lui-même. L'enjeu de ce débat, aujourd'hui, est de savoir si l'on veut continuer à regarder l'histoire dans la perspective des vainqueurs ou non.
L'ébranlement des armées allemandes qui a commencé en ce jour de juin a d'abord été couronné d'un succès militaire sans précédant. Effectivement, le coup brutal asséné par les troupes allemandes surprend la plupart des unités soviétiques. Par centaines, les avions soviétiques sont détruits au sol; les positions d'artillerie et les concentrations de troupes sont annihilées. Au prix de lourdes pertes en matériel, les Soviétiques sont contraints de reculer. Dès le début du mois de juillet, commencent les grandes batailles d'encerclement, où des centaines de milliers de soldats soviétiques sont faits prisonniers. En tout et pour tout, l'URSS perd, au cours des trois premières semaines de la guerre, 400.000 hommes, 7600 chars et 6200 avions: une saignée inimaginable.
C'est après ces succès inouïs que le chef de l'état-major général de l'armée de terre allemande, le Colonel-Général Halder, écrit dans son journal: . Une erreur d'appréciation, comme on n'en a jamais vue. Car au bout de 1396 jours, la campagne la plus coûteuse que l'Allemagne ait jamais déclenchée, se termine par une défaite.
Le désastre soviétique
Pourtant, le désastre soviétique paraissait complet. Au vu de celui-ci, on comprend l'euphorie de Halder, même si on ne prend pas seulement en considération les deux premières semaines de la guerre mais ses six premiers mois. Jusqu'à la fin de l'année 1941, la Wehrmacht fait environ trois millions de prisonniers soviétiques. C'est l'ampleur de ces pertes qui incite les défenseurs de la thèse de l'attaque délibérée à justifier leur point de vue: en effet, ces pertes tenderaient à prouver que l'Union Soviétique n'était pas préparée à la guerre, qu'elle ne se doutait de rien et qu'elle a été complètement surprise par l'attaque allemande.
Il est exact de dire, en effet, que l'Union Soviétique n'avait pas imaginé que l'Allemagne l'attaquerait. Néanmoins, il est tout-à-fait incongru de conclure que l'Union Soviétique ne s'était pas préparée à la guerre. Staline avait bel et bien préparé une guerre, mais pas celle qu'il a été obligé de mener à partir de juin 41. Pour les officiers de l'état-major allemand comme pour tous les observateurs spécialisés dans les questions militaires, c'est devenu un lieu commun, depuis 1941, de dire que l'avance allemande vers l'Est a précédé de peu une avance soviétique vers l'Ouest, qui aurait été menée avec beaucoup plus de moyens. La vérité, c'est que le déploiement soviétique, prélude à l'ébranlement des armées de Staline vers l'Ouest, n'a pas eu le temps de s'achever.
Comparer les forces
et les effectifs en présence
Lorsque l'on compare les forces et les effectifs en présence, on en retire d'intéressantes leçons. On ne peut affirmer que la Wehrmacht allemande —sauf dans quelques unités d'attaque aux effectifs réduits et à l'affectation localisée— était supérieure en nombre. Les quelque 150 divisions allemandes (dont 19 blindées et 15 motorisées), qui sont passées à l'attaque, se trouvaient en face de 170 divisions soviétiques massées dans la zone frontalière. Parmi ces divisions soviétiques, 46 étaient blindées et motorisées. En matériel lourd, la supériorité soviétique était écrasante. Les unités allemandes attaquantes disposaient de 3000 chars et de 2500 avions, inclus dans les escadrilles du front; face à eux, l'Armée Rouge aligne 24.000 chars (dont 12.000 dans les régions militaires proches de la frontière) et 8.000 avions. Pour ce qui concerne les pièces d'artillerie, la Wehrmacht dispose de 7000 tubes et les Soviétiques de 40.000! Si l'on inclut dans ces chiffres les mortiers, le rapport est de 40.000 contre 150.000 en faveur des Soviétiques. Le 22 juin, l'Armée soviétique aligne 4,7 millions de soldats et dispose d'une réserve mobilisable de plus de 10 millions d'hommes.
Les Landser allemands avançant sur le front russe constatent très vite comment les choses s'agençaient, côté soviétique: effectivement, les pertes soviétiques sont colossales, mais, ce qui les étonne plus encore, c'était la quantité de matériels que les Soviétiques étaient en mesure d'acheminer. Les Allemands abattent quinze bombardiers soviétiques et voilà qu'aussitôt vingt autres surgissent. Quand les Allemands arrêtent la contre-attaque d'un bataillon de chars soviétiques, ils sont sûrs que, très rapidement, une nouvelle contre-attaque se déclenchera, appuyée par des effectifs doublés.
Un matériel soviétique
d'une qualité irréprochable
Sur le plan de la qualité du matériel, la Wehrmacht n'a jamais pu rivaliser avec ses adversaires soviétiques. Alors qu'une bonne part des blindés soviétiques appartiennent aux types lourdement cuirassés KV et T-34 (une arme très moderne pour son temps), les Allemands ne peuvent leur opposer, avant 1942, aucun modèle équivalent. La plupart des unités allemandes sont dotées de Panzer I et de Panzer II, totalement dépassés, et de chars tchèques, pris en 1938/39.
Pourquoi l'Allemagne ne peut-elle rien jeter de plus dans la balance? Pour une raison très simple: après la victoire de France, l'industrie allemande de l'armement, du moins dans la plupart des domaines cruciaux, avait été remise sur pied de paix. Ainsi, les usines de munitions (tant pour l'infanterie que pour l'artillerie) avaient réduit leurs cadences, comme le prouvent les chiffres de la production au cours de ces mois-là. Est-ce un indice prouvant que l'Allemagne préparait de longue date une guerre offensive?
Concentration et vulnérabilité
Mais cette réduction des cadences dans l'industrie de l'armement n'est qu'un tout petit élément dans une longue suite d'indices. Surgit alors une question que l'on est en droit de poser: la supériorité soviétique était si impressionnante, comment se fait-il que la Wehrmacht n'ait pas été battue dès 1941 et que l'Armée Rouge ait dû attendre 1944-45 pour vaincre?. La réponse est simple: parce le gros des forces soviétiques était déjà massé dans les zones de rassemblement, prêt à passer à l'attaque. Cette énorme concentration d'hommes et de matériels a scellé le destin de l'Armée Rouge en juin 1941. En effet, les unités militaires sont excessivement vulnérables lorsqu'elles sont concentrées, lorsqu'elles ne se sont pas encore déployées et qu'elles manœuvrent avant d'avoir pu établir leurs positions. A ces moments-là, chars et camions roulent pare-chocs contre pare-chocs; les colonnes de véhicules s'étirent sur de longs kilomètres sans protection aucune; sur les aérodromes, les avions sont rangés les uns à côté des autres.
Aucune armée au monde n'a jamais pris de telles positions pour se défendre. Tout état-major qui planifie une défense, éparpille ses troupes, les dispose dans des secteurs fortifiables, aptes à assurer une défense efficace. Toute option défensive prévoit le creusement de réseaux de tranchées, fortifie les positions existantes, installe des champs de mines. Staline n'a rien fait de tout cela. Au contraire: après la campagne de Pologne et à la veille de la guerre avec l'Allemagne, Staline a fait démanteler presque entièrement la ligne défensive russe qui courait tout au long de la frontière polono-soviétique pour prévenir toute réédition des attaques polonaises; mieux, cette ligne avait été renforcée sur une profondeur de 200 à 300 km. Or, pourtant, l'Armée Rouge, pendant la guerre de l'hiver 1939-40 contre la Finlande, avait payé un très lourd tribut pour franchir le dispositif défensif finlandais. Toutes les mesures défensives, toutes les mesures de renforcement des défenses existantes, ont été suspendues quelques mois avant que ne commence l'. Les barrières terrestres ont été démontées, les charges qui minaient les ponts et les autres ouvrages d'art ont été enlevées et les mines anti-chars déterrées. Quant à la , bien plus perfectionnée, elle a subi le même sort, alors que, depuis 1927, on n'avait cessé de la renforcer à grand renfort de béton armé. Et on ne s'est pas contenté de la démonter en enlevant, par exemple, toutes les pièces anti-chars: on a fait sauter et on a rasé la plupart des bunkers qui la composaient. Ces démontages et ces destructions peuvent-ils être interprétés comme des mesures de défense? Le Maréchal soviétique Koulikov disait en juin 1941: .
Les dix corps aéroportés de Staline
Bon nombre d'autres mesures prises par les Soviétiques ne sauraient être interprétées comme relevant de la défense du territoire. Par exemple, la mise sur pied de dix corps aéroportés. Les troupes aéroportées sont des unités destinées à l'offensive. Entraîner et équiper des unités aéroportées coûtent des sommes astronomiques; pour cette raison budgétaire, les Etats belligérants, en général, évitent d'en constituer, ne fût-ce qu'un seul. L'Allemagne ne l'a pas fait, alors que la guerre contre l'Angleterre le postulait. Staline, pour sa part, en a mis dix sur pied d'un coup! Un million d'hommes, avec tous leurs équipements, comprenant des chars aéroportables et des pièces d'artillerie légères. Au printemps de l'année 1941, l'industrie soviétique, dirigée depuis sa centrale moscovite, ordonna la production en masse des planeurs porteurs destinés au transport de ces troupes. Des milliers de ces machines sont sorties d'usine. Staline, à l'évidence, comptait s'en servir pendant l'été 1941, car rien n'avait été prévu pour les entreposer. Or, ces planeurs n'auraient pas pu résister à un seul hiver russe à la belle étoile.
Ensuite, depuis la fin des années 30, l'industrie de guerre soviétique produisait des milliers d'exemplaires du char BT: des blindés de combat capables d'atteindre des vitesses surprenantes pour l'époque et dont le rayon d'action était impressionnant; ces chars avaient des chenilles amovibles, de façon à ce que leur mobilité sur autoroutes soit encore accentuée. Ces chars n'avaient aucune utilité pour la défense du territoire.
En revanche, pour l'attaque, ils étaient idéaux; en juillet 1940, l'état-major soviétique amorce la mise sur pied de dix armées d'avant-garde, baptisées pour tromper les services de renseignements étrangers. A ce sujet, on peut lire dans l'Encyclopédie militaire soviétique: (vol. 1, p. 256). Il s'agissait d'armées disposant de masses de blindés, en règle générale, de un ou de deux corps dotés chacun de 500 chars, dont les attaques visait une pénétration en profondeur du territoire ennemi.
Les préparatifs offensifs de l'Armée rouge peuvent s'illustrer par de nombreux indices encore: comme par exemple le transport vers la frontière occidentale de l'URSS de grandes quantités de matériels de génie prévoyant la construction de ponts et de voies ferrées. Les intentions soviétiques ne pouvaient être plus claires.
Hitler prend Staline de vitesse
C'est sans doute vers le 13 juin que l'état-major général soviétique a commencé à mettre en branle son 1er échelon stratégique, donc à démarrer le processus de l'offensive. L'organisation de ce transfert du 1er échelon stratégique a constitué une opération gigantesque. Officiellement, il s'agissait de manœuvres d'été. A l'arrière, le 2ième échelon stratégique avait commencé à se former, dont la mission aurait été de prendre d'assaut les lignes de défense allemandes, pour le cas (envisagé comme peu probable) où elles auraient tenus bon face à la première vague.
Mais le calcul de Staline a été faux. Hitler s'est décidé plus tôt que prévu à passer à l'action. Il a précédé son adversaire de deux semaines. Côté soviétique, la dernière phase du déploiement du 1er échelon (trois millions d'hommes) s'était déroulée avec la précision d'une horloge. Mais au cours de ce déploiement, cette gigantesque armée était très vulnérable. Le matin du 22 juin, l'offensive allemande a frappé au cœur de cette superbe mécanique et l'a fracassée.
A ce moment, de puissantes forces soviétiques se sont déjà portées dans les balcons territoriaux en saillie de la frontière occidentale, notamment dans les régions de Bialystok et de Lemberg (Lvov). Les Allemands les ont encerclées, les ont forcées à se rassembler dans des secteurs exigus et les y ont détruites. Et ils ont détruit également d'énormes quantités de carburant et de munitions que les trains soviétiques avaient acheminés vers le front le matin même.
Staline jette ses inépuisables réserves dans la balance
Le désastre soviétique était presque parfait. Presque, pas entièrement. Les pertes étaient certes énormes mais les réserves étaient encore plus énormes. De juillet à décembre 1941, l'Union Soviétique a réussi à remettre sur pied 200 importantes unités, dont les effectifs équivalaient à ceux d'une division. La Wehrmacht n'a pas su en venir à bout. Pendant l'hiver, devant Moscou, l'Allemagne a perdu sa campagne de Russie. A partir de ce moment-là, la Wehrmacht n'a plus livré que des combats désespérés contre l'Armée Rouge, avec un acharnement aussi fou qu'inutile, tant l'adversaire était numériquement supérieur, et compensait ses pertes en matériel par les livraisons américaines.
Voici, en grandes lignes, les faits présents le 22 juin 1941. L'histoire des préliminaires de cette campagne de Russie, la question de savoir à quelle date précise les Allemands et les Soviétiques avaient décidé d'attaquer, restent matières à interprétation, d'autant plus que d'importantes quantités d'archives allemandes sont toujours inaccessibles, aux mains des vainqueurs, et que les archives soviétiques ne peuvent toujours pas être consultées par les chercheurs. La raison de ces secrets n'est pas difficile à deviner...
Joachim F. WEBER.
(texte issu de Criticón, Nr. 125, Mai/Juni 1991; adresse de la revue: Knöbelstrasse 36/0, D-8000 München 22).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, urss, staline, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 05 juillet 2009
H. Diwald: Der Kampf um die Weltmeere
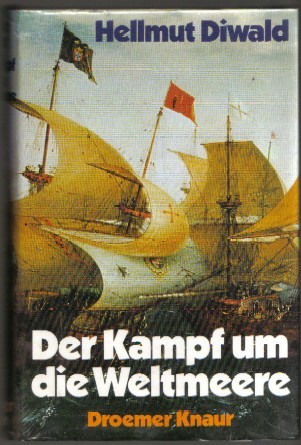
Der Kampf um die Weltmeere
S. 215 – 224 - Ex: http://www.hellmutdiwald.de
Die Linien
Das Ungeheuer Francis Drake
Die Achillesferse Spaniens
Vom Räuber zum Ritter
Die Linien
„Das Ringen der Mächte spielte sich in zwei verschiedenen Bereichen ab. Während des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert pendelte sich in Europa ein gewisses Religionsgleichgewicht ein. Neben der christlich-katholischen Ordnungsidee hatte sich der protestantische Sonderanspruch durchgesetzt und war akzeptiert worden. Außerhalb der Territorialregelungen der Friedensschlüsse wurde auch die Protestantenforderung nach Freiheit der Meere gelten gelassen - allerdings lediglich imaginär. Durch den atlantischen Ozean wurden gedachte Linien gezogen, an denen der Raum des europäischen Staatensystems völkerrechtlich endete. Jenseits dieser Linien verlor das zwischenstaatliche öffentliche Recht, das sich zu jener Zeit in Europa entwickelte, seine Verbindlichkeit.
Die Linienregelung geht dem Prinzip nach zurück auf den Vertrag von Cateau-Cambresis des Jahres 1559 zwischen Spanien und Frankreich. Was die Territorialbestimmungen betrifft, so handelt es sich bei diesem Friedensschluß um die Besiegelung einer empfindlichen französischen Niederlage. Der Text der Vereinbarung läßt keinen Zweifel daran. Frankreich muß auf seine italienischen Ansprüche verzichten und das Herzogtum Savoyen herausgeben. Der Vertrag enthält allerdings kein Wort von den mündlichen Absprachen, die während der Verhandlungen getroffen wurden: Die Friedensvereinbarungen besitzen nur für Europa Geltung, nicht aber für die Bereiche der Meere. Dort, jenseits von Europa, entscheiden nach wie vor die Waffen, entscheidet die maritime Kriegsmacht über Herrschaft und Besitz; die Kämpfe, zu denen es dabei kommen werde, wirken sich in keiner Weise auf das Verhältnis der beiden Staaten in Europa aus.
Die imaginären Linien, die durch das Meer gezogen wurden, waren sowohl Freundschafts- als auch Feindschaftslinien. Letzten Endes handelte es sich dabei um eine Abwandlung der Demarkationen, welche die Päpste vorgenommen hatten. Die neuen Linien grenzten lediglich den europäischen Landraum genauer von dem ozeanischen Freiraum ab, in dem kein Recht, keine Ordnung, kein Gesetz galt und in dem die Seefahrernationen einander bekämpften, als hätte es seit den prähistorischen Zeiten nie etwas anderes gegeben als das nackte Faustrecht. Daß dieser Kampf von Europa ausging, daß er die Form war, in der Europa eine unerhörte Expansion vollzog - die gewaltigste aller Expansionen der Weltgeschichte -, das legte trotz der Brutalität des ganzen Prozesses den hohen Rang Europas bis ins 20. Jahrhundert unwiderruflich und in historisch unvergleichlicher Form fest.
Durch die Ausgrenzung des Kampfgebietes vermittels Festlegung von Zonen, in denen vertragliches Recht galt, beziehungsweise nicht galt, sprach die europäische Welt ihrer Rechtsordnung nur in den bisher vertrauten, alten Bereichen Gültigkeit zu, sie billigte die Existenz einer »Neuen Welt« als eines Freiraums des gewaltsamen Zugriffs. Sie würden erst dann zu Objekten des europäischen Völkerrechts werden, wenn der Kampf um sie entschieden war. Solange dieser Zeitpunkt ausstand, hielt sich der Brauch der »Freundschaftslinien«. Im Süden verliefen sie entlang des Wendekreises des Krebses oder des Äquators, im Westen hielten sie sich an den Längengrad durch die Kanarischen Inseln oder die Azoren. Gelegentlich wurden sie sogar amtlich festgelegt - und damit ein Sachverhalt offiziell anerkannt, den es offiziell nicht gab. Der Widersinn dabei beruht darauf, daß an diesen Linien die Gültigkeit des europäischen Rechts endete und jenseits davon der Raum des gesetzlosen Kampfes um die Weltmeere, die Freiheit des Faustrechts begann. Ob in Europa zwischen den Seerivalen Frieden herrschte oder nicht: Jenseits »der Linie« lagen die Überseeräume der Gewalt. Der britische Seeheld Francis Drake gab dafür die Parole aus, eine Formel von welthistorischem Gewicht und drakonischer Kürze: »No peace beyond the line!- Kein Friede jenseits der Linie! «
Unter den Wahrzeichen der religiösen und sittlichen Begründungen von Rechts- und Unrechtsbestimmungen ist diese Linienabgrenzung etwas Ungeheuerliches. Sie beglaubigt die Existenz einer doppelten Moral und relativiert dadurch sowohl ihre christlich unterbaute als auch innerweltlich postulierte Unbedingtheit. Wie sollte ein gläubiger, ein sittlicher Mensch begreifen, daß sich christliche Herrscher dazu verstehen, für den unabsehbaren Raum des Ozeans die Barbareien und Ruchlosigkeiten eines Naturzustandes primitivster Art gelten zu lassen und sich gleichzeitig für den europäischen Kontinentalbereich auf das Gegenteil zu einigen? Wie ließ es sich rechtfertigen, die Meere als ein Reich der Anarchie auszugrenzen? Waren die Unterschiede zwischen Recht und Unrecht, Gut und Böse eine Frage der Geographie? Von solchen Zweifeln wurde der große Philosoph Pascal zu dem Seufzer hingerissen: »Die fundamentalen Gesetze wechseln. Ein Meridian entscheidet über die Wahrheit. «
So sah die eine Seite der Medaille aus. Die andere Seite bestand darin, daß durch die Linien-Übereinkunft die europäische Ordnung entscheidend stabilisiert wurde. Die Demarkationen verhinderten eine Zersetzung der Vertragsregelungen durch die rohe Willkür im Freiraum der See. In der Praxis bedeutete die »Freiheit der Meere« eine totale Befreiung von Recht, Moral und Gesetz; sie bedeutete aber genauso eine Rettung der innereuropäischen Ordnung, sie verhinderte hier den Rückfall in die Barbarei vorzivilisatorischer Zustände.
Das Ungeheuer Francis Drake
Am leidenschaftlichsten wurde diese Übereinkunft von England befürwortet. Das Königreich war damals der schwächste Partner in dem exklusiven Kreis der Seefahrernationen, und vielleicht erkannten gerade deshalb die britischen Staatsmänner und Herrscher besonders früh, daß England daraus den größten Nutzen ziehen konnte. Seine Piraten hatten fast ausnahmslos nichts anderes im Sinn, als in den Freiräumen der Meere Beute zu machen. Aber diejenigen von ihnen, die immerhin Anflüge von Format besaßen, achteten sorgsam darauf, daß ein hoher Prozentsatz des Geraubten am Königshof abgeliefert wurde - manchmal war es fast die Hälfte.
Das englische Freibeutergewerbe wurde erstmals von John Hawkins auf einen bemerkenswerten Stand gebracht. Er entstammte einer Familie von Kaufleuten und Schiffseignern aus Plymouth. 1562, 30 Jahre alt, segelte er mit einer Dreierflottille zu seiner ersten Fahrt nach Afrika. An der Sierra Leone überfiel er portugiesische Schiffe, raubte dreihundert Negersklaven und verkaufte sie mit riesigem Gewinn in Haiti. Königin Elisabeth I. wußte offiziell nichts von dieser Fahrt, was sie aber nicht hinderte, höchst offiziell die prachtvollen Perlen zu tragen, die ihr Hawkins aus Westindien mitbrachte.
1566 wurde John Hawkins von einem jungen Mann besucht, einem entfernten Verwandten seiner Familie. Dieser Francis Drake hatte sich kürzlich unter Kapitän John Lovell an einer Fahrt nach Mexiko beteiligt; sie war ein katastrophaler Mißerfolg gewesen, die Engländer wurden von den Spaniern völlig ausgeraubt. Von dieser Fahrt brachte Francis Drake vollendete seemännische Kenntnisse und einen maßlosen Haß auf die Spanier mit.
Hawkins bereitete für das folgende Jahr eine neue Kaperexpedition vor. Im Oktober 1567 lichteten sechs Schiffe die Anker. Das Flaggschiff »Jesus von Lübeck«, 700 Tonnen groß, hatte Königin Elisabeth dem Flottillenchef Hawkins selbst zur Verfügung gestellt; sie war an dem Unternehmen noch mit einem zweiten Schiff, der »Minion«, beteiligt. Francis Drake befehligte eine kleine Barke von 50 Tonnen, die »Judith«. An der Guineaküste erbeuteten die Engländer 500 Sklaven und segelten mit ihnen nach Amerika. Die Fahrt war ein halber Rachezug, denn sie liefen die Hafenstadt Rio de la Hacha an, in der Kapitän Lovell und Drake 1565 ausgeplündert worden waren. Als die Spanier jeden Handel mit den Engländern ablehnten, landete ein Kommando zu einem Plünderungszug, anschließend wurde die Stadt beschossen. Erst jetzt erklärten sich die Bewohner bereit, die Sklaven abzukaufen. Auf der Rückfahrt kamen die Schiffe in ein schweres Unwetter, das Flaggschiff schlug leck, Hawkins und Drake mußten in San Juan de Ulloa bei Veracruz Schutz suchen. Am nächsten Tag fuhren dreizehn spanische Geleitschiffe in den Hafen ein. Hawkins und der spanische Befehlshaber vereinbarten ein neutrales Verhalten. Wenig später brachen die Spanier jedoch das Abkommen, eröffneten das Feuer auf die britischen Schiffe und töteten jeden Engländer, der sich an Land befand. Hawkins und Drake konnten zwar vier Spanier in den Grund bohren, verloren aber selbst die »Jesus von Lübeck« und drei weitere Schiffe; nur die »Minion« und die »Judith« retteten sich, schwer beschädigt, aufs offene Meer. Drake erreichte am 20. Januar 1569 Plymouth, seine »Judith« kroch mehr in den Hafen als daß sie segelte. Eine Woche später erreichte auch Hawkins die Küste von Cornwall. Die »Minion« war in einem so jämmerlichen Zustand, daß er sie von hier nach Plymouth schleppen lassen mußte.
Das Mißgeschick der beiden Korsaren wurde in England als eine quasi öffentliche Demütigung empfunden. Hawkins und Drake, die sich genaugenommen nur hatten übertölpeln lassen, unterstützten diese Meinung durch kräftige Klagen über die Wortbrüchigkeit der Spanier. Der königliche Hof zeigte lebhaftes Verständnis für diese Version, denn durch den Verlust der »Jesus von Lübeck«, durch die unerfüllte Hoffnung auf ihren Anteil an der Beute und die havarierte »Minion« war auch Elisabeth I. geschädigt worden. Bei Hawkins hielten sich Rachegefühl und Resignation die Waage, Drakes verletzter Stolz dagegen ließ keine andere Empfindung zu als Haß.
Sein nächstes Unternehmen bereitete er außerordentlich gründlich vor. 1570 segelte er mit zwei kleinen Schiffen zu einer Erkundungsfahrt nach Westindien. Drake war zwar inzwischen in die Königliche Marine aufgenommen worden, doch die Expedition unternahm er auf eigene Faust, ebenso eine zweite Rekognoszierungsfahrt mit nur einem Schiff im darauffolgenden Jahr. Er lernte die Inseln der Karibik, die Küste Südamerikas, die Strömungen, Untiefen und Windverhältnisse, die Schlupfwinkel und versteckten Naturhäfen so gut kennen, als wäre er dort aufgewachsen. Drake wußte jetzt auch bis in die Einzelheiten, wie die spanischen Galeonen mit Gold beladen wurden, wie ihr Geleitzugsystem funktionierte, wie die Schatzschiffe gesichert wurden. Im Jahre 1626, dreißig Jahre nach dem Tod von Francis Drake, veröffentlichte einer seiner Neffen einen Bericht über das Unternehmen, zu dem Drake 1572 mit nur zwei Schiffen aufbrach. Die Notizen erschienen unter dem Titel »Sir Francis Drake redivivus fordert dieses stumpfsinnige und verweichlichte Zeitalter auf, seinen noblen Schritten nach Gold und Silber zu folgen«.
Die »noblen Schritte nach Gold und Silber« des Kapitäns Drake machten seinen Namen binnen wenigen Monaten in ganz Europa berühmt und berüchtigt. Es war eines der verwegensten Projekte der ganzen Epoche, würdig auch des Beinamens, mit dem Königin Elisabeth inzwischen von spanischen und französischen Diplomaten ausgezeichnet wurde: »Perfide, freche Jezabel des Nordens«. Und wirklich mehr als frech - sofern dieses Wort die Drakesche Expedition treffend charakterisiert - war seine spektakuläre Kaperfahrt, zu der er im Mai 1572 auslief.
Die Besatzung hatte Drake ausnahmslos aus Freiwilligen zusammengestellt, aus blutjungen Seeleuten, insgesamt 73 Mann. Ein volles Jahr trieb sich Drake mit ihnen an der Nordküste Panamas herum, überfiel Städte und Garnisonen, kaperte Fregatten, lieferte sich Gefechte mit spanischen Truppen, tauchte blitzschnell und völlig unerwartet auf, landete einen Coup und verschwand ebenso rasch, als hätte ihn die See verschluckt - offensichtlich ein ebenso genialer wie verrückter Abenteurer, der es nur darauf angelegt hatte, seinen Hals zu riskieren, aber mit dem Teufel im Bunde sein mußte, weil er jeder Falle entschlüpfte.
Verrückt mußte er deshalb sein, weil er auf eigene Faust, aber namens angemaßter Stellvertretung des kümmerlichen Inselkönigreiches England, die Weltmacht Spanien zu attackieren wagte, vielmehr: Ein einzelner Mann mit zwei kleinen Schiffen und einem Haufen verwegener Burschen führte Krieg gegen den spanischen König, gegen den faktischen Herren der Welt in dieser Zeit. Die Hälfte von Drakes Raubzügen schlug fehl, endete ganz anders als geplant, aber sein jähes Hervorbrechen und urplötzliches Verschwinden, die Tollkühnheit seiner Angriffe mit wenigen Männern, die Unverschämtheit, mit der er sowohl an Land als auch auf See alles überfiel, was ihm einen Versuch wert zu sein schien, festigte seinen Ruf bei den Spaniern: Der Einzelgänger Drake war kein normaler Kapitän, sondern ein Ungeheuer des Meeres. Dementsprechend wurde sein Name spanisch abgewandelt: »El draque — der Drache«. Soweit es die Mischung aus Bewunderung und Wut betraf, die darin lag, glaubte auch Drake selbst an seine »Ungeheuerlichkeit«, denn er war maßlos eitel auf seine Tollkühnheit und seemännische Überlegenheit und hatte unstreitig auch ein gewisses Recht dazu.
Sein Hauptziel war es, einen der großen Silber- und Goldtransporte, die von Peru über Land nach Panama zum Hafen Nombre de Dios gingen, zu überfallen. Ein erster Versuch mißglückte, der zweite wurde ein voller Erfolg. Der Transport bestand aus fast zweihundert Packtieren; um die ganze Beute fortzuschleppen, war die Zahl der Engländer zu gering, sie beschränkten sich deshalb auf das Gold. Anfang August 1573 fuhren die Schiffe Drakes in den Hafen von Plymouth ein, schwer beladen mit einer ungeheuren Beute.
Die Achillesferse Spaniens
England jubelte, Spanien schäumte vor Zorn, Francis Drake lachte - und plante das nächste Piratenstück, ein Projekt, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Daß er, der Seemann, die Geldtransporte nach Panama an Land überfallen mußte, paßte so zu ihm, als wäre ein Hai gezwungen, außerhalb des Wassers zu jagen. Die Konvois über den Atlantik waren schwer bewacht; ein Überfall im Alleingang hatte von vornherein keine Aussicht, nur mit einem größeren Schiffsverband war ein erfolgreicher Angriff möglich. Dazu aber konnte sich die Königin nicht entschließen, England fehlte noch bei weitem die maritime Macht, um Spanien offen herauszufordern, so stetig Elisabeth I. auch die Flotte vergrößern ließ.
Andererseits handelte es sich bei dem Verbindungsweg zwischen der Karibik und dem iberischen Mutterland um den Lebensnerv des spanischen Weltreichs. Der gesamte Staatsschatz hing völlig von den Silber- und Goldtransporten über den Atlantik ab; wenn dieser Zustrom versiegte oder auch nur kurze Zeit unterbrochen wurde, konnten die Truppen in den Niederlanden nicht besoldet, die neuen Schiffe nicht gebaut, die europäische Politik Spaniens nicht fortgeführt werden. In der Karibik und in Peru, das die größten Goldvorräte besaß, befand sich die Achillesferse Spaniens. Drake erreichte eine Audienz und entwickelte der Königin seinen Plan. Das Edelmetall aus den Minen Perus wurde zu den Häfen der Pazifikküste Amerikas gebracht und dort auf die Schatzschiffe verladen, die nach Norden in den Golf von Panama fuhren. Hier wurden die Lasten auf Maultiere umgeladen und über die Landenge zu den karibischen Häfen transportiert, um dann an Bord der Schiffe nach Europa zu kommen. Drake hatte vor, durch eine Umsegelung Südamerikas in den Pazifik vorzudringen. Die Durchquerung der Magellanstraße war zwar nach dem Bericht Pigafettas das Entsetzlichste, was Seefahrer durchmachen könnten, aber er, Drake, schrecke vor nichts zurück. Auf der pazifischen Seite würde er dann in dem gewaltigsten Raubzug, den die Piratengeschichte kannte, die Schiffe des spanischen Königs ausplündern.
Elisabeth I. hungerte kaum weniger nach Gold als Drake. Der Plan versetzte sie in helle Begeisterung, sie versicherte Francis Drake, daß er ihre volle Unterstützung erhalten werde, und sie würde sich an dem Unternehmen auch finanziell beteiligen; offiziell könne und dürfe sie allerdings mit der Piratenfahrt nichts zu tun haben, besonders weil im Augenblick das Verhältnis Englands zu Spanien aufmerksamer denn je gepflegt werden müsse. Drake hatte für alles Verständnis, er wollte nichts weiter, als mit stillschweigender königlicher Rückendeckung seine Schiffe ausrüsten und schnellstens aufbrechen. Die Vorbereitungen wurden nicht eigens getarnt, um keine Neugier und keine Gerüchte zu wecken. Drake wußte, daß er seine Pläne am sichersten geheimhielt, wenn er möglichst offen vorging. Am 15. November 1577 verließ er mit fünf Seglern England.
Drakes Fahrt ähnelte in vielem dem Unternehmen Magellans, allerdings nur in nebensächlichen Dingen; beide brachen mit fünf Schiffen auf, beide mußten Meutereien niederschlagen, beide verloren Schiffe in Stürmen, beide Expeditionen endeten damit, daß nur ein einziges Schiff in den Heimathafen zurückkehrte. Drake durchquerte die Magellanstraße in der erstaunlich kurzen Zeit von sechzehn Tagen, mit drei Schiffen erreichte er im Herbst 1578 den Pazifik, verlor in einem wochenlangen Sturm zwei weitere Schiffe und segelte schließlich allein mit seinem Flaggschiff »Golden Hind« nach Norden.
Mit einem Überfall Valparaisos begann sein beispielloser Kaperzug. Er lief in den Hafen ein, plünderte die Stadt, raubte die Kirchen aus und überholte dann in aller Ruhe das Schiff, ergänzte die Vorräte und lag auf der Reede, bis sich die Mannschaft von den Strapazen erholt hatte. Während der nächsten fünf Monate segelte er ohne Hast die Küste entlang nach Norden, systematisch die Hafenstädte plündernd, über eine Strecke von mehr als 3000 Kilometer bis Lima. Die Stadt war der zentrale Stapelplatz für die Schätze Perus. Im Hafen ankerten zwölf große spanische Schiffe, die Kapitäne fühlten sich so sicher, daß die ganze Takelage an Land war; kein Mensch rechnete mit einem Überfall. Drake hatte kaum jemals so leichte Beute gemacht und noch nie in solchen Dimensionen.
In Lima erfuhr er, daß vor kurzem eine besonders große Galeone mit vielen Tonnen Silber, Gold und Schmuck nach Panama gesegelt war; das Schiff war allerdings schwer bestückt. Drake setzte dem Spanier sofort nach, holte ihn knapp jenseits des Äquators ein und konnte ihn trotz seiner Geschütze und der starken Besatzung entern. Außer Gold und Silber befanden sich unter Deck dreizehn Truhen mit Schmuck, Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten.
Drake dehnte seinen Piratenzug bis nach Mexiko aus, als Beute nahm er jetzt nur noch Gold und Perlen mit. Den Nordkurs hatte er deshalb eingeschlagen, weil er den amerikanischen Kontinent nach einer Nordwestpassage absuchte. Er drang bis zum 48. Breitengrad vor. Auf der Höhe der Insel Vancouver gab er das Projekt auf, überquerte im Gefolge Magellans den Pazifik, erreichte die Molukken, wurde von den Herrschern freundlich empfangen, belud den restlichen Laderaum seiner »Golden Hind« mit den kostbarsten Gewürzen und nahm endlich Kurs in die Heimat, quer durch den Indischen Ozean und seine Stürme, um das Südkap Afrikas und durch den Atlantik vorbei an den Azoren. Im Herbst 1580 tauchte die »Golden Hind« vor Plymouth auf, zerlumpt und abgerissen wie ihre Besatzung, ein jämmerliches Schiff, doch bis über den Freibord beladen mit einem ungeheueren Schatz: die »Golden Hind«, der berühmteste Segler der Epoche.
Vom Räuber zum Ritter
Niemand hat nach so langer Zeit noch mit der Rückkehr Drakes gerechnet. Der Hafenkommandant von Plymouth begrüßt das Schiff mit Salutschüssen, die Stadt taumelt vor Begeisterung, der Jubel brandet über das Land, die Nachricht von Drakes Ankunft erreicht London in der Nacht, die Menschen rütteln sich gegenseitig wach, sie strömen auf die Straße, auch die Königin wird im Palast von St. James geweckt, sie wirft ein Neglige über, trommelt ihre Räte zusammen - so wird erzählt - und stammelt ihnen die Nachricht entgegen: »Drake ist zurück, er hat die Welt umsegelt!« Dabei rinnen Tränen über ihre Wangen. … „
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, océans, géopolitique, politique maritime, puissance maritime, mers, mer, thalassocratie, angleterre, espagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 04 juillet 2009
Un tabou de l'histoire contemporaine: l'attaque allemande contre l'Union Soviétique en juin 1941

Archives de Synergies Européennes - 1992
Un tabou de l'histoire contemporaine: l'attaque allemande contre l'Union Soviétique en juin 1941
par le Generalleutnant Dr. Franz UHLE-WETTLER
ancien Commandeur du NATO Defence College de Rome
Le 22 juin de cette année, il y avait tout juste cinquante ans que la Wehrmacht était entrée en Russie. Notre époque se caractérisant par un engouement pour les dates-anniversaires, médias et politiciens ont eu l'occasion de se manifester et de faire du tapage. Mais on savait d'avance ce qu'ils allaient nous dire. Ils nous ont rappelé que l'Allemagne, pendant la seconde guerre mondiale, avait utilisé des méthodes criminelles (l'ordre de déclencher l'Opération Barbarossa) et concocté des desseins tout aussi criminels (le Plan de la réorganisation politique et économique des territoires de l'Est). Et que c'est pour promouvoir ces méthodes et réaliser ces desseins que les Allemands ont combattu. Avec des reproches dans la voix, avec des trémolos de honte, on nous a remémoré que toutes les institutions politiques, y compris la Wehrmacht, ont participé à ces crimes. Plus d'un donneur de leçons est venu à nous, la mine docte, pour nous dire qu'il fallait briser les tabous et laisser la vérité se manifester.
Mais il y a plus intéressant que ces sempiternelles répétitions de ce que nous savons déjà: précisément ce que ces briseurs de tabous veulent ériger comme tabous, les révélations qu'ils considèrent comme sacrilèges et qu'ils dénoncent comme telles. L'hebdomadaire Die Zeit, notamment, s'est spécialisé dans ce genre d'entourloupettes. En 1988, quand les toutes premières voix se sont élevées pour dire que l'attaque allemande de juin 1941 n'était peut-être pas une attaque délibérée, perpétrée sans qu'il n'y ait eu, de la part de l'adversaire, la moindre provocation, Die Zeit répondit par deux longs articles morigénateurs, dont le titre et les sous-titres en disaient assez sur leur contenu et leur style: «Les mensonges qui justifient la thèse de l'attaque défensive - Pourquoi on réactive la fable de la guerre préventive déclenchée par l'Allemagne». Bref: le ton d'une inquisition moderne.
Bien sûr, Staline voulait la paix
et Hitler, la guerre
Souvenons-nous toujours que les médias et les politiciens ne traitent des causes de la guerre qu'au départ de catégories moralisantes: on parle de culpabilité dans le déclenchement de la guerre, de Kriegs-’Schuld’. Or la guerre est un fait de monde qui échappe précisément aux catégories de la morale. Mieux qui ne peut nullement s'appréhender par les catégories de la morale. Si Hitler avait acquis plus rapidement la victoire à l'Ouest ou si, au moins, il était parvenu à une paix provisoire avec l'Angleterre, il aurait pu, s'il en avait eu envie, tourner tout son potentiel contre la Russie. Staline aurait été livré à son bon vouloir. Donc Staline ne pouvait pas, sans réagir, laisser évoluer la situation de la sorte. Il devait en conséquence attaquer l'Allemagne tant que celle-ci affrontait encore l'Angleterre (derrière laquelle se profilaient depuis un certain temps déjà les Etats-Unis). Staline a dû opté pour cette solution par contrainte. Et cette option n'a rien à voir avec une quelconque notion morale de «faute», de «culpabilité»; elle a été dictée par la volonté de Staline de survivre.
Examinons les choses de l'autre bord: la contrainte que Staline allait inévitablement subir, Hitler ne pouvait pas ne pas la deviner. Par conséquent, Hitler était contraint à son tour d'élaborer des plans pour abattre la puissance de Staline, avant que celui-ci ne passe à l'attaque. Et quand, dans une situation pareille, si explosive et si complexe, l'état-major allemand assure Hitler que la Russie peut être battue en quelques mois, plus rien ne pouvait arrêter le Führer. Processus décisionnaire qui n'a rien à voir non plus avec la notion de «faute», mais découle plus simplement de la position géographique occupée par l'Allemagne. Oser poser aujourd'hui de telles réflexions réalistes, non morales: voilà qui est tabou.
Mais il y a encore plus étonnant: par exemple, ce que nos destructeurs de tabous racontent sur les intentions de Staline en 1940/41. Les documents soviétiques ne sont toujours pas accessibles. Pourtant, nos briseurs de tabous savent parfaitement bien ce que voulait Staline. Et il voulait la paix. Evidemment. Donc, l'attaque allemande était délibérée, injustifiée. Scélérate. Comme sont des scélérats ceux qui osent émettre d'autres hypothèses sur la question. Des scélérats et des menteurs. Des menteurs qui cultivent de mauvaises intentions. Voilà comment on défend des tabous.
Pourtant Karl Marx déjà nous avait enseigné que les Etats socialistes devaient se préparer pour la guerre finale contre les capitalistes. Staline —on sait qu'il ne s'encombrait pas de scrupules inutiles— avait choisi de provoquer cette lutte finale par l'offensive. Et il l'avait planifiée jusqu'au plus insignifiant détail. Depuis 1930, tous les nouveaux wagons des chemins de fer soviétiques, épine dorsale de la logistique des armées modernes (encore de nos jours), devaient être construits de façon à pouvoir passer rapidement du grand écartement russe au petit écartement européen. Préconise-t-on de telles mesures quand on n'envisage que la défensive? De plus, Staline avait mis sur pied une armée gigantesque. On pourrait arguer que c'était pour se défendre; mais les chars et les unités aéroportées y jouaient un rôle prépondérant. Par conséquent, cette immense armée avait bel et bien été conçue pour une guerre offensive.
Comparons quelques chiffres pour donner une idée de la puissance soviétique en matière de blindés; en 1941, la Wehrmacht possédait 3700 chars capables d'engager le combat, c'est-à-dire des chars qui ont au moins un canon de 37 mm. Elle disposait en plus de 2030 engins chenillés ou sur roues armés de mitrailleuses ou de canons de 20 mm. Elle a attaqué la Russie avec 2624 chars et 1024 engins armés de mitrailleuses ou de canons légers de 20 mm (types Panzer I ou Panzer II). C'était tout! Face à elle, l'Armée Rouge alignait entre 22.000 et 24.000 chars de combat, presque tous armés de canons de 45 mm ou plus. Parmi ces chars, on trouvait déjà 1861 chars des types KV et T34, qui étaient invulnérables face à presque tous les chars allemands de l'époque. L'arme blindée soviétique, à elle seule, était plus puissante que toutes les autres forces blindées du monde! La supériorité soviétique en matières de canons et de mortiers était plus impressionnante encore. Quant aux escadrilles aériennes, le rapport des forces était également défavorable aux Allemands: le 22 juin 1941, les unités allemandes envoyées au front russe disposaient de 2703 avions de combat; leurs adversaires soviétiques en avaient de 8000 à 9000, pour protéger des unités bien plus importantes encore, massées dans l'arrière-pays.
Les Soviétiques disposaient en tout état de cause d'une puissance militaire capable de passer à l'offensive. Et l'URSS avait des raisons de s'en servir. Mais que voulait Staline?
Déjà, au début de l'été 1940, quand les Allemands n'avaient plus que quatre divisions à l'Est, Staline avait massé près de cent divisions le long de sa frontière occidentale. Personne ne saura jamais ce que Staline comptait en faire, au cas où l'attaque allemande contre la France se serait enlisée. A la veille de l'attaque allemande contre l'Est, Staline avait rassemblé 180 divisions dans ses districts militaires de l'Ouest. Elles venaient des régions les plus éloignées de l'empire soviétique: de la Transbaïkalie et du Caucase. A ces 180 divisions, s'ajoutaient encore neuf nouveaux corps mécanisés (chacun doté de plus de 1000 chars) ainsi que dix nouveaux corps d'armée aéroportés, ce qui trahissait bien les intentions offensives du dictateur géorgien.
Bon nombre de ces divisions acheminées vers l'Ouest ont été cantonnées dans des bivouacs de forêt provisoires, où il s'avérait difficile de maintenir à long terme les acquis de l'instruction et la vigueur combattive des troupes. Pas une seule de ces unités ne s'est mise en position défensive. Si elles avaient construit des redoutes de campagne, installé des obstacles, posé des champs de mines, l'attaque allemande de juin 1941 aurait été bloquée net et neutralisée. Les généraux soviétiques n'ont pas tenu leurs unités de chars en réserve pour une éventuelle contre-attaque mais les ont avancés le plus loin possible vers l'Ouest, dans les saillies frontalières. Indice plus révélateur encore: les dépôts logistiques de pièces de rechange, de munitions, etc. se situaient dans la plupart des cas à l'avant, plus à l'Ouest, que les unités de combat ou les escadrilles d'avions qui étaient censées s'ébranler les premières. Beaucoup de phénomènes apparamment marginaux confirment la thèse de l'imminence d'une attaque soviétique. Citons-en un seul: lors de leur avance fulgurante, les troupes allemandes ont souvent découvert des stocks de cartes militaires soigneusement emballées. Ces paquets contenaient des cartes de territoires allemands.
La thèse de l'attaque
délibérée ne tient plus
Que pouvons-nous prouver en avançant tous ces indices? Rien. Sinon que l'attaque du 22 juin 1941 n'était probablement pas une attaque délibérée et injustifiée contre une URSS qui ne voulait que la paix. Staline avait tous les moyens qu'il fallait pour attaquer. Beaucoup d'indices prouvent qu'il avait également l'intention d'attaquer, comme Hitler l'a affirmé dans plusieurs conversations secrètes et privées. Reste à savoir quand cette attaque soviétique se serait déclenchée. Quelques semaines plus tard? Au printemps de 1942? La décision allemande d'attaquer, la date du déclenchement des opérations, ont-elles été choisie parce que l'état-major allemand avait aperçu le danger d'une attaque soviétique imminente ou parce que les mouvements des troupes soviétiques ont précipité le cours des événements ou ont-elles été choisies tout-à-fait indépendemment des manœuvres soviétiques? Voilà tout un jeu de questions encore sévèrement tabouisé. La «querelle des historiens», il y a quelques années, l'a amplement démontré.
Quoi qu'il en soit: tout historien qui prétend aujourd'hui, en dépit de tous ces indices, que l'attaque allemande était entièrement injustifiée, qu'elle a été perpétrée sans qu'il n'y ait eu la moindre provocation soviétique, tout historien qui avance la thèse d'une attaque allemande délibérée et veut faire d'une telle thèse un axiome de vérité, ne pourra plus être pris au sérieux. La raison, le bon sens et le programme du premier semestre de toute licence en histoire nous enseignent la même chose: toute connaissance sûre quant aux motivations, aux intentions et aux objectifs ne peut être acquise qu'au départ de documents internes. Or les documents soviétiques sont toujours inaccessibles.
Dr. Franz UHLE-WETTLER.
00:08 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, allemagne, russie, urss, staline, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 juillet 2009
Le mire espansionistiche di Mehmed II

Arrigo PETACCO
Le mire espansionistiche di Mehmed II
tratto da: Arrigo PETACCO, La croce e la mezzaluna. Lepanto 7 ottobre 1571: quando la Cristianità respinse l'Islam, Mondadori, Milano 2005, p. 7-10.
Murad II morì nel 1451 e gli successe il figlio Mehmed II. Il nuovo sultano aveva appena diciannove anni e l'impero che aveva ereditato dal padre era già potente e temuto: dominava infatti buona parte della penisola balcanica oltre una grossa fetta dell'Asia Minore. Soltanto Costantinopoli era ancora indipendente, ma come può esserlo un castello assediato. Murad l'aveva rispettata, forse perché intimorito più dal suo leggendario prestigio che dalla sua potenza militare. D'altronde, alla grandezza di Roma Costantinopoli assommava la magia della sua storia: sulla "regina delle città" avevano regnato novantadue imperatori e nessun altro luogo del mondo, tranne Roma, poteva vantare una storia tanto lunga ed ininterrotta. Mehmed era invece di tutt'altro avviso e voleva conquistarla per realizzare l'ambizioso disegno di ricostituire l'antico Impero romano, il cui mito era giunto anche fra le aride montagne dell'Anatolia.
Mehmed era un uomo del suo tempo e la guerra era il suo sport preferito. Continuò le campagne iniziate dal genitore e mise a segno una serie di successi che ne ingigantirono l'immagine. Per le sue fulminanti vitorie, i soldati lo avevano ribattezzato Al Fàtih, il conquistatore, e l'eco delle sue imprese non aveva tardato a giungere anche nell'Occidente cristiano. Malgrado la giovane età, Mehmed era rispettato e temuto. Possedeva una forte personalità e un'ambizione illimitata: "Un solo Dio in cielo e un solo re sulla terra" era il suo motto, e lui naturalmente voleva essere quel "re". I suoi biografi sottolineano la sua intelligenza, la sua naturale crudeltà, nonché l'immancabile fanatismo religioso che lo animava: lui stesso era convinto di essere la "Spada dell'Islam". Ma non trascurano di metterne in rilievo anche la sorprendente cultura umanistica, l'interesse per il mondo greco e latino e l'ammirazione per i grandi condottieri dell'antichità.
Avido lettore di testi classici, il giovane sultano, che aveva scelto quali modelli Alessandro Magno e Giulio Cesare, quando conquistò la Grecia (destinata a rimanere per tre secoli e mezzo sotto il dominio turco) si mostrò meno feroce del solito e manifestò una sorta di venerazione per Atene, da lui definita la "città dei saggi". Ne onorò le antiche vestigia, le tradizioni e accolse nella sua corte artisti e filosofi ellenici.
Ma la conquista della Grecia non aveva appagato le ambizioni di Al Fàtih: egli guardava molto più lontano. Si raccontava che già all'età di quindici anni, al padre che gli suggeriva di rispettare Costantinopoli, avesse risposto: "Appena tu sarai spirato io farò la guerra contro l'imperatore romano perché, se lo sconfiggerò, diventerò padrone di tutto il mondo".
Il mito di Roma affascinava Mehmed fin dalla più tenera età. Nei suoi sogni di conquista non figurava soltanto la "seconda Roma", ossia quella bizantina, ma la "prima", quella vera, quella latina: la più antica e più bramata dai guerrieri musulmani incoraggiati dalla profezia secondo cui Roma era la "mela rossa" che un giorno il sultano avrebbe staccato dal'albero. Non a caso il nome dell'agognata "mela rossa" era evocato anche dal grido di guerra dell'esercito otomano, che suonava all'incirca così: "Làilahà, Allah! Roma! Roma!".
Per nobilitare il proprio lignaggio e per dare una sorta di legittimità alle sue mire espansionistiche, Mehmed II aveva accreditato e perfezionato una teoria piuttosto bizzarra che già era presente nell'immaginario islamico e che ora cercheremo di riassumere. Poiché, secondo la leggenda, i turchi discendevano da un mitico re Teucro - e "teucri" per qualche tempo i turchi erano stati chiamati (teucro significa infatti troiano) - il fantasioso sultano ne aveva ricavato la prova, si fa per dire, che il suo popolo discendeva direttamente dai troiani e che Priamo era il capostipite della sua dinastia. [...] Poiché, come "testimoniava" Virgilio nell'Eneide, Roma era stata fondata dalla progenie di Enea, ed Enea era un profugo troiano, di conseguenza il "vendicatore di Troia" poteva vantare dei diritti anche sulla città dei Cesari.
Questa ricostruzione impapocchiata dell'albero genealogico del popolo turco oggi potrà far sorridere, ma all'epoca fu presa molto sul serio dai sudditi del sultano e non soltanto da loro. Il papa Niccolò V, per esempio, molto addolorato per la caduta di Costantinopoli, non sorrise affatto quando gli giunse una missiva risentita di Mehmed nella quale il sultano esprimeva la propria meraviglia per il fatto che i romani odiassero tanto i turchi visto che tutto sommato erano... "cugini".
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, empire ottoman, méditerranée, rome, islam |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 juillet 2009
Cosa accadde davvero allo Scia' dell'Iran
COSA ACCADDE DAVVERO ALLO SCIA’ DELL’IRAN

Mi chiamo Ernst Schroeder, e siccome ho amici iraniani dai tempi della scuola e ogni tanto guardo la vostra rivista on line, ho pensato di inviarvi queste tre pagine prese da un libro che ho letto qualche mese fa, intitolato: Un secolo di guerra: la politica petrolifera anglo-americana e il Nuovo Ordine Mondiale. scritto dallo storico tedesco William Engdahl.
E’ un libro che tratta dell’intreccio tra la politica e il petrolio degli ultimi 100 anni.
Vi mando il brano perché lo pubblichiate sul vostro sito, dato che penso possa essere importante per tutte le persone di discendenza persiana.
DI WILLIAM ENGDAHL
“Nel novembre del 1978, il Presidente Carter nominò George Ball del Bilderberg Group, un altro membro della Commissione Trilaterale , a capo di una speciale unità operativa iraniana della Casa Bianca sotto Brzezinski, Consigliere per la Sicurezza Nazionale.
Ball caldeggiò l’abbandono di Washington del sostegno allo Scià iraniano a favore dell’appoggio all’opposizione fondamentalista islamica dell’Ayatollah Khomeini. Robert Bowie della CIA fu uno dei principali “funzionari incaricati” nel nuovo colpo guidato dalla CIA contro l’uomo che 25 anni prima proprio le loro trame nascoste avevano messo al potere.
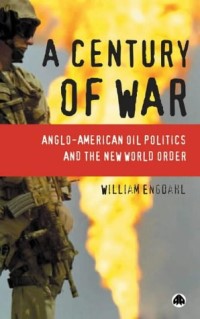
Il loro piano si basava su un dettagliato studio del fenomeno del fondamentalismo islamico, così come era stato presentato dall’esperto inglese dell’Islam Dott. Bernard Lewis, allora assegnatario di un incarico all’Università di Princeton, negli Stati Uniti. Il progetto di Lewis, reso noto durante l’incontro del Bilderberg Group nel maggio del 1979 in Austria, appoggiava il movimento radicale Fratellanza Mussulmana alle spalle di Khomeini, con l’intento di promuovere la balcanizzazione dell’intero Vicino Oriente mussulmano lungo linee tribali e religiose. Lewis sosteneva che l’Occidente dovesse incoraggiare gruppi indipendenti come i Curdi, gli Armeni, i Maroniti libanesi, i Copti etiopi, i Turchi dell’Azerbaijan, eccetera eccetera. Il disordine sarebbe sfociato in quello che egli definiva un “Arco di Crisi”, che si sarebbe diffuso nelle regioni mussulmane dell’Unione Sovietica.
Il colpo contro lo Scià, come quello del 1953 contro Mossadegh, fu pilotato dai servizi segreti inglesi e americani, con il pomposo Brzezinski che si prese il merito pubblico per la liberazione dallo Scià “corrotto”, mentre gli inglesi, tipicamente, rimasero al sicuro in posizione defilata.
Durante il 1978 erano in corso negoziati tra il governo dello Scià e la società British Petroleum per il rinnovo dell’accordo stipulato 25 anni prima sull’estrazione del petrolio. Nell’ottobre dello stesso anno le trattative furono mandate a monte per un’ “offerta” degli inglesi, che chiedevano diritti esclusivi sulle future esportazioni del petrolio iraniano rifiutandosi di garantirne l’acquisto. La dipendenza dell‘esportazione controllata dagli inglesi pareva giunta al termine, e l’Iran sembrava vicino all’indipendenza nella sua politica di vendita del petrolio per la prima volta dal 1953, con impazienti potenziali compratori in Germania, Francia, Giappone e altri paesi. In un editoriale di quel settembre, la testata iraniana Kayhan international scrisse:
Guardando al passato, la società venticinquennale con il consorzio [British Petroleum], e il rapporto cinquantennale con la British Petroleum che l’ ha preceduta, non sono stati soddisfacenti per l’Iran…D’ora in avanti, la NIOC [National Iranian Oil Company, Compagnia Petrolifera Nazionale Iraniana] dovrebbe fare in modo di gestire tutte le operazioni per conto proprio. (1)
Londra stava ricattando il governo dello Scià, e lo sottoponeva ad enormi pressioni economiche rifiutandosi di acquistare tutta la produzione petrolifera iraniana, comprando cioè soltanto circa 3 milioni di barili al giorno invece degli almeno cinque milioni di barili pattuiti. La cosa inflisse all’Iran drastiche ripercussioni sugli introiti, che favorirono un contesto in cui il malcontento religioso contro lo Scià poté essere ravvivato da agitatori appositamente addestrati, schierati dai servizi segreti inglesi e statunitensi. Inoltre, in questo frangente critico, ci furono scioperi tra i lavoratori del petrolio che ne paralizzarono la produzione.
Mentre i problemi economici interni dell’Iran crescevano, i consiglieri americani per la “sicurezza” della Savak, la polizia segreta dello Scià, attuarono in modo calcolato una politica di repressione ancora più brutale, per aumentare al massimo l’antipatia popolare verso lo Scià. Nello stesso momento il governo Carter cominciò cinicamente a protestare contro gli abusi dei “diritti umani” sotto lo Scià.
La British Petroleum, stando a quello che si dice, cominciò ad organizzare fughe di capitali fuori dall’Iran, per mezzo della sua considerevole influenza sul mondo finanziario e bancario iraniano. Le trasmissioni in lingua persiana della BBC, con dozzine di corrispondenti madrelingua inviati fin nel più piccolo villaggio, sollecitarono l’isteria collettiva contro lo Scià. Durante questo periodo La BBC diede all’Ayatollah Khomeini pieno appoggio propagandistico all’interno del paese. Questa organizzazione di emittenti radiotelevisive, di proprietà del governo inglese, si rifiutò di dare al governo dello Scià la stessa possibilità per poter ribattere. Ripetuti appelli personali dello Scià alla BBC non diedero alcun risultato. I servizi segreti anglo-americani si impegnarono in modo esplicito per rovesciare il suo governo. Lo Scià fuggì in Gennaio, e già dal febbraio del ’79 Khomeini era volato a Teheran per proclamare l’instaurazione del suo regime teocratico e repressivo in sostituzione del governo precedente.
Riflettendo sulla sua caduta qualche mese dopo, poco prima della sua morte, lo Scià in esilio osservò:
Allora non lo sapevo –o forse non volevo saperlo- ma ora mi è chiaro che gli Americani volevano estromettermi. E’ chiaramente questo ciò che i sostenitori dei diritti umani del Dipartimento di Stato volevano…che idea dovevo farmi sulla decisione improvvisa del Governo di chiamare l’ex sotto segretario di Stato George Ball alla Casa Bianca come consigliere sull’Iran?... Ball era tra quegli americani che volevano abbandonare me e, alla fine, il mio paese.
Con la caduta dello Scià e l’ascesa al potere dei seguaci fanatici di Khomeini in Iran si scatenò il caos. Al maggio del 1979, il nuovo governo Khomeini aveva stabilito i piani di sviluppo per l’energia nucleare del paese, e annunciato la cancellazione dell’intero programma per la costruzione del reattore nucleare francese e tedesco.
Le esportazioni di petrolio dell’Iran, circa 3 milioni di barili giornalieri, furono repentinamente bloccate. Stranamente, anche la produzione dell’Arabia Saudita in quei giorni critici del gennaio 1979 fu ridotta a circa 2 milioni di barili al giorno. In aggiunta alle pressioni sull’approvvigionamento mondiale, la British Petroleum proclamò lo stato di necessità e cancellò i contratti principali di fornitura del petrolio. Di conseguenza, all’inizio del 1979, i prezzi nel mercato di Rotterdam salirono alle stelle, fortemente influenzati dalla British Petroleum e dalla Royal Dutch Shell, le maggiori compagnie commercianti in petrolio. Il secondo “shock” petrolifero degli anni ’70 era in pieno svolgimento.
Gli indizi dicono che gli effettivi ideatori del colpo di stato di Khomeini, a Londra e tra i ranghi più alti delle organizzazioni liberali statunitensi, decisero di tenere il Presidente Carter del tutto all’oscuro di questa politica e dei suoi scopi ultimi. La crisi energetica che in seguito colpì gli Stati Uniti fu uno dei principali fattori che determinò la sconfitta di Carter un anno dopo.
Non ci fu mai una reale diminuzione nell’approvvigionamento mondiale di petrolio. Le effettive capacità produttive dell’Arabia Saudita e del Kuwait avrebbero potuto fronteggiare in qualunque momento la temporanea caduta di produzione di 5-6 milioni di barili giornalieri, come confermò mesi dopo un’inchiesta congressuale statunitense condotta dal General Accounting Office (Ufficio della Contabilità Generale).
Le scorte petrolifere insolitamente basse delle multinazionali petrolifere costituenti le Sette Sorelle contribuirono a generare un’enorme crisi del prezzo del petrolio, con un costo per il greggio che crebbe sul mercato da circa 14 dollari al barile del 1978 alla cifra astronomica di 40 dollari al barile per alcune qualità di greggio.
Lunghe code ai distributori di benzina in tutti gli Stati Uniti contribuirono a creare un generale senso di panico, e il segretario all’energia ed ex direttore della CIA, James R. Schlesinger, non aiutò a calmare le acque quando disse al Congresso e ai media nel febbraio del 1979 che la caduta della produzione del petrolio iraniano era “probabilmente più grave” dell’imbargo petrolifero arabo del 1973. (2)
La politica estera della Commissione Trilaterale del governo Carter fece in modo inoltre che fosse gettato al vento ogni sforzo europeo della Germania e della Francia per sviluppare accordi commerciali e relazioni economiche e diplomatiche con il loro vicino sovietico, sotto la protezione della distensione e dei vari accordi economici sovietico-europei sull’energia.
Il Consigliere per la Sicurezza di Carter, Zbigniew Brzezinski, e il Segretario di Stato, Cyrus Vance, perfezionarono la loro politica dell’ “Arco di Crisi”, diffondendo i disordini della rivoluzione iraniana lungo tutto il perimetro intorno all’Unione Sovietica. Per tutto il perimetro islamico dal Pakistan all’Iran, le iniziative statunitensi provocarono instabilità o qualcosa di peggio”.

Zbigniew Brzezinski, autore della teoria della “Cintura Verde” sotto la presidenza Carter, intendeva abbattere l’URSS circondandola con stati islamici alleati degli Stati Uniti
William Engdahl, Un secolo di guerra: la politica petrolifera anglo-americana e il nuovo ordine mondiale, © 1992, 2004, Pluto Press Ltd, pagine 171-174
William Eghdal
Note:
1) Nel 1978, il quotidiano iraniano Ettelaat pubblicò un articolo in cui si accusava Khomeini di essere un agente segreto britannico. I religiosi organizzarono violente dimostrazioni in risposta, che portarono alla fuga dello Scià qualche mese più tardi. Vedere U.S. Library of Congress Country Studies, Iran. The Coming of the Revolution, December 1987. Il ruolo delle trasmissioni in lingua persiana della BBC nella cacciata dello Scià è spiegato nei dettagli in Hossein Shahidi, “BBC Persian Service 60 years on”, in The Iranian, September 24, 2001.
2) Comptroller General of the United States. 'Iranian Oil Cutoff: Reduced Petroleum Supplies and Inadequate U.S. Government Response.' Report to Congress by General Accounting Office. 1979.
(http://www.comedonchisciotte.net/modules.php?name=News&file=article&sid=108)
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iran, shah, politique internationale, moyen orient, histoire, géopolitique, géostratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 juin 2009
Über den Begriff Mitteleuropas

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1993
Robert Steuckers:
Über den Begriff "Mitteleuropa"
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vor der deutschen Wiedervereinigung also vor 1990 sprach man öfters als heute vom Mitteleuropa, von einer mitteleuropäischen Annäherung bzw. einem mitteleuropäischen Kulturraum in den deutschen Medien als heute. Die Grünen, die Pazifisten, die linke Flügel der nordeuropäischen Sozialdemokratie unter dem geistigen Impuls von Männern wie Willy Brandt oder Olof Palme erwähnten damals eine atomwaffenfreie Friedenszone von Nordschweden bis zur griechischen Grenze, die die Streitkräfte der Supermächte geographisch trennen würde. Diese Sozialdemokraten pazifistischer Überzeugung kämpften eigentlich für die Errichtung einer «Gürtel der Neutralen». Was Palme in Schweden vorschlug, war wie ein Echo des Rapacki-Plan im Polen der 60er Jahre. Ihrerseits schlugen der General Jochen Löser und Frau Ulrike Schilling eine «mitteleuropäischer Friedenszone» mit historisch gut begründeten und sachlichen Argumenten (cf. Neutralität für Mitteleuropa. Das Ende der Blöcke, C. Bertelsmann, München, 1984). Aber dieser sozial-demokratische und pazifistische Diskurs, obwohl sehr relevant und geopolitisch durchaus koherent, erschien dem geschichtsunbewußten Publikum als eher abstrakt oder eben als intellektuele Spinnerei. Kritisch kann man zwar sagen, daß dieser Diskurs bloß zeitbedingt war und, zumindest im Falle der Pazifisten, die Palme laut verehrten, keine historisch-konkrete Perspektive bot.
Der Mitteleuropa-Begriff wurde elastisch im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts gedacht. Einerseits haben wir den Begriff eines reichszentrierten Mitteleuropas, mit Deutschland als Rumpf. Andererseits haben wir einen alternativen Begriff, der das Mitteleuropa zu einem «Cordon» reduziert, das nur Staaten zählt, die weder deutsch noch russisch sind. Dieses Mitteleuropa ist dann Pufferzone zwischen den deutschen und russischen Reichen und sollte als Ziel haben, eine Bündnis zwischen diesen zwei Giganten zu verhindern.
Das reichszentrierte Mitteleuropa hatte seine optimalen Grenzen zur Zeit der Karolinger: die Westgrenze lief von den Küsten des Nordsees, also von Friesland, bis zur Küste des Mittelmeers in der Provence; die Ostgrenze lief von der Odermündung bis zur Adria, d.h. zur dalmatischen Küste. Die Achsen Rhein-Rhône und Ostsee-Adria machten aus dem mitteleuropäischen Raum einen weltoffenen Raum mit Zugang zum Atlantischen Ozean und zum Mittelmeer. Dieser Raum hat parallele Flüsse in der norddeutschen Ebene (Schelde, Maas, Rhein, Weser, Elbe, Oder, Weichsel) und in dem burgundischen Raum (Saône, Rhône), die in Richtung Süd-Nord oder Nord-Süd fliessen. Demgegenüber steht der französischen Kernraum mit ebenfalls parallele Flüsse, die aber in Richtung Ost-West fliessen (Somme, Seine, Loire, Garonne). Das Schicksal der Völker hing in diesen Zeit sehr stark von diesen geographischen Bedingungen ab. Flüsse erleichterten die Kommunikationen. Ländliche Strassen waren unsicher und große Mengen Güter konnten nicht mit Karren befördert worden. Zu diesen drei Reihen Flüßen muß man einen vierten Fluß mitrechnen: die Donau, die eine West-Ost-Achse darstellt. Das nach den Türken-Kriegen erweiterte reichszentrierte Mitteleuropa wurde im neunzehnten Jahrhundert noch Donauräumisch bestimmt. Pläne entstanden, um einen gemeinsamen Markt mit den heutigen Benelux-Ländern, dem Reich, der Schweiz, der Donau-Monarchie, Rumänien, Serbien und Bulgarien entstehen zu lassen. Der östereichische Industrie-Leiter Alexander von Peez, Geographen wie Kirchhoff und Partsch, Penck und Hassinger, versuchten diesen Raum theoretisch zu fassen und schlugen Methoden und Pläne vor, um den balkanischen Raum als Ergänzungsraum für die industrialisierten Zonen des Altreichsgebietes zu organisieren. Diese Donau-bedingten Geopolitik projizierte sich weiter, über Anatolien nach Mesopotamien bis zur Küste des Persischen Golfes. Das erklärt die deutsch-österreichisch-ottomanische Bündnis im ersten Weltkrieg, aber auch teilweise die amerikanische Intervention in Irak in September 1990. Ein Europa ohne Eisernen Vorhang darf in den Augen der amerikanischen Geopolitiker und Planer sich nicht bis zur Persischen Golf ausdehnen, wie damals das Reich und Österreich-Ungarn nicht über den Balkan und das Ottomanische Reich über ein Fenster auf den Indischen Ozean geniessen.
Eben um diese geopolitische Dynamik zu torpedieren, fanden die Verfasser des Versailler Vertrages einen neuen Mitteleuropa-Begriff aus. Dieser Begriff sieht den mitteleuropäischen Raum als Pufferzone, als «Cordon sanitaire» zwischen Deutschland und Russland oder als Hindernis, als «Barrière» gegen jede friedliche, nicht-koloniale und wirtschaftliche Expansion Nordmitteleuropas in Richtung des Persischen Golfes. 1919 warnte der britische Geopolitiker Halford John Mackinder vor einer deutsch-russischen Bündnis, die dazu bestimmt war, ein gewaltiges Kontinentalblock zu organisieren, wo die angelsächsischen Seemächte keinen Zugriff mehr haben würden. Deshalb suggerierte Mackinder, ein «Cordon sanitaire» zwischen dem besiegten Deutschland und der aufkommenden Sowjetunion zu errichten. Lord Curzon, der Mann der die polnisch-sowjetische Grenze festlegte, war ein aufmerksamer Leser der geopolitischen Thesen Mackinders. Er versuchte sie in der Praxis umzusetzen. Der Franzose André Chéradame legte 1917 die Methoden aus, womit die Allierten die Achse Hamburg-Persischer Golf fragmentieren müßten, um
1) Deutschland seine Absatzmärkte im Ottomanischen Bereich wegzunehmen;
2) Die Donau-Monarchie zu zerstören und alle Zugänge zur Adria dem kleinen Österreich zu verhindern;
3) Bulgarien zu zähmen und ihm alle Zugänge zum Mittelmeer zu sperren;
4) Ein Großserbien zu schaffen, die alle Küsten der Adria kontrollieren würde;
5) Ein Großrumänien zu schaffen, um Ungarn und Bulgarien zu schwächen.
Fazit: Mitteleuropa unter deutscher Führung darf kein Zugang zum Mittelmeer mehr besitzen. Damit vollendete sich den historischen Prozeß, daß im Frühmittelalter mit dem Verlust der Provence, des Rhônetales und des Hafens von Marseille durch geschickte französische Ehepolitik. 1919 besitzt der geplante mitteleuropäische Markt mit dem Ottomanischen Reich als Ergänzungsraum kein Zugang mehr zum Mittelmeer. Erinneren wir uns doch, daß der Bonaparte es schon zwischen 1805 und 1809 versucht hat, Österreich und Ungern den Zugang zur Adria zu sperren: aus Südkärnten, Slowenien, Westkroatien und Dalmatien wurden die sogennanten «Illyrische Départements» zusammengestellt, die unmittelbar von Paris regiert wurden. Man begreift so, wie wichtig die Adria war, ist und bleiben wird. Deshalb erkannte Hans-Dietrich Genscher bewußt oder unbewußt sofort die Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens; er konnte so ein der schlimmsten Überbleibsel von Versailles wegschaffen. Im Westen waren einige Kanzleien damit nicht ganz einverstanden. Ein Wort noch über das Prinzip der nationalitäten des US-Präsidenten Woodrow Wilsons. Die Mittelmächte verteidigten damals keine nationale bzw. nationalistische Prinzipien sondern Übernationale bzw. reichische Prinzipien. Der österreichische Kronprinz wollte eine eidgenössenschaftliche Strukturierung der südslawischen Gebiete der Donau-Monarchie. Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina hätten eine eidgenössenschaftliche Verfassung gahbt, selbstverständlich auch für die orthodoxen Serben, die sich in diesen Gebieten im Laufe der Jahrhunderte niedergelassen hatten.
Das Mitteleuropa, das der Westen sich wünscht, darf keinen Zugang zum Mittelmeer haben. Heute wird dieser Mitteleuropa-Begriff u. a. von dem ungarischen Philosoph György Konrád propagiert. Konrád, der sich schon im Dissidententum zur Zeit Breschnews für einen humanen Sozialismus engagiert hatte, hat trotzdem richtige Argumente: Der mitteleuropäische Raum stellt eine Buntheit von Völker dar, also passen die Lösungen der homogöneisierenden Jakobinismus nicht; dieser Raum ist mit dem deutschen Volksraum nicht zu vergleichen, weil Deutschland und Deutschösterreich ethnisch homogen sind und politische Strukturen entwickeln, die eben für die ethnisch heterogenen Regionen Ostmitteleuropas nicht geeignet sind. Konrád fügt hinzu, daß das Experiment des «real existierenden Sozialismus» absolut notwendig ist, um einer künftigen mitteleuropäischen Konföderation beitreten zu können. Sein Standpunkt ist also nicht der gleiche wie der der französischen und englischen Diplomaten von 1918-19, aber haben geographisch bzw. geopolitisch das selbe Resultat. So bleiben in der Optik Konráds nur Polen, die Tschechoslowakei (die aber heute nicht mehr als solche besteht) und Ungarn, um diese hypothetische Konföderation beizutreten. Ich zweifle doch daran, daß eine solche Konföderation Überlebenschancen haben würde. In der Zwischenkriegszeit belasteten schon bestimmte Strukturmängel das politische Leben dieser Staaten: Das Heeresetat des polnischen Staates war wahnsinnig hoch, so daß die zivile Sektoren der Wirtschaft total vernachlässigt wurden; die Verbindungen mit Eisenbahn zwischen Böhmen einerseits und Berlin oder Wien andererseits waren erheblich erschwert, was nicht ohne Konsequenz für Handel und Wirtschaft war; Ungarn wurde von einem Admiral regiert und hatte überhaupt keinen Zugang zum Meer übrig; der ungarische Staat war ganz offensichtlich ein Krüppelstaat.
Weiter kann man sagen, daß das reichszentrierte Mitteleuropa, also m.a.w. der Raum des Karolingischen Reiches, grenzen mit fast alle anderen Staaten bzw. Völker in Europa. Strategisch gesehen, ist sein Spielraum den ganzen europäischen Kontinent. Strategisch gibt es also eine Art Gleichnis zwischen dem Reich des Mittelalters bzw. Deutschland bzw. die Bündnis zwischen dem wilhelminischen Deutschland und der Donaumonarchie und Gesamteuropa.
Der schwedische Geopolitiker Rudolf Kjellén hat es sofort nach dem ersten Weltkrieg erkannt. Mit modernen Mitteln, dank sei der Geschwindigkeit der motorisierten Truppen und der Luftstreitkräfte, lässen sich Bayern oder Tirol auf den Stränden der Normandie verteidigen. Die Bretagne und die Normandie gehören also seit Juni 1944 zum gleichen strategischen Raum als etwa Frankenland oder Kärnten. Dieser Fakt wird selbstverständlich heute, wo Raketen die entscheidende Waffen sind, bestättigt und bekräftigt. Soweit was Raum und Geschichte betrifft.
Im 19. Jahrhundert versuchte der Philosoph Constantin Frantz ein Föderalismus zu entwickeln, die alle Kräfte, die innerhalb des Volkes wirkten, bündeln könnte. Föderalismus hieß nicht bei ihm «spalten», wie die Separatisten aller Art es denken, sondern bündeln. Weiter wollte sein bündelnder Föderalismus die konkreten und ortsverbundenen Identitäten nicht zerstören, sondern sie auf einem höheren Niveau entfalten. Dieser Sinn für Verschiedenheit und dieses Respekt für lokale Belange entspricht einem typischen mitteleuropäischen Rechtsempfinden, das man u.a. bei den Austro-Marxisten, bei den konservativen Föderalisten und Regionalisten, in bestimmten Punkte des Programms der FPÖ Jörg Haiders, bei gewissen Anhänger der neuen Rechten, bei linken Regionalisten oder Grünen wieder. Das deutsche Verfassungsrecht seit 1949 ist davon geprägt. Die Schweiz wird seit 700 Jahre durch diese Prinzipien regiert. Die Tschechei und die Slowakei haben sich getrennt und suchen eine Lösung in einem Föderalismus bundesdeutscher bzw. schweizerischer Art. Regionen innerhalb oder außerhalb des mitteleuropäischen Raumes suchen die Möglichkeit, ihre Gemeinsamkeiten unmittelbar (d.h. ohne die Intervention zentralistischer Behörden) auszubeuten. Beispiele dieses Zusammenrückens gibt es in Hülle und Fülle: Alpen-Adria, ARGE-Alpen, Bodensee-Gemeinschaft, Sarlorlux (Saar-Lothringen-Luxemburg), Euroregio (NL-Limburg, VL-Limburg, Provinz Lüttich/Wallonien, Kreise Aachen und Köln, Deutschsprachige Gemeinschaft im Königreich Belgiens). In Spanien entwickelt sich ein «asymmetrischer Bundestaat», wo die Teile das Recht haben, eine eigene Außenpolitik zu treiben. In Frankreich, dem stärksten zentralisierten Staat Europas, wird die Notwendigkeit allmählich gefühlt, daß die Regionen an Autonomie gewinnen müssen, um nicht das Risiko zu laufen, in der Rückständigkeit zu fallen. Aber die Föderalisierung Frankreichs wird noch hartnäckig von gestrigen Kräften mit Erfolg bekämpft. Ich nehme hier die Gelegenheit, weil hier auch ein Vertreter der deutschen Menschenrechten-Kommission tagt, um die Anwesenden daran zu erinnern, daß Paris gewissen KSZE- oder UNO-Beschlüsse geweigert zu unterzeichen hat, weil diese den Schütz der Minderheiten vorsahen. Paris hat dafür gemeinsame Front mit Bulgarien, Rumänien (schon zur Zeit Ceaucescus) und Griechenland gemacht. In Italien, die Erfolge der Regionalisten der Lega Lumbarda werden die letzte Reste der römischen Zentralismus verschwinden lassen. In Großbritannien, erheben sich jetzt mehr und mehr Stimmen, um dem Lande eine Verfassung zu geben. Andererseits macht die sog. devolution Fortschritt. Schottland und Wales zählen ungefähr 5 Millionen Einwohner, Nordirland ist eine Raumeinheit für sich, aber England zählt 45 Millionen Einwohner, was das Gleichgewicht zwischen den Teilen zerstört. Deshalb suggerieren Juristen eine Verteilung Englands in neun historisch gewachsenen Ländern.
Das Problem der Subsidiarität
Heute wird die Subsidiarität allgemein verstanden als eine Absage der eigenen Souveränität, d.h. der nationalen bzw. staatlichen Souveränität, zugunsten einer übergeordneten Instanz, z.B. Europa. Europa entscheidet in den wichtigen Sachen und läßt Länder, Regionen, Gemeinden, eventuelle nationale Staaten die alltägliche Verwaltung. So haben die Briten, besonders die Konservativen um Frau Thatcher und John Major, den Begriff Subsidiarität verstanden. Theoretisch bedeutet aber eigentlich die Subsidiarität was ganz anders.
In der parawissenschaftlichen Literatur, die aber wichtig durch ihrem Impakt in den Medien ist, sagt etwa ein Alvin Toffler in seinem letzten Buch, Powershift, daß heute durch Faxgeräte, Computer, Modems, usw. die Zentralisierung der Großunternehmen nicht mehr notwendig ist. Die Großunternehmen, deren Etat manchmal größer ist als der Etat mancher europäischer Staaten, entwickeln sich jetzt in Mosaik, d.h. so, daß die Buchhaltung der Filialen bzw. der örtlichen Zweige völlig autonomisiert wird. Buchhaltung muß ortsnah werden, d.h. Rechnung damit halten, daß Sachen bzw. Unternehmen immer örtlich bestimmt sind.
In der streng wissenschaftliche Literatur, z. B. im erwähnenswerten Buch von Frau Prof. Chantal Millon-Delsol (L'Etat subsidiaire. Ingérence et non-ingérence de l'Etat: le principe de subsidiarité aux fondements de l'histoire européenne, Presses Universitaires de France, Coll. «Léviathan», Paris, 1992) , die in Paris in der Sorbonne doziert, bedeutet Subsidiarität die Autonomie aller Verwaltungsebenen oder aller Körperschaften, die eine gegebene Gesellschaft strukturieren. Chantal Millon-Delsol findet das prinzip Subsidiarität im deutschen Verwaltungsrecht zurück. Unter anderem in den Gemeindeordnungen, deren Art. 75 sagt: «Die Gemeinde darf nichts unternehmen, daß das private Sektor unternehmen kann». Subsidiarität wird hier nicht explizit sondern implizit formuliert. Diese Undeutlichkeit sollte verfassungsmäßig geregelt werden.
«Mitteleuropa» ist auch der Raum, wo dieses Rechtsempfinden implizit oder explizit (in der Schweiz z. B.) besteht. Rückkehr zur Mitte heißt deshalb auch Rückkehr zu diesem Rechtsempfinden. Was unseren Zeitgenossen auch zwingt, Aufmerksamkeit zu zeigen, wo Abweigungen auftauchen. Abweichungen sind entweder ein Zuviel an Staatlichkeit (Tocqueville stellte es für das hegelsche Preußen seiner Zeit) oder ein Zuwenig an Staatlichkeit (Tocqueville und Hegel stellten es gemeinsam für den Vereinigten Staaten fest, wo ein Despotismus durch Mangel an Staatlichkeit herrschte).
Das Rechtsempfinden Mitteleuropas kann als Modell für Gesamteuropa dienen. Strebungen in dieser Richtung können heute in Frankreich oder in Großbritannien beobachtet werden, wo ein strenger Zentralismus allmählich vor einer bescheidenen «Devolution» weicht oder wo eine stets wachsende Minderheit von Juristen eine moderne Verfassung fordern (Großbritannien hat nämlich keine Verfassung).
Mitteleuropa ist auch der Raum, wo Ordo-Liberalismus entstanden ist. Liberalismus reinsten Wassers führt zur Anarchie durch Mangel an Staatlichkeit. Totalitarismus sowjetischer Prägung führt zur Verknochung und Verbonzung durch Mangel an Autonomie. Ordo-Liberalismus wäre in diesem Sinne ein Gleichgewicht zwischen der stabilitätstiftenden Tradition und der erneuerungsschaffenden Dynamik.
Ordo-Liberalismus und Subsidiaritätsprinzip wären also die Grundpfeiler eines renovierten Gesamteuropas, in dem Gemeinschaften, Gemeinden und Gemeindewesen, ein eigenes Leben, ein Eigentum (im Sinne Stirner) , eine Eigenheit bzw. eine «Identität» (1) hätten und bewahren könnten. Damit diese Gemeinwesen sich entfalten können, brauchen sie eine garantierte Autonomie. Aber welche Kräfte wurden diese Autonomie gefährden?
1. Der äußere Feind. Dieser greift an, so daß Ernstfall bzw. Ausnahmezustand herrscht. In solchen extremen Fällen, gewinnt Autorität oder Diktatur (im Sinne Bodins oder Schmitts) Signifikanz.
2. Die ideologische Verblendung. Wenn ideologische Verblendung herrscht, ist der Staat kein dienstleistendes Prinzip, kein Instrument der Autonomie mehr. Der Staat wird dann bloß ein äußeres Instrument, das sich die Kräfte der Gemeinschaften bzw. Körperschaften innerhalb des Volkes bedient, um eine abstrakten Ideologie im Konkreten zu verwirklichen. So, zum Beispiel, die Ideologie der totalen, absoluten Freiheit herrscht in den Vereinigten Staaten: die Kriminalität aber wächst und das Schulwesen geht zugrunde. Die französische Revolution wollte die Idee der Gleichheit verwirklichen, was zu eine permanente Bürgerkrieg geführt und das Land definitiv geschwächt hat. Die Idee des Wohlfahrtstaates haben im Nachkrieg die Behörden Großbritanniens und Schwedens durchführen wollen; das hat aber die Industrie zertrümmert oder die Gesellschaft verknochet. Die Historiker führen auch manchmal aubereuropäiche Beispiele: das Mandarinat hat das traditionnelle China geschwächt und die Idee eines Ameisenstaates das Inkareich ruiniert.
Subsidiarität heißt, daß der Staat eine Regulationsinstanz ist (die Regulation, durch die sog. Regulationisten vertreten, wird allmählich heute —zumindest theoretisch— das Regierungsprojekt derjenigen Sozialisten, die die Wohlfahrt retten wollen aber trotzdem anerkannt haben, daß die Gleichheitswahn zur Starrheit führt). Die Regulationisten sind meistens innerhalb der sozialdemokratischen Parteien aktiv und ihre Projekten sind öfters mit denjenigen der grünen Humansozialisten, die das Kalmar-Prinzip in der Industrie verteidigen, gekoppelt.
3. Verantwortungslosigkeit bzw. Verantwortungsmüdigkeit der Bürger. Das Prinzip Subsidiarität bzw den subsidiären Staat zu verteidigen, ist eine schwere Aufgabe, weil die Behörden müssen dann ihre natürliche Tendenz, sich auszuweiten, bremsen, und zur gleichen Zeit, muß die zivile Gesellschaft erfolgreiche Initiativen nehmen. Um solche Initiativen zu nehmen, muß die Bevölkreung streng politisch bewußt sein, was heutzutage höchst problematisch ist, da in unseren westlichen Konsumgesellschaften das Spielerische die Oberhand hat.
In den rein wissenschaftlichen Werken der Professorin Chantal Million-Delsol heißt Subsidiarität:
1) Autonomie bestehen lassen bzw. fördern, wo sie vorhanden ist.
2) Alle Formen des Zentralismus vermeiden, da jeder Zentralismus eigentlich eine abstrakte Ideologie ins Konkrete verwirklichen will, was eine praktische Unmöglichkeit ist.
3) Eine Anthropologie, die den Menschen, die Gemeinden akzeptiert, wie sie sind, und nicht wie sie sein sollten.
Ein der akutsten Probleme unserer Zeit, ist es, daß Europa von Ideologen regiert wird. Ein erheblicher Teil unserer Regierenden sind keine nüchterne Beobachter der menschlichen Pluralität oder der erdhaften Wirklichkeit. Joze Pucnik, Leiter der slowenischen Sozialdemokratie, behauptete sehr richtig in einem Interview, daß die Menschenrechte konkrete und nicht abstrakte Rechte sind, d.h. daß diese Rechte sind, die in einem historischen Kontext eingebettet und daran angepaßt sind. Menschenrechte sind Produkte bestimmter Geschichten, variieren also vom Ort zu Ort, vom Zeitraum zu Zeitraum, und sind nicht ganz allgemein die Produkte einer bloßen Deklaration.
Fazit: Unser Ort ist der mitteleuropäische Raum, wo sich ein bestimmtes Rechtsempfinden im Laufe der Geschichte entwickelt hat. Unser Kampf für eine eigene Verfassung und für unsere Ort- und Zeitbedingte Rechte sollte selbstverständlich Rechnung halten mit diesem Raumbestimmtheit und diesem Rechtsempfinden. Das heißt Rückkehr zur Mitte. Besser gesagt: zu unsere eigene Mitte.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, mitteleuropa, europe centrale, allemagne, notion d'empire, europe, affaires européennes, pacifisme, neutralisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 juin 2009
Oswald Mosley e l'Unione dei Fascisti inglesi
|
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : angleterre, fascisme, grande-bretagne, années 20, années 30, nationalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 03 juin 2009
A propos des accords Reagan/Gorbatchev

SYNERGIES EUROPÉENNES - Juin 1988
A propos des accords Reagan-Gorbatchev
par Jean-Rémy Vanderlooven
La récente signature, en décembre dernier, du traité américano-soviétique portant sur une réduction des euro-missiles a fait couler beaucoup d'encre. La ren-contre à Moscou de Reagan et de Gorbatchev prouve en tout cas que cet accord est durable. Enfin un évé-nement médiatique qui ne soit sucité ni par une catastrophe ni par un scandale?
Bien que le traité, désormais ratifié par le Congrès américain, ne concerne que 3 à 7% de la puissance de feu nucléaire des deux super-puissances, réactions et com-mentaires ont fusés en tous sens.
Certains en ont déduit, hâtivement sans doute, que Reagan et Gorbatchev s'étaient soudain convertis au pacifisme angélique, d'autres y ont trouvé une preu-ve supplémentaire du machiavélisme soviétique, et quelques-uns, enfin, sont partis en quête d'un para-pluie, pas trop troué, sous lequel se réfugier frileu-sement. Toutes ces gesticulations révèlent un double manque considérable: la lucidité et la dignité.
En fait, la signature de ce traité trouve sa véritable im-portance historique, en tant que signe d'une dou-ble modification d'analyse et de stratégie dans le chef des deux grands et "subsidiairement" du statut de l'Europe de l'Ouest.
USA
Depuis quelques années, la stratégie mondiale des E-tats-Unis se réoriente en fonction de deux éléments re-lativement neufs. D'une part, une résurgence de la tentation isolationniste. Celle-ci est illustrée, au plan économique, par les différentes "guerres" euro-amé-ricaines (aciers, pâtes, etc.), ou encore, par la dégringolade —voulue— du dollar sur toutes les pla-ces financières, ce qui a pour double effet de faire fi-nancer la démagogie reaganienne par le reste du mon--de et d'élever des barrières autour du marché in-térieur américain. Parallèlement, au plan militaire, l'IDS ne sanctuarise que le territoire américain.
D'autre part, la source de la vitalité américaine glisse de la côte Est vers la côte Ouest, recentrage motivé par le transfert du centre de gravité économique de l'At-lantique-Nord au Pacifique. Cette double con-train-te, à laquelle s'ajoute au relatif manque de "fia-bi-lité" des alliés de l'OTAN, conduit, dans la pensée stratégique américaine, à une marginalisation toujours plus marquée de l'Europe de l'Ouest. Un désengagement progressif des Américains en Europe est donc de plus en plus probable.
URSS
En ce qui concerne l'URSS, il serait temps d'aban-donner nos phantasmes concernant une quelconque volonté de démocratisation de type "occidentalo-libéral". La nouvelle direction du pays a relevé un dé-fi d'une toute autre nature: la modernisation d'un sys-tème économique obsolète, condition de survie de l'empire. Cette exigence détermine le choix de nou-velles priorités: la société civile et l'infrastructure économique/technologique prennent, momentané-ment (?), le pas sur la logique d'un impérialisme pu-rement militaire et sur son corrolaire, la course aux armements.
Cette réorientation fondamentale devra permettre à la fois le transfert de ressources financières et humai-nes à l'intérieur de l'URSS et, via une amélioration du "look" diplomatique, une meilleure collaboration avec le reste du monde. Si tout ceci peut se traduire par une moindre militarisation de la société sovié-ti-que, par une relative décentralisation du pouvoir et par un assouplissement des normes de commu-nica-tion et d'information, l'Union Soviétique restera mal-gré tout fort éloignée d'un quelconque "plura-lis-me".
Les indices de ce changement de stratégie ne man-quent pas; l'URSS s'est longtemps montrée très ac-ti-ve dans le monde par ses interventions militaires, sou-vent massives. Dans les pays d'Europe centrale, à Cuba, au Vietnam, en Angola, en Ethiopie, en Af-gha-nistan (ces entreprises ont d'ailleurs eu pour effet d'atténuer le complexe d'"assiégés" des dirigeants so-viétiques).
Or, plus récemment, un relatif désengagement est per-ceptible, illustré, par exemple, par une aide plus dis-crète au Nicaragua, par la non-intervention directe en Pologne, par les velléités de retrait d'Afghanistan ou encore par le traité sur les euromissiles.
Tout cela rend l'étouffement complet des satellites eu-ropéens moins impératif et diminue l'acuité de l'af-frontement avec les nations ouest-européennes.
Europe de l'Ouest
Les Européens de l'Ouest ne peuvent nullement es-pé-rer imposer une stratégie propre et volontariste dans le cadre de ces bouleversements.
En effet, du fait des conséquences de ses guerres ci-viles et des erreurs historiques qui ont jalonné les po-litiques de colonisation puis de décolonisation, l'Europe a dû renoncer à son rôle de leader mondial. Cependant, les atouts qu'elle conserve, doivent lui permettre de développer une tactique "opportuniste" en fonction du relatif espace d'autonomie qui s'offre à elle.
Cette tactique devrait s'articuler sur trois options fon-damentales: 1) le neutralisme (non-alignement idéo-logique par rapport aux deux super-puissances; ce que les Allemands nomment plus justement la Blockfreiheit); 2) le recentrage et 3) la redécouverte de ces axes naturels de collaboration internationale.
Neutralisme
"Plutôt rouge que mort?". Certainement pas: une tel-le attitude n'est qu'une façon, parmi d'autres, de sa-crifier, une fois de plus, l'essentiel: la dignité. En fait, le nouveau neutralisme dont ont besoin le centre et l'ouest de notre continent est la première condition de son indépendance: il s'agit de s'affranchir de la tu-telle exercée par les deux grands, tutelle qui n'apporte qu'une protection illusoire au prix d'une vassalisation bien réelle. Dans cette optique, tant l'iso-la-tionnisme américain que l'attitude nouvelle des Soviétiques à l'égard du glacis est-européen sont des opportunités qui ne peuvent être négligées.
Recentrage
Au-delà de cette neutralité réinventée, l'espace euro-péen ainsi créé ne pourra définir son identité et affir-mer sa vocation internationale qu'en faisant appel à un système de références et de projets se rapportant à lui-même.
Potentiels culturels et traditions politiques purement européens sont, en effet, appelés à former la base d'une vision prospective de notre devenir, par la mi-se en avant de la communauté de destin de nos peu-ples. Nous voilà bien éloigné du "grand marché" pu-rement mercantile et ouvert à tous vents que nous proposent nos technocrates...
Axes d'ouverture
Contrairement aux dires des farfelus du mondialisme militant, l'avenir international de l'Europe ne passe pas par Séoul ou Lima, lieux pour nous excentri-ques, appartenant à l'espace sud- ou nord-pacifique.
Notre histoire indique à suffisance les solidarités (et les interdépendances) naturelles qui devraient être ré-ac-tualisées: l'axe est-ouest d'une part, l'axe nord-sud d'autre part.
Les conditions d'émergence du premier axe ont été dé-veloppées dans le points précédent. En ce qui con-cerne le deuxième axe —l'Afrique— sa réalité est clairement inscrite dans les faits. Nombre de nos pro-blèmes parmi les plus concrets, comme l'immi-gration ou l'approvisionnement en énergie, par exemple, ne pourront être résolus que sur base d'un dialogue trans-méditerranéen.
Défis
Il s'agit donc, pour l'Europe, de relever un défi: re-constituer une identité européenne propre qu'il fau-dra concrétiser dans un espace autonome et inscrire dans une alternative internationale dynamique.
Au boulot,...
Jean-Rémy VANDERLOOVEN.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européeennes, histoire, années 80, etats-unis, urss, union soviétique, guerre froide, perestroïka, glasnost |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 juin 2009
La RAF allemande: une analyse

SYNERGIES EUROPÉENNES - Juillet 1988
La RAF allemande: une analyse
par Michel FROISSARD
Les éditions Méridiens-Klincksieck ont sorti récemment une analyse du phénomène RAF (Rote Armee Fraktion) ou "Bande à Baader", où les chapitres sur les préoccupations idéologiques du groupe ont retenu toute notre attention. Son titre:
Anne Steiner & Loïc Debray
La Fraction Armée Rouge. Guérilla urbaine en Europe occidentale,
Méridiens-Klincksieck, Paris, 1987, 267 pages.
Pour les auteurs, l'histoire de la RAF comporte deux phases distinctes: celle de 1970-72 et celle de 1976-77. La première de ces phases est, bien sûr, la phase de maturation où la RAF acquiert son type particulier. Une quarantaine de personnes sont à la base des infrastructures de guerilla urbaine et, phénomène caractéristique, près de 50% d'entre elles sont des femmes, qui exerceront les mêmes tâches "militaires" que les hommes, en dépit de leur maternité. Pour Anne Steiner et Loïc Debray, ce renoncement au statut de femme et de mère, élément déterminant de l'"ascétisme révolutionnaire", procède d'une hiérarchie de valeurs affirmée par les militants: le "devenir général" pas-se avant le "cercle individuel". Cette intransigeance conduira les deux vagues de la RAF au terrorisme et à l'échec.
Vient ensuite la question des générations: la RAF est-elle un phénomène de génération, comme on l'a souvent dit? Est-elle le fait de ceux et celles dont les parents étaient jeunes adultes à l'apogée du nazisme? L'écrasante majorité des militants est effectivement née entre 1942 et 1949: leur petite enfance est marquée par la destruction totale de leur pays et par le désorientement des parents. En ce sens, il n'est pas faux d'affirmer que la variante terroriste de l'extrême-gauche allemande découle d'un mal-être propre à la "générations des ruines". Le terrorisme urbain a été une part essentielle dans l'après-guerre allemand, japonais et italien, c'est-à-dire dans l'après-guerre des trois pays vaincus de la seconde guerre mondiale; même si les formes du terrorisme urbain et les formes du régime dominant avant la guerre étaient fort différentes dans chacun des trois pays, il y a là plus qu'une coïncidence, contrairement à ce que semblent penser Steiner et Debray. Ce dénominateur commun de vaincu, pour nos deux auteurs, serait fortuit, puisqu'aux Etats-Unis, grands vainqueurs de la seconde guerre mondiale, il existait également un terrorisme urbain, ce-lui des Weathermen et de la SLA (Symbionese Liberation Army). C'est oublier que la masse des isolationnistes amé-ricains, qui n'avaient pas voulu la guerre et souhaité une autarcie américaine non-interventionniste, ont été également des vaincus en ce siècle et que l'hostilité d'hier à toute guerre contre l'Allemagne ou le Japon re-pose sur les mêmes principes po-li-tiques que l'hostilité à la guerre du Vietnam.
Pas d'identité historique possible pour les militants de la RAF
En revanche, Steiner et Debray signalent à très juste titre que si les Brigades Rouges (BR) italiennes, les indépendantistes basques ou l'IRA irlandaise pouvaient se référer à une identité historique (les "partisans" pour les BR) partagée par de larges strates de la population, les militants de la RAF étaient en quelque sorte orphelins sur ce chapitre: ils ne pouvaient plus se référer au combat de l'Allemagne contre les impérialismes américain et britannique, as-sorti du soutien aux indépendantistes arabes et hindous et aux justicialistes latino-américains, puisque l'extrême-gauche, dont les chefs de file idéologiques avaient trouvé refuge à l'Ouest, de Londres à la Californie, n'avaient guère cultivé de traditions anti-impérialistes à cette époque cruciale de notre siècle. Malheureusement Steiner et Debray se bornent seulement à constater l'impossiblité d'une référence à une identité historique précise. Il est juste en revanche de percevoir, chez les hommes et les femmes de la RAF comme chez un Pierre Goldmann, une aspiration existentielle/existentialiste au combat, à la lutte armée, à l'aventure révolutionnaire. Très juste aussi de dire que cette aspiration procède d'une volonté de sortir d'une situation d'apathie dans laquelle l'Allemagne s'était enlisée dans le sillage du miracle économique et de l'opulence des Golden Sixties. Les générations parentales, ex-nationales-socialistes, ont-elles dès lors été inconsciemment accusées d'avoir trahi les linéaments d'anti-impérialisme de l'ère hitlérien-ne et de n'en avoir retenu que les réflexes anti-communistes ou les calculs opportunistes, dépourvus de toute conscience politique forte? La RAF, à son insu, constitue-t-elle un retour maladroit des analyses nationales révolutionnaires anti-fascistes (Paetel, Niekisch, etc.) en matière d'impérialisme, mais un retour d'emblée condamné à l'échec à cause de son déséquilibre paroxystique patent?
Cet échec, directement prévisible, n'est-il pas dû à une absence de dimension populiste, de cœur pour le concitoyen qualunquiste, benoîtement aveuglé par les facilités du monde libéral ambiant, et à un trop-plein d'existentialisme héroïcisant et élitiste, de facture sartrienne, où le non engagé est d'office un "salaud", où le militant devient arrogant parce qu'il connaît ou croit connaître, dans son intimité personnelle, un niveau de conscience supérieur à la moyenne générale? L'idiosyncrasie des figures de proue de la RFA est à ce sujet révélatrice: la plupart de ces figures sont des intellectuel(le)s militant(e)s dont la pensée est conséquente jusqu'au bout, au point de n'accepter aucune espèce de compromission. Divers courants de gauche, dont le dénominateur commun est un refus de la société libérale et marchande, cimentée de surcroît par un conservatisme rigide, quelque peu autoritaire, conformiste et anti-intellectuel, débouchent sur la stratégie terroriste du refus absolu: ainsi, l'avocat Horst Mahler, militant du SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund; ligue des étudiants socialistes allemands) et de l'APO (Außerparlamentarische Opposition; Opposition extra-parlementaire), laboratoire de la gauche anti-dogmatique, a estimé que seul le re-cours au terrorisme pouvait provoquer l'avènement d'une société idéale, soustraite à tous dogmes. Ulrike Meinhof est, elle, une ancienne activiste de la KPD, interdite en 1952 (1). Elle a été la rédactrice en chef du journal Konkret, organe théorique du parti. La gauche dont elle est issue n'a pas le caractère soft de l'anti-dogmatisme de l'APO/ SDS. Sa trajectoire est très classique: issue d'une famille socialiste qui avait refusé le compromis de Bad-Godesberg (2), elle adhère à la KPD semi-clandestine mais refuse de militer dans la DKP, le parti qui en prend le relais après la levée de l'interdiction. Le passé de Ulrike Meinhof est un passé marqué par le communisme dur.
Ne pas se laisser déterminer par les "conditions objectives"
Gudrun Ensslin, pour sa part, est issue d'un milieu pacifiste chrétien: elle a été membre de la Jeunesse évangélique et a milité dans le mouvement anti-atomique, avant de fonder les Editions Voltaire avec son camarade Vesper et d'adhérer au SDS. Jan-Carl Raspe incarne les nouvelles voies du gauchisme: vie en communauté, création de structures alternatives, pédagogie anti-autoritaire, etc. La motivation de Raspe est toute personnelle et d'ordre psychologique: il était sans cesse travaillé par une angoisse envahissante et avait besoin d'une sphère d'affectivité communautaire. Raspe a transposé ce désir d'affectivité à l'ensemble de la société: selon lui, les prolétaires accèderaient à un monde meilleur, plus satisfaisant, si on leur donnait l'occasion de vivre en dehors des structures individualistes de la société marchande. "Seules des expériences alternatives dans le combat politique, pourraient mettre en route les processus par lesquels l'idéologie bourgeoise et la structure psychique individualiste seraient surmontées de façon durable", écrira-t-il. Comme les mouvements de jeunesse du début du siècle, les quelques dizaines de militants de la RAF refusent de se laisser déterminer par les "conditions objectives" mais ne se contentent pas de leurs communautés alternatives et veulent intervenir brutalement dans l'espace bourgeois, conquérir par la violence des morceaux d'"espaces libérés" supplémentaires. Et cette violence, ultime recours de ces desperados intellectuels, ne s'est-elle pas d'autant plus facilement installée dans leurs cerveaux parce qu'aucune tempérance de nature organique et historique, aucune mémoire vectrice de nuances, ne pouvait plus se lover dans un intellect germanique après la grande lessive de la rééducation perpétrée par les psychologues-policiers de l'US Army?
La carte terroriste a précisément été jouée par ceux qui, contrairement à Rudy Dutschke et Bernd Rabehl, n'ont pas voulu s'immerger dans le nationalisme de gauche, n'ont pas songé à recourir à l'histoire nationale, pourtant témoin de tant de luttes pour la liberté, le droit et l'égalité, pour donner à leur engagement une dimension collective concrète, même dans ses dimensions mythiques. Un langage social-révolutionnaire, propre au mouvement ouvrier, mais couplé à une mythologie nationale, aurait permis aux activistes de la RAF de conserver un lien avec les mas-ses populaires. Cela, Dutschke et Rabehl, les para-maoïstes qui dirigeaient la revue berlinoise Befreiung (= Libération), l'avaient compris. La RAF, de son côté, gardait un langage très raide, très expurgé de toute connotation historico-romantique instrumentalisable, accessible aux masses. Pourtant son constat relatif à la RFA, nous le trouvons, sous des formes variées, dans tous les discours idéologico-politiques allemands: l'Allemagne Fédérale n'a jamais eu de souveraineté et ne constitue plus un "Etat national" proprement dit; elle est une zone privée d'autonomie au sein d'un système économico-politique dominé par les Etats-Unis; la classe politique ouest-allemande est "fantoche"; l'occupation militaire américaine ôte toute indépendance à la RFA, etc. Quel conservateur, quel nationaliste, quel socialiste, quel communiste, quel gauchiste, quel écologiste n'a pas déploré ce nanisme politique? N'est-ce pas le démocrate-chrétien Barzel qui a résumé de la façon la plus concise la situation de son pays: "L'Allemagne? Un géant économique et un nain politique". Conjugaison de toutes les "conditions objectives" jugées inadmissibles, le système, expliquaient dans leurs tracts les militants de la RAF, instaure un "nouveau fascisme" qu'il s'agit de combattre. D'où leur venait cette définition du "nouveau fascisme"? D'André Glucksmann, aujourd'hui grand défenseur de l'Occident, rénégat aux yeux d'Hocquenghem, pourfendeur de toutes les tentatives de "finlandisation" réelles ou imaginaires. Steiner et Debray ont le grand mérite de rappeler ce détail.
Le "nouveau fascisme" défini par Glucksmann
Glucksmann, en 1972, écrivait, dans Les Temps modernes, la revue de Sartre, que le "nouveau fascisme" ne vient pas de la base comme l'ancien, mais qu'il s'est au contraire imposé d'en haut. " (...) le nouveau fascisme s'appuie, comme jamais auparavant, sur la mobilisation guerrière de l'appareil d'Etat, il recrute moins les exclus du système impérialiste que les couches autoritaires et parasites produites par le système (...). La particularité du nouveau fascisme, c'est qu'il ne peut plus organiser directement une fraction des masses". En d'autres mots et sans phraséologie militante pompeuse, l'intégration totale des individus à la machinerie politico-économique, l'homogénéisation des identités, l'arasement définitif des originalités, si bien perçus par Pier Paolo Pasolini le Corsaire (et avec quel style!), s'opère par des instances et du personnel d'idéologie officiellement "démocratique", installés au pouvoir par l'anti-fascisme (armé en France et en Italie, "psychologue" et "pédagogue" en Allemagne) et revenus dans les fourgons de l'US Army ou des troupes anglo-impérialistes de Montgomery. La contradiction, propre aux discours de la gauche militante et intellectuelle, est ici flagrante et a fini par ruiner leur crédibilité: comment peut-on baptiser "nouveau fascisme" l'ensemble des instances nées de l'anti-fascisme? Comment peut-on se réclamer à la fois de l'anti-impérialisme et de l'anti-fascisme, alors que ce dernier n'a pu vaincre qu'avec l'appui du grand capitalisme amé-ricain et de l'impérialisme colonial britannique? Comment faire accepter aux combattants du tiers-monde cette logique qui, en dernière instance, est américanophile? Comment faire accepter à l'indépendantiste indien, au militant panarabe, au justicialiste argentin, au sandiniste nicaraguayen, à l'indigéniste péruvien, au martyr malgache que la logique de Roosevelt, des banquiers de la City et de Wall Street, des compagnies pétrolières ou des marchands de fruits est certes mauvaise sous les tropiques mais qu'elle a été une bénédiction pour la vieille Europe? N'est-ce pas là le plus sûr moyen d'apparaître niais et schizophrène? Glucksmann a au moins été conséquent en pro-cédant à ses reniements successifs, quitte à se métamorphoser, aux yeux des soixante-huitards durs et purs, en un "nouveau fasciste", selon sa propre définition! Pasolini, quant à lui, a écrit que le fascisme ancien, mussolinien, était une broutille provinciale, comparable aux mésaventures cocasses de Don Camillo, à côté de la chape de plomb que faisait peser sur nos cultures la société marchande; la schizophrénie de la gauche, devenue désespérément furieuse dans le chef des combattants de la RAF, est restée en-deçà de ces brillantes analyses et c'est la raison essentielle de son échec.
Mais cet échec n'est pas seulement celui du terrorisme violent, c'est l'échec de l'ensemble des forces de gauche. Le constat posé par les disciples de Baader quant à l'involution de la gauche ouest-allemande est juste: après la guerre, la SPD a neutralisé tous les courants contestataires de la RFA qui s'opposaient à l'intégration à sens unique dans la "communauté atlantique des valeurs", autrement dit dans le réseau des flux économiques déterminé depuis Washington. Avec le congrès de Bad Godesberg, la SPD admet l'intégration occidentale, abandonne toute perspective neutraliste donc toute indépendance et souveraineté ouest-allemandes, tout projet d'apaisement centre-européen, toute fonction dialoguante à l'autrichienne, toute possibilité de "troisième voie" gaullienne. Ce refoulement énorme, cet--te mise au frigo de tant d'aspirations légitimes, ancrées dans l'histoire, anciennes comme la civilisation de notre continent, n'a pu conduire qu'à l'explosion anarchique et incohérente de la révolte étudiante et, par suite, à l'épilogue navrant du terrorisme urbain. Si la stratégie terroriste ne pouvait qu'être marginale, coupée du peuple, élitiste à mauvais escient, brutale au point d'apparaître gratuite, le constat posé est exact, bien que mal formulé, et de surcroît présent partout dans les milieux intellectuels de RFA, à degrés divers, depuis les cercles conservateurs jusqu'aux activistes nationalistes et gauchistes. Le legs majeur de la RAF, ce n'est pas une lutte victorieuse, ce n'est pas une brochette de héros auréolés de gloire et vertueux (ses protagonistes sont marqués d'angoisse, de schizophrénie, d'agressivité pathologique), c'est surtout une analyse qui dit que le "nouveau fascisme", c'est la social-démocratie, celle qui a capitulé à Bad-Godesberg. Ce slogan contradictoire, basé sur une série de faits réels, contient précisément tous les errements, tous les refoulements, toutes les distorsions que la gauche n'a pas pu surmonter, incapable qu'elle a été de poser des constats d'ordre historique cohérents et de moduler sa praxis en conséquence. On ne fait pas de vraie politique en manipulant des concepts occasionalistes à la sauce psychanalytique et en tripotant des pseudo-arguments freudo-marxistes, où transparaissent des fantasmes sexuels incapacitants. Un retour à Dutschke et à Paetel serait sans doute une meilleure thérapeutique.
Michel FROISSARD.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terrorisme, allemagne, raf, baader-meinhoff, histoire, années 70, gauchisme, extrémisme, extrême gauche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 31 mai 2009
G. Maschke: "Mit der Jugend damals wurde diskutiert"

Dossier "Günter Maschke"
"Mit der Jugend damals wurde diskutiert"
Der Ex-68er Günter Maschke über Jugendgewalt, die Kampagne gegen Rechts und das geistige Klima in Deutschland
Morittz Schwarz/Dieter Stein - Ex: http://www.jungefreiheit.de
Herr Maschke, Gewalt von Jugendlichen hat zahlreiche Initiativen gegen "Rechtsradikalismus" hervorgerufen. Handelt es sich bei diesen Ausschreitungen tatsächlich um Rechtsradikalismus?
Maschke: Zum Teil ist das nur ein Jugendprotest, der sich die vielversprechendste Form aussucht. Man sagt, diese Jungs seien sehr dumm. Tatsächlich aber sind sie so dumm, daß sie nicht manipuliert werden können. Die haben wenigstens eine instinktive Ahnung von der Schande ihres Vaterlandes. Sie sind für unsere ideologische Betreuungsmaschinerie nicht mehr erreichbar. Ich finde, man kann sich jetzt nicht stante pede ständig von ihnen distanzieren. Dazu kommen sicherlich auch agents provocateurs, da sind eine Menge ungeklärter Vorfälle wie jener in Düsseldorf, die ja auch immer zur richtigen Zeit losbrechen. Ich glaube, daß hier ein Vordergrund aufgebaut wird, um von der Weichenstellung in Richtung Einwanderungsland abzulenken. Dafür braucht man nicht nur Vorwände, sondern muß auch den aktivsten und aggressivsten Widerstand brechen; die anderen werden dann kuschen. Das ist nicht nur Sommerlochfüllung, das ist die totalitäre Demokratie, die wir haben.
Manche dieser Gewalttäter mögen resistent gegen den Zeitgeist sein, werden sie aber nicht in jedem Fall manipuliert, etwa von der NPD?
Maschke: Ich lehne es ab, mich innerhalb der Rechten von irgendwelchen Leuten öffentlich zu distanzieren. Den Luxus können wir uns gar nicht leisten. Das habe ich auch in der Linken kaum gemacht. Am besten schweigt man. Etwas anderes sind Gewalttaten gegen mißliebige Personen bis hin zum Mord. Das ist eine Sache des Strafrechts.
"Die Herrschenden wollen eine quasi volksgemeinschaftliche Zivilgesellschaft stiften"
Immerhin argumentiert man, auch mit Blick auf ein Parteienverbot, doch mit dem "Menschenbild" der NPD, das den Nährboden nicht nur der jüngsten Gewalttaten bilde.
Maschke: Die "Null Toleranz"-Propagandisten operieren doch genau mit dem Menschenbild, das angeblich bekämpft wird, nämlich mit einem totalitären. Eine Großgesellschaft von achtzig Millionen Menschen will nicht begreifen, daß es da soundsoviel Promille diese und jene gibt. Wie man die dann behandelt, ist eine ganz andere Frage. Aber es zeigt den totalitären Willen zur Einheit und zur Vereinheitlichung. Insofern dienen ihnen die wenigen stigmatisierten "Neonazis" ex negativo als letzter Zement für eine mittlerweile völlig atomisierte Gesellschaft. Durch sie wollen die Herrschenden ihre eigene Form einer quasi volksgemeinschaftlichen Zivilgesellschaft stiften. Also muß ich, nach Logik der Etablierten, diesen winzigen Gegner aufblasen und zu einer Macht machen, die einerseits dumm, klein und mies ist, andererseits ungeheuer gefährlich. Dieser Reflex, diese Psychomechanik, ist totalitär.
Sie meinen, die äußerste Rechte, die den Kampf explizit auf die Straße tragen möchte, vertrete tatsächlich eine legitime Gegenposition zum "System"?
Maschke: Dieses Land kämpft darum, seine eigenen Interessen nicht mehr formulieren zu dürfen. Der Widerstand dagegen könnte sich ausweiten und intelligenter werden, wobei ich allerdings mit Blick auf das verfügbare Potential skeptisch bin. Deshalb müssen schon die Ansätze rasiert werden. Und deshalb wird man denen auch ganz anders auf‘s Haupt schlagen als den 68ern. Und ich werde mich deshalb auch nicht abgrenzen. Nicht weil es keine Unterschiede gebe, sondern weil die falschen Leute dazu auffordern und man das außerdem nicht vor den Ohren des gemeinsamen Feindes tut.
Wird es zu massiver Repression kommen?
Maschke: Ja, sicher.
Wird die sogenannte "rechte Gewalt" dadurch gebändigt werden?
Maschke: Das weiß ich nicht.
Nehmen Sie denn die Herausforderung an und diskutieren mit Leuten, die den politischen Kampf mit Gewalt führen wollen?
Maschke: In Frankfurt am Main? Da gibt es doch kaum welche. Man muß im übrigen auch nicht mit jedem reden, und man muß sich nicht zu jedem und allem erklären. Ich möchte erstmal genaueres wissen und keinesfalls nur aufgrund der Dürre urteilen, die mir Ulrich Wickert allabendlich vermittelt.
Was sind denn Ihrer Meinung nach die Ursachen der teilweise als "nationaler Widerstand" deklarierten Gewalt?
Maschke: Die Motive liegen in der Misere dieses Landes. Und diese Misere zu hegen und zu pflegen ist doch die raison d’etre dieser Republik. Und nun werfen ausgerechnet Leute mit einem intellektuell tatsächlich nicht sehr beeindruckenden Niveau diese Fragen auf. Das muß die Gutmenschen ja irritieren. Denn das eigentliche Thema darf nicht zum Thema werden. Das ist typisch für Gesellschaften, die immer postulieren, sie würden über alles diskutieren. Damit verschleiern sie die Tabuisierung, daß sie nicht über den Kern der Sache diskutieren wollen.
Der proklamierte "nationale Widerstand" mitsamt seinen alles andere als politisch motivierbaren Gewaltexzessen trifft also Staat und Gesellschaft, viel mehr ins Mark, als die von Ihnen eher als intellektuell unbedarft eingeschätzten "Aktivisten" selber überhaupt vermuten?
Maschke: Wenn die Diskussion über die nationale Frage und ob wir ewig eine Schuldbekennungs- und Reparationseinheit bleiben, hochkommt, sind die etablierten Strukturen und damit die Karrieren ihrer Nutznießer gefährdet. Kämen die eigentlichen Dinge zur Sprache, würden sich diese Leute als illegitim erweisen.
Damit wären wir nun bei Ihrem bekannten Credo, wenn Sie von der Illegitimität der bundesdeutschen parlamentarischen Demokratie sprechen. Könnten Sie diese fundamentale Kritik erläutern?
Maschke: Die bundesdeutsche Demokratie leitet ihre Legimität aus den Wahlen der Lizenz-Parteien ab. Wir haben doch gar keine Demokratie, statt dessen haben wir eben eine Parteienherrschaft. Keine einzige Schicksalsentscheidung dieses Volkes, etwa Nato-Beitritt, die Einwanderung oder Euro-Einführung wurde in den letzten fünfzig Jahren auf wirklich demokratischem Wege, nämlich durch den Demos, getroffen – mit Ausnahme der Wiedervereinigung. Statt daß die Parteien, wie vom Grundgesetz gefordert, an der politischen Willensbildung mitwirken, mediatisieren sie den Volkswillen. Demokratie bei uns heißt: das Volk mit dem Knüppel des Volkes prügeln (Bakunin). Deshalb verweigere ich mich dem Konsens mit diesen Herren – selbst gegenüber Skinheads. Und besonders schändlich finde ich, daß heute genau diejenigen die Entmündigung des Souveräns fortsetzen, die vor dreißig Jahren ihr besonderes moralisches Recht gerade aus dem Kampf für "wahre Demokratie" abgeleitet haben.
Die Neigung der Berliner Parteien, mit totalitär anmutenden "Kampagnen" auf Herausforderungen zu reagieren, ist also Ausdruck eines Gefühls der Unsicherheit, ähnlich wie es die politische Klasse in der DDR empfunden hat?
Maschke: Sicher, würde das entdeckt werden, könnte daraus folgen, daß dieser Kampf um die Lebensfragen dieser Nation aufgenommen werden muß. Also darf diese Frage nie gestellt werden. Deshalb darf es keine wirkliche Kultur der öffentlichen Debatte der zentralen Fragen geben, deshalb wird der Widerpart so in die Ecke gedrängt, bis er sich nur noch auf die jetzt in Erscheinung tretende sehr deformierte und dumme Art äußern kann. Dieses Kunststück ist gelungen. Das Schlagwort "Rechts" dient der Exklusion. Und je weiter links einer steht, desto mehr Rechte sieht er. Natürlich, das gebe ich zu, funktioniert das andersherum genauso. Nur unterliegt der Rechte eben einer viel größeren Diskriminierungsmacht, denn der Linke, so die Mär, will ja letztendlich doch "das Gute". Zwar will er es mit "falschen Mitteln", aber irgendwie will er Besseres, als es das skeptischere Menschenbild des Rechten bietet. Das ist eben eine Kultur, die auf dem Narzißmus aller beruht, und den darf man nicht beleidigen, etwa mit reaktionären Wahrheiten. Wer das tut, ist draußen. Deshalb ist es falsch zu glauben, man könnte eine demokratische, akzeptierte Rechte etablieren. Dafür fehlt die pluralistische Struktur in diesem Land.
Wäre es deshalb nicht Aufgabe einer – konservativen – Opposition, für unsere Demokratie diese plurale Freiheit zurückzuerkämpfen?
Maschke: Die geistige Freiheit geht bei uns inzwischen gegen Null. Nach menschlichem Ermessen ist der Zug längst abgefahren. Wir befinden uns bereits nach Spengler. Die Sprache weiß es noch. Es heißt immer: die "ewig Unbelehrbaren". Es geht auch wieder um Belehrung, wobei immer fingiert wird, der zu Belehrende wüßte einfach noch nichts. Dabei gibt es Leute, die sind das erst geworden, durch jahrzehntelanges Lesen etwa. Ich bin zum Beispiel heute wesentlich unbelehrbarer als vor dreißig Jahren. Ich habe mir also meine Unbelehrbarkeit durch Gelehrsamkeit erkämpft. Die Gesellschaft tut immer so, als würde die Gegenmeinung nur von Ahnungslosen, Irren und Verbrechern vertreten. Wie konnte ein so großer Gelehrter wie Ernst Nolte sowas sagen? Ja, wahrscheinlich weil er ein großer Gelehrter ist! Die moderne Welt ist die Strafe für den modernen Menschen, doch der merkt es nicht einmal.
Die Aufgabe wäre doch, darüber zu wachen, daß der politische Streit in den in- stitutionalisierten Formen, also gewaltfrei ausgetragen wird. Ist deshalb das Klima des medial ausgerufenen Ausnahmezustands der letzten Wochen für eine Demokratie nicht mindestens so gefährlich wie die Atmosphäre der Gewalt?
Maschke: Sicher, und zwar eben weil wir keine nationale Kohäsion haben und deshalb auch nicht die Fähigkeit, mit den eigenen Minderheiten umzugehen, ganz im Gegensatz zu den Fremden. Bei achtzig Millionen gibt es einfach soundsoviele einer bestimmten Couleur, das müßte man eigentlich wissen und aushalten können. So wie das in anderen Ländern der Fall ist.
"Unsere Gesellschaft von Feigen und Rückgratlosen muß täglich neu Hitler besiegen"
Der rebellierenden Jugend von 68 brachte man Verständnis entgegen, weil man sie als die eigene erkannte. Warum gibt es für jene heutigen Jugendlichen, die nicht einfach nur Straftäter sind, sondern die sich ausschließlich politisch rechts artikulieren, nur Haß, warum das Bestreben, mittels einiger Straftäter eine ganze Szene zu kriminalisieren und sozial auszugrenzen?
Maschke: Verständnis darf sich gar nicht bilden. Die Bekämpfung dient ja gerade dazu, ein mögliches Verstehen zu verhindern. Ein Verstehen würde auch die Motive offenbar werden lassen.
Den eigenen Söhnen und Töchtern der 68er, soweit sie ein politisches Anliegen haben, soll nun mit einem neuen Radikalenerlaß auch sozial der Garaus gemacht werden. Warum?
Maschke: Zum ersten muß man einen Kotau vor dem Ausland machen, zum zweiten einen vor den "moralischen Instanzen" im eigenen Land. Zum dritten braucht eine Gesellschaft, die keine politischen Ziele und kein politisches Ethos mehr hat, irgend jemanden, über die sie sich einigen kann, und das sind eben diese armen Hanseln. Und viertens schüchtert man damit die anderen ein. Diese Strategie hat zwar etwas Irres und Hysterisches an sich, ist aber, wie gesagt, aus der Sicht der Etablierten gar nicht so verkehrt.
Es gab schon mal einen Radikalenerlaß gegen die APO.
Maschke: Das war wohl ein Schlag ins Wasser, denn diese Leute sind ja heute Minister.
Ist es nicht grotesk, daß die Leute, die sich damals gegen den Radikalenerlaß gegen Links gewehrt haben, nun einen solchen gegen Rechts fordern?
Maschke: Nein, denn wer im Besitz der Macht ist, der verteidigt sie, so ist das. Das Schamlose ist nur, daß Leute wie Joschka Fischer damals viel mehr recht hatten mit ihrer Opposition gegen das "System". Jetzt ist Fischer etabliert, ohne daß sich am "System" etwas geändert hätte. Das ist so typisch für die ganze Pseudo-Rebellen-Generation. Schamlos ist, daß sie sich als mittlerweile Verfolger immer noch als Verfolgte kostümieren. Dabei gehört ihnen dieser Staat.
Würden Sie unterscheiden zwischen dem Protest von 1968 und heute?
Maschke: Es gibt gewisse Überschneidungen. 68 wurde schon deshalb nicht richtig bekämpft, weil die Gesellschaft schon auf dem Wege dorthin war. Die Gesellschaft war schon durchliberalisiert und entnationalisiert. Für die APO war im Prinzip Raum in der Gesellschaft. Das zweite ist, der damalige Protest wurde von der akademischen Jugend artikuliert, und die wird natürlich mit Samthandschuhen angefaßt. Nicht wie die Sub-Proletarier, auf die kann man ja einknüppeln. Es ist wie in einer lateinamerikanischen Bananenrepublik, wo der Revoluzzer von gestern der Minister von heute ist, ohne daß er eine Revolution gemacht hätte. Mit der Jugend von damals wurde dagegen diskutiert. Und tatsächlich gab es 1968 sehr wohl nationale Motive bei einzelnen Führern der Bewegung, etwa Rudi Dutschke oder Bernd Rabehl. Die Gesellschaft befand sich aber bereits auf dem Weg zum Hedonismus, und die asketische Fraktion der 68er war nur sehr klein.
Sehen Sie heute Anknüpfungen an diese "asketische", "nationale" Position?
Maschke: Das könnte man aufgrund ästhetischer Kriterien verneinen. Wenn ich für Deutschlands Wiedergesundung bin, dann amerikanisiere ich mich nicht mit den entsprechenden Pullovern, den entsprechenden Aufschriften und dröhne mich nicht mit dieser Musik voll. Ich firmiere nicht in englisch, was ja nun wirklich die Sprache des Feindes ist. Und laufe nicht herum, wie in einem amerikanischen Slum. Unsere Gesellschaft von Feigen und Rückgratlosen muß natürlich täglich neu den toten Hitler besiegen. Das wissen wiederum jene, die deshalb gerne mal den Arm heben, um sich über die Reaktion zu freuen. So läuft das. Ein Teil dieser Leute ist doch gar nicht politisiert, sondern hofft nur auf den größten Skandal.
Es wird gern unterstellt, die schweigende Mehrheit zeige keine Zivilcourage, weil sie mit der Gewalt gegen Ausländer insgeheim übereinstimme.
Maschke: Es berührt schon sehr merkwürdig, wenn eine Meinung "Zivilcourage" genannt wird, die die Regierung, die Opposition, die Kirchen, die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberverbände und die Medien vertreten. Zweitens ist es eine falsche Vorstellung, übrigens auch bei vielen Rechten, daß es eine schweigende Mehrheit gibt. Die ist doch schon längst gekippt. Die Menschen sind bereits völlig verändert worden. Natürlich gibt es noch Differenzen und Unzufriedenheit in unzähligen kleinen Dingen, doch die Grundlagen sind alle akzeptiert. Heute glauben alle an die Menschheit, an die Globalisierung, an den Egalitarismus. Die schweigende Mehrheit ist ein Mythos, vor allem der Rechten.
Konservative Inhalte sind sozial einbindend und sinnstiftend und hätten der Entwurzelung der Jugend, die in den Medien pauschal als asoziale Gewalttäter präsent sind, vielleicht entgegenwirken können. Verlangt das Dilemma nicht nach einer Renaissance konservativer Politik?
Maschke: Ja, aber die ist ja inzwischen oft gar nicht mehr zu vermitteln. Die Begriffe sind völlig verfälscht, etwa "Toleranz". Das heißt eigentlich, "Was Du meinst, ist falsch, aber ich dulde es." Er bezeichnet eben mitnichten Gleichwertigkeit von Meinungen, es ist keine Indifferenz. Es unterscheidet noch etwas Richtiges von etwas Falschem. Heute hat man einen vorgefertigten gemeinsamen Schatz an harmlosen Meinungen. Und sobald ich eine andere habe, werde ich eben nicht mehr toleriert, auch nicht im alten Sinn des Wortes. Oder nehmen Sie den Begriff "Diskurs". Der muß eigentlich ergebnisoffen sein, ist er aber heutzutage nicht.
Besteht nicht die Gefahr, daß die Jugendlichen vom "Null Toleranz"-Bündnis schlicht umerzogen, statt endlich zu selbstbewußten Deutschen und damit radikalismusresistenten Menschen erzogen werden?
Maschke: Ersteres ist im Prinzip doch schon in vollem Gange. Das erfolgt durch drei Faktoren: Konsum, einen Vorrat erlaubter Meinungen und die Einigung über das absolut Böse. Das funktioniert einzig deshalb noch nicht so richtig, weil wir so eine Durchrausch-Gesellschaft haben: Zum einen Ohr rein, zum anderen wieder heraus. Auf zum nächsten "Fun". Da hat sich ja auch die Vergangenheitsbewältigung selbst ein Bein gestellt. Denn die Beschäftigung damit birgt nicht so viel "Fun" in sich. Nachdem man die Leute erst idiotisiert hat, um sie vollzudröhnen, erweist sich das jetzt auch in gewisser Weise als Hindernis.
Günter Maschke bei einem Kongreß der neurechten Vereinigung GRECE in Paris, 1997: 1943 in Erfurt geboren und in Trier aufgewachsen, arbeitet Günter Maschke nach seiner Lehre als Versicherungskaufmann 1964/66 zusammen mit dem späteren Terroristen Jörg Lang in der Redaktion der Tübinger Studentenzeitung "Notizen". Mitglied der illegalen KPD, flüchtet er vor dem Wehrdienst über Paris und Zürich nach Wien. 1967 organisiert er in der österreichischen Hauptstadt als "Rudi Dutschke von Wien" die außerparlamentarische Opposition und schlägt sich als Mitarbeiter der kommunistischen "Volksstimme" und des "Wiener Tagebuchs" durch. Nach einer Kundgebung gegen den Vietnamkrieg wird er verhaftet; ihm droht die Abschiebung in die Bundesrepublik, wo ihn wiederum eine Haftstrafe wegen Desertion erwartet. In dieser Situation gewährt ihm Fidel Castro politisches Asyl, Anfang 1968 geht Maschke nach Cuba, wo er zwei Jahre später wegen "konterrevolutionärer Umtriebe" ausgewiesen wird. Seither lebt und arbeitet der "einzige echte Renegat der 68er" (Jürgen Habermas) als Schriftsteller und Privatgelehrter in Frankfurt am Main. 1990 und 1992 unterrichtet er als Gastprofessor an der Hochschule der Kriegsmarine in La Punta (Peru). Günter Maschke war von 1980 bis 1982 Herausgeber der "Edition Maschke" im Hohenheim Verlag (u.a. Werke von Mircea Eliade, Pierre Drieu La Rochelle, Carl Schmitt und Bernard Willms). Er veröffentlichte zahlreiche Beiträge für Rundfunk, Zeitungen und wissenschaftliche Zeitschriften, insbesondere zum Werk von Juan Donoso Cortés und Carl Schmitt.
00:16 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, années 60, contestation, mai 68, 1968, jeunesse, jeunesse contestataire, violence juvénile, gauche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les aventuriers de la contre-révolution
Les aventuriers de la contre-Révolution
Paul-François Paoli
09/04/2009 | http://www.lefigaro.fr/
Nous sommes le 26 décembre 1799 dans un salon parisien où se croisent les intrigants de tous bords. Un homme jeune y entre, grand, mince, habillé comme un monsieur. Il s'appelle Jean-Guillaume Hyde de Neuville et, grâce à l'entremise de Talleyrand, s'apprête à rencontrer Bonaparte. Le premier consul, qui vient d'accéder au pouvoir après le coup d'État du 18 Brumaire, veut pacifier la Vendée et tend la main aux chouans. Le jeune aristocrate, qui, depuis la Terreur, est de tous les combats de la contre-Révolution, saisit l'occasion de parlementer. L'attente dure et l'émissaire royaliste songe à la finalité de sa mission qui va se révéler chimérique : installer Louis XVIII sur le trône avec l'aide d'un général que les jacobins considèrent désormais comme un traître à la République. Quand Bonaparte survient, Hyde de Neuville ne le reconnaît pas. « Petit, maigre, les cheveux collés sur les tempes, la démarche hésitante, il ne ressemble en rien au général qu'imagine Hyde. Sans doute, pense-t-il, est-ce là un serviteur. L'homme s'adosse à la cheminée, redresse la tête et regarde Hyde. Il le fixe avec une telle expression et une telle pénétration que celui-ci perd toute assurance, sous le feu de l'œil investigateur d'un homme qui grandit d'un coup de cent coudées. »
Racontée par l'historien Jean-Paul Bertaud dans Les Royalistes et Napoléon, cette scène digne des Chouans de Balzac donne la mesure de la tragédie qui déchire la France. Hyde de Neuville et Bonaparte se combattent, mais, d'une certaine manière, ils se ressemblent : ce sont des guerriers habités par le sens de l'honneur et l'ambition politique. D'ailleurs, ils se sont déjà affrontés. Le 5 octobre 1795, Hyde de Neuville faisait partie de la manifestation royaliste du 13 vendémiaire que le général corse a fait mitrailler pour sauver le Directoire. Depuis, Bonaparte a conquis ses galons, en Italie et en Égypte, avant de prendre le pouvoir. Il veut intégrer les aristocrates à son grand projet de refondation des élites et rêve de réussir une synthèse entre le meilleur de l'Ancien Régime, l'esprit chevaleresque, et l'acquis fondamental de la Révolution, dont il a lui-même bénéficié : la promotion par le mérite. Homme d'ordre, plutôt que jacobin, il tente de mettre un terme à la guerre civile qui déchire le pays. Malgré le ralliement de nombreux émigrés et le concordat avec le Pape qui restaure les droits de l'autel en 1801, il n'y parviendra jamais vraiment.
Un enracinement populaire
C'est l'histoire de cet échec que raconte Bertaud dans cet essai qui retrace la destinée de quelques hautes figures du royalisme français. Nul n'ignore l'existence de Cadoudal, que Bonaparte admirait pour sa bravoure, ou du duc d'Enghien dont l'exécution honteuse tache le règne napoléonien, mais qui connaît la vie haute en couleur de Jean-Guillaume Hyde de Neuville ou d'Armand Victor Le Chevalier, conspirateur qui sera fusillé après avoir multiplié les complots ? Au passage, Bertaud montre que la contre-Révolution ne peut être réduite à des groupuscules d'émigrés aigris stipendiés par les monarchies étrangères. Son enracinement populaire est patent dans le Midi et l'ouest de la France, mais aussi en Normandie. « Le Chevalier n'a jamais aimé les Anglais, leur assistance et leur influence toujours calculées lui sont insupportables. Il a décidé de ne pas les attendre et de recruter une armée parmi les paysans qu'il entretient depuis toujours dans l'esprit de révolte. » Incarcéré par Fouché, le ministre de la Police, il lui écrit : « J'ai projeté une insurrection contre Napoléon (…) mais l'idée d'un assassinat ne s'est jamais présentée à mon esprit et lorsqu'on me l'a offerte, je l'ai réprouvée avec indignation parce que je trouve indigne d'un homme d'honneur de se servir, contre ses ennemis, des moyens qu'ils trouveraient méprisables contre lui-même. »
Bertaud a raison d'affirmer que si les royalistes sont les témoins d'un monde révolu, ils sont aussi les visionnaires du monde à venir : où le pouvoir de l'État, le plus froid des monstres froids, va s'accroître aux dépens des libertés, et où l'idéologie ne fera plus très grand cas de la vie humaine. Les royalistes sont, pour beaucoup d'entre eux, des romantiques qui refusent la marche du temps. « Le retour à un âge médiéval, où le rêve l'emporte sur la réalité, est au cœur du modèle contre-révolutionnaire qui habite les royalistes depuis un quart de siècle. Pour eux la féodalité est l'âge d'or. Les hommes y vivaient selon le pacte passé entre le Ciel et la Terre et la chevalerie imposait à tous ses valeurs : courage et maîtrise de soi, respect de la parole donnée, désintéressement et protection des faibles », écrit Bertaud. Ce n'est pas pour rien que Chateaubriand, Vigny, Balzac et Barbey d'Aurevilly furent royalistes. La littérature, en somme, leur doit beaucoup. Quant à l'historiographie de la Révolution française, marquée chez nous par la prégnance de l'interprétation jacobine, elle les a trop souvent caricaturés en défenseurs d'un ordre ranci.
Les Royalistes et Napoléon de Jean-Paul Bertaud, Flammarion, 459p., 25 €.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : napoléon, bonaparte, contre-révolution, conservatisme, royalisme, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 mai 2009
Histoire de Flandre
A acheter de toute urgence : Histoire de Flandre
Eric Vanneufville
 Aux Pays-Bas, les historiens ont intégré en partie, selon les territoires et les époques, l’histoire de la Flandre. Leurs collègues belges en ont fait de même. En France, la Flandre de France en tant que telle a fait l’objet de différentes études, surtout par des histoiriens francophones.
Aux Pays-Bas, les historiens ont intégré en partie, selon les territoires et les époques, l’histoire de la Flandre. Leurs collègues belges en ont fait de même. En France, la Flandre de France en tant que telle a fait l’objet de différentes études, surtout par des histoiriens francophones.
Il manquait à cet ensemble de travaux divers et non coordonnés une vision harmonisée, dépassant les clivages dans le temps et l’espace, et tenant compte des apports néerlandophones. faisant défaut également la vision ancrée localement plutôt que celle ordinairement déployée depuis Paris, Bruxelles ou Amsterdam et La Haye. Bref, la lacune c’était le “point de vue flamand”.
C’est dans cet esprit qu’a été conçu et réalisé le présent ouvrage qui s’appuie sur les racines de la Flandre médiévale en son entiereté, depuis l’Escaut jusqu’à la Scarpe, puis sur les modifications apportées par les princes et les monarques, depuis les Bourguignons jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, et enfin par la probématique constituée par la division de la Flandre et la dispersion de la flamandité au sein d’Etats plus ou moins intéressés par l’existence reconnue du peuple de Flandre(s).
Historien, de Flandre de France mais connaisseur des Pays-Bas et de la langue néerlandaise, Eric Vanneufville a mené à bien depuis ses premières recherches doctorales il y a plus de trente ans, divers travaux en ce domaine. Il a rassemblé ses connaissances pour offrir au lecteur une histoire de Flandre(s) enfin abordée du point de vue Flamand.
En trois parties, huit chapitres et deux cents pages, cet ouvrage agrémenté de cartes et d’illustrations, se présente de façon pratique en format de livre de poche et pour un coût modique, adapté à une diffusion “grand public”.
Il fait partie d’une collection d’histoires de régions et pays, éditée chez Yoran Embanner.
Article printed from :: Novopress.info Flandre: http://flandre.novopress.info
URL to article: http://flandre.novopress.info/?p=4198
00:30 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, terroirs, terres d'europe, flandre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'histoire vraie de Lawrence d'Arabie
L'histoire vraie de Lawrence d'Arabie
23/04/2009 | http://www.lefigaro.fr/
T. E. Lawrence - On a retrouvé la version intégrale des «Sept Piliers de la sagesse», la fameuse saga autobiographique de l'agent britannique.
Quand éclate la Grande Guerre, Hussein, le chérif de La Mecque, et ses fils en profitent pour se révolter contre l'occupation turque, vieille de cinq cents ans ! Les Turcs étant alliés aux Allemands, les Arabes sont solidaires des forces françaises et britanniques. Lawrence est un familier du Moyen-Orient où il a mené des missions archéologiques. Il parle l'arabe et se fait recruter comme officier de renseignement. Il est bientôt chargé de rencontrer le chérif Fayçal, fils d'Hussein, retranché au cœur des montagnes dans l'arrière-pays de Médine.
Ainsi commence la gigantesque saga, avec le portrait majestueux de Fayçal, le prophète, l'icône de la rébellion. C'est lui qui va réunir les tribus, les réconcilier, les rallier contre les Turcs. C'est le frère loyal de Lawrence. Tel est le couple rayonnant de cette longue pérégrination guerrière à travers ce que Lawrence appelle le Hedjaz, c'est-à-dire l'Arabie des villes saintes, et plus largement un pays qui s'étend de La Mecque à Damas.
La légende de Lawrence est telle que le lecteur, gavé de gloses et de clichés, s'attend à un mélange inextricable de combats et de méditations dostoïevskiennes. Tant le personnage est réputé complexe, déchiré, masochiste. Mais les pages où il confie ses dilemmes et ses vertiges sont finalement limitées par rapport à l'insatiable tableau des courses, des escarmouches, des bivouacs virils, des sabotages à la dynamite de voies ferrées et de ponts.
La cavalcade épique occupe la presque totalité du livre, à part un préambule caustique et une parenthèse au bout de huit cents pages où Lawrence prend du recul et révèle soudain un tout autre portrait de lui-même, sous le masque du guerrier et du militant de la cause arabe. Il se qualifie « d'escroc à succès » et « d'imposteur impie ». C'est un précipice qui s'ouvre au cœur du héros et de son épopée pour les scinder en deux parts irréconciliables. Un divorce entre l'action et la pensée.
On tue, on fouette, on torture à tout-va !
Le mythe de Lawrence va prospérer au tranchant de cette faille. Lawrence opère cette volte-face vertigineuse qui retourne le colonel efficace et fervent en traître attifé en Bédouin, en sceptique très occidental, persuadé de son échec, de son égotisme, Zarathoustra raté, miné par la culpabilité et l'autoflagellation. Car, dès le départ, Lawrence a deviné que les Britanniques veulent canaliser et contrôler le désir d'indépendance des Arabes, il ne croit donc au succès de sa mission que dans la brûlure de l'action.
Pourtant, c'est un combattant clairvoyant, entouré de cheikhs tribaux truculents et divisés, plus amateurs de razzias que du fantasme de l'unité arabe. Certaines tribus partent pour la bataille avec leurs esclaves armés de dagues, en croupe des méharis. Lawrence admire leurs cuisses noires et musclées. D'autres se dénudent carrément dans l'assaut pour que leurs vêtements souillés n'infectent pas leurs blessures. Et Lawrence de savourer le spectacle des volées de jambes athlétiques et brunes. Son homosexualité n'est jamais avouée directement. Mais il chouchoute un couple de serviteurs juvéniles, amants l'un de l'autre, facétieux et transgressifs à souhait. Leurs foucades garçonnières agrémentent la ritournelle des tueries. Car on tue, on fouette, on torture à tout-va ! Lawrence, lui-même, exécute de trois balles un soldat fautif. Il en fait une description détaillée. Le fameux sadomasochisme du personnage n'est jamais revendiqué, il se déduit de la somme des souffrances infligées et endurées dans les déserts torrides parcourus par des méharistes coriaces et cruels.
L'originalité du livre tient à la multitude d'actes bruts commis dans des paysages décrits avec une exactitude de géologue et de géographe. Ce qui prime est la souplesse, la précision, la prégnance, la frontalité du récit. C'est le roman physique des granits dressés en embuscade, des grès, des laves, des dunes diamantines, des silex coupants, des puits antiques, des dromadaires omniprésents, de leurs selles somptueuses, des oueds, des gorges piranésiennes et des vallées parfumées. La chimère de Lawrence va échouer en 1920, puisque les Britanniques ne vont pas honorer leurs promesses faites aux Arabes.
Depuis Œdipe, pas de mythe sans Sphinx, sans duplicité, sans échec, sans dérapage pervers. Jamais un aventurier n'a été capable d'être à la fois aussi clair et concret dans l'action et aussi abstrait dans la méditation amère qui la récuse. Cette monstruosité, ces deux bords d'une blessure qui ne peut cicatriser, voilà la chair béante du mythe qu'un accident de moto viendra nimber de mort absurde.
Les Sept Piliers de la sagesse de Thomas Edward Lawrence traduit de l'anglais par Éric Chédaille Phébus, 1 072 p., 25 €.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arabie, arabie saoudite, première guerre mondiale, moyent orient, proche orient, islam, grande-bretagne, angleterre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Karel Martel en de Slag bij Poitiers
Karel Martel en de Slag bij Poitiers
Deze Frankische koning is over het algemeen onbekend. Toch heeft Europa zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht. Zonder deze overwinning had de wereld er totaal anders uitgezien en was er van het huidige Europa met onze normen en waarden, cultuur en andere verworvenheden totaal geen sprake geweest.
Leven van Karel Martel
Karel Martel werd geboren in Herstal (in het huidige Wallonië) op 23 augustus 676. Hij was een onwettige zoon van Pepijn II en zijn concubine Alpaida. Karel werkte zich op boven zijn jongere halfbroers, de Pepiniden en andere rechtmatige erfgenamen van Pepijn II.
In de onzekere toestand na de dood van Pepijn II in 714 had de Friese koning Radboud Utrecht heroverd op de Franken en met zijn vloot in 716 zelfs Keulen bedreigd tijdens de Slag bij Keulen, die de Friezen wonnen. Karel Martel zijn eerste overwinning als aanvoerder van het Frankische leger kwam in 716 in de Slag bij Amel. Daar versloeg hij de Neustrische koning Chilperik II door hem te overvallen met een hinderlaag. In 717 maakte Karel Martel zich van de totale macht meester en werd koning der Franken. Het jaar daarop verdreef hij de Saksen en won waarschijnlijk zo ook Utrecht terug. Toch was dit alles slechts klein bier ten opzichte van wat hij nu moest gaan presteren.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : francs, pippinides, histoire, europe, moyen âge, bataille |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 mai 2009
La presse juive sous le III° Reich

SYNERGIES EUROPÉENNES - JUILLET 1988
La presse juive sous le IIIième Reich
Recension: Herbert FREEDEN, Die jüdische Presse im Dritten Reich, Jüdischer Verlag bei athenäum, 1987, 203 S., 48 DM.
Le livre de Freeden lève le voile qui cachait jusqu'ici l'histoire de la presse juive sous le Troisième Reich et les débats que celle-ci a véhiculé. La presse juive dont il est question ici n'est pas la presse progressiste, non spécifiquement juive de l'époque de Weimar, que certains polémistes nationalistes avaient affublé du titre de Judenpresse. Il s'agit d'une presse, propre à la communauté israëlite allemande, qui n'a cessé de paraître qu'à la fin de 1938. Cette presse comptait 65 journaux et revues dont le tirage global mensuel s'élevait à un million d'exemplaires. Elle dérivait de deux matrices bien distinctes:
1) une presse libérale ou socialiste cosmopolite, orchestrée par de jeunes intellectuels juifs, qui avaient trouvé dans le journalisme des postes que la société wilhelmienne n'avait pas voulu leur confier dans l'enseignement ou le fonctionnariat;
2) une presse traditionnelle, confessionnelle et homilétique, dirigée et contrôlée par le rabbinat. Sa fonction était de renforcer la conscience juive, de façon à accentuer une "ségrégation culturelle positive", et de transmettre des informations générales au public juif. Une question importante était débattue après la proclamation des "lois de Nuremberg": rester ou émigrer? Les sionistes ne réclamaient pas une émigration massive vers la Palestine et les non-sionistes n'excluaient par pour autant la possibilité de l'Aliyah (retour à la "terre promise"). D'autres pariaient sur la Tchuva, le retour à la religion. Beaucoup d'intellectuels et les anciens combattants, notamment ceux qui s'exprimaient dans Der Schild, réaffirmaient haut et fort leur patriotisme allemand. Du côté des autorités, Ernst Krieck, recteur de l'université de Francfort, plaide pour la constitution d'une autonomie populaire (völkisch) juive au sein du Reich, qui reprendrait à son compte le refus sioniste de l'émancipation-assimilation, destructrice d'identité. On s'aperçoit, grâce à la recherche de Freeden, quelle densité prenait le débat éternel sur la question juive à l'ombre du drapeau à croix gammée. A relire au moment où en France des polémistes simplificateurs cherchent à créer une histoire juive aseptisée et abstraite.
(Robert STEUCKERS).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : judaica, national-socialisme, allemagne, judaïsme, années 30, iii° reich, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 27 mai 2009
G. Deschner: Die Kurden - Volk ohne Staat
|
 Günther Deschner: Die Kurden. Volk ohne Staat | ||||
| München 2003 Herbig-Verlag, 349 S. | ||||
| Nach Arabern, Türken und Persern sind die Kurden das viertgrößte Volk des Nahen Ostens. Ein 30 Millionen-Volk mit einer Jahrtausende alten Geschichte und Kultur, aber ohne eigenen Staat. Kurdistan findet sich auf keiner Landkarte. "Kurdistanim ka?" - "Wo ist mein Kurdistan?" singt der berühmte kurdische Barde Sivan Perwer und rüttelt damit die Kurden immer wieder auf zum Kampf für Freiheit und nationales Selbstbestimmungsrecht, den sie gleichwohl erfolglos führen, seit ihr Land nach dem ersten Weltkrieg zerstückelt und unter den Staaten Türkei, Iran, Syrien und Irak aufgeteilt wurde. In "Die Kurden. Volk ohne Staat" analysiert der Publizist und Nah-Ost-Experte Günther Deschner Gründe und Zusammenhänge für die Unterdrückung eines Volkes, dessen Ziel es einzig ist, sein politisches, wirtschaftliches, kulturelles und soziales Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Herausgekommen ist dabei eine ebenso fundierte wie spannend geschriebene politisch-historische Darstellung des Kurdenproblems - unter Einbeziehung aktueller Entwicklungen im Irak-Konflikt. Nicht zuletzt setzt die vorliegende Monographie Maßstäbe für spätere Arbeiten zum Thema Kurden/Kurdistan. Deschner versteht sich expressis verbis als Anwalt der Kurden. Seit 1972 hat er Kurdistan mehrfach bereist, den Kampf der Kurden um Unabhängigkeit hautnah mitverfolgt und Gespräche geführt mit wichtigen Kurdenführern wie dem kurdischen Mythos Mustafa Barsani, dem Chef der Patriotischen Union Kurdistan (PUK) Dschalal Talabani sowie dem gescheiterten PKK-Führer Abdullah Öczalan. Stets wurden und werden, so seine nüchterne Bilanz, die Kurden als Bauern auf dem Schachbrett der regionalen wie auch internationalen Machtpolitik hin- und hergeschoben. Detail- und faktenreich schildert der Autor anhand einer Fülle von Beispielen, wie Verträge, die den Kurden das Recht auf Unabhängigkeit versprachen, gebrochen wurden. Dabei spannt das Buch einen weiten Bogen von der ersten Aufteilung Kurdistans zwischen Osmanen und Persern 1639 bis hin zum "Dolchstoß aus Teheran und dem zweifachen Verrat durch Amerika" 1975 und 1991. Vor allem die neuere Geschichte der Kurden ist reich an Aufständen und Befreiungskriegen, in denen die Kurden sich gegen Umsiedlung, Assimilierung und Vernichtung wehren und für ihre geschichtliche und politische Identität kämpfen. Deschner spricht hier von einem bis in unsere Zeit in wechselnder Intensität anhaltenden Völkermord, von der Welt kaum registriert und kritisiert. Erst die Aufhebung des Ausnahmezustands Ende 2002 bedeutete für das kurdische Südostanatolien das Ende eines 15-jährigen, blutigen Bürgerkriegs. Zwar hat das türkische Parlament auf Drängen der Europäischen Union eine Reihe von Reformen auch hinsichtlich der kulturellen Freiheiten der Kurden eingeleitet. Gleichwohl harren noch viele Gesetze ihrer administrativen Umsetzung. Unterdessen rückt der Krieg im Irak den jahrzehnte währenden Kampf der Kurden um Freiheit und Unabhängigkeit in den Blickwinkel der internationalen Politik. Zwar leben die Kurden im Nordirak seit dem Golfkrieg 1991 faktisch unter einem Autonomiestatut, mit eigenem Parlament und internationalen Kontakten - fast ein eigener Staat, wie Deschner feststellt. Allerdings hängt dieser, wie sich jetzt zeigt, am seidenen Faden. Die Kurden erhoffen sich in einem neuen föderalen System eine Ausweitung ihrer Autonomiezone, nicht zuletzt als Belohnung für ihre Koalitionstreue im Kampf gegen Saddam Hussein. Es geht ihnen hierbei auch um ihr historisch angestammtes Recht auf die 3000 Jahre alte - auf Ölfeldern liegende - Stadt Kirkuk, dem "kurdischen Jerusalem", als künftige Hauptstadt Irakisch-Kurdistans. Doch auch diesmal, wie schon so oft in der Vergangenheit, fürchten die Kurden, verraten und im Stich gelassen zu werden. Überhaupt spielt Kirkuk, von den Kurden als "das Herz Kurdistans" verehrt, eine zentrale Rolle für die weitere Entwicklung in Irakisch-Kurdistan. Kirkuk ist ein Schmelztiegel unterschiedlicher Volksgruppen. Neben den Kurden, die bereits jetzt wieder eine große Mehrheit bilden, leben hier vor allem die großen und kleinen Minderheiten der Turkmenen, der Araber und der christlichen Assyrer. Während die zentralen Positionen in der Stadt inzwischen von Kurden besetzt sind - so ist der Bürgermeister seit Juni 2003 wieder ein Kurde und die Stadtpolizei besteht zu 80 Prozent aus Kurden - nehmen die Spannungen zwischen den Volksgruppen zu, vor allem zwischen Kurden und Turkmenen. Die Turkmenen fühlen sich mittlerweile als Iraker und befürworten einen irakischen Zentralstaat. Ob und inwieweit die kurdische Wiederbesiedlung der Region unterdessen zu einer Beschneidung der Rechte von Minderheiten geführt hat, dieser Frage geht das Buch allerdings nicht nach. Indes: Der erweiterte Autonomieanspruch der Kurden ist nicht nur den USA ein Dorn im Auge, die ob ihrer jüngst wieder bezeugten strategischen Allianz mit der Türkei für einen ungeteilten Irak eintreten, sondern weckt auch Ängste in Ankara und Damaskus. Und das zu Recht, so Deschner. Denn ein erfolgreicher Kurdenstaat im Irak würde zweifelsohne mobilisierend auf die Kurden der angrenzenden Regionen wirken. In diesem Zusammenhang verweist der Autor auf die engen Kontakte zwischen den verschiedenen Volksteilen, die bis zum Ersten Weltkrieg kaum reale Grenzen kannten. Die guten Verbindungen zwischen irakischen, türkischen und iranischen Kurden, spielen "eine das kurdische Bewusstsein stark beschleunigende Rolle". Aber auch die europäische "Diaspora" spielt eine besondere Rolle, wenn es um den schnellen Austausch von Nachrichten, Meinungen und Stimmungen via Presse, Rundfunk, Internet und bislang drei Satelliten-TV-Sender geht. Das aus der Türkei verdrängte kurdische Landproletariat finde dabei häufig erst in Deutschland, Belgien und Frankreich seine kurdische Kultur. "Die Kurden sind wohl vor der werdenden politischen zuerst eine Kulturnation", so Deschner. Gleichwohl, so mahnt der Autor, bestehe jederzeit die Gefahr des Ausbruchs der alten "kurdischen Krankheit", der notorischen Uneinigkeit untereinander. "Die Kurdenstämme", so zitiert Deschner eine alte Chronik, "halten untereinander nicht zusammen; keiner will dem anderen gehorchen und untertan sein." Wenn es jetzt in Irakisch-Kurdistan zu Konflikten zwischen Kurden komme, so Deschner, dann gehe es dabei aber weniger um hehre politische Ziele, sondern vielmehr um Macht, Ansehen und Eitelkeit einzelner Parteifunktionäre, Stammesfürsten und Familienclans. Die beiden wichtigsten Kurdenführer des Irak indessen, Massud Barsani, der Vorsitzende der Kurdistan Democratic Party (KDP), und Dschalal Talabani, Chef der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), sind zwar nicht "immer ein Herz und eine Seele", wie Deschner betont, doch eint sie bei aller Rivalität das zusammen ausgearbeitete Konzept zur Verteidigung der Autonomie. Sowohl die territoriale Aufteilung in PUK- und KDP-Regionen als auch die gemeinsam von beiden Parteiführern gesteuerte kurdische Regionalregierung und das Parlament in Erbil, tragen nach Deschner ebenso zum derzeit herrschenden Burgfrieden bei. Ausführlich diskutiert der Autor die grundsätzlich unter den Kurden umstrittene Frage, inwieweit ein föderales, national begrenztes Autonomiekonzept den Menschen zwar etwas mehr Freiheit bringt, letztlich jedoch die Spaltung des kurdischen Volkes zementiert und den Traum eines kurdischen Einheitsstaates in weite Ferne rückt. Für Deschner freilich geht dieser alte, neue Traum an der politischen Realität der dem Nahen Osten immanenten nationalen, religiösen und wirtschaftlichen Spannungen völlig vorbei. Vielmehr appelliert er an die Führer und Politiker der irakischen Kurden, auf dem "gewachsenen kurdischen Potential" aufzubauen, um so zwischen Träumen und Realpolitik, zwischen Geschichte und Hoffnung, die kurdische Realität zu gestalten: Eine Realität von Freiheit und Unabhängigkeit zunächst im Irak, wegbereitend für die Kurden in der Türkei, im Iran und in Syrien. Günther Frieß | ||||
00:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, turquie, empire ottoman, kurdistan, kurdes, moyen orient, grand moyen orient, irak, iran |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook