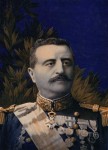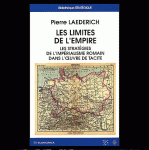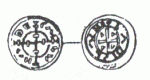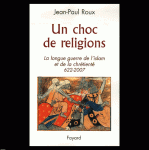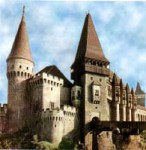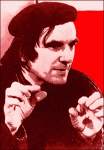Waarom nadenken over het verleden en de historische evolutie van het socialisme, op het moment dat het in Europa dikwijls electoraal verliest, terwijl het geen politiek project en geen gewapende takken meer heeft, geen Sovjet-banden of andere meer heeft, waar een fanatiek individualisme dat sociale catastrofes baart de postmoderne mentaliteit in de Eerste Wereld steeds meer bepaalt, van bevliegingen en rages vanwege yuppies en trendy kleinburgers die zich nestelen in hun kleine virtuele wereldje.
Waarom nadenken over het verleden en de historische evolutie van het socialisme, op het moment dat het in Europa dikwijls electoraal verliest, terwijl het geen politiek project en geen gewapende takken meer heeft, geen Sovjet-banden of andere meer heeft, waar een fanatiek individualisme dat sociale catastrofes baart de postmoderne mentaliteit in de Eerste Wereld steeds meer bepaalt, van bevliegingen en rages vanwege yuppies en trendy kleinburgers die zich nestelen in hun kleine virtuele wereldje.
Omdat het socialisme, of men het nu wil of niet, een communautaire reflex en aspiratie vertoont. Om een al even zo banaal als reëel discours aan te halen, de mens is geen wezen dat enkel op zichzelf gericht is, op zijn eigen ik. Hij is het kind van z’n ouders, maar ook kleinzoon of kleindochter, broer of zus, vader of moeder, neef, buur, collega,… In deze betekenis kan hij het goede wensen voor zijn groep of groepen binnen dewelke hij leeft en handelt en bijgevolg dit gemeenschappelijke goede verheffen boven zijn eigen individueel welzijn. Zoals alle aanhangers van grote religies en ook de adepten van het klassieke humanisme steeds hebben onderlijnd, een mens kan zijn welzijn opofferen voor z’n kinderen, een strijdzaak, voor elk soort motief dat het zelf overstijgt. Z’n intelligentie en instinctueel geheugen (twee kwaliteiten die niet noodzakelijk heterogeen en incompatibel zijn) kunnen dus opofferingen vooropstellen voor een tijd die als beter aangevoeld wordt, maar die nog toekomstig is. De mens handelt niet enkel vanuit een hedendaags perspectief, maar rekent vaak op de langere termijn, op vooruitzichten, wedt op de toekomst van de zijnen. Met het vermelden van deze banaliteiten, die antropologen en sociologen maar al te goed kennen, wensen we te wijzen op de nietigheid en de leegte van filosofische of economische theorieën die halsstarrig een methodologisch individualisme postuleren en die overal de hedendaagse manie van de politieke correctheid willen instellen.
Een deel van de aanhangers van het Verlichtingsdenken, vanaf de 18de eeuw, voerde in de dagelijkse politieke praktijk het methodologisch individualisme in, anderen legde de basis voor een sociale politiek, dikwijls in het kielzog van Verlichte despoten, anderen zoals filosofen uit de Parijse salons legden de basis voor het positivisme, terwijl nog anderen in het kielzog van Herder en de Sturm und Drang een emancipatie van mensen en zielen voorstelden door beroep te doen op de wortels van culturen, op ontluikende cultureel-literaire werken die de identiteit in al haar originaliteit en mooie onschuldige eenvoud weergaven. Door het bekritiseren van het methodologisch individualisme bij een deel van de volgelingen uit de Europese Verlichting, verwerpen we daarom nog niet alle facetten van deze Verlichting maar enkel deze die een dolgedraaide evolutie kenden, die een reeks foute veronderstellingen, dogma’s propageren en een schematische ideologie instellen en die er een discours op nahouden die elk debat weigert maar bol staat van modieuze woordkeuzes (door de Franse filosoof-medioloog François-Bernard Huyghe de “Langue de coton” genoemd), kortom, de hedendaagse politieke correctheid. Die “langue de coton” is in feite de concrete vertaling van de “Newspeak” die Orwell aanduidde in zijn bekende roman ‘1984’. Daar tegenover denken wij dat een dubbel teruggrijpen naar de vele facetten van de Verlichting, veronachtzaamd door het hedendaagse dominante discours, ons in staat zou stellen om het debat te heropstarten en aan onze medemens die in een impasse verkeert reële politieke alternatieven voor te stellen.
De mislukkingen van de Verlichting vertonen zich op meerdere niveaus in de Europese geschiedenis van de laatste tweehonderd jaar:
1) In de ideologieën die afgeleid zijn van de metaforen “tijd” en “machine”, wijzend op een mechanistische visie op politiek-sociale kwesties, waar elk individu aanzien wordt als een eenvoudig op zichzelf gericht radertje, vergelijkbaar met alle andere radertjes, zonder binding of wortels, verbindt de individualistische stroming in het Verlichtingsdenken aan deze metaforische en schematische visie sociale en politieke stellingen terwijl men voorbijging aan de voorbode van het romantisme en de organische politieke filosofieën waarin de principes van ontstaan, vorming en groei volkomen natuurlijk ingebed zijn.
2) In de maatregelen die door de nieuwe Franse republiek na de revolutie werden gestemd, tegen de corporatieve systemen, rechten op samenwerkingsverbanden en belangengroepen, enz.; de hypercentralistische organisatie van de nieuwe republiek waar de burgemeesters Parijs vertegenwoordigden en niet de lokale gemeenschappen; de introductie van een individualistisch recht in gans Europa via de Napoleontische legers; maatregelen die ertoe leidden dat bepaalde contrarevolutionaire groepen zich konden affirmeren als kampioenen van sociale rechtvaardigheid, in tegenstelling tot wat de huidige gangbare historiografie stelt.
3) De opkomst van de industriële revolutie in het teken van het individueel recht in Engeland en in teken van het geheel op het continent.
4) De uitwerking van mechanistische en individualistische economische theorieën.
5) Het ontstaan van een socialisme dat als filosofisch-ideologisch fundament een “wetenschappelijk” mechanistisch en individualistisch denken heeft.
Dit vijfvoud aan feiten heeft het socialisme gestimuleerd, georganiseerd in de 2de Internationale, daarna het communisme in de 3de Internationale en tenslotte het trotskisme in de 4de Internationale (de veelvuldige afsplitsingen en dissidenties niet meegeteld); om de meest mechanistische, machinistische en anorganische Verlichtingsideeën aan te nemen én de meer pragmatische, organische en culturele stromingen af te wijzen als reactionair, gericht tegen de “emanciperende” Verlichting. Indien het socialisme is ten onder gegaan, dan is het precies te wijten aan dat cultiveren van een waarachtig geloof in die mechanistische religie die zich “wetenschappelijk” achtte en onderuit is gehaald door bevindingen in de fysische wetenschap, vanaf 1875 met de ontdekking van het thermodynamica-principe, met de kwantumfysica en de opgang van de biologische wetenschappen, enz… Het socialisme heeft een eeuw overleefd na de ondergang van haar mechanistische “epistemologie”.
Indien het socialisme, als particratisch systeem verankerd in de Europese geschiedenis, zich had gericht op de organicistische metaforen uit het denken van herder en het romanticisme, dan was het vandaag de dag allicht nog springlevend geweest. Elke beoefening van politieke die de individualistische methodologie afwijst, moet breken met de mechanistische paradigma’s zoals geïllustreerd door de paradigma’s van het uurwerk en de machine(2).
In feite ware een inzet op het « metafoor van de boom » democratischer geweest : de aandrijvende kracht van de machine is exterieur aan de machine, net zoals de despoot exterieur is aan het volk waarover hij heerst. Het principe van de boom als drijvende kracht, zijn bron van energie, zijn allereerste impuls, huist namelijk in zijn innerlijkheid. De boom regeert zichzelf, zijn levensbestaan is niet afhankelijk van een exterieure kracht die een sleutel hanteert of een raderwerk in gang zet om te bewegen of te “leven”. Ter vergelijking, een organisch socialisme, dus niet langer mechanistisch, had kunnen voortkomen uit de geschiedenis zelf van een volk dat het regeerde en beschermde. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de socialistische oligarchiën de fout hebben begaan om uit het volk te treden, of een volk te regeren dat vreemd was aan henzelf in naam van een zeer hypothetische « internationale solidariteit », zonder (nog langer) te begrijpen wat de innerlijke motivaties van dat volk zijn. De kritieken van een Roberto Michels over de Verbürgerlichung, Verbonzung und Verkalkung (verburgerlijking, progressieve dominantie van de partijbonzen, sclerose) en de harde, bittere satire van een George Orwell in Animal Farm, waar de varkens uiteindelijk meer gelijk worden dan de anderen zijn hierover veelzeggend en tonen aan, voor zover nog nodig, dat de socialisten en de sociaal-democraten onderhevig zijn aan die politieke zwakheid, het is te zeggen, de zwakheid die erin bestaat een ideologie aan te nemen zonder diepgang die ertoe leidt dat ze in de marge van de bevolking belanden, hun socialistisch discours sterk relativeert en in de praktijk tot het omgekeerde leidt. De oligarchisering van de socialistische partijen is een permanent risico die het socialisme bedreigt, juist door toedoen van de “bonzen” die weigeren op te gaan in een volkslichaam, dat ze van nature uit als onvermijdelijk irrationeel beschouwen maar die vaak ontsnapt aan het kraakheldere schematisme van de beredeneerde Rede die hen eigen is.
Vandaag de dag verklaren de socialismes van verschillende kleuren en strekkingen de erfgenamen te zijn van de Franse Revolutie. Hoewel, het is de Franse Revolutie die de rechten op vereniging van bouwvakkers, handarbeiders, knechten,… alsook de beroepsverenigingen onderdrukt. Zij kiest daarentegen voor een puur individualistisch recht, gericht tegen de verenigingsrechten en de gedifferentieerde aanpak van de sociale kwestie. Gedurende de ganse 19de eeuw trachtten de werknemers hun traditionele verenigingen opnieuw te vestigen, ondermeer via het syndicalisme en in Engeland via een communautaristische vorm van socialisme: het guild-socialism. Maar de oligarchen van de socialistische partijen daarentegen hebben gekozen voor hun reële ideologie, nochtans tegengesteld aan het socialisme dat ze pretendeerden te verdedigen. De opeenvolgende breuken, afsplitsingen, de verschillende mutaties van het linkse discours zijn au fond gebaseerd op de weigering van het individualistisch mechanisme van deze “revolutionaire” Verlichtingsideologie. Nu de partijoligarchen, de “bonzen” zoals Roberto Michels hen noemt, een gedrag vertonen dat niet door de beugel kan, gelet op de betrokkenheid in maffieuze netwerken (zoals Craxi in Italië of de zaak Cools in België die leidde tot de naam “Palermo-aan-de-Maas”), vertaalt de malaise zich aan de basis door een desertie van het electoraat, en aan de top bij de intellectuelen, door een verandering in paradigma’s en dikwijls ook een terugkeer naar de onuitroeibare nostalgie van de gemeenschap. Vandaag praat men in de cenakels van denkend links, waaronder in de Verenigde Staten, opnieuw over “communautarisme”. Een discours die er hen toe verplicht opnieuw verbanden en waarden te herontdekken die tijdens de Franse Revolutie en het Bonapartistisch avontuur enkel door “contra-revolutionairen” werden verdedigd of geanalyseerd.
Algemeen kan men stellen dat de historiografische bronnen die gerelateerd zijn aan de contra-revolutie, bij de contra-revolutionaire auteurs duidelijk wijzen op een wil tot terugkeer naar het Ancien Régime en de klerikale en aristocratische elites opnieuw in het zadel wil helpen die er door de revolutie waren uit gelicht. Anderzijds zijn er bij die als “contra-revolutionair” beschouwde auteurs ook diegenen die autonomie van de werkenden, de arbeiders,… willen herstellen waarbij de extreme individualisering van het eigendomsrecht in bourgeois-recht dat vanaf 1789 triomfeert en finaal ook gecodificeerd wordt. Iets wat men nooit had durven doen tijdens het Ancien Régime, zelfs niet toen een langzame erosie van de solidariteitstradities was ingezet sinds een tweetal eeuwen. In Frankrijk vond de verdwijning van de orden eerder plaats dan elders in Europa. De situaties varieerden volgens de provincies. In het westen wegen de afnames van de heerlijkheden en het leenrecht zwaar door, in het zuiden en de streken rond Lyon en Parijs zijn ze praktisch volledig verdwenen. Aan de vooravond van de Revolutie heeft de boerenstand, de basis van de bevolking want de industriële revolutie is nog niet gestart en de arbeiders zijn kwantitatief nog beperkt in omvang, een afkeer van de verhoogde heffingen door klerken en de fiscus, maar dringen aan op het behoud van de collectieve goederen die vrij ter beschikking staan van de dorpsgemeenschap. Indien er opstanden en rellen zijn voor 1789, dan zijn die gericht tegen de bezitters van “rechten op heerlijkheden” en tegen hen die een private eigendom vestigen op een oude collectieve grond. Men zou dus kunnen denken dat de Franse boerenstand die vijandig staat tav “rechten op heerlijkheden” omdat ze een inbreuk vormen op gemeenschappelijke gronden, toegewijd was aan de republikeinse ideeën. Maar hun waaier van eisen en verzuchtingen herhaalt zich na de grote omwentelingen die Frankrijk overspoeld hadden: de revolutionaire assemblees voeren de belastingen opnieuw in en verzwaren ze nog, de grondlasten zijn nog zwaarder dan tijdens het Ancien Régime (november 1790). De historicus Hervé Luxardo stelt dat men aandrong op een “een revolutie binnen de revolutie”: de bourgeoisie vervangt het Ancien régime in de steden, installeert haar macht die de boerenstand schade toebrengt en die geleidelijk aan ertoe leidt dat de vijandigheid die men had t.a.v. de adel zich nu ent op de bourgeois die eigenaars zijn geworden van de oude collectieve goederen, op de nieuwe bezitters, de “foutus bourgeois” zoals een revolterende boer uit de Dordogne hen noemt in 1791. De revolte van het platteland maakt geen onderscheid tussen een edelman als dienaar van de koning of een bourgeois als aanhanger van de revolutionaire theorieën. Wanneer de revolutionaire staat de goederen van de Kerk verkoopt als zijnde “nationale goederen” aan particulieren in plaats van ze te herverdelen onder dorpelingen raken de gemoederen opgehitst en slaat in het westen van het land de vlam in de pan: opstanden in de Vendée en in Bretagne.
Erger nog, zo meldt Hervé Luxardo, in december 1789 vernietigen de nieuwe regeerders de laatste volksvergaderingen waar alle familiehoofden konden stemmen, door hen te vervangen door verkozen gemeenteraden waar enkel de “citoyens actifs” (lees: de rijksten!) kon voor stemmen! Deze maatregel maakte een einde aan de legende dat de Franse Revolutie “democratisch” was. Vanaf dan zouden de nieuwe notabelen die afgescheiden van een volk dat geen inspraak meer had, de collectiever goederen naar hun eigen goeddunken gaan beheren, het leidde op 28 september 1791 tot een plattelandswet die praktisch elk recht op het genieten van de vruchten van collectieve gronden, weiden, bossen verbood. Een catastrofe in de winterperiode die schaarste en hongersnood bracht bij de armste plattelandsbewoners. Een andere Franse historicus die kritisch staat t.a.v. de Franse Revolutie, René Sédillot, schrijft: jammergenoeg “is het voor bejaarden, weduwen, kinderen, zieken, armen om koren bijeen te rapen na de oogst, om te genieten van nagras, om stro te verzamelen voor bedekkingen, om druiven op te pikken na de wijnoogst, om kruiden en grassen bijeen te harken na het maaien (…) het is niet langer toegelaten voor de kuddes om vrije toegang te hebben tot de stoppelvelden en braaklanden.” Kortom, met één pennentrek elimineerde de wetgevende bourgeoisie de enige sociale zekerheid dat deze armste groepen hadden. Deze lacune zou ertoe leiden dat er arme klassen , “gevaarlijke klassen” ontstonden volgens de heersende terminologie. Het platteland kon niet langer alle dorpelingen voeden, wat een exodus veroorzaakte naar de steden of naar de kolonies, voeding gevend aan het ontstaan van een agressief en wanhopig socialisme.
In de steden waren de beroepen georganiseerd in gilden (meesters-chefs en werknemers-gezellen) en in gezellenverenigingen (zonder de meesters-chefs). De gezellenverenigingen organiseren de solidariteit tussen de werknemers-gezellen en staken indien hun verzuchtingen niet gehoord worden. De Frans-revolutionaire wetgever Isaac Le Chapelier veegt met één pennentrek de mogelijkheid van tafel om nog syndicaten te benoemen, kortom om er nog te stichten, en zelfs alle samenwerking van gesalarieerden mogelijk te maken. Sédillot: “De wet Le Chapelier van 14 juni 1791 maakte een einde aan al wat kon bestaan aan werknemersvrijheden.” Later veronachtzaamt de Code Civil de arbeidsregels en –wetten. Het Consulaat van Bonaparte herstelt de politionele controle op de werknemers door het “livret”, een arbeidsboekje, in te voeren. Geen enkele vorm van links kan geloofwaardig zijn indien het terzelfder tijd pretendeert erfgenaam te zijn van de Franse revolutie, partizaan van haar ideologie, en de werkende klasse te verdedigen. De Waalse Parti Socialiste is in flagrante tegenstelling met de essentie van het socialisme en de sociale solidariteit wanneer haar tenoren zoals Philippe Moureaux en Valmy Féaux geestdriftig de lof bezingen van de “Grote Revolutie” en zonder verpinken de ontelbare schurkenstreken van de sansculotten. De ganse sociale strijd van de 19de eeuw is in feite een protest tegen en een weigering van die wet Le Chapelier. In filosofische termen is de mechanistische ideologie uit het revolutionaire tijdperk van de Franse republiek niet in staat om de solidariteit te verzekeren en was de aanzet tot een ernstige sociale achteruitgang.
De gebeurtenissen van de Franse revolutie en het opkomen van de industriële revolutie in Engeland leidden tot een nieuw economisch denken van een wiskundig-rekenkundig type waarbij dat van Ricardo in het oog springt. Geen enkele historische of geografische context wordt in rekening gebracht en men zou moeten wachten op de Duitse « Historische Schule », het Kathedersozialismus en het institutionalisme (wat overigens Amerikaans is) om parameters te herintroduceren in het economisch denken die rekening houden met de omstandigheden, geschiedenis, geografie. Meteen werd ook het absurde idee ondergraven dat er één enkele economische wetenschap is die universeel alle bestaande, werkende economieën in de wereld kan sturen.
Bijgevolg is het socialisme een reactie tegen de Aufklärung zoals zij werd geïnterpreteerd in de Franse revolutie en door wetgevers zoals Le Chapelier. Het socialisme is dan ook, gelet op haar drijfveren aan het begin van haar levensloop, fundamenteel voor het behoud van de organische vrijheden, gemeenschappelijke goederen en de wijzen van organisatie in gilden en gezellenverenigingen. Die drijfveren zijn « juste » (juste afgeleid van het Latijnse ius, recht). Maar als het socialisme zoals we het nu kennen een mislukking, een onrechtvaardigheid of zelfs oplichterij is, dan is dit omdat het de verzuchtingen van het volk verraden heeft net zoals de Franse revolutionairen hun boeren hebben verraden. Een socialisme dat gedragen wordt door een historische en organische inhoud, gekoppeld aan een economische doctrine die schatplichtig is aan de Historische Schule en het Kathedersozialismus moet overnemen waar een vals socialisme dat gedecontextualiseerd, mechanistisch is en gedragen wordt door wiskundig-rekenkundige economische doctrines en een Frans-revolutionaire ideologie.
Robert Steuckers
Bibliografie:
- F.M. BARNARD, Herder’s Social and Political Thought. From Enlightenment to Nationalism, Clarendon Press, Oxford, 1965.
- Michel BOUVIER, L’Etat sans politique. Tradition et modernité, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1986.
- Louis-Marie CLÉNET, La contre-révolution, Presses universitaires de France, Paris, 1992.
- Bernard DEMOTZ & Jean HAUDRY (Hrsg.), Révolution et contre-révolution, Ed. Porte-Glaive, Paris, 1989.
- Jean EHRARD, L’idée de nature en France à l’aube des Lumières, Flammarion, Paris, 1970.
- Georges GUSDORF, La conscience révolutionnaire. Les idéologues, Payot, Paris, 1978.
- Georges GUSDORF, L’homme romantique, Payot, Paris, 1984.
- Panajotis KONDYLIS, Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, DTV/Klett-Cotta, München/Stuttgart, 1986.
- Panajotis KONDYLIS, Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang, Klett-Cotta, Stuttgart, 1986.
- Jean-Jacques LANGENDORF, Pamphletisten und Theoretiker der Gegenrevolution 1789-1799, Matthes & Seitz, München, 1989.
- Hervé LUXARDO, Rase campagne. La fin des communautés paysannes, Aubier, Paris, 1984.
- Hervé LUXARDO, Les paysans. Les républiques villageoises, 10°-19° siècles, Aubier, Paris, 1981.
- Stéphane RIALS, Révolution et contre-révolution au XIX° siècle, DUC/Albatros, Paris, 1987.
- Antonio SANTUCCI (Hrsg.), Interpretazioni dell’illuminismo, Il Mulino, Bologna, 1979 [in dieser Anthologie: cf. Furio DIAZ, “Tra libertà e assolutismo illuminato”; Alexandre KOYRÉ, “Il significato della sintesi newtoniana”; Yvon BELAVAL, “La geometrizzazione dell’universo e la filosofia dei lumi”; Lucien GOLDMANN, “Illuminismo e società borghese”; Ira O. WADE, “Le origini dell’illuminismo francese”].
- René SÉDILLOT, Le coût de la révolution française, Librairie académique Perrin, Paris, 1987.
- Barbara STOLLBERG-RILINGER, Der Staat als Maschine. Zur politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats, Duncker & Humblot, Berlin, 1986.
- Raymond WILLIAMS, Culture and Society 1780-1950, Penguin, Harmondsworth, 1961-76.
(Vertaald uit het Frans) Bron : Synergies Européennes, Stocker Verlag (Graz), Nouvelles de Synergies Européennes, Novembre, 1994





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg