mardi, 26 mai 2009
Livres sur Nietzsche

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
Livres sur Nietzsche
Recensions de Robert Steuckers
Tarmo Kunnas, Nietzsches Lachen. Eine Studie über das Komische bei Nietzsche, Edition Wissenschaft & Literatur, München, 1982.
Le comique chez Nietzsche est un thème, pense le philosophe et essayiste polyglotte finlandais Tarmo Kunnas, qui n'a guère été exploré. C'est le pathos nietzschéen, son romantisme fougueux, bruyant, qui séduit d'emblée et capte les attentions. Rares sont les observateurs, bons connaisseurs de l'œuvre complète de Nietzsche, qui ont pu percevoir l'ironie cachée, le sourire dissimulé, qui se situe derrière les aphorismes tranchés, affirmateurs et romantiques. Nietzsche se sentait trop solitaire, trop menacé, pour se permettre un humour souverain, direct, immédiat, sans fard. Tarmo Kunnas explore toute l'œuvre de Nietzsche pour y repérer les éléments de satire, d'ironie, d'humour et de parodie. Il nous révèle les mutations, les glissements qui se sont produits subrepticement depuis sa jeunesse idéaliste jusqu'à la veille de sombrer dans la folie.
Tarmo Kunnas, Politik als Prostitution des Geistes. Eine Studie über das Politische bei Nietzsche, Edition Wissenschaft & Literatur, München, 1982.
Nietzsche a été politisé, mobilisé par des partisans, mis au service des causes les plus diverses. Pour Tarmo Kunnas, Nietzsche est plutôt «anti-politique», hostile à l'emprise croissante du politique sur les esprits. Méticuleusement, il analyse la critique du système partitocratique chez Nietzsche, ses tendances anti-démocratiques, ses propensions à l'aristocratisme, son refus de l'idéologème «progrès», son anti-socialisme, son anti-capitalisme, son anti-militarisme et, finalement, les rapports entre Nietzsche et le nationalisme, entre Nietzsche et le racisme (l'anti-sémitisme).
Richard Maximilian Lonsbach, Friedrich Nietzsche und die Juden. Ein Versuch (zweite, um einen Anhang und ein nachwort erweiterte Auflage), herausgegeben von Heinz Robert Schlette, Bouvier Verlag / Herbert Grundmann, Bonn, 1985.
R. M. Lonsbach est le pseudonyme de R. M. Cahen, avocat israëlite de Cologne, émigré en Suisse en 1937, revenu dans sa ville natale en 1948. Cahen/Lonsbach était un admirateur de Nietzsche et son petit livre, aujourd'hui réédité, est une réfutation radicale des thèses qui font de Nietzsche un antisémite rabique. Ecrit dans l'immédiat avant-guerre, en 1939, ce livre a enregistré un franc succès dans les milieux de l'émigration allemande, ainsi qu'en Pologne, aux Pays-Bas et en Scandinavie. Il réfutait anticipativement toutes les théories de notre après-guerre qui ont démonisé Nietzsche. C'est en ce sens que cet ouvrage est un document indispensable. Malgré l'ambiance anti-nietzschéenne de l'Allemagne américanisée, Lonsbach/Cahen ne modifia pas sa position d'un iota et réaffirma ses thèses lors d'une émission radiophonique en 1960. Le texte de cette émission est également reproduit dans ce volume édité par H. R. Schlette.
Henry L. Mencken, The Philosophy of Friedrich Nietzsche, The Noontide Press, Torrance (California), 1982 (reprint of the first edition of 1908).
Journaliste brillant, fondateur de l'American Mercury, auteur d'un livre vivant sur la langue anglo-américaine, Henry L. Mencken, dont l'ampleur de la culture générale était proverbiale, écrivit également un essai sur Nietzsche en 1908. Pour l'Américain Mencken, Nietzsche est un transgresseur, sa pensée constitue l'antidote par excellence au sentimentalisme démobilisateur qui exerçait ses ravages à la fin du XIXème siècle. Mencken admire l'individualisme de Nietzsche, son courage de rejetter les modes et les dogmes dominants. Curieusement, Mencken croit repèrer un dualisme chez Nietzsche: celui qui opposerait un dyonisisme à un apollinisme, où le dyonisisme serait vitalité brute et l'apollinisme, vitalité de «seconde main», une vitalité dressée par les convenances. Les castes de maîtres seraient ainsi dyonisiennes, tandis que les castes d'esclaves seraient apolliniennes, parce qu'elles soumettent leur vitalité au diktat d'une morale. Cette interpétation est certes totalement erronée mais nous renseigne utilement sur la réception américaine de l'œuvre de Nietzsche. Dans le chef de Mencken, la pensée de Nietzsche devait compléter et amplifier celles de Darwin et Huxley, dans l'orbite d'un univers intellectuel anglo-saxon dominé par l'antagonisme entre l'«individualisme» de l'auto-conservation et l'«humanitarisme» du christianisme moral.
Mihailo Djuric und Josef Simon (Hrsg.), Kunst und Wissenschaft bei Nietzsche, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1986.
Ouvrage collectif sur l'esthétisme nietzschéen, ce volume contient un article centré sur l'histoire des idées de Descartes à Nietzsche, chez qui les concepts traditionnels d'«imagination» et d'«intuition» acquièrent progressivement une dimension entièrement nouvelle (Tilman Borsche: Intuition und Imagination. Der erkenntnistheoretische Perspektivenwechsel von Descartes zu Nietzsche). Mihailo Djuric évoque longuement la fusion de la pensée et de la poésie dans le Zarathoustra (Denken und Dichten in "Zarathustra"). Diana Behler passe au crible la métaphysique de l'artiste ébauchée par Nietzsche (Nietzsches Versuch einer Artistenmetaphysik). Goran Gretic étudie, quant à lui, la problématique de la vie et de l'art, dans laquelle se repère le renversement proprement nietzschéen: la métaphysique se fonde dans l'homme; donc, le chemin de la pensée ne passe pas nécessairement par l'homme pour accéder à l'Etre mais va de l'homme à l'homme.
Josef Simon (Hrsg.), Nietzsche und die philosophische Tradition, Band I u. II, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1985.
Deux volumes comprenant dix études sur Nietzsche. Parmi celles-ci, un essai de Volker Gerhardt sur le «devenir» dans la pensée de Nietzsche (Die Metaphysik des Werdens. Über ein traditionelles Element in Nietzsches Lehre vom "Wille zur Macht"); une étude de Tilman Borsche sur le redécouverte des présocratiques chez Nietzsche (Nietzsches Erfindung der Vorsokratiker). Le Japonais Kogaku Arifuku compare, lui, les fondements du bouddhisme, dont la vision du vide (sunyata), avec la définition nietzschéenne du nihilisme (Der aktive Nihilismus Nietzsches und der buddhistische Gedanke von sunyata [Leerheit]). Günter Abel analyse la philosophie de Nietzsche au départ d'une réinvestigation de l'héritage nominaliste (Nominalismus und Interpretation. Die Überwindung der Metaphysik im Denken Nietzsches). Abel définit le nominalisme comme une vision du monde qui perçoit celui-ci comme un monde d'individualités, où aucun «universel» n'a d'assise solide, où les principes doivent être manipulés avec parcimonie si l'on ne veut pas choir dans les «schémas» déréalisants, où les assertions doivent se référer à un «contexte» précis; ce monde-là, enfin, est fait, de finitudes concrètes, non d'infinitudes transcendantes. Josef Simon étudie, lui, le concept de liberté chez Nietzsche (Ein Geflecht praktischer Begriffe. Nietzsches Kritik am Freiheitsbegriff der philosophischen Tradition).
Mihailo Djuric u. Josef Simon (Hrsg.), Zur Aktualität Nietzsches, Band I u. II, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1984.
Onze textes magistraux, consacrés au visionnaire de Sils-Maria. Dont celui de Günter Eifler sur les interprétations françaises contemporaines de l'œuvre de Nietzsche (Zur jüngeren französischen Nietzsche-Rezeption). Mihailo Djuric se penche sur la question du nihilisme (Nihilismus als ewige Wiederkehr des Gleichen). Branko Despot démontre avec un extraordinaire brio comment le temps, la temporalité, suscite la «volonté de puissance». La vie, qui est «devenir», ne connait aucune espèce d'immobilité, mais le «déjà-advenu» impose des critères qui ne peuvent pas être ignorés, comme si le «déjà-advenu» n'avait jamais, un jour, fait irruption sur la trame du devenir et n'y avait pas laissé son empreinte. Dans la lutte «agonale», le surhomme doit affronter les aléas nouveaux et les legs épars du passé, vestiges incontournables. Le temps est donc lui-même volonté de puissance, puisque l'homme (ou le surhomme) doit se soumettre à ses diktats et épouser ses caprices, se lover dans leurs méandres (B.D., Die Zeit als Wille zur Macht). Tassos Bougas s'interroge sur le retour au monde préconisé par Nietzsche (Nietzsche und die Verweltlichung der Welt); son objectif, c'est de repérer les étapes de cette immanentisation et de dresser le bilan de la contribution nietzschéenne à ce processus, à l'œuvre depuis l'aurore des temps modernes (T.B., Nietzsche und die Verweltlichung der Welt). Friedrich Kaulbach et Volker Gerhardt se préoccupent de l'esthétisme nietzschéen et de sa «métaphysique de l'artiste» (F.K., Ästhetische und philosophische Erkenntnis beim frühen Nietzsche; V.G., Artisten-Metaphysik. Zu Nietzsches frühem Programm einer ästhetischen Rechtfertigung der Welt).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne, nietzsche, livres |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 mai 2009
Bibliographie nietzschéenne contemporaine

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987
Bibliographie nietzschéenne contemporaine
par Robert Steuckers
Francesco Ingravalle, Nietzsche illuminista o illuminato?, Edizioni di Ar, Padova, 1981.
Une promenade rigoureuse à travers la jungle des interprétations de l'œuvre du solitaire de Sils-Maria. Dans son chapitre V, Ingravalle aborde les innovations contemporaines de Robert Reininger, Gianni Vattimo, Walter Kaufmann, Umberto Galimberti, Gilles Deleuze, Eugen Fink, Massimo Cacciari, Ferruccio Masini, Alain de Benoist, etc.
Friedrich Kaulbach, Sprachen der ewigen Wiederkunft. Die Denksituationen des Philosophen Nietzsche und ihre Sprachstile, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1985.
Dans ce petit ouvrage, Kaulbach, une des figures de proue de la jeune école nietzschéenne de RFA, aborde les étapes de la pensée de Nietzsche. Au départ, cette pensée s'exprime, affirme Kaulbach, par «un langage de la puissance plastique». Ensuite, dans une phase dénonciatrice et destructrice de tabous, la pensée nietzschéenne met l'accent sur «un langage de la critique démasquante». Plus tard, le style du langage nietzschéen devient «expérimental», dans le sens où puissance plastique et critique démasquante fusionnent pour affronter les aléas du monde. En dernière instance, phase ultime avant l'apothéose de la pensée nietzschéenne, survient, chez Nietzsche, une «autarcie de la raison perspectiviste». Le summum de la démarche nietzschéenne, c'est la fusion des quatre phases en un bloc, fusion qui crée ipso facto l'instrument pour dépasser le nihilisme (le fixisme de la frileuse «volonté de vérité» comme «impuissance de la volonté à créer») et affirmer le devenir. Le rôle du «Maître», c'est de pouvoir manipuler cet instrument à quatre vitesses (les langages plastique, critique/démasquant, expérimental et l'autarcie de la raison perspectiviste).
Pierre Klossowski, Nietzsche und der Circulus vitiosus deus, Matthes und Seitz, München, 1986.
L'édition allemande de ce profond travail de Klossowski sur Nietzsche est tombée à pic et il n'est pas étonnant que ce soit la maison Matthes & Seitz qui l'ait réédité. Résolument non-conformiste, désireuse de briser la dictature du rationalisme moraliste imposé par l'Ecole de Francfort et ses émules, cette jeune maison d'édition munichoise, avec ses trois principaux animateurs, Gerd Bergfleth, Axel Matthes et Bernd Mattheus, estime que la philosophie, si elle veut cesser d'être répétitive du message francfortiste, doit se replonger dans l'humus extra-philosophique, avec son cortège de fantasmes et d'érotismes, de folies et de pulsions. Klossowski répond, en quelque sorte, à cette attente: pour lui, la pensée impertinente de Nietzsche tourne autour d'un axe, celui de son «délire». Cet «axe délirant» est l'absolu contraire de la «théorie objective» et signale, de ce fait, un fossé profond, séparant la nietzschéité philosophique des traditions occidentales classiques. L'axe délirant est un unicum, non partagé, et les fluctuations d'intensité qui révolutionnent autour de lui sont, elles aussi, uniques, comme sont uniques tous les faits de monde. Cette revendication de l'unicité de tous les faits et de tous les êtres rend superflu le fétiche d'une raison objective, comme, politiquement, le droit à l'identité nationale et populaire, rend caduques les prétentions des systèmes «universalistes». Le livre de Klossowski participe ainsi, sans doute à son insu, à la libération du centre de notre continent, occupé par des armées qui, en dernière instance, défendent des «théories objectives» et interdisent toutes «fluctuations d'intensité».
Giorgio Penzo, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando Editore, Roma, 1987.
On sait que la légende de Nietzsche précurseur du national-socialisme a la vie dure. Pire: cette légende laisse accroire que Nietzsche est le précurseur d'un national-socialisme sado-maso de feuilleton, inventé dans les officines de propagande rooseveltiennes et relayé aujourd'hui, quarante ans après la capitulation du IIIème Reich, par les histrions des plateaux télévisés ou les tâcherons de la presse parisienne, désormais gribouillée à la mode des feuilles rurales du Middle West. Girogio Penzo, professeur à Padoue, met un terme à cette légende en prenant le taureau par les cornes, c'est-à-dire en analysant systématiquement le téléscopage entre Nietzsche et la propagande nationale-socialiste. Cette analyse systématique se double, très heureusement, d'une classification méticuleuse des écoles nationales-socialistes qui ont puisé dans le message nietzschéen. Enfin, on s'y retrouve, dans cette jungle où se mêlent diverses interprétations, richissimes ou caricaturales, alliant intuitions géniales (et non encore exploitées) et simplismes propagandistes! Penzo étudie la formation du mythe du surhomme, avec ses appréciations positives (Eisner, Maxi, Steiner, Riehl, Kaftan) et négatives (Türck, Ritschl, v. Hartmann, Weigand, Duboc). Dans une seconde partie de son ouvrage, Penzo se penche sur les rapports du surhomme avec les philosophies de la vie et de l'existence, puis, observe son entrée dans l'orbite du national-socialisme, par le truchement de Baeumler, de Rosenberg et de certains protagonistes de la «Konservative Revolution». Ensuite, Penzo, toujours systématique, examine le téléscopage entre le mythe du surhomme et les doctrines du germanisme mythique et politisé. Avec Scheuffler, Oehler, Spethmann et Müller-Rathenow, le surhomme nietzschéen est directement mis au service de la NSDAP. Avec Mess et Binder, il pénètre dans l'univers du droit, que les nazis voulaient rénover de fond en comble. A partir de 1933, le surhomme acquiert une dimension utopique (Horneffer), devient synonyme d'«homme faustien» (Giese), se fond dans la dimension métaphysique du Reich (Heyse), se mue en prophète du national-socialisme (Härtle), se pose comme horizon d'une éducation biologique (Krieck) ou comme horizon de valeurs nouvelles (Obenauer), devient héros discipliné (Hildebrandt), figure anarchisante (Goebel) mais aussi expression d'une maladie existentielle (Steding) ou d'une nostalgie du divin (Algermissen). Un tour d'horizon complet pour dissiper bon nombre de malentendus...
Holger Schmid, Nietzsches Gedanke der tragischen Erkenntnis, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1984.
Une promenade classique dans l'univers philosophique nietzschéen, servie par une grande fraîcheur didactique: telle est l'appréciation que l'on donnera d'emblée à cet petit livre bien ficelé d'Holger Schmid. Le chapitre IV, consacré à la «métaphysique de l'artiste», magicien des modes de penser antagonistes, dont le corps est «geste» et pour qui il n'y a pas d'«extériorité», nous explique comment se fonde une philosophie foncièrement esthétique, qui ne voit de réel que dans le geste ou dans l'artifice, le paraître, suscité, produit, secrété par le créateur. Dans ce geste fondateur et créateur et dans la reconnaissance que le transgresseur nietzschéen lui apporte, le nihilisme est dépassé car là précisément réside la formule affirmative la plus sublime, la plus osée, la plus haute.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nietzsche, allemagne, livre, bibliographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 mars 2009
Frédéric Nietzsche et ses héritiers
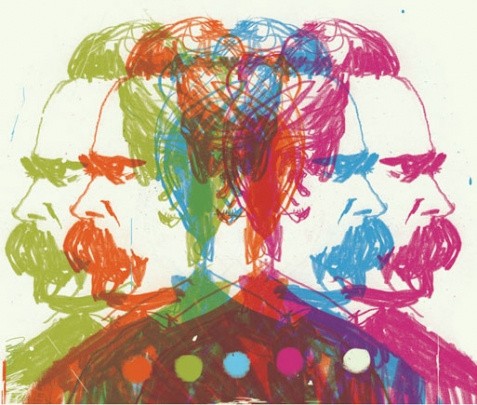
Frédéric Nietzsche et ses héritiers
(Intervention de Robert Steuckers - Université d'été de la FACE - 1995)
L'inpact de Nietzsche est immense: on ne peut remplacer la lecture de Nietzsche par une simple doxa, mais si l'on fait de l'histoire des idées politiques, on est obligé de se pencher sur les opinions qui mobilisent les élites activistes. L'objet de cet exposé n'est donc pas de faire de la philosophie mais de procéder à une doxanalyse du nietzschéisme politisé. Nous allons donc passer en revue les opinions qui ont été dérivées de Nietzsche, tant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique. Nietzsche est présent partout. Il n'y a pas un socialisme, un anarchisme, un nationalisme qui n'ait pas reçu son influence. Par conséquent, si l'on maudit Nietzsche, comme cela arrive à intervalles réguliers, si l'on veut expurger tel ou tel discours de tout nietzschéisme, si l'on veut pratiquer une “correction politique” anti-nietzschéenne, on sombre dans le ridicule ou le paradoxe. On en a eu un avant-goût il y a deux ans quand un quarteron de cuistres parisiens a cru bon de s'insurger contre un soi-disant rapprochement entre “rouges” et “bruns”: si rapprochement il y avait eu, il aurait pu tout bonnement se référer à du déjà-vu, à des idées nées quand socialistes de gauches et pré-fascistes communiaient dans la lecture de Nietzsche.
L'an passé, pour le 150ième anniversaire de la naissance de Frédéric Nietzsche, un chercheur américain Steven A. Aschheim a publié un ouvrage d'investigation majeur sur les multiples impacts de Nietzsche sur la pensée allemande et européenne, The Nietzsche Legacy in Germany 1890-1990 (California University Press). Etudier les impacts de la pensée de Nietzsche équivaut à embrasser l'histoire culturelle de l'Allemagne dans son ensemble. Il y a une immense variété d'impulsions nietzschéennes: nous nous bornerons à celles qui ont transformé les discours politiques des gauches et des droites.
Steven Aschheim critique les interprétations du discours nietzschéen qui postulent justement que Nietzsche a été “mésinterprété”. Il cite quelques exemples: l'école de Walter Kaufmann, traducteur américain de l'œuvre de Nietzsche. Kaufmann estime que Nietzsche a été “droitisé”, au point de refléter l'idéologie des castes dominantes de l'Allemagne wilhelmienne. Or celles-ci conservent une idéologie chrétienne, essentiellement protestante, qui voit d'un assez mauvais oeil la “philosophie au marteau” qui démolit les assises du christianisme. Le professeur anglais Hinton Thomas, lui, a publié un ouvrage plus pertinent, dans le sens où il constate que Nietzsche est bien plutôt réceptionné à la fin du 19ième siècle par des dissidents, des radicaux, des partisans, des libertaires, des féministes, bref, des transvaluateurs et non pas des conservateurs frileux ou hargneux.
Nietzsche est donc d'abord un philosophe lu par les plus turbulents des sociaux-démocrates, par les socialistes les plus radicaux et les plus intransigeants. Ces hommes et ces femmes manifestent leur insatisfaction face à l'orthodoxie marxiste du parti social-démocrate, où le marxisme devient synonyme de socialisme procédurier, sclérosé, bureaucratique. Les socialistes allemandes les plus fougueux rejettent la filiation “Hegel-Marx-Sociale-Démocratie”. L'itinéraire de Mussolini est instructif à cet égard. De même, la correspondante du journal L'Humanité, Isadora Duncan, en publiant des articles apologétiques sur la révolution russe, écrit, en 1920, que cette révolution réalisent les idéaux et les espoirs de Beethoven, Nietzsche et Walt Whitman. Aucune mention de Marx.
Ces socialistes radicaux voulaient en finir avec la “superstructure”. Ils pensaient pouvoir mieux la démolir avec des arguments tirés de Nietzsche qu'avec des arguments tirés de Marx ou d'Engels. Les jeunes sociaux-démocrates regroupés autour de Die Jungen, la revue de Bruno Wille, l'idéologue Gustav Landauer critiquent les pétrifications du parti et exaltent la fantaisie créatrice. La féministe Lily Braun s'oppose à toutes les formes de dogmatisme, vote les crédits de guerre contre le knout du tsarisme, le bourgeoisisme français et le capitalisme anglais, et finit, comme Mussolini, par devenir nationaliste. De même le pasteur non-conformiste Max Maurenbrecher évolue de la sociale-démocratie aux communautés religieuses libres, dégagées des structures confessionnelles, et de celles-ci à un nationalisme ferme mais modéré.
Après 1918, la gauche ne cesse pas de recourir à Nietzsche. Ainsi, Ernst Bloch, futur conseiller de Rudy Dutschke qui finissait par théoriser un national-marxisme, dérive une bonne part de sa méthodologie de Nietzsche. Marcuse, en se réclamant de l'Eros, critique la superstructure idéologique de la civilisation occidentale.
Mais les conformistes de la gauche n'ont jamais accepté ces “dérives indogmatisables”. Dès le début du siècle, un certain Franz Mehring ne cesse de rappeler les jeunes amis de Bruno Wille à la “raison”. Kurt Eisner, qui avait pourtant aimé Nietzsche, rédige un premier manuel d'exorcisme en 1919. Plus tard, Georg Lukacs abjure à son tour l'apport de Nietzsche, alors qu'il en avait été compénétré. Plus récemment, Habermas tente d'expurger tous les linéaments de nietzschéisme dans le discours de l'école de Francfort et de ses épigones. En France, Luc Ferry et Alain Renaut tente de liquider le nietzschéisme français incarné par Deleuze et Foucault, sous prétexte qu'il prône le vitalisme contre le droit. Toutes les manifestations de “political correctness” depuis le début du siècle ont pour caractéristique commune de vouloir éradiquer les apports de Nietzsche. Vaine tentative. Toujours vouée à l'échec.
(résumé de Catherine NICLAISSE).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : philosophie, allemagne, révolution conservatrice, nietzsche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 février 2009
Nietzsche on Friendship and on the Tragedy of Life
Nietzsche on friendship and on the ‘tragedy of life’
Ex: http://faustianeurope.wordpress.com/
 ‘Friendship’ is something to which we all probably would nod and we would say that we fully understand what is meant by it, but do we? Who are these ‘friends’ we think are around us? What do they mean to us and do these ‘friends’ of today really differ from people we only ‘know better’ and or to whom we ‘talk more’ than with random people we daily meet? These might sound like silly questions to ask, really, however, when the phenomenon of Facebooks, Myspace etc. strikes daily the news and journalists often mention that people have tens or even hundreds ‘friends’ on their profiles, I believe it is never useless to stop and wonder for a moment.
‘Friendship’ is something to which we all probably would nod and we would say that we fully understand what is meant by it, but do we? Who are these ‘friends’ we think are around us? What do they mean to us and do these ‘friends’ of today really differ from people we only ‘know better’ and or to whom we ‘talk more’ than with random people we daily meet? These might sound like silly questions to ask, really, however, when the phenomenon of Facebooks, Myspace etc. strikes daily the news and journalists often mention that people have tens or even hundreds ‘friends’ on their profiles, I believe it is never useless to stop and wonder for a moment.
Quite interestingly, I would like to point out to perhaps the most unexpected person who considered friendship in his work - to Friedrich Nietzsche. He, just as the voluntarist Schopenhauer before him, had almost no friends at all. Suffering from constant health problems – migraine headaches and vomiting, this brilliant intellectual had to resign from the post of professor at the University of Basle, which he received at unheard age of 24, and in 1879 started to travel around Europe, seeking seclusion and peace from his collapsing health near mountain lakes deep in the Alps.
In earlier days of his writing career, Nietzsche was a friend and admirer of the work of Richard Wagner. Nietzsche saw in Wagner’s opera Tristan und Isolde (1865) the possible resurrection of the antic tragedy. The Greek tragedy was for Nietzsche especially important because he regarded it as an ‘honest depiction of human life.’ That is, as a piece of art that depicts each person as born with certain qualities, but also possessing the ‘tragic flaw,’ which gives him a destiny that he cannot escape. Although in the Greek tragedy characters struggle with their predestined path, by each step they inadvertently proceed towards their certain end.
This is perhaps best depicted in Sophocles’ Oedipus Rex, where Oedipus is given a terrible predicament – he is to marry his mother and kill his father. The tragic flaw in case of Oedipus is hubris – and although that when he hears his terrible fate from the Delphic Oracle and tries to flee from the place where his (foster) parents live, escaping, he kills his father Laius – only because they argue who has the right-of-way.
Nevertheless, heroes of the antic tragedy – although endowed with the tragic fate – are not content with it, and they struggle till the very end. As Nietzsche mentions in The Birth of Tragedy this is a ‘honest’ image of what life is – tragic.
One is born into a condition one does not chooses. He is endowed with certain predispositions, born into a certain family, into a specific community, which make tremendous impact on one’s identity – on the fact ‘who one is.’ The ancient Greeks personified this human precondition as ‘given’ by three Moirae – the personifications of destiny. The ancient hero, however, is the one who, although endowed with both flaws and qualities, does not ‘give up’ and fights his destiny and although never wins (the human life can never be won, the human life is tragic, it always ends in death which can never be avoided) he understands that ‘there are moments and things worth living (and dying) for.’
In his later works, Nietzsche elaborates further; when one considers great heroes as Beethoven, Goethe or Napoleon, they were all both endowed with certain flaws, no one of them was ‘perfect,’ but they all, above all, were in their specific fields great ‘warriors,’ who stood against the human fate and managed to push the meaning of living to a completely another, greater level – they set example for others and in their fight found what ‘they are’ – what to be living for them truly means. They found that it is precisely this fight, this totality of all things – both living and dying, both flaws and qualities, both joy and sadness, both victories and failures – what life is. That life is beautiful – and interesting – and worth living for – because above all, to be a human means a tremendous possibility, a challenge – to understand one’s flaws and qualities and on them build one’s work – one’s fate. For Nietzsche, life is an art, a Greek tragedy. And it is precisely this fact that life is tragic – which makes is beautiful. For Nietzsche, and for the ancient Greeks, the life ‘makes sense’ only when understood in this highly artistic sense.
As to Richard Wagner – and to the opera Tristan und Isolde Nietzsche so admired, one could now perhaps better understand why Nietzsche praised Wagner as a cultural prodigy. Nietzsche saw in earlier Wagner’s work a possibility how to restore the tragic understanding of life, back into the contemporary society which elevated only the Christian reverence and its preaching that man is born from sin and that he can only achieve ‘happiness’ in the afterlife. The Christians, Nietzsche maintains, do not understand what life is, they are in fact, the life’s failures, to weak to conceive of life as the totality of all values – as both struggle and peace, as both birth and death and so on. They instead would like to live in ‘eternal happiness and peace,’ which is a non-sense Nietzsche argues; since happiness cannot exist without sadness, as sadness cannot without happiness. Just as well as life entails death, also death is necessary to give life to next generations. Each exists only in relation to the opposite. The weak would be even unable to consider, Nietzsche argues, that life consisting only of ‘happiness’ would be too boring to live. Indeed, for the strong, for the type of the antic hero, it is unimaginable to be living in the Christian heaven, in an eternal ‘peace and happiness.’ One might well say that what is the hell for the Christian, is the ‘heaven’ for a Nietzschean hero, because, quite simply, it would be much more fun.
The friendship between Wagner and Nietzsche nevertheless did not last long. Wagner more and more enclosed himself with a circle of German nationalists and instead of elevating Nietzsche’s untimely model of the Antic hero, Wagner became too narrowly German, and ultimately, with his final opera Parsifal, even a hypocrite. In Parsifal Wagner elevated the Christian piety, when he himself was an admirer of Nordic paganism. Nietzsche was nauseated by the fact that Wagner used something so alien to his (Wagner’s) beliefs only to promote the sense of German national history. Even then, Nietzsche stayed true to his beliefs, and although he despised its pseudo-Christian leitmotif, he admired the beauty of the music; in a letter to Peter Gast from 1887, he asks himself: ‘Has Wagner ever written anything better?’
It is then perhaps no wonder that for Nietzsche, the friendship has a very peculiar meaning. Today it is mostly understood that a friend is someone ‘who wants the best for you.’ Nietzsche considers this too shallow and his response is similar as in the case of the Christians who would like to live only in their ‘heaven.’ A true friend for Nietzsche is someone who by wishing you the ‘best’ wishes you ‘the worst,’ – struggle, strife, obstacles, fear, and ‘many good enemies.’ A friend for Nietzsche is not someone who accepts your every word and blindly follows in your steps or even someone who tries to ‘offer you a helping hand’ – this only promotes laziness, acceptance of one’s status, weakness and decadence. To wish truly one best also means to be in opposition, to propose contra-arguments, to go one’s own way and even destroy and fight against a friend’s plans. In the Nietzschean sense, the friend is the one ‘who wishes you to be strong.’ In contrast to a Christian who wishes you ‘heaven,’ that is meekness and decadence in otherworldly piety.
Consider also this assumption: what is for Nietzsche the difference between friend and enemy? One can easily derive from the above mentioned that there is no difference at all. Both friend and enemy is someone who you consider your equal. It is someone who you think is worth fighting against. From the fight, you both learn and ultimately strengthen your resolve. In fact, it might be said that ‘your best friend is also your best enemy, and your best enemy is your best friend.’ Similarly, Nietzsche mentions Christ’s ‘love thy enemy’ as a commendable principle to follow, but not in the ‘Christian sense.’ For Nietzsche, since love and hate are almost inseparable, the enemy, your antithesis, is also someone to be truly admired, because this enemy inevitably forms a part of ‘who you are,’ the enemy shows you a different side of the coin, and thus makes you stronger in the end.
In the end, one might and might not aggree, yet Nietzsche certainly provides a persuasive theory of friendship, especially in a time when it seems that friendship is being reduced to an artificial list of names available on an individual’s profile somewhere on the internet…
00:17 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nietzsche, allemagne, révolution conservatrice, amitié |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 février 2009
L'homme, une matière première
L'homme, une matière première
Trouvé sur: http://polemia.com
Heidegger, comme les anciens Grecs, définit l’homme essentiellement comme « mortel », comme « être-pour-la-mort », c’est-à-dire ouvert en permanence à la perspective de mourir, contrairement à l’animal qui, lui, « ne meurt pas mais périt ». Il renoue ainsi avec notre tradition qui remonte au Christianisme, mais antérieurement encore, à Platon notamment (voir le « Phédon »).
Notre rapport avec la mort cependant, dans la société occidentale moderne, ne cesse de se détériorer. La vie moderne, axée sur la consommation et le plaisir immédiat, cherche à effacer la mort de nos consciences. Lorsqu’elle survient, comme c’est le cas avec nos morts au champ d’honneur en Afghanistan, c’est un vrai scandale !
Quatre métiers, quatre « vocations » (le mot allemand « Beruf » pour métier comporte cette idée d’un « appel » du destin ; « Ruf » veut dire appel), comportent dans leur essence un rapport privilégié avec la mort : la médecine, la justice, l’armée et la fonction ecclésiastique. Les « pompes funèbres » sont un service commercial et n’entrent donc pas ici en ligne de compte ! Le médecin lutte contre la mort et il lui est interdit, selon une tradition qui remonte à Hippocrate (5e siècle avant JC) de donner la mort ès qualité de médecin. Le juge par contre, depuis l’aube de la civilisation jusqu’à quelques années en Europe, est habilité à donner la mort dans un certain nombre de cas précis. Le soldat a pour vocation de mourir pour la patrie et de donner la mort à l’ennemi. Le prêtre est présent à la fin de la vie et aide le mourant à « effectuer le passage ». Ce sont les quatre fonctions en rapport avec la mort et qui correspondent aux quatre pôles du quadriparti, ce monde de l’être qui fonde l’authenticité de notre existence selon Heidegger. Le médecin représente le pôle de la terre (la « cause matérielle » d’Aristote), le juge représente le « ciel » (la cause formelle, le devoir-être), le prêtre la divinité (la cause finale) et le soldat le monde des hommes (la cause motrice).
Dans notre monde moderne, ce monde est bouleversé et remplacé par un « immonde » selon la frappante formule du philosophe Jean-François Mattéi (voir son livre : « La barbarie intérieure » (1)) Le juge est désormais privé de son pouvoir de donner la mort. Il est éliminé. Le prêtre n’est plus convoqué que par les croyants qui sont une minorité, il est marginalisé. Le soldat meurt encore mais c’est très mal vu. La dimension militaire est évacuée le plus possible des valeurs de notre société marchande. L’héroïsme n’est plus une valeur directrice dans l’imaginaire social comme il l’a toujours été des épopées d’Homère (8e siècle avant notre ère) jusqu’à, disons, le culte des héros de la Résistance.
Par contre, le médecin dont la vocation était de lutter contre la mort au point de lui interdire de donner la mort (le serment d’Hippocrate des anciens Grecs interdit au médecin de pratiquer l’avortement), est appelé à la donner de plus en plus ! Non seulement par l’avortement mais par la possibilité de l’euthanasie qui rassemble de plus en plus de partisans !
Nous voilà donc dans un « monde à l’envers » en quelque sorte où le juge ne peut plus tuer mais où le médecin tuera de plus en plus fréquemment. Le prêtre et le soldat, quant à eux, sont appelés à disparaître, si le « progrès » continue sa route ! A quoi peuvent servir les prêtres, à quoi peuvent servir les soldats dans une société matérialiste de consommation ? Quel sens peut encore avoir le don de sa vie à autrui dans un monde qui plaide pour l’extension illimitée de l’ego et du plaisir immédiat ? Cette inversion des fonctions sociales devrait conduire nos compatriotes à s’interroger. Mais le conditionnement médiatique ne va pas dans ce sens. De plus en plus de pressions se font jour pour légitimer le rôle de tueur donné au médecin alors qu’une indignation générale se fait jour s’il s’agit de redonner au juge le pouvoir de donner la mort.
Le temps est venu où la prédiction de Nietzsche dans son « Ainsi parlait Zarathoustra » se réalise : Nietzsche dit que le monde moderne est celui des « derniers hommes qui ont inventé le bonheur ». « Idéal, amour, étoile, qu’est cela ? disent les derniers hommes. (…) Un peu de poison pour rendre la vie agréable (la drogue), beaucoup de poison pour la finir agréablement ». La mort comme façon de vivre plus agréablement (sans enfant non désiré, sans souffrance de la maladie) est la mort vue de façon « moderne », c’est-à-dire utilitariste. La mort est ainsi arraisonnée par le dispositif utilitaire (le « Gestell » de Heidegger (2)) qui domine notre vie sans que nous en ayons vraiment conscience. L’homme est de moins en moins un « mortel » conscient de sa condition tragique de finitude sur cette terre. Il devient la plus importante des matières premières au service du système techno-économique. Il perd ainsi sa liberté et son essence humaine largement à son insu.
Mais la réduction de la mort à un acte médical est revendiquée comme un progrès de l’humanisme ! La disparition de l’héroïsme des valeurs sociales directrice (héroïsme pourtant revendiqué notamment par toutes les Républiques précédentes) est considérée comme un progrès : rien ne doit s’opposer aux caprices de l’ego dans sa poursuite de la puissance et du plaisir ! La sécularisation matérialiste de la société est un progrès des Lumières ! L’homme est un animal et la raison est là pour satisfaire ses pulsions dans un cadre sécurisé !
On considère encore normal d’envoyer à la mort des jeunes gens honnêtes qui risquent leur vie pour le bien commun : soldats, policiers, pompiers ! Mais on est horrifié à l’idée de condamner à mort un monstre qui a torturé et assassiné une enfant ! Dans un monde où l’on ne croit plus guère au sacré, on affirme que la vie du grand criminel est sacrée et que l’homme ne peut avoir le pouvoir légal de la lui enlever ! Mais le flic ou le soldat peuvent crever car « c’est leur métier » : ils ont signé un contrat en ce sens ! Le criminel n’a pas signé de tel « contrat professionnel » donc sa vie ne peut être mise en jeu même s’il met en jeu la vie des autres ! Cette « idéologie du contrat » qui seule permet la « mort utile » n’est pas autre chose que la justification de l’opération qui consiste à faire de l’homme une matière première du système social dominant. On passe bien des contrats avec les fournisseurs de pétrole ! On peut perdre sa vie ou sa dignité pourvu que ce soit conformément à un « contrat » (le mot « contrat » est d’ailleurs valorisé chez les mafieux : pour éliminer un gêneur !)
Telle est la sensibilité de l’immonde moderne ! Elle est « sensible », ce qui n’empêche pas celle-ci d’être perverse ! Robespierre aussi était « sensible » ! Il expliquait qu’il fallait exterminer tous les Vendéens par pitié ! Par pitié pour la République ! En donnant aux médecins le monopole de donner la mort à l’avenir, ne créé-t-on pas cependant une « guillotine rampante » ?
Il est à souhaiter qu’un jour la liberté et la dignité de l’homme soient restaurés. Cela suppose certainement de retrouver un rapport « normal », noble et non ig-noble avec la mort !
Yvan BLOT
12/01/09
(©)Polémia
19/01/09
(1) Jean-François Mattéi,« La barbarie intérieure », puf, 2004, 334p.
http://www.polemia.com/article.php?id=1195
(2)Le « Gestell » ou « dispositif utilitaire » qui règle le monde
http://www.polemia.com/article.php?id=1818
Yvan Blot
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, anthropologie, grèce antique, nietzsche, heidegger |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 18 novembre 2008
L'impact de Nietzsche dans les milieux de gauche et de droite
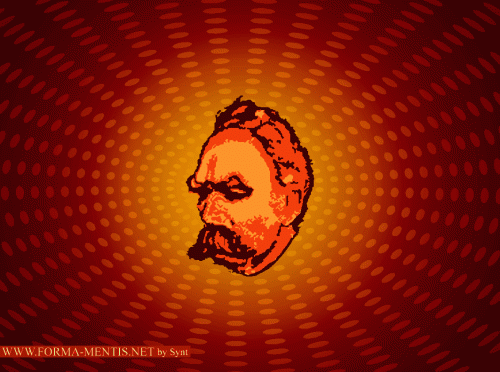
L'impact de Nietzsche dans les milieux politiques de gauche et de droite
par Robert STEUCKERS
Intervention lors de la 3ième Université d'été de la FACE, Provence, juillet 1995
Analyse:
-Steven E. ASCHHEIM, The Nietzsche Legacy in Germany. 1890-1990, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1992, 337 p., ill., ISBN 0-520-07805-5.
- Giorgio PENZO, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando Editore, Roma, 1987, 359 p., 25.000 Lire.
L'objet de mon exposé n'est pas de faire de la philosophie, d'entrer dans un débat philosophique, de chercher quelle critique adresse Nietzsche, par le biais d'un aphorisme cinglant ou subtil, à Aristote, à Descartes ou à Kant, mais de faire beaucoup plus simplement de l'histoire des idées, de constater qu'il n'existe pas seulement une droite ou un pré-fascisme ou un fascisme tout court qui dérivent de Nietzsche, mais que celui-ci a fécondé tout le discours de la sociale-démocratie allemande, puis des radicaux issus de cette gauche et, enfin, des animateurs de l'Ecole de Francfort. De nos jours, c'est la “political correctness” qui opère par dichotomies simplètes, cherche à cisailler à l'intérieur même des discours pour trier ce qu'il est licite de penser pour le séparer pudiquement, bigotement, de ce qui serait illicite pour nos cerveaux. C'est à notre sens peine perdue: Nietzsche est présent partout, dans tous les corpus, chez les socialistes, les communistes, les fascistes et les nationaux-socialistes, et, même, certains arguments nietzschéens se retrouvent simultanément sous une forme dans les théories communistes et sous une autre dans les théories fascistes.
La “political correctness”, dans sa mesquinerie, cherche justement à morceler le nietzschéisme, à opposer ses morceaux les uns aux autres, alors que la fusion de toutes les contestations à assises nietzschéennes est un impératif pour le XXIième siècle. La fusion de tous les nietzschéismes est déjà là, dans quelques cerveaux non encore politisés: elle attend son heure pour balayer les résidus d'un monde vétuste et sans foi. Mais pour balayer aussi ceux qui sont incapables de penser, à gauche comme à droite, sans ces vilaines béquilles conventionnelles que sont les manichéismes et les dualismes, opposant binairement, répétitivement, une droite figée à une gauche toute aussi figée.
La caractéristique majeure de cet impact ubiquitaire du nietzschéisme est justement d'être extrêmement diversifiée, très plurielle. L'œuvre de Nietzsche a tout compénétré. Méthodologiquement, l'impact de la pensée de Nietzsche n'est donc pas simple à étudier, car il faut connaître à fond l'histoire culturelle de l'Allemagne en ce XXième siècle; il faut cesser de parler d'un impact au singulier mais plutôt d'une immense variété d'impulsions nietzschéennes. D'abord Nietzsche lui-même est un personnage qui a évolué, changé, de multiples strates se superposent dans son œuvre et en sa personne même. Le Dr. Christian Lannoy, philosophe néerlandais d'avant-guerre, a énuméré les différents stades de la pensée nietzschéenne:
1er stade: Le pessimisme esthétique, comprenant quatre phases qui sont autant de passages: a) du piétisme (familial) au modernisme d'Emerson; b) du modernisme à Schopenhauer; c) de Schopenhauer au pessimisme esthétique proprement dit; d) du pessimisme esthétique à l'humanisme athée (tragédies grecques + Wagner).
2ième stade: Le positivisme intellectuel, comprenant deux phases: a) le rejet du pessimisme esthétique et de Wagner; b) l'adhésion au positivisme intellectuel (phase d'égocentrisme).
3ième stade: Le positivisme anti-intellectuel, comprenant trois phases: a) la phase poétique (Zarathoustra); b) la phase consistant à démasquer l'égocentrisme; c) la phase de la Volonté de Puissance (consistant à se soustraire aux limites des constructions et des constats intellectuels).
4ième stade: Le stade de l'Antéchrist qui est purement existentiel, selon la terminologie catholique de Lannoy; cette phase terminale consiste à se jeter dans le fleuve de la Vie, en abandonnant toute référence à des arrière-mondes, en abandonnant tous les discours consolateurs, en délaissant tout Code (moral, intellectuel, etc.).
Plus récemment, le philosophe allemand Kaulbach, exégète de Nietzsche, voit six types de langage différents se succéder dans l'œuvre de Nietzsche: 1. Le langage de la puissance plastique; 2. Le langage de la critique démasquante; 3. Le style du langage expérimental; 4. L'autarcie de la raison perspectiviste; 5. La conjugaison de ces quatre premiers langages nietzschéens (1+2+3+4), contribuant à forger l'instrument pour dépasser le nihilisme (soit le fixisme ou le psittacisme) pour affronter les multiples facettes, surprises, imprévus et impondérables du devenir; 6. L'insistance sur le rôle du Maître et sur le langage dionysiaque.
Ces classifications valent ce qu'elles valent. D'autres philosophes pourront déceler d'autres étapes ou d'autres strates mais les classifications de Lannoy et Kaulbach ont le mérite de la clarté, d'orienter l'étudiant qui fait face à la complexité de l'œuvre de Nietzsche. L'intérêt didactique de telles classifications est de montrer que chacune de ces strates a pu influencer une école, un philosophe particulier, etc. De par la multiplicité des approches nietzschéennes, de multiples catégories d'individus vont recevoir l'influence de Nietzsche ou d'une partie seulement de Nietzsche (au détriment de tous les autres possibles). Aujourd'hui, on constate en effet que la philosophie, la philologie, les sciences sociales, les idéologies politiques ont receptionné des bribes ou des pans entiers de l'œuvre nietzschéenne, ce qui oblige les chercheurs contemporains à dresser une taxinomie des influences et à écrire une histoire des réceptions, comme l'affirme, à juste titre, Steven E. Aschheim, un historien américain des idées européennes.
Nietzsche: mauvais génie ou héraut impavide?
Aschheim énumère les erreurs de l'historiographie des idées jusqu'à présent:
- Ou bien cette historiographie est moraliste et considère Nietzsche comme le “mauvais génie” de l'Allemagne et de l'Europe, “mauvais génie” qui est tour à tour “athée” pour les catholiques ou les chrétiens, “pré-fasciste ou pré-nazi” pour les marxistes, etc.
- Ou bien cette historiographie est statique, dans ses variantes apologétiques (où Nietzsche apparaît comme le “héraut” du national-socialisme ou du fascisme ou du germanisme) comme dans ses variantes démonisantes (où Nietzsche reste constamment le mauvais génie, sans qu'il ne soit tenu compte des variations dans son œuvre ou de la diversité de ses réceptions).
Or pour juger la dissémination de Nietzsche dans la culture allemande et européenne, il faut: 1. Saisir des processus donc 2. avoir une approche dynamique de son œuvre.
Le bilan de cette historiographie figée, dit Aschheim, se résume parfaitement dans les travaux de Walter Kaufmann et d'Arno J. Mayer. Walter Kaufmann démontre que Nietzsche a été mésinterprété à droite par sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche, par Stefan George, par Ernst Bertram et Karl Jaspers. Mais aussi dans le camp marxiste après 1945, notamment par Georg Lukacs, communiste hongrois, qui a dressé un tableau général de ce qu'il faut abroger dans la pensée européenne, ce qui revient à rédiger un manuel d'inquisition, dont s'inspirent certains tenants actuels de la “political correctness”. Lukacs accuse Nietzsche d'irrationalité et affirme que toute forme d'irrationalité conduit inéluctablement au nazisme, d'où tout retour à Nietzsche équivaut à recommencer un processus “dangereux”. L'erreur de cette interprétation c'est de dire que Nietzsche ne suscite qu'une seule trajectoire et qu'elle est dangereuse. Cette vision est strictement linéaire et refuse de dresser une cartographie des innombrables influences de Nietzsche.
Arno J. Mayer rappelle que Nietzsche a été considéré par certains exégètes marxisants comme le héraut des classes aristocratiques dominantes en Allemagne à la fin du XIXième siècle. L'insolence de Nietzsche aurait séduit les plus turbulents représentants de cette classe sociale. Aschheim estime que cette thèse est une erreur d'ordre historique. En effet, l'aristocratie dominante, à cette époque-là en Allemagne, est un milieu plutôt hostile à Nietzsche. Pourquoi? Parce que l'anti-christianisme de Nietzsche sape les assises de la société qu'elle domine. L'“éthique aristocratique” de Nietzsche est fondamentalement différente de celle des classes dominantes de la noblesse allemande du temps de Bismarck. Par conséquent, Nietzsche est jugé “subversif, pathologique et dangereux”. La “droite” (en l'occurrence la “révolution conservatrice”) ne l'utilisera surtout qu'après 1918.
Les “transvaluateurs”
Hinton Thomas, historien anglais des idées européennes, constate effectivement que Nietzsche est réceptionné essentiellement par des dissidents, des radicaux, des partisans de toutes les formes d'émancipation, des socialistes (actifs dans la social-démocratie), des anarchistes et des libertaires, par certaines féministes. Thomas nomme ces dissidents des “transvaluateurs”. La droite révolutionnaire allemande, post-conservatrice, se posera elle aussi comme “transvaluatrice” des idéaux bourgeois, présents dans l'Allemagne wilhelmienne et dans la République de Weimar. Hinton Thomas concentre l'essentiel de son étude aux gauches nietzschéennes, en n'oubliant toutefois pas complètement les droites. Son interprétation n'est pas unilatérale, dans le sens où il explore deux filons de droite où Nietzsche n'a peut-être joué qu'un rôle mineur ou, au moins, un rôle de repoussoir: l'Alldeutscher Verband (la Ligue Pangermaniste) et l'univers social-darwiniste, plus particulièrement le groupe des “eugénistes”.
En somme, on peut dire que Nietzsche rejette les systèmes, son anti-socialisme est un anti-grégarisme mais qui est ignoré, n'est pas pris au tragique, par les militants les plus originaux du socialisme allemand de l'époque. Les intellectuels sociaux-démocrates s'enthousiasment au départ pour Nietzsche mais dès qu'ils établissent dans la société allemande leurs structures de pouvoir, ils se détachent de l'anarchisme, du criticisme et de la veine libertaire qu'introduit Nietzsche dans la pensée européenne. La social-démocratie cesse d'être pleinement contestatrice pour participer au pouvoir. Roberto Michels appelera ce glissement dans les conventions la Verbonzung, la “bonzification”, où les chefs socialistes perdent leur charisme révolutionnaire pour devenir les fonctionnaires d'une mécanique partitocratique, d'une structure sociale participant en marge au pouvoir. Seuls les libertaires comme Landauer et Mühsam demeurent fidèles au message nietzschéen. Enfin, au-delà des clivages politiques usuels, Nietzsche introduit dans la pensée européenne un “style” (qui peut toujours s'exprimer de plusieurs façons possibles) et une notion d'“ouverture”, impliquant, pour ceux qui savent reconnaître cette ouverture-au-monde et en tirer profit, une dynamique permanente d'auto-réalisation. L'homme devient ce qu'il est au fond de lui-même dans cette tension constante qui le porte à aller au-devant des défis et des mutations, sans frilosité rédhibitoire, sans nostalgies incapacitantes, sans rêves irréels.
Enfin, Nietzsche a été lu majoritairement par les socialistes avant 1914, par les “révolutionnaires-conservateurs” (et éventuellement par les fascistes et les nationaux-socialistes) après 1918. Aujourd'hui, il revient à un niveau non politique, notamment dans le “nietzschéisme français” d'après 1945.
L'impact de Nietzsche sur le discours socialiste avant 1914 en Allemagne
En Allemagne, mais aussi ailleurs, notamment en Italie avec Mussolini, alors fougueux militant socialiste, ou en France, avec Charles Andler, Daniel Halévy et Georges Sorel, la philosophie de Nietzsche séduit principalement les militants de gauche. Mais non ceux qui sont strictement orthodoxes, comme Franz Mehring, que les nietzschéens socialistes considèrent comme le théoricien d'un socialisme craintif et procédurier, fort éloigné de ses tumultueuses origines révolutionnaires. Franz Mehring, gardien à l'époque de l'orthodoxie figée, évoque une stricte filiation philosophie —en dehors de laquelle il n'y a point de salut!— partant de Hegel pour aboutir à Marx et à la pratique routinière, sociale et parlementariste, de la sociale-démocratie wilhelminienne. Face à ce marxisme conventionnel et frileux, les gauches dissidentes opposent Nietzsche ou l'un ou l'autre linéament de sa philosophie. Ces gauches dissidentes conduisent à un anarchisme (plus ou moins dionysiaque), à l'anarcho-syndicalisme (un des filons du futur fascisme) ou au communisme. Ainsi, Isadora Duncan, une journaliste anglaise qui couvre, avec sympathie, les événements de la Révolution Russe pour L'Humanité, écrit en 1921: «Les prophéties de Beethoven, de Nietzsche, de Walt Whitman sont en train de se réaliser. Tous les hommes seront frères, emportés par la grande vague de libération qui vient de naître en Russie». On remarquera que la journaliste anglaise ne cite aucun grand nom du socialisme ou du marxisme! La gauche radicale voit dans la Révolution Russe la réalisation des idées de Beethoven, de Nietzsche ou de Whitman et non celles de Marx, Engels, Liebknecht (père), Plekhanov, Lénine, etc.
Pourquoi cet engouement? Selon Steven Aschheim, les radicaux maximalistes dans le camp des socialistes se réfèrent plus volontiers à la critique dévastatrice du bourgeoisisme (plus exactement: du philistinisme) de Nietzsche, car cette critique permet de déployer un “contre-langage”, dissolvant pour toutes les conventions sociales et intellectuelles établies, qui permettent aux bourgeoisies de se maintenir à la barre. Ensuite, l'idée de “devenir” séduit les révolutionnaires permanents, pour qui aucune “superstructure” ne peut demeurer longtemps en place, pour dominer durablement les forces vives qui jaillissent sans cesse du “fond-du-peuple”.
En fait, dès la fin de la première décennie du XXième siècle, la sociale-démocratie allemande et européenne subit une mutation en profondeur: les radicaux abandonnent les conventions qui se sont incrustées dans la pratique quotidienne du socialisme: en Allemagne, pendant la première guerre mondiale, les militants les plus décidés quittent la SPD pour former d'abord l'USPD puis la KPD (avec Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht); en Italie, une aile anarcho-syndicaliste se détache des socialistes pour fusionner ultérieurement avec les futuristes de Marinetti et les arditi revenus des tranchées, ce qui donne, sous l'impulsion de la personnalité de Mussolini, le syncrétisme fasciste; etc.
le socialisme: une révolte permanente contre les superstructures
Par ailleurs, dès 1926, l'Ecole de Francfort commence à déployer son influence: elle ne rejette pas l'apport de Nietzsche; après les vicissitudes de l'histoire allemande, du nazisme et de l'exil américain de ses principaux protagonistes, cette Ecole de Francfort est à l'origine de l'effervescence de mai 68. Dans toutes ces optiques, le socialisme est avant toutes choses une révolte contre les superstructures, jugées dépassées et archaïques, mais une révolte chaque fois différente dans ses démarches et dans son langage selon le pays où elle explose. A cette révolte socialiste contre les superstructures (y compris les nouvelles superstructures rationnelles et trop figées installées par la sociale-démocratie), s'ajoute toute une série de thématiques, comme celles de l'“énergie” (selon Schiller et surtout Bergson; ce dernier influençant considérablement Mussolini), de la volonté (que l'on oppose chez les dissidents radicaux du socialisme à la doctrine sociale-démocrate et marxiste du déterminisme) et la vitalité (thématique issue de la “philosophie de la Vie”, tant dans ses interprétations laïques que catholiques).
Une question nous semble dès lors légitime: cette évolution est-elle 1) marginale, réduite à des théoriciens ou à des cénacles intellectuels, ou bien 2) est-elle vraiment bien capillarisée dans le parti? Steven Aschheim, en concluant son enquête minutieuse, répond: oui. Il étaye son affirmation sur les résultats d'une enquête ancienne, qu'il a analysée méticuleusement, celle d'Adolf Levenstein en 1914. Levenstein avait procédé en son temps à une étude statistique des livres empruntés aux bibliothèques ouvrières de Leipzig entre 1897 et 1914. Levenstein avait constaté que les livres de Nietzsche étaient beaucoup plus lus que ceux de Marx, Lassalle ou Bebel, figures de proue de la sociale-démocratie officielle. Cette étude prouve que le nietzschéisme socialiste était une réalité dans le cœur des ouvriers allemands.
«Die Jungen» de Bruno Wille, «Der Sozialist» de Gustav Landauer
En Allemagne, la première organisation socialiste/nietzschéenne était Die Jungen (Les Jeunes) de Bruno Wille. Celui-ci entendait combattre l'“accomodationnisme” de la sociale-démocratie, son embourgeoisement (rejoignant par là Roberto Michels, analyste de l'oligarchisation des partis), le culte du parlementarisme (rejoignant Sorel et anticipant les deux plus célèbres soréliens allemands d'après 1918: Ernst Jünger et Carl Schmitt), l'ossification du parti et sa bureaucratisation (Michels). Plus précisément, Wille déplore la disparition de tous les réflexes créatifs dans le parti; l'imagination n'est plus au pouvoir dans la sociale-démocratie allemande du début de notre siècle, tout comme aujourd'hui, avec l'accession au pouvoir des anciens soixante-huitards, l'imagination, pourtant bruyamment promise, n'a plus du tout droit au chapitre, “political correctness” oblige. Ensuite, autre contestataire fondamental dans les rangs socialistes allemands, Gustav Landauer (1870-1919), qui tombera les armes à la main dans Munich investie par les Corps Francs de von Epp, fonde une revue libertaire, socialiste et nietzschéenne, qu'il baptise Der Sozialist. Chose remarquable, son interprétation de Nietzsche ignore le culte nietzschéen de l'égoïté, l'absence de toute forme de solidarité ou de communauté chez le philosophe de Sils-Maria, pour privilégier très fortement sa fantaisie créatrice et sa critique de toutes les pétrifications à l'œuvre dans les sociétés et les civilisations modernes et bourgeoises.
Max Maurenbrecher et Lily Braun
Max Maurenbrecher (1874-1930), est un pasteur protestant socialiste qui a foi dans le mouvement ouvrier tout en se référant constamment à Nietzsche et à sa critique du christianisme. La première intention de Maurenbrecher a été justement de fusionner socialisme, nietzschéisme et anti-christianisme. Son premier engagement a lieu dans le Nationalsozialer Verein de Naumann en 1903. Son deuxième engagement le conduit dans les rangs de la sociale-démocratie en 1907, au moment où il quitte aussi l'église protestante et s'engage dans le “mouvement religieux libre”. Son troisième engagement est un retour vers son église, un abandon de toute référence à Marx et à la sociale-démocratie, assortis d'une adhésion au message des Deutschnationalen. Maurenbrecher incarne donc un parcours qui va du socialisme au nationalisme.
Lily Braun, dans l'univers des intellectuels socialistes du début du siècle, est une militante féministe, socialiste et nietzschéenne. Elle s'engage dans les rangs sociaux-démocrates, où elle plaide la cause des femmes, réclame leur émancipation et leur droit au suffrage universel. Ce féminisme est complété par une critique systématique de tous les dogmes et par une esthétique nouvelle. Son apport philosophique est d'avoir défendu l'“esprit de négation” (Geist der Verneinung), dans le sens où elle entendait par “négation”, la négation de toute superstructure, des ossifications repérables dans les superstructures sociales. En ce sens, elle annonce certaines démarches de l'Ecole de Francfort. Lily Braun plaidait en faveur d'une juvénilisation permanente de la société et du socialisme. Elle s'opposait aux formes démobilisantes du moralisme kantien. Pendant la première guerre mondiale, elle développe un “socialisme patriotique” en arguant que l'Allemagne est la patrie de la sociale-démocratie, et qu'en tant que telle, elle lutte contre la France bourgeoise, l'Angleterre capitaliste et marchande et la Russie obscurantiste. Son néo-nationalisme est une sociale-démocratie nietzschéanisée perçue comme nouvelle idéologie allemande. La constante du message de Lily Braun est un anti-christianisme conséquent, dans le sens où l'idéologie chrétienne est le fondement métaphysique des superstructures en Europe et que toute forme de fidélité figée aux idéologèmes chrétiens sert les classes dirigeantes fossilisées à maintenir des superstructures obsolètes.
Contre le socialisme nietzschéen, la riposte des “bonzes”
Avec Max Maurenbrecher et Lily Braun, nous avons donc deux figures maximalistes du socialisme allemand qui évoluent vers le nationalisme, par nietzschéanisation. Cette évolution, les “bonzes” du parti l'observent avec grande méfiance. Ils perçoivent le danger d'une mutation du socialisme en un nationalisme populaire et ouvrier, qui rejette les avocats, les intellectuels et les nouveaux prêtres du positivisme sociologique. Les “bonzes” organisent donc leur riposte intellectuelle, qui sera une réaction anti-nietzschéenne. Le parallèle est facile à tracer avec la France actuelle, où Luc Ferry et Alain Renaut critiquent l'héritage de mai 68 et du nietzschéisme français des Deleuze, Guattari, Foucault, etc. Le mitterrandisme tardif, très “occidentaliste” dans ses orientations (géo)politiques, s'alignent sur la contre-révolution moraliste américaine et sur ses avatars de droite (Buchanan, Nozick) ou de gauche, en s'attaquant à des linéaments philosophiques capables de ruiner en profondeur —et définitivement— les assises d'une civilisation moribonde, qui crève de sa superstition idéologique et de son adhésion inconditionnelle aux idéaux fluets et chétifs de l'Aufklärung. L'intention de Ferry et Renaut est sans doute de bloquer le nietzschéisme français, afin qu'il ne se mette pas au service du lepénisme ou d'un nationalisme post-lepéniste. Démarche bizarre. Curieux exercice. Plus politicien-policier que philosophique...
Kurt Eisner: nietzschéen repenti
L'exemple historique le plus significatif de ce type de réaction, nous le trouvons chez Kurt Eisner, Président de cette République des Soviets de Bavière (Räterepublik), qui sera balayée par les Corps Francs en 1919. Avant de connaître cette aventure politique tragique et d'y laisser la vie, Eisner avait écrit un ouvrage orthodoxe et anti-nietzschéen, intitulé Psychopathia Spiritualis, qui a comme plus remarquable caractéristique d'être l'œuvre d'un ancien nietzschéen repenti! Quels ont été les arguments d'Eisner? Le socialisme est rationnel et pratique, disait-il, tandis que Nietzsche est rêveur, onirique. Il est donc impossible de construire une idéologie socialiste cohérente sur l'égocentrisme de Nietzsche et sur son absence de compassion (ce type d'argument sera plus tard repris par certains nationaux-socialistes!). Ensuite, Eisner constate que l'“impératif nietzschéen” conduit à la dégénérescence des mœurs et de la politique (même argument que le “conservateur” Steding). A l'injonction “devenir dur!” de Nietzsche, Eisner oppose un “devenir tendre!”, pratiquant de la sorte un exorcisme sur lui-même. Eisner dans son texte avoue avoir succombé au “langage intoxicateur” et au “style narcotique” de Nietzsche. Contrairement à Lily Braun et polémiquant sans doute avec elle, Eisner s'affirme kantien et explique que son kantisme est paradoxalement ce qui l'a conduit à admirer Nietzsche, car, pour Eisner, Kant, tout comme Nietzsche, met l'accent sur le développement libre et maximal de l'individu, mais, ajoute-t-il, l'impératif nietzschéen doit être collectivisé, de façon à susciter dans la société et la classe ouvrière un pan-aristocratisme (Heinrich Härtle, ancien secrétaire d'Alfred Rosenberg, développera un argumentaire similaire, en décrivant l'idéologie nationale-socialiste comme un mixte d'impératif éthique kantien et d'éthique du surpassement nietzschéenne, le tout dans une perspective non individualiste!).
Si Eisner est le premier nietzschéen à faire machine arrière, à amorcer dans le camp socialiste une critique finalement “réactionnaire” et “figeante” de Nietzsche et du socialisme nietzschéen, si Ferry et Renaut sont ses héritiers dans la triste France du mitterrandisme tardif, Georg Lukacs, avec une trilogie inquisitoriale fulminant contre les mutliples formes d'“irrationalisme” conduisant au “fascisme”, demeure la référence la plus classique de cette manie obsessionnelle et récurrente de biffer les innombrables strates de nietzschéisme. Pourtant, Lukacs était vitaliste dans sa jeunesse et cultivait une vision tragique de l'homme, de la vie et de l'histoire inspirée de Nietzsche; après 1945, il rédige cette trilogie contre les irrationalismes qui deviendra la bible de la “political correctness” de Staline à Andropov et Tchernenko dans les pays du COMECON, chez les marxistes qui se voulaient orthodoxes. Pourtant, les traces du nietzschéisme sont patentes dans la gauche nietzschéenne, chez Bloch et dans l'Ecole de Francfort.
Les gauchistes nietzschéens
Par gauchisme nietzschéen, Aschheim entend l'héritage d'Ernst Bloch et d'une partie de l'Ecole de Francfort. Ernst Bloch a eu une grande influence sur le mouvement étudiant allemand qui a précédé l'effervescence de mai 68. Une amitié fidèle et sincère le liait au leader de ces étudiants contestataires, Rudy Dutschke, apôtre protestant d'un socialisme gauchiste et national. Bloch opère une distinction fondamentale entre “marxisme froid” et “marxisme chaud”. Ce dernier postule un retour à la religion, ou, plus exactement, à l'utopisme religieux des anabaptistes, mus par le “principe espérance”. Lukacs ne ménagera pas ses critiques, et s'opposera à Bloch, jugeant son œuvre comme “un mélange d'éthique de gauche avec une épistémologie de droite”. Bloch est toutefois très critique à l'égard de la vision de Nietzsche qu'avait répandue Ludwig Klages. Bloch la qualifiera de “dionysisme passéiste”, en ajoutant que Nietzsche devait être utilisé dans une perspective “futuriste”, afin de “modeler l'avenir”. Bloch rejette toutefois la notion d'éternel retour car toute idée de “retour” est profondément statique: Bloch parle d'“archaïsme castrateur”. Le dionysisme que Bloch oppose à celui de Klages est un dionysisme de la “nature inachevée”, c'est-à-dire un dionysisme qui doit travailler à l'achèvement de la nature.
Bloch n'appartient pas à l'Ecole de Francfort; il en est proche; il l'a influencée mais ses idées religieuses et son “principe espérance” l'éloignent des deux chefs de file principaux de cette école, Horkheimer et Adorno. Les puristes de l'Ecole de Francfort ne croient pas à la rédemption par le principe espérance, car, disent-il, ce sont là des affirmations para-religieuses et a-critiques. Dans leurs critiques des idéologies (y compris des idéologies post-marxistes), les principaux protagonistes de l'Ecole de Francfort se réfèrent surtout au “Nietzsche démasquant”, dont ils utilisent les ressources pour démasquer les formes d'oppression dans la modernité tardive. Leur but est de sauver la théorie critique, et même toute critique, pour exercer une action dissolvante sur toutes les superstructures léguées par le passé et jugées obsolètes. Dans ce sens, Nietzsche est celui qui défie au mieux toutes les orthodoxies, celui dont le “langage démasquant” est le plus caustique; Adorno justifiait ses références à Nietzsche en disant: «Il n'est jamais complice avec le monde». A méditer si l'on ne veut pas être le complice du “Nouvel Ordre Mondial”...
Marcuse: un nietzschéisme de libération
Quant à Marcuse, souvent associé à l'Ecole de Francfort, que retient-il de Nietzsche? L'historiographie des idées retient souvent deux Marcuse: un Marcuse pessimiste, celui de L'homme unidimensionnel, et un Marcuse optimiste, celui d'Eros et civilisation. Pour Steven Aschheim, c'est ce Marcuse optimiste —il met beaucoup d'espoir dans son discours— qui est peut-être le plus “nietzschéen”. Son nietzschéisme est dès lors un nietzschéisme de libération, teinté de freudisme, dans le sens où Marcuse développe, au départ de sa double lecture de Nietzsche et de Freud, l'idée d'un “pouvoir libérateur du souvenir”. Jadis, la mémoire servait à se souvenir de devoirs, d'autant de “tu dois”, suscitant tout à la fois l'esprit de péché, la mauvaise conscience, le sens de la culpabilité, sur lesquels le christianisme s'est arcbouté et a imprégné notre civilisation. Cette mémoire-là “transforme des faits en essences”, fige des bribes d'histoire peut-être encore féconds pour en faire des absolus métaphysiques pétrifiés et fermés, qu'on ne peut plus remettre en question; pour Nietzsche, comme pour le Marcuse optimiste d'Eros et civilisation, il faut évacuer les brimades et les idoles qu'a imposées cette mémoire-là, car les instincts de vie (pour Freud: l'aspiration au bonheur total, entravée par la répression et les refoulements), doivent toujours, finalement, avoir le dessus, en rejettant sans hésiter toutes les formes d'“escapismes” et de négation. Pour Marcuse, en cela élève de Nietzsche, la civilisation occidentale et son pendant socialiste soviétique (Nietzsche aurait plutôt parlé du christianisme) sont fondamentalement fallacieux (parce que sur-répressifs) (*) car ils conservent trop d'essences, d'interdits, et étouffent les créativités, l'Eros. On retrouve là les mêmes mécanismes de pensée que chez un Landauer.
La “science mélancolique” d'Adorno
Adorno, dans Minima Moralia, se réfère à la dialectique négative de Nietzsche et se félicite du fait que cette négation nietzschéenne permanente ne conduit à l'affirmation d'aucune positivité qui, le cas échéant, pourrait se transformer en une nouvelle grande idole figée. Mais, Adorno, contrairement à Nietzsche, ne prône pas l'avènement d'un “gai savoir” ou d'une “gaie science”, mais espère l'avènement d'une “science mélancolique”, sorte de scepticisme méfiant à l'endroit de toute forme d'affirmation joyeuse. Adorno se démarque ainsi du “panisme” de Bloch, des idées claires et tranchées d'un Wille ou d'une Lily Braun, du communautarisme socialiste d'un Landauer ou, anticipativement, du “gai savoir” d'un philosophe nietzschéen français comme Gilles Deleuze. Pour Adorno, la joie ne doit pas tout surplomber.
Pour Aschheim, l'Ecole de Francfort adopte alternativement deux attitudes face à ce que Lukacs, dans sa célèbre polémique pro-rationaliste, a qualifié d'“irrationalisme”. Selon les circonstances, l'Ecole de Francfort distingue entre, d'une part, les irrationalismes féconds, qui permettent la critique des superstructures (dans ce qu'elles ont de figé) et/ou des institutions (dans ce qu'elles ont de rigide) et, d'autre part, les irrationalismes réactionnaires qui affirment brutalement des valeurs en dépit de leur obsolescence et de leur fonction au service du maintien de hiérarchies désuètes.
A quoi sert la “political correctness”?
Aschheim constate que l'idéologie des Lumières introduit et généralise dans la pensée européenne le relativisme, le subjectivisme, etc. qui développent, dans un premier temps, une dynamique critique, puis retournent cette dynamique contre le sujet érigé comme absolu dans la civilisation occidentale par les tenants de l'Aufklärung eux-mêmes. Ce que Ferry a appelé la “pensée-68” est justement cette idéologie des Lumières qui devient justement sans cesse plus intéressante, en ses stades ultimes, parce qu'elle retourne sa dynamique relativiste et perspectiviste contre l'idole-sujet. Ferry estime que ce retournement est allé trop loin, dans les œuvres de philosophes français tels Deleuze, Guattari, Foucault,... La “pensée-68” sort donc de l'Aufklärung stricto sensu et travaille à dissoudre le sacro-saint sujet, pierre angulaire des régimes libéraux, pseudo-démocratiques, nomocratiques et/ou ploutocratiques, axés sur l'individualisme juridique, sur la méthodologie individualiste en économie et en sociologie. Par conséquent, contre l'avancée de l'Aufklärung jusqu'à ses conséquences ultimes, avancée qui risque de faire voler en éclat des cadres institutionnels vermoulus qui ne peuvent plus se justifier philosophiquement, un personnel composite de journalistes, de censeurs médiatiques, de fonctionnaires, de juristes et de philosophes-mercenaires doit imposer une “correction politique”, afin de restituer le sujet dans sa plénitude et sa “magnificence” d'idole, afin de promouvoir et de consolider une restauration néo-libérale.
Revenons toutefois à Aschheim, qui cherche à remettre clairement en évidence les linéaments de nietzschéisme dans l'Ecole de Francfort, tout en montrant par quelles portes entrouvertes la correction politique, sur le modèle des Mehring, Eisner, Lukacs, Ferry, etc., peut simultanément s'insinuer dans ce discours. Horkheimer, chef de file de cette Ecole de Francfort et philosophe quasi officiel de la première décennie de la RFA, juge Nietzsche comme suit: le philosophe de Sils-Maria est incapable de reconnaître l'importance de la “société concrète” (**) dans ses analyses, mais, en dépit de cette lacune, inacceptable pour ceux qui ont été séduits, d'une façon ou d'une autre, par le matérialisme historique de la tradition marxiste, Nietzsche demeure toujours libre de toute illusion et voit et sent parfaitement quand un fait de vie se fige en “essence” (pour reprendre le vocabulaire de Marcuse). Horkheimer ajoute que Nietzsche “ne voit pas les origines sociales des déclins”. Position évidemment ambivalente, où admiration et crainte se mêlent indissolublement.
Nietzsche, le maître en “misologie”
En 1969, J. G. Merquior, dans Western Marxism, ouvrage qui analyse les ressorts du “marxisme occidental”, rappelle le rôle joué par les diverses lectures de Nietzsche dans l'émergence de ce phénomène un peu paradoxal de l'histoire des idées; Nietzsche, disait Merquior, est un “maître en misologie” (néologisme désignant l'opposition radicale des irrationalistes à l'endroit de la raison voire de la logique). Cette misologie transparaît le plus clairement dans la Généalogie de la morale (1887), où Nietzsche dit que “n'est définissable que ce qui n'a pas d'histoire”; en effet, on ne peut enfermer dans des concepts durables que ce qui n'a plus de potentialités en jachère, car des potentialités insoupçonnées peuvent à tout moment surgir et faire éclater le cadre définitionnel comme une écorce devenue trop étroite.
Notre point de vue dans ce débat sur l'Ecole de Francfort: cette école critique à juste titre l'étroitesse des vieilles institutions, lois, superstructures, qui se maintiennent envers et contre les mouvements de la vie, mais, dans la foulée de sa critique, elle heurte et tente d'effacer des legs de l'histoire qui gardent en jachère des potentialités réelles, en les jugeant a priori obsolètes. Elle n'utilise qu'une panoplie d'armes, celles de la seule critique, en omettant systématiquement de retourner les forces vives et potentielles des héritages historiques contre les fixations superstructurelles, les manifestations institutionnelles reflètant dans toutes leurs rigidités les épuisements vitaux, et les processus de dévitalisation (ou de désenchantement). Bloch, en dépit de ses références aux théologies de libération et aux messianismes révolutionnaires, abandonne au fond lui aussi l'histoire politique, militaire et non religieuse —c'est du moins le risque qu'il court délibérément en déployant sa critique contre Klages— pour construire dans ses anticipations quasi oniriques un futur somme toute bien artificiel voire fragile. Son recours aux luttes est à l'évidence pleinement acceptable, mais ce recours ne doit pas se limiter aux seules révoltes motivées par des messianismes religieux, il doit s'insinuer dans des combats pluriséculaires à motivations multiples. Adorno et Horkheimer abandonnent eux aussi l'histoire, la notion d'une continuité vitale et historique, au profit du magma informe et purement “présent”, sans profondeur temporelle, de la “société” (erreur que l'on a vu se répéter récemment au sein de la fameuse “nouvelle droite” parisienne, où l'histoire est étrangement absente et le pilpoul sociologisant, nettement omniprésent). Le risque de ce saltus pericolosus, d'Adorno et Horkheimer, dit Siegfried Kracauer (in: History: The Last Things Before the Last, New York, OUP, 1969), est de perdre tout point d'appui solide pour capter les plus fortes concrétions en devenir qui seront marquées de durée; pour Kracauer la “dialectique négative” des deux principaux parrains de l'Ecole de Francfort “manque de direction et de contenu”. Tout comme les ratiocinations jargonnantes et sociologisantes d'Alain de Benoist et de sa bande de jeunes perroquets.
L'entreprise de “dé-nietzschéanisation” de Habermas
Si Nietzsche a été bel et bien présent, et solidement, dans le corpus de l'Ecole de Francfort, il en a été expulsé par une deuxième vague de “dialecticiens négatifs” et d'apôtres, sur le tard, de l'idéologie des Lumières. Le chef de file de cette deuxième vague, celle des émules, a été sans conteste Jürgen Habermas. Aschheim résume les objectifs de Habermas dans son travail de “dé-nietzschéanisation”: a) œuvrer pour expurger les legs de l'Ecole de Francfort de tout nietzschéisme; b) rétablir une cohérence rationnelle; c) re-coder (!) (Deleuze et Foucault avaient dissous les codes); d) reconstruire une “correction politique”; e) réexaminer l'héritage de mai 68, où, pour notre regard, il y a quelques éléments très positifs et féconds, surtout au niveau de ce que Ferry et Renaut appelerons la “pensée-68”; dans ce réexamen, Habermas part du principe que la critique de la critique de l'Aufklärung, risque fortement de déboucher sur un “néo-conservatisme”; de ce fait, il entend militer pour le rétablissement de la “dialectique de l'Aufklärung” dans sa “pureté” (ou dans ce qu'il veut bien désigner sous ce terme). Pour Habermas, le nietzschéisme français, le néo-heideggerisme, le post-structuralisme de Foucault, le déconstructivisme de Derrida, sont autant de filons de 68 qui ont chaviré dans “l'irrationalisme bourgeois tardif”. Or ces démarches philosophiques non-politiques, ou très peu politisables, ne se posent nullement comme des options militantes en faveur d'un conservatisme ou d'une restauration “bourgeoise”, bien au contraire, on peut conclure que Habermas déclenche une guerre civile à l'intérieur même de la gauche et cherche à émasculer celle-ci, à la repeindre en gris. Dans son combat, Habermas s'attaque explicitement aux notions d'hétérogénité (de pluralité), de jeu (de tragique, de kaïros tel que l'imaginait un Henri Lefebvre), de rire, de contradiction (implicite et incontournable), de désir, de différence. Selon Habermas, toutes ces notions conduisent soit au “gauchisme radical” soit à l'“anarchisme nihiliste” soit au “quiétisme conservateur”. De telles attitudes, prétend Habermas, sont incapables d'envisager un changement chargé de sens (i. e. un sens progressiste et modéré, évolutionnaire et calculant). D'où Habermas, et à sa suite Ferry et Renaut, estiment être les seuls habilités à énoncer le sens, lequel est alors posé a priori, imposé d'autorité. Le libéralisme ou le démocratisme que habermas, Ferry et Renaut entendent représenter sont dès lors les produits d'une autorité, en l'occurence la leur et celle de ceux qui les relaient dans les médias.
Le libéralisme et le démocratisme autoritaires (sur le plan intellectuel), mais en apparence tolérants sur le plan pratique, constituent en fait le fondement de notre actuelle “political correctness” qui se marie très bien avec le pouvoir des “socialistes établis”, héritiers du social-démocratisme à la Mehring, et flanqués des orthodoxes marxistes dévitalisés à la Lukacs. Cette alliance vise à remplacer un autoritarisme par un autre, une superstructure par une autre, qui serait le réseau des notables, des mafieux et des fonctionnaires socialistes. Une telle constellation idéologique renonce à émanciper continuellement les masses, les citoyens, les esprits mais entend installer un appareil inamovible (au besoin en noyautant les services de police, comme c'est le cas des socialistes en Belgique qui transforment la gendarmerie, déjà Etat dans l'Etat, en une armée au service du ministère de l'intérieur socialiste, tenu par un ancien gauchiste adepte de la marijuana). Cette constellation idéologique et politique refuse de réceptionner l'innovation, de quelqu'ordre qu'elle soit, et les rénégats de 68, les repentis à la façon d'Eisner, trahissent les intellectuels féconds de leur propre camp de départ, pour déboucher sur un discours sans relief, sans sel.
Donc l'aventure commencée par Die Jungen autour de Wille est un échec au sein de la sociale-démocratie. Ses forces dynamiques vont-elles aller vers un nouveau fascisme? Il semble que la sociale-démocratie n'écoute pas les leçons de l'histoire et qu'en alignant à l'université des Habermas, des Ferry et des Renaut, ou en manipulant des groupes de choc violents, ou en animant des cercles conspirationnistes parallèles comme le CRIDA de “René Monzat”, elle prépare un nouvel autoritarisme, qu'en d'autres temps elle n'aurait pas hésiter à qualifier de “fascisme”. Dans toute tradition politico-intellectuelle, il faut laisser la porte ouverte au dynamisme juvénile, immédiatement réceptif aux innovations. Une telle ouverture est une nécessité voire un impératif de survie. Dans le cas de la sociale-démocratie, si ce dynamisme juvénile ne peut s'exprimer dans des revues, des cercles, des associations, des mouvements de jeunesse liés au parti, il passera forcément “à droite” (ce qui n'est jamais qu'une convention de langage), parce que la gauche-appareil ne cesse de demeurer sourde à ses revendications légitimes. Aujourd'hui, ce passage “à droite” est possible dans la mesure où la “droite” est démonisée au même titre que l'anarchisme au début du siècle. Et les démonisations fascinent les incompris.
Nietzsche et la “droite”
Avant 1914, la droite allemande la plus bruyante est celle des pangermanistes, qui ne se réfèrent pas à Nietzsche, parce que celui-ci n'évoque ni la race ni la germanité. Lehmann pensait que Nietzsche restait en dehors de la politique et qu'il était dès lors inutile de se préoccuper de sa philosophie. Paul de Lagarde ne marque pas davantage d'intérêt. Quant à Lange, il est férocement anti-nietzschéen, dans la mesure où il affirme que la philosophie de Nietzsche est juste bonne “pour les névrosés et les littérateurs”, “les artistes et les femmes hystériques”. A Nietzsche, il convient d'opposer Gobineau et de parier ainsi pour le sang, valeur sûre et stable, contre l'imagination, valeur déstabilisante et volatile. Otto Bonhard, pour sa part, réfute l'“anarchisme nietzschéen”.
C'est sous l'impulsion d'Arthur Moeller van den Bruck que Nietzsche fera son entrée dans les idéologies de la droite allemande. Moeller van den Bruck part d'un premier constat: le défaut majeur du marxisme (i. e. l'appareil social-démocrate) est de ne se référer qu'à un rationalisme abstrait, comme le libéralisme. De ce fait, il est incapable de capter les véritables “sources de la vie”. En 1919, la superstructure officielle de l'empire allemand s'effondre, non pas tant par la révolution, comme en Russie, mais par la défaite et par les réparations imposées par les Alliés occidentaux. L'Armée est hors jeu. Inutile donc de défendre des structures politiques qui n'existent plus. La droite doit entrer dans l'ère des “re-définitions”, estime Moeller van den Bruck, et à sa suite on parlera de “néo-nationalisme”.
Si tout doit être redéfini, le socialisme doit l'être aussi, aux yeux de Moeller. Celui-ci ne saurait plus être une “analyse objective des rapports entre la superstructure et la base”, comme le voulait l'idéologie positiviste de la sociale-démocratie d'après le programme du Gotha, mais une “volonté d'affirmer la vie”. En disant cela, Moeller ne se contente pas d'une déclamation grandiloquente sur la “vie”, de proclamer un slogan vitaliste, mais dévoile les aspects très concrets de cette volonté de vie: une juste redistribution permet un essor démographique. La vie triomphe alors de la récession. Dès lors, ajoute Moeller, les clivages sociaux ne devraient plus passer entre des riches qui dominent et des masses de pauvres. Au contraire, le peuple doit être dirigé par une élite frugale, apte à diriger des masses dont les besoins élémentaires et vitaux sont bien satisfaits. Ce processus doit se dérouler dans des cadres nationaux visibles, assurant une transparence, et, bien entendu, clairement circonscrits dans le temps et l'espace pour que le principe “nul n'est censé ignorer la loi” soit en vigueur sans contestation ni coercition.
Même raisonnement chez Werner Sombart: le nouveau socialisme s'oppose avec véhémence à l'hédonisme occidental, au progressisme, à l'utilitarisme. Le nouveau socialisme accepte le tragique, il est non-téléologique, il ne s'inscrit pas dans une histoire linéaire, mais fonde un nouvel “organon”, où fusionnent une vox dei et une vox populi, comme au moyen-âge, mais sans féodalisme ni hiérarchie rigide.
Spengler et Shaw
Pour Spengler, on doit évaluer positiviement le socialisme dans la mesure où il est avant toute chose une “énergie” et, accessoirement, le “stade ultime du faustisme déclinant”. Spengler estime que Nietzsche n'a pas été jusqu'au bout de ses idées sur le plan politique. Ce sera Georges Bernard Shaw, notamment dans Man and Superman et Major Barbara, qui énoncera les méthodes pratiques pour asseoir le socialisme nietzschéen dans les sociétés européennes: mélange d'éducation sans moralisme hypocrite, de darwinisme tourné vers la solidarité (où les communautés les plus solidaires gagnent la compétition), d'ironie et de distance par rapport aux engouements et aux propagandes. Shaw, en annexe de son drame Man and Superman, publie ses Maxims for Revolutionists, rappelle que la “démocratie remplace la désignation d'une minorité corrompue par l'élection d'un grand nombre d'incompétents”, que la “liberté ne signifie [pas autre chose] que la responsabilité et que, pour cette raison, la plupart des hommes la craignent”; enfin: “l'homme raisonnable est celui qui s'adapte au monde; l'hommer irraisonnable est celui qui persiste à essayer d'adapter le monde à lui-même. C'est pourquoi le progrès dépend tout entier de l'homme raisonnable. L'homme qui écoute la Raison est perdu: le Raison transforme en esclaves tous ceux dont l'esprit n'est pas assez fort pour la maîtriser”. “Le droit de vivre est une escroquerie chaque fois qu'il n'y a pas de défis constants”. “La civilisation est une maladie provoquée par la pratique de construire des sociétés avec du matériel pourri”. “La décadence ne trouvera ses agents que si elle porte le masque du progrès”.
Le socialisme doit donc être forgé par des esprits clairs, dépourvus de tous réflexes hypocrites, de tout ballast moralisant, de toutes ces craintes “humaines trop humaines”. Dans ce cas, conclut Spengler à la suite de sa lecture de Shaw, le “socialisme ne saurait être un système de compassion, d'humanité, de paix, de petits soins, mais un système de volonté-de-puissance”. Toute autre lecture du socialisme serait illusion. Il faut donner à l'homme énergique (celui qui fait passer ses volontés de la puissance à l'acte), la liberté qui lui permettra d'agir, au-delà de tous les obstacles que pourraient constituer la richesse, la naissance ou la tradition. Dans cette optique, liberté et volonté de puissance sont synonymes: en français, le terme “puissance” ne signifie pas seulement la volonté d'exercer un pouvoir, mais aussi la volonté de faire passer mes potentialités dans le réel, de faire passer à l'acte, ce qui est en puissance en moi. Définition de la puissance qu'il convient de méditer, —et pourquoi pas à l'aide des textes ironiques de Shaw?— à l'heure où la “correction politique” constitue un retour des hypocrisies et des moralismes et un verrouillage des énergies innovantes.
Aschheim montre dans son livre le lien direct qui a existé entre la tradition socialiste anglaise, en l'occurence la Fabian Society animée par Shaw, et la redéfinition du socialisme par les premiers tenants de la “révolution conservatrice” allemande. Dénominateur commun: le refus de conventions stérilisantes qui bloquent l'avancée des hommes “énergiques”.
Nietzsche et le national-socialisme
Au départ, Nietzsche n'avait pas bonne presse dans les milieux proches de la NSDAP, qui reprend à son compte les critiques anti-nietzschéennes des pangermanistes, des eugénistes et des idéologues racialistes. Les intellectuels de la NSDAP poursuivent de préférence les spéculations raciales de Lehmann et se désintéressent de Nietzsche, plus en vogue dans les gauches, chez les littéraires, les féministes et dans les mouvements de jeunesse non politisés. Ainsi, au tout début de l'aventure hitlérienne, Dietrich Eckart, le philosophe folciste (= völkisch) de Schwabing, rejette explicitement et systématiquement Nietzsche, qui est “un malade par hérédité”, qui a médit sans arrêt du peuple allemand; pour Eckart, la légende d'un Nietzsche qui vitupère contre l'Allemagne parce qu'il l'aime au fond passionément est une escroquerie intellectuelle. Enfin, constate-t-il, l'individualisme égoïste de Nietzsche est totalement incompatible avec l'idéal communautaire des nationaux-socialistes. Après avoir édité des exégèses de Nietzsche pourtant bien plus fines, Arthur Drews, théologien folciste inféodé à la NSDAP, s'insurge en 1934 dans Nordische Stimme (n°4/34), contre la thèse d'un Nietzsche qui aime son pays malgré ses vitupérations anti-germaniques et affirme —ce qui peut paraître paradoxal— que le jeune poète juif Heinrich Heine, lui, critiquait l'Allemagne parce qu'il l'aimait réellement. Nietzsche est ensuite accusé de “philo-sémitisme”: pour Aschheim et, avant lui, pour Kaufmann, le texte le plus significatif de l'ère nazie en ce sens est celui de Curt von Westernhagen, Nietzsche, Juden, Antijuden (Weimar, Duncker, 1936). Alfred von Martin, critique protestant, revalorise l'humaniste Burckhardt et rejette le négativisme nietzschéen, plus pour son manque d'engagement nationaliste que pour son anti-christianisme (Nietzsche und Burckhardt, Munich, 1941)! Finalement, les deux auteurs pro-nietzschéens sous le Troisième Reich, outre Bäumler que nous analyserons plus en détail, sont Edgar Salin (Jacob Burckhardt und Nietzsche, Bâle, 1938), qui prend le contre-pied des thèses de von Martin, et le nationaliste allemand, liguiste (= bündisch) et juif, Hans-Joachim Schoeps (Gestalten an der Zeitwende: Burckhardt, Nietzsche, Kafka, Berlin, Vortrupp Verlag, 1936). Quant au critique littéraire Kurt Hildebrandt, favorable au national-socialisme, il critique l'interprétation de Nietzsche par Karl Jaspers, comme le feront bon nombre d'exilés politiques et Walter Kaufmann. Jaspers aurait développé un existentialisme sur base des aspects les moins existentialistes de Nietzsche. Tandis que Nietzsche s'opposait à toute transcendance, Jaspers tentait de revenir à une “transcendance douce”, en négligant le Zarathoustra et la Généalogie de la morale. Enfin, plus important, l'apologie de la créativité chez Nietzsche et sa volonté de transvaluer les valeurs en place, de faire éclore une nouvelle table des valeurs, font de lui un philosophe de combat qui vise à normer une nouvelle époque émergeante. Dans ce sens, Nietzsche n'est pas un intellectuel virevoltant (freischwebend) au gré de ses humeurs ou de ses caprices, mais celui qui jette les bases d'un système normatif et d'une communauté positive, dont les assises ne sont plus un ensemble fixe de dogmes ou de commandements (de “tu dois”), mais un dynamisme bouillonant et effervescent qu'il faut chevaucher et guider en permanence (Kurt Hildebrandt, «Über Deutung und Einordnung von Nietzsches System», Kant-Studien, vol. 41, Nr. 3/4, 1936, pp. 221-293). Ce chevauchement et ce guidage nécessitent une éducation nouvelle, plus attentive aux forces en puissance, prêtes à faire irruption dans la trame du monde.
Plus explicite sur les variations innombrables et contradictoires des interprétations de Nietzsche sous le Troisième Reich, est le livre du philosophe italien Giorgio Penzo (cf. supra), pour qui l'époque nationale-socialiste procède plus généralement à une dé-mythisation de Nietzsche. On ne sollicite plus tant son œuvre pour bouleverser des conventions, pour ébranler les assises d'une morale sociale étriquée, mais pour la réinsérer dans l'histoire du droit, ou, plus partiellement, pour faire du surhomme nietzschéen un simple équivalent de l'homme faustien ou, chez Kriek, l'horizon de l'éducation. On assiste également à des démythisations plus totales, où l'on souligne l'infécondité fondamentale de l'anarchisme nietzschéen, dans lequel on décèle une “pathologie de la culture qui conduit à la dépolitisation”. Ce reproche de “dépolitisation” trouve son apothéose chez Steding. D'autres font du surhomme l'expression d'une simple nostalgie du divin. L'époque connaît bien sûr ses “lectures fanatiques”, dit Penzo, où l'incarnation du surhomme est tout bonnement Hitler (Scheuffler, Oehler, Spethmann, Müller-Rathenow). Seule notable exception, dans ce magma somme toute asses confus, le philosophe Alfred Bäumler.
Bäumler: héroïsme réaliste et héraclitéen
La seule approche féconde de Nietzsche à l'ère nationale-socialiste est donc celle de Bäumler. Pour Bäumler, par ailleurs pétri des thèses de Bachofen, Nietzsche est un “penseur existentiel”, soit un philosophe qui nous invite à nous plonger dans la concrétude sociale, politique et historique. Bäumler ne retient donc pas le reproche de “dépolitiseur”, que d'aucuns, dont Steding, avaient adressé à Nietzsche. Bäumler définit l'“existentialité” comme un “réalisme héroïque” ou un “réalisme héraclitéen”; l'homme et le monde, dans cette perspective, l'homme dans le monde et le monde dans l'homme, sont en devenir perpétuel, soumis à un mouvement continu, qui ne connaît ni repos ni quiétude. Le surhomme est dès lors une métaphore pour désigner tout ce qui est héroïque, c'est-à-dire tout ce qui lutte dans la trame en devenir de l'existence terrestre.
On constate que Bäumler donne la priorité au “Nietzsche agonal” plutôt qu'au “Nietzsche dionysiaque”, qui hérissait Steding, parce qu'il était le principal responsable du refus des formes et des structures politiques. Bäumler estime que Nietzsche inaugure l'ère de la “Grande Raison des Corps”, où la Gebildetheit, ne s'adressant qu'au pur intellect en négligeant les corps, est inauthentique, tandis que la Bildung, reposant sur l'intuition, l'intelligence intuitive, et une valorisation des corps, est la clef de toute véritable authenticité. Notons au passage que Heidegger, ennemi de Bäumler, parlait aussi d'“authenticité” à cette époque. La logique du Corps, qui est une logique esthétique, sauve la pensée, pense Bäumler, car toute la culture occidentale s'est refermée sur un système conceptuel froid qui ne mène plusà rien, système dont la trajectoire a été jalonnée par le christianisme, l'humanisme (basé sur une fausee interprétation, édulcorée et falsifiée, de la civilisation gréco-romaine), le rationalisme scientiste. La notion de Corps (Leib), plus le recours à ce que Bäumler appelle la “grécité véritable”, soit une grécité pré-socratique, de même qu'à une germanité véritable, soit une germanité pré-chrétienne, conduisent à un retour à l'authentique, comme le prouvent, à l'époque, les innovations de la philologie classique. Cette mise en équation entre grécité pré-socratique, germanité pré-chrétienne et authenticité, constitue le saltus periculosus de Bäumler: dénier toute authenticité à ce qui sortait du champs de cette grécité et de cette germanité, a valu à Bäumler d'être ostracisé pendant longtemps, avant d'être timidement réhabilité.
Les impasses philosophiques de la bourgeoisie allemande
Dans un second temps, Bäumler politise cette définition de l'authenticité, en affirmant que le national-socialisme, en tant que Weltanschauung, représente “une conception de l'Etat gréco-germanique”. Bäumler ne se livre pas trop à des rapprochements hasardeux, ni à des sollicitations outrancières. Pourquoi affirme-t-il que l'Etat national-socialiste est grèco-germanique au sens où Nietzsche a défini la corporéité grecque et accepté la valorisation grecque des corps? Pour pouvoir affirmer cela, Bäumler procède à une inteprétation de l'histoire culturelle de la “bourgeoisie allemande”, dont tous les modèles ont été en faillite sous la République de Weimar. L'Aufklärung, première grande idéologie bourgeoise allemande, est une idéologie négative car elle est individualiste, abstraite et ne permet pas de forger des politiques cohérentes. Le romantisme, deuxième grande idéologie de la bourgeoisie allemande, est une tradition positive. Le piétisme, troisième grande idéologie bourgeoise en Allemagne, est rejeté pour les mêmes motifs que l'Aufklärung. Le romantisme est positif parce qu'il permet une ouverture au Volk, au mythe et au passé, donc de dépasser l'individualisme, le positivisme étriqué et la fascination inféconde pour le progrès. Cependant, en gros, la bourgeoisie n'a pas tiré les leçons pratiques qu'il aurait fallu tirer au départ du romantisme. Bäumler reproche à la bourgeoisie allemande d'avoir été “paresseuse” et d'avoir choisi un expédiant; elle a imité et importé des modèles étrangers (anglais ou français), qu'elle a plaqué sur la réalité allemande.
Parmi les bricolages idéologiques bourgeois, le plus important a été le “classicisme allemand”, sorte de mixte artificiel d'Aufklärung et de romantisme, incapable, selon Bäumler, de générer des institutions, un droit et une constitution authentiquement allemands. En rejetant l'Aufklärung et le piétisme, en renouant avec le filon romantique en jachère, explique et espère Bäumler, le national-socialisme pourra “travailler à élaborer des institutions et un droit allemands”. Mais le nouveau régime n'aura jamais le temps de parfaire cette tâche.
Action, destin et décision
Dans l'interprétation bäumlerienne de Nietzsche, la mort de Dieu est synonyme de mort du Dieu médiéval. Dieu en soi ne peut mourir car il n'est rien d'autre qu'une personnification du Destin (Schicksal). Celui-ci suscite, par le biais de fortes personnalités, des formes politiques plus ou moins éphémères. Ces personnalités ne théorisent pas, elles agissent, le destin parle par elles. L'Action détruit ce qui existe et s'est encroûté. La Décision, c'est l'existence même, parce que décider, c'est être, c'est se muer en une porte qu'enfonce le Destin pour se ruer dans la réalité. Ernst Jünger aurait parlé de l'“irruption de l'élémentaire”. Pour Bäumler, le “sujet” a peu de valeur en soi, il n'en acquiert que par son Action et par ses Décisions historiques. Ce déni de la “valeur-en-soi” du sujet fonde l'anti-humanisme de Bäumler, que l'on retrouve, finalement, sous une autre forme et dans un langage marxisé, chez Althusser, par exemple, où la “fonction pratique-sociale” de l'idéologie prend le pas sur la connaissance pure (comme, dans la conception de Bäumler, le plongeon dans la vie réelle se voyait octroyer une bien plus grande importance que la culture livresque de l'idéologie des Lumières ou du classicisme allemand). Pour Althusser, dont la pensée est arrivée à maturité dans un camp de prisonniers en Allemagne pendant la 2ième Guerre mondiale, l'idéologie (la Weltanschauung?), était une instance mouvante, portée par des penseurs en prise sur les concrétudes, qui permettait de mettre en exergue les rapports de l'homme avec les conditions de son existence, de l'aider dans un combat contre les “autorités figées”, qui l'obligeaient à répéter sans cesse, —“sisyphiquement” serait-on tenter de dire—, les mêmes gestes en dépit des mutations s'opérant dans le réel. Pour Althusser, l'idéologie ne peut donc jamais se muer en une science rigide et fermée, ne peut devenir pur discours de représentation, et, en tant que conceptualisation permanente et dynamique des faits concrets, elle conteste toujours le primat de l'autorité politique ou politico-économique installée et établie, tout comme l'“anarchisme” gauchiste et nietzschéen de Landauer refusait les rigidifications conventionnelles, car elles étaient autant de barrages à l'irruption des potentialités en germe dans les communautés concrètes. Enfin, il ne nous paraît pas illégitime de comparer les notions d'“authenticité” chez Bäumler (et Heidegger) et de “concrétude” chez Althusser, et de procéder à une “fertilisation croisée” entre elles.
L'anti-humanisme de Bäumler repose, quant à lui, sur trois piliers, sur trois œuvres: celles de Winckelmann, de Hölderlin et de Nietzsche. Winckelmann a brisé l'image toute faite que les “humanités” avaient donné de l'antiquité grecque à des générations et des générations d'Européens. Winckelmann a revalorisé Homère et Eschyle plutôt que Virgile et Sénèque. Hölderlin a souligné le rapport entre la grécité fondamentale et la germanité. Mais l'anti-humanisme de Bäumler est une “révolution tranquille”, plutôt “métapolitique”, elle avance silencieusement, à pas de colombe, au fur et à mesure que croulent et s'effondrent dogmes, certitudes et représentations figées, notamment celles de l'humanisme, ennemi commun de Bäumler et d'Althusser. Althusser a recours, lui, à la traditionnelle lutte des classes marxistes, mais avec un politburo contrôlé par un “comité scientifique”, capable de déceler les changements, les fulgurances du devenir, dès qu'ils se pointent, même timidement.
Conclusion
Il nous a semblé nécessaire de revenir à ce foisonnement d'interprétations diverses de la philosophie de Nietzsche, qui surgit ou court transversalement à travers tous les champs politico-idéologiques du siècle, pour tenter de répondre à la critique qu'adressent Ferry et Renaut à l'encontre du “nietzschéisme français”, pour nous obliger à revenir à des stabilités politiques jugées “correctes”. Lukacs les avait précédés dans un travail similaire. Tout recours à Nietzsche dans une perspective “révolutionnante”, de facture socialiste-gauchiste ou révolutionnaire-conservatrice, devient aujourd'hui suspect. En Allemagne, ce fut le cas entre 1945 et la moitié des années 80. En France, le recours à Nietzsche, ou le recours simultané à Marx et à Nietzsche, voire à Nietzsche, Marx et Freud, n'a pas été interdit ou boycotté. Un anti-humanisme, une philosophie du soupçon à l'endroit des représentations humanistes, a pu fermement s'installer jusqu'il y a peu de temps en France. C'est contre cet héritage, aujourd'hui oublié à l'ère du prêt-à-penser et des ultra-simplifications télévisées, où l'on est prié de tout dire en quelques secondes, que luttent Renaut et Ferry. Mais Nietzsche est revenu en Allemagne par le biais d'une “gauche nietzschéenne” française qui a séduit une petite phalange de brillants esprits, sur lesquels Habermas a tiré à boulets rouges. Des disciples de Habermas parlaient de “Lacan-can” et de “Derrida-da”, pour laisser sous-entendre que les travaux de ces deux philosophes n'étaient que cancans et dadas. Sur le modèle de la réaction de Franz Mehring ou des reniements de Kurt Eisner, une nouvelle inquisition anti-nietzschéenne se déploie de part et d'autre du Rhin où sévissent, avec un empressement à la fois triste et comique, les “anti-fascistes” habermassiens, mués en défenseurs de bien glauques établissements, et le duo Ferry-Renaut, appuyés par quelques terribles simplificateurs postés dans des officines para-policières. Les cas du philosophe vitaliste Gerd Bergfleth, agressé en ma présence à Francfort par des vitupérateurs délirants, —rapidement remis à leur place par la tchatche et le rire homérique de Günther Maschke (***)— ou de l'éditeur Axel Matthes, qui propose au public allemand d'excellentes traductions de Baudrillard, Artaud, Bataille, etc., sont révélateurs de la violence et de l'hystérie de cette nouvelle inquisition.
Que conclure de cette fresque fort longue mais très incomplète? Que la culture est un tout. Que les interpénétrations et les compénétrations idéologiques, politiques et culturelles sont omniprésentes. Il est en effet impossible de démêler l'écheveau, sans opérer de dangereuses mutilations. Les synthèses sublimes et même les bricolages idéologiques un peu boîteux n'échappent pas à la règle. Nous avons aujourd'hui une gauche qui joue aux inquisiteurs contre les idéologèmes qu'elle étiquette de “droite”, sans se rendre compte, car elle a la mémoire fort courte, que ces mêmes idéologèmes ont été forgés au départ par des hommes de la gauche la plus pure et la plus sublime, que toutes les gauches ont hissés dans leurs propres panthéons! Habermas en Allemagne, ses imitateurs français à Paris, sont en train de castrer les gauches allemande et française, tout en se déclarant de “gauche”, mais d'une gauche bourgeoise, humaniste, illuministe. Nous vivons donc le règne d'une inquisition, d'une prohibition. Mais c'est une gesticulation inutile.
Robert STEUCKERS.
Notes:
(*) Par sur-répression, Marcuse entend l'ensemble des mécanismes et des discours qui permettent aux dominants d'une société d'imposer pour leur seul bénéfice de cruelles contraintes à ceux qu'ils exploitent, dans le désordre et le gaspillage, en imposant aux dominés un “sur-travail”. Cette logique nietzschéo-marcusienne pourrait servir à juger les dominants actuels, jonglant avec les mécanismes de la partitocratie, qui excluent de larges strates de leurs concitoyens du marché de l'emploi pour s'approprier les fonds qui pourraient le relancer ou qui imposent une fiscalité telle que la vie des indépendants devient une prison.
(**) Le nietzschéisme caricatural de certaines droites politiques ou métapolitiques est à la fois le refus de prendre en compte la “société concrète” mais aussi le refus de reprendre en compte le combat à la fois conservateur, romantique, démocratique et populiste, pour la “societas civilis”. Panajotis Kondylis reproche notament aux droites “révolutionnaires-conservatrices” du temps de Weimar d'avoir dévié dans l'esthétisme révolutionnaire, sans plus chercher à reconstituer une “societas civilis”, où les ressorts des différentes communautés composant la nation sont entretenus, harmonisés et perpétués. Un même reproche peut être adressé aux “nouvelles droites”, surtout celles qui ont sévi à Paris.
(***) Lors d'une Foire de Francfort, fin des années 80, Gerd Bergfleth devait présenter son dernier livre, critique à l'égard de cette “raison palabrante” qui s'était emparée de la philosophie allemande au détriment de tous les linéaments de vitalisme. Cette présentation a eu lieu dans une librairie de la ville, où plusieurs furieux, alternant colères et larmes (Lothar Baier!), ont injurié le conférencier, l'ont menacé, l'ont accusé de ressusciter l'“inressuscitable”, le tout sous les sarcasmes, les rires tonitruants et les moqueries de Günter Maschke, spécialiste de Donoso Cortès et de Carl Schmitt, et ancien agitateur du SDS gauchiste à l'époque des révoltes étudiantes de 1967/68. Parmi les auditeurs, Karlheinz Weißmann, Axel Matthes et Robert Steuckers. Soirée grandiose! Ou le ridicule des inquisiteurs a parfaitement transparu.
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : philosophie, nietzsche, gauche, droite, révolution conservatrice, allemagne, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 août 2008
Dionysische wijsheid
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dionysos, nietzsche, mythologie, dieux, antiquité grecque, grèce antique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 juillet 2008
Pour la Vie, contre les structures abstraites!

Intervention lors de la 8ième Université d'Eté de "Synergies Européennes", Trente, 1998
Pour la Vie, contre les structures abstraites !
Maïtre Jure Vujic
Que signifie au juste la revendication de la vie face aux structures abstraites? Dans le cadre d'une approche philosophique, cela conduit vers une intention de réduire la portée des démarches de la pensée consciente et de ses médiations, et de potentialiser celle de l'inconscient ou de la vie immédiate par une saisie de la réalité humaine en deça des formes et des constructions sociales et politiques artificielles et abstraites par essence, des traditions historiques désuètes et des cristallisations culturelles stériles.
Cette démarche philosophique que l'on pourrait qualifier soit d'“irrationaliste” soit de “vitaliste” sous-entend même l'importance de la philosophie de Kant constatant les limites de la raison théorique et dont les prolongements critiques engendrent un double courant: l'un axé sur la volonté morale et sur une dialectisation de la raison (Fichte et Hegel) qui débouche par réaction dans le marxisme et le “matérialisme dialectique”; l'autre, qui revendique l'immédiateté de la vie, l'intuitionisme et le primat de l'instinct, procède du courant de pensée engendré par Schopenhauer, véritable père de l'irrationalisme contemporain, et trouve ses ramifications philosophiques chez Nietzsche, Jung, Adler et même Freud, l'existentialisme français de Sartre et la philosophie existentielle de la vie que l'on retrouve chez Bergson, Schelling, Kierkegaard, Maurice Blondel. L'école allemande, avec Wilhelm Dilthey, G. Misch, B. Groethuysen, Ed. Spranger, Hans Leisegang, A. Dempf, R. Eucken, E. Troeltsch, G. Simmel, ainsi que la philosophie naturaliste de la vie d'Oswald Spengler et Ludwig Klages.
Le dénominateur commun que l’on retrouve dans chacun de ces courants de pensée hétéroclites et qui réside dans la revendication du principe de vie face au constructivisme abstrait, étant donné la diversité des perspectives qui l’expriment, ne se laisse pas enfermer dans un schéma d’interprétation global à la manière dont procède Georges Lukacs, le célèbre marxiste hongrois, qui considère la pensée irrationaliste allemande comme typiquement bourgeoise et « réactionnaire », en tenant pour définitivement acquis que l’histoire des idées est subordonnée à des forces primaires agissantes : situation et développement des forces de production, évolution de la société, caractère de la lutte des classes, etc…
Ce qui est certain, c’est que ce courant de pensée vitaliste ou « irrationaliste » remet en question l’idée de progrès historique, la linéarité et le mythe progressiste, et qu’il représente ainsi la contrepartie du courant de pensée qui, du XVIIIième siècle français à travers Kant et la révolution française, débouche dans la dialectique hégélienne et marxiste ; contrepartie dans la mesure où il déprécie le pouvoir de la raison, que ce soit en contestant l’objectivité du réel, que ce soit en réduisant la connaissance intellectuelle à son efficacité technique, que ce soit en se réclamant d’une saisie mystique de la réalité « absolue », décrétée irrationnelle dans son essence. La lutte contre l’abstraction et la raison a des formes aussi variées que les motivations qui l’engendrent. Elle peut notamment aboutir à faire un principe de la notion d’absurde qui a surgi chez Schopenhauer et plus tard chez Cioran.
De Leibniz à Kant et Schopenhauer
A l’opposé du rationalisme de la pensée occidentale, du principe de raison suffisante énoncé par Leibniz, du cartésianisme, la revendication de la vie dont Schopenhauer se fera le principal promoteur, sous-entend que l’intelligence ou la raison n’est pas à la racine de toute chose, qu’elle a surgi d’un monde opaque, et que les principes qu’elle introduit demeurent irrémédiablement à la surface de la réalité, puisqu’ils lui sont, comme l’intelligence elle-même, surajoutés. Le corollaire d’une telle conception est que la réalité qui fonde toutes les existences particulières est elle-même sans fondement, sans raison, sans cause (générale), que notre manière de raisonner, dès lors, est valable seulement pour ce qui est des rapports que les êtres et les choses entretiennent dans l’espace et dans le temps.
Au-delà d’un impératif absolu de la loi morale de type kantien, qui fonde le constructivisme de type ontologique et abstrait, Schopenhauer se fait le chantre d’une sourde impulsion à vivre, antérieure à toute activité logique, que l’on peut saisir au plus profond de soi-même pour une appréhension directe avant sa déformation abstraite dans les cadres de l’espace et du temps, et qui se révèle comme une tendance impulsive et inconsciente. Schopenhauer, dans sa réflexion, reprend des motifs hérités du « divin Platon » dans l’allégorie de la caverne qui nous révèle que le monde que nous percevons est un monde d’images mouvantes.
Schopenhauer et le « Voile de Maya »
D’autre part, il empruntera à la tradition de l’Inde l’idée que les êtres humains sont enveloppés dans le « voile de Maya », c’est-à-dire plongés dans un monde illusoire. Schopenhauer restera persuadé que les fonctions psychiques ne représentent, par rapport à la réalité primaire et absolue du vouloir-vivre (Wille zum Leben) qu’un aspect secondaire, une adjonction, une superstructure abstraite. A la tentation de l’illusoire, de l’abstrait et de l’absurde, que l’on menait vers un pessimisme radicale, Schopenhauer proposait le remède de la négation du vouloir-vivre, une forme supérieure d’ascétisme.
A l’idée d’humanité, qui lui paraît absurde, il oppose des « modèles » éternels qu’il empruntera au platonisme. Cet emprunt lui sert à expliquer les types de phénomènes du vouloir dans l’espace et dans le temps, phénomènes reproduisant incessamment des modèles, des formes, des idées éternelles et immuables. Il y a des idées inférieures, ou des degrés élémentaires, de la manifestation du vouloir : pesanteur, impénétrabilité, solidité, fluidité, élasticité, magnétisme, chimisme ; et les idées supérieures qui apparaissent dans le monde organique et dont la série s’achève dans l’homme concret.
Transformant la primauté du vouloir-vivre schopenhauerien en primauté de la volonté de puissance, opposant au renoncement préconisé par Schopenhauer une affirmation-glorification de la volonté, Nietzsche se fait l’annonciateur de l’homme vital, de l’homme créateur de valeurs, de l’homme-instance-suprême, en même temps que de grands bouleversements qui préfigurèrent le nihilisme européen du XXième siècle. Et cela, au temps du positivisme abstrait et du constructivisme, c’est-à-dire à un moment où la prudence l’emporte et où la vie humaine paraît confortablement ancrée dans des institutions sécurisantes. Sur le chemin où l’homme européen s’est trouvé engagé jusqu’à présent, déterminé par l’héritage de l’Antiquité et par l’avènement du christianisme, la revendication de la vie chez Friedrich Nietzsche qui, par sa critique radicale et impitoyable de la religion, de la philosophie de la science, de la morale s’exprime à travers sa phrase lancinante : « Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite ».
Nietzsche : vitalisme et tragique
Le vitalisme de Nietzsche se révélera tout d’abord dans son œuvre La naissance de la tragédie, puis à travers la dichotomie qu’il institue entre l’esprit apollinien, créateur d’images de beauté et d’harmonie, et l’état dionysiaque, sorte d’ivresse où l’homme brise et dépasse les limites de son individualité. Apollon, symbole de l’instinct plastique, dieu du jour, de la clarté, de la mesure, force plastique du rêve créateur ; Dionysos, dieu de la nuit, du chaos démesuré, de l’informe, est pour Nietzsche le grand élan de la vie qui répugne à tous les calculs et à tous les décrets de la raison. Les deux figures archétypales sont pour Nietzsche la révélation de la nature véritable de la réalité suprême, l’antidote contre les structures existentielles et psychologiques abstraites et sclérosées. C’est dans cette optique que Nietzsche condamnera la révolution rationnelle de Socrate, dont il pense qu’elle a tué l’esprit tragique au profit de la raison, de l’homme abstrait et théorique.
Pour Nietzsche, être forcé de lutter contre les instincts, c’est la formule de la décadence : tant que la vie est ascendante, bonheur et instinct sont identiques. Avec Socrate et, après lui, le christianisme venant aggraver le processus, l’existence s’est, selon Nietzsche, banalisée sur la base d’un immense malentendu qui réside dans la morale chrétienne de perfectionnement, ce que Deleuze nommera plus tard la morale des dettes et des récompenses.
Ce que Nietzsche veut dévoiler, c’est la toute-puissance de l’instinct, qu’il tient pour fondamental : celui qui tend à élargir la vie, instinct plus fort que l’instinct de conservation tendant au repos, que la crainte alimente et qui dirige les facultés intellectuelles abstraites. La volonté créatrice chez l’individu est ce par quoi il se dépasse et va au-delà de lui-même ; il s’agit de se transcender et de s’éprouver comme un passage ou comme un pont. Le vitalisme de type héroïque conduira Nietzsche à dénoncer le nihilisme européen en y contribuant par sa philosophie « à coups de marteau » à se faire, à coups d’extases, l’annonciateur du surhomme et de l’Eternel retour face à l’homme abstrait et théorique et au mythe progressiste de l’humanité.
C’est ce qui fera dire à l’écrivain grec Nikos Kazantzaki qui appellera Nietzsche le « grand martyr », parce que Nietzsche lui a appris à se défier de toute théorie optimiste et abstraite.
Freud, apologiste des instincts vitaux
Avec Freud, nous pouvons quitter le domaine de la philosophie puisqu’il s’agit d’un médecin spécialisé en neuro-psychiatrie, dont toutes les théories en appellent à son expérience clinique. Mais il convient d’observer que les deux plans, celui de la réflexion philosophique et celui des sciences humaines ne peuvent être séparée abstraitement. Freud forgera, pour qualifier l’élargissement de ses théories, le terme de métapsychologie, en estimant que la réalité qu’il désigne est celle des processus inconscients de la vie psychique, qui permet de dévoiler ceux qui déterminent, par projection, les constructions métaphysiques. Freud, irrationaliste au sens ontologique du terme et apologiste des instincts vitaux du subconscient humain restera néanmoins un pessimiste biologique.
C’est ainsi qu’au regard des deux grands dissidents de la psychanalyse qu’il a créée, son pessimisme diffèrera de la confiance d’Adler dans la force ascensionnelle de la vie, comme de la vague nostalgie d’un paradis perdu qui imprègnera la pensée de Jung. Pour Adler, le besoin de s’affirmer chez l’être humain reste prédéterminant dans sa pensée, la vie est une lutte dans laquelle il faut nécessairement triompher ou succomber. Face aux abstractions de la raison qui nous menacent, la poussée vitale, ne peut être valablement appréhendée que d’une manière dynamique sous la forme de tendances, d’impulsions, de développement. L’essentiel pour comprendre l’être humain, ce n’est pas la libido et ses transformations, c’est la volonté de puissance sous ses formes diverses : auto-affirmation, amour-propre, besoin d’affirmer son moi, besoin de se mettre en valeur.
L’idée de communauté chez Adler
Adler identifie au sentiment social la force originelle qui a présidé à la formation de buts religieux régulateurs, en parvenant à lier d’une certaine manière entre eux les êtres humains. Le sentiment représente avant tout pour lui une tendance vers une forme de collectivité qu’il convient d’imaginer éternelle. Quand Adler parle de la communauté, il ne s’agit jamais pour lui d’une collectivité abstraite de type sociétaire actuel, ni d’une forme politique ou religieuse déterminée. Il faut entendre le terme au sens d’une communauté organique idéale qui serait comme l’ultime réalisation de l’évolution chez Carl Gustav Jung ; le pouvoir des archétypes n’est que la projection de l’affirmation de la vie face à la superstructure psychologique conditionnée par les contingences externes et abstraites.
Jung : l’inconscient originaire, source de vie
Jung dispose d’une véritable « vision du monde » à partir de données intrapsychiques et qui sont à la base de sa métapsychologie, ainsi que de sa psychologie analytique. Jung insiste sur l’origine même de la conscience, émergence dont il pense qu’elle s’est lentement développée par retrait des projections, ainsi que sur l’autonomie créatrice d’un inconscient impénétrable par un outillage biologique. Toutes ses élucidations sont inscrites dans la perspective d’un inconscient originaire, source de « vie », d’une ampleur incommensurable, et d’où surgit quelque chose de vrai. Pour lui, aucune théorie ne peut vraiment expliquer les rêves, dont certains plongent dans les profondeurs de l’inconscient. Il faut les prendre tels qu’ils sont : produits spontanés, naturels et objectifs de la psyché qui est elle-même la mère et la condition du conscient.
La doctrine de Jung postule l’existence de l’inconscient collectif, source des archétypes qui manifestent des images et des symboles indépendants du temps et de l’espace. Pour Jung, le psychisme individuel baigne dans l’inconscient collectif, source primaire de l’énergie psychique à l’instar de l’élan vital de Bergson. Selon Jung, l’homme moderne qui se trouve plongé dans des virtualités abstraites, a eu le tort de se couper de l’inconscient collectif, réalité vitale et objective, ce qui aurait creusé un hiatus entre savoir et croire.
Animisme, instinctivisme, symbolique ontologique
La sagesse jungienne débouche sur un anti-modernisme dont la condition de validité est que le monde eût été meilleur dans les époques à mentalité magique, qui privilégiait l’animisme, l’instinctivisme et le symbolisme ontologique par rapport au rationalisme abstrait et empirique des temps modernes. Avant d’aborder une succincte présentation de la philosophie à proprement parler existentielle, il convient de faire un détour sur une certaine forme d’irrationalisme philosophique que l’on peut qualifier d’existentialisme ou d’humanisme crispé et dont la figure de proue reste Jean-Paul Sartre.
La raison dialectique, issue de la révolution française, de Hegel à Marx, implique une critique de la raison classique, plus spécifiquement de la manière dont celle-ci concevait les principes d’identité et de non-contradiction ; et sa visée n’est plus de se détacher de la réalité historique et sociale pour la penser en dehors du temps, mais, au contraire, d’exprimer l’orientation même de cette réalité. C’est ainsi que Karl Marx décrétait, dans ses fameuses thèses sur Feuerbach, qu’il ne s’agit plus d’interpréter le monde, mais de le transformer.
Sartre et la totale liberté de l’homme
Ces remarques visent à situer l’attitude de Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste de l’engagement et de la liberté, hostile à tout retrait hors de la réalité historique et sociale. Promoteur au départ d’une conception irrationaliste de la liberté, il a voulu, à partir d’elle, exercer une action politique et sociale révolutionnaire, ce qui l’a forcément conduit à se rapprocher du courant de pensée communiste. Dans L’Etre et le Néant, Sartre entreprend de démonter la totale liberté de l’homme. Il veut prouver que la liberté humaine surgit dans un monde « d’existants bruts » et « absurdes ». La liberté, c’est l’homme lui-même et les choses au milieu desquelles elle apparaît : lieu, époque, etc., constituant la situation. Lorsque Sartre nous dit que l’homme est condamné à la vie et à la liberté, il faut entendre que celle-ci n’est pas facultative, qu’il faut choisir incessamment, que la liberté est la réalité même de l’existence humaine.
Quant aux choses abstraites dans lesquelles cette liberté se manifeste, elles sont contingentes au sens d’être là, tout simplement, sans raison, sans nécessité. Il y a donc pour Sartre, sur le plan ontologique, une dualité radicale entre la liberté (le pour-soi) et le monde (l’en-soi). Il n’en demeure pas moins que l’engagement marxiste-léniniste de Sartre dénote chez lui une certaine intégration dans les circuits abstraits d’une idéologie contestatrice pour ses débuts ; et réactionnaire dans l’après-68.
Chez Sartre, l’existentialisme consistait à intégrer dans le souci d’exercer une action politique et sociale et de la justifier, l’apport du courant hégélo-marxiste à une théorie ayant d’abord consacré le primat de la vie immédiate comme liberté absolue au sein d’une réalité parfaitement opaque ; effort qui confère à son humanisme une singulière crispation et le conduit irrémédiablement dans les méandres de l’abstraction idéologique.
A l’instar de cet existentialisme de type sartrien, la « philosophie de la vie » qui se développera du 19ième au 20ième siècle en Allemagne et en France privilégie les notions de vitalisme, de personnalisme, d’irréversibilité, d’irrationnel par rapport au statisme, à la logique, à l’abstrait, à la généralité et au schématisme. C’est dans ce courant de pensée que s’inscrit Henri Bergson, promoteur de l’idée « d’élan vital », qui s’oppose au mécanicisme, au matérialisme et au déterminisme.
L’Etre est conçu comme une force vitale qui s’inscrit dans son propre rythme, dans une donnée ontologique spécifique. L’intuition reste l’impératif pour tout être humain pour appréhender l’intériorité et la totalité. La vie reste et transcende la matière, la conscience et la mémoire et appelle l’élan d’amour qui seul est à même de valoriser l’intériorité, la liberté et la volonté créatrice.
Le vitalisme de Maurice Blondel
Le vitalisme de Maurice Blondel réside dans l’affirmation et la suprématie de l’action qui est la véritable force motrice de toute pensée. On peut déceler dans les conditions existentielles de l’action l’interaction d’une pensée cosmique, et Blondel proclamera que la vie « est encore plus que la vie ». Parallèlement à ce courant de pensée français s’insérant dans la philosophie de la vie, se développera une philosophie de la vie purement allemande, de type scientifico-spirituel, qui appréhendera le phénomène de la vie dans ses formes historiques, spirituelles et constituant une véritable école d’interprétation des phénomènes spirituels dans le cadre de la philosophie, de la pédagogie, de l’histoire et de la littérature.
Wilhelm Dilthey assimilera le phénomène de la vie sans a priori métaphysique au concept de la « compréhension » (Verstehen), avec des prolongements structuralistes et typologiques. Dans le sillage de son école se distingueront des penseurs tels que G. Mische, B. Groethuysen, Ed. Spranger, Hans Leisegang, A. Dempf. Dans cette continuité, Georg Simmel concluera que la vie, qui est par essence informe, ne peut devenir un phénomène que lorsqu’elle adopte une forme, ce qui suppose qu’elle doit elle-même se transcender pour être au-dessus de la vie. Dans le cadre de l’école structuraliste de la philosophie de la vie allemande, s’illustreront Oswald Spengler, qui décrivit le déclin de l’Occident comme une morphologie de l’histoire de l’humanité, et surtout Ludwig Klages, qui prophétisera la ruine du monde au nom de la suprématie de l’esprit, car l’esprit étant l’ennemi de la vie anéantit la croissance et l’épanouissement de la nature innocente et originelle.
De Chateaubriand à Berdiaeff
Chateaubriand disait, dans Les Mémoires d’Outre-tombe : « La mode est aujourd’hui d’accueillir la liberté d’un rire sardonique, de la regarder comme une vieillerie tombée en désuétude avec l’honneur. Je ne suis point à la mode, je pense que, sans la liberté, il n’y a rien dans le monde ; elle donne du prix à la vie ; dussé-je rester le dernier à la défendre, je ne cesserai de proclamer ses droits ». Nul autre penseur et écrivain que Nicolas Berdiaeff, le mystique aristocrate russe du 20ième siècle ne donnera autant de résonance à ces paroles en insistant constamment sur l’étroite correspondance entre la liberté et l’impératif de la vie face aux diverses séductions des strucures abstraites de la pensée, de la psychologie, de l’idéologie qui engendrent diverses formes d’esclavagisme. L’homme est tour à tour esclave de l’être, de Dieu, de la nature, de la société, de la civilisation, de l’individualisme, de la guerre, du nationalisme, de la propriété et de l’argent, de la révolution, du collectivisme, du sexe, de l’esthétique, etc.
Les mobiles internes de la philosophie de Berdiaeff restent constants depuis le début : primauté de la liberté sur l’être, de l’esprit sur la nature, du sujet sur l’objet, de la personne sur le général et l’universel, de la création sur l’évolution, du dualisme sur le monisme, de l’amour sur la loi. La principale source de l’esclavage de l’homme et du processus engendré par l’abstraction et l’illusion constructiviste réside dans l’objectivation et la socialisation à outrance de l’Etre, dans l’atomisation sociétaire et indivi-dualiste qui détruit les formes organiques de la communauté ; cette dernière est fondée sur l’affirmation de l’idée personnaliste et authentiquement aristocratique, donc différencialiste ; l’affirmation de la qualité en opposition avec la quantité, la reconnaissance de la primauté de la personne impliquant bien celle d’une inégalité métaphysique, d’une diversité, celle des distinctions, la désapprobation de tout mélange.
Berdiaeff, en dénonçant toute forme de statolâtrie, a considéré que la plus grande séduction de l’histoire humaine est celle de l’Etat dont la force assimilante est telle qu’on lui résiste malaisément. L’Etat n’est pas une personne, ni un être, ni un organisme, ni une essentia ; il n’a pas son existence propre, car il n’existe que dans et par les hommes dont il se compose et qui représentent, eux, de vrais centres existentiels. L’Etat n’est qu’une projection, une extériorisation, une objectivation des états propres aux hommes eux-mêmes. L’Etat qui fait reposer sa grandeur et sa puissance sur les instincts les plus bas peut être considéré comme le produit d’une objectivation comportant une perte complète de la personnalité, de la liberté et de la ressemblance humaine. C’est l’expression extrême de la chute. La base métaphysique de l’anti-étatisme chez Berdiaeff est constituée par le primat de la vie et de la liberté de l’être, de la personne, sur la société.
Miguel de Unamuno et l’homme concret
Dans le prolongement de Berdiaeff, et pour conclure, Miguel de Unamuno, dans son œuvre Le sentiment tragique de la vie, proclamera la suprématie de la concrétude de la personne face à l’humanité abstraite par cette phrase : « Nullum hominem a me alienum puto ». Pour lui, rien ne vaut, ni l’humain ni l’humanité, ni l’adjectif simple ni le substantif abstrait, mais le substantif concret : l’homme. L’homme concret, en chair et en os, qui doit être à la base de toute philosophie vraie, qui se préoccupe du sentimental, du volitionnel, de la projection dans l’infini intérieur de l’homme donc de la vie et d’un certain sentiment tragique de la vie qui sous-entend le problème de notre destinée individuelle et personnelle et de l’immortalité de l’âme.
Maître Jure VUJIC.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, vitalisme, littérature, psychanalyse, nietzsche, existentialisme, sartre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 juillet 2008
Nietzsche vu par Deleuze
Francesco INGRAVALLE:
Nietzsche vu par Deleuze
Edité en Italie par Bertani en 1973, puis, dans une seconde édition, en 1978, le travail de Gilles Deleuze sur Nietzsche avait été publié pour la première fois en France en 1965. Il s’agit principalement d’une anthologie, précédée d’une introduction magistrale, où l’auteur propose une nouvelle fois ses interprétations de la pensée du philosophe allemand qu’il avait préalablement consignées dans son ouvrage de 1962, intitulé “Nietzsche et la philosophie”.

Selon le rédacteur de l’introduction à cette édition italienne, Nietzsche marque de son sceau une étape de la crise la plus aiguë du rationalisme occidental, c’est-à-dire l’étape où la réalité “plane”, systémique, se transforme en un complexe de contradictions et de conflits. La philosophie a donc pour tâche non plus de soutenir l’ordre existant et de résoudre les contradictions qui y surgissent mais de refléter les contradictions elles-mêmes.
La réalité n’est pas “une”; il n’existe pas “une” vérité; il existe en revanche un usage politique de la “vérité”, ce qui nous amène à constater qu’il y de nombreuses vérités. Il est dès lors nécessaire de mobiliser nos attentions pour capter les fonctions politiques des vérités existantes, ce qui revient à détruire et les vérités et les certitudes.
Comme Freud avait découvert la matrice sensuelle de tout agir humain (la libido) et comme Marx avait mis en lumière la matrice économique des vicissitudes historiques et politiques ainsi que des idées, Nietzsche, pour sa part, a découvert (ou contribué à faire découvrir) la matrice politique du problème de la vérité par le biais de son travail d’arrachage de tous ses masques que se donnent les vérités et les certitudes.
Dans la perpsective que nous suggère cette nouvelle introduction italienne au travail de Deleuze, nous pourrions utiliser le Nietzsche démystificateur de la “Vérité” pour remettre en question le “noyau métaphysique de Marx”, c’est-à-dire cette notion d’objectivité fondée sur un mode inconditionné et ingénu, typique des problématisations auxquelles Marx fit face pendant toute l’époque de l’idéalisme allemand (grosso modo entre les dernières années du 18ième siècle et les deux premières décennies du 19ième).
Quant à l’essai d’introduction de Gilles Deleuze lui-même, il met en avant l’anti-métaphysique de Nietzsche; par le truchement de positions où les valeurs sont décrétées supérieures à la Vie , la philosophie se pose comme juge de la Vie et ne tarde pas, alors, à s’opposer à elle. Une philosophie de cet acabit dérive de Socrate: “si l’on définit la métaphysique par la distinction entre deux mondes, en opposant l’essence à l’apparence, le vrai au faux, l’intelligible au sensible, alors, oui, on peut dire que Socrate a inventé la métaphysique (...)”.
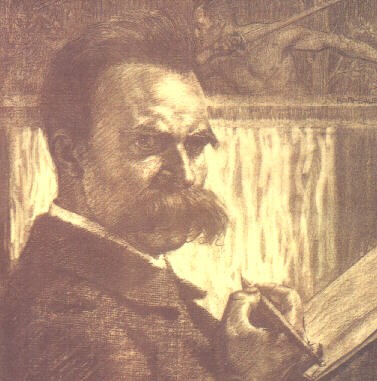
Et c’est là que Deleuze affronte l’un des points nodaux les plus complexes dans les interprétations de la pensée de Nietzsche, celui que pose la notion de “volonté de puissance”. Selon Deleuze, cete “volonté de puissance” nietzschéenne ne doit pas se comprendre comme un brame véhément, réclamant pouvoir et domination. Il s’agit bien plutôt d’un principe qui compénètre tous nos jugements de valeur. Ce principe consiste à “créer” et à “donner”, non à prendre, à confisquer. Si l’on considère, au contraire, que cette “volonté de puissance” est le “brame du dominateur”, alors l’on pense, implicitement, que la volonté “veut” la puissance. Au contraire, Nietzsche retient l’idée que la puissance est, à l’intérieur même de la volonté, l’origine même du vouloir. De ce fait, la “volonté de puissance” nait de la “plénitude”, de la “santé”. Dans une optique différente, elle peut en arriver à cette “volonté de puissance” dont parle le psychanalyste Alfred Adler, c’est-à-dire un besoin d’affirmation de soi qui, s’il est frustré, génère les névroses. On peut donc dire, avec Nietzsche et avec Deleuze, que la “volonté de puissance” est le désir compris non comme un besoin mais plutôt comme une “nécessité de créer”. La créativité, ainsi comprise, se distingue de la simple “réactivité”. La volonté de puissance comme “brame” réclamant le pouvoir est à l’origine des morales d’esclaves, du ressentiment de ceux qui sont malades contre ceux qui sont en bonne santé.
Deleuze poursuit en présentant les quatre modes de la “transvaluation de toutes les valeurs”. Par dessus tout, Deleuze précise que, par le terme “transvaluation”, il entend un devenir actif des forces, le “triomphe de l’affirmation dans la volonté de puissance”, le “oui” à la Vie. C ’est à ce moment-là que la pensée nietzschéenne s’attaque à tout ce qui jusqu’alors avait été retenu comme sacré (Dieu, la morale bourgeoise), en retenant ces choses décrétées sacrées comme autant de sacrilèges contre la Vie , de menaces de la réaction contre la créativité.
Le premier mode de la “transvaluation” est le refus de la négation nihiliste du multiple au profit d’un “Un” fallacieux, que les philosophes nomment l’Etre. Le multiple et le devenir sont affirmés, chez Nietzsche, non en tant qu’instances que l’on pourrait ramener à l’Un et à l’Etre, mais en tant que tels et rien que tels. Le second mode de la “transvaluation” est l’affirmation de l’affirmation précédente du devenir, symboliquement représentée par le dieu affirmateur de la Vie (Dionysos) et par son épouse (Arianne). Le troisième mode, Deleuze l’appelle le “jeu de l’Eternel Retour”. Nietzsche entend l’Eternel Retour selon diverses acceptions: soit comme retour du même (“tout se répète”) et c’est là une certitude qui rend malade et faible; soit comme l’Eternel Retour “sélectif”, notion pour laquelle ne revient que ce qui est affirmation de la Vie : “toute chose que je veux (...), je dois le vouloir de façon telle à en vouloir aussi l’Eternel Retour (...). Même une bassesse ou une paresse veulent leur éternel retour pour devenir autre chose qu’une paresse ou une bassesse: elles veulent devenir active et, de ce fait, potentialité d’affirmation”. L’Eternel Retour est certes répétition mais répétition qui sélectionne.
La transvaluation présente un quatrième et dernier aspect qui implique l’émergence du “surhomme” et le produit. Le “surhomme”, dans la terminologie nietzschéenne désigne exactement la concentration de tout ce qui peut être affirmé, la forme supérieure de ce qui est, le type qui représente l’Etre sélectif, le produit et la subjectivité de cet être”.
Les textes qu’a choisis Deleuze pour la partie anthologique de son travail sont répartis en sections: selon l’image du philosophe aux diverses périodes de sa vie et dans les différents horizons culturels qu’il a fréquentés; une section est consacrée à la philosophie dionysiaque, d’autres à la volonté de puissance, au nihilisme et à la transvaluation, à l’Eternel Retour et à la folie.
En appendice de cette éditions italienne, nous trouvons également le fameux essai de Georges Bataille, intitulé “Nietzsche et les fascistes” (repris en version italienne de la revue “Il Verri”, n°39-40, 1972). Les pages de Bataille fourmillent d’évocations à des fascistes falsificateurs, à des nazis malveillants et perfides; il y pose la soeur de Nietzsche en une sorte de Judas Iscariote au féminin; le cousin de Nietzsche, Richard Oehler, est associé à ces terribles figures dans une intrigue à mi-chemin entre le mélodrame et le roman gothique. Pour Bataille, ce qui est “mauvais”, c’est l’usage politique qu’ils ont fait de Nietzsche, que ce soit l’usage révolutionnaire ou l’usage réactionnaire. Pour démontrer sa thèse, Bataille passe en revue les textes du jeune Mussolini, d’Alfred Rosenberg, d’Alfred Bäumler, explore le petit univers du néo-paganisme allemand de manière assez honnête, et finit par conclure “que la pensée aporétique de Nietzsche ne se dirige pas vers des mesquineries contingentes à la merci d’une liberté ombrageuse”.

Cette diabolisation de l’interprétation politique de Nietzsche nous laisse perplexe, pour le simple motif que Bataille, qu’il le veuille ou non, donne, lui aussi, une interprétation politique de Nietzsche: il voit en ce philosophe allemand le théoricien de la foi qui arrachera le destin de l’humanité à l’asservissement rationnel de la production et à l’asservissement irrationnel du passé; c’est là, sans aucun doute, une interprétation politique. L’interprétation de Bataille est en plus liée aux contingences politiques, celles de la période nationale-socialiste, vu que les interprétations nationales-socialistes et celle de Bataille sont nées de la crise si complexe qu’a traversée l’esprit occidental. Alors, interprétation politique pour interprétation politique, il nous paraît opportun, ici, de citer ce qu’écrivait Adriano Romualdi en 1970 dans l’introduction à son anthologie de la pensée politique de Nietzsche: “Que serait Rousseau sans la révolution française? Ou Marx sans la révolution russe? Il me paraît secondaire de se poser la question de savoir si la révolution française incarne le “vrai” Rousseau ou si la révolution russe incarne le “vrai” Marx. De la même manière, nous sommes contraints aujourd’hui de lire Nietzsche en tenant compte d’Hitler” (A. Romualdi, “Nietzsche”, Ed. Ar, Padova, 1970).
Elevons le débat: tant l’interprétation de Deleuze (et son choix de textes) que l’essai de Bataille ne contribuent que bien peu à faire passer le philosophe allemand du “panthéon national-socialiste” au “panthéon démocratique”. De fait, il est impossible de nier l’existence, dans la pensée de Nietzsche, la présence de distinctions entre la “santé” et la “maladie” (entre l’actif et le réactif), distinctions qui constituent les bases d’une pensée qui, quoi qu’on puisse en dire, reste antidémocratique et hiérarchique. Il est clair aussi que l’on ne peut pas définir Nietzsche, de manière simpliste et simplificatrice, comme un “national-socialiste”, vu la forte composante démocratique et populaire du national-socialisme allemand. Si Nietzsche brocardait le pangermanisme et l’antisémitisme en les désignant comme des manifestations de l’esprit plébéien et démocratique, il aurait très probablement pris une posture analogue face au national-socialisme. Mais cette probabilité n’autorise personne à le faire passer avec armes et bagages sur la voie radieuse du socialisme.
Ironie du sort, Deleuze confirme, dans son essai d’introduction, une intuition très présente dans un essai sur Nietzsche du philosophe national-socialiste Bäumler, intuition qui porte sur la centralité du concept de volonté de puissance dans la philosophie de Nietzsche. Si l’intention du travail de Deleuze a été indubitablement de “dénazifier” Nietzsche, de l’homologuer dans l’espace libéral-démocratique en réduisant sa pensée à un discours politique non hiérarchisant ou, du moins, anti-autoritaire et, partant, néo-démocratique, le résultat de ses efforts n’aboutit pas à faire passer cette intention de départ. Il suffit de lire le livre pour s’en convaincre.
Francesco INGRAVALLE.
(recension parue dans “Diorama Letterario”, Florence, n°17, février 1979; reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur; trad. franç.: Robert Steuckers; titre du livre recensé: Gilles Deleuze, “Nietzsche”, con antologia di testi - introduzione di franco Rella e appendice di Georges Bataille, Bertani ed., Verona, 1978).
00:14 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : philosophie, gilles deleuze, nietzsche, allemagne, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




