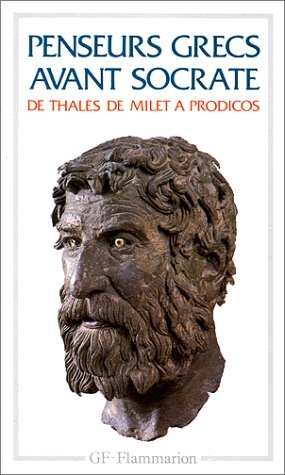 To understand why Europeans were the progenitors of the highest accomplishments in history – close to one hundred percent of the great ideas in philosophy, science, anthropology, sociology, economics, geography, geology, astronomy, mathematics, architecture, technology, dance, and music – you must understand the Presocratic self-conscious separation of the knowing “I” from the “not-I.” The Presocratics were the first humans to discover that they have a mind that is the seat of thinking and thus of knowledge, the only agency in the whole realm of nature able to separate itself from everything that is not its own, as well as making itself “a possible object of thought to itself,” as Aristotle would put it in a clear-cut manner later on [On the Soul, Bk. III: Ch. 4, 429b]. The Presocratics were the first men to detach their ego consciousness from the surrounding natural world, establishing their thinking “I” as the cognitive center, the decision-maker as to what makes truthful statements possible, in contradistinction to traditions handed down without reflection, the voices of gods and demons.
To understand why Europeans were the progenitors of the highest accomplishments in history – close to one hundred percent of the great ideas in philosophy, science, anthropology, sociology, economics, geography, geology, astronomy, mathematics, architecture, technology, dance, and music – you must understand the Presocratic self-conscious separation of the knowing “I” from the “not-I.” The Presocratics were the first humans to discover that they have a mind that is the seat of thinking and thus of knowledge, the only agency in the whole realm of nature able to separate itself from everything that is not its own, as well as making itself “a possible object of thought to itself,” as Aristotle would put it in a clear-cut manner later on [On the Soul, Bk. III: Ch. 4, 429b]. The Presocratics were the first men to detach their ego consciousness from the surrounding natural world, establishing their thinking “I” as the cognitive center, the decision-maker as to what makes truthful statements possible, in contradistinction to traditions handed down without reflection, the voices of gods and demons.
It is barely possible today to say that the Greek achievement was unique and even less possible to speak of a “Greek miracle.” The situation is so bad in our pathological universities that some academics are now insisting that to teach about the foundational role of the Greeks in the making of Western civilization is “a slippery slope to white supremacy.” This is the culmination of many decades of “novel” interpretations by classicists themselves, starting with the claim that the Greeks were not original but ungrateful imitators of their “African and Asian neighbors.” Postmodernists have long been trying to persuade white students that Greek-European rationality is itself mythological or, conversely, that there are other rationalities – Bantu, Aztec, and Hindu – no less valuable than Western rationality.
A major flaw in attempts to downgrade the ancient Greeks is that no matter how many links may have been established between the ancient Greeks (and Western peoples generally) with other cultures, it is always the Europeans who do the achieving, who brought forth the invention of universities, the twelfth-century Renaissance, the Papal Revolution, the invention of mechanical clocks, the discovery and mapping of the world, “an extraordinary burst of innovations in microscopy, human anatomy, optics, electrical studies, and the science of mechanics during the sixteenth and seventeenth centuries,” the Enlightenment, and the Industrial Revolution. Another flaw is that it is hard to hide the far superior achievements of the ancient Greeks in multiple fields of knowledge and the arts compared to the meager achievements of other Axial Age civilizations in religion and conventional ethics.
In response to the now-institutionalized downgrading of the Greeks, I decided to study recent defenses of the traditional view of the Greeks as an exceptional people. I also decided to read Havelock’s Preface to Plato, a now classic book which can be fruitfully understood as a study of the birth of self-consciousness, rather than as a mere study of the rise of a literate, alphabetic culture over an oral culture, or a defense of Plato’s attack on the poetic tradition.
André Laks, The Concept of Presocratic Philosophy: Its Origin, Development, and Significance (2006 in French, 2018 in English).
Maria Michela Sassi, The Beginnings of Philosophy in Greece (2009 in Italian, 2018 in English).
Christopher Lyle Johnstone, Listening to Logos: Speech and the Coming of Wisdom in Ancient Greece (2009).
Constantine J. Vamvacas, The Founders of Western Thought: The Presocratics (2001 in Greek, 2009 in English).
Eric A. Havelock, Preface to Plato (1963).
[2]The Concept of Presocratic Philosophy
I will write a brief exegesis of each book in the order in which I read them. Laks’s book is a historiographical survey of “the various senses in which Presocratic philosophers [were] considered Presocratic” from ancient to contemporary times (35). For a long time, beginning with Aristotle and Diogenes Laertius (third century AD, author of a biography of Greek philosophers, Lives and Opinions of Eminent Philosophers [3]), the Presocratics were viewed as “natural philosophers” who conducted inquiries into nature – the “principle” or “substrate” in Aristotle’s words – “of which all beings are made,” the way in which the universe and the Earth were formed, including the study of specialized topics such as the distance and size of the heavenly bodies, the luminosity of the Moon, the causes of earthquakes, and the origins of living things. They were seen as the “first ones to philosophize” about the nature of things. Hegel continued this “Aristotelian” interpretation of the Presocratics, but Nietzsche criticized this idea and focused instead on the “tragic” element in early Greek culture and the power of myths, while Heidegger reinterpreted Presocratic writings not as inquiries into the nature of things but as inquiries into man’s relationship-of-Being towards the “world.” Then came Horkheimer and Adorno, members of the Frankfurt School, blaming the Presocratics for starting the Western presumption that its own particular form of thinking was disinterested and purely concerned with the pursuit of truth. It was, rather, a will to dominate nature, not superior to mythological accounts but a myth itself, a totalitarian myth seeking to displace other forms of thinking. Anthropologists welcomed this critique, “by showing either that rationality is at work in myth itself or that there are other rationalities besides Western rationality” (37).
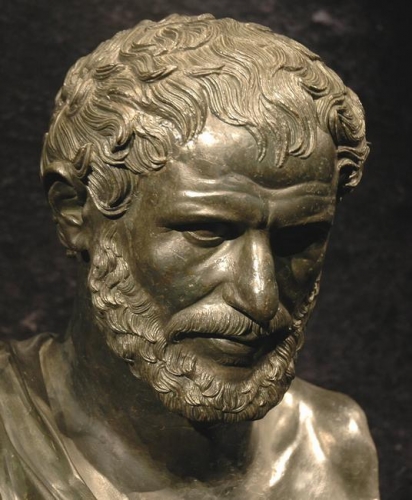 Laks brings up studies about the “Orientalizing” aspects of Greek culture, borrowings from the Near East, briefly mentioning Jaspers’ thesis about similar breakthroughs elsewhere in the world from mythology to rationality during the Axial Age period between 800 and 200 BC. He also pays particular attention to J. P. Vernant’s central book, The Origins of Greek Thought (1962), and its claim that there was no “Greek miracle” in the sense that Greek reason did not arise suddenly out of some innate Greek genius but was a product of the democratizing political atmosphere within the city-states, which encouraged debate and a form of rationality that was then extended to the study of nature.
Laks brings up studies about the “Orientalizing” aspects of Greek culture, borrowings from the Near East, briefly mentioning Jaspers’ thesis about similar breakthroughs elsewhere in the world from mythology to rationality during the Axial Age period between 800 and 200 BC. He also pays particular attention to J. P. Vernant’s central book, The Origins of Greek Thought (1962), and its claim that there was no “Greek miracle” in the sense that Greek reason did not arise suddenly out of some innate Greek genius but was a product of the democratizing political atmosphere within the city-states, which encouraged debate and a form of rationality that was then extended to the study of nature.
Laks wants to defend the older Aristotelian interpretation, but in a way that acknowledges more recent interpretations, making his more than 100-page book a rather weak (never elaborated) defense of the “new rationality” of the Presocratics. He spends a chapter valuing Ernest Cassirer’s early twentieth-entury writings on the Greeks, closing the book with a nice “Hegelian” passage from Cassirer that “Greek philosophy can be characterized to a certain extent as the first manifestation of the act of thinking itself: as a thought that in the midst of its pure movement gives to itself its content and its firm configuration.” This great passage, however, is left hanging without explanation. Laks does not explain what it means for thought to give itself its own content, but instead offers a rather unclear and contorted summation of the relationship between Cassirer’s philosophy of symbolic forms and Greek thought.
The Beginnings of Philosophy in Greece
Maria Sassi’s book is a more decisive defense of the Aristotelian interpretation. The Presocratics were responsible for the birth of philosophy, the cultivation of a “rationalistic” approach to the study of nature, and “the elaboration of a critical stance toward received opinions” (xiv). She gives serious attention to the “revisionists” and acknowledges early influences from the Near East and the continued presence of magic, mythological motifs and soteriological aspirations among the Greeks, while explaining, nevertheless, how Presocratic thought “represents a truly new contribution to the understanding of the nature of things . . . an epochal break from the structure of the mythological cosmogonies” (xv-xvi).
Rather than emphasizing the link between Greek philosophy and the rise of the city-states, Sassi pays attention to the role of prose writing during the second half of the fifth century in expressing and solidifying “rational argumentation.” She objects to the way an “anticlassicistic trend has become mandatory” in academia; the way academics today are “obsessed with the need to push as far back as possible the infancy of philosophy, to the point of causing philosophy to ‘disappear’ into myth” (14-15). She mentions the “indebtedness” of archaic Greece to the Semitic East, “from technology to medicine to mythology,” but insists that after the Homeric Age “logos gains more and more importance as the designation of speech that does not depend on tradition but only needs to be evaluated with respect to its internal organization . . . in the context of argumentative strategies” (19).
[4]She believes that Aristotle was correct in identifying the Presocratics as the first philosophers of nature in their search for the “principle” of things and something ultimate beneath the sensory variations we observe in nature without appealing to any divine force. Already in Hesiod (700 BC), we have the first author in history “to talk about himself in the first person” rather than anonymously, as was the case in the Near East. This is an important observation Sassi makes, though, without explaining why writing in the first person was such a significant attribute of Greek originality. We will see below that speaking in the first person, using your name to signal that you are the author (authority) of your ideas, was part of the expression of the Presocratic liberation of the self from external controls and obfuscations. They were the first humans to discover the self and to separate the knower from the immemorial grip of traditional myths. Hesiod is just the beginning; he was still inhabiting a world of myths, but, as Sassi tells us, he was the first to compose a systematic genealogy of the gods, “an organizational system for the gods’ respective spheres of influence . . . exhibiting unprecedented, encyclopedic ambition, with the aim of presenting his own arrangement as the right one” (32-33, her italics). Hesiod wants to know, in his words, “how in the beginning the gods, the earth and the rivers were born, and the boundless sea seething with its swell, and the bright stars and the broad sky above.” Sassi shows that there is “a logic in this [Hesiod’s] cosmogony. Rather than the product of a mytho-poetic process, it appears to be the result of a series of systematic choices stemming from an original reflection” (36).
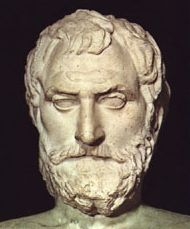 Beginning with Thales’ use of a common noun, water, rather than a mythic name, as the ultimate source of all things, Anaximander (610-546 BC), writing some forty years after his teacher Thales, would try to locate in a precise sequence the increasing distance from the Earth of the Moon, Sun, and stars. Anaximander wrote about heavenly bodies as impersonal forces without any anthropomorphic traits, using a language “keen on processes of abstraction and conceptualization” (41). Even in political thinking, one finds in the works of Solon an emphasis on human responsibility for their own misfortune and a denial of intentionality on the part of gods. Around 500 BC we have Heraclitus describing the universe as a kosmos, an orderly arrangement characterized by regularity without divine influences. She notes the “pointedly polemical character” of Heraclitus’ writing and, indeed, how each Presocratic thinker, from Heraclitus on, proposed a new theory in self-conscious refutation of preceding theories, engaging in “second-order questions” as to why their theoretical approaches were superior to previous assessments. Sassi says that this “self-conscious knowledge” bespeaks of thinkers who were increasingly aware that knowledge flows out of their own knowing minds in competition with other rationalizing minds. She cites Heraclitus’ proclamation, “I went in search of myself,” in order “to stress that he extrapolated the contents of logos from an isolated and highly personal reflection” (73). She notes as well how Heraclitus developed a conception of the psyche as the source of cognition away from the Homeric notion of the psyche as vital breath. Knowledge is the product of the activity of the psyche.
Beginning with Thales’ use of a common noun, water, rather than a mythic name, as the ultimate source of all things, Anaximander (610-546 BC), writing some forty years after his teacher Thales, would try to locate in a precise sequence the increasing distance from the Earth of the Moon, Sun, and stars. Anaximander wrote about heavenly bodies as impersonal forces without any anthropomorphic traits, using a language “keen on processes of abstraction and conceptualization” (41). Even in political thinking, one finds in the works of Solon an emphasis on human responsibility for their own misfortune and a denial of intentionality on the part of gods. Around 500 BC we have Heraclitus describing the universe as a kosmos, an orderly arrangement characterized by regularity without divine influences. She notes the “pointedly polemical character” of Heraclitus’ writing and, indeed, how each Presocratic thinker, from Heraclitus on, proposed a new theory in self-conscious refutation of preceding theories, engaging in “second-order questions” as to why their theoretical approaches were superior to previous assessments. Sassi says that this “self-conscious knowledge” bespeaks of thinkers who were increasingly aware that knowledge flows out of their own knowing minds in competition with other rationalizing minds. She cites Heraclitus’ proclamation, “I went in search of myself,” in order “to stress that he extrapolated the contents of logos from an isolated and highly personal reflection” (73). She notes as well how Heraclitus developed a conception of the psyche as the source of cognition away from the Homeric notion of the psyche as vital breath. Knowledge is the product of the activity of the psyche.
Sassi could have said more about how Heraclitus connected his conception that there is a rational order in the world, a logos, with the idea that the logos is present within the inner self in the degree to which the psyche is self-conscious of being the source of knowledge (115). The logos can only be revealed to humans who know that their minds are the agency through which the rationality of the world can be revealed. In order to achieve knowledge, the individual must be self-conscious of his psyche as the repository of knowledge, as the only vehicle through which the logos of the world can be understood. By looking “within themselves,” inside their thinking minds, humans can reveal the logos that is outside them.
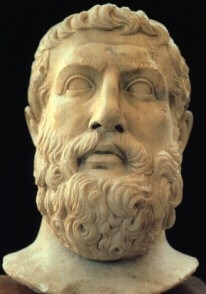 Sassi contrasts as well the “conservation” role of writing in the Near East, which remained religious and was “composed anonymously within a circle of priests and then copied for centuries without any conceptual changes” (75), to the writing of the Greeks, which was open to everyone. She estimates that about thirty percent of male citizens in the polis were able to read and write. The Greeks adopted prose writing in the last decades of the fifth century, she says, in their “search for directness and unambiguousness” and their preference for truths freed from the “restraints of prosody,” and in contradistinction to the texts of Mesopotamia with their “revelations of a preestablished traditional” worldview immune “from authorial interventions” (142). Herodotus’ Histories was the “first extended prose narrative of Greek literature,” followed by Zeno, Melissus, the Pythagoreans, Anaxagoras, Leucippus, and Democritus. This was a prose “rich in elaborate syntactical structures in unison with a linguistic inquiry that prefers precision over metaphors and evocative expressions” (171).
Sassi contrasts as well the “conservation” role of writing in the Near East, which remained religious and was “composed anonymously within a circle of priests and then copied for centuries without any conceptual changes” (75), to the writing of the Greeks, which was open to everyone. She estimates that about thirty percent of male citizens in the polis were able to read and write. The Greeks adopted prose writing in the last decades of the fifth century, she says, in their “search for directness and unambiguousness” and their preference for truths freed from the “restraints of prosody,” and in contradistinction to the texts of Mesopotamia with their “revelations of a preestablished traditional” worldview immune “from authorial interventions” (142). Herodotus’ Histories was the “first extended prose narrative of Greek literature,” followed by Zeno, Melissus, the Pythagoreans, Anaxagoras, Leucippus, and Democritus. This was a prose “rich in elaborate syntactical structures in unison with a linguistic inquiry that prefers precision over metaphors and evocative expressions” (171).
The Greeks knew they had a mind intended for thought. This found expression in their determination to stand out as singular authors capable of relying on their own minds, as testified in their increasing use of “I” when formulating a new argument. Herodotus used the first person 1,087 times, to show his authorial presence in his understanding of the Persian wars, “accompanied by a growing focus on methodological questions, such as the role of empirical observation and the evaluation of symptoms/testimonies as proof of an argument” (173). What they claim to know are the reflections of their own minds.
Sassi knows there is a relationship between the redefinition of the psyche as the source of reasoning and the pursuit of truth, the emphasis on authorial responsibility, the emergence of prose writing, and the description of the nature of things through the use of increasingly abstract concepts. But she never says in a clear-cut manner that the essential achievement of the Presocratics, which made possible their magnificent creativity in multiple fields, and which laid the grounds for Socrates and after, was their discovery that knowledge ultimately comes from the faculty of the mind, the ability of the thinking self to turn in upon itself as the one self-conscious agent in the universe that is capable not only of knowing but of knowing that it is the agent that can decide what it means to know.
Listening to the Logos
Only one-third of Christopher Johnstone’s book is about the Presocratics, and he does not engage with postmodernists or multicultural revisionists. Nevertheless, he offers a tighter account of the relationship between the invention of alphabetic writing, the appearance of prose composition, the discovery of the mind, the rise of a consciousness “rooted in a distinction between the knower and the known,” and the idea that the psyche of man, “in its deepest nature,” is logos. He also brings out in a slightly acuter way the seminal ideas of Eric Havelock. In the end, however, Johnstone’s conclusion about the exact contribution of the Presocratics is similar to Sassi’s. The Presocratics, he writes, offered a new understanding of the world “from a purely mythopoetic view to include a naturalistic/philosophical orientation” (2). This conclusion is flawed in giving the impression that the Presocratics merely originated a rational and critical approach to the study of nature that would culminate in modern science. But Johnstone does have a keener sense, though he never says it directly, about the Presocratic discovery of the faculty of the mind as the only authorial agency that can be trusted in the pursuit of truth.
[5]He explains well that mythical accounts as such are not irrational insofar as they are efforts to make sense of the world, to give meaning and order “to the variety and variability in what happens around us and of apprehending the causes behind events”. A myth is a story, “a narrative that enables a people – a tribe, a clan, a culture – to make sense of the mysterious,” how things came into being, where did we come from, and who are our original ancestors. Myths allow individuals and groups to “fit into” the order of things, to find a moral ground for action, and a means to pass from one generation to another the most fundamental truths of a people. Using Jean Piaget’s language [6], we can say that myths are accounts by a people who don’t have the cognitive capacity to engage in formal operational thinking, though they do have a capacity to engage in concrete operational thinking in their daily survival strategies. If we identify rationality with formal thinking and the ability to offer explanations of natural events without appealing to, or appeasing, gods and demons, then the Presocratics were the first to rely on rational concepts.
But this Piagetian emphasis on formal rationality does not hit the spot. Mythological people are unable to understand the real causes behind events precisely because they lack consciousness of their consciousness and have no concept of an “I” in separation from the world around them. They are overwhelmed by multifarious forces within and without, feelings and instincts, noises and natural events, storms and hurricanes, the darkness of the forests, the vastness of the sea and the sky, all intermingled with their dreams, fears, emotions, and appetites. Johnstone brings Julian Jaynes’ view about the inability of the Homeric Greeks to identify the logos within them, their own minds as the locus of the “I” in distinction from what lies outside the self. The characters of the Iliad, he cites Jaynes, “do not sit down and think out what to do. They have no conscious minds such as we say we have, and certainly no introspections . . . The beginnings of action are not in conscious plans, reasons, and motives; they are in the actions and speeches of gods.” He also cites Bruno Snell’s estimation that “in Homer every new turn of events is engineered by the gods . . . For human initiative has no source of its own” (20).
I have written about [7] the immense value of Jaynes and Snell in identifying the emergence of “consciousness of consciousness” after Homer as a pivotal factor in ancient Greek culture. I will not rehearse the limitations in Jaynes and Snell except to say that their denial of introspection in the Iliad went too far. I see the Iliad as a transitional work exhibiting signs of free deliberation. Jaynes also confounded matters in attributing the emergence of self-consciousness to external historical factors, such as the weakening and collapse of theocratic empires, the intermingling of peoples from different nations with different beliefs, which supposedly weakened the “auditory power” of gods and the rigid norms occupying the brains of peoples. His explanation that the development of a language sophisticated enough to produce metaphors of “me” and of “analog I” made matters even more confounding since the Iliad is packed with some of the best metaphors in Western literature. Snell, for his part, never offered an explanation as to how the “inner self” suddenly emerged in Greek lyrical poetry after 650 BC.
Johnstone deserves credit for bringing up some key passages from Jaynes and Snell. Most Classicists today don’t even know Jaynes, and the few who have read Snell are under the delusional belief that their hyper-specialized research about trivial subjects stands above his “dated” ideas. In a strong way, Johnstone incorporates Havelock’s ideas. In my estimation Havelock’s book, Preface to Plato, published in 1963, is similarly important in identifying the emergence of self-conscious personalities as the central breakthrough of the Greeks. Unfortunately, Havelock misdirected attention from this insight by attributing the origins of Greek self-consciousness to the rise of a new “technology of communication,” or the “invention of alphabetic writing” per se. Every time Havelock’s name comes up, it is about his “theory” that alphabetic writing engendered a different attitude of mind, or, in the words of Johnstone, about how the transition from an oral to a literate culture “induce[d] a form of consciousness rooted in a distinction between the knower and the known” (39). As I see it, alphabetic writing, the fact that Greek prose came to be “characterized by unparalleled lucidity,” to cite Vamvacas, “precision, suppleness, and aesthetic dexterity” (7), was itself a manifestation of the self-awareness and self-knowledge developed by the Greeks in tandem with their uniquely aristocratic lifestyle and ethos of personal heroism.
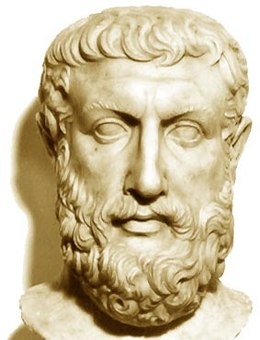 Johnstone’s account is thus limited in its focus on alphabetic writing as such, which leads him to ponder about other “conditions . . . that incubated the seeds of Western scientific and philosophical thought.” He brings up the city of Miletos, from which the first Presocratics came, as a location at the “crossroads for east and west.” He says that exposure in this city “to a wide variety of mythic traditions and to alternative ways of understanding” somehow produced, in the words of an academic he cites, “a breakthrough in man’s thinking, a shift toward rationalism” (38). Academics love this stuff about diverse cities creating cultural “enrichment.” They never care to ask why the far older cosmopolitan cities of the Near East failed to produce any rationalism and why whites are always the ones responsible for new ideas.
Johnstone’s account is thus limited in its focus on alphabetic writing as such, which leads him to ponder about other “conditions . . . that incubated the seeds of Western scientific and philosophical thought.” He brings up the city of Miletos, from which the first Presocratics came, as a location at the “crossroads for east and west.” He says that exposure in this city “to a wide variety of mythic traditions and to alternative ways of understanding” somehow produced, in the words of an academic he cites, “a breakthrough in man’s thinking, a shift toward rationalism” (38). Academics love this stuff about diverse cities creating cultural “enrichment.” They never care to ask why the far older cosmopolitan cities of the Near East failed to produce any rationalism and why whites are always the ones responsible for new ideas.
For all this, Johnstone appreciates how original the Greeks were; how they subjected all accounts, including mythic tales, to critical questioning; how their speech was no longer characterized by ritualistic formulas, but was based on open debate; and how they developed a language capable of the abstraction that is necessary for analytical and rational accounts. He thus tells us how Anaximander was the “first Greek to produce a written account of the workings of nature” (47), a language which still contained mythopoetic images, but which also bespoke of impersonal forces governing the universe. Subsequently, Presocratics would produce “more abstract conceptualizations.” Heraclitus would find a logos, unity and harmony, beneath the apparent multiplicity evinced by the senses, coupled with the realization that fire, not water and not earth, was responsible for the changes we observe, the unstable and dynamic side of natural processes, which are likewise “ordered” by the “measures” of a logos. It is the rational mind within humans, the logos inside them, expressed through speech, which grasps the logos of the cosmos. Parmenides rationalized reality even more in claiming that Being itself is what is logically possible and that the logos of the soul is the instrument by which we can grasp the truth of Being.
While Johnstone sometimes misdirects by concentrating too much on the transition from a mythical to a rational account of nature, he is well aware of the “psychological side” in the Presocratic revolution, the way the Greek thinker “was rid of interference from the gods in his/her inner life and was therefore free to develop a sense of self-directedness . . . The move toward subjectivity and agency is an important departure from the Homeric mind, marking the origin of the Western concept of self-hood as autonomous and morally responsible” (80).
The Founders of Western Thought: The Presocratics
Published as Volume 257 of the Boston Studies in the Philosophy of Science, Constantine Vamvacas’ book has a textbook-like quality, with a chapter dedicated to each of the major Presocratics. The first three general chapters and the “Epilogue” will do for our purposes. There is one passage in which Vamvacas brings up directly the realization of self-consciousness by the Greeks: “[T]he Greek of the Homeric period did not feel independent, and thus did not consider himself responsible for his actions and feelings. He attributed everything to the gods, and he even lacked the realization that he himself could be the cause of his decisions and feelings” (9). But this passage stands alone. He does not reference Jaynes and Havelock. He cites Snell a few times, but not in regards to his central argument about the Greek “discovery of the mind.” The main figure in Vamvacas’ study is Karl Popper, who argued that the Presocratics “created the rational or scientific attitude, and with it our Western civilization, the only civilization, which is based upon science.” Those who think that the rise of Galilean-Newtonian science is the defining attribute separating the West from the Rest will be drawn to Popper’s interpretation. My view is that the continuous creativity of Europeans in all the spheres of life since ancient times has been a result of their growing realization that inside them there is a mind (soul or psyche) capable of being the seat of autonomous reflection. I will address this point again in the last section, on Havelock.
[8]Vamvacas finds Jaspers’ argument that there were breakthroughs in civilizations outside Greece limited in its inability to appreciate the Greek scientific spirit. The Chinese were concerned with practical-ethical questions about “proper human relations” and the Axial writings of India remained within the ambit of religious longings about the meaning of life. Only the Greeks sought to understand the “ultimate reality hidden beneath the phenomenal world of sense-experience” (249). It was the Greeks who provided the principles and concepts that would make possible modern science: the idea that there are universal laws of nature, that there is an underlying reality beneath sensory experience explainable through the proper use of deductive and inductive methods, that there is a mathematical order in the natural world, that all things are ultimately made of atomic particles, and that there is symmetry and proportion in the natural world.
 Vamvacas makes the very important point that “Presocratic philosophy is not the culmination of a sudden awakening of the Greek spirit. It is the culminating result of a long development and maturation of the Greek mind” (19). He says little, however, about this long development, apart from noticing that Hesiod’s Theogony goes beyond standard mythological accounts in placing the gods “in a consistent, complete, ordered system,” and posing questions about the beginning of the world, and communicating an interest in “truths.” Vamvacas refers briefly to the “awakening of the personality of the Greek” in early lyric poetry, the fact that such poets as Archilochus, Simonides, and Sappho (writing in the seventh century after Homer, and before the Presocratics) expressed their own “personal values.” But not much else is said. Snell still remains the go-to source for the argument that Greek lyric poets were the first ones to separate the individual self from prescribed expressions and norms. Vamvacas is nevertheless an excellent source for a comprehensive argument about the scientific orientation of the Presocratics. I like the statement that during the Presocratics era “for the first time the human mind focuses on the truth” (20). He does not explain the connection between the discovery of the mind and the pursuit of truth, but it is implicit in his overall argument that there can be no truth-seeking without an inner awareness of the faculty of reason, the only faculty that can legislate for itself principles, concepts, and theories, because, if I may use the words of Aristotle, it is the only faculty that is “able to think itself” [On the Soul, Bk. III: Ch. 4, 429b].
Vamvacas makes the very important point that “Presocratic philosophy is not the culmination of a sudden awakening of the Greek spirit. It is the culminating result of a long development and maturation of the Greek mind” (19). He says little, however, about this long development, apart from noticing that Hesiod’s Theogony goes beyond standard mythological accounts in placing the gods “in a consistent, complete, ordered system,” and posing questions about the beginning of the world, and communicating an interest in “truths.” Vamvacas refers briefly to the “awakening of the personality of the Greek” in early lyric poetry, the fact that such poets as Archilochus, Simonides, and Sappho (writing in the seventh century after Homer, and before the Presocratics) expressed their own “personal values.” But not much else is said. Snell still remains the go-to source for the argument that Greek lyric poets were the first ones to separate the individual self from prescribed expressions and norms. Vamvacas is nevertheless an excellent source for a comprehensive argument about the scientific orientation of the Presocratics. I like the statement that during the Presocratics era “for the first time the human mind focuses on the truth” (20). He does not explain the connection between the discovery of the mind and the pursuit of truth, but it is implicit in his overall argument that there can be no truth-seeking without an inner awareness of the faculty of reason, the only faculty that can legislate for itself principles, concepts, and theories, because, if I may use the words of Aristotle, it is the only faculty that is “able to think itself” [On the Soul, Bk. III: Ch. 4, 429b].
Eric Havelock’s Preface to Plato
This book, published in 1963, is part of the older school of thought about Greek uniqueness. It is a book I have known for some time as a defense of Plato’s attack on the oral Homeric tradition and as a study of the rise of a literate culture in Greece. Suspecting there was more to it, I recently decided to read it, learning that it inhabits indeed a similar interpretative world as the books by Jaynes and Snell in its emphasis on self-consciousness. This is not how Havelock frames his own study, and this is why the full implications of his book have not been fully absorbed. But the standard interpretation is not inconsistent with the view that Havelock was not solely concerned with the emergence of alphabetic writing and Platonic rationalism, but with arguing that the realized condition of self-consciousness and inner freedom required an abstract and theoretical language with a different syntax away from the oral Homeric tradition with its formulaic rhythms, visual imagery, and memorialized thoughts.
However, I don’t want to force my own interpretation onto Havelock, and so we can say that the thesis of his book is that the invention of the Greek alphabet, in contrast to all previous systems of communication, including the Phoenician, brought about a revolution from a Homeric state of being in which Greeks could not differentiate a man’s breath or his life blood from his mind, and were thus devoid of self-consciousness, to a Platonic state of mind in which they came to develop a conception of their personalities as autonomous agents no longer absorbed within an oral tradition and a poetic language incapable of abstract thinking. What I find most persuasive in this thesis is its emphasis on the Greek discovery of the psyche as the seat of self-consciousness involving the separation of the knower from the known.
[9]But I find it hard to accept the claim that the introduction of alphabetic writing was the one factor that brought about this revolution. Havelock writes about how “the alphabet proved so much more effective and powerful an instrument for the preservation of fluent communication than any syllabary had been” (137). Oral cultures are preoccupied with “formulaic directives” and the transmission of immemorial norms through incantation and repetition. In oral poetry the utterance is immediate, mnemonic, surviving only in memory and recitation, accepted without inviting inquiring minds to think for themselves. The alphabet, by contrast, encourages a form of consciousness in which pronouns are used, “both personal and reflexive . . . in new syntactical contexts . . . as objects of verbs of cognition, or placed in antithesis to the ‘body’ . . . in which the ‘ego’ was thought as residing” (198). The “I” as the authorial agent of his own ideas becomes the norm, together with prose writing without any metrical (or rhyming) structure but aiming at analytical precision and open argumentation. Havelock also points out that the written word exists independently of the subject, outside the reader, and can be studied, underlined, and analyzed – not merely memorized and recited as sacred oral tales, but as accounts which can be subjected to endless questioning.
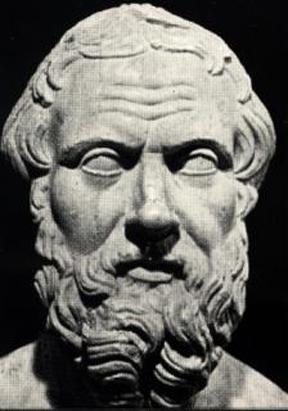 But while alphabetic writing eventually became an indispensable means of communicating truths (during the fourth century BC), beyond poetic recitations about the norms to be valued in a community, I would argue, as Havelock admits in passing, that “there are clear signs in Homer himself that the Greek mind would one day reach out in search of a different kind of experience” beyond poetic recitation. I will not repeat my view that Homer was a transitional figure. It may suffice to point out Havelock’s own recognition that alphabetic writing barely existed before Euripides, by which time the Presocratics had already achieved so much. Havelock knows this: “the Presocratics themselves were essentially oral thinkers . . . but they were trying to device a vocabulary and syntax for a new future, when thought should be expressed in categories organized in a syntax suitable to abstract statement” (x).
But while alphabetic writing eventually became an indispensable means of communicating truths (during the fourth century BC), beyond poetic recitations about the norms to be valued in a community, I would argue, as Havelock admits in passing, that “there are clear signs in Homer himself that the Greek mind would one day reach out in search of a different kind of experience” beyond poetic recitation. I will not repeat my view that Homer was a transitional figure. It may suffice to point out Havelock’s own recognition that alphabetic writing barely existed before Euripides, by which time the Presocratics had already achieved so much. Havelock knows this: “the Presocratics themselves were essentially oral thinkers . . . but they were trying to device a vocabulary and syntax for a new future, when thought should be expressed in categories organized in a syntax suitable to abstract statement” (x).
I would argue that the gradual emergence of personalities capable of introspection, already evident in the Iliad, and in the poetic heroic literature of Indo-Europeans generally, and certainly in the (emerging abstract) thoughts of the Presocratics, is what precipitated the widespread use of alphabetic writing. I disagree with the cause-effect relationship Havelock identifies in this key passage:
One is entitled to ask . . . given the immemorial grip of the oral method of preserving group tradition, how a self-consciousness could ever have been created . . .The fundamental answer must lie in the changing technology of communication (208).
This tendency to identify alphabetic writing as an independent variable has led Havelock’s interpreters to view Preface to Plato as an argument about the importance of alphabetic writing. No one has paid much attention to Havelock’s qualifications: “In fact it is probably more accurate to say that while the discovery [of the psyche as the seat of self-consciousness] was affirmed and exploited by Socrates, it was the slow creation of many minds among his predecessors and contemporaries. One thinks particularly of Heraclitus and Democritus” (197-8).
Once we look past the idea of alphabetic writing as an independent variable that somehow came onto the scene as a “new technology of communication” pushing the Greeks into philosophical reflection, we may be able to appreciate how insightful Preface to Plato remains. There is more to this book than what I outlined above. I will close this article with a few more passages from this book which bring out Havelock’s realization that Greek uniqueness was about the coming to self-consciousness by humans for the first time in history.
Homeric man . . . was part of all he had seen and heard and remembered. His job was not to form individual and unique convictions but to retain tenaciously a precious hoard of exemplars. These were constantly present with him in his acoustic reflexes and also visually imagined before his mind’s eye. His mental condition, though not his character, was one of passivity, of surrender, and a surrender accomplished through the lavish employment of the emotions and of the motor reflexes (199).
The speech of men who have remained in the Greek sense ‘musical’ and have surrendered themselves to the spell of the tradition, cannot frame words to express the conviction that ‘I’ am one thing and the tradition is another; that ‘I’ can stand apart from the tradition and examine it; that ‘I’ can and should break the spell of its hypnotic force; and that ‘I’ should divert some at least of my mental powers away from memorisation and direct them instead into channels of critical inquiry and analysis (199-200).
This amounts to accepting the premise that there is a ‘me’, a ‘self’, a ‘soul’, a consciousness which is self governing and which discovers the reason for action in itself rather than in imitation of the poetic experience (200).
It was his [Plato’s] self-imposed task, building to be sure on the work of predecessors, to establish two main postulates: that of the personality which thinks and knows, and that of a body of knowledge which is thought and known. To do this he had to destroy the immemorial habit of self-identification with the oral tradition. For this had merged the personality with the tradition, and made a self-conscious separation from it impossible (201).
So it is that the long sleep of man is interrupted and his self-consciousness, separating itself from the lazy play of endless saga-series of events, begins to think and to be thought of, ‘itself of itself’, and as it thinks and is thought, man in his new inner isolation confronts the phenomenon of his own autonomous personality and accepts it (210).
Conclusion
What needs to be explained, the explanandum, is the rise of self-consciousness, and the explanation for this, the explanans, is not a new technology of communication, a cosmopolitan life in Miletos, or the geography of Greece, however important these explanans were to the whole historical dynamic. Our focus should be on the aristocratic male culture of ancient Greece and its promotion of ego-consciousness. The Presocratics brought self-consciousness to a level never witnessed before in history through the initiation of true philosophical reflection, a process of introspection initiated by the heroes of the Iliad and the Odyssey, expressed particularly through the greater self-control and power of deliberation the character Odysseus represents. The Indo-Europeans and the heroic Homeric Greeks intensified the consciousness of the male ego, inventing the patriarchal rule of Olympus, the supremacy of sky gods in opposition to the original cult of demonic and inherently unconscious fertility goddesses, which had hitherto ruled all societies, and from which non-Europeans males never managed to detach themselves in the same degree as Indo-European males. We will examine in a future article how the more intense masculinization process associated with the Indo-European pastoral, horse-riding, aristocratic way of life started the emancipation of ego-consciousness from the enveloping world of the Great Mother, in which humans were ruled by the irrationality of chance, demons and witches, entrapped to a world of chthonian darkness, embedded to nature, the emotional impulses of the body, and orgiastic frenzies and hallucinations.
This article was reprinted from the Council of European Canadians [10] Website.







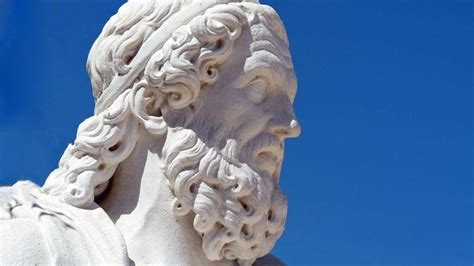
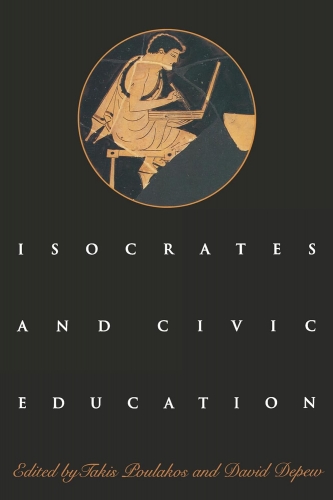


 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
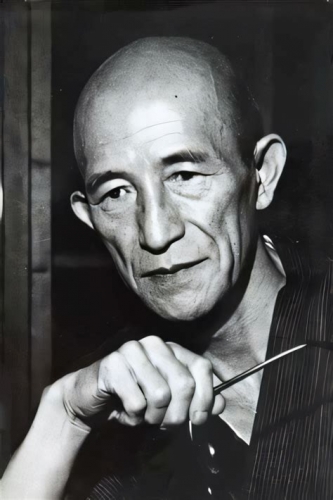
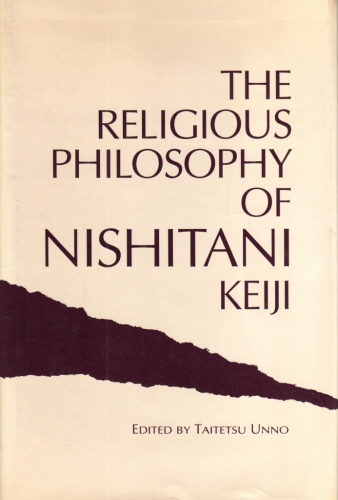
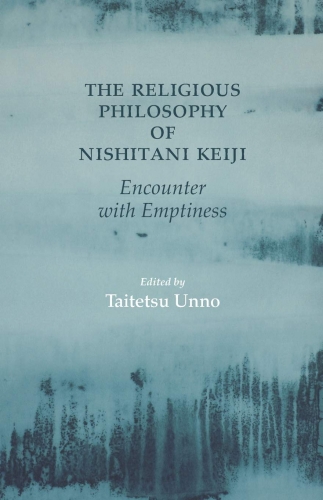
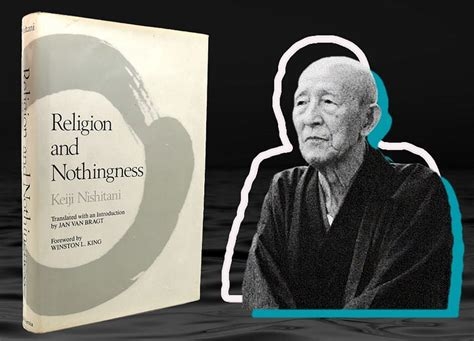

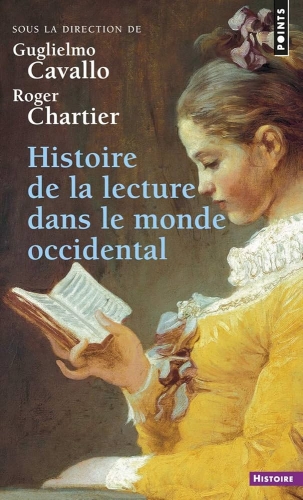
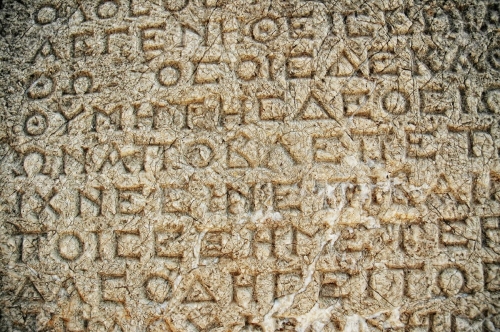
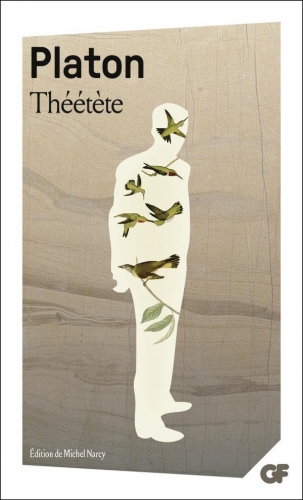
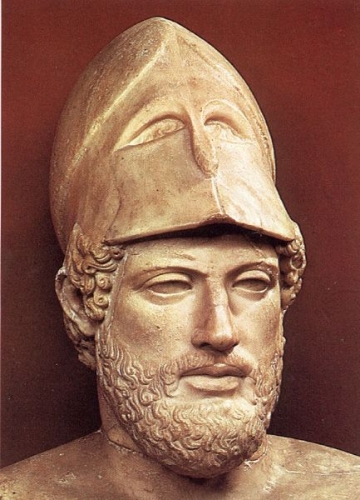
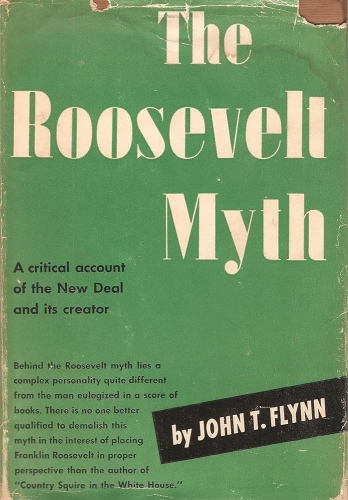
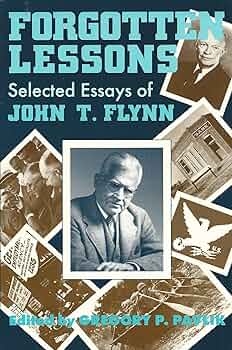 Dans ses Leçons oubliées, Flynn compare Roosevelt au fameux stratège athénien Périclès: dette énorme, gesticulations médiatiques, grands travaux, constructions de prestige, bases, colonies (les bases US !), et une belle guerre mondiale et surtout perpétuelle. Tout rapproche Périclès de Roosevelt, y compris le prestige historique de ces deux grandes et catastrophiques figures. Roosevelt démantela les empires coloniaux et brada notre Europe - comme Périclès la Grèce avec la Guerre du Péloponnèse.
Dans ses Leçons oubliées, Flynn compare Roosevelt au fameux stratège athénien Périclès: dette énorme, gesticulations médiatiques, grands travaux, constructions de prestige, bases, colonies (les bases US !), et une belle guerre mondiale et surtout perpétuelle. Tout rapproche Périclès de Roosevelt, y compris le prestige historique de ces deux grandes et catastrophiques figures. Roosevelt démantela les empires coloniaux et brada notre Europe - comme Périclès la Grèce avec la Guerre du Péloponnèse.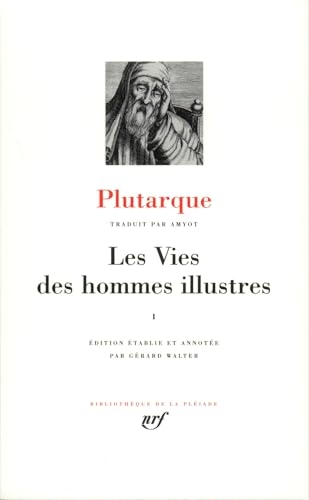 « Ainsi Périclès, fort de l'appui du peuple, abattit la puissance de ce tribunal (l’aréopage). Il se vit dépossédé de la plupart de ses juridictions par l'entremise d'Ephialte; Cimon fut banni comme ami des Lacédémoniens, et ennemi de la démocratie (misodèmon), — Cimon qui ne le cédait à personne en naissance et en richesses, qui avait remporté de brillantes victoires sur les Barbares, qui avait rempli la ville de dépouilles et de trésors, comme je l'ai raconté dans sa Vie. — Tel était sur la multitude l'ascendant de Périclès (kratos en to démo Perikleou) ».
« Ainsi Périclès, fort de l'appui du peuple, abattit la puissance de ce tribunal (l’aréopage). Il se vit dépossédé de la plupart de ses juridictions par l'entremise d'Ephialte; Cimon fut banni comme ami des Lacédémoniens, et ennemi de la démocratie (misodèmon), — Cimon qui ne le cédait à personne en naissance et en richesses, qui avait remporté de brillantes victoires sur les Barbares, qui avait rempli la ville de dépouilles et de trésors, comme je l'ai raconté dans sa Vie. — Tel était sur la multitude l'ascendant de Périclès (kratos en to démo Perikleou) ».



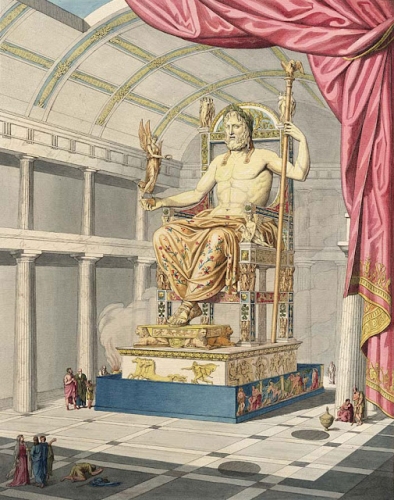

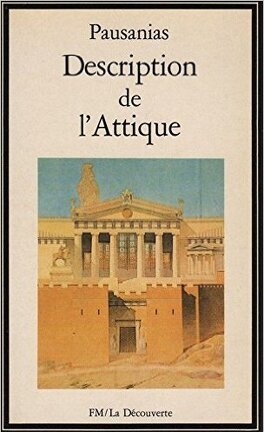 On peut lire dans le célèbre guide de la Grèce antique écrit par Pausanias à l'époque des Jeux olympiques: "Les spectacles merveilleux qu'offre la Grèce sont nombreux, et certains d'entre eux suscitent l'émerveillement de ceux qui en entendent seulement parler ; mais dans les cérémonies des mystères d'Eleusis et les jeux d'Olympie, on perçoit la présence d'un soin particulier pour le ciel". Un soin particulier des cieux, écrit Pausanias. Pour les Grecs de l'Antiquité (c'est-à-dire pour les pères de notre civilisation, auxquels nous devons encore aujourd'hui une grande partie de notre culture), prendre soin des cieux et honorer les dieux signifiait prendre soin de leur humanité et l'honorer. Aujourd'hui, cette désacralisation habituelle du divin et cette moquerie de la religion ne sont-elles pas la porte ouverte à la désacralisation de l'humain ?
On peut lire dans le célèbre guide de la Grèce antique écrit par Pausanias à l'époque des Jeux olympiques: "Les spectacles merveilleux qu'offre la Grèce sont nombreux, et certains d'entre eux suscitent l'émerveillement de ceux qui en entendent seulement parler ; mais dans les cérémonies des mystères d'Eleusis et les jeux d'Olympie, on perçoit la présence d'un soin particulier pour le ciel". Un soin particulier des cieux, écrit Pausanias. Pour les Grecs de l'Antiquité (c'est-à-dire pour les pères de notre civilisation, auxquels nous devons encore aujourd'hui une grande partie de notre culture), prendre soin des cieux et honorer les dieux signifiait prendre soin de leur humanité et l'honorer. Aujourd'hui, cette désacralisation habituelle du divin et cette moquerie de la religion ne sont-elles pas la porte ouverte à la désacralisation de l'humain ?

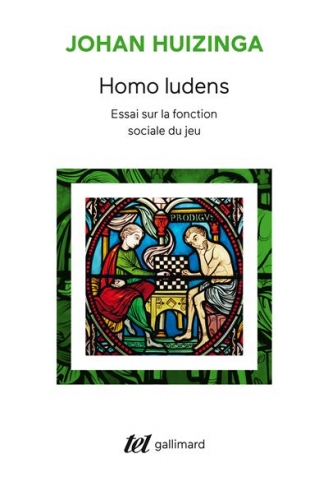




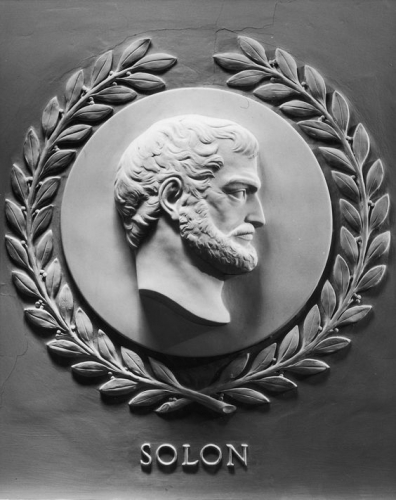



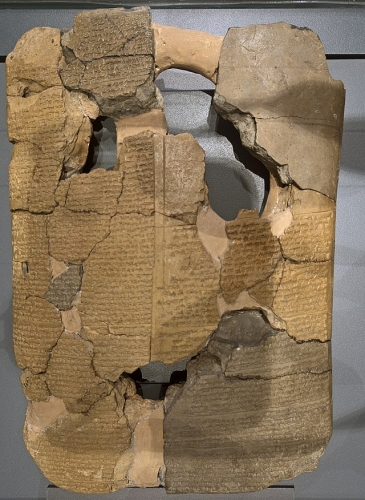
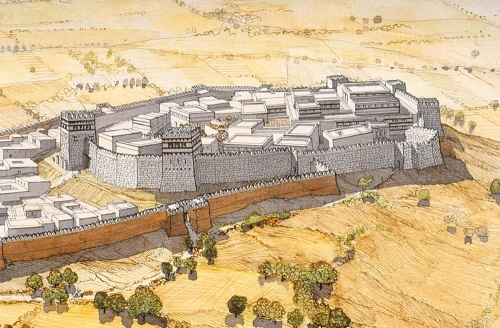








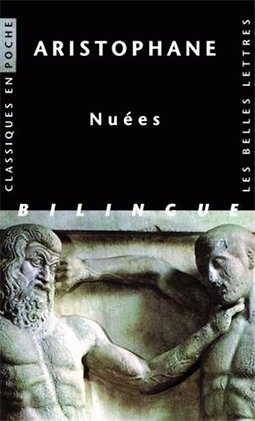 Socrate lui-même, on le sait, s'est intéressé à la philosophie d'Anaxagore ; outre les célèbres passages dans les Nuées d'Aristophane, où les nuages semblent se référer - comme le note Maria Michela Sassi - aux "implications athées de l'étude des phénomènes naturels", il y a les non moins célèbres passages du Phédon (96a-99c), où Socrate rappelle s'être intéressé dans sa jeunesse aux "recherches sur la nature" (historia perì physeos) et en particulier, précisément, à la philosophie d'Anaxagore.
Socrate lui-même, on le sait, s'est intéressé à la philosophie d'Anaxagore ; outre les célèbres passages dans les Nuées d'Aristophane, où les nuages semblent se référer - comme le note Maria Michela Sassi - aux "implications athées de l'étude des phénomènes naturels", il y a les non moins célèbres passages du Phédon (96a-99c), où Socrate rappelle s'être intéressé dans sa jeunesse aux "recherches sur la nature" (historia perì physeos) et en particulier, précisément, à la philosophie d'Anaxagore.

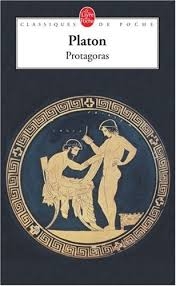 Dans le Protagoras, l'histoire est bien connue: les dieux confient aux deux frères la distribution des biens aux vivants; les deux frères se mettent d'accord pour qu'Epiméthée soit chargé de la distribution, qui, cependant, échoue, laissant l'homme dépourvu de tout moyen propre à sa survie, de sorte que Prométhée est conduit à voler le feu pour le donner aux hommes, avec une singulière inversion des rôles, de l'exécuteur des ordres de Zeus à son violateur. De là, comme le note Curi, émerge "une sorte de théorie du progrès", avec le passage de l'homme de la condition dans laquelle il se trouvait avec Épiméthée à celle dans laquelle il se trouve avec Prométhée, renversant ainsi le cadre régressif hésiodique, dans lequel c'est Épiméthée qui succède à son frère.
Dans le Protagoras, l'histoire est bien connue: les dieux confient aux deux frères la distribution des biens aux vivants; les deux frères se mettent d'accord pour qu'Epiméthée soit chargé de la distribution, qui, cependant, échoue, laissant l'homme dépourvu de tout moyen propre à sa survie, de sorte que Prométhée est conduit à voler le feu pour le donner aux hommes, avec une singulière inversion des rôles, de l'exécuteur des ordres de Zeus à son violateur. De là, comme le note Curi, émerge "une sorte de théorie du progrès", avec le passage de l'homme de la condition dans laquelle il se trouvait avec Épiméthée à celle dans laquelle il se trouve avec Prométhée, renversant ainsi le cadre régressif hésiodique, dans lequel c'est Épiméthée qui succède à son frère. 
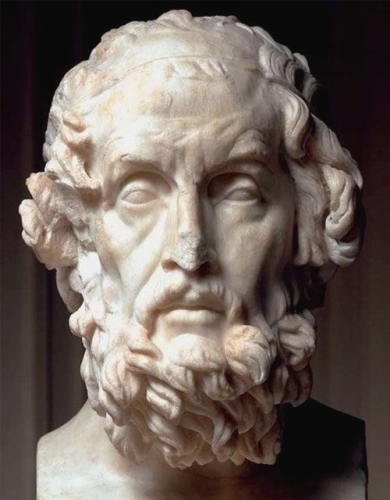

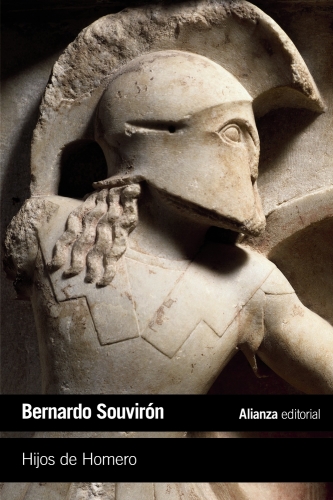



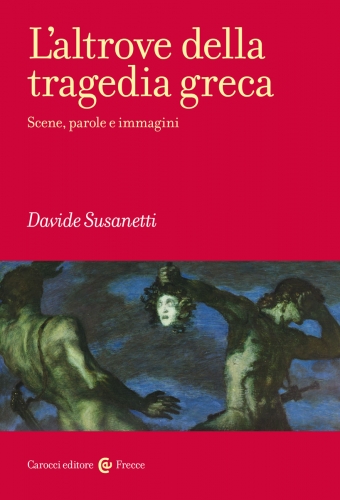

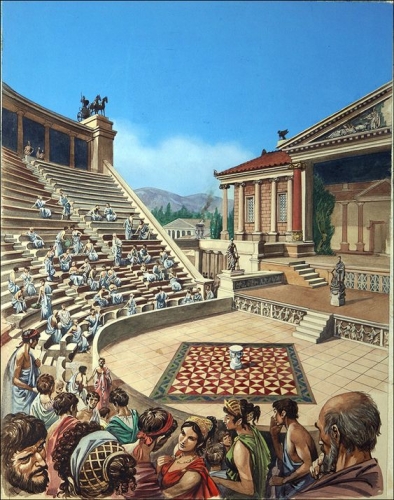
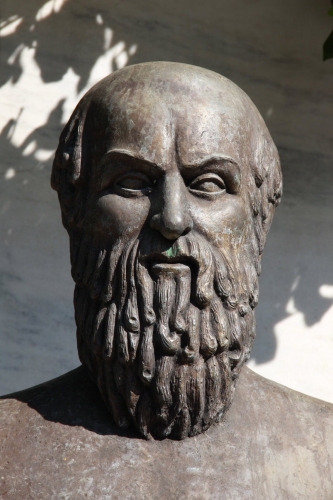
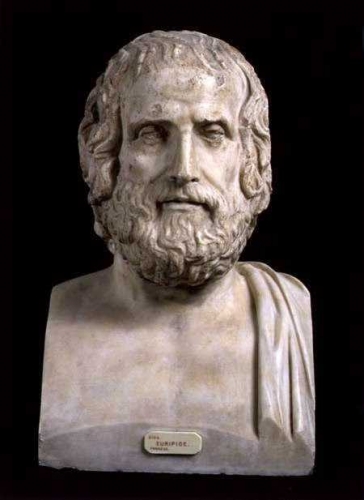
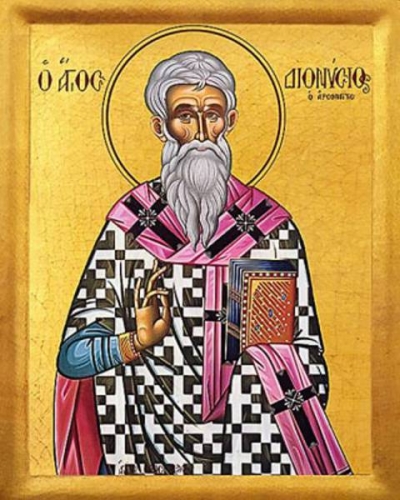
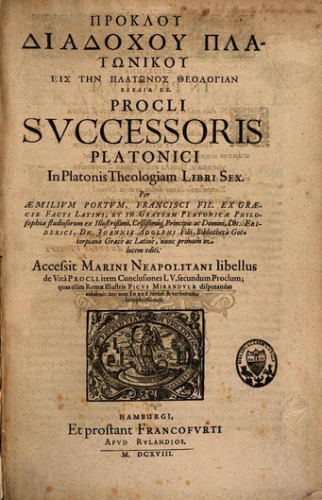
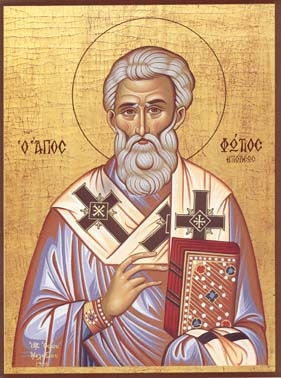
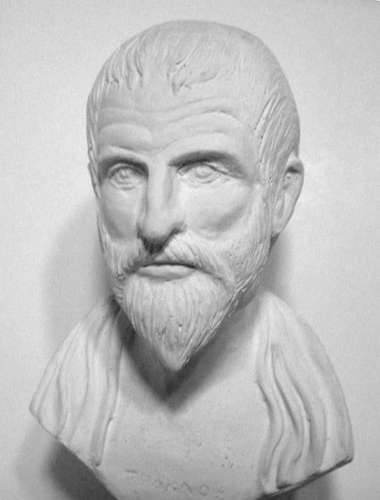
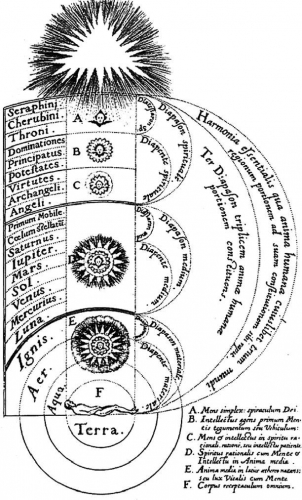
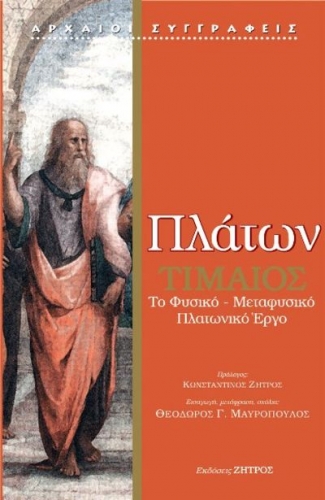

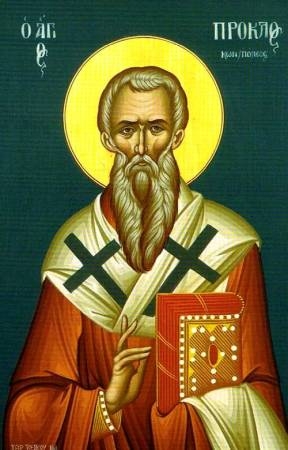


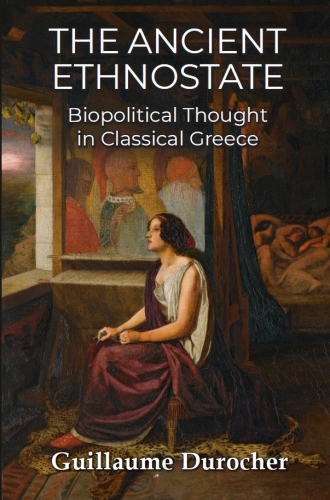

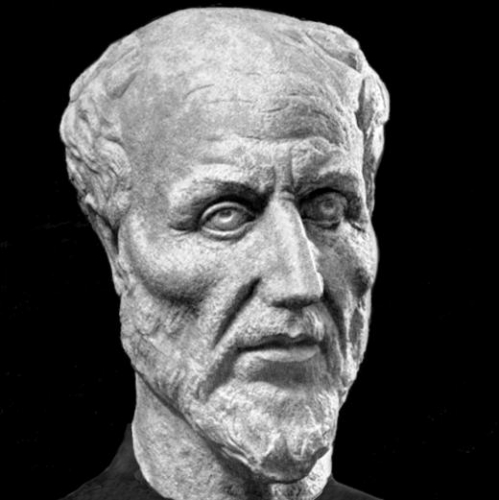

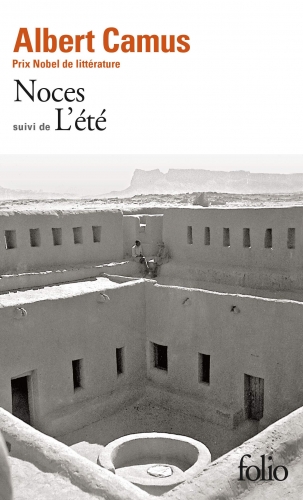
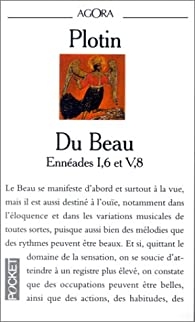 L’idée est antérieure, en amont, elle est avant la chose, et avant même la « cause », au sens logico-déductif. Elle est, au sens propre, instauratrice. Alors que le concept peut se réduire à sa propre définition, et qu’il n’offre à l’entendement dont il est issu aucun obstacle, aucun voile, aucun mystère, l’idée échappe à la connaissance totale que nous voudrions en avoir ; elle se propose à nous à travers le voile de ses manifestations, de ses émanations et déroute la perception directe que nous voudrions en avoir par la multiplicité de ses apparences. « Le concept, écrit encore Schopenhauer, est abstrait et discursif, complètement indéterminé quant à son contenu, rien n’est précis en lui que ses limites ; l’entendement suffit pour le comprendre et pour le concevoir ; les mots sans autre intermédiaire suffisent à l’exprimer ; sa propre définition enfin, l’épuise tout entier. L’Idée au contraire […] est absolument concrète ; elle a beau représenter une infi-nité de choses particulières, elle n’en est pas moins déterminée sur toutes ses faces ; l’individu en tant qu’individu ne peut jamais la connaître ; il faut pour la concevoir se dépouiller de toute volonté, de toute individualité et s’élever à l’état de sujet connaissant pur. »
L’idée est antérieure, en amont, elle est avant la chose, et avant même la « cause », au sens logico-déductif. Elle est, au sens propre, instauratrice. Alors que le concept peut se réduire à sa propre définition, et qu’il n’offre à l’entendement dont il est issu aucun obstacle, aucun voile, aucun mystère, l’idée échappe à la connaissance totale que nous voudrions en avoir ; elle se propose à nous à travers le voile de ses manifestations, de ses émanations et déroute la perception directe que nous voudrions en avoir par la multiplicité de ses apparences. « Le concept, écrit encore Schopenhauer, est abstrait et discursif, complètement indéterminé quant à son contenu, rien n’est précis en lui que ses limites ; l’entendement suffit pour le comprendre et pour le concevoir ; les mots sans autre intermédiaire suffisent à l’exprimer ; sa propre définition enfin, l’épuise tout entier. L’Idée au contraire […] est absolument concrète ; elle a beau représenter une infi-nité de choses particulières, elle n’en est pas moins déterminée sur toutes ses faces ; l’individu en tant qu’individu ne peut jamais la connaître ; il faut pour la concevoir se dépouiller de toute volonté, de toute individualité et s’élever à l’état de sujet connaissant pur. »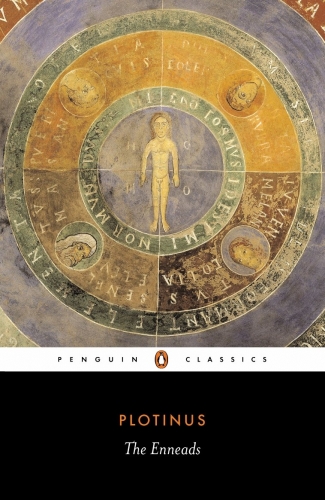
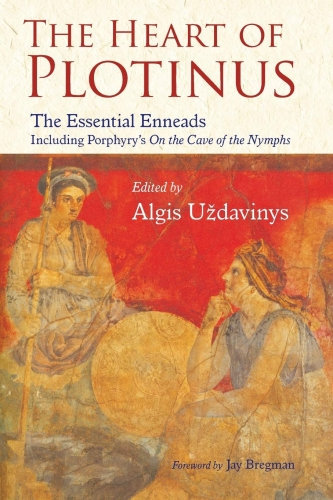

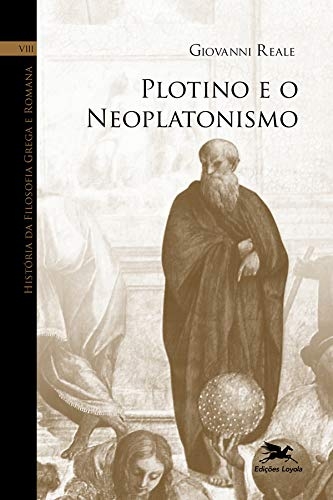





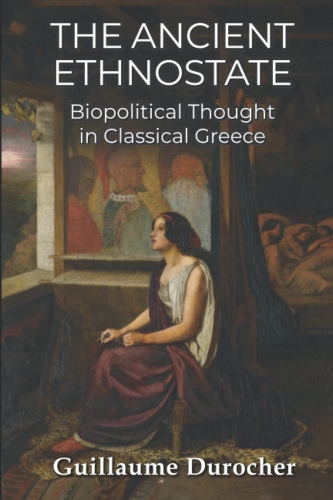











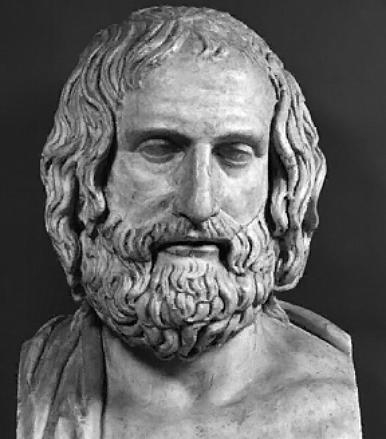




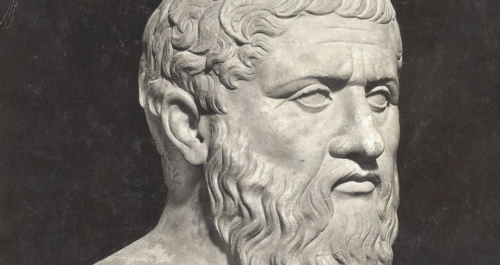





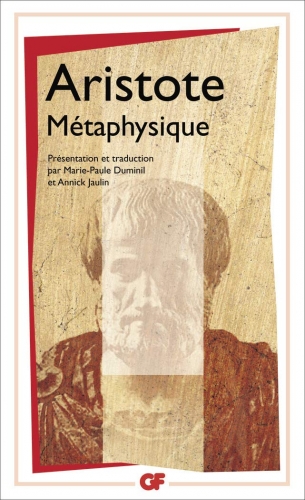 L’affaire Socrate crée un gouffre entre philosophie et politique. On s’est demandé si les idées de Socrate étaient entièrement reprises par Platon. En vérité, Socrate est un personnage de Platon, mais n’est pas tout Platon. Socrate fait douter Platon. Prenons le moment fort de Socrate, prenons le procès. Socrate essaie de convaincre les juges par la persuasion, qui est l’art rhétorique. Mais Socrate oscille entre rhétorique et dialectique dans sa défense. Il perd ainsi sur les deux tableaux. Consistant à s’adresser à plusieurs juges, sa rhétorique est tactiquement le meilleur choix. Mais elle consiste à chercher à convaincre, à chercher à l’emporter dans un débat, non à trouver la vérité. Socrate rhétoricien est en porte à faux avec lui-même. La dialectique est d’un autre ordre que la rhétorique. Elle n’est pas la persuasion politique. La dialectique est l’art de chercher la vérité par le discours philosophique, mais c’est le discours entre deux personnes. C’est le dialogue (à être trop utilisé de notre temps, le terme a perdu sa fraicheur. Il s’agit ici du dialogue au sens originel). Ce peut être plusieurs discours à deux, mais c’est un échange à deux, arguments contre arguments.
L’affaire Socrate crée un gouffre entre philosophie et politique. On s’est demandé si les idées de Socrate étaient entièrement reprises par Platon. En vérité, Socrate est un personnage de Platon, mais n’est pas tout Platon. Socrate fait douter Platon. Prenons le moment fort de Socrate, prenons le procès. Socrate essaie de convaincre les juges par la persuasion, qui est l’art rhétorique. Mais Socrate oscille entre rhétorique et dialectique dans sa défense. Il perd ainsi sur les deux tableaux. Consistant à s’adresser à plusieurs juges, sa rhétorique est tactiquement le meilleur choix. Mais elle consiste à chercher à convaincre, à chercher à l’emporter dans un débat, non à trouver la vérité. Socrate rhétoricien est en porte à faux avec lui-même. La dialectique est d’un autre ordre que la rhétorique. Elle n’est pas la persuasion politique. La dialectique est l’art de chercher la vérité par le discours philosophique, mais c’est le discours entre deux personnes. C’est le dialogue (à être trop utilisé de notre temps, le terme a perdu sa fraicheur. Il s’agit ici du dialogue au sens originel). Ce peut être plusieurs discours à deux, mais c’est un échange à deux, arguments contre arguments. 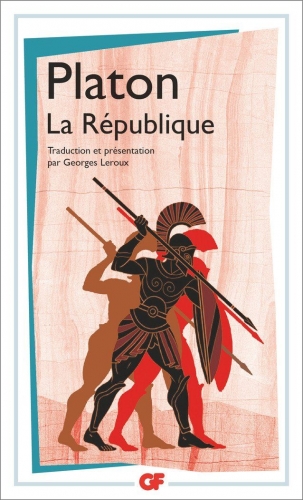 Pour que la compréhension mutuelle s’opère, il faut que chacun puisse comprendre autrui. La condition de cela, c’est que chacun se connaisse lui-même comme un autre. C’est la capacité réfléchissante. C’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate, reprenant une devise inscrite sur le temple de Delphes [la formule est attribuée aussi à Thalès de Milet]. Socrate qui dit encore : « Une vie sans examen ne vaut d’être vécue ». Pour se connaitre, il faut se mettre à distance de soi. Il faut devenir ce que nous sommes, nous autres, humains : des êtres réflexifs. Des êtres qui se voient agir, qui se savent pensants. C’est en se connaissant que l’on peut être en accord avec soi-même. Pour Socrate, il n’y a pas de vérité absolue. [Absolu veut dire « séparé », mais aussi « qui existe par soi-même », qui n’est pas déterminé par un autre que lui. Causa sui : cause de soi. En ce sens, quand Platon définit le monde des Idées comme séparé du monde sensible, cela veut dire principalement ‘’existant par lui-même’’]. Il n’y a selon Socrate que des vérités en contexte. Des vérités en situation, dira Sartre. Des vérités pour soi, aurait dit Kant. « Je sais que je ne sais pas », dit encore Socrate. Cela veut dire : « Je sais que je ne sais pas, ou que je sais mal, la vérité de l’autre ». Je sais que j’ai du mal à me mettre à la place de l’autre, et de voir la vérité de l’autre. Il n’y a donc pas de vérité absolue, c’est-à-dire auto-fondée. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est parce que les hommes ne sont pas interchangeables qu’il en est ainsi. Ma tâche, c’est de ne pas me mentir à moi-même. C’est d’être authentique (mais sachons-le : l’authenticité est un obstacle au pouvoir et à l’argent]. La naissance d’un monde commun réside justement dans le sentiment de la limite de ma connaissance. C’est dans la mesure où je ne connais que le monde qui m’apparait, tel qu’il m’apparait, à moi tel que je suis, avec mes limites, que je sais qu’il n’y a pas de vérité absolue. En même temps, je sais que mon opinion (si elle est sincère, vraiment vécue, et non une duplication de celle du groupe) n’est pas une illusion, qu’elle n’est pas fausse parce qu’elle est subjective. Je sais que ma subjectivité n’implique pas une fausseté, à condition de m’engager dans un travail dialogique, y compris avec moi-même. La sophistique est ainsi, non pas annihilée, mais dépassée. Elle est surmontée : c’est l’Aufhebung de Hegel.
Pour que la compréhension mutuelle s’opère, il faut que chacun puisse comprendre autrui. La condition de cela, c’est que chacun se connaisse lui-même comme un autre. C’est la capacité réfléchissante. C’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate, reprenant une devise inscrite sur le temple de Delphes [la formule est attribuée aussi à Thalès de Milet]. Socrate qui dit encore : « Une vie sans examen ne vaut d’être vécue ». Pour se connaitre, il faut se mettre à distance de soi. Il faut devenir ce que nous sommes, nous autres, humains : des êtres réflexifs. Des êtres qui se voient agir, qui se savent pensants. C’est en se connaissant que l’on peut être en accord avec soi-même. Pour Socrate, il n’y a pas de vérité absolue. [Absolu veut dire « séparé », mais aussi « qui existe par soi-même », qui n’est pas déterminé par un autre que lui. Causa sui : cause de soi. En ce sens, quand Platon définit le monde des Idées comme séparé du monde sensible, cela veut dire principalement ‘’existant par lui-même’’]. Il n’y a selon Socrate que des vérités en contexte. Des vérités en situation, dira Sartre. Des vérités pour soi, aurait dit Kant. « Je sais que je ne sais pas », dit encore Socrate. Cela veut dire : « Je sais que je ne sais pas, ou que je sais mal, la vérité de l’autre ». Je sais que j’ai du mal à me mettre à la place de l’autre, et de voir la vérité de l’autre. Il n’y a donc pas de vérité absolue, c’est-à-dire auto-fondée. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est parce que les hommes ne sont pas interchangeables qu’il en est ainsi. Ma tâche, c’est de ne pas me mentir à moi-même. C’est d’être authentique (mais sachons-le : l’authenticité est un obstacle au pouvoir et à l’argent]. La naissance d’un monde commun réside justement dans le sentiment de la limite de ma connaissance. C’est dans la mesure où je ne connais que le monde qui m’apparait, tel qu’il m’apparait, à moi tel que je suis, avec mes limites, que je sais qu’il n’y a pas de vérité absolue. En même temps, je sais que mon opinion (si elle est sincère, vraiment vécue, et non une duplication de celle du groupe) n’est pas une illusion, qu’elle n’est pas fausse parce qu’elle est subjective. Je sais que ma subjectivité n’implique pas une fausseté, à condition de m’engager dans un travail dialogique, y compris avec moi-même. La sophistique est ainsi, non pas annihilée, mais dépassée. Elle est surmontée : c’est l’Aufhebung de Hegel. 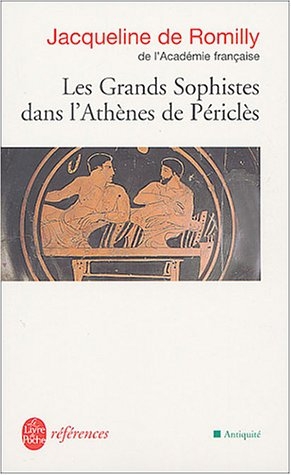 Socrate n’est pas si radicalement éloigné de ce qui sera, bien plus tard, la position de Nietzsche que l’on pourrait le penser au regard de la détestation nietzschéenne de Socrate. Socrate partage avec Nietzsche la même distance critique par rapport à l’idée d’un Moi-sujet homogène. La structure dialogique de la vérité, et par là même de la vertu, car c’est vertu que de chercher la vérité, et il n’est de vertu que la vérité. Cette structure dialogique vient de la nature même de l’homme : nous nous parlons à nous-mêmes. Tout le temps. Nous sommes déjà, avant même de converser avec autrui, « deux en un ». Nous sommes des êtres réfléchissants. Nous ne pouvons avoir des amis que si nous sommes d’abord en accord avec nous-mêmes. Sans autrui, je m’épuiserais dans le dialogue avec moi-même, justement parce que je suis « deux en un ». C’est grâce à autrui que je redeviens un car mes différences internes sont moins importantes que les différences externes, celles qui existent entre moi et les autres.
Socrate n’est pas si radicalement éloigné de ce qui sera, bien plus tard, la position de Nietzsche que l’on pourrait le penser au regard de la détestation nietzschéenne de Socrate. Socrate partage avec Nietzsche la même distance critique par rapport à l’idée d’un Moi-sujet homogène. La structure dialogique de la vérité, et par là même de la vertu, car c’est vertu que de chercher la vérité, et il n’est de vertu que la vérité. Cette structure dialogique vient de la nature même de l’homme : nous nous parlons à nous-mêmes. Tout le temps. Nous sommes déjà, avant même de converser avec autrui, « deux en un ». Nous sommes des êtres réfléchissants. Nous ne pouvons avoir des amis que si nous sommes d’abord en accord avec nous-mêmes. Sans autrui, je m’épuiserais dans le dialogue avec moi-même, justement parce que je suis « deux en un ». C’est grâce à autrui que je redeviens un car mes différences internes sont moins importantes que les différences externes, celles qui existent entre moi et les autres. 




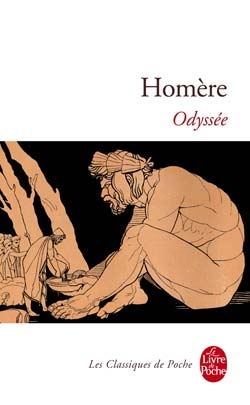 Le sort humilié de Télémaque dans l’Odyssée :
Le sort humilié de Télémaque dans l’Odyssée :







 Il primo di questi è per l’appunto, il non saper leggere i segni, perché in fondo ad essi non crediamo affatto. Invero, ogni cosa nell’Universo Creato è segno, o per meglio dire, simbolo, di qualcos’altro. Questa è certezza di ogni Sapienza Tradizionale, anche e soprattutto di quella cristiana. La Storia, d’altro canto non è semplice successione di eventi, bensì Storia Sacra che si svolge dall’alfa all’omega secondo un superiore disegno di Provvidenza. Pertanto all’uomo il cui intelletto non è ancora stato sigillato non possono sfuggire i segni che continuamente essa ci presenta. Solo un’opera di cultura può colmare tale ignoranza e portare ad un primo risveglio dei sensi interiori.
Il primo di questi è per l’appunto, il non saper leggere i segni, perché in fondo ad essi non crediamo affatto. Invero, ogni cosa nell’Universo Creato è segno, o per meglio dire, simbolo, di qualcos’altro. Questa è certezza di ogni Sapienza Tradizionale, anche e soprattutto di quella cristiana. La Storia, d’altro canto non è semplice successione di eventi, bensì Storia Sacra che si svolge dall’alfa all’omega secondo un superiore disegno di Provvidenza. Pertanto all’uomo il cui intelletto non è ancora stato sigillato non possono sfuggire i segni che continuamente essa ci presenta. Solo un’opera di cultura può colmare tale ignoranza e portare ad un primo risveglio dei sensi interiori.