jeudi, 19 février 2009
Comment utiliser à bon escient l'expression "postmodernité"?

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1989
Comment utiliser à bon escient l'expression «postmodernité»? Pourquoi cette nébuleuse intellectuelle est-elle proche de notre courant de pensée?
par Robert STEUCKERS
Explication: ce texte a servi d'introduction et d'annonce à une conférence de Robert Steuckers devant le public sélectionné du "Cercle Héraclite" à Paris, qui constituait le noyau du G.R.E.C.E., émanation principale de la "Nouvelle droite" en France. A la demande de Charles Champetier, promu directeur du département "Etudes et Recherches" de cette association à vocation métapolitique, Robert Steuckers revenait travailler au sein de ce groupement, après l'avoir quitté, dégoûté, suite aux évictions scandaleuses de Guillaume Faye et Jean-Claude Cariou. Son objectif était de soutenir la volonté de rénovation du jeune Charles Champetier, qui, d'étudiant plein de bonne volonté et de bonnes intentions, allait lentement "pourrir" au sein de cette secte pour se voir contaminé par tous les travers du gourou que Pierre-André Taguieff a justement défini comme "polygraphe et doxographe". Le texte qui suit est paru dans le bulletin interne du G.R.E.C.E., peu avant la conférence de Steuckers, qui eut lieu en juin 1989. A ce titre, il revêt une certaine valeur historique pour qui voudra encore se pencher sur l'historique de la secte métapolitique que fut le G.R.E.C.E. avant de périr sous les contradictions, atermoiements, pusillanimités et trahisons de son faux-derche emblématique de gourou. Plus généralement, il montre que la dite secte n'a pas embrayé sur les interrogations philosophiques de l'époque, n'a pas travaillé correctement sur le plan métapolitique et n'a pas arraché les éléments valables du discours et du questionnement post-modernes à la nouvelle gauche néo-libérale. On voit le résultat: le gourou a été totalement marginalisé et le néo-libéralisme n'a plus d'adversaire si ce n'est une gauche confite dans ses archaïsmes. Le gourou, par narcissisme, par égomanie, a loupé le coche. C'est un vrai doxographe. Taguieff avait raison!
La finalité de la conférence itinérante que je donnerai au cours de ce printemps dans diverses villes d'Europe, c'est de replonger notre courant de pensée dans le débat philosophique actuel et de montrer que nos intuitions les plus anciennes cadrent avec les innovations les plus récentes du microcosme des philosophes.
Dans un numéro récent de la revue Criticón, Armin MOHLER, dont les conseils et les directives nous ont toujours été si utiles, nous exhorte à lire et à potasser un ouvrage de 1987, dû à la plume de Wolfgang WELSCH et consacré aux multiples débats tournant autour de la postmodernité (Unsere postmoderne Moderne, Acta Humaniora, Weinheim, 1987). Le mérite de WELSCH, c'est d'avoir enfin clarifié le concept de «postmodernité» et d'avoir classé les linéaments de ce phénomène sur un mode pédagogique.
In nuce, voici ce que WELSCH nous démontre dans son ouvrage:
1) La postmodernité, ce n'est pas la posthistoire, ni l'«hypertélie» de Baudrillard, où l'on pose un diagnostic pessimiste, en disant que l'histoire s'est arrêtée, que nous sommes encroûtés dans l'obésité transhistorique. La postmodernité n'admet pas ce pessimisme outrancier.
2) La postmodernité, ce n'est pas non plus la société postindustrielle. Cette dernière conserve le grand projet de faire le bonheur des masses en produisant et en commercialisant des biens de consommation en quantités énormes. Telle que l'a théorisée le sociologue américain Daniel BELL (cf. Guillaume FAYE, «Les néo-conservateurs américains» in Orientations n°6), cette société postindustrielle est marquée par une mutation technologique: le passage des technologies hard (industrialisme sidérurgique, extraction du charbon, etc.) aux technologies soft (informatique), couplé à une «révolution culturelle» escapiste, qui se perd dans un esthétisme irréalitaire et «distrait» nos contemporains, tout en alimentant leurs fantasmes de tous ordres. Ancien libéral (au sens américain du terme) devenu néo-conservateur, BELL constate la faillite du grand projet bonheurisant des libéraux et des marxistes, mais il en a la nostalgie; il ne veut pas renoncer à ses promesses et à ses acquis et craint que la sphère culturelle, perçue comme anarchisante, ne précipite le monde dans un chaos néo-médiéval. Les postmodernes, eux, ne s'encombrent pas de telles peurs parce qu'ils pensent et agissent selon des logiques multiples et non plus, comme BELL, sur un mode unitaire, monologique (même si BELL, en opposant la logique industrielle à la logique culturelle constatait de facto qu'il y avait au moins deux logiques).
Ensuite, WELSCH a le mérite de nous suggérer une chronologie cohérente de l'évolution intellectuelle de l'Europe. Pour lui, la modernité, c'est la vision-du-monde qui démarre avec le grand projet de «mathesis universalis» de Descartes, relayé par les mythes de l'âge des Lumières, de l'Aufklärung. C'est effectivement à cette époque que l'individualisme bourgeois fait irruption dans le droit, avec les révolutions américaine et française (cf. Louis DUMONT), que la sphère du politique se «moralise» en paroles et s'ensauvage dans le concret (exterminations des «pas moraux»: Vendéens, Indiens d'Amérique, Fédéralistes lyonnais et autres récalcitrants), que naissent les grands programmes idéologiques dont nous souffrons encore (libéralisme économique de la «main invisible» et de la «concurrence parfaite», «équilibres» des pensées économiques de RICARDO et MARX). Cet espoir de voir se réaliser, en des jours meilleurs, dans un futur utopique, un «équilibre idéal», c'est ce que défendent aujourd'hui les principaux adversaires de notre courant de pensée: HABERMAS, les néo-libéraux qui ont colonisé étroitement les droites françaises, les adeptes du «réarmement théologique» (pour qui la main invisible d'Adam SMITH est une instance régulatrice, détachée du concret comme le Yahvé biblique tonne au-dessus des hommes), les néo-individualistes anti-holistes (Alain LAURENT), etc.
Devant la modernité en marche au XVIIIième et au XIXième siècles, les romantiques se révoltent sans toutefois pouvoir opposer une épistémologie scientifique suffisamment étayée pour réfuter les assises de la physique newtonienne et, partant, le projet philosophique cartésien qui en découle. Comme seule prévaut la physique déterministe, physique des choses inanimées, le romantisme, malgré son épistémologie botaniciste/organique, ne parvient pas à secréter un contre-monde, basé sur une vision radicalement alternative. Nietzsche, lui non plus, ne parviendra pas à ébranler les certitudes de la modernité, malgré son style et ses aphorismes visionnaires. La rupture, selon Welsch, est consommée quand apparaît, à l'aube de notre siècle, la physique relativiste d'un Heisenberg ou d'un Gödel. La structure intime des faits physiques ne correspond plus, désormais, à un schéma figé, stable, équilibré: derrière l'apparente stabilité des choses, se profile un chaos synergétique, où évolutions et involutions se côtoient. Les explorations les plus récentes des physiciens contemporains (Prigogine, Haken, Mandelbrot, etc.) ont confirmé cette vision d'un chaos synergétique sous-jacent. Dès lors, les idéologies politiques, les «grands récits» (Lyotard) de la modernité politique, sont basés sur des postulats infirmés par la science. Du coup, notre sphère politique, marquée soit par le libéralisme soit par le marxisme, s'avère désuète, obsolète, inadéquate.
Pour Welsch, la seule postmodernité qui soit acceptable sur le plan intellectuel, c'est celle qui prend le relais de l'épistémologie des sciences physiques et cherche à en transposer les découvertes dans la philosophie et dans la vie quotidienne. Face à cette postmodernité précise, nous trouvons, explique Welsch, une postmodernité anonyme et une postmodernité diffuse. La PM anonyme, ce sont tous les courants de pensée, toutes les philosophies qui enregistrent et acceptent la structure chaotique/synergétique du monde, sans toutefois revendiquer l'appellation «postmoderne». La PM diffuse, c'est l'ensemble considérable des opinions hétéroclites qui se baptisent «postmodernes» pour être dans le vent et pour justifier des fantasmes de toutes natures.
En Allemagne, aujourd'hui, la pensée officielle, la seule qui soit tolérée, c'est celle qui répète les postulats de la modernité en les napant d'une sauce nouvelle. Pour sortir de cette impasse, de jeunes philosophes font soit appel à l'irrationnel pur et brut, soit opèrent un détour par les philosophes français contemporains, inspirés par Nietzsche et Heidegger. En effet, dans la philosophie française contemporaine, nous trouvons, souvent derrière un vocabulaire à première vue abscons, des linéaments nietzschéens ou des linéaments calqués sur le chaotique/synergétique de la physique nouvelle. C'est le cas chez Deleuze, Guattari, Foucault et Derrida. Notre courant de pensée doit s'approprier impérativement les éléments de nietzschéisme présents dans les thèses de ces philosophes car nous assistons au phénomène suivant: les tenants du néo-universalisme actuel sont en train de les larguer, de les démoniser, de les assimiler purement et simplement à notre vision-du-monde, laquelle, bien sûr, ils condamnent sans appel. Dans deux ouvrages récents, deux vulgarisateurs du néo-universalisme, Luc Ferry et Alain Renaut signalaient que Deleuze, Foucault et Derrida avaient, ô scandale, proclamé la «mort de l'homme», la «fin du sujet» (lisez: l'individualisme occidental), et avaient hissé «le vitalisme au-dessus du droit».
Devant tous ces faits d'histoire de la pensée, la tâche d'un mouvement métapolitique comme le nôtre, c'est de transposer les acquis de la physique contemporaine dans le domaine de la philosophie, de les greffer sur les corpus des sociologies organiques et vitalistes, puis de propulser cette audacieuse synthèse dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans le politique, l'organisation de la Cité, le droit, l'économie, etc. Rien ne sert de sombrer dans le pessimisme; au contraire: le travail qui nous attend, dès cet instant même, est énorme et fascinant. Au bout de nos efforts, il y aura incontestablement la victoire.
Robert STEUCKERS,
janvier 1989.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, modernité, post-modernité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 10 janvier 2009
La ville, sa figure moderne

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - VOULOIR (Bruxelles) - Juillet 1994
Fabrice MISTRAL:
La ville, sa figure moderne
“La forme de la ville a, depuis la révolution industrielle, toujours changé plus vite que le coeur des mortels (...)”, écrit Annie Fourcaut, remarquable historienne de l’urbanisme contemporain. C’est en banlieue, territoire de constitution récente, moins marqué par les héritages que ne le sont les vieux centres urbains, que la modernité urbaine s’incarne le plus fortement (1). Bouleversement des images de la ville comme de son fonctionnement, nouveaux réseaux de communication, télescopage entre la rapidité potentielle des déplacements et l’engorgement effectif, ...: la ville témoigne au plus haut point des contradictions sociales à l’oeuvre. Deux aspects principaux, particulièrement marqués en banlieue, peuvent être repérés:
- la fin de tout holisme urbain,
- la nouvelle nature des communications physiques.
a) Contrairement à la ville traditionnelle, la ville moderne n’est plus perceptible comme un tout. Georges Teyssot écrit qu’elle “outrepasse définitivement le monde de l’expérience sensible” (2). De là nait une profusion des “images” de la ville produites par les architectes et les bureaux d’études: précisement parce que cette image fait problème, et ne relève plus de l’évidence. Jacques Guillerme écrit: “La puissance de la figuration tient essentiellement à la dénotation qui lui est associable”. En d’autres termes, imaginer, c’est dévoiler. Heidegger l’exprime à sa façon: “L’ouverture d’un monde donne aux choses leur mouvement et leur repos, leur éloignement et leur proximité, leur ampleur et leur étroitesse” (3). Pour cette ouverture, des repères sont nécessaires: sans cartes, le territoire n’existe plus. A l’inverse, avec la prolifération des représentations, le territoire disparait aussi. On peut faire l’hypothèse suivante: “La catastrophe urbaine aurait résidé en l’impossibilité de maîtriser la représentation de la ville” (4). Conséquence de cette multiplication des points de vue sur la ville: la fin du “holisme” urbain, c’est-à-dire d’un sentiment commun d’appartenance. Vient alors le temps des remises en scène. L’objectif (voir “Banlieues 89”, le secteur politique de la ville du ministère de la culture, etc) est de génerer un “nouvel art d’habiter”, et la possibilité d’appropriations collectives des lieux. Le problème est qu’une trop fréquente méconnaissance des pratiques urbaines de la part des urbanistes, plus encore de leurs maîtres d’ouvrage, rend fragiles ces remises en scène. Difficulté des tentatives “baroques” (5) de réenchantement de la ville: elles sont fondées généralement sur une naturalisation de l’histoire plus que sur sa réinvention. A cette aune, la différence entre l’urbanisme des libéraux - qui rejette le zonage au nom du refus des règles - et l’urbanisme des sociaux-démocrates - interventionnistes au nom d’un équilibre à rétablir - est, sinon “illusoire”, comme l’écrit Guiheux, du moins secondaire. Dans les deux cas, l’urbanisme (moderne) est système d’objets. Dans les deux cas, ceux-ci ne font pas corps avec la ville.
Le baroquisme consolide en outre la césure entre l’intérieur et l’extérieur dans la ville, entre l’habitat et la rue. Dans la ville traditionnelle, le dedans n’est qu’un “pli du dehors” (Henri Gaudin). Pour autant, ce pli rend les intérieurs habitables. Car il y a opacité de l’étoffe. Dans la ville moderne, le mythe de la transparence tend à supprimer les intérieurs en tant que lieux habités. Et la tentative baroque de conjurer la banalité par la naturalisation de l’histoire renforce l’incommunication.
b) La seconde caractéristique de la modernité urbaine concerne la nature des communications matérielles et d’abord la nouvelle conception de leurs intersections. Les voies de communication se multiplient qui correspondent à une direction, mais ne se rencontrent pas avec d’autres voies: un échangeur n’est pas un point, mais un noeud. C’est “une intersection sans carrefour” note Michel Serres. L’échangeur “reçoit et redistribue, il trie sans mélanger” (6). La route moderne - celle des autoroutes et des “voies rapides” - est par nature unidimensionnelle, elle ne correspond qu’à un trajet et un seul: de l’embranchement ouest de l’autoroute X à la sortie sud de telle ville. Le trajet est ainsi en quelque sorte irréversible. En cas d’erreur d’aiguillage, “même si nous retournons sur le point, nous serons néanmoins sur une autre voie” (Georges Teyssot). Ces trajectoires pré-déterminées, faites pour éviter de nous “perdre”, aboutissent à une formidable dépossession de la liberté humaine d’interpréter un territoire - comme un musicien interprète une partition.
La nouvelle nature des réseaux de transport amène à s’interroger sur les rapports entre la modernité urbaine et la communication. Chantal de Gournay rappelle que pour communiquer, il faut “savoir s’effacer (derrière une facade, un rôle” (7). En ce sens, la banalité, par opposition à la distinction, est précisément ce qui permet la communication: c’est dans la mesure où nous sommes partiellement inauthentiques que la communication est possible. De ce fait, il n’y a pas coincidence entre les activités de conscience et les manières d’apparaître. La conséquence urbaine en est qu’un lieu de communication est un lieu “de tous le monde et de personne” - comme à Marseille la Canebière que Marcel Roncayolo définit comme un “no man’s land”. Par là, elle est qualifiée comme lieu inconsommable et inappropriable. Banal, mais à sa façon.
Le problème est que, dans la ville moderne, ou dans celle parfois qualifiée de post-moderne, l’espace public répond à la recherche d’un style. Or, cet espace public fonctionne comme tel précisement s’il “correspond à un degré zéro de la mise en scène”, écrit Chantal de Gournay qui ajoute: “L’espace public post-moderne, fait “sur mesure” sinon à la mesure de son “public”, est à la grande ville industrielle ce que le “narrowcasting” est à la télévision de masse” (8).
La place de l’espace public est ainsi un repère capital dans la génèse de la ville moderne. Tout d’abord, cet espace est caractérisée par la rue. Celle-ci devient au XIXème siècle espace d’auto-mise en scène de la socialité pour elle-même (comme l’illustrent bien les peintures de Monet). Elle l’est notamment au travers des grands magasins, qui consacrent à la fois le triomphe de la consommation et de l’individualisme. Se manifeste ainsi une rupture avec la Renaissance: la ville moderne ne se contente plus de se représenter. Elle se donne en spectacle.
La modernité urbaine dans ses premiers moments a représenté une transition dans laquelle coexistaient des aspects modernes et traditionnels qu’a bien vu Walter Benjamin. La rue n’est plus “pli sinueux”, mais ruban géométrique. “Ce n’est pas dans l’errance que l’homme se livre à la rue, écrit-il dans Le livre des passages (Le Cerf, 1989); il succombe au contraire à la fascination du ruban monotone qui se déroule devant lui.”
“Le labyrinthe, poursuit Benjamin, représente toutefois la synthèse de ces deux types de terreur; c’est une errance monotone” (9). En conséquence, c’est avec raison que C. de Gournay peut écrire: “L’espace public, loin d’être pour le flaneur un champ d’interaction humaine, est un lieu de perte où l’homme se dissout dans l’équivalence qui régit désormais l’univers de la marchandise” (10). Une des formes de cette perte est l’expérience fusionnelle qui se produit dans la ville moderne sous la forme de la fascination par la marchandise, - la “communion avec la marchandise” dont parle Walter Benjamin. Paradoxe apparent: ce qui triomphe à partir du 19ème siècle, c’est le simulacre d’une communion ou d’une fusion qui cache maladroitement la réalité de l’homme des foules (le flaneur de Baudelaire), ou de l’homme sans qualité (Musil). En effet, “la socialité, précise Isaac Joseph, en tant que celle-ci implique une concertation, est tout le contraire d’une expérience fusionnelle” (11). Cette socialité implique une communication et non la simple présence à son rôle social. Elle est tout autre que la danse devant le feu d’artifice des marchandises.
Aussi, au travers de la communication, peut-on approfondir l’opposition typologique entre la ville traditionnelle et la ville moderne. Dans la première, le réseau de communication physique relève du labyrinthe, où la réversibilité est toujours possible. Ce labyrinthe, ponctué de carrefours, est “régi, note G. Teyssot, par des schémas d’axialité, formé d’une hiérarchie d’espaces caractérisés” - les avenues, les places, les rues, les galeries, ... C’est un moyen d’apprivoiser l’espace. Il permet les repères, et surtout les arrêts. La ville traditionnelle est ainsi celle qui permet de revenir sur ses pas. Dans la mesure où elle se lit au travers des rues, elle permet de prendre ce qu’André Breton appelait “le vent de l’éventuel” - et est l’un des lieux du politique tout comme de la disponibilité sexuelle. La ville traditionnelle est celle dans laquelle la déambulation est possible, - et le projet non obligatoire.
Dans la ville moderne et hyper-moderne, l’urbanisme des voies non réversibles est aussi celui des “rubans”: rubans des équipements culturels, des sièges de société, etc. A l’échelle des agglomérations est reprise l’idée de la ville linéaire de Le Corbusier. Ainsi le “grand espace” de la ville moderne, qui est l’espace de l’agglomération, est-il un espace d’homogénéisation. Il s’oppose à l’esthétique du divers (Victor Segalen) et du mélange. Il est ponctué, dans sa variante hyper-moderne, non de rues, même si on observe parfois une composition en terme d’axe (néo-hausmannisme), mais surtout de “pôles d’excellence”: (Massy-Rungis, Cergy-Pontoise, ...) ou de “zones de restructuration” (Seine-amont, la boucle de Genevilliers,...). Dans tous les cas de figures, ces pôles doivent “communiquer” entre eux plus qu’avec leur environnement respectif. Plus que destinataires ou émetteurs de communication, ils doivent être vecteurs de communication eux-mêmes.
Observateur attentif de ces signes, Marc Augé appelle sur-modernité “la surabondance évênementielle, la surabondance spatiale et l’individualisme des réferences” (12). La sur-modernité est selon lui caractérisée par les non-lieux. Explication: le lieu, “identitaire, relationnel et historique”, s’incrit dans un territoire, façonné par les pratiques des hommes. Alors que le non-lieu, couplé avec un espace neutre et “mathématique” (que dire de l’espace, sinon sa surface ?), est une simple portion d’espace. Le non-lieu n’habite pas l’espace; il est donc lui-même inhabitable. Conséquence: il ne permet pas la mutation de l’espace en territoire, ensemble de lieux humanisé et historicisé. La sur-modernité apparait ainsi une forme d’hyper-modernité, à quoi se réduit pour Kostas Axelos la “post-modernité”. Nous en sommes là. Il en est désormais de la modernité comme de l’Occident défini par Cioran: c’est “une pourriture qui sent bon”. A ce stade, l’a-venir ne peut être qu’un retournement. La clé en est la sortie du règne de la marchandise, donc de l’auto-symbolisation par l’économie. C’est dire que le travail vivant doit cesser d’être au service de l’accumulation et au contraire devenir l’objet premier de valorisation. A ces conditions, un dépassement tant de la ville traditionnelle que de la ville moderne pourrait donner lieu à une ville authentiquement post-moderne.
Fabrice MISTRAL
_______________
(1): précisons d’emblée que nous partageons le point de vue de Kostas Axelos comme quoi le post-moderne n’est que de “l’hyper-moderne”: l’exacerbation du moderne, non sa négation.
(2): la métropole mise en représentation, in Urbanisme: la ville entre image et projet, Cahiers du C.C.I. n°5, Centre Georges Pompidou.
(3): L’origine de l’oeuvre d’art, in Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962.
(4): Alain Guiheux, Cahiers du C.C.I, op. cit.
(5): le thème de la ville baroque a été popularisé par Jean-Pierre Le Dantec. Voir Dédale le héros, Balland, 1991.
(6): Hermès 2. L’interférence, éditions de Minuit, 1976.
(7): in Cahiers du C.C.I., op. cit.
(8): id.
(9): Walter Benjamin écrit: “Le labyrinthe est la patrie de celui qui hésite. Le chemin de celui qui appréhende de parvenir au but dessinera facilement un labyrinthe. Ainsi fait la pulsion sexuelle dans les épisodes qui précèdent sa libération.” Il note encore, avec une justesse saisissante: “Le labyrinthe est le bon chemin pour celui qui arrive bien assez tôt au but. Ce but est le marché”.
(10): in Cahiers du C.C.I.
(11): I. Joseph, communication pour le colloque “Vie publique, vie privée”, Lyon, octobre 1980. La socialité est ici entendue au sens de sociabilité (selon la distinction que fait Bourdieu entre cette dernière et la sociétabilité).
(12): Non lieux, Introduction à l’anthropologie de la surmodernité, Seuil, 1992.
°°°
00:05 Publié dans Architecture/Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : architecture, urbanisme, modernité, philosophie, post-modernité, communication |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 octobre 2008
Une critique de la modernité chez P. Koslowski
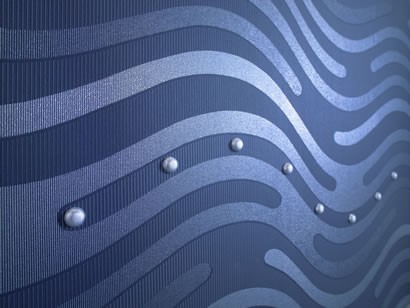
Une critique de la modernité chez Peter Koslowski
Peter Koslowski est un analyste critique de notre modernité dominante et stéréotypante, dont l'ouvrage sur Ernst Jünger a été largement remarqué l'an dernier (cf. la recension que lui consacre Isabelle Fournier dans Vouloir n°4/1995). Né en 1952, ce jeune philosophe anti-moderne (mais qui n'appartient nullement à l'école néo-conservatrice), pose comme premier diagnostic que la modernité au sens le plus caricatural du terme a pris fin quand la physique a découvert la non-conservation ou entropie, soit le deuxième principe de la thermodynamique en 1875 et quand l'esprit humain a pris fondamentalement conscience de sa finitude au point de ne plus croire à ce mythe tenace de la perfectibilité infinie (cf. NdSE n°14), au progrès, aux formes diverses d'évolution(isme) téléologique, aux sotériologies laïques et eudémonistes vectorialisées, etc. Mais parallèlement à ces mythes progressistes, vectoriels, téléologiques, messianiques et perfectibilistes, les temps modernes, soit la Neuzeit qui précède la modernité des Lumières proprement dite, avait développé une normalité basée sur l'accroissement de complexité, ce qui revient à dire que cette Neuzeit accepte comme normal, comme fait acquis, que le monde se complexifie, que les paramètres s'accumulent, que les paramètres anciens et nouveaux bénéficient tous éventuellement d'une équivalence axiologique quand on les juge ou on les utilise, que l'accumulation de nouveautés est un bienfait dont les hommes vont pouvoir tirer profit. Avec l'avènement de la Neuzeit, avec les innovations venues d'Amérique et des autres continents découverts par les marins et les aventuriers européens, le monde devient de plus en plus complexe et cette complexité ne va pas diminuer.
L'accroissement de complexité ne postule nullement une idéologie irénique: au contraire, nous constatons, au cours du XVIIième siècle, l'éclosion de philosophies fortes du politique (Hobbes), au moment où la modernité dans sa première phase offensive propose justement une pluralité de projets pour remplacer le système médiéval fixe (tellurocentré) qui s'est effondré. La Réforme, la Contre-Réforme, le Baroque, les Lumières, l'idéalisme allemand, le marxisme, sont autant de projets modernes mais contradictoires les uns par rapport aux autres; ce sont des philosophies fortes, des récits mobilisateurs (avec une téléologie plus ou moins explicite). Mais aujourd'hui, la défense et l'illustration d'une modernité, que l'on pose comme seule morale et acceptable, dérive d'une interprétation simplifiée du corpus des Lumières, procède d'une réduction de la modernité à un seul de ses projets, explique Koslowski. Une schématisation du message des Lumières sert désormais de base théorique à une vulgate qui ne sous-tend finalement, ajouterions-nous, que les discours ou les systèmes politiques de la France, de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et des Pays-Bas. Cette vulgate s'exprime dans les médias et dans la philosophie hypersimplificatrice d'un Habermas et de ses épigones parisiens, tels Bernard-Henri Lévy, Guy Konopnicki ou Christian Delacampagne. L'objectif des tenants de cette vulgate, nouveau mythe de l'Occident, est de créer une orthoglossie pour pallier à la chute des métarécits hégéliens, marxistes ou marxisants, démontés par Lyotard. Orthoglossie correspondant parfaitement au thème de la “fin de l'histoire” cher à Fukuyama, au moment de la chute du Mur. Cette orthoglossie s'appelle plus communément aujourd'hui la political correctness, en bon basic English.
Mais à notre sens, la post-modernité a pour impératif de dépasser cette orthoglossie dominante et tyrannique et:
- doit démontrer l'inanité et le réductionnisme de cette orthoglossie;
- dire qu'elle est une prison pour l'esprit;
- que son évacuation est une libération;
- que traquer cette orthoglossie ne relève pas d'un pur irrationalisme ni d'une inversion pure et simple du rationalisme de bon aloi, mais d'une volonté d'ouverture et de plasticité.
A ce sujet, que nous dit Koslowski qui est religieux, catholique, disciple de Romano Guardini, comme on peut le constater dans ses références? Ceci: «La finitude de l'existence humaine s'oppose tant à l'impératif de complètement de la modernité et de la raison discursive qu'au droit des époques futures à développer leur propre projet. La post-modernité veut poursuivre son propre projet. On ne peut pas lui enlever ce droit en imprégnant totalement le monde de raison discursive. Le droit de chaque époque est le droit de chaque génération à marquer son temps et le monde. Nous sommes contraints aujourd'hui d'apporter des limites à cette pulsion frénétique au complètement et aussi de nous rendre disponibles pour laisser en place ruines, choses inachevées et surfaces libres. Si nous ne pouvons plus aujourd'hui tolérer les ruines, les traces du passé et que nous les soumettons à la restauration, avec son perfectionnisme, ses laques et ses vernis, si nous percevons toutes les prairies ou les superficies libres comme de futurs chantiers de construction, qui devront être recouverts au plus vite, cela veut dire que nous nous trouvons toujours sous l'emprise de cette pulsion de complètement, propre à la modernité, ou sous l'emprise modernisatrice de la raison totalisante. Nous tentons de bannir de notre environnement toutes les traces de finitude et de temporalité en procédant à des restaurations et des modernisations parfaites. La profondeur et l'antiquité qui sont présentes sur le visage du monde sont évacuées au profit d'une illusion de complétude. Bon nombre de ruines doivent rester en place, en tant que témoins de la grandeur et du néant du passé. Leur incomplétude est une chance qui s'offre à elles de voir un jour leur construction reprendre, lorsque leur temps sera revenu, comme après plusieurs siècles, un jour, on a repris la construction de la Cathédrale de Cologne en ruines. Un jour, peut-être, on retravaillera au projet ou à certains projets de la modernité. Mais aujourd'hui, il y a plus important que le projet de la modernité: les ateliers de la post-modernité» (p. 49; réf. infra).
Mais les ateliers de la post-modernité doivent-ils reproduire à l'infini ce travail de “déconstruction” entrepris il y a quelques décennies par les philosophes français? Certes, il convient avec les post-modernes “déconstructivistes” de travailler à l'élimination des effets pervers des “grands récits”, mais sans pour autant se complaire et s'enliser dans un pur “déconstructivisme”, ou vagabonder en toute insouciance dans les méandres d'une polymythie anarchique, anarcho-libérale et fragmentée, qui n'est qu'un euphémisme pour désigner le chaos et l'anomie. Koslowski plaide pour la ré-advenance d'une sophia. Car toute création et toute naissance ne sont pas les produits d'une réflexion (d'un travail de la raison discursive), au contraire, créations et naissances sont les produits et de la volonté et de l'imagination et de la pensée et de l'action, soit d'un complexe que l'on peut très légitimement désigner sous le nom grec et poétique de sophia. Sans reductio aucune.
En fait, Koslowski apporte matière à méditation pour tous ceux qui constatent que l'eudémonisme et le consumérisme contemporains, —désormais dépourvus de leurs épines dorsales qu'étaient les métarécits— sont des impasses, car ils abrutissent, anesthésient et mettent le donné naturel en danger. Koslowski déploie une critique de cette modernité réduite à une hypersimplification des Lumières qui ne sombre pas dans la pure critique, dans un travail de démolition finalement stérile ou dans une acceptation fataliste du chaos, camouflant mal une capitulation de la pensée. La polymythie d'Odo Marquard (qui suscite de très vives critiques chez Koslowski) ou le “pensiero debole” de Vattimo —réclamant l'avènement et la pérennisation d'une joyeuse anarchie impolitique— sont autant d'empirismes capitulards qui ne permettront jamais l'éclosion d'une pensée réalitaire et acceptante, tempérée et renforcée par une sophia inspirée de Jakob Boehme ou de Vladimir Soloviev, prélude au retour du politique, à pas de colombe... Car sans sophia, le “réalitarisme” risque de n'être qu'une simple inversion mécanique et carnavalesque du grand récit des Lumières, qui confisquerait aussi aux générations futures le droit de forger un monde à leur convenance et de léguer un possible à leurs descendants.
Robert STEUCKERS.
(extrait d'une conférence prononcée lors de la deuxième université d'été de la FACE, Provence, août 1994).
- Peter KOSLOWSKI, Die Prüfungen der Neuzeit. Über Postmodernität. Philosophie der Geschichte, Metaphysik, Gnosis, Edition Passagen, Wien, 1989, 167 p., ISBN 3-900767-22-X.
00:25 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : modernité, post-modernité, philosophie, allemagne, métaphysique, orthoglossie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 02 octobre 2008
Les leçons de Peter Koslowski face à la post-modernité

Les leçons de Peter Koslowski face à la post-modernité
par Jacques-Henry Doellmans
Peter Koslowski, jeune philosophe allemand né en 1952, est professeur de philosophie et d'économie politique à l'Université de Witten/Herdecke, président de l'Institut CIVITAS, Directeur de l'Institut de Recherches en Philosophie de l'Université de Hanovre. Son objectif est de déployer une critique fondée de la modernité et de tous ses avatars institutionalisés (en politique comme en économie). Ses arguments, solidement étayés, ne sont pas d'une lecture facile. Rien de son œuvre, déjà considérable, n'a été traduit et nous, francophones, avons peu de chances de trouver bientôt en librairie des traductions de ce philosophe traditionnel et catholique d'aujourd'hui, tant la rigueur de ses arguments ruine les assises de la pensée néo-gnosticiste, libérale et permissive dominante, surtout dans les rédactions parisiennes!
Koslowski est également un philosophe prolixe, dont l'éventail des préoccupations est vaste: de la philosophie à la pratique de l'économie, de l'éthique à l'esthétique et de la métaphysique aux questions religieuses. Koslowski est toutefois un philosophe incarné: la réflexion doit servir à organiser la vie réelle pour le bien de nos prochains, à gommer les dysfonctionnements qui l'affectent. Pour atteindre cet optimum pratique, elle doit être interdisciplinaire, éviter l'impasse des spécialisations trop exigües, produits d'une pensée trop analytique et pas assez organique.
Pour la rédaction d'un article, l'interdisciplinarité préconisée par Koslowski fait problème, dans la mesure où elle ferait allègrement sauter les limites qui me sont imparties. Bornons-nous, ici, à évoquer la présentation critique que nous donne Koslowki de la “postmodernité” et des phénomènes dits “postmodernes”.
La “modernité” a d'abord été chrétienne, dans le sens où les chrétiens de l'antiquité tardive se désignaient par l'adjectif moderni, pour se distinguer des païens qu'ils appelaient les antiqui. Dans cette acception, la modernité correspond au saeculum de Saint-Augustin, soit le temps entre la Chute et l'Accomplissement, sur lequel l'homme n'a pas de prise, seul Dieu étant maître du temps. Cette conception se heurte à celle des gnostiques, constate Koslowski, qui protestent contre l'impuissance de l'homme à exercer un quelconque pouvoir sur le temps et la mort. Le gnosticisme —qu'on ne confondra pas avec ce que Koslowski appelle “la vraie gnose”— prétendra qu'en nommant le temps (ou des segments précis et définis du temps), l'homme parviendra à exercer sa puissance sur le temps et sur l'histoire. Par “nommer le temps”, par le fait de donner des noms à des périodes circonscrites du temps, l'homme gnostique a la prétention d'exercer une certaine maîtrise sur ce flux qui lui échappe. La division du temps en “ères” antique, médiévale et moderne donne l'illusion d'une marche en avant vers une maîtrise de plus en plus assurée et complète sur le temps. Telle est la logique gnostique, qui se répétera, nous allons le voir, dans les “grands récits” de Hegel et de Marx, mais en dehors de toute référence à Dieu ou au Fils de Dieu incarné dans la chair des hommes.
Parallèlement à cette volonté d'arracher à Dieu la maîtrise du temps, le gnosticisme, surtout dans sa version docétiste, nie le caractère historique de la vie de Jésus, rejette le fait qu'il soit réellement devenu homme et chair. Le gnosticisme spiritualise et dés-historise l'Incarnation du Christ et introduit de la sorte une anthropologie désincarnée, que refusera l'Eglise. Ce refus de l'Eglise permet d'éviter l'écueil de l'escapisme vers des empyrées irréelles, de déboucher dans l'affabulation phantasmagorique et spiritualiste. L'Incarnation revalorise le corps réel de l'homme, puisque le Christ a partagé cette condition. Cette revalorisation implique, par le biais de la caritas active, une mission sociale pour l'homme politique chrétien et conduit à affirmer une religion qui tient pleinement compte de la communauté humaine (paroissiale, urbaine, régionale, nationale, continentale ou écouménique). L'homme a dès lors un rôle à jouer dans le drame du saeculum, mais non pas un rôle de pur sujet autonome et arbitraire. Si les gnostiques de l'antiquité avaient nié toute valeur au monde en refusant l'Incarnation, l'avatar moderne du gnosticisme idolâtrera le monde, tout en le désacralisant; le monde n'aura plus de valeur qu'en tant que matériau, que masse de matières premières, mises à la totale disposition de l'homme, jetées en pâture à son arbitraire le plus complet. Le gnosticisme moderne débouche ainsi sur la “faisabilité” totale et sur la catastrophe écologique.
Si le premier concept de modernité était celui de la chrétienté imbriquée dans le saeculum (selon Saint-Augustin), la deuxième acception du terme “modernité” est celle de la philosophie des Lumières, dans ses seuls avatars progressistes. Koslowski s'insurge contre la démarche de Jürgen Habermas qui a érigé, au cours de ces deux dernières décennies, ces “Lumières progressistes” au rang de seul projet valable de la modernité. Habermas perpétue ainsi la superstition du progressisme des gauches et jette ainsi un soupçon permanent sur tout ce qui ne relève pas de ces “Lumières progressistes”. L'idée d'un progrès matériel et technique infini provient du premier principe (galiléen) de la thermodynamique, qui veut que l'énergie se maintient en toutes circonstances et s'éparpille sans jamais se perdre au travers du monde. Dans une telle optique, l'accroissement de complexité, et non la diminution de complexité ou la régression, est la “normalité” des temps modernes. Mais, à partir de 1875, émerge le second principe de la thermodynamique, qui constate la déperdition de l'énergie, ce qui permet d'envisager la décadence, le déclin, la mort des systèmes, la finitude des ressources naturelles. Le projet moderne de dominer entièrement la nature s'effondre: l'homme gnostique/moderne ne prendra donc pas la place de Dieu, il ne sera pas, à la place de Dieu, le maître du temps. Dans ce sens, la postmodernité commence en 1875, comme le notait déjà Toynbee, mais ce fait de la déperdition n'est pas pris en compte par les idéologies politiques dominantes. Partis, idéologues, décideurs politiques agissent encore et toujours comme si ce second principe de la thermodynamique n'avait jamais été énoncé.
Pourtant, malgré les 122 ans qui se sont écoulés depuis 1875, l'usage du vocable “postmoderne” est venu bien plus tard et révèle l'existence d'un autre débat, parti du constat de l'effondrement de ce que Jean-François Lyotard appelait les “grands récits”. Pour Lyotard, les “grands récits” sont représentés par les doctrines de Hegel et de Marx. Ils participent, selon Koslowski, d'une “immanentisation radicale” et d'une “historicisation” de Dieu, où l'histoire du monde devient synonyme de la marche en avant de l'absolu, libérant l'homme de sa prison mondaine et de son enveloppe charnelle. Pour Marx, cette marche en avant de l'absolu équivaut à l'émancipation de l'homme, qui, en bout de course, ne sera plus exploité par l'homme ni assujetti au donné naturel. Lyotard déclarera caducs ces deux “grands récits”, expressions d'un avatar contemporain du filon gnostique.
A la suite de cette caducité proclamée par Lyotard, le philosophe allemand Odo Marquard embraye sur cette idée et annonce le remplacement des deux “grands récits” de la modernité européenne par une myriade de “petits récits”, qu'il appelle (erronément) des “mythes”. Le marxisme, l'idéalisme hégélien et le christianisme, dans l'optique de Marquard, sont “redimensionnés” et deviennent des “petits récits”, à côté d'autres “petits récits” (notamment ceux du “New Age”), auquel il octroie la même valeur. C'est le règne de la “polymythie”, écrit Koslowski, que Marquard érige au rang d'obligation éthique. Le jeu de la concurrence entre ces “mythes”, que Koslowski nomme plus justement des “fables”, devient la catégorie fondamentale du réel. La concurrence et l'affrontement entre les “petits récits”, le débat de tous avec tous, le jeu stérile des discussions aimables non assorties de décisions constituent la variante anarcho-libérale de la postmodernité, conclut Koslowski. Ce néo-polythéisme et cet engouement naïf pour les débats entre tous et n'importe qui dévoile vite ses insuffisances car: 1) La vie est unique et ne peut pas être inscrite exclusivement sous le signe du jeu, sans tomber dans l'aberration, ni sous le signe de la discussion perpétuelle, ce qui serait sans issue; 2) Totaliser ce type de jeu est une aberration, car s'il est totalisé, il perd automatiquement son caractère ludique; 3) Cette polymythie, théorisée par Marquard, se méprend sur le caractère intrinsèque des “grands récits”; contrairement aux “petits récits”, alignés par Marquard, ils ne sont pas des “fables” ou de sympathiques “historiettes”, mais un “mélange hybride d'histoire et de philosophie spéculative”, qui est “spéculation dogmatique” et ne se laisse pas impliquer dans des “débats” ou des “jeux discursifs”, si ce n'est par intérêt stratégique ponctuel. La polymythie de Marquard n'affirme rien, ne souhaite même pas maintenir les différences qui distinguent les “petits récits” les uns des autres, mais a pour seul effet de mélanger tous les genres et d'estomper les limites entre toutes les catégories. Les ratiocinations évoquant une hypothétique “pluralité” qui serait indépassable ne conduisent qu'à renoncer à toute hiérarchisation des valeurs et s'avèrent pure accumulation de fables et d'affabulations sans fondement ni épaisseur.
Après la “polymythie” de Marquard, le second volet de l'offensive postmoderne en philosophie est représentée par le filon “déconstructiviste”. En annonçant la fin des “grands récits”, Lyotard a jeté les bases d'une vaste entreprise de “déconstruction” de toutes les institutions, instances, initiatives, que ces “grands récits” avaient générées au fil du temps et imposées aux sociétés humaines. Procédant effectivement de cette “spéculation dogmatique” assimilable à un néo-gnosticisme, les “grands récits” ont été “constructivistes” —ils relevaient de ce que Joseph de Maistre appelait “l'esprit de fabrication”— et ont installé, dit Koslowski, des “cages d'acier” pour y enfermer les hommes et, aussi, les mettre à l'abri de tout appel de l'Absolu. Ces “cages d'acier” doivent être démantelées, ce qui légitime la théorie et la pratique de la “déconstruction”, du moins jusqu'à un certain point. Si déconstruire les cages d'acier est une nécessité pour tous ceux qui veulent une restauration des valeurs (traditionnelles), faire du “déconstructivisme” une fin en soi est un errement de plus de la modernité. Toujours hostile aux avatars du gnosticisme antique, à l'instar du penseur conservateur Erich Voegelin, Koslowski rappelle que pour les gnoses extrêmes, le réel est toujours “faux”, “inauthentique”, “erratique”, etc. et, derrière lui, se trouvent le “surnaturel”, le “tout-autre”, l'“inattendu”, le “nouveau”, l'“étranger”, toujours plus “vrais” que le réel. Pour Lyotard et Derrida, le philosophe doit toujours placer ce “tout-autre” au centre de ses préoccupations, lui octroyer d'office toute la place, au détriment du réel, toujours considéré comme insuffisant et imparfait, dépourvu de valeur. Lyotard veut privilégier les “discontinuités” et les “hétérogénéités” contre les “continuités” et les “homogénéités”, car elles témoignent du caractère “déchiré” du monde, dans lequel jamais aucun ordre ne peut se déployer. L'idée d'ordre —et non seulement la “cage d'acier”— est un danger pour les déconstructivistes et non pas la chance qui s'offre à l'homme de s'accomplir au service des autres, de la Cité, du prochain, etc.
Pour Koslowski, cette logique “anarchisante” dérive de Georges Bataille, récemment “redécouvert” par la “nouvelle droite”. Bataille, notamment dans La littérature et le mal, explique que la souveraineté consiste à accroître la liberté jusqu'à obtenir un “être-pour-soi” absolu, car toute activité consistant à maintenir l'ordre est signe d'escalavage, d'une “conscience d'esclave”, servile à l'égard de l'“objectivité”. L'homme ne peut être souverain, pour Bataille, que s'il se libère du langage et de la vie, donc s'il est capable de s'auto-détruire. Le moi de Bataille renonce de façon absolue à défendre et à maintenir la vie (laquelle n'a pas de valeur comme le monde n'avait pas de valeur pour les gnostiques de la fin de l'antiquité, qui refusaient le mystère de l'Incarnation). L'apologie du “gaspillage”, antonyme total de la “conservation”, et la “mystique du moi” chez Bataille débouchent donc sur une “mystique de la mort”. En ce sens, elle surprivilégie la dispersio des mystiques médiévaux, lui accorde un statut ontologique, sans affirmer en contre-partie l'unio mystica.
Telle est la critique qu'adresse Koslowski à la philosophie postmoderne. Elle ne s'est pas contenté de “déconstruire” les structures imposées par la modernité, elle n'a pas rétabli l'unio mystica, elle a généralisé un “déconstructivisme” athée et nihiliste, qui ne débouche sur rien d'autre que la mort, comme le prouve l'œuvre de Bataille. Mais si Koslowski s'insurge contre le refus du réel qui part du gnosticisme pour aboutir au déconstructivisme de Derrida, que propose-t-il pour ré-ancrer la philosophie dans le réel, et pour dégager de ce ré-ancrage une philosophie politique pratique et une économie qui permette de donner à chacun son dû?
Dans un débat qui l'opposait à Claus Offe, politologue allemand visant à maintenir une démocratie de facture moderne, Koslowski indiquait les pistes à suivre pour se dégager de l'impasse moderne. Offe avait constaté que les processus de modernisation, en s'amplifiant, en démultipliant les différenciations, en accélérant outrancièrement les prestations des systèmes et sous-systèmes, confisquaient aux structures et aux institutions de la modernité le caractère normatif de cette même modernité. Différenciations et accélérations finissent par empêcher la modernité d'être émancipatrice, alors qu'au départ son éthique foncière visait justement l'émancipation totale (i.e.: échapper à la prison du réel pour les gnostiques, s'émanciper de la tyrannie du donné naturel chez Marx). Pour réintroduire au centre des préoccupations de nos contemporains cette idée d'émancipation, Offe prône l'arrêt des accumulations, différenciations et accélérations, soit une “option nulle”. Offe veut la modernité sans progrès, parce que le progrès fini par générer des structures gigantesques, incontrôlables et non démocratiques. Il réconcilie ainsi la gauche post-industrielle et les paléo-conservateurs, du moins ceux qui se contentent de ce constat somme toute assez facile. Effectivement, constate Koslowski, Offe démontre à juste titre qu'une accumulation incessante de différenciations diminue la vitalité et la robustesse de la société, surtout si les sous-systèmes du système sont chacun monofonctionnels et s'avèrent incapables de régler des problèmes complexes, chevauchant plusieurs types de compétences. Si les principes de vérité, de justice et de beauté s'éloignent les uns des autres par suite du processus de différenciation, nous aurons, comme l'avait prévu Max Weber, une vérité injuste et laide, une justice fausse et laide et une esthétique immorale et fausse. De même, le divorce entre économie, politique et solidarité, conduit à une économie impolitique et non solidaire, à une politique anti-économique et non solidaire, à une solidarité anti-économique et impolitique. Ces différenciations infécondes de la modernité doivent être dépassées grâce à une pratique de l'“interpénétration” générale, conduisant à une polyfonctionalité des institutions dans lesquelles les individus seront organiquement imbriqués, car l'individu n'est pas seulement une unité économique, par exemple, mais est simultanément ouvrier d'usine, artiste amateur, père de famille, etc. Chaque institution doit pouvoir répondre tout de suite, sans médiation inutile, à chacune des facettes de la personnalité de ce “père-artiste-ouvrier”. Offe considère que l'“interpénétration” pourrait porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Koslowski rétorque que cette séparation des pouvoirs serait d'autant plus vivante avec des institutions polyfonctionnelles et plus robustes, taillées à la mesure d'hommes réels et complexes. L'“option nulle” est un constat d'échec. L'effondrement de la modernité politique et des espoirs qu'elle a fait naître provoque la déprime. Un monde à l'enseigne de l'“option nulle” est un monde sans perspective d'avenir. Un système qui ne peut plus croître, s'atrophie.
Pour Koslowski, c'est le matérialisme, donc la pensée économiciste, —la sphère de l'économie dans laquelle la modernité matérialiste avait placé tous ses espoirs— qui est contrainte d'adopter l'“option nulle”. Comme cette pensée a fait l'impasse sur la culture, la religion, l'art et la science, elle est incapable de générer des développements dans ces domaines et d'y susciter des effets de compensation, pourtant essentiels à l'équilibre humain et social. L'impasse, le sur-place du domaine socio-économique doit être un appel à investir des énergies créatrices et des générosités dans les dimensions religieuses, artistiques et scientifiques, conclut Koslowski.
Telle est bien son intention et Koslowski ne se contente pas d'émettre le vœu d'une économie plus conforme aux principes de conservation et d'équilibre des philosophies non modernes. Deux livres très denses témoignent de sa volonté de sauver l'économie et le social de la stagnation et du déclin induits par l'“option nulle”, constatée par Offe, un politologue déçu de la modernité mais qui veut à tout prix la sauver, en dépit de ses échecs patents. Dans cette optique, Koslowski a écrit Wirtschaft als Kultur (1989) et Die Ordnung der Wirtschaft (1994) (réf. infra). Ces deux ouvrages sont si fondamentaux que nous serons contraints d'y revenir: retenons, ici, que Koslowski, dans Wirtschaft als Kultur, part du constat que les réserves naturelles de la planète s'épuisent, qu'elles sont limitées, que cette limite doit être prise en compte dans toutes nos actions, qu'elle implique ipso facto que le progrès accumulatif illimité est une impossibilité pratique. A ce progressisme qui avait structuré toute la pensée moderne, Koslowski oppose les idées d'une “justice” et d'une “réciprocité” dans les échanges entre l'homme et la nature. Ensuite, il plaide pour une réinsertion de la pensée économique dans une culture plus globale, laissant une large place à l'éthique du devoir. Il esquisse ensuite les contours de l'Etat social postmoderne, qui doit être “subsidiaire” et prévoir une solidarité en tous sens entre les générations. Cet Etat postmoderne et subsidiaire doit participer, de concert avec ses homologues, à la restauration d'un marché intérieur européen, prélude à la naissance d'une “nation européenne”, capable d'organiser ses différences ethniques et culturelles sans sombrer dans le nivellement des valeurs qu'un certain discours sur la “multiculturalité” appelle de ses vœux (Koslowski se montre très sévère à l'égard de cet engouement pour la “multiculture”).
Dans Die Ordnung der Wirtschaft, ouvrage très solidement charpenté, Koslowski jette les bases d'un néo-aristotélisme, où s'allient “philosophie pratique” et “économie éthique-politique”. Cette alliance part d'une “interpénétration” et d'une “compénétration” des rationalités éthique, économique et politique. Ainsi, la “bonne politique” est celle qui ne répond pas seulement aux impératifs politiques (conservation du pouvoir, évitement des conflits), mais vise le bien commun et la couverture optimale de tous les besoins vitaux. Les structures économiques, toujours selon cette logique néo-aristotélicienne, doivent également répondre à des critères politiques et éthiques. Quant à l'éthique, elle ne saurait être ni anti-économique ni anti-politique. Cette volonté de ne pas valoriser un domaine d'activité humaine au détriment d'une autre postule de recombiner ce que la modernité avait voulu penser séparément. La philosophie pratique d'Aristote entend également conserver les liens d'amitié politique (philia politike) entre les citoyens et les communautés de citoyens, qui fondent le sens du devoir et de la réciprocité. Koslowski relie ce principe cardinal de la pensée politique aristotélicienne aux travaux de la nouvelle école communautarienne américaine (A. MacIntyre, M. Walzer, Ch. Taylor, etc.). Le néoaristotélisme met l'accent sur le retour indispensable de la vertu grecque de phronesis: l'intelligence pratique, capable de discerner ce qui est bon et utile pour la Cité, dans le contexte propre de cette Cité. En effet, la rationalité pure, sur laquelle l'hypermodernité avait parié, exclut le contexte. L'application de cette rationalité décontextualisante dans le domaine de l'économie a conduit à une impasse voire à des catastrophes: une rationalité économique réelle et globale exige une immersion herméneutique dans le tissu social, où se conjuguent actions économiques et politiques. Enfin, le réel est le fondement premier de la philosophie pratique et non le “discours” ou l'“agir communicationnel” (cher à Habermas ou à Apel), car tout ne procède pas de l'agir et du parler: l'Etre transcende l'action et ses déterminations précèdent l'acte de parler ou de discourir.
La pensée philosophique et économique de Koslowski constitue une réponse aux épreuves que nous a infligées la modernité: elle représente la facette positive, le complément constructif, de sa critique de la modernité gnosticiste. Elle est un chantier vers lequel nous allons immanquablement devoir retourner. Puisse cette modeste introduction éveiller l'attention du public francophone pour cette œuvre qui n'a pas encore été découverte en France et qui complèterait celles de Taylor, MacIntyre, Spaemann, déjà traduites.
Bibliographie:
- Peter KOSLOWSKI, «Sein-lassen-können als Überwindung des Modernismus. Kommentar zu Claus Offe», in Peter KOSLOWSKI, Robert SPAEMANN, Reinhard LÖW, Moderne oder Postmoderne?, Acta Humaniora/VCH, Weinheim, 1986
- Peter KOSLOWSKI, Wirtschaft als Kultur. Wirtschaftskultur und Wirtschaftsethik in der Postmoderne, Edition Passagen, Wien, 1989.
- Peter KOSLOWSKI, Die Prüfungen der Neuzeit. Über Postmodernität. Philosophie der Geschichte, Metaphysik, Gnosis, Edition Passagen, Wien, 1989.
- Peter KOSLOWSKI, «Supermoderne oder Postmoderne? Dekonstruktion und Mystik in den zwei Postmodernen», in Günther EIFLER, Otto SAAME (Hrsg.), Postmoderne. Anspruche einer neuen Epoche. Eine interdisziplinäre Erörterung, Edition Passagen, Wien, 1990.
- Peter KOSLOWSKI, Die Ordnung der Wirtschaft, Mohr/Siebeck, Tübingen, 1994.
par Jacques-Henri Doellmans
00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : post-modernité, modernité, philosophie, allemagne, catholicisme, religion, éthique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


