Diplômé de l’École normale supérieure, Jean-Yves Pranchère est par ailleurs professeur à l’Université libre de Bruxelles et membre du comité de rédaction de la Revue européenne des sciences sociales (Droz, Genève). Son domaine d’étude est la théorie politique, avec un attrait tout particulier pour les auteurs réactionnaires sur lesquels il a notamment travaillé pour sa thèse. Il a récemment publié chez Seuil une somme avec Justine Lacroix (professeure de théorie politique à l’ULB) sur les critiques des droits de l’homme, des contre-révolutionnaires à Hannah Arendt en passant par Marx ou Carl Schmitt : « Le Procès des droits de l’homme. Généalogie du scepticisme démocratique ». Nous avons voulu nous entretenir avec lui car, antilibéraux, nous nous interrogeons nous-mêmes sur le rapport entre droits de l’homme et politique révolutionnaire.
Le Comptoir : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser spécifiquement à la thématique de la critique des droits de l’homme ?
 Jean-Yves Pranchère : L’initiative est venue de Justine Lacroix, qui s’est engagée il y a six ans dans le projet d’une étude des résistances contemporaines aux droits de l’homme ; elle en a exposé les attendus dans deux articles programmatiques, « Des droits de l’homme aux droits humains ? » et « Droits de l’homme et politique ». Elle a organisé sur ce sujet, dans le cadre du Centre de Théorie politique qu’elle dirige, un intense travail collectif ; le récent dossier publié par le site Raison publique en est une des traces. Ce travail entrait en résonance avec mes propres recherches sur la tradition contre-révolutionnaire, que je me suis efforcé d’étudier comme une des coordonnées décisives de ce qu’Adorno et Horkheimer ont nommé la « dialectique des Lumières » – qu’il ne faut justement pas concevoir, à la façon des contre-révolutionnaires eux-mêmes, comme la logique nécessaire d’un déclin ou d’une autodestruction de la raison, mais comme le processus pluriel au cours duquel se révèlent, entrent en crise ou s’élucident les ambiguïtés du projet d’autonomie.
Jean-Yves Pranchère : L’initiative est venue de Justine Lacroix, qui s’est engagée il y a six ans dans le projet d’une étude des résistances contemporaines aux droits de l’homme ; elle en a exposé les attendus dans deux articles programmatiques, « Des droits de l’homme aux droits humains ? » et « Droits de l’homme et politique ». Elle a organisé sur ce sujet, dans le cadre du Centre de Théorie politique qu’elle dirige, un intense travail collectif ; le récent dossier publié par le site Raison publique en est une des traces. Ce travail entrait en résonance avec mes propres recherches sur la tradition contre-révolutionnaire, que je me suis efforcé d’étudier comme une des coordonnées décisives de ce qu’Adorno et Horkheimer ont nommé la « dialectique des Lumières » – qu’il ne faut justement pas concevoir, à la façon des contre-révolutionnaires eux-mêmes, comme la logique nécessaire d’un déclin ou d’une autodestruction de la raison, mais comme le processus pluriel au cours duquel se révèlent, entrent en crise ou s’élucident les ambiguïtés du projet d’autonomie.
Parmi les motifs du livre, que nous avons écrit à deux dans une interaction permanente, je soulignerai la perplexité éprouvée devant le succès d’une critique des droits de l’homme menée au nom de la démocratie.
Le paradoxe est déjà ancien : il surgit dès le retour des droits de l’homme sur l’avant de la scène politique dans les années 1970, à la suite du coup d’État de Pinochet au Chili et des luttes des dissidents des pays de l’Est[i]. Ceux-ci induisirent une large conversion de la gauche, y compris de la gauche dite alors “eurocommuniste”, à un refus définitif de l’idée que la violation des droits fondamentaux pouvait être une étape de la construction du socialisme. Or, cette reconquête du langage des droits de l’homme, accomplie à la fois contre l’effondrement totalitaire du “socialisme réel” et contre le soutien des USA aux régimes tortionnaires d’Amérique latine, s’est presque aussitôt accompagnée d’un discours de méfiance à l’égard desdits “droits de l’homme” ; discours qui n’a cessé de s’amplifier depuis, alors même que ceux qui l’adoptent disent explicitement ne rien opposer aux droits de l’homme. Marcel Gauchet, par exemple, assume en termes très clairs l’impossibilité d’une opposition de principe au droits de l’homme : « Les droits de l’homme sont cette chose rare entre toutes qu’est un principe de légitimité. Ils sont le principe de légitimité qui succède au principe de légitimité religieux. Il n’y en aura eu que deux dans l’histoire, et il y a toutes les raisons de penser qu’il n’y en a que deux possibles, logiquement parlant. À quelle source rapporter ce qui fait norme parmi les êtres, quant à ce qui organise leurs communautés, quant à ce qui les lie, quant à ce qui permet d’établir le juste entre eux, quant à l’origine des pouvoirs chargés de régler l’existence en commun ? À ce problème fondamental, il y a deux façons de répondre et deux seulement. Ou bien cette source est au-delà du domaine des hommes, ou bien elle est en lui — ou bien elle est transcendante, ou bien elle est immanente. »[ii]
On croit comprendre alors que la réserve exprimée envers les droits de l’homme vise uniquement une interprétation illusoire de ceux-ci, selon laquelle ils seraient susceptibles de fournir, non seulement le cadre juridique, mais la substance même de la vie sociale. Comme l’explique encore Marcel Gauchet, dans son tout dernier livre : « Ce n’est pas le principe qu’il y a lieu de condamner : nous sommes bien évidemment tous pour les droits de l’homme. C’est l’usage qu’on en fait qui doit être incriminé ; l’impossibilité pour une société de se réduire à ce principe, qui est par ailleurs vrai. Nous sommes tous pour les droits de l’homme, mais… Tout est dans ce “mais” qu’il est très difficile de faire entendre aux procureurs qui pensent être dans le vrai […]. »[iii]
Cette distinction entre le “principe” et “l’usage” n’est pourtant pas suffisante pour supprimer toute perplexité. Dans la phrase : « les droits de l’homme, mais… », le « mais » porte bel et bien sur le principe qu’on s’efforce de relativiser au moment même où on admet qu’il n’a pas de rival. S’il ne s’agissait que de critiquer un « usage », il n’y aurait aucune nécessité à soumettre le principe à un « mais » ; il suffirait de lui ajouter un “et”, un “avec”, un “de telle manière que…” – bref, de lui ajouter un mode d’emploi. Imagine-t-on un chrétien qui dirait “Aimez-vous les uns les autres, mais…” ou “Soyez justes, mais…” ? Son message en serait immédiatement brouillé.
Force est donc de constater que la critique des droits de l’homme conserve quelque chose de paradoxal et d’équivoque. À preuve le fait que le « mais », dans le propos cité de Marcel Gauchet, n’introduit pas à une spécification de l’idée, mais à l’indétermination de trois points de suspension, suivis de l’esquive facile que constitue la polémique rebattue contre le “politiquement correct” qui, paraît-il, empêche Zemmour, Onfray et Finkielkraut de faire la une des magazines.
“Les droits de l’homme, mais…” Cette rumeur qu’on entend partout, et qui inspire l’accusation vide de “droit-de-l’hommisme”, appelle une question simple : “… mais quoi ?” C’est là l’objet de notre livre.
La critique des droits de l’homme a pu connaître diverses formes. Contrairement à ce que l’on pense généralement, elle n’a pas été l’apanage des réactionnaires. Pourriez-vous nous dresser un bref panorama de ces critiques ?
Je crains de ne pas pouvoir résumer en quelques lignes ce qui nous a demandé un livre entier ! Je serai donc elliptique plutôt que bref. Notre livre part d’un essai de classification des critiques contemporaines des droits de l’homme et dresse l’arrière-plan généalogique de celles-ci. La typologie contemporaine distingue trois grands courants :
- un courant “antimoderne”, qui conteste le principe même des droits de l’homme ; il se divise en deux branches, une branche néo-thomiste axée sur l’idée d’un ordre juste qui ne connaît de droits que relatifs, et une branche qu’on pourrait dire néo-schmittienne qui dénonce les droits de l’homme comme un moralisme antipolitique ;
- un courant “communautaire”, qui reconnaît la valeur normative des droits de l’homme mais en limite la portée en soulignant que ces droits ne peuvent produire ni communauté politique ni lien social ; cette thématique a été développée, de manière parallèle, par les communautariens américains et par les souverainistes français qui entendent par “république” le régime de l’incarnation de la nation en une volonté générale ;
- un courant “radical”, d’ascendance marxienne, qui voit dans les droits de l’homme l’indice d’un abandon du projet de l’auto-organisation démocratique de la société au profit de l’éternisation de la séparation entre “société civile” et État.
Ces différents courants reprennent, sur un mode souvent diffus, des argumentaires qui ont été mis au point, sous des formes extrêmement conséquentes, par de grands théoriciens politiques dont les pensées nous ont paru constituer, pour ainsi dire, des “idéaux-types” réalisés des critiques possibles des droits de l’homme. Il nous a donc semblé nécessaire de confronter les critiques contemporaines à ces modèles antérieurs qui définissent les enjeux dans toute leur acuité.
« La similarité des arguments utilisés par les différents auteurs n’empêche pas la profonde hétérogénéité des dispositifs théoriques. »
Nous avons distingué ainsi une critique réactionnaire, théologico-politique, axée sur les devoirs envers Dieu, dont la version “sociologique” est fournie par Bonald et la version “historiciste” par Maistre ; une critique conservatrice, à la fois libérale et jurisprudentialiste, axée sur les droits de la propriété et de l’héritage, représentée par Burke ; une critique progressiste, utilitariste, axée sur le primat des besoins sur les droits, dont la version individualiste, libérale-démocratique, est donnée par Bentham, et dont la version organiciste, qu’on peut dire en un sens “socialiste”[iv], est donnée par Comte ; une critique révolutionnaire, axée sur le refus de discipliner par le droit l’auto-émancipation sociale, dont la figure éminente est bien entendu le communisme de Marx.
L’étude de ces quatre modèles fait d’abord apparaître que la similarité des arguments utilisés par les différents auteurs n’empêche pas la profonde hétérogénéité des dispositifs théoriques : quoi de commun entre un Burke, qui entend subordonner les droits de l’homme au droit de propriété qui les annule socialement, et un Marx qui entend pousser les droits de l’homme au-delà d’eux-mêmes en tournant leur revendication d’égalité contre le droit de propriété ?
De là une deuxième leçon : les critiques des droits de l’homme sont instables, traversées par des dialectiques qui les conduisent, quand elles ne veulent pas déboucher sur des positions contradictoires ou régressives, à fournir malgré elles les moyens d’un enrichissement ou d’un approfondissement des droits de l’homme.
Cette leçon est illustrée par deux grandes figures antithétiques du XXe siècle : la figure “régressive” de Carl Schmitt, qui dans les années 1920, avant son passage au nazisme, a développé de manière systématique – et, il faut bien le dire, fallacieuse – le thème d’une opposition entre démocratie et État de droit, conduisant à une dénonciation virulente de la fonction “dépolitisante” des droits de l’homme ; et la figure dialectiquement instruite de Hannah Arendt, qui, aux antipodes de la régression nationaliste proposée par Schmitt, a réarticulé l’idée des droits de l’homme sous la forme du “droit à avoir des droits”. Hannah Arendt, nous semble-t-il, indique les voies d’une conception politique des droits de l’homme, qui les lie indissolublement à la citoyenneté sans confondre celle-ci avec la forme de l’État-nation ni céder au mirage d’un État mondial qui en finirait avec la condition politique de la pluralité.
On parle beaucoup aujourd’hui des droits de l’homme, mais on oublie l’autre versant de la Déclaration de 1789, qui était là pour satisfaire la frange républicaine des révolutionnaires : les droits du citoyen. N’est-ce pas là une preuve du triomphe de la vision libérale de ces droits ?
Je vous répondrais volontiers en pastichant le célèbre paragraphe des Considérations sur la France de Maistre contre l’idée de “l’homme” : j’ai vu des partisans et des ennemis des droits de l’homme, mais quant à “on”, je ne l’ai jamais rencontré de ma vie !
Plus sérieusement, les droits de l’homme ne sont ni une idéologie unifiée ni une doxa anonyme sous laquelle on pourrait ranger pêle-mêle des phénomènes aussi différents que les militantismes nationaux et transnationaux en faveur de l’égalité des droits et des solidarités sociales, le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme ou du Tribunal pénal international de La Haye (dont l’autorité reste refusée par nombre de grands États), l’architecture démocratique de l’État de droit social, l’influence médiatique de rhétoriques moralisantes dont l’effet est d’émousser la pointe critique des droits de l’homme, ou encore l’existence de falsifications impérialistes éhontées qui font servir le langage des droits de l’homme à la mise en œuvre de leur violation, comme ce fut le cas avec Georges W. Bush.
Cette hétérogénéité est irréductible. Dans la mesure où les droits de l’homme sont « un principe de légitimité », pour reprendre l’expression de Marcel Gauchet, ils ne sont pas tant un “discours” que l’ouverture d’un champ discursif et d’un espace d’action politique. À ce titre, ils tolèrent une multiplicité d’investissements : ils s’exposent aux ruses des faussaires ; ils peuvent subir les distorsions que leur imposent des stratégies intéressées ; mais ils peuvent aussi – et surtout – nourrir des revendications fortes qui réclament que la réalité soit mise en conformité avec l’idéal et que les droits soient établis dans toute leur extension et leur plénitude. Il faut donc renoncer à faire la psychologie imaginaire d’un sujet imaginaire qui serait “l’époque” – le “on”, qui serait en attente de nos leçons de morale –, et se tourner vers l’analyse politique des lignes de force du champ de bataille des “droits de l’homme”.
« La réticence néo-libérale à l’égard des droits de l’homme est cohérente. »
Pour ce qui est de cette “vision” qui oublie les droits du citoyen dans les droits de l’homme, je serais d’accord avec vous pour dire qu’elle est libérale, mais au sens d’un libéralisme très étroit et très appauvri : un libéralisme hayékien, mais pas rawlsien.
En revanche, je suis assez dubitatif devant l’idée que ce libéralisme hayékien détiendrait la clef de la vision dominante des droits de l’homme. Je crois au contraire qu’il ne parle le langage des droits de l’homme qu’à contrecœur, et pour le subvertir. Rappelons-nous que l’offensive ultralibérale a trouvé son premier terrain d’application dans le Chili de la fin des années 1970 et que Hayek, par son soutien à Pinochet, a montré que les droits individuels requis par la liberté du marché n’étaient pas les “droits de l’homme”.
Et, j’ajouterais que la réticence néo-libérale à l’égard des droits de l’homme est cohérente. Elle vient d’une conscience lucide de ce que les “droits du citoyen” n’ont jamais été et ne peuvent jamais être un ”autre versant” des droits de l’homme, à la façon d’un “volet facultatif” : ils sont leur cœur même depuis le début, depuis ce mois d’août 1789 où personne n’était encore “républicain” et ne pouvait imaginer jusqu’où conduirait la radicalité du processus révolutionnaire qui venait de se donner sa justification théorique dans la Déclaration.
Il ne faut pas oublier, en effet, que la Déclaration inscrit en elle l’acte insurrectionnel dont elle procède : elle est le texte par lequel une insurrection politique énonce et réfléchit son droit. Par là s’explique que les énoncés de la Déclaration aient pu constituer une sorte d’événement originaire, en rupture avec ses propres antécédents jusnaturalistes, et initier un développement voué à dépasser les intentions conscientes des rédacteurs. Relisez donc les trois premiers articles : l’affirmation que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » (article 1) débouche presque immédiatement sur la proclamation de la souveraineté de la nation, comprise comme la communauté politique des individus égaux en droits (article 3). L’égalité des droits induit directement la souveraineté du peuple qui en est la seule forme possible.
Il n’y a pas là deux “versants” ou deux idées, celles de l’homme et du citoyen (auxquels on aurait accordé des droits distincts pour faire plaisir aux uns et aux autres), mais bien une seule et même proposition, qu’Etienne Balibar nomme « la proposition de l’égaliberté »[v] afin de souligner l’identité qu’elle affirme entre égalité et liberté, une identité plus étroite que celle que suggère l’expression “égalité des libertés”. Cette identité entre égalité et liberté implique que l’homme et le citoyen soient indissociables, puisque l’égalité est à la fois la condition et l’objet de la pratique des citoyens en tant qu’ils sont des hommes libres.

Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère
Les droits de l’homme sacralisent d’une certaine manière les droits qu’ils proclament, en les absolutisant. L’idée est bien souvent de les préserver de l’intervention du pouvoir, des délibérations humaines. Par ailleurs, l’idée d’une charte de droits sacralisés pourrait être perçue comme une limite à la décision humaine, donc un facteur d’hétéronomie. Les droits de l’homme ne sont-ils pas aujourd’hui devenus l’un des principaux vecteurs de destruction de la politique, comme l’affirme Marcel Gauchet ?
Le refus de la sacralisation des droits, au nom du droit (sacré, donc ?) qu’ont les hommes de se donner les lois qu’ils veulent, est le thème central de la critique utilitariste et libérale des Déclarations faite par Bentham. À cette critique, on peut objecter qu’elle repose sur un contresens – qui, il est vrai, a été commis par certains (certains seulement) des révolutionnaires eux-mêmes[vi].
Car, la Déclaration de 1789 n’est pas une “charte de droits sacralisés” ou une énumération de droits absolus : elle est l’effort pour tirer les conséquences de la proclamation de l’égalité des hommes en droit. Elle n’absolutise pas les droits qu’elle énonce : elle décrit la manière dont ils s’équilibrent entre eux sous le principe de l’égalité et de la réciprocité des libertés. Elle est un développement, une explicitation, de la proposition de l’égaliberté – proposition dont les Déclarations ultérieures proposeront des explications qui se voudront, sans toujours l’être, plus complètes et mieux instruites.
Vous m’objecterez que le dernier article de la Déclaration de 1789 insiste bel et bien sur la sacralité du droit de propriété. Assurément ! Il ne s’agit pas de nier que le texte porte en lui, sous l’unité de son geste insurrectionnel si bien analysé par Claude Lefort[vii], les tensions théoriques induites par les désaccords des rédacteurs – tensions superbement étudiées par Marcel Gauchet dans La Révolution des droits de l’homme[viii].
Mais je n’en répondrai pas moins en rappelant que Bentham n’avait peut-être pas tort de voir, dans l’étrange insistance du dernier article à déclarer la propriété sacrée, le signe de ce que nous appelons depuis Freud une dénégation. Bentham pensait que l’égalitarisme professé par la Déclaration de 1789 avait, dans les faits, tellement désacralisé la propriété que les rédacteurs, saisis de peur devant le sens général de leur propre texte, s’étaient crus obligés de nier par un article final les conséquences évidentes des articles précédents. La Déclaration, disait Bentham, « a sacralisé la propriété à la façon dont Jephté s’est senti obligé de sacraliser sa sœur en lui coupant la gorge ». Jaurès ne dira en un sens pas autre chose lorsqu’il expliquera longuement, dans ses Études socialistes de 1901 (publiées par les Cahiers de la quinzaine de Péguy) que la Déclaration allait d’emblée très au-delà des intentions bourgeoises des révolutionnaires et portait en elle le socialisme.
Quoi qu’il en soit, accuser l’idée des droits de l’homme d’être un facteur d’hétéronomie revient à se méprendre sur leur sens, qui est précisément d’énoncer les conditions de l’autonomie individuelle et collective. La seule limite qu’ils imposent à l’autonomie est de ne pas détruire les conditions même qui la rendent possible. Habermas a parfaitement vu ce point quand il a soutenu la thèse de la « co-originarité » des droits de l’homme et de la souveraineté populaire.
Autonomie individuelle et autonomie collective s’impliquent l’une l’autre sous le régime de l’égalité des droits : telle est l’idée des droits de l’homme, le principe de leur énonciation.
Les énoncés de ces droits sont quant à eux les résultats, toujours révisables, de la façon dont la collectivité politique réfléchit les conditions de sa propre autonomie. Ils sont la forme sous laquelle les citoyens se reconnaissent réciproquement comme libres et égaux en se déclarant les uns aux autres leurs droits tels qu’ils les concluent de leur « égaliberté ».
On peut dès lors rester sceptique devant le reproche adressé aux droits de l’homme de “détruire” la politique. Ce thème avait un sens précis chez Carl Schmitt, qui identifiait l’égalité démocratique à l’homogénéité nationale et la politique à la capacité de distinguer ses ennemis, à commencer par ses ennemis intérieurs (que Schmitt désignera clairement en 1933 : les juifs et les communistes). Si la politique consiste, pour un peuple, à être capable d’assumer l’hostilité requise envers l’ennemi extérieur et intérieur, il va de soi que le respect des droits de l’homme désarme la politique. Mais une telle position est inconcevable dans le cadre d’une pensée qui ne confond pas l’autonomie démocratique avec une théologie nationaliste.
Comment comprendre alors le sens de cette critique chez des républicains d’aujourd’hui, en particulier chez Marcel Gauchet ?
Avant de nous pencher sur cette critique, commençons par rappeler qu’aux États-Unis, dans la deuxième moitié des années 1970, les idéologues républicains qui allaient inspirer la “révolution conservatrice” reaganienne, tel Irving Kristol[ix], ont mis en garde contre le danger qu’il y avait à élever des droits de l’homme à la hauteur d’un principe politique (et non d’une simple limite morale). Vouloir modeler la politique sur les droits de l’homme conduisait selon eux à s’enfoncer dans la “crise de gouvernabilité” qui inquiétait alors les économistes libéraux ; cela revenait à encourager un programme de démocratie sociale incompatible avec le bon fonctionnement d’un ordre de marché appuyé sur les vertus du respect de l’autorité et de la fierté patriotique liée au culte de la réussite et de la compétitivité. Notons au passage qu’Irving Kristol, en des termes pas si éloignés de ceux utilisés dix ans plus tard par Régis Debray, définissait la république comme la démocratie corrigée par l’éducation et le savoir (y compris le savoir de la science économique).
À la différence de ces critiques néoconservatrices et néolibérales, le retentissant article de Marcel Gauchet publié en 1980 dans Le Débat sous le titre-slogan « les droits de l’homme ne sont pas une politique » rendait un son nettement social-démocrate[x]. Marcel Gauchet soulignait que le repli sur les droits de l’homme traduisait une « impuissance à concevoir un avenir différent pour cette société », un abandon du « problème social » et du projet « d’une société juste, égale, libre ». En retombant dans « l’ornière et l’impasse d’une pensée de l’individu contre la société », les militants des droits de l’homme se faisaient les promoteurs d’une « aliénation collective », marquée par « le renforcement du rôle de l’État » et « l’aggravation du désintérêt pour la chose publique ». Contre quoi Gauchet soulignait qu’il n’était pas possible de « disjoindre la recherche d’une autonomie individuelle de l’effort vers une autonomie sociale ». Cette expression d’autonomie sociale suggérait qu’il s’agissait de maintenir les idéaux d’un socialisme anti-totalitaire, qu’on pouvait supposer autogestionnaire, contre la renonciation à la transformation sociale qu’impliquait un militantisme confiné à la protection des droits individuels.
Le propos n’allait pourtant pas sans une certaine ambiguïté. D’une part, il était étrange de voir Marcel Gauchet passer sous silence les thèses de celui qui était alors le principal représentant d’une philosophie politique des droits de l’homme, à savoir Claude Lefort. Car Claude Lefort, qui semblait être la cible non nommée de la polémique, ne pouvait certainement pas être tenu pour un penseur de “l’individu contre la société” : sa réhabilitation des droits de l’homme insistait au contraire sur le fait que ces droits n’étaient pas des droits de l’individu, mais bien des droits de la liberté des rapports sociaux. Ce qui était selon lui en jeu dans les droits de l’homme, par opposition au totalitarisme, n’était pas la sécession de l’individu à l’égard du social et du politique, mais la nécessité de ne pas penser la citoyenneté sous le fantasme du Peuple-Un et de la volonté homogène.
D’autre part, Marcel Gauchet décrivait les effets délétères des droits de l’homme sur la démocratie à travers des formules qui ne permettaient pas de décider de la nature exacte du lien qu’il faisait entre droits et désocialisation. Il parlait ainsi de « la dynamique aliénante de l’individualisme qu’ils [les droits de l’homme] véhiculent comme leur contre-partie naturelle », tournure qui suggérait à la fois que « l’aliénation individualiste » surgissait de la nature même des droits de l’homme et qu’elle leur restait extérieure puisqu’ils n’en étaient qu’un véhicule. Marcel Gauchet donnait à penser que l’effet aliénant des droits n’avait rien de nécessaire quand il écrivait que les droits de l’homme pourraient « devenir une politique » à la condition « qu’on sache reconnaître et qu’on se donne les moyens de surmonter » leur individualisme adjacent.
L’œuvre ultérieure de Marcel Gauchet réduisit l’équivoque en interprétant, de façon plus unilatérale, la menace que faisaient peser les droits de l’homme sur la démocratie comme une menace purement endogène – ce qu’exprime le titre de son recueil de 2002, La démocratie contre elle-même. L’inflexion conservatrice était sensible dans l’article de 2000, « Quand les droits de l’homme deviennent une politique » : « La démocratie n’est plus contestée : elle est juste menacée de devenir fantomatique en perdant sa substance du dedans, sous l’effet de ses propres idéaux [Jean-Yves Pranchère souligne ici]. En s’assurant de ses bases de droit, elle perd de vue la puissance de se gouverner. Le sacre des droits de l’homme marque, en fait, une nouvelle entrée en crise des démocraties en même temps que leur triomphe. »
Selon cette analyse, la crise venait, non pas d’un manque de démocratie, mais de l’excès produit par la pleine réalisation des idéaux démocratiques. L’inquiétude portait donc désormais, comme chez les néolibéraux, sur l’ingouvernabilité induite par la dynamique des droits et aggravée par le contexte de la société française – que la revue Le Débat avait souvent décrite, notamment en 1995, comme trop incapable de réforme en raison de son attachement irrationnel aux archaïsmes de son État social[xi]. L’interprétation de la crise de la démocratie comme une crise imputable à la seule logique de l’extension des droits avait pour effet de détourner l’attention de ce sur quoi, au même moment, un auteur conspué par Marcel Gauchet, à savoir Pierre Bourdieu, centrait quant à lui ses interventions politiques : la montée des inégalités, la généralisation de la précarité, la destruction des solidarités sociales induite par les politiques de dérégulation, bref le recul factuel de la démocratie et des droits sous l’effet d’une offensive néo-libérale qu’un auteur comme Pierre Rosanvallon n’hésite plus aujourd’hui à décrire comme une « véritable contre-révolution ».
Marcel Gauchet a depuis lors réaffirmé, dans son dialogue avec Alain Badiou[xii] ou dans tel article récent, l’orientation sociale-démocrate de sa pensée. Cette orientation est cependant peu visible dans son dernier livre Comprendre le malheur français. Marcel Gauchet y polémique contre le “néolibéralisme”, mais il définit celui-ci comme « un discours de contestation de la possibilité, pour le politique, d’imposer quelque limite que ce soit aux initiatives économiques des acteurs et plus généralement à l’expression de leurs droits », ce qui revient à faire du néolibéralisme un simple cas de la politique des droits. L’argument oublie que les versions les plus fortes du néolibéralisme, comme celle de Friedrich Hayek, ont pour cœur l’efficience du marché et pensent les droits comme les « règles de juste conduite » qui assurent la possibilité de cette efficience[xiii]. Le néolibéralisme ainsi compris est farouchement hostile à tout projet de contrôle démocratique de l’économie et à toute “expression” des droits individuels au-delà de l’objectif abstrait de l’existence d’un ordre légal assurant l’honnêteté des échanges. C’est pourquoi Hayek a toujours salué en Burke un des meilleurs représentants du libéralisme tel qu’il l’entendait – Burke qui, en disciple d’Adam Smith, dénonçait les droits de l’homme au nom des lois de la propriété, de l’héritage et du marché qui font la « richesse des nations« , en même temps qu’au nom du droit particulier de ces nations dont chacune a une identité propre.
Une même thèse court de Burke à Hayek : parce que le marché ne peut constituer un ordre qu’à la condition que ceux qui agissent en lui possèdent les vertus nécessaires à cet ordre, et que la première de ces vertus est la méfiance envers les projets de planification rationnelle, autrement dit le respect de la sagesse inconsciente des développements spontanés qui constituent la tradition, le néo-libéralisme appelle comme son complément naturel un traditionalisme. En règle générale, soutient Hayek, « les règles hérités de la tradition sont ce qui sert le mieux le fonctionnement de la société, plutôt que ce qui est instinctivement reconnu comme bon, et plutôt que ce qui est reconnu comme utile à des fins spécifiques »[xiv].
Ce traditionalisme implique un nationalisme dans la mesure où la “nation” est la forme par excellence de la tradition. L’alliance qu’on observe partout entre néolibéralisme et nationalisme néoconservateur semble d’abord un paradoxe, tant le principe du marché ouvert paraît incapable de justifier l’existence des communautés nationales. L’éloge de Burke par Hayek permet de comprendre que le paradoxe n’en est pas un : le nationalisme est le supplément d’âme dont le “patriotisme du marché” néolibéral a besoin pour se réaliser. Les inégalités sociales, si elles sont un moyen de la grandeur du pays et de la promotion de son identité, ne trouvent-elles pas leur meilleure justification dans l’imaginaire de l’unité nationale ?
Or, les critiques qu’adresse Marcel Gauchet au “néolibéralisme” – confondu avec une sorte de paradoxale anomie des droits – recoupent sur bien des points la critique des droits de l’homme par Burke, c’est-à-dire par un penseur qui est un des grands ancêtres du néolibéralisme contemporain dans sa version conservatrice. Après tout, Burke déclarait déjà ne pas attaquer l’idée des droits de l’homme, mais seulement leur interprétation révolutionnaire : « je suis aussi loin de dénier en théorie les véritables droits des hommes que de les refuser en pratique », disait-il en soulignant que les besoins de la société imposaient à ces droits toutes sortes de « réfractions ».
La critique des effets “dépolitisants” des droits de l’homme est donc, comme telle, très ambiguë : entend-on dire par là que l’idée des droits de l’homme entrave les luttes pour l’égalité ? L’argument est peu crédible. Veut-on dire que cette idée nuit à l’identification des citoyens à leur nation, identification qui seule les rendrait capables d’altruisme et de sacrifice ? Il reste alors à faire la différence entre l’amour de l’ordre établi et l’esprit de solidarité, qui lie autonomie individuelle et autonomie collective sans supprimer la première dans la seconde. À moins qu’on ne veuille, sous le poids de la toute-puissance des marchés financiers, renoncer à la politique de l’égalité et lui substituer une politique de l’identité nationale qui nommerait “république”, non plus le régime de l’égalité des droits et de l’élaboration d’une rationalité partagée, mais le narcissisme collectif d’un sentiment communautaire.
 Ne faudrait-il pas, plutôt qu’un « pompeux catalogue des droits de l’homme » (Marx) – dont on ne sait trop sur quels critères ils ont été choisis –, « une modeste “Magna Carta” susceptible de protéger réellement les seules libertés individuelles et collectives fondamentales » (Michéa) ?
Ne faudrait-il pas, plutôt qu’un « pompeux catalogue des droits de l’homme » (Marx) – dont on ne sait trop sur quels critères ils ont été choisis –, « une modeste “Magna Carta” susceptible de protéger réellement les seules libertés individuelles et collectives fondamentales » (Michéa) ?
Cette formule sonne comme une proposition ultra-libérale qui demanderait qu’on s’en tienne aux seules libertés négatives ou défensives, “modestes” en ce sens qu’elles ne doivent surtout pas se prolonger dans des droits sociaux ou un projet de démocratie radicale !
Les droits de l’homme ne sont « pompeux » que si on les comprend comme un « catalogue » – ce qu’était la « Magna Carta », catalogue de libertés assurant surtout les privilèges de l’aristocratie anglaise. Mais, encore une fois, cette réduction des droits de l’homme à un catalogue en manque la logique propre. Saisis comme le développement de la « proposition de l’égaliberté », ils constituent une idée somme toute moins « pompeuse », et certainement moins exposée à la tentation totalitaire, que l’idée vague du communisme qui irriguait la critique de Marx.
Il ne faudrait d’ailleurs pas mécomprendre le sens de la déclaration de Marx que détourne Michéa. On lit dans Le Capital que la lutte de la classe ouvrière, lorsqu’elle obtient des mesures imposant des limites à l’exploitation, « remplace le pompeux catalogue des “inaliénables droits de l’homme” par la modeste Magna Carta d’une journée de travail limitée par la loi ». Marx n’entendait certainement pas par là qu’il fallait se contenter de tempérer l’exploitation sans y mettre fin, et renoncer au projet d’une auto-organisation démocratique de la société pour s’en tenir à de “modestes” corrections apportées à la violence des rapports de propriété et de production ! Ce qu’il dénonçait, c’était une interprétation des droits de l’homme qui réduisait ceux-ci à une égalité formelle entre des libertés inégalement réelles. Mais cette dénonciation même reconnaissait paradoxalement la force émancipatrice de la loi et du droit, conformément à la pratique du mouvement ouvrier qui a toujours formulé ses revendications en termes de “droits”[xv].
« Il se trouve que la critique marxienne des droits de l’homme est beaucoup plus complexe et contradictoire que ce qu’en a retenu la catastrophique vulgate léniniste. »
Il se trouve que la critique marxienne des droits de l’homme est beaucoup plus complexe et contradictoire que ce qu’en a retenu la catastrophique vulgate léniniste. La phrase “réformiste” de Marx que vous avez citée suffirait d’ailleurs à montrer que nous n’avons aucune raison de tenir le révolutionnarisme autoritaire de Lénine pour plus “légitime” ou plus “marxiste” que la social-démocratie de Kautsky ou de Jaurès. Mais cet entretien est déjà bien trop long pour que nous entrions dans ces méandres. Sans innocenter Marx ni lui imputer directement les ravages totalitaires causés par la simplification léniniste de sa critique des droits de l’homme, je me contenterai de dire qu’entre la modestie de l’action syndicale et la démesure d’une idée aussi indéterminée que celle d’une “démocratie totale” qui aurait magiquement aboli l’État et le marché, la référence maintenue aux droits de l’homme rappelle la nécessité de penser ensemble l’horizon de l’universel, la condition de la pluralité et les médiations de l’institution – sur le triple plan de l’international, du national et du transnational.
Les droits de l’homme sont-ils dépassés ?
C’est le vieux rêve contre-révolutionnaire : en finir avec les droits de l’homme et avec l’exorbitant processus révolutionnaire qu’ils ont déclenché par leur promesse d’égalité impossible à satisfaire. Bonald disait qu’il fallait « se pénétrer de cette vérité philosophique et la plus philosophique des vérités : que la révolution a commencé par la Déclaration des droits de l’homme, et qu’elle ne finira que par la déclaration des droits de Dieu« . Mais cette position avait son propre horizon “révolutionnaire”, proprement apocalyptique, avoué par Maistre dans le dernier entretien des Soirées de Saint-Pétersbourg qui annonce la fusion des nations dans l’imminence d’une Troisième Révélation divine…
La contre-révolution d’aujourd’hui n’a pas la radicalité d’un Bonald ou d’un Maistre. Elle espère plutôt, comme Barnave en 1791 ou François Furet dans les années 1980, « terminer la révolution » en contenant l’essor des droits de l’homme, en les faisant rentrer dans le rang de ces “libertés négatives” qu’ils ont toujours excédées, à tous les sens de ce mot. Et, à voir la popularité de personnages politiques tels que Trump, Abe, Poutine, Erdogan ou Orban, on peut se demander si le futur ne pourrait pas avoir la forme d’une « (mal)sainte alliance entre Schmitt et Hayek », qui compenserait les duretés de l’inégalité par les satisfactions fantasmatiques de la communion nationale. Mais cela même ne prouverait rien contre les droits de l’homme : nous n’en sentirions que plus vivement la force de leur exigence.
Quant à un “dépassement” des droits de l’homme qui viendrait de la parfaite réalisation de leurs demandes, faut-il vraiment expliquer en détail pourquoi nous en sommes très loin ?
Nos Desserts :
Notes :
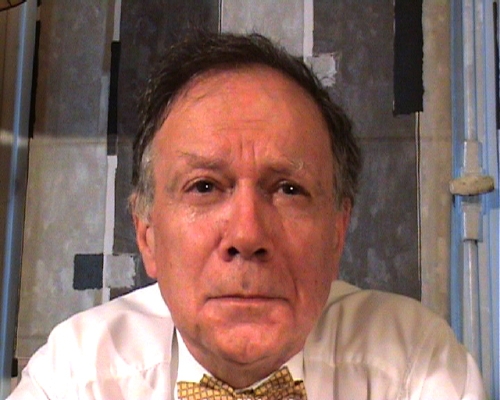
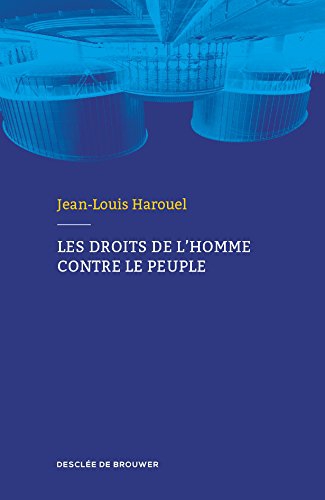 Breizh-info.com : Les Européens semblent totalement désarmés aujourd’hui par leurs gouvernants, face à des populations qui elles, ne sont pas soumises à la tyrannie des droits de l’homme. Est-ce encore réversible ?
Breizh-info.com : Les Européens semblent totalement désarmés aujourd’hui par leurs gouvernants, face à des populations qui elles, ne sont pas soumises à la tyrannie des droits de l’homme. Est-ce encore réversible ?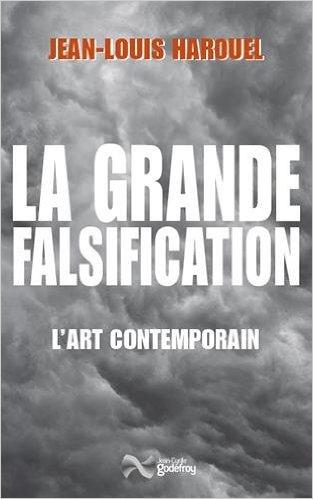 Breizh-info.com : Le principe de non discrimination, érigé en loi en France, patrie des droits de l’homme, n’est il pas lui même la porte ouverte à tous les excès ? Ne discrimine-t-on pas de toute façon naturellement ? Avons nous définitivement tourné le dos aux valeurs transmises sous l’Antiquité, dans une Grèce et une Rome qui justement discriminaient, c’est à dire distinguait leurs citoyens des autres ?
Breizh-info.com : Le principe de non discrimination, érigé en loi en France, patrie des droits de l’homme, n’est il pas lui même la porte ouverte à tous les excès ? Ne discrimine-t-on pas de toute façon naturellement ? Avons nous définitivement tourné le dos aux valeurs transmises sous l’Antiquité, dans une Grèce et une Rome qui justement discriminaient, c’est à dire distinguait leurs citoyens des autres ? Au XIXe siècle, on a beaucoup critiqué l’Église pour son attachement aux régimes monarchiques, sa condamnation de la liberté de conscience, de la souveraineté du peuple, du libéralisme et de théories philosophiques telles que le naturalisme ou le rationalisme. L’Église n’était pas dans son rôle, mais elle ne l’est pas davantage quand le pape prétend aujourd’hui, au nom des droits de l’homme, interdire aux nations européennes tout contrôle des flux migratoires. Le pape se comporte en théocrate quand il dicte aux pays européens un sans-frontiérisme qui les condamne à mort.
Au XIXe siècle, on a beaucoup critiqué l’Église pour son attachement aux régimes monarchiques, sa condamnation de la liberté de conscience, de la souveraineté du peuple, du libéralisme et de théories philosophiques telles que le naturalisme ou le rationalisme. L’Église n’était pas dans son rôle, mais elle ne l’est pas davantage quand le pape prétend aujourd’hui, au nom des droits de l’homme, interdire aux nations européennes tout contrôle des flux migratoires. Le pape se comporte en théocrate quand il dicte aux pays européens un sans-frontiérisme qui les condamne à mort.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
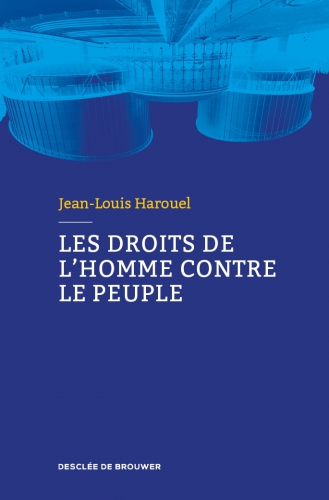 Comme d'habitude
Comme d'habitude
 Jean-Yves Pranchère : L’initiative est venue de Justine Lacroix, qui s’est engagée il y a six ans dans le projet d’une étude des résistances contemporaines aux droits de l’homme ; elle en a exposé les attendus dans deux articles programmatiques,
Jean-Yves Pranchère : L’initiative est venue de Justine Lacroix, qui s’est engagée il y a six ans dans le projet d’une étude des résistances contemporaines aux droits de l’homme ; elle en a exposé les attendus dans deux articles programmatiques, 


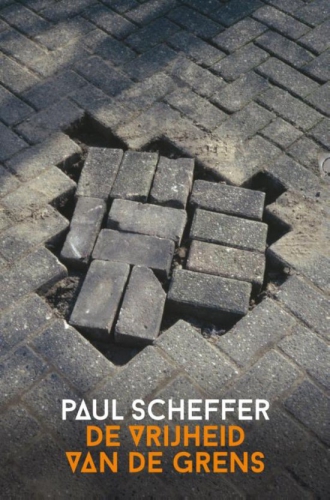 Het vergt moed om op te staan en de collectieve hysterie te nuanceren, zeker als de publicist uit socialistische stal komt. De Nederlander Paul Scheffer heeft bewezen moed en een scherpe pen te combineren. Na zijn bestseller “Het land van aankomst” fileert hij opnieuw de multiculturele nachtmerrie die zich in Europa aftekent.
Het vergt moed om op te staan en de collectieve hysterie te nuanceren, zeker als de publicist uit socialistische stal komt. De Nederlander Paul Scheffer heeft bewezen moed en een scherpe pen te combineren. Na zijn bestseller “Het land van aankomst” fileert hij opnieuw de multiculturele nachtmerrie die zich in Europa aftekent.
 Si un livre est un chemin que l’auteur vous invite à parcourir en sa société, le petit livre de souvenirs que l’historien Jean de Viguerie vient de publier, sous le titre Le passé ne meurt pas, appartient assurément à cette dernière catégorie. La forme en est modeste et paisible ; le ton sans fanfaronnade, précis et posé, même lorsqu’il s’agit d’événements douloureux, et toujours discrètement irrigué d’un humour d’autant plus savoureux qu’il ne se pousse pas du col.
Si un livre est un chemin que l’auteur vous invite à parcourir en sa société, le petit livre de souvenirs que l’historien Jean de Viguerie vient de publier, sous le titre Le passé ne meurt pas, appartient assurément à cette dernière catégorie. La forme en est modeste et paisible ; le ton sans fanfaronnade, précis et posé, même lorsqu’il s’agit d’événements douloureux, et toujours discrètement irrigué d’un humour d’autant plus savoureux qu’il ne se pousse pas du col.