vendredi, 28 novembre 2025
En route vers une union militaire ? - Des milliards pour l’armement et plus encore : l’UE lance un programme pour le lobby de la défense

En route vers une union militaire ?
Des milliards pour l’armement et plus encore: l’UE lance un programme pour le lobby de la défense
Source: https://derstatus.at/globalismus/milliarden-fur-waffen-co...
Notre bel argent de bons contribuables sera consacré à leur armement: Bruxelles lance l'«European Defence Industry Program» (EDIP). Son objectif: que les pays de l’UE développent, achètent et produisent conjointement des armes, des munitions et d’autres équipements militaires. À cet effet, l’UE prévoit de dépenser pas moins de 1,5 milliard d’euros dans les deux prochaines années. À cela s’ajoutent de nouvelles aides financières à Kiev.
Le programme d’armement EDIP joue sur tous les tableaux
Une grande euphorie accompagne la progression du projet, du côté des représentants des familles politiques du système à Bruxelles. Le principal négociateur pour le budget, et ministre danois des Finances d'obédience social-démocrate, Nicolai Wammen, se réjouit de l’augmentation des dépenses militaires de l’UE qui passent à 2,8 milliards d’euros — soit un doublement depuis 2023 — et parle d’un budget «fort et résilient» dans ce domaine. François-Xavier Bellamy, négociateur de l’UE pour l’industrie, la recherche et l’énergie, est également très enthousiaste: «Nous veillons à ce que les pays européens investissent dans des armes qui leur garantissent une autonomie totale d’action.»
Il évoque des « décennies de dépendances dangereuses » qui auraient menacé la «souveraineté de nos démocraties». Le programme EDIP renforce la «base industrielle» et garantit que les armées des pays de l’UE «disposent des moyens pour remplir leur mission». La participation de l’industrie de défense ukrainienne, également, est particulièrement saluée dans la famille politique, comme l’explique Michael Gahler, député de la CDU allemande et négociateur du PPE au comité de la défense de l’UE. Cependant, il regrette que le 1,5 milliard d’euros débloqué par Bruxelles soit encore «bien trop faible» à son goût…

Économie de guerre de l’UE: l’Autriche neutre, elle aussi, finance le projet
La FPÖ pressent déjà le pire en lien avec ces annonces. La députée européenne de la FPÖ, Petra Steger (photo), a déclaré: «L’Union européenne fait un pas colossal vers une union militaire, et le gouvernement autrichien est en première ligne. Ce qui est présenté ici sous le nom de European Defence Industry Programme n’est rien d’autre que le début d’une économie de guerre à l’échelle de l’UE.» À l’avenir, les États membres pourront se faire subventionner jusqu’à 100 % des coûts de leurs projets de défense par l’UE.
Cela n’est pas bon non plus pour la neutralité autrichienne: «Ainsi, nous, en tant que contributeurs nets autrichiens, finançons directement la militarisation d’autres pays. Encore plus de redistribution, encore plus de folie des armements — plus vite, plus grand, plus cher que jamais. C’est la rupture définitive avec un projet qui a commencé comme une union pour la paix.» Que l’Ukraine reçoive en plus 5,9 milliards d’euros de Bruxelles énerve la députée: «L’UE injecte des milliards dans la production militaire ukrainienne — nouvelles usines, licences de production, achats conjoints — et cela dans un pays qui est dans l’actualité depuis des mois à cause de colossaux scandales de corruption.»
Diplomatie plutôt qu’une «folie militariste délirante»
Il ne s’agit «pas seulement de préparer l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, mais aussi de préparer l’adhésion de l’UE à la guerre en Ukraine !» Selon Mme Steger, cela montre une fois de plus: « L’UE n’a aucun intérêt à la paix. Alors que le monde parle de solutions pacifiques possibles, Bruxelles prépare un conflit sur le long terme.» La responsabilité revient maintenant au gouvernement allemand: «Ceux qui participent à cette démarche foulent délibérément aux pieds la neutralité permanente. L’Autriche est progressivement entraînée dans une union militaire. [...] L’Europe a besoin de diplomatie, de paix et de bon sens, pas d’une folie militariste ! »
Dimanche déjà, le secrétaire général de la FPÖ, Michael Schnedlitz, a critiqué la prestation de la ministre des Affaires étrangères, membre du parti libéral NEOS, Beate Meinl-Reisinger, lors de la conférence de presse à la radio autrichienne ORF. Elle y a encore plaidé pour la création d’une armée européenne. Selon la vision de la FPÖ, c’est non: « Si la ministre des Affaires étrangères veut vraiment donner un signal pour la paix en Ukraine, alors elle doit proposer l’Autriche comme lieu pour des négociations sérieuses de paix. La neutralité autrichienne n’est pas un instrument pour ses fantasmes d’armée européenne — elle doit enfin s’engager pour la paix et la diplomatie.» Ses fantasmes ne correspondent pas à l’attitude qu'attendent les citoyens et sont « stupides et dangereux».
Suivez-nous sur Telegram : t.me/DerStatus & sur Twitter/X : @derStatus_at +++
19:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : europe, actualité, affaires européennes, autriche, union europeénne, défense |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 27 novembre 2025
Georg Mayer (FPÖ): «L'UE conduit l'Europe vers une dépendance dangereuse – ce sont nos entreprises locales qui en font les frais»

Georg Mayer (FPÖ): «L'UE conduit l'Europe vers une dépendance dangereuse – ce sont nos entreprises locales qui en font les frais»
Par Georg Mayer
Source: https://www.fpoe.eu/mayer-eu-steuert-europa-in-eine-gefae...
« Avec sa politique industrielle idéologisée, la Commission européenne a conduit l'Europe vers une dépendance extrêmement dangereuse vis-à-vis de la Chine – et tente désormais de masquer les problèmes qu'elle a elle-même causés en maniant à tour de bras des vocables-slogans tels que le « dérisquage ». En réalité, nous assistons à une désindustrialisation provoquée par Bruxelles, explique Georg Mayer, député européen de la FPÖ autrichienne, à l'occasion du débat en session plénière sur les restrictions chinoises à l'exportation.
Mayer souligne que l'UE a imposé pendant des années des exigences climatiques excessives, a posé une interdiction totalement inappropriée des moteurs à combustion et imposé une bureaucratie toujours plus lourde, qui ont considérablement affaibli la base industrielle de l'Europe. "Alors que d'autres régions du monde renforcent leur industrie, l'UE chasse systématiquement notre production hors d'Europe. Et maintenant, on s'étonne que la Chine tire parti de sa position? Cette évolution était prévisible", déclare M. Mayer.
La ligne de conduite de la Commission, qui pourrait conduire l'Europe à une confrontation avec la Chine, est particulièrement dangereuse: «Une escalade du conflit serait suicidaire sur le plan économique. La Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Europe. Ceux qui brandissent des gestes menaçants mettent en danger notre prospérité. » Ce sont surtout les entreprises locales qui en font les frais: « Ce ne sont pas les élites bruxelloises qui paient la facture, mais nos entreprises locales, celles qui garantissent chaque jour des emplois et créent de la valeur ajoutée.
Mayer exige un changement radical de mentalité
« Il faut mettre fin à cette mauvaise orientation idéologique. L'Europe n'a pas besoin de petits jeux géopolitiques, mais, enfin, d'une politique qui renforce notre industrie, assure la sécurité d'approvisionnement et rétablisse la compétitivité. »
Le FPÖ continuera à « s'opposer aux dérives autodestructrices de Bruxelles » et à réclamer une politique industrielle raisonnable qui remette l'Europe sur les rails sur le plan économique.
Georg Mayer
- Membre de la commission des pétitions (PETI);
- Membre suppléant de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE).
18:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : fpö, georg mayer, autriche, europe, union européenne, affaires européennes, désindustrialisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 22 octobre 2025
Petra Steger: «L'interdiction d'importer du gaz russe dans l'UE est un suicide économique!»

Petra Steger: «L'interdiction d'importer du gaz russe dans l'UE est un suicide économique!»
Par Petra Steger
La députée européenne de la FPÖ autrichienne, Petra Steger, critique avec virulence l'interdiction définitive d'importer du gaz naturel russe jusqu'à fin 2027, laquelle doit être votée aujourd'hui par le Conseil des ministres de l'UE: «Une interdiction totale des importations de gaz naturel russe équivaut à un suicide économique. L'UE se dirige ainsi sciemment vers une spirale descendante de désindustrialisation, de hausse rapide du chômage et de perte irréversible de compétitivité internationale. De tels volumes d'importation ne peuvent tout simplement pas être compensés dans un avenir prévisible, et certainement pas à des conditions économiquement viables. Le gaz naturel liquéfié (GNL) est non seulement beaucoup plus cher, mais il pose également d'énormes défis logistiques et écologiques ».
Selon Mme Steger, l'industrie européenne est déjà soumise à une pression énorme: « Les prix de l'énergie, qui sont supérieurs à la moyenne depuis des années, poussent de nombreuses entreprises à délocaliser leur production hors d'Europe. Une nouvelle augmentation des coûts, provoquée par une politique énergétique motivée par des considérations idéologiques, accélérerait considérablement cet exode et détruirait des dizaines de milliers d'emplois».
Dans ce contexte, Mme Steger critique tout aussi vivement le gouvernement fédéral autrichien: «Un gouvernement qui agit dans l'intérêt de sa propre population n'aurait pas dû faire autre chose que d'opposer aujourd'hui un veto clair et net à cette question cruciale. Mais au lieu de s'engager résolument en faveur d'un approvisionnement énergétique sûr et abordable, condition indispensable à la performance économique et à la cohésion sociale, on suit aveuglément, cette fois encore, les directives irréalistes de Bruxelles».
En conclusion, la députée européenne de la FPÖ réclame un changement de cap fondamental dans la politique énergétique et les sanctions européennes: «Il faut revenir à la raison économique, respecter strictement notre neutralité et reconquérir de manière cohérente la souveraineté énergétique nationale. Ceux qui, par obstination idéologique, excluent catégoriquement l'achat de gaz russe bon marché mettent en danger non seulement la base industrielle de l'Europe, mais aussi notre prospérité, notre stabilité sociale et, en fin de compte, la paix intérieure de notre continent».

Petra Steger
Membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE);
Membre suppléante de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE);
Membre suppléante de la commission de la sécurité et de la défense (SEDE).
21:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, autriche, gaz, gaz russe, hydrocarbures |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 septembre 2025
Roman Haider sur les objectifs climatiques de l’UE: “90 % de CO₂ en moins = 100 % d’autodestruction!”

Roman Haider sur les objectifs climatiques de l’UE: “90 % de CO₂ en moins = 100 % d’autodestruction!”
Le report de la décision au Conseil européen doit être saluer
Par Roman Haider
Source: https://www.fpoe.eu/haider-zu-eu-klimazielen-90-prozent-w...
“Réduire de 90 % les émissions de CO₂ signifie en réalité pour les citoyens 100 % de coûts en plus et, de fait, zéro perspective d’avenir meilleur”, avertit le député européen de la FPÖ, Me Roman Haider. Avec le nouvel objectif pour 2040, la Commission européenne pousse délibérément des millions de personnes supplémentaires vers la pauvreté, la dépendance et le chômage.
“Déjà, l’objectif de 55% pour 2030 a fait exploser les prix de l’énergie, ruiné des entreprises et détruit des emplois. Mais cela était encore l’étape la plus facile, les économies dites ‘bon marché’. Si l’objectif de 90% est appliqué, comme proposé par la Commission, alors se chauffer deviendra un luxe, conduire une voiture sera hors de prix et des dizaines de milliers d’emplois partiront en Inde, en Chine et en Turquie”, critique sévèrement Haider.
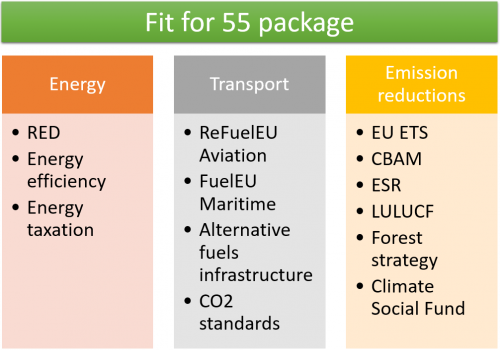
“Le paquet ‘Fit for 55’ est un exemple type de sur-réglementation. L’extension du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) au chauffage et au transport touche chaque citoyen, mais n’apporte aucun progrès mesurable, hormis des recettes supplémentaires pour le ministre des Finances.”
“Il faut bien se chauffer et aller travailler, ce n’est pas un loisir. S’y ajoutent la hausse des coûts pour l’industrie et l’interdiction des moteurs à combustion. Si l’on veut encore intensifier cette voie, vouée à l’échec, c’est tout simplement de la pure folie”, constate Haider.
Les conséquences sont claires: pour atteindre l'objectif de "moins 90% de CO₂", il y aura une avalanche de bureaucratie supplémentaire, des coûts énergétiques encore plus élevés et, avec pour résultat, la perte totale de notre compétitivité et une dépendance irrémédiable envers des pays tiers. “Ce n’est pas une politique climatique, c’est de la planification économique à la soviétique peinte en vert. Nous avons besoin d’innovation et de liberté, pas d’une réglementation de notre vie et de notre économie dans les moindres détails”, conclut Haider.
Alors que l’UE n’est responsable que de 7% des émissions mondiales, la Chine et l’Inde en représentent plus de 40% – sans qu'elles n'aient souscrit à des engagements contraignants. “Nous ruinons nos citoyens et notre économie, pendant que nos concurrents rient et prospèrent. L’UE se légitimait autrefois en nous protégeant à l’extérieur et en offrant plus de libertés à l’intérieur. Mais depuis que la Commission cède à tous les caprices des activistes climatiques, c’est exactement le contraire: non seulement les fondements de notre économie sont en danger, mais la poursuite de cette politique fait également exploser les fondements de l’UE. On ne peut pas longtemps agir contre ses propres intérêts juste pour briller lors des sommets climatiques internationaux”, explique Haider.
“L’Europe a besoin d’innovation et de liberté – pas de paternalisme, d’interdictions et d’économie planifiée depuis Bruxelles. Nous nous battons au Parlement pour un rejet clair de cette trajectoire destructrice et pour une fin du Green Deal dans son ensemble”, conclut Haider.

Qui est Roman Haider?
Porte-parole du groupe FPÖ au sein de la commission des transports (TRAN) | Membre de la commission de l’environnement (ENVI)
19:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fausse écologie, actualité, europe, affaires européennes, roman haider, autriche, fpö, fit for 55, écologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 septembre 2025
Harald Vilimsky: «L'UE dans un état lamentable – Ursula von der Leyen a conduit l'Europe au bord du gouffre»

Harald Vilimsky: «L'UE dans un état lamentable – Ursula von der Leyen a conduit l'Europe au bord du gouffre»
Cette Commission et sa présidente doivent enfin tirer leur révérence et ouvrir la voie à un avenir radieux pour l'Europe et ses grands États.
Par Harald Vilimsky
Source: https://www.fpoe.eu/vilimsky-eu-in-erbaermlichem-zustand-...
« L'état de l'Union européenne n'a jamais été aussi déplorable. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et ses commissaires ont conduit notre continent et ses grands États au bord du gouffre sur les plans économique, culturel et social », a déclaré aujourd'hui Harald Vilimsky, chef de la délégation du FPÖ au Parlement européen, lors du débat sur la situation de l'UE en séance plénière à Strasbourg.
Pendant la pandémie de coronavirus, l'UE a provoqué une vague gigantesque de dettes avec des confinements et des achats de vaccins des plus discutables. Les citoyens ont été privés de leur liberté, les troubles psychologiques et les problèmes de santé ont considérablement augmenté. Selon M. Vilimsky, l'UE bloque encore aujourd'hui toute enquête sérieuse sur ces thématiques.
Dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Union agit comme un fauteur de guerre, a adopté près de 20 paquets de sanctions qui touchent principalement l'Europe elle-même, laquelle se positionne ainsi comme un perdant géopolitique de premier ordre. « La politique menée par l'UE est une honte », a souligné M. Vilimsky.
Sur le plan économique également, l'UE se dirige vers la catastrophe: la politique ratée du Green Deal menace la survie de l'industrie automobile européenne, détruit des centaines de milliers d'emplois et prive de très nombreuses familles de leurs perspectives d'avenir. Dans le même temps, la Commission s'impose comme le contrôleur suprême du numérique, restreint la liberté d'expression et va à l'encontre de tout ce que l'Europe représentait au départ: la paix, la liberté, la sécurité et la prospérité. Au lieu de cela, on assiste à l'émergence néfaste d'un bellicisme, à des crises économiques qui sont auto-infligées, à un terrorisme importé, à de l'antisémitisme et à un climat d'oppression.
« Cette Commission et sa présidente doivent enfin tirer leur révérence et ouvrir ainsi la voie à un avenir meilleur pour l'Europe et ses grands États. Sinon, von der Leyen et ses acolytes entreront dans les livres d'histoire comme les destructeurs de l'Europe. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des personnalités capables de corriger progressivement les graves dérives actuelles. L'Alliance des patriotes est prête à relever ce défi, avec le soutien croissant de la population », a conclu M. Vilimsky.
Qui est Harald Vilimsky?
Chef de délégation FPÖ au Parlement européen | Membre de la commission des affaires étrangères (AFET) | Membre suppléant de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE)
17:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : harald vilimsky, actualité, europe, affaires européennes, autriche, fpö |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 09 septembre 2025
Petra Steger: « Les projets d'Ursula von der Leyen concernant les troupes européennes relèvent du bellicisme et constituent une trahison du projet de paix européen ! »

Petra Steger: « Les projets d'Ursula von der Leyen concernant les troupes européennes relèvent du bellicisme et constituent une trahison du projet de paix européen!»
Par Petra Steger
Source: https://www.fpoe.eu/steger-von-der-leyens-plaene-fuer-eu-...
La députée européenne du FPÖ Petra Steger réagit avec virulence aux récentes déclarations de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon lesquelles il existerait déjà des « projets très précis » concernant l'envoi de troupes européennes en Ukraine.
« Von der Leyen aggrave sans raison et sans discernement une situation déjà explosive », déclare la députée européenne, soulignant qu'il ne semble même pas y avoir de consensus au sein de l'UE sur cette question : « Le ministre allemand de la Défense ne veut pas s'impliquer dans cette affaire, d'autres États membres de l'UE la rejettent également – avec qui von der Leyen s'est-elle mise d'accord à ce sujet ? »
« L'UE a été fondée à l'origine comme un projet de paix – aujourd'hui, von der Leyen en fait une institution instigatrice de guerre ! Chaque nouvelle annonce d'envoi de soldats dans un conflit extrêmement dangereux rapproche l'UE d'une confrontation directe avec la Russie. C'est extrêmement dangereux et cela montre à quel point Bruxelles s'est éloignée des intérêts des citoyens européens », déclare Mme Steger.
Pour la mandataire du FPÖ, la neutralité autrichienne joue un rôle particulièrement important à cet égard : « La neutralité de l'Autriche est inscrite dans notre Constitution.
Quiconque envisage d'envoyer des soldats autrichiens sous quelque prétexte que ce soit dans la guerre en Ukraine commet une trahison envers la Deuxième République. Nous ne devons pas nous laisser manipuler par des intérêts géopolitiques étrangers à l'Europe. Dans cette situation délicate, j'exige de notre gouvernement fédéral qu'il apporte des éclaircissements à Mme von der Leyen et qu'il lui demande de s'abstenir à l'avenir de faire de telles déclarations. »
Au sujet des récentes déclarations du parti au pouvoir NEOS concernant un État européen et une armée européenne, Petra Steger précise : « Le fait que le NEOS caresse l'idée d'un super-État européen et d'une armée européenne, avec les fantasmes de l'OTAN qui vont avec, revient à jouer avec le feu. La ministre des Affaires étrangères et son parti sont en train de devenir un risque pour la sécurité de la République d'Autriche. Il est temps que le président fédéral Van der Bellen agisse enfin et démette Mme Meinl-Reisinger de ses fonctions. »
Pour conclure, Mme Steger précise : « Le FPÖ dit non à toute forme d'union militaire européenne et non aux troupes européennes en Ukraine. L'Autriche ne doit pas prendre part à une folie qui mène notre continent au bord d'une guerre mondiale. »

Qui est Petra Steger?
Membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) | Membre suppléante de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) | Membre suppléante de la commission de la sécurité et de la défense (SEDE)
15:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, petra steger, fpö, autriche, neutralité, neutralité autrichienne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 septembre 2025
Harald Vilimsky: «Un vote de défiance clair contre von der Leyen et les partis qui la soutiennent»

Harald Vilimsky: «Un vote de défiance clair contre von der Leyen et les partis qui la soutiennent»
Selon l'Eurobaromètre, seuls 38 % des Autrichiens ont une image positive de l'UE.
Par Harald Vilimsky
Source: https://www.fpoe.eu/vilimsky-nur-38-der-oesterreicher-hab...
« Le dernier sondage Eurobaromètre montre une fois de plus à quel point la confiance des Autrichiens dans l'Union européenne a chuté », a déclaré aujourd'hui Harald Vilimsky, chef de la délégation de la FPÖ. « Seuls 38 % ont encore une image positive de l'UE, ce qui est un constat d'échec pour la soi-disant « communauté de valeurs » qui sévit à Bruxelles. »
Vilimsky attribue cette situation à une série d'erreurs : « Qu'il s'agisse du bellicisme proclamé au lieu d'une politique de paix, des scandales liés aux vaccins et des accords secrets avec Pfizer, des mesures de censure centralisées sur Internet ou des machinations des ONG écologistes et gauchistes financées par l'UE, tout cela façonne l'image de cette UE sous la houlette d'Ursula von der Leyen. »
Vilimsky souligne également la coresponsabilité du gouvernement fédéral actuel d'Autriche dans ces mauvais résultats et l'attribue à son soutien à la politique actuelle de l'UE menée depuis Bruxelles. « Ce qui est particulièrement perfide, c'est que cette politique est activement soutenue par les partis traditionnels au sein du gouvernement fédéral et leurs satellites au Parlement européen. L'ÖVP, la SPÖ et le parti NEOS se font les complices dociles de l'extension du pouvoir et du programme centralisateur de von der Leyen, et s'opposent aux intérêts de la population autrichienne. »
L'un des problèmes les plus urgents reste la crise migratoire non résolue. « Dix ans après la phrase fatidique d'Angela Merkel, « Nous y arriverons » ("Wir schaffen das!"), il apparaît clairement que non, nous n'y sommes pas arrivés. Le nombre de demandes d'asile reste élevé, les expulsions sont rares et nos systèmes sociaux sont massivement surchargés. Le fait que, précisément en Autriche, la migration et l'asile soient le deuxième sujet le plus important pour les gens après l'inflation en dit long. »
Vilimsky a annoncé que la FPÖ et le groupe parlementaire Patriots continueraient à s'opposer aux dérives au niveau européen : « Nous défendons une Europe de la liberté, de la souveraineté, de la démocratie – et une UE qui sert les citoyens, et non l'élite mondialiste. Nous continuerons à dénoncer le centralisme européen et ceux qui en profitent, et à le combattre sans relâche. » Il souligne que seul un contrepoids fort, apporté par la FPÖ et ses alliés européens, permettra de réussir à mettre en place une politique autodéterminée et proche des citoyens.
Qui est Harald Vilimsky?
Chef de la délégation FPÖ au Parlement européen | Membre de la commission des affaires étrangères (AFET) | Membre suppléant de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE)
20:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, autriche, fpö, harald vilimsky, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 août 2025
Petra Steger: «Le contrôle prévu des chats par l'UE est une attaque générale contre les droits fondamentaux et les libertés de la population européenne!»

Petra Steger: «Le contrôle prévu des chats par l'UE est une attaque générale contre les droits fondamentaux et les libertés de la population européenne!»
Le gouvernement fédéral autrichien est appelé à voter fermement contre les projets de surveillance numérique de Bruxelles au Conseil de l'UE !
Par Petra Steger
Source: https://www.fpoe.eu/steger-geplante-eu-chatkontrolle-ist-generalangriff-auf-grund-und-freiheitsrechte-der-europaeischen-bevoelkerung/
« La Commission européenne et la présidence danoise du Conseil ne lâchent pas prise : l'adoption prévue du règlement CSA au Conseil de l'Union européenne constitue une atteinte sans précédent aux droits fondamentaux et aux libertés des citoyens européens. Sous le couvert de la lutte contre la pédocriminalité, on crée un système qui prévoit essentiellement une surveillance de masse généralisée et l'affaiblissement du chiffrement de bout en bout », dit et met en garde Petra Steger, députée européenne (FPÖ), après que la présidence danoise du Conseil a fait du contrôle des chats l'une de ses priorités.
« La surveillance généralisée des chats privés constitue une violation flagrante des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article 8 de la CEDH. Même le service juridique du Conseil de l'UE met en garde, dans un avis officiel, contre l'affaiblissement du chiffrement de bout en bout, qui constitue une atteinte massive à la vie privée des citoyens et une violation des droits de l'homme. Des défenseurs indépendants de la protection des données et le Parlement européen se sont également clairement prononcés contre les analyses de masse et l'érosion de la sécurité des communications. Seules la Commission von der Leyen et la présidence danoise du Conseil, qui agit désormais sous son égide, font avancer ce projet de surveillance avec toute leur énergie », poursuit Mme Steger.
Il est particulièrement préoccupant que la présidence danoise du Conseil veuille imposer un accord au Conseil dès septembre: « Le gouvernement fédéral autrichien est clairement appelé à voter contre la proposition danoise de contrôle des chats et à ne pas s'engager définitivement dans la voie anticonstitutionnelle de la censure et du contrôle numériques. Il ne faut en aucun cas accepter que les libertés fondamentales des citoyens soient sacrifiées au profit d'un régime de surveillance centralisé à Bruxelles. »
« La FPÖ opposera donc une résistance farouche au Parlement européen comme au niveau national. La population européenne a un droit inaliénable à la vie privée, à la confidentialité des communications et à la protection contre les fantasmes de toute-puissance de l'État. Nous défendrons ces droits fondamentaux par tous les moyens – contre le contrôle des chats, contre la censure et contre la frénésie de surveillance de Bruxelles. Notre engagement est en accord avec la grande protestation citoyenne et les milliers d'e-mails de protestation que nous avons reçus ces dernières semaines », a conclu la députée européenne du FPÖ, Petra Steger.

Petra Steger
Membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) | Membre suppléante de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) | Membre suppléante de la commission de la sécurité et de la défense (SEDE)
19:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : censure, surveillance, petra steger, fpö, autriche, europe, affaires européennes, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 août 2025
«L'œuvre de Merkel – notre perte»: le nouveau livre de Gerald Grosz

«L'œuvre de Merkel – notre perte»: le nouveau livre de Gerald Grosz
Source: https://unzensuriert.at/307306-merkels-werk-unser-untergang-neues-grosz-buch-in-wien-vorgestellt/?pk_campaign=Unzensuriert-Infobrief
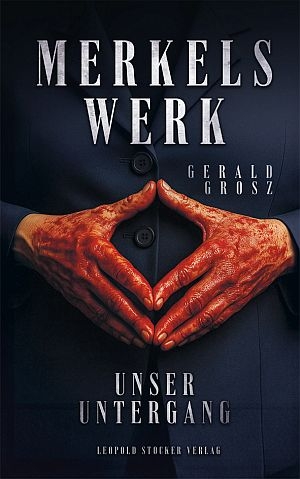 Avec son cinquième livre, « L'œuvre de Merkel – notre perte » (https://www.buecherquelle.at/shop/merkels-werk-unser-untergang/), le commentateur politique Gerald Grosz a touché un point sensible. Avant même sa mise en vente, l'ouvrage figurait déjà dans les listes des meilleures ventes. Le best-seller a été présenté lors d'une conférence de presse à Vienne en présence de personnalités politiques autrichiennes et allemandes.
Avec son cinquième livre, « L'œuvre de Merkel – notre perte » (https://www.buecherquelle.at/shop/merkels-werk-unser-untergang/), le commentateur politique Gerald Grosz a touché un point sensible. Avant même sa mise en vente, l'ouvrage figurait déjà dans les listes des meilleures ventes. Le best-seller a été présenté lors d'une conférence de presse à Vienne en présence de personnalités politiques autrichiennes et allemandes.
Regard sur les conséquences catastrophiques de la migration de masse
Écrit en seulement cinq semaines, Grosz documente les conséquences de la politique migratoire erronée menée depuis 2015, telles que les agressions à l'arme blanche, les viols collectifs et les vols à main armée, qui sont désormais monnaie courante dans les villes allemandes et autrichiennes comme Vienne. Le système social n'est pas destiné à ceux qui en ont besoin, mais sert d'instrument politique à l'élite pour attirer ceux qu'elle veut voir venir, critique Grosz.
Les proches des victimes s'expriment
Dans son livre, il donne également la parole aux proches de victimes bien connues du public. Par exemple, le père d'Ann-Marie (17 ans), qui a été poignardée avec son petit ami de 19 ans en 2023 à Brokstedt (Schleswig-Holstein) dans un train par un Palestinien apatride qui a également blessé cinq autres passagers, dont certains gravement. Melanie Popp, mère de Leonie, une jeune fille de 13 ans assassinée à Vienne, qui avait été agressée sexuellement par quatre jeunes Afghans en juin 2021, puis laissée pour morte devant la maison après avoir ingéré une overdose de drogue, prend également la parole.
D'autres destins des victimes du terrorisme à Vienne en 2020, à Villach en 2025, des morts de l'attentat terroriste de la Breitscheidplatz à Berlin en 2016, des victimes de Solingen ou de celles du massacre au couteau de Mannheim montrent dans ce livre comment l'échec politique flagrant détruit de plus en plus de vies innocentes.
Le travail de mémoire fait toujours défaut
Udo Landbauer, vice-président de la FPÖ de Basse-Autriche, Dominik Nepp, président de la FPÖ de Vienne et vice-maire, et Tino Chrupalla, porte-parole de l'AfD, ont souligné l'importance de l'ouvrage de Grosz. Chrupalla a critiqué le fait qu'aucun travail de mémoire n'ait été effectué à ce jour et que ce soit justement un auteur autrichien qui doive s'en charger. Landbauer a déploré: « 2015 a été une rupture fatidique, au cours de laquelle la souveraineté et l'identité de l'Autriche ont été abandonnées. » Nepp a ajouté que Vienne avait radicalement changé au cours des dix dernières années, car des migrants étrangers de rude culture et peu éduqués avaient été littéralement invités par des prestations sociales généreuses, et que les conséquences catastrophiques se faisaient sentir partout: agressions au couteau, vols à main armée, bandes de jeunes et violence collective.
Les faux conservateurs continuent d'échouer
Pour Chrupalla, Grosz, Landbauer et Nepp, une chose est claire : les soi-disant partis conservateurs (Grosz : « Avant les élections, ils clignotent pour virer à droite, après les élections, ils tournent à gauche ») ne font que simuler une ligne dure en matière d'asile, alors que la réalité montre que la politique migratoire a lamentablement échoué. Un changement de cap est nécessaire, soutenu par des partis tels que la FPÖ ou l'AfD et par des auteurs courageux comme Grosz, qui lancent le débat public.
13:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : migrations, allemagne, autriche, gerald grosz, livre, europe, affaires européennes, angela merkel, politiques migratoires |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 août 2025
Migration massive: l'Autriche interdit le mariage entre cousins

Migration massive: l'Autriche interdit le mariage entre cousins
Source: https://report24.news/massenmigration-oesterreich-verbietet-ehe-zwischen-cousin-und-cousine/
Depuis le vendredi 1er août 2025, il est officiellement interdit en Autriche de se marier avec son cousin ou sa cousine. Cette nouvelle loi est une réaction aux pratiques matrimoniales qui ont fait leur apparition dans le pays avec l'immigration massive, notamment les mariages d'enfants et les mariages entre parents, courants dans le monde musulman. Cependant, les relations sexuelles entre cousins restent autorisées par la loi...
En Autriche, les cousins ne peuvent plus se marier.
Le fait que le gouvernement fédéral estime cette interdiction nécessaire en dit long : les mariages entre parents ne sont bien sûr pas un phénomène majoritaire en Autriche. On admet toutefois que ces unions sont courantes dans les communautés immigrées. Donc cette loi est, en fait, un aveu en matière de politique d'intégration. Selon le ministère de la Famille, six mariages sur dix sont conclus entre parents dans « certains » pays musulmans.
« Nous voulons délibérément éviter de telles situations en Autriche », a déclaré la ministre de l'Intégration, Claudia Plakolm (ÖVP). Pourquoi cela est-il devenu nécessaire ?
Les registres d'état civil (via les actes de naissance) sont chargés du contrôle. Toute infraction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende. Il reste bien sûr à voir si des poursuites seront effectivement engagées.
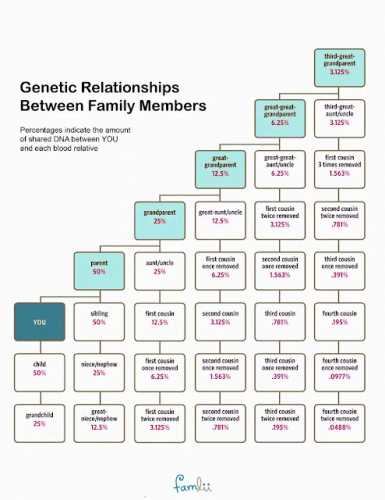
Selon la ministre de l'Intégration, les mariages forcés et les mariages d'enfants constituent une forme de « violence liée à l'honneur et au genre » et constituent également une violation grave des droits de l'homme. Dans le monde, une fille sur cinq de moins de 18 ans serait concernée par un tel mariage – au total, environ 650 millions de femmes auraient été mariées alors qu'elles étaient encore enfants. Tout cela n'est pas nouveau pour les citoyens autrichiens, mais ils doivent bien sûr se garder de critiquer la « culture » des immigrés.
Le nouvel article rend non seulement impossible le mariage des enfants (de moins de 18 ans), mais interdit également le mariage entre parents jusqu'au quatrième degré collatéral, afin d'empêcher par exemple les mariages entre cousins ou entre neveux et nièces, oncles et tantes. Ce qui a été conclu à l'étranger n'est plus reconnu dans la république alpine. Mais un détail piquant subsiste : les relations sexuelles entre proches parents restent autorisées.
Cela soulève des questions. Si ces mariages sont si problématiques sur le plan juridique, social et sanitaire, pourquoi le lit reste-t-il tabou ? Le ministère de la Justice déclare : on a envisagé d'étendre la loi sur l'inceste, mais on est arrivé à la conclusion qu'une interdiction pénale n'avait « guère de sens ». Ah, bon, très bien.
Les enfants issus de relations consanguines présentent un risque considérablement accru de maladies héréditaires, de malformations et de handicaps mentaux. Ce sont avant tout les enfants qui en souffrent, mais aussi la société, qui doit supporter les coûts médicaux.
15:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, autriche, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 août 2025
Comment l'Europe se nuit à elle-même avec les sanctions contre la Russie - Entretien avec Johann Gudenus

Comment l'Europe se nuit à elle-même avec les sanctions contre la Russie
Entretien avec Johann Gudenus
Propos recueillis par Patrick Poppel
Source: https://www.unser-mitteleuropa.com/173397
L'ancien vice-bourgmestre de Vienne et député au Conseil national autrichien Johann Gudenus a pris position quant aux répercussions des sanctions contre la Russie sur l'économie européenne et sur l'évolution économique mondiale en général.
L'interview de M. Gudenus, qui a régulièrement suivi des cours d'été à l'université Lomonossov de Moscou pendant ses études, a été réalisée par Patrick Poppel, expert au Centre d'études géostratégiques de Belgrade.
Question : Quel a été l'impact des sanctions contre la Russie sur l'économie européenne ?
Gudenus : Les sanctions ont causé des dommages considérables, en particulier à l'Europe. Selon l'Institut pour l'économie mondiale de Kiel, les pays de l'UE ont perdu environ 100 milliards d'euros rien qu'en 2023 en raison de la baisse des exportations et de l'augmentation des coûts. L'industrie, la construction mécanique et le secteur de l'énergie sont particulièrement touchés. Alors que la Russie a réorienté ses exportations, les entreprises européennes ont dû faire face à une baisse des commandes et à une délocalisation de leur production vers des pays hors de l'UE.
Question : Dans quels domaines les conséquences de ces sanctions sont-elles les plus perceptibles pour l'Europe ?
Gudenus : Le secteur de l'énergie est le plus durement touché. Les prix du gaz et de l'électricité ont augmenté à plusieurs reprises en Europe: en Allemagne, par exemple, le coût d'un mégawattheure d'électricité est passé à plus de 500 euros en 2022, alors qu'il était d'environ 60 euros avant la crise. Cela a fortement augmenté les coûts de production et entraîné une fuite des investissements. Le plus grand groupe chimique BASF a annoncé le transfert d'une partie de sa production en Chine. La population souffre également de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat.


Question : Avant les sanctions, la Russie était l'un des plus gros acheteurs de technologies, de machines-outils et de voitures en Europe. La Chine a-t-elle désormais pris la place des constructeurs automobiles allemands ?
Gudenus : Exactement. En 2021, l'Allemagne a exporté pour plus de 4,5 milliards d'euros de voitures vers la Russie. En 2023, ce chiffre est tombé à moins de 300 millions d'euros. Dans le même temps, les marques chinoises BYD, Chery et Haval se sont conquis la part du lion sur le marché russe. Aujourd'hui, plus de 70% de toutes les voitures neuves en Russie sont produites en Chine. C'est un coup dur et direct pour l'industrie automobile allemande.
Question : Pensez-vous que les sanctions anti-russes sont avant tout un coup dur pour les constructeurs européens et un renforcement de l'économie chinoise ?
Gudenus : Oui, c'est l'un des résultats les plus importants et les plus paradoxaux. Les sanctions n'ont pas brisé la Russie, mais ont affaibli l'Europe elle-même. La Chine est sortie gagnante: ses exportations vers la Russie ont augmenté de 46% en 2023, tandis que les exportations européennes se sont effondrées. L'Europe s'isole économiquement, tandis que la Chine étend constamment son influence et conquiert des marchés que les Européens ont abandonnés pour des raisons politiques.
15:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : johann gudenus, autriche, europe, entretiens, affaires européennes, sanctions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 août 2025
Portefeuille numérique de la Commission européenne: vers une transparence totale des citoyens européens ?

Portefeuille numérique de la Commission européenne: vers une transparence totale des citoyens européens ?
Source: https://unzensuriert.at/305919-digitale-brieftasche-der-e...
La Commission européenne prévoit de mettre à disposition de tous les citoyens européens un portefeuille numérique d'ici 2026. Celui-ci doit garantir des moyens de paiement sécurisés et la conservation sûre de documents au sein de l'Union européenne.
Selon la Commission européenne, l'utilisation du portefeuille numérique ne sera pas obligatoire pour le moment. Cependant, les appels de plus en plus nombreux en faveur d'une obligation d'identification pour accéder aux réseaux sociaux ou d'une restriction d'âge pour ceux-ci font craindre une introduction détournée de cette mesure.
Une porte ouverte à la censure
Le portefeuille numérique pour les cartes d'identité et les cartes de paiement offre aux eurocrates de nombreuses possibilités de surveillance et de censure. Les sources d'information alternatives qui présentent un point de vue différent sur des questions importantes telles que les vaccins à ARNm, le changement climatique et la guerre en Ukraine sont depuis longtemps une épine dans le pied de la Commission européenne.
La possibilité de lier obligatoirement le portefeuille numérique à l'accès à Internet ou à la création de comptes sur les réseaux sociaux constitue une menace pour la liberté d'expression. L'épée de Damoclès que représente actuellement la « haine en ligne », qui pèse sur la liberté d'expression anonyme sur Internet, devient ainsi un instrument de censure direct.

La tactique du salami pour rendre les citoyens européens transparents
Nous prenons une décision, nous la mettons sur la table et nous attendons de voir ce qui se passe. S'il n'y a pas de tollé général ni de révolte, parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce qui a été décidé, alors nous continuons, pas à pas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible.
La citation ci-dessus de l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, tirée du magazine Der Spiegel, explique certains des dysfonctionnements causés par Bruxelles. Parmi ceux-ci figurent l'échec de la politique migratoire, la « folie du coronavirus » et maintenant la transformation insidieuse de tous les citoyens de l'UE en personnes transparentes grâce à l'introduction de l'euro numérique et d'un portefeuille numérique.
La Commission européenne parle de « volontariat »
Pour l'instant, la Commission européenne parle de volontariat. Mais comme nous l'avons appris pendant la crise du coronavirus, le volontariat ne vaut que tant qu'une minorité en fait usage. Cependant, si moins de 30% des citoyens européens n'ont pas de carte d'identité numérique ou de carte de paiement numérique, ils finiront par céder à la pression sociale ou aux lois de la majorité. De plus, il n'y a qu'un pas pour la Commission européenne à franchir pour rendre ces outils numériques indispensables à l'accès aux réseaux sociaux.

La résistance, comme pendant la pandémie de coronavirus, doit être réprimée
Les lois et mesures de censure actuelles ont rendu très difficile pour le gouvernement fédéral noir-vert en Autriche (= démocrates-chrétiens et écologistes) de réprimer ou d'ignorer les protestations contre les mesures liées au coronavirus. Toutefois, si l'accès aux réseaux sociaux était soumis à une obligation d'identification, il serait alors facile de censurer les opinions qui s'écartent, par exemple, de celles de la chaîne officielle ORF et de punir les « criminels de la pensée » pour diffusion de fausses informations.
Si cela avait déjà été le cas à l'époque du coronavirus, beaucoup moins de personnes se seraient probablement informées sur les effets secondaires possibles d'un vaccin à ARNm ou sur la nocivité des mesures anti-coronavirus pour les enfants et les adolescents. Nous pouvons supposer que la résistance à l'obligation vaccinale aurait été moindre et que le gouvernement fédéral noir-vert aurait mis en place l'obligation vaccinale en 2022.
15:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, autriche, affaires européennes, portefeuille numérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 juillet 2025
La députée européenne de la FPÖ Petra Steger sur la criminalisation des forces patriotiques par «la justice devenue arme politique»

La députée européenne de la FPÖ Petra Steger sur la criminalisation des forces patriotiques par «la justice devenue arme politique»
Source: https://www.unser-mitteleuropa.com/170839
Dans un communiqué de presse, la députée européenne de la FPÖ, Petra Steger, dénonce vivement la criminalisation des forces politiques dans l’UE par « l’instrumentalisation de la justice devenue arme politique ».
La nouvelle accusation portée contre l’ancien Premier ministre tchèque Andrej Babiš (photo) n’est pas un cas isolé selon la députée européenne Petra Steger (FPÖ), mais fait partie d’une tendance européenne bien plus large. « Dans de plus en plus d’États membres de l’UE, nous observons le même mécanisme alarmant. Ceux qui s’opposent à l’établissement bruxellois, qui pensent et agissent en patriotes, deviennent la cible de la justice. En Hongrie, en Pologne, en Roumanie ou en Italie – partout où des forces de droite et conservatrices gagnent des majorités, des adversaires politiques cherchent à utiliser les tribunaux pour réaliser ce qu’ils n’ont pas pu obtenir aux urnes », avertit Petra Steger.
L’affaire Babiš est exemplaire d’un développement où les principes de l’État de droit sont de plus en plus sacrifiés à des intérêts partisans: « Le fait que, juste avant des élections importantes, des enquêtes soient lancées ou que des procès soient rouverts, suscite des doutes légitimes sur l’indépendance de nombreux systèmes judiciaires – même si cela est régulièrement nié par les institutions de l’UE ».
La députée FPÖ voit dans cette stratégie une expression d’une peur profonde de l’établissement face au changement démocratique: « Les électeurs ont depuis longtemps compris que les partis traditionnels européens ne défendent plus leurs intérêts. La classe politique réagit à cela par la répression plutôt que par l’autocritique. Mais le temps de l’ingérence est révolu – l’Europe devient patriotique ! ».
Enfin, Petra Steger exige une transparence totale quant à l’influence politique qui s'exerce sur les enquêtes et jugements judiciaires: « Si l’UE veut vraiment défendre l’État de droit, elle doit aussi veiller à ce que les tribunaux ne deviennent pas les complices d’une élite en déroute. La justice ne doit pas devenir une arme contre l’opposition ! ».
21:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, petra steger, autriche, europe, affaires européennes, fpö, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 juin 2025
La députée européenne du FPÖ Petra Steger: « Les discussions à huis clos entre l'UE et les grandes entreprises sont un scandale démocratique ! »

La députée européenne du FPÖ Petra Steger: « Les discussions à huis clos entre l'UE et les grandes entreprises sont un scandale démocratique ! »
Source: https://www.unser-mitteleuropa.com/169501
La députée européenne du FPÖ Petra Steger a réagi avec virulence lors de la réunion de la commission de la défense SEDE qui s'est tenue le 3 juin, au cours de laquelle une rencontre avec Brad Smith, vice-président de Microsoft, a eu lieu à huis clos et sans la participation de la majorité des députés.
« Le fait que la commission de la défense de l'UE participe à une réunion secrète et opaque avec un haut représentant d'une entreprise technologique américaine, tout en excluant les députés élus et donc l'opinion publique européenne, est un scandale démocratique sans précédent ! De telles discussions en coulisses sapent la confiance dans les institutions de l'UE », a déclaré Mme Petra Steger.
Les voix critiques sont « exclues »
Selon Petra Steger, le fait que seuls les coordinateurs des groupes politiques aient été invités montre une tendance croissante à éliminer le contrôle parlementaire: « Il s'agit ici manifestement d'une tentative délibérée d'écarter les voix critiques, en particulier lorsqu'il s'agit de questions sensibles liées à la cybersécurité et à l'influence de puissantes entreprises sur notre infrastructure de sécurité. Cela n'a plus rien à voir avec la transparence démocratique. »
Petra Steger, elle-même membre suppléante de la commission SEDE, met également en garde contre l'influence croissante des entreprises transnationales sur les décisions de politique de sécurité dans l'UE : « Si des géants technologiques multinationaux tels que Microsoft sont autorisés à discuter de questions militaires avec des instances européennes à huis clos, sans obligation de rendre des comptes au public, cela constitue un pas dangereux vers une politique pro-technocratique occulte. Il faut une transparence totale et un contrôle parlementaire, pas des accords élitistes conclus en coulisses. »
En conclusion, Petra Steger demande la fin de cette pratique antidémocratique et un retour aux principes fondamentaux du parlementarisme: «L'UE doit se décider: veut-elle une Europe des citoyens ou une Europe des entreprises? Au FPÖ, nous sommes clairement en faveur d'une transparence totale, d'une participation démocratique et de la défense de la souveraineté nationale contre le lobbying des entreprises. »
12:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : petra steger, actualité, union européenne, parlement européen, affaires européennes, europe, fpö, autriche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 03 mars 2025
Autriche: pas de chancellerie pour le peuple!

Autriche: pas de chancellerie pour le peuple!
par Georges Feltin-Tracol
Le 12 février dernier, les conservateurs de l’ÖVP (Parti populaire autrichien) rompaient les discussions avec les nationaux-populistes du FPÖ au terme de trente-quatre jours de pourparlers intenses. Sept mois après les élections législatives du 29 septembre 2024, Vienne n’a toujours pas de nouveau gouvernement. Pis, pour la seconde fois de sa carrière, le conservateur covidiste acharné Alexander Schallenberg est chancelier fédéral par intérim depuis le 10 janvier dernier.
Officiellement, le désaccord à l’origine de la rupture porte sur l’identité politique des titulaires aux ministères de l’Intérieur, de l’Économie, des Finances, des Affaires étrangères et de l’Agriculture. Bien que partenaires mineurs, les conservateurs exigent ces postes et réclament en plus la direction des services de renseignements. Deux demandes que n’acceptent pas les nationaux-populistes, grands vainqueurs au Conseil national avec 28,85 % des suffrages exprimés. En fait, à l’approche des législatives en Allemagne du 23 février, les conservateurs autrichiens ont obtempéré aux injonctions comminatoires de la droite molle allemande.
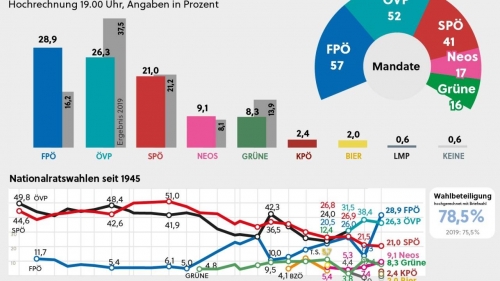
Historiquement, la démocratie chrétienne demeure étrangère à la vie politique autrichienne. L’équivalent autrichien de la CDU (Union chrétienne démocrate) n’existe pas. La matrice de la droite autrichienne est conservatrice avec une forte tradition du christianisme social. L’ÖVP compte de nombreuses affinités avec son homologue bavarois, la CSU (Union chrétienne sociale), allié et faire-valoir de la CDU auprès des électeurs souvent trompés et spoliés. Les dirigeants de la CSU, dont son président, par ailleurs ministre-président de l’État libre de Bavière, Markus Söder, ont estimé inimaginable d’assister à la formation d’un gouvernement FPÖ – ÖVP sous la conduite du FPÖ Herbert Kickl. Un tel gouvernement aurait eu un effet politique considérable sur l’opinion publique allemande.

Ce n’est pas la première fois que les Allemands s’occupent des affaires intérieures de l’Autriche. En mai 2019, la coalition gouvernementale entre l’ÖVP et le FPÖ explose à la suite de l’« Ibizagate ». Une vidéo aux origines suspectes montre en 2017 le futur vice-chancelier et chef alors du FPÖ, Heinz-Christian Strache (photo), sur l’île espagnole d’Ibiza se faire piéger par une femme qui se présente en nièce d’un supposé oligarque russe afin de financer en douce le parti et d’acheter un journal assez connu, la Kronen Zeitung, en échange de l’obtention de marchés publics. La diffusion de ces images douteuses permet au jeune chancelier Sebastian Kurz d’écarter le FPÖ du pouvoir et de s’allier ensuite aux Verts. Le soi-disant scandale est une opération des services secrets allemands. L’extrême-centriste Angela Merkel, l’une des pires femmes de l’histoire, cherchait à briser cette alliance par tous les moyens.

La situation politique en Autriche est pour l’heure bloquée. Le FPÖ fait déjà campagne pour de nouvelles législatives bien que la présidence du Conseil national revienne à l’un de ses membres, Walter Rosenkranz (photo). Cet échec ravit l’actuel président de la République fédérale d’Autriche, le Vert Alexander Van der Bellen. Ce dernier n’a jamais caché son mépris pour la FPÖ, ses responsables, ses cadres et ses électeurs.
Dès le 3 octobre dernier, le chef de l’État autrichien manœuvre afin d’empêcher Herbert Kickl, ministre fédéral de l’Intérieur de 2017 à 2019, de constituer une majorité gouvernementale stable et solide. Alexander Van der Bellen offre au chancelier sortant, le conservateur Karl Nehammer, la mission de nouer un accord qui maintiendrait dans l’opposition le FPÖ. Karl Nehammer commence des négociations avec la SPÖ (les sociaux-démocrates) et NEOS. Fondé vers 2012, NEOS - La nouvelle Autriche - Forum libéral est une formation libérale-progressiste pro-euro-atlantiste qui siège aux côtés des macronistes. Or, le 6 janvier 2025, les tractations butent sur des questions budgétaires liées à la réforme probable des retraites. Contrarié par cette mésentente soudaine, Alexander Van der Bellen confie alors de mauvaise grâce à Herbert Kickl le mandat de constituer un gouvernement. En vain !
Au cours de la campagne électorale de septembre 2024, Herbert Kickl qui se moque volontiers du concept défaitiste de dédiabolisation, s’est présenté auprès de ses compatriotes en futur « chancelier du peuple ». Cette simple allusion à la légitimité populaire de la fonction lui a valu de la part des médiacrates et de ses ennemis politiques des tombereaux d’accusations fallacieuses et fielleuses tant il est vrai que les récents chanceliers sont plutôt des « larbins de l’hyper-classe occidentale »…
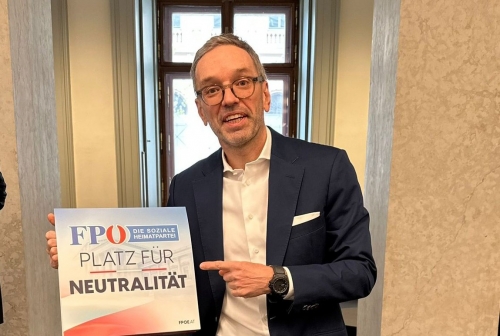
Outre la question lancinante de l’immigration de peuplement, le FPÖ défend avec ardeur et constance la neutralité absolue de l’Autriche en dépit de son appartenance à l’Union dite européenne. Il refuse toute adhésion de la Turquie dans l’ensemble gérontocratique continental et exige, avec une belle régularité, la constitutionnalisation de l’usage des espèces monétaires dans la vie quotidienne. Il tient ainsi à répliquer par avance aux délires bureaucratiques du fumeux euro numérique.
Avec les Hongrois du Fidesz de Viktor Orban et les Tchèques d’ANO d’Andrej Babiš, la FPÖ est à l’origine des Patriotes pour l’Europe, le groupe qui, avec 86 membres, est le troisième au pseudo-parlement de Bruxelles – Strasbourg. Il aurait toutefois pu suivre l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) au sein du groupe Europe des nations souveraines. Cependant, la tonalité libérale – libertaire – libertarienne de la branche occidentale de l’AfD l’irrite en partie.


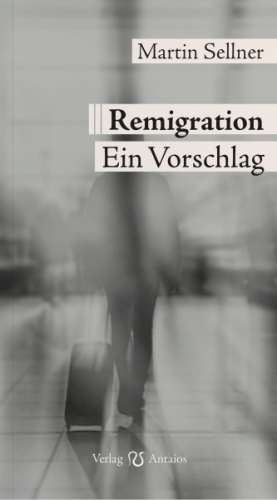
Bien des cadres du FPÖ proviennent des confréries étudiantes non mixtes qui pratiquent encore la Mensur, le duel au sabre, d’où une proximité certaine avec l’élu de Thuringe Björn Höcke, chef de file de l’aile identitaire, régulièrement persécuté par une « injustice » allemande. À la fin du mois de janvier 2025, un adhérent de la FPÖ aurait par exemple financé pour deux millions d’euros la fabrication d’affiches en faveur de l’AfD. Figure bourgeoise par excellence, Alice Weidel, ancienne banquière chez Goldman Sachs, s’est référé pendant les réunions électorales à la « remigration ». C’est aussi le titre d’un essai paru l’an dernier (Remigration. Ein Vorschlag, soit « Remigration. Une suggestion ») de l’identitaire autrichien Martin Sellner, proche de la FPÖ, lui aussi en proie à d’ignobles campagnes médiatico-judiciaires incessantes.
Une alliance tripartite « Feu tricolore à l’autrichienne » entre l’ÖVP, la SPÖ et les Verts est pour l’instant impossible à réaliser. Une entente entre l’ÖVP et la SPÖ est plus plausible, mais elle ne serait majoritaire que d’un seul siège (92 sur 183). Il est donc envisageable que l’Autriche connaisse à son tour des législatives anticipées dans les prochains mois.
GF-T
PS : Ce 27 février, les conservateurs de l’ÖVP et les sociaux-démocrates de la SPÖ ont conclu un accord de gouvernement avec les centristes libéraux de NEOS. L’Autriche aura sous peu un gouvernement tripartite.
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 145, mise en ligne le 25 février 2025 sur Radio Méridien Zéro.
13:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, autriche, europe centrale, europe danubienne, affaires européennes, politique, fpö, herbert kickl |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 novembre 2024
Petra Steger (FPÖ): «Les politiciens de l’UE entraînent l’Europe dans la guerre!»

Petra Steger (FPÖ): «Les politiciens de l’UE entraînent l’Europe dans la guerre!»
Source: https://unser-mitteleuropa.com/152705
Lors d’un discours incisif au Parlement européen, Petra Steger, députée européenne de la FPÖ (Autriche), a accusé les dirigeants de l’Union européenne de comportement irresponsable et de bellicisme. Elle a vivement critiqué la politique actuelle de l’UE envers l’Ukraine et a directement interpellé les responsables, notamment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères Josep Borrell et la présidente du Parlement européen Roberta Metsola.
Une critique acerbe de la politique d’escalade et de l’irresponsabilité des dirigeants de l’UE
Petra Steger a déclaré :
« Avez-vous perdu la raison ? Si vous continuez ainsi, vous conduisez l’Europe droit à la guerre ! ».
Elle a particulièrement dénoncé les projets de livraison de missiles allemands Taurus et d’autres armes à longue portée à l’Ukraine:
« Jusqu’où ira votre prétendue solidarité inconditionnelle ? Est-ce cela le projet de paix revendiqué par l’Union européenne ? Accepterez-vous enfin de négocier la paix seulement lorsque les premières bombes tomberont sur l’Union européenne ? »
Selon Petra Steger, l’UE serait désormais dirigée par des moralistes déconnectés de la réalité, incapables de comprendre l’ampleur de leurs décisions.
Elle a accusé les dirigeants européens de jouer un dangereux jeu d’escalade, guidé par une idéologie, au lieu de privilégier la diplomatie et les négociations de paix.
« Depuis le début de cette guerre abominable, il n’y a eu aucune initiative de paix sérieuse de la part de l’UE. À la place, Von der Leyen et ses alliés n’ont cessé d’alimenter la spirale de l’escalade avec des exigences toujours plus extrêmes et des livraisons d’armes », a affirmé Petra Steger.
L’Europe, grande perdante économique
Petra Steger a souligné que l’Europe payait déjà un lourd tribut économique:
« Pendant que des bombes tombent en Ukraine, les caisses américaines se remplissent. L’industrie de l’armement américaine engrange des milliards de profits, tandis que nos industries sont au bord de la faillite et que les citoyens souffrent de la flambée des prix de l’énergie ».
Elle a dénoncé la perte de lien avec la réalité des élites européennes, qui auraient conduit le continent dans une impasse stratégique.
Un appel à la raison
Petra Steger a exhorté les responsables de l’UE à adopter une approche plus raisonnable :
« Nous, les Freiheitlichen du FPÖ, demandons une politique européenne de paix indépendante, axée sur le dialogue et les négociations, plutôt que sur les livraisons d’armes. Les citoyens européens ne méritent pas des fauteurs de guerre idéologiques à leur tête, mais des dirigeants responsables, qui placent les intérêts économiques et la sécurité de nos citoyens au premier plan – et mettent ainsi fin aux souffrances indescriptibles du peuple ukrainien », a-t-elle conclu.
16:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ukraine, europe, autriche, affaires européennes, petra steger, fpÖ, parlement européen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 22 novembre 2024
Leo von Hohenberg, arrière-petit-fils de l'archiduc François-Ferdinand, démasque la guerre comme "modèle commercial"

Le Prince Leo von Hohenberg (à droite), en conversation avec Florian Machl, animateur principal du site Report24 (Autriche).
Leo von Hohenberg, arrière-petit-fils de l'archiduc François-Ferdinand, démasque la guerre comme "modèle commercial"
Source: https://report24.news/leo-hohenberg-urenkel-von-erzherzog...
La famille Hohenberg, de haute noblesse, est indissociable de l'histoire de l'Autriche. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand a déclenché la Première Guerre mondiale. Pour Leo v. Hohenberg, la guerre n'est pas une solution viable pour régler les conflits dans ce monde - et il constate : « Ce que beaucoup de gens ne prennent pas en considération, c'est qu'il n'y a guère d'autre possibilité de faire autant d'argent, et aussi rapidement, que lors d'une guerre ». Lui-même s'est récemment engagé en faveur de la paix et de la responsabilité individuelle de tous les êtres humains.
Le rédacteur en chef de Report24, Florian Machl, a eu l'occasion de s'entretenir personnellement avec Leo von Hohenberg après son discours historique (Report24 en a rendu compte: https://report24.news/leo-hohenberg-historische-rede-fuer-frieden-werteerhalt-und-eigenverantwortung/). En tant que journaliste critique, Machl n'a pas voulu se contenter d'entendre des généralités, mais a remis en question la position de cet entrepreneur à succès sur l'adhésion à l'OTAN, la guerre en Ukraine et d'autres conflits. Dans son discours, Hohenberg est souvent revenu sur la responsabilité personnelle - aussi bien pour s'informer et se former que pour assumer ses opinions et les transmettre. L'arrière-petit-fils de l'archiduc François-Ferdinand a également véhiculé cette attitude dans cette courte interview.
La guerre, selon Leo von Hohenberg, est une entreprise totalement inefficace :
"Et ce à quoi beaucoup de gens ne pensent pas, c'est qu'il n'y a guère de possibilité de faire autant d'argent aussi rapidement que lors d'une guerre. Il y a là de très grandes organisations, très puissantes, qui ont tout intérêt à augmenter leur valeur actionnariale. Je crois que Truman l'avait déjà dit, le complexe militaro-industriel a ici une très grande influence sur la politique. Et je pense qu'au moins la prolongation des guerres est dans l'intérêt de très nombreuses personnes, qui font tout simplement beaucoup d'argent dans ce contexte. J'ai été particulièrement choqué ces dernières années de voir avec quelle rapidité la société était prête à diaboliser complètement un peuple entier, un pays entier. Et que le simple fait de s'asseoir à la table des négociations semble être considéré, désormais, comme un acte condamnable. C'est triste. Ici, on n'a manifestement pas tiré les leçons de l'histoire ou on ne veut pas les tirer".
Il souligne l'importance de la propagande de guerre - qui n'est évidemment pas une oeuvre utile. Des initiatives politiques ou journalistiques, des sites, qui avaient été pacifistes par le passé s'expriment aujourd'hui de manière particulièrement euphorique en faveur de la guerre.
Selon Hohenberg, la neutralité, au sens de « se tenir à l'écart », n'est en aucun cas de la lâcheté, mais de la ruse.
"Si je ne veux pas impliquer mon peuple dans une guerre qui a peut-être été déclenchée par d'autres personnes, non issues mon peuple, et que je suis ensuite obligé d'entrer en guerre par le biais d'un quelconque contrat, alors ce n'est tout simplement pas une posture très intelligente. La neutralité est la variante la plus intelligente, à mon avis. Et ce qui est bien sûr beaucoup plus important, c'est de veiller à ce que nous puissions également défendre l'Autriche. Et ne pas s'accrocher, en matière de défense, à des systèmes dirigés ou du moins déterminés de l'extérieur".
Hohenberg évoque le financement comme moyen de mettre fin aux guerres. Si les Etats-Unis, par exemple, coupaient les vivres, la paix serait tout à fait envisageable en Ukraine et au Moyen-Orient.
Report24 a rapporté, il y a quelque temps, les déclarations de l'héritier théorique du trône d'Autriche, Karl v. Habsbourg, qui s'est à plusieurs reprises rangé de manière partisane du côté de l'Ukraine et qui fait en principe la promotion de l'OTAN et de la guerre. Leo von Hohenberg, son cousin au second degré, défend apparemment un autre point de vue.
A lire également : "Petit-fils de l'empereur Charles Habsbourg : depuis 2022, une voix forte en faveur de l'OTAN et contre la paix en Ukraine": (https://report24.news/kaiser-enkel-karl-habsburg-seit-202...)
14:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, leo von hohenberg, autriche, neutralité, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Norbert van Handel: La Russie a toujours été un partenaire respectueux des règles

Norbert van Handel:
La Russie a toujours été un partenaire respectueux des règles
Source: https://unser-mitteleuropa.com/121207
La neutralité comme facteur économique
En détruisant presque entièrement le statut de neutralité, le gouvernement autrichien a également pesé de manière dramatique sur l'économie positive, en place depuis 1955. La Russie a toujours été un partenaire respectueux des règles établies. Tous les accords entre la Russie et l'Autriche étaient corrects et perceptibles par tous. Après que le gouvernement fédéral autrichien a approuvé, de manière totalement incompréhensible, les sanctions de l'UE contre la Russie et a recommandé aux entreprises autrichiennes en Russie de mettre un terme à leurs activités dans ce pays, le dommage a été causé.
Les dommages économiques qui en ont résulté pour l'Autriche sont probablement plus importants que tout ce que la politique coronaviresque, le changement climatique, l'inflation et les coûts en tous genres imposés par l'UE avaient déjà pu provoquer.
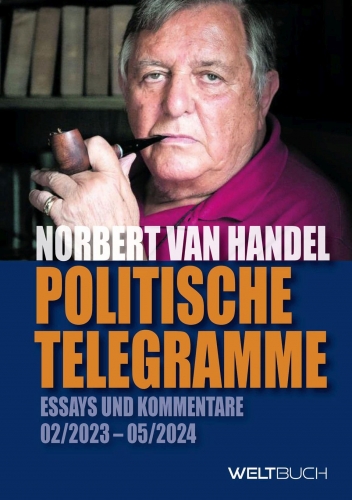
Si l'Autriche avait adopté une position réellement neutre, comme elle aurait dû le faire conformément à ses obligations en droit international, le pays, demeuré neutre, ne serait pas considéré comme un pays ennemi par la Russie.
Depuis 1955, date du traité d'Etat, l'Autriche n'a jamais violé sa neutralité et la position pro-occidentale du pays n'a jamais été perçue comme une position « hostile » par la Russie. Malheureusement, cela a changé depuis la guerre en Ukraine.
Au lieu qu'un gouvernement raisonnable et tourné vers l'avenir se tienne à l'écart du conflit et traite les deux belligérants du point de vue de la neutralité, l'Autriche, à cause d'une politique étrangère désastreuse, a directement basculé dans le scénario de guerre voulu par l'Union européenne, l'OTAN et, finalement, les États-Unis. C'est l'une des erreurs les plus fatales que l'Autriche ait pu commettre depuis 1955, non seulement pour l'Autriche même mais aussi pour l'Europe, car les États neutres sont justement les partenaires par excellence de la politique internationale, qui peuvent œuvrer pour la paix par des efforts et des initiatives constants, des conférences et une diplomatie silencieuse. Ni le ministre des affaires étrangères, qui n'est qu'un dilettante, ni le gouvernement dans son ensemble n'ont voulu ou compris cela. Malheureusement, la Suisse n'est pas non plus restée vraiment neutre dans ce contexte lorsqu'elle a soutenu les sanctions contre la Russie.
Orban: le représentant de l'Europe centrale
Bien que la Hongrie soit un Etat de l'OTAN et un membre de l'Union européenne, Viktor Orban a réellement su positionner son pays à la tête d'une Europe centrale chrétienne. Et ce non seulement au niveau national, mais aussi international, lorsqu'il a déclaré l'année dernière dans une interview en anglais que la paix suite à la guerre en Ukraine ne serait garantie que si Trump était réélu aux Etats-Unis.
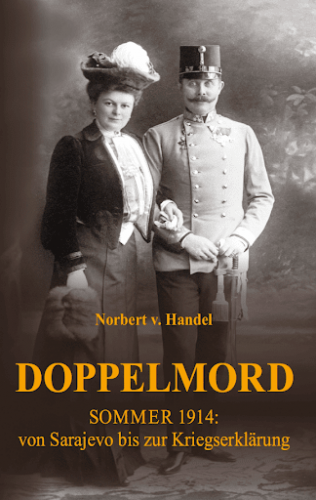
Le Premier ministre hongrois a en outre déclaré que la population ukrainienne ne serait épargnée des souffrances qu'elle endure que si la paix était instaurée. Les livraisons d'armes constantes et toujours plus importantes de l'Occident - selon Orban - détruisent avant tout l'Ukraine et cela doit être compris de tous.
Les colonies dévorent leurs colonisateurs
En Afrique, on remarque, sans entrer dans les détails, que de plus en plus de pays francophones tournent le dos à leurs anciens colonisateurs, alors que la France pensait jusqu'à présent pouvoir les traiter comme de simples colonies. Ce ne sont toutefois pas les Etats-Unis qui s'engouffreront dans ce vide, mais plutôt la Chine, car l'Afrique a depuis longtemps tourné le dos à l'impérialisme américain.
BRICS
Une partie essentielle du monde, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et tous les États de plus en plus nombreux qui souhaitent se joindre à ce système libre et neutre, détermineront l'économie à l'avenir.
Pourquoi ?
Parce que, contrairement aux États occidentaux saturés, ils ont un énorme besoin de services, d'infrastructure, de savoir-faire technique et de systèmes industriels. L'Occident est saturé, mais pas les BRICS. Des exportations substantielles vers ces pays représenteront donc un élan mondial à ne pas sous-estimer.
Dr. Norbert van Handel, Steinerkirchen a.d. Traun.
14:08 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norbert van handel, actualité, europe, affaires européennes, autriche, russie, neutralité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 octobre 2024
Sortie du système d'asile de l'UE: Pays-Bas, Hongrie - quand l'Autriche suivra-t-elle?

Sortie du système d'asile de l'UE: Pays-Bas, Hongrie - quand l'Autriche suivra-t-elle?
Depuis 2015, plus de huit millions de demandes d'asile ont été déposées dans l'UE.
Source: https://unzensuriert.at/283370-ausstieg-aus-eu-asylsystem-niederlande-ungarn-wann-folgt-oesterreich/?pk_campaign=Unzensuriert-Infobrief
Après les Pays-Bas, c'est au tour de la Hongrie d'annoncer son intention de sortir du système d'asile de l'UE. Des voix s'élèvent désormais pour demander que l'Autriche se retire également de ce système.
Depuis hier, lundi, on sait que la Hongrie demande elle aussi, dans une lettre adressée à la Commission européenne, la possibilité de se retirer des règles européennes en matière d'asile. Le ministre hongrois des Affaires européennes, János Bóka, explique dans sa lettre qu'il souhaite suivre l'exemple des Pays-Bas. La Hongrie est convaincue que le renforcement du contrôle national de l'immigration est désormais le seul moyen d'atteindre ces objectifs et d'endiguer l'immigration illégale, qui représente un risque pour la sécurité.
Un signal important en provenance des Pays-Bas
Auparavant, les Pays-Bas avaient demandé à la Commission européenne de procéder à un tel retrait. Geert Wilders, qui siège pour la première fois au gouvernement avec son Parti pour la liberté (PVV), a parlé d'un signal important, « qu'un vent nouveau souffle sur les Pays-Bas ». Les deux pays auront-ils du succès avec leurs vœux ? En règle générale, une telle exception doit être approuvée par l'ensemble des 27 Etats membres de l'UE.
Le système d'asile de l'UE est complètement dépassé
Néanmoins, le chef de la délégation FPÖ au sein de l'UE, Harald Vilimsky, exige désormais que l'Autriche se retire du système d'asile. Il a déclaré dans un communiqué:
Le système d'asile de l'UE est complètement dépassé et inutilisable depuis longtemps pour faire face à l'immigration de masse qui abuse du droit d'asile. C'est pourquoi l'Autriche devrait suivre l'exemple des Pays-Bas et de la Hongrie et demander l'abandon de ce système d'asile.
Plus de huit millions de demandes d'asile
Depuis 2015, plus de huit millions de demandes d'asile ont été déposées dans l'UE. Peu importe de quelles régions du monde viennent les demandeurs d'asile et combien de pays tiers sûrs ils ont dû traverser, pays où ils auraient pu trouver une protection. Cela doit enfin cesser - « d'autant plus que nous savons depuis longtemps que plus de la moitié d'entre eux n'ont aucun droit à la protection, même selon les règles généreuses de l'UE», a déclaré Vilimsky. Au vu de cet échec persistant du système, il n'est pas étonnant que de plus en plus de pays veuillent se retirer.
Les États perdent leur souveraineté
Un Etat qui ne peut plus déterminer quelles personnes et combien de personnes séjournent sur son territoire a perdu des parties essentielles de sa souveraineté et donc de sa légitimité, a déclaré le député européen de la FPÖ.
20:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asile, europe, affaires européennes, hongrie, pays-bas, autriche, immigration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 03 octobre 2024
La Fpö gagne en Autriche. Mais la clique atlantiste n'en veut pas au gouvernement

La FPÖ gagne en Autriche. Mais la clique atlantiste n'en veut pas au gouvernement
Augusto Grandi
Source: https://electomagazine.it/in-austria-vince-la-destra-del-fpo-ma-lammucchiata-atlantista-non-la-vuole-al-governo/
En Autriche comme en Allemagne. La dite "extrême droite" qu'est la FPÖ gagne les élections mais le réflexe conditionné des autres partis se déclenche aussitôt, tous prêts à faire tout et le contraire de tout pour ignorer les choix d'un tiers de la population autrichienne. Un scénario qui se répète partout en Europe. Un tiers, un quart de la population, selon les diverses élections, n'a plus de droits. Formellement, cela convient. Parce que cela signifie que deux tiers ou trois quarts des électeurs ne sont pas d'accord avec les partisans de ces droites.
Oui, d'accord, mais alors sur quoi sont-ils d'accord? Sur la répartition des sièges, sans aucun doute. Sur l'obéissance aveugle et absolue aux seigneurs de la guerre. Sur le droit des oligarques, locaux et internationaux, d'appauvrir la classe moyenne pour créer un immense lumpenprolétariat européen à exploiter de toutes les manières. Sur le fait de favoriser l'arrivée de nouveaux esclaves pour accroître la concurrence vers le bas. Et peu importe que le parti opposé à cette saloperie progresse d'une douzaine de points tandis que le parti au pouvoir en perd autant. Tous ensemble pour éviter le changement.
Majorité et opposition, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en France, en Espagne. Ils font semblant de se disputer pour justifier la présence de partis différents. Mais au fond, rien ne change dans les stratégies nationales. Oui, la droite fluide enverrait en prison ceux qui volent les vieilles dames dans le tramway ou ceux qui occupent le domicile d'une personne âgée temporairement hospitalisée. Mais, pour ne pas irriter les intellos de gauche qui vivent dans des zones protégées et n'utilisent pas les transports en commun, la droite laisse la décision aux magistrats qui sont prêts à relâcher même ceux qui n'ont pas encore été arrêtés.
Alors que la gauche n'enverrait en prison que ceux qui osent se défendre contre une agression, peut-être par un migrant qui aura eu, parait-il, ses raisons de voler ou d'occuper.
Il en va de même pour les guerres atlantistes. Les peuples d'Europe en ont assez de s'appauvrir pour enrichir les marchands d'armes et de mort. Mais les partis de la majorité et de l'opposition s'en moquent et s'obstinent dans la guerre, l'autoritarisme, la pauvreté.
16:01 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autriche, fpö, europe, affaires européennes, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 septembre 2024
Seule la FPÖ a voté pour un cessez-le-feu en Ukraine !

Seule la FPÖ a voté pour un cessez-le-feu en Ukraine !
Source: https://unser-mitteleuropa.com/147500
Tout comme l'AfD en Allemagne, c'est la FPÖ en Autriche qui milite pour la fin de la guerre en Ukraine et donc pour des négociations de paix. Pas seulement en Autriche même, mais aussi au Parlement européen. En revanche, les « partis démocratiques » autoproclamés se rangent fermement du côté des bellicistes.

Le chef de la délégation du FPÖ à l'UE, M. Vilimsky, a déclaré : « L'ÖVP, le SPÖ, les Verts et les Neos continuent d'alimenter le bellicisme ».
« Alors que l'ÖVP, la SPÖ, les Verts et Neos encouragent une nouvelle escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie, la FPÖ est le seul parti autrichien à défendre une ligne conforme à notre neutralité perpétuelle inscrite dans la Constitution », a déclaré le chef de la délégation du FPÖ au Parlement européen, Harald Vilimsky, en commentant une résolution adoptée jeudi, qui se prononce en faveur d'un soutien militaire continu à l'Ukraine et de l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe.
Six élus FPÖ face à tous les autres
Parmi les parlementaires européens autrichiens, seuls les six députés FPÖ se sont prononcés en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et de la fin de la guerre. Les autres députés autrichiens noirs (démocrates-chrétiens), rouges (socialistes), roses (NEOS/libéraux) et verts ont rejeté cet amendement pacificateur. Il en a été de même pour un autre amendement visant à ne plus livrer d'armes dans la zone de guerre.
Les néos se distinguent par leur bellicisme
Les députés de l'ÖVP, de la SPÖ et des Verts se sont montrés un peu moins enthousiastes en ce qui concerne la levée des restrictions sur les armes et la livraison de missiles de croisière. Ils se sont abstenus de voter sur ce point.

"Seuls le député Neos Helmut Brandstätter (photo) et sa collègue - tous deux membres du groupe Renew du Parlement européen tout comme la lobbyiste présumée des industries de l'armement, Marie-Agnes Strack-Zimmermann de la FDP allemande - se sont prononcés en faveur de la levée des restrictions sur les armes et de la livraison rapide des missiles de croisière Taurus de fabrication allemande. Cela devrait permettre aux armes et aux missiles financés principalement par la Facilité européenne de paix (FEP) d'attaquer des cibles en Russie », a expliqué Vilimsky.
Le mot « cessez-le-feu » n'apparaît même pas dans la résolution
Il reproche aux partisans du texte que le mot « cessez-le-feu » ne figure même pas dans la résolution.
"Il s'avère qu'outre la Commission européenne, une grande partie du Parlement européen n'est pas du tout intéressée par la fin du conflit. Les conséquences sont la poursuite sans fin de cette guerre, d'innombrables soldats tués et une population civile totalement désespérée. Cette folie doit enfin prendre fin », a déclaré le chef de la délégation FPÖ au Parlement européen, qui se prononce pour des négociations de paix immédiates.

UNSER MITTELEUROPA est publié sans d'ennuyeuses publicités automatisées à l'intérieur des articles, qui rendent parfois la lecture difficile. Si vous appréciez cela, nous vous serions reconnaissants de soutenir notre projet. Détails sur les dons (PayPal ou virement bancaire) sur le site (cf. supra).
18:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : neutralité, actualité, autriche, fpö, parlement européen, bellicisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 22 août 2024
Martin Sellner : Regime Change de droite. Une esquisse stratégique

Recension
Martin Sellner : Regime Change de droite. Une esquisse stratégique
L'été dernier, l'activiste Martin Sellner a publié un ouvrage intitulé Regime Change von rechts, dans lequel il présente et explique différentes stratégies. Une tentative qui vaut la peine d'être lue, comme l'explique Simon Dettmann dans son compte-rendu détaillé pour la revue Freilich.
par Simon Dettmann
Source: https://www.freilich-magazin.com/kultur/rezension-martin-sellner-regime-change-von-rechts-eine-strategische-skizze
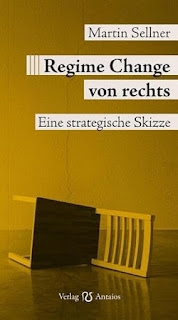 Regime Change von rechts, la publication la plus complète à ce jour de l'activiste politique autrichien Martin Sellner, visage et maître à penser des Identitaires dans l'espace germanophone, constitue véritablement un "grand coup". Tout d'abord parce que l'ouvrage répond effectivement à l'ambition qu'il s'est fixée, celle d'ordonner, de systématiser et d'élever à un niveau théorique supérieur les débats sur la stratégie et la tactique menés dans les milieux dits de la "nouvelle droite". Le livre de Sellner est une tentative d'unifier l'ensemble des milieux de la nouvelle droite, qu'il assimile au camp de la droite, autour d'une stratégie visant à atteindre l'objectif principal commun, à savoir assurer la pérennité du peuple allemand. L'auteur, avec sa pensée formée par Gramsci, Althusser et Gene Sharp et son regard souvent sociologique et psychologique sur les processus politiques, a de nombreux arguments en sa faveur. Mais sa façon de tourner en rond autour du problème de la démographie, qui tend à devenir monomaniaque, pourrait avoir un effet négatif à long terme sur la droite intellectuelle et politique.
Regime Change von rechts, la publication la plus complète à ce jour de l'activiste politique autrichien Martin Sellner, visage et maître à penser des Identitaires dans l'espace germanophone, constitue véritablement un "grand coup". Tout d'abord parce que l'ouvrage répond effectivement à l'ambition qu'il s'est fixée, celle d'ordonner, de systématiser et d'élever à un niveau théorique supérieur les débats sur la stratégie et la tactique menés dans les milieux dits de la "nouvelle droite". Le livre de Sellner est une tentative d'unifier l'ensemble des milieux de la nouvelle droite, qu'il assimile au camp de la droite, autour d'une stratégie visant à atteindre l'objectif principal commun, à savoir assurer la pérennité du peuple allemand. L'auteur, avec sa pensée formée par Gramsci, Althusser et Gene Sharp et son regard souvent sociologique et psychologique sur les processus politiques, a de nombreux arguments en sa faveur. Mais sa façon de tourner en rond autour du problème de la démographie, qui tend à devenir monomaniaque, pourrait avoir un effet négatif à long terme sur la droite intellectuelle et politique.
Tbilissi, 7 mars 2023. Pour la deuxième nuit consécutive, des milliers de personnes patientent sur la grande place près du Parlement géorgien. Mais contrairement à hier, les forces de l'ordre ne se contentent plus d'observer avec apathie. Cette fois, la police utilise des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre les manifestants. La foule se disperse rapidement, donnant lieu à des scènes que les journalistes qualifient généralement de "tumultueuses". Alors que presque tous les manifestants s'écartent ou se réfugient dans les rues latérales, une femme d'âge moyen court dans la direction opposée - tout droit vers les canons à eau. Elle tient dans ses mains un énorme drapeau européen qu'elle agite frénétiquement. Les canons à eau commencent immédiatement à la viser, mais cela ne semble pas l'impressionner.
Des manifestants se précipitent vers elle et tentent de la protéger des jets d'eau. Trempé et entouré de gens, elle se tient au milieu de l'une des plus grandes places de la capitale et brandit le drapeau bleu foncé avec les étoiles jaunes vers le ciel nocturne. Il en résulte pendant quelques secondes une scène d'une grande puissance iconique et d'une grande force symbolique. Il en résulte une image dont les éléments de base font partie intégrante d'une iconographie de la révolution et font partie de la mémoire collective des Européens - comme le confirmeront tous ceux qui ont déjà vu "La liberté guidant le peuple" de Delacroix ou une représentation des combats sur les barricades pendant la révolution de mars 1848. Le drapeau de l'UE, quant à lui, fait référence à la forme concrète de bouleversement social que les manifestants ont en tête: une révolution de couleur.

Des révolutions colorées avec l'argent des autres
Les manifestations de masse sont motivées par le projet du gouvernement géorgien d'adopter une loi qui obligerait les ONG et les médias financés à plus de 20% par l'étranger à se désigner eux-mêmes comme "agents étrangers".
Une telle loi contrecarrerait la stratégie des agents étrangers, des groupes de médias et des think tanks occidentaux visant à influencer l'opinion publique en Géorgie et à faire basculer le pays dans le camp des libéraux pro-occidentaux; la dite loi entraverait donc l'intégration de la Géorgie dans le bloc de puissance occidental, du moins à moyen terme. Mais rien n'y fait. Deux jours plus tard, le 9 mars, la pression est trop forte et le gouvernement est contraint d'abroger cette loi mal acceptée.
Le mouvement de protestation, qui semble être parti de rien, n'a certes pas atteint son objectif principal, qui était de contraindre le parti au pouvoir "Rêve géorgien", qui mène une politique étrangère multisectorielle, à démissionner et à être remplacé par une alliance de partis extrêmement pro-occidentaux lors de nouvelles élections, mais il a atteint son objectif intermédiaire, annoncé publiquement et fortement mobilisateur, en quelques jours seulement.
Voilà pour la pratique concrète du changement de régime et de la révolution de couleur.
Un livre paru au bon moment
Mais ne serait-il pas possible d'adopter les stratégies, les tactiques, les formes d'organisation et de protestation d'une révolution de couleur et de les mettre en œuvre en Allemagne, en Autriche ou en Suisse ? En d'autres termes, une révolution culturelle et de couleur étiquetée "de droite", c'est-à-dire réclamant la fin de l'hégémonie discursive des idées libérales de gauche et leur remplacement par des idées conservatrices et nationalistes, associée à un changement de gouvernement, pourrait-elle avoir du succès dans l'espace germanophone ? Même s'il préfère écrire Social Change et Regime Change : Martin Sellner, on peut l'affirmer avec certitude après la lecture de son livre, en est profondément convaincu. C'est pourquoi Regime Change von rechts traite aussi de la possibilité d'une révolution de couleur, des chemins tortueux qui y mènent, de ses conditions sociales préalables, de sa théorie et de la théorie de sa pratique. C'est un livre étonnamment optimiste, qui ne cherche pas à démoraliser mais à motiver l'action, tout en invitant sans cesse le lecteur à réfléchir à ses propres actions d'un point de vue stratégique et moral.
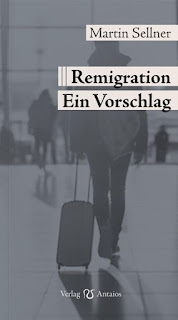 Mais c'est surtout un livre nécessaire, car il corrige des hypothèses théoriques erronées encore largement répandues dans le camp de la droite, souligne les impasses stratégiques et démystifie les mythes. Par exemple, Sellner explique de manière convaincante pourquoi beaucoup (d'activisme de droite) ne sert pas toujours à grand-chose, pourquoi croire que l'on peut convaincre l'adversaire de sa propre vision du monde par une argumentation rationnelle et ainsi amorcer ce qu'il appelle un tournant spirituel est politiquement naïf et part de présupposés anthropologiques erronés ou pourquoi, à l'inverse, se concentrer uniquement sur les valeurs esthétiques et les questions de style de vie personnel mène à une impasse politique. À une époque où les milieux dits de "nouvelle droite" sont trop souvent caractérisés par l'oscillation de jeunes idéalistes entre le besoin activiste de faire quelque chose tout de suite d'une part, et le défaitisme mélancolique d'autre part - c'est-à-dire, en termes mémétiques, le dualisme de "It's over !" et "We're so back !" -, il est malheureusement (pédagogiquement) nécessaire de rappeler de telles évidences.
Mais c'est surtout un livre nécessaire, car il corrige des hypothèses théoriques erronées encore largement répandues dans le camp de la droite, souligne les impasses stratégiques et démystifie les mythes. Par exemple, Sellner explique de manière convaincante pourquoi beaucoup (d'activisme de droite) ne sert pas toujours à grand-chose, pourquoi croire que l'on peut convaincre l'adversaire de sa propre vision du monde par une argumentation rationnelle et ainsi amorcer ce qu'il appelle un tournant spirituel est politiquement naïf et part de présupposés anthropologiques erronés ou pourquoi, à l'inverse, se concentrer uniquement sur les valeurs esthétiques et les questions de style de vie personnel mène à une impasse politique. À une époque où les milieux dits de "nouvelle droite" sont trop souvent caractérisés par l'oscillation de jeunes idéalistes entre le besoin activiste de faire quelque chose tout de suite d'une part, et le défaitisme mélancolique d'autre part - c'est-à-dire, en termes mémétiques, le dualisme de "It's over !" et "We're so back !" -, il est malheureusement (pédagogiquement) nécessaire de rappeler de telles évidences.
Oui, Regime Change von rechts, livre pédagogique et morigénateur, est souvent redondant et didactique dans son écriture et sa construction, comme nous l'avons déjà souligné de manière critique. Cependant, cela est dû au fait que l'ouvrage s'adresse principalement à l'intérieur, c'est-à-dire aux mouvements et aux partis. Ainsi, les caractéristiques mentionnées ne renvoient pas à des déficits de Sellner, mais indirectement à des déficits (intellectuels) chez de nombreux acteurs de la droite.
Le peuple est au centre des préoccupations
Le cœur théorique de l'ouvrage est constitué par la définition de l'objectif principal de la droite, l'analyse du système politique ou social dans lequel la droite doit nécessairement opérer et l'évaluation des différentes stratégies concurrentes pour atteindre l'objectif principal, l'accent étant clairement mis sur l'analyse des stratégies. La définition de cet objectif principal tient en quelques pages. Et ce, à juste titre. Heureusement, il n'y a guère de désaccord au sein du dit camp sur cette question. Pour Sellner, l'objectif principal de la droite est de préserver l'identité ethnoculturelle - une formulation qui peut être identifiée sans hésitation à la garantie de la pérennité du peuple allemand. Des explications et des justifications complexes sont ici totalement inutiles; l'intérêt pour sa propre pérennité (collective) est naturel, évident et immédiatement compréhensible pour tous.

Et d'ailleurs, ce fait est aussi la cause principale de la négation de l'existence du peuple allemand par la classe dirigeante. Car les acteurs décisifs de cette classe dirigeante sont certainement conscients qu'en admettant ce fait, ils s'engageraient sur une "pente glissante", au bas de laquelle se trouverait leur perte de pouvoir. Il est donc impossible pour la classe dirigeante de céder le moindre terrain dans la lutte pour une interprétation universelle du concept de peuple. Elle se retrancherait ainsi dans une position qu'elle a déjà reconnue comme intenable à long terme. En laissant le concept de peuple s'effacer devant celui d'identité, Sellner gâche à la légère le potentiel subversif inhérent à ce concept.
Après avoir clarifié le véritable objectif, à savoir l'autosuffisance ou l'accumulation du pouvoir politique pour l'assurer, l'auteur passe à l'explication de la relation entre certains concepts. Quelle est la relation entre l'objectif principal et les objectifs intermédiaires ? Quelle est la différence entre stratégie et tactique ? Les passages d'analyse conceptuelle de ce type, que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le livre, peuvent être considérés comme ennuyeux et techniques par certains lecteurs, mais ils sont éminemment importants - et Sellner les expose avec la précision sobre d'un général qui présente son plan de bataille.
Avec Gramsci et Althusser contre l'élite
En revanche, la partie consacrée à l'analyse systémique est déjà bien plus vaste. Ici, Sellner est confronté au défi de dresser un tableau réaliste, mais aussi compréhensible et non hypercomplexe de l'ordre social et politique dans lequel la droite doit agir. Ce n'est pas une tâche facile dans le contexte de l'Allemagne fédérale ou de l'Autriche, car la tromperie systématique et ciblée des citoyens sur le fonctionnement réel des institutions, la dynamique interne de l'État dans ces nations n'est pas un simple sous-produit de l'ordre dominant, mais la base de son existence, et c'est justement là que trop de citoyens s'installent confortablement dans leurs représentations illusoires de l'État dans lequel ils vivent.


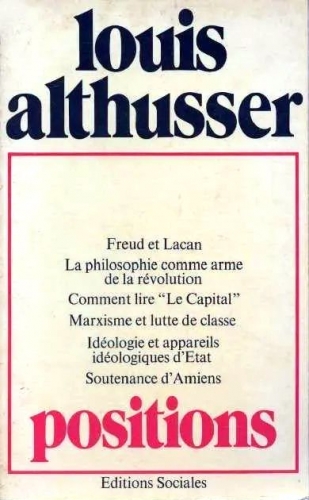
Mais Sellner est ici clairement dans son élément et profite de cette partie pour introduire deux théories qui l'ont fortement marqué, lui et la Nouvelle Droite dans son ensemble : la théorie de l'hégémonie du pouvoir d'Antonio Gramsci et Les appareils idéologiques d'État de Louis Althusser. Avec ces théories, il tente d'attirer l'attention du lecteur sur la véritable base du pouvoir des classes dominantes dans les pays occidentaux, à savoir l'opinion publique ou le pouvoir de la créer, de la contrôler et de la diriger.
Pour faciliter la tâche des personnes qui ne connaissent pas le grammaticalisme juridique, il intègre la théorie dans un réseau de métaphores et de mots clés, dont certains sont même de sa propre initiative. Il y a tout d'abord la métaphore du climat d'opinion, avec laquelle il veut visualiser la production complexe de l'opinion publique et qui est tout à fait convaincante. Il illustre ensuite les changements réels et potentiels de l'opinion publique et la métaphore du couloir d'opinion avec le modèle déjà très populaire de la fenêtre d'Overton.
Tout cela est très méritoire et remplit son objectif éducatif, mais en face, il y a deux mots d'ordre qui sont malheureusement moins convaincants : le simulacre de démocratie et le totalitarisme doux.
La question cruciale de la démocratie
Le problème avec la notion de simulation de démocratie est qu'elle implique deux affirmations de base, toutes deux indiscutablement vraies, mais qui induisent néanmoins en erreur. D'une part, le fait que les dirigeants prétendent, du moins publiquement, que leur régime est démocratique et, d'autre part, le fait qu'il ne l'est pas en réalité. Sellner écrit que la démocratie n'est qu'un simulacre, parce que l'opinion publique n'est pas le produit du libre jeu des forces, mais du filtre systémique qu'il appelle le climatiseur d'opinion. Mais si une démocratie n'existe que si elle permet le libre jeu des forces, alors il n'y en a jamais eu. Sellner nourrit ici des illusions libérales et semble sur le point de ressortir de la naphtaline des phrases d'Habermas telles que le "discours sans domination" et la "contrainte sans contrainte du meilleur argument". En outre, le concept procédural de démocratie qui sous-tend toujours implicitement le discours de Sellner sur la simulation de démocratie est trompeur. Il semble vraiment croire à la possibilité d'une "vraie" démocratie au sens d'un gouvernement populaire. C'est en cela qu'il se distingue par exemple de ses adversaires libéraux de gauche, c'est-à-dire de la classe dirigeante, au sein de laquelle on défend depuis longtemps une conception substantielle de la démocratie, parfois même de manière semi-officielle.
Concrètement, cela signifie que pour les libéraux de gauche, la démocratie est devenue le mot-clé du libéralisme de gauche. Tant que les intellectuels de droite réagiront en introduisant dans le discours le mirage rousseauiste du vrai gouvernement parfait du peuple, au lieu d'élaborer à leur tour un concept substantiel de démocratie, ils contribueront à mettre la droite hors jeu. En effet, en raison de son faible degré d'organisation, de la politisation et de l'éducation souvent superficielles des individus et, surtout, de sa taille, un peuple dans son ensemble n'est pas en mesure d'exercer un quelconque pouvoir. Comme le confirme l'histoire de l'humanité, celle-ci ne peut être exercée collectivement que par de petits sous-groupes bien organisés du peuple, au sein desquels il existe un degré relativement élevé d'homogénéité idéologique et de conformité sociale et où le savoir de la domination est systématiquement accumulé. Ces sous-groupes sont les élites ou les classes dirigeantes. Elles dominent le reste du peuple, qui leur fait face en tant que "masse". Et il en sera probablement toujours ainsi. C'est pourquoi la lutte pour la vraie démocratie, dans le sens d'un gouvernement populaire, ressemble à la recherche de la mérule.
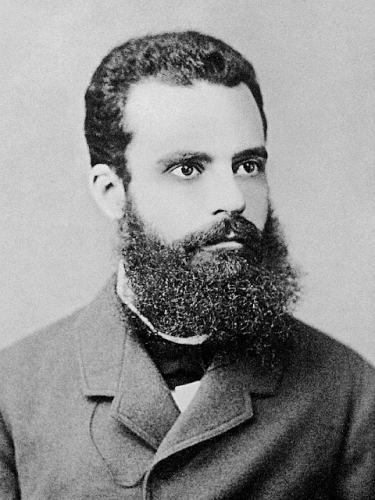
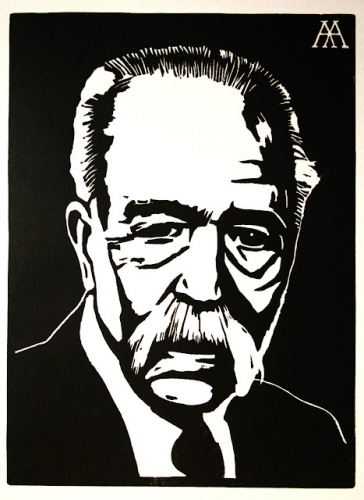

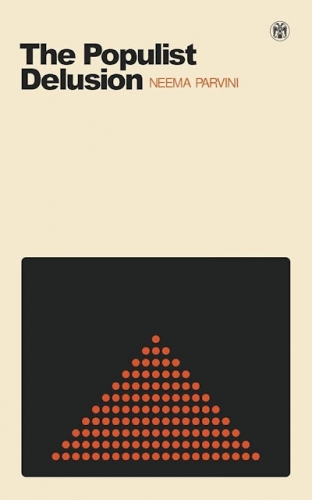
Le courage de la cohérence politique
L'exposé de Sellner aurait gagné à faire davantage référence aux classiques de la sociologie des élites comme Vilfredo Pareto et Gaetano Mosca. Il court ainsi le risque de succomber à une illusion populiste (décrite en détail par le philosophe britannique Neema Parvini dans son livre The Populist Delusion).
Il en va de même pour l'expression "totalitarisme doux". Sellner l'utilise pour évoquer et condamner la répression de l'appareil d'État contre tout ce qui est de droite. C'est tout à son honneur, mais doit-il pour cela utiliser un terme entièrement libéral, qui a été inventé pour immuniser moralement les libéraux contre leurs critiques de gauche et de droite et qui remplit encore bien cet objectif aujourd'hui ? Est-ce vraiment une bonne idée de conforter des contemporains intellectuellement libérés dans leur tendance, typique des boomers, à rejeter l'autorité et l'ordre et à les condamner comme étant généralement totalitaires, fascistes et illégitimes, et d'introduire leur vocabulaire dans la Nouvelle Droite ? Le totalitarisme est généralement compris comme la volonté d'imposer une idéologie d'État dans tous les domaines de la vie sociale et de transformer ainsi les individus dans le sens de cette idéologie d'État. Bien sûr, l'observation que les systèmes libéraux peuvent également être totalitaires est un progrès de la connaissance par rapport à la position libérale selon laquelle le totalitarisme n'est possible que dans les systèmes non libéraux, c'est-à-dire les systèmes supposés d'extrême droite ou d'extrême gauche (Ryszard Legutko a écrit sur cette observation un livre à lire , Le démon de la démocratie!)

Mais pourquoi s'arrêter à mi-chemin dans le processus de connaissance ? Car quelle valeur a encore la notion de totalitarisme si tout système, quelle que soit son orientation idéologique, tend à agir de manière totalitaire dans certaines situations? A long terme, la droite ne pourra pas éviter de reconnaître que dans les phénomènes qualifiés de totalitaires, l'essence du politique ne fait que se révéler à nous sous une forme particulièrement pure.
Lorsqu'un ordre étatique dérive prétendument vers le totalitarisme, l'hostilité entre deux groupes sociaux atteint simplement un niveau plus élevé. C'est pourquoi les représailles de l'État contre les droits politiques ne sont pas un pas en avant du totalitarisme doux vers le totalitarisme ouvert, mais une politisation. Et la volonté de pénétrer politiquement tous les espaces sociaux, qu'Olaf Scholz a résumée un jour dans l'un de ses rares moments de sincérité par la phrase "Nous voulons conquérir la souveraineté aérienne au-dessus des berceaux", fait désormais partie de la logique propre de la politique et de tout mouvement politique qui veut conquérir et conserver le pouvoir. La souveraineté idéologique totale du libéralisme de gauche sur toutes les institutions pertinentes, des crèches aux maisons de retraite, est une réalité en République fédérale - et c'est précisément pour pouvoir décrire cette réalité qu'Althusser a développé la théorie des appareils idéologiques d'État. Sellner la mentionne également brièvement, mais ne l'applique pas de manière conséquente.
Qui fait partie de la droite politique ?
Mais avant d'aborder les différentes stratégies, il tente, dans un très court chapitre, de clarifier la question de savoir qui et quoi fait réellement partie de la droite. Sa réponse : exclusivement la Nouvelle Droite et aucun autre milieu. Pas la vieille droite, ni les libéraux-conservateurs. Il ne veut même pas inclure les nationaux-conservateurs dans le camp de la droite. C'est étonnant, car le national-conservatisme est sans doute la description la plus précise possible de ce que Sellner lui-même et une grande partie de la Nouvelle Droite représentent politiquement. Il est bien sûr légitime de définir tous ceux qui ne sont pas de la nouvelle droite comme étant hors de leur propre camp, mais cela ne fait que renommer le milieu de la nouvelle droite en "camp de droite". Les quelques personnes de la vieille droite et surtout les nombreux libéraux-conservateurs ne disparaissent pas pour autant, bien au contraire. Le fait d'ignorer ces milieux ne facilite pas le débat sur le fond, mais le rend beaucoup plus difficile. Ce n'est pas la description qu'une personne fait d'elle-même comme étant de droite, conservatrice, nationaliste, etc. qui détermine généralement sa réalité sociale, mais une attribution étrangère émanant des libéraux et des gauchistes. Et pour eux, la droite englobe tout, de Jan Fleischhauer à la division des armes nucléaires. La nouvelle droite pourrait en rire de bon cœur si les attributions étrangères de la gauche libérale n'avaient pas un pouvoir énorme. D'une certaine manière, elles créent une réalité à laquelle la Nouvelle Droite aura du mal à se soustraire. L'énorme hétérogénéité de la droite, même par rapport à la gauche politique, est un fait, mais Sellner préfère partir d'une situation politique idéale dans laquelle il n'y a que des néo-droitiers.
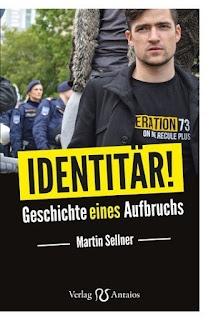 Mais le cœur de l'ouvrage est clairement la partie consacrée à l'analyse stratégique. Il y présente quatre stratégies principales pour atteindre l'objectif principal de la droite et neuf non stratégies. Les quatre stratégies principales sont la Reconquista, le militantisme, le patriotisme parlementaire et la stratégie de rassemblement. Il en rejette deux en bloc : le patriotisme parlementaire et le militantisme. A juste titre, c'est pourquoi nous ne reviendrons pas ici sur ces chemins de traverse. La stratégie du rassemblement, c'est-à-dire la concentration de toutes les forces et ressources encore disponibles dans une région, est pour lui une solution de secours en cas d'échec de la stratégie qu'il préfère : la Reconquista. L'analyse des non-stratégies prend beaucoup de place et c'est justement là que Sellner écrit souvent avec un ton didactique ou pédagogique. Certains lecteurs s'en lasseront, mais étant donné que Sellner s'adresse parfois explicitement aux adolescents et jeunes adultes enclins au militantisme et qu'il tente de les dissuader de leurs actions destructrices, c'est malheureusement nécessaire.
Mais le cœur de l'ouvrage est clairement la partie consacrée à l'analyse stratégique. Il y présente quatre stratégies principales pour atteindre l'objectif principal de la droite et neuf non stratégies. Les quatre stratégies principales sont la Reconquista, le militantisme, le patriotisme parlementaire et la stratégie de rassemblement. Il en rejette deux en bloc : le patriotisme parlementaire et le militantisme. A juste titre, c'est pourquoi nous ne reviendrons pas ici sur ces chemins de traverse. La stratégie du rassemblement, c'est-à-dire la concentration de toutes les forces et ressources encore disponibles dans une région, est pour lui une solution de secours en cas d'échec de la stratégie qu'il préfère : la Reconquista. L'analyse des non-stratégies prend beaucoup de place et c'est justement là que Sellner écrit souvent avec un ton didactique ou pédagogique. Certains lecteurs s'en lasseront, mais étant donné que Sellner s'adresse parfois explicitement aux adolescents et jeunes adultes enclins au militantisme et qu'il tente de les dissuader de leurs actions destructrices, c'est malheureusement nécessaire.
Différentes stratégies pour guider...
Dans ce contexte, deux des non-stratégies semblent particulièrement intéressantes, à savoir l'accélérationnisme et la pensée dite "babo". Alors que l'accélérationnisme, bien qu'étant à l'origine une figure de pensée du philosophe néo-réactionnaire Nick Land, est devenu un mot-clé légitimant la violence brutale dans d'obscurs biopes en ligne et a rapidement sombré dans l'insignifiance, les variantes de la "pensée babo" connaissent aujourd'hui un nouvel âge d'or. Le babo est le patron ; un homme alpha charismatique qui construit autour de lui une société d'hommes de plus en plus souvent purement virtuelle. Il prêche à ses adeptes un culte du machisme, presque toujours associé à l'optimisation de soi et à l'abandon total de la politique pratique. Presque toujours, ces scènes babos sont marquées par les intérêts financiers du mâle alpha concerné. Si elles ont longtemps été des phénomènes marginaux, elles passent depuis une dizaine d'années plus souvent de la sous-culture au centre de la société.

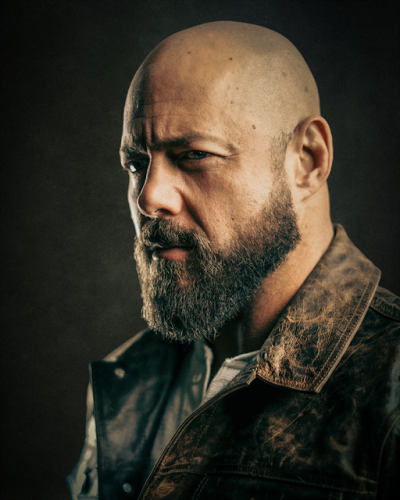

Figures de la "droite-style-de-vie": Kollegah, Jack Donavan et le livre de Costin Alamariu.
Il y en a pour tous les goûts: les jeunes immigrés enclins aux théories du complot y trouvent leur compte (Kollegah), tout comme les personnes exclusivement obnubilées par l'argent et le statut social (Andrew Tate), les nostalgiques du tribalisme (Jack Donovan) et les jeunes hommes en quête d'un support pseudo-intellectuel pour leurs jeux de rôle (Costin Alamariu ou "Bronze Age Pervert"). Il devrait aller de soi que cette "droite du style de vie" matérialiste, qui tend vers un amoralisme hors du monde, ne mérite pas d'être appelée droite dans un sens substantiel quelconque et qu'elle mène à une impasse stratégique. Pourtant, le départ de Trump en novembre 2020 et les déceptions qu'il a causées à ses partisans ont créé un terrain propice à l'éclosion non seulement d'un culte schizophrène de la crise (QAnon), mais aussi de cette "droite du style de vie" dont nous avons parlé. Cette vague s'est propagée depuis longtemps dans les pays germanophones. Sellner critique ces tendances, mais il aurait dû citer des noms et taper plus fort ; la pensée babo est la plus pertinente des non-stratégies actuelles.
... mais seulement une stratégie directrice ?
L'auteur consacre une attention particulière à la stratégie directrice qu'il privilégie, la Reconquista. Par reconquista, il entend une stratégie de conquête du pouvoir culturel ou discursif qui s'inspire théoriquement de Gramsci, Althusser et, même si son nom n'est pas cité, de Foucault, et qui, dans sa partie pratique, accorde une grande importance aux formes de protestation de l'action non-violente au sens de Gene Sharp. Mais plutôt que de parler d'hégémonie culturelle ou de discours hégémonique, Sellner préfère écrire "Social Change". Le "changement de régime" qui donne son titre à l'ouvrage n'est nécessaire que lorsque l'État devient ouvertement totalitaire. Si le "changement de régime" échoue également, la droite doit passer à la stratégie du rassemblement. Telles sont les grandes lignes de la Reconquista de Sellner.
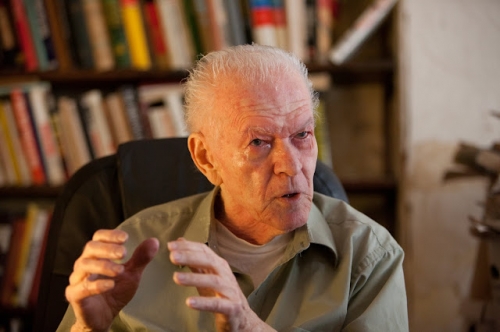

Pour résumer, je dirais que : cette stratégie est inattaquable sur le fond et est considérée, à juste titre, comme un "état de l'art" dans les cercles intellectuels de droite. Ce qui appelle en revanche une critique, ce sont les tâches de fond attribuées aux différentes composantes de la droite dans le cadre de la Reconquista. Sellner divise le camp de la (nouvelle) droite en 5 parties distinctes : le parti, le contre-public (médias/influenceurs de droite), la théorisation (intellectuels), la contre-culture et le mouvement (activiste). Au sein du camp, il existe une répartition claire des tâches et des rôles.
En outre, parmi les sous-groupes, le mouvement bénéficie d'une primauté. Comme pour lui, la préservation du peuple est l'objectif principal de droite, le problème principal est à l'inverse celui de la démographie, c'est-à-dire le Grand Remplacement/Peuplement. Jusqu'ici, rien de controversé. Mais Sellner exige en plus que TOUTE activité dans TOUT sous-groupe de la droite aborde à tout moment, directement ou indirectement, le problème du Grand Remplacement ou, comme il l'écrit, le tournant de la politique démographique et identitaire. Ce qu'il entend exactement par politique démographique et identitaire n'est pas clair. On peut toutefois supposer qu'il s'agit de tous les idéologèmes et récits qui, intériorisés collectivement, sont devenus les conditions de possibilité de la catastrophe démographique et lui ont spirituellement préparé le terrain. Il est donc probable que ces termes soient également très étroits et directement liés au Grand Remplacement.

La droite, telle que Sellner la conçoit, tourne donc autour de l'échange de population et est fixée de manière monomaniaque sur celui-ci. Cela serait particulièrement évident dans le domaine de la culture et dans les milieux intellectuels. Les musiciens de rock de droite chanteraient à longueur de journée sur les cas de violence des migrants et les points de basculement démographiques imminents, et la tâche la plus passionnante d'un intellectuel ou d'un scientifique de droite consisterait à calculer ces points de basculement, à produire et à populariser des études sur les effets négatifs de la diversité ethnique sur des groupes ethniquement, relativement, homogènes. Oui, avec le temps, une telle droite se rapprocherait de plus en plus des images diffamatoires que la gauche et les libéraux en donnent. Mais ce ne serait même pas le problème principal. Il résiderait dans le fait qu'une telle droite serait avant tout profondément ennuyeuse.
La droite monothématique
Une telle droite monothématique n'exercerait aucun attrait culturel et intellectuel sur les non-droites (encore). Peu d'artistes et de chercheurs en sciences humaines souhaiteraient faire partie d'un milieu dans lequel ils seraient cantonnés à un rôle et à une mission aussi contraignants. Cette fixation du milieu culturel et des intellectuels sur la tâche qui leur revient rappelle de loin, avec toute la prudence requise par de telles comparaisons, l'exigence formulée par les dirigeants communistes à l'égard du monde culturel et intellectuel d'articuler clairement le point de vue de classe. Le problème d'une telle attitude n'est pas tant qu'elle soit autoritaire ou illibérale, mais plutôt qu'elle est vouée à l'échec. Il est bien sûr souhaitable qu'un artiste, un penseur ou un scientifique politiquement ancré à droite exprime clairement l'objectif principal de la droite. Mais aucun mouvement activiste ne peut le lui imposer de manière contraignante. La seule façon de parvenir à la focalisation sur le Grand Remplacement dans toutes les composantes de la droite que Sellner a en tête est de faire naître soi-même les acteurs de la contre-culture et des sciences humaines à partir de ce que son propre milieu lui offre actuellement, de les "caster" en quelque sorte. Une stratégie dont la Nouvelle Droite a fait l'expérience, parfois douloureuse, ces dernières années. Car les grands penseurs et artistes ne se laissent pas caster. Ils sont presque tous le produit d'un climat propice à leur émergence. Ils naissent de manière organique ou pas du tout.
De plus, la demande de Sellner de se concentrer uniquement sur le problème de la démographie est naïve du point de vue de la sociologie des élites. Dans les pays germanophones, des centaines de milliers de personnes travaillent dans des universités, des ONG ou des entreprises de médias et occupent des emplois qui, aux yeux de l'extérieur, paraissent souvent futiles et inutiles (bullshit jobs). Pourtant, d'un point de vue systémique, les activités de ce groupe, qui constitue une partie importante de la classe dirigeante et de la classe managériale professionnelle (PMC), ont un objectif important. Ce but est équivalent à celui des appareils idéologiques d'État dans la théorie d'Althusser : l'auto-reproduction de l'ordre dominant. Un ordre qu'Althusser décrit comme capitaliste, alors que la droite intellectuelle le décrit plutôt comme moderne ou libéral (de gauche). Les élites intellectuelles ont donc pour fonction de produire, d'orienter et de légitimer le discours hégémonique, ainsi que de former une élite de la relève dans les universités et de la mettre idéologiquement au pas. Les productions intellectuelles de ces milieux sont pour la plupart peu impressionnantes. La plupart du temps, il s'agit de rationalisations post-hoc du statu quo.

Pas d'offre pour l'élite ?
Mais ce qui est décisif, c'est que la perception est totalement différente au sein des milieux décrits : les personnes concernées sont fermement convaincues de réaliser des prouesses intellectuelles et de travailler sur des théories révolutionnaires. Ils tirent leur légitimité et leur confiance en eux de cette image d'avant-garde de la pensée profonde. Le problème survient lorsque Sellner pense pouvoir satisfaire la curiosité intellectuelle et la soif de statut de la (nouvelle) classe moyenne universitaire avec le Grand Remplacement (qui n'est pas une théorie, mais simplement un fait) et la propagation du pronatalisme et d'une nouvelle politique identitaire (il s'agit probablement de nationalisme). Cela ne réussira pas. En effet, le surplus de capital culturel et de distinction qui, pour les personnes très intelligentes, est lié à la maîtrise et à la réflexion sur des systèmes théoriques extrêmement complexes tels que la philosophie transcendantale, la théorie des systèmes, l'éthique du discours ou les poststructuralismes, ne trouve pas d'équivalent à droite dans l'offre de Sellner sous la forme d'une théorie de droite d'une complexité comparable. Pourtant, indépendamment de la question de savoir si de telles théories existent éventuellement à droite, Sellner précise à plusieurs reprises et sans équivoque qu'il n'a aucune intention de les utiliser. C'est surprenant quand on connaît son penchant pour Heidegger et sa critique hermétique et obscure de la technique.
Une explication possible de son scepticisme prononcé à l'égard des intellectuels et de la partie de la Professional Managerial Class marquée par le discours académique réside dans le fait qu'il pourrait avoir analysé l'évolution historique de la gauche radicale en Allemagne de l'Ouest : après s'être formée et établie dans les années 60, elle s'est fragmentée dans les années 70 en centaines de petits groupes sectaires sous la forme de "groupes K", de cercles de lecture, de comités, etc. qui avaient en commun de travailler sur des questions intellectuelles de détail, de se prétendre radicaux ou extrêmes malgré leur totale passivité et d'être (sans surprise) hostiles les uns aux autres. Martin Sellner aura étudié de près cette fragmentation induite par l'intellectualisme et, conscient de son immense hétérogénéité idéologique et de la proportion élevée de trublions et de "grifters" qui lui est propre, il voudra épargner à la droite le sort de la gauche radicale après 1968. C'est louable, mais ce faisant, il dépasse l'objectif. Il verse l'enfant intellectuel de droite en même temps qu'il tente honorablement de verser le bain de la gauche académique.

La droite a besoin de plus de débats !
En conséquence, cette critique doit se conclure par un plaidoyer pour une droite pluraliste et créative. Une droite qui, bien entendu, intègre et soutient un mouvement activiste fort en tant que partie intégrante de la mosaïque de la droite, mais qui s'oppose à ce que ce mouvement fasse valoir une "compétence directive" vis-à-vis des autres parties du camp. Il semble aberrant qu'un plus grand pluralisme interne au sein de la droite puisse détourner l'attention de l'objectif principal généralement accepté, à savoir assurer la pérennité du peuple. Actuellement, les partis de droite deviennent de plus en plus souvent des représentants des intérêts des peuples respectifs des États. Ce processus doit être compris comme le corollaire naturel de la fragmentation ethnique croissante et de l'envahissement par les étrangers. La réalité de plus en plus évidente du Grand Remplacement entraîne une prise de conscience ethnique, la transformation des partis populistes de droite en partis ethniques et l'opposition des groupes nationaux aux groupes étrangers. Ce front peut être retardé, mais pas arrêté, par des crises (externes) et des fronts transversaux temporaires. En effet, elle ne trouve pas sa racine dans une volonté ou une décision politique (collective), mais dans la nature humaine. En conséquence, malgré le scepticisme de rigueur quant à la valeur explicative des théories sociobiologiques et d'éthique humaine, un recours occasionnel à des concepts tels que le comportement territorial et la peur de l'étranger aurait été bénéfique aux explications de l'auteur. Poussée par des chocs ethniques de plus en plus importants à des intervalles de plus en plus courts, la droite se focalisera de plus en plus sur le Grand Remplacement et ses conditions directes de facilitation. Le véritable art consiste à l'élargir sur le plan thématique.
L'accent mis par Sellner sur la démographie semble ici relever de la pensée "beaucoup d'aide pour beaucoup", qu'il rejette pourtant tant. Mais si 2.000 militants contre le Grand Remplacement distribuent des tracts et collent des affiches au lieu de 1.000, l'effet n'est pas double. Au lieu de plus de flyers et de sites web sur le problème de la démographie, la droite a besoin de plus et de meilleurs débats sur la géopolitique, l'ordre économique, la protection de la nature, la politique éducative, le transhumanisme, les études de genre, l'architecture ou l'éthique. Elle a besoin de l'écologiste hirsute de la vieille école qui veut désormais empêcher non seulement les routes de contournement mais aussi les éoliennes, de l'intello génial qui travaille dans sa cave sur des recherches révolutionnaires sur la bataille des chars de Prokhorovka et sur l'histoire économique de la Saxe Kursawa, de l'ex-féministe désabusée qui se bat désormais avec passion contre le "wokisme" et le translobby et du renégat de gauche que l'étroitesse d'esprit des cercles intellectuels de gauche a poussé vers la droite. Et surtout, la droite doit se défaire de l'illusion qu'elle peut remettre à plus tard, c'est-à-dire après l'arrivée espérée au pouvoir, toutes les questions essentielles en dehors de l'objectif principal commun. Si tel était le cas, la large alliance de circonstance se déchirerait immédiatement après sur toutes sortes de questions et le pouvoir tout juste conquis s'effriterait entre les doigts.
Une réponse convaincante
Dès le 14 mars 2023, soit une semaine seulement après la grande manifestation de Tbilissi, la "femme au drapeau européen", comme est présentée la Géorgienne, est assise dans un studio de télévision de Radio Free Europe (RFE) et parle avec éloquence, dans une vidéo, de l'événement qui l'a rendue célèbre en Occident. Il s'agit d'une production sur papier glacé qui trouvera son public sur Youtube. "Radio Free Europe" est un média américain basé à Prague, considéré par les critiques de gauche comme de droite comme un instrument de propagande du gouvernement américain proche de la CIA et destiné à préparer des révolutions de couleur. Des liens tout aussi évidents existent également entre l'opposition géorgienne et le National Endowment for Democracy (NED), une organisation qui, selon son ex-président Allen Weinstein, fait publiquement ce que la CIA faisait auparavant en secret. La RFE et la NED reçoivent toutes deux des fonds directs du budget fédéral américain, une source de financement quasiment inépuisable.
Reste à savoir si, contrairement aux mouvements d'opposition pro-occidentaux d'Europe de l'Est et d'Asie, la droite ne doit pas miser sur une stratégie de changement social ou de changement de régime par le biais de la métapolitique et des formes de protestation, dans l'esprit de Gene Sharp, alors qu'elle n'a pas d'oligarques milliardaires, d'ONG proches de l'État et de superpuissance derrière elle, mais qu'elle a contre elle les élites nationales, les ONG proches de l'État et une superpuissance. Il n'y aura jamais de réponse définitive à une telle question. Mais il est possible d'y répondre de manière convaincante. C'est exactement ce que fait Martin Sellner dans Regime Change von rechts - et il conseille avec passion et pour de nombreuses bonnes raisons cette stratégie qu'il appelle "Reconquista". La droite devrait suivre son conseil.
Commandez maintenant : Martin Sellner - Regime Change von rechts. Eine strategische Skizze: ): https://www.freilich-magazin.com/shop/regime-change-von-rechts-eine-strategische-skizze?prevPath=/shop/buecher/antaios
A propos de l'auteur :
Simon Dettmann, né en 1993, a étudié la philosophie et l'histoire dans une université d'Allemagne de l'Ouest. Ses domaines d'intérêt incluent la philosophie politique, l'éthique et l'architecture
15:03 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martin sellner, nouvelle droite, neue rechte, nouvelle droite allemande, allemagne, autriche, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 juillet 2024
Kickl: "Les discussions d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine sont une folie politique"

Kickl: "Les discussions d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine sont une folie politique"
Le président du FPÖ, Herbert Kickl, a vivement critiqué la décision d'entamer des pourparlers d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine alors que le pays est toujours en état de guerre active et qu'il est loin de remplir les critères de Copenhague requis.
Source: https://zurzeit.at/index.php/kickl-eu-beitrittsgespraeche-mit-ukraine-sind-politischer-wahnsinn/
"Admettre dans l'UE un pays en pleine guerre et en proie à une corruption rampante est un exemple parfait des dérives impulsées par les élites bruxelloises et le parti unique noir-vert-rouge-pink", a déclaré Kickl dans un communiqué de presse.
Il a notamment critiqué le chancelier Nehammer, membre de l'ÖVP chrétienne-démocrate, qui a omis d'opposer le veto autrichien à l'ouverture des discussions, ce qui aurait été dans l'intérêt de la sécurité et de la prospérité de la population autrichienne. "Au lieu de cela, Nehammer joue les claqueurs pour les projets politiques délirants de l'establishment de l'UE au détriment de sa propre population, comme dans le cas du régime de sanctions qui, avec le 14ème paquet récemment adopté, ne met pas fin à la guerre mais détruit notre économie et notre prospérité", poursuit Kickl.
Le FPÖ considère que la politique de neutralité active est la seule politique étrangère valable pour l'Autriche et souligne la nécessité de la rétablir complètement. "La neutralité perpétuelle, massivement érodée par le gouvernement noir-vert sous les applaudissements de la SPÖ et du parti NEOS, doit être restaurée dans l'intérêt de notre population. C'est ce que les citoyens attendent d'un chancelier fédéral et c'est ce qu'un chancelier du peuple libéral s'efforcerait de faire depuis le début", a conclu M. Kickl.
18:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, autriche, herbert kickl, mitteleuropa, europe danubienne, neutralité, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 30 mai 2024
Ce qu'il faut savoir sur la nouvelle droite allemande - Entretien avec Martin Lichtmesz

Ce qu'il faut savoir sur la nouvelle droite allemande
Entretien avec Martin Lichtmesz
Source: https://magyarjelen.hu/mit-kell-tudni-a-nemet-uj-jobbolda...
La Nouvelle Droite (Neue Rechte) est une école de pensée et un réseau organisationnel vaguement défini qui vise à faire revivre et à réinterpréter de manière constructive la tradition conservatrice de la droite allemande, en opposition à l'ordre libéral américanisant qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Elle se situe à la droite des partis centristes de droite CDU/CSU et, dans un sens, va au-delà du populisme de droite (AfD, PEGIDA) et du radicalisme de droite (par exemple, Die Heimat). En tant qu'école de pensée, elle est à la fois « postérieure » et « antérieure » à ses antécédents politiques et idéologiques du 20ème siècle. Elle a été fondamentalement influencée par les penseurs et les théories de la Révolution conservatrice allemande et de la Nouvelle Droite française. Une différence importante, cependant, est que cette dernière est basée sur un retour au paganisme, alors que le mouvement allemand est (principalement) basé sur le christianisme. Dans l'entretien suivant avec Martin Lichtmesz, membre autrichien éminent de la Nouvelle Droite allemande, nous discutons de son parcours personnel, de son travail de traducteur et d'écrivain, de la Nouvelle Droite allemande, de l'Europe centrale et des possibilités offertes par la politique. L'entretien avec Balázs György Kun peut être lu ci-dessous.

- Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
- Je suis né à Vienne en 1976, j'ai vécu à Berlin pendant quatorze ans et je suis retourné dans mon pays d'origine, l'Autriche, il y a une dizaine d'années. Depuis 2005, j'écris pour des magazines et des revues allemands de droite, tant sur papier qu'en ligne. Actuellement, je contribue principalement au blog et au magazine bimensuel Sezession, ainsi qu'à l'Institut für Staatspolitik (Institut pour la politique de l'État) en Allemagne. En plus d'écrire des livres sur des sujets tels que la politique, la culture et la religion, j'ai traduit plusieurs textes du français et de l'anglais, dont le plus réussi est la célèbre dystopie sur l'immigration de Jean Raspail, Le Camp des saints. Je suis associé à la branche autrichienne de Génération identitaire (GI), bien que je ne participe pas à ses activités. Il m'arrive de faire du streaming avec mon ami Martin Sellner. J'apparais aussi parfois sur des chaînes anglophones.
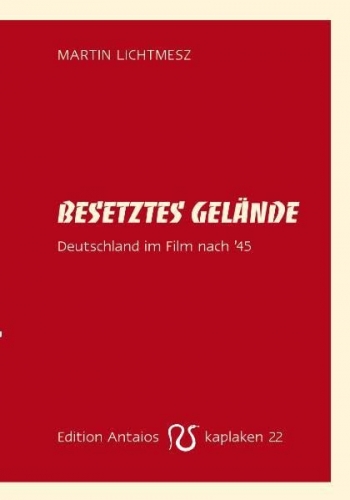
- Vous avez beaucoup écrit sur les films sur le site Sezession et vous avez également publié un livre sur le cinéma allemand après 1945 (« Besetztes Gelände. Deutschland im Film nach '45 »). Quel est votre réalisateur hongrois préféré et pourquoi ?
- En fait, je connais très peu le cinéma hongrois... Plusieurs films de Miklós Jancsó ont eu une grande influence sur moi, en particulier Csillagosok, katonák (1967). Sátántangó (1994) de Béla Tarr a été une expérience époustouflante, bien que sombre et épuisante. J'ai assisté à deux projections complètes de ce film, ce qui est un véritable test d'endurance puisqu'il dure près de huit heures à un rythme très lent et « hypnotique ». J'ai également apprécié My 20th Century (1989) d'Ildikó Enyedi. J'ai particulièrement aimé la scène où l'acteur autrichien Paulus Manker reprend son rôle de philosophe misogyne Otto Weininger, un rôle qu'il avait déjà joué dans son propre film de folie Weiningers Nacht. Je viens de remarquer, en passant, que les trois films que j'ai mis en évidence sont en noir et blanc.
- Comment décririez-vous la Neue Rechte à nos lecteurs ?
- Il s'agit d'un terme générique, non dogmatique, pour désigner le spectre de la droite « dissidente » et non conventionnelle en Allemagne. Il est surtout utilisé comme un terme générique pratique, et tous ceux qui sont classés dans cette catégorie ne l'apprécient pas ou ne l'acceptent pas. Il fait généralement référence aux personnes ayant des opinions « identitaires », ethno-nationalistes. Parmi les personnes orientées idéologiquement, nous trouvons très souvent ce que nous appelons des « Solidarpatrioten », qui optent pour une position patriotique dans leur approche des questions socio-économiques, qui critiquent le libéralisme du marché libre et les autres variantes du libéralisme. Une position « anti-atlantiste » est très courante dans ce milieu: il s'agit d'un souverainisme qui vise à libérer l'Allemagne de la domination américaine sur le long terme (de manière réaliste, donc à très long terme). Elle est également souvent utilisée comme auto-désignation par ceux qui souhaitent se démarquer des groupes restants de la « Alte Rechte » (« vieille droite »), qui forment un milieu très différent et se caractérisent par leur attachement à certaines nostalgies historiques, à certains symbolismes et à certaines idéologies que la nouvelle droite rejette. Il y a aussi beaucoup de recoupements récents avec le phénomène du « populisme de droite », qui monte en puissance depuis 2015 (au moins), même s'il n'est certainement plus à son apogée.


Götz Kubitschek et son épouse Ellen Kositza dans leur propriété à Schnellroda.
Le quartier général de la « nouvelle droite » en Allemagne se trouve aujourd'hui à Schnellroda, un petit village de Saxe-Anhalt, où se trouve le « manoir » de Götz Kubitschek, une demeure séculaire restaurée, qui abrite la maison d'édition Antaios Verlag, qui fait date depuis assez longtemps. Avec Erik Lehnert, Kubitschek organise des « académies » où de jeunes militants de droite allemands, autrichiens et suisses se réunissent pendant un week-end pour nouer des contacts communautaires et professionnels, écouter des conférences et des discours et participer à des discussions approfondies sur des sujets spécifiques. En septembre dernier, par exemple, le thème principal était la « propagande » sous tous ses aspects.
D'autres académies se sont penchées sur la géopolitique, l'anthropologie, l'architecture, « l'avenir de l'État-nation et de l'Europe », « l'État et l'ordre », « la politique des partis », « la violence », « la faisabilité » ou une discussion générale sur la situation politique actuelle. Les présentations sont d'une grande qualité intellectuelle et visent à couvrir autant d'aspects que possible du sujet. Cependant, il ne s'agit pas d'une « tour d'ivoire » philosophique et théorique, mais également d'une formation à des fins politiques et stratégiques pratiques. De nombreux participants travaillent au sein de l'AfD (Alternative für Deutschland), le parti d'opposition patriotique le plus important et le plus performant d'Allemagne. Il s'agit en particulier d'une partie importante de l'AfD des Länder « de l'Est », qui entretient de très bonnes relations et de très bons contacts avec Schnellroda.
Naturellement, le « pouvoir en place (et contesté) » n'aime pas cela et tente de faire pression sur ces organisations et réseaux indésirables, notamment par le biais des activités du « Bundesamt für Verfassungsschutz », l'« Office fédéral pour la protection de la Constitution », une institution créée par l'État pour diaboliser et diffamer toute opposition politique. En résumé, lorsque les Allemands parlent aujourd'hui de la « Neue Rechte », ils pensent surtout au réseau autour de Schnellroda, qui se compose d'identitaires, de membres de l'AfD, d'éditeurs indépendants, d'initiatives, de médias, de libres penseurs et d'« influenceurs ». Tous ne partagent pas les mêmes positions, mais ils ont une vision commune de base.
- La Nouvelle Droite (française) a une forte influence en dehors de la France et du monde francophone. La situation est-elle similaire pour la Neue Rechte? Dans l'affirmative, pouvez-vous citer quelques penseurs, hommes politiques et organisations qui ont été influencés par cette « école de pensée » en Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays ?
- Pour être honnête, je ne pense pas qu'elle ait eu beaucoup d'influence, voire aucune, en dehors de l'Allemagne, car très peu de nos écrits ont été traduits. Certaines actions de GI ont probablement été une source d'inspiration au niveau international, par exemple lorsqu'ils ont escaladé la porte de Brandebourg en 2016 et ont affiché une bannière disant « Secure Borders, Secure Future » (frontières sûres, avenir sûr). Nous sommes certainement en contact avec des personnes partageant les mêmes idées dans de nombreux autres pays européens, tant à l'Est qu'à l'Ouest, ainsi qu'aux États-Unis et en Russie. Cependant, une influence allemande plus importante est à l'œuvre en arrière-plan, car la Nouvelle Droite et la Neue Rechte ont toutes deux de fortes racines idéologiques dans ce que l'on appelle la « révolution conservatrice » des années 1920 et 1930 : les noms de célèbres penseurs classiques tels qu'Oswald Spengler, Carl Schmitt, Ludwig Klages, Ernst Jünger ou Martin Heidegger me viennent à l'esprit.
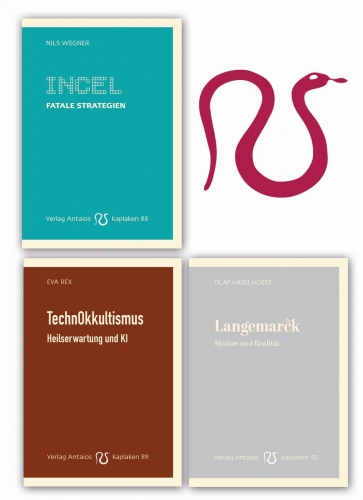
- Pouvez-vous nous présenter brièvement la maison d'édition Antaios ? Quels sont les livres que vous publiez ? Vous en avez cité quelques-uns qui vous paraissent importants.
- Antaios existe depuis plus de vingt ans. L'éventail des livres publiés est très large : ouvrages théoriques, essais, romans, débats, réflexions philosophiques, interviews ou monographies sur des penseurs et écrivains importants (Ernst Nolte, Georges Sorel, Armin Mohler, Mircea Eliade ou Nicolás Gómez Dávila, pour n'en citer que quelques-uns). Bien sûr, les thèmes habituels de la droite sont au centre : l'immigration de masse, le « grand remplacement », l'identité ethnoculturelle et l'analyse de la myriade de têtes d'hydre que constituent nos ennemis : la théorie du genre, l'antiracisme, le mondialisme, le transhumanisme, la technocratie ou le « cotralalavidisme ». Une série populaire et à succès est celle des « Kaplaken » : des livres courts qui tiennent confortablement dans une poche, écrits par différents auteurs sur différents sujets. Ils constituent une expérience de lecture rapide, instructive et souvent divertissante, un cadeau idéal pour éclairer et égayer amis et parents, et sont très recherchés par les collectionneurs. La série a publié jusqu'à présent 87 volumes.
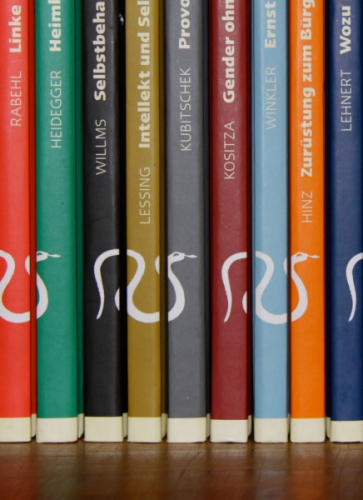
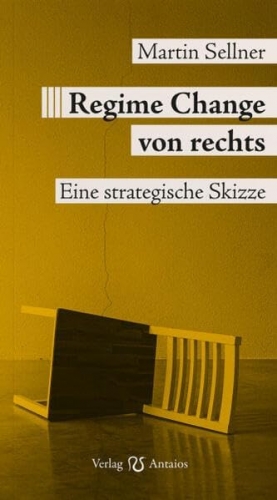
Il est difficile d'identifier les « plus importants », tant ils sont nombreux, et je suis certainement un peu partial. Deux ouvrages théoriques ont été publiés récemment et ont été bien accueillis par les lecteurs : Politik von rechts (« Politique de droite ») de Maximilian Krah, homme politique de l'AfD, tente de définir l'essence et les contours de la politique de droite aujourd'hui, tandis que Regime Change von rechts (« Changement de régime de droite ») de Martin Sellner est une esquisse impressionnante et approfondie des stratégies métapolitiques nécessaires au changement en Allemagne et en Europe occidentale, ce qui, à ma connaissance, n'a jamais été fait auparavant sous une forme aussi détaillée et concrète. Parmi les autres ouvrages très influents, citons Solidarischer Patriotismus (« Patriotisme solidaire ») de Benedikt Kaiser et Systemfrage (« La question du système ») de Manfred Kleine-Hartlage, une analyse tranchante de la difficile question de savoir si le changement est possible dans le cadre du système politique actuel (apparemment condamné) (l'auteur nie que ce soit possible).
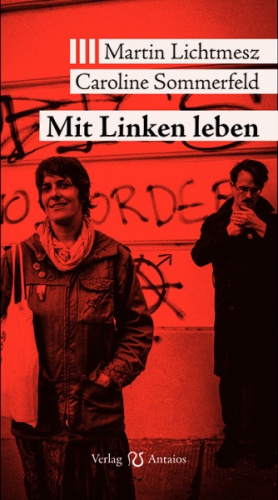
Mit Linken leben (« Vivre avec la gauche ») de Caroline Sommerfeld et moi-même a également été un « best-seller » dans notre gamme, une sorte de « manuel de survie » pour les personnes ayant des opinions « erronées », conçu pour aider à gagner les débats, à s'omposer dans les débats, à s'orienter politiquement, à démasquer les absurdités de la gauche, à comprendre ses « types » et sa psychologie, et surtout à faire face aux pressions sociales dans la famille, au travail, à l'école, à l'université, dans les amitiés, etc. Son ton est plus "léger" que celui de la plupart de nos livres, et il contient même des conseils de drague pour les gens de droite ! Il a été publié en 2017, au plus fort de la vague ”populiste“ consécutive à la "crise des migrants", et je dois avouer que certaines parties me semblent déjà un peu désuètes et datées, comme si elles étaient maintenues dans une capsule temporelle. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé est Tristesse Droite, publié en 2015, qui documente quelques soirées au cours desquelles un petit groupe de défenseurs de la Nouvelle Droite (dont je faisais partie) s'est réuni à Schnellroda pour avoir une longue discussion ouverte - comme nous le disons - « sur Dieu et le monde », qui a duré des heures et a donné lieu à un livre très inhabituel, qui donne à réfléchir et qui est très intime.
- Avez-vous des projets de livres ou de traductions en cours ? Quels sont ceux que vous considérez comme les plus importants ?
- Il y a un projet majeur sur lequel je travaille depuis un certain temps et qui prendra encore plus de temps. Il s'agit d'une sorte de lexique des films que je considère comme importants ou valables d'un point de vue de droite. Je ne parle pas nécessairement de films « de droite » (il y en a peu qui peuvent être classés comme tels à 100 %), mais de films qui ont une valeur historique, intellectuelle et esthétique pour la pensée de droite. Ce projet s'est transformé en une sorte de projet gigantesque, car je me suis retrouvé avec environ 200 films que je voulais inclure. J'aimerais également ajouter quelques réflexions générales sur la question et la politique de la censure, la responsabilité de l'artiste, les tensions et les points communs entre l'art et l'idéologie, les bons et les mauvais côtés de la culture de masse (je pense qu'il y a des bons côtés), et le présent et l'avenir du visionnage de films à une époque entièrement numérique où le cinéma classique, du moins tel que je le conçois, est en train de mourir.
J'ai un livre plus ancien à mon actif, qui était en fait mon tout premier ouvrage, et que je considère toujours comme un bon travail (il appartient à d'autres de décider à quel point), intitulé « Besetztes Gelände » (« Territoire occupé », 2010), et qui est essentiellement un essai long mais tendu et poignant sur la représentation cinématographique de l'histoire, avec un accent particulier sur la Seconde Guerre mondiale et le rôle de l'Allemagne.
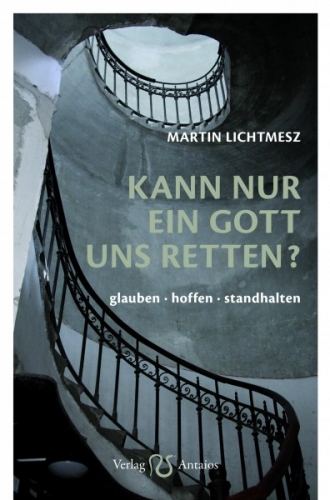
Toutefois, à mon humble avis, mon livre le plus « important » et le plus ambitieux est « Kann nur ein Gott uns retten ? » (« Seul un Dieu peut-il nous sauver ? »). Il s'agit d'une méditation très profonde, forte de 400 pages, sur la nature de la religion et sa relation avec la politique (pour le dire de manière un peu simpliste), d'un point de vue (principalement) catholique ou plutôt (si j'ose dire) « catholicisant » (j'étais très influencé à l'époque par des auteurs comme Charles Péguy et Georges Bernanos). Néanmoins, je ne me considère pas comme un « vrai » catholique et je reste un « chercheur » plutôt qu'un « croyant ». Quoi qu'il en soit, j'ai mis toute ma vie et tout mon cœur dans cet écrit, et il s'agit avant tout d'une confession assez personnelle, même si j'ai essayé de la dissimuler autant que possible. Aussi, si un traducteur était intéressé, j'apprécierais beaucoup, car je ne pense pas avoir été capable d'aller au-delà de cet écrit.
- Legatum Publishing publiera prochainement une traduction anglaise de votre livre Ethnopluralismus (« Ethnopluralisme »). Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et sur sa pertinence ? Pourquoi le livre et l'idée d'ethnopluralisme sont-ils importants ? J'ai également une question plus complexe, et peut-être plus provocante, à propos de l'ethnopluralisme. Pour autant que je sache, c'est feu le sociologue et historien Henning Eichberg qui a commencé à utiliser ce terme, qui est rapidement devenu un concept important pour la Nouvelle Droite. Comment se fait-il alors que, selon le site web d'Antaios, vous soyez le « premier à présenter un compte rendu complet de ce concept, de ses possibilités et de ses interprétations erronées » ?
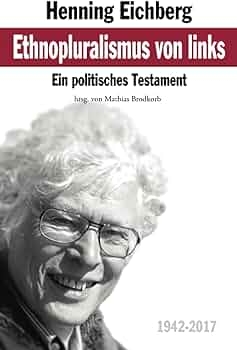 Il s'agit d'un malentendu. « Introduire » le concept ne signifie pas que je l'ai inventé, ni que j'ai inventé le terme « ethnopluralisme », qui a été forgé par Henning Eichberg en 1973 (dans un contexte anti-eurocentrique, anti-colonialiste, plutôt « de gauche »). Le point de mon livre est que l'« ethnopluralisme », comme l'« universalisme », est pluriel. Je veux dire par là qu'il n'y a jamais eu une seule théorie ou un seul principe contraignant portant ce nom, mais plutôt différentes « versions » qui ne sont pas nécessairement désignées par ce terme. Mon livre est le premier à fournir une vue d'ensemble critique des théories ethnopluralistes, de leur contexte historique, de leurs éléments centraux et de leurs « prédécesseurs » intellectuels et conceptuels. Ma formule est la suivante : « J'appelle ethnopluralisme tout concept qui défend le nationalisme et l'ethnicité en général comme un bien inhérent ». En tant que position politique, c'est une position que la plupart des nationalistes modernes acceptent aujourd'hui comme principe selon lequel tous les peuples du monde sont considérés comme ayant le « droit » à l'auto-préservation et à l'autodétermination pour défendre leur identité ethnoculturelle contre les excès universalistes et l'uniformisation, communément appelés aujourd'hui « globalisme ».
Il s'agit d'un malentendu. « Introduire » le concept ne signifie pas que je l'ai inventé, ni que j'ai inventé le terme « ethnopluralisme », qui a été forgé par Henning Eichberg en 1973 (dans un contexte anti-eurocentrique, anti-colonialiste, plutôt « de gauche »). Le point de mon livre est que l'« ethnopluralisme », comme l'« universalisme », est pluriel. Je veux dire par là qu'il n'y a jamais eu une seule théorie ou un seul principe contraignant portant ce nom, mais plutôt différentes « versions » qui ne sont pas nécessairement désignées par ce terme. Mon livre est le premier à fournir une vue d'ensemble critique des théories ethnopluralistes, de leur contexte historique, de leurs éléments centraux et de leurs « prédécesseurs » intellectuels et conceptuels. Ma formule est la suivante : « J'appelle ethnopluralisme tout concept qui défend le nationalisme et l'ethnicité en général comme un bien inhérent ». En tant que position politique, c'est une position que la plupart des nationalistes modernes acceptent aujourd'hui comme principe selon lequel tous les peuples du monde sont considérés comme ayant le « droit » à l'auto-préservation et à l'autodétermination pour défendre leur identité ethnoculturelle contre les excès universalistes et l'uniformisation, communément appelés aujourd'hui « globalisme ».
Cette conception prétend avoir surmonté le chauvinisme et le « racisme » de la « vieille droite », qui considérait souvent les autres nations et races comme « inférieures » et donc comme des objets légitimes de conquête, d'asservissement et de colonisation. Au lieu de cela, les autres nations et races sont considérées comme « différentes », sans aucun jugement de valeur, dans une sorte de « relativisme culturel ». Il s'agit d'un nationalisme « défensif » plutôt qu'agressif et envahissant. Il s'agit d'un concept de « vivre et laisser vivre », confronté à une menace historique perçue par toutes les nations et ethnies du monde : un idéal utopique de « monde unique », le rêve de certains, le cauchemar d'autres, dans lequel toute l'humanité est unie sous un seul gouvernement mondial, surmontant toutes les barrières ethniques, raciales et même, de nos jours, de « genre ». Comme l'a dit Alain de Benosit : « Je ne me bats pas contre l'identité des autres, mais contre un système qui détruit toutes les identités ». Guillaume Faye parle, lui, d'un « système qui tue les peuples » et voit dans l'abolition des identités nationales l'aboutissement, la finalité du libéralisme. Ce déracinement ethnique peut prendre plusieurs formes, et l'on peut affirmer - au moins dans une certaine mesure - que la société technologique elle-même conduit inévitablement à la désintégration de la nation et de l'identité ethnoculturelle.
Dans le monde occidental, la manière la plus directe et la plus dangereuse de briser les nations est la politique d'immigration de masse, que Renaud Camus appelle « le grand remplacement ». La position ethnopluraliste, au contraire, souligne que le droit à la patrie et le droit à l'autodétermination doivent prévaloir dans les deux sens: nous, Occidentaux, ne chercherons pas à recoloniser le Sud, mais nous refuserons aussi d'importer le Sud dans notre propre pays.
Cependant, les idées ethnopluralistes n'avaient initialement rien à voir avec la prévention de l'immigration de masse (même dans les années 1970, lorsque Eichberg a développé son concept). Elles remontent au philosophe romantique allemand - et plutôt apolitique - Herder, qui, dès le XVIIIe siècle, était un représentant du mouvement romantique allemand. À la fin du XVIIIe siècle, Herder, philosophe allemand, considérait que la « Volksseele » (« l'âme du peuple », terme qu'il utilisait plutôt que le « Volksgeist », plus familier et plus hégélien) était menacée par l'essor de l'ère industrielle et les idées des Lumières universelles. Au cours du siècle suivant, Herder est devenu le parrain du particularisme et du nationalisme, en concurrence avec les autres grands courants idéologiques de l'époque, le libéralisme/capitalisme et le socialisme/communisme. Même dans ces grandes lignes, il est clair que j'ai une histoire assez longue et compliquée à raconter, et ce n'est que dans les derniers chapitres que j'aborde la Nouvelle Droite française et la Neue Rechte allemande.
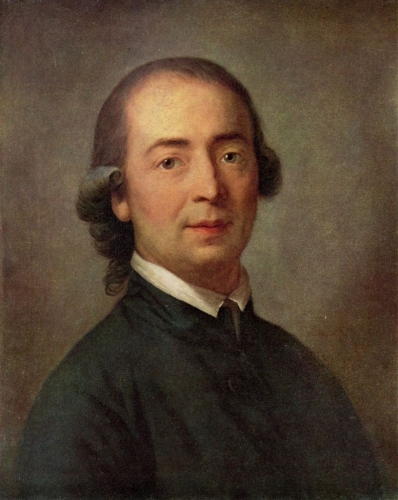
Dans mon livre, je ne parle pas seulement de Herder et de Hegel, mais aussi de la critique païenne et polythéiste du christianisme (qui remonte à l'Antiquité), des « peintures monumentales » de l'histoire mondiale de Gobineau, Spengler et Rosenberg, qui cherchaient à proposer des théories du déclin et de la chute ; les idées de Julius Evola sur la « race intellectuelle » ; la vision de Renan sur la nation ; ou les théories proto-ethnopluralistes et culturalo-relativistes de Franz Boas et Ludwig Ferdinand Clauss. Ce dernier, d'ailleurs, était un théoricien de la race plutôt hétérodoxe qui travaillait dans le cadre du système national-socialiste. J'ai trouvé un certain nombre de parallèles et de chevauchements surprenants entre les deux, que personne, à ma connaissance, n'avait remarqués auparavant. L'une des figures de proue de mon livre est l'ethnologue Claude Lévi-Strauss - un autre penseur qui n'a jamais utilisé cette définition - qui est peut-être le théoricien le plus important de l'« ethnopluralisme » de l'après-Seconde Guerre mondiale. Le cadre que j'utilise pour contextualiser le terme est emprunté au sociologue allemand Rolf Peter Sieferle, qui a écrit des livres qui ont fait date et qui éclairent l'émergence du monde moderne comme peu ont pu le faire.
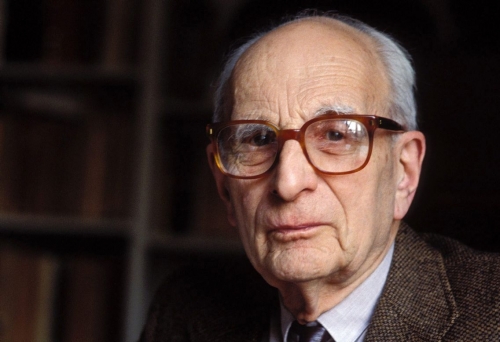
Ce n'est que dans le dernier chapitre que j'exprime mes propres opinions, qui sont très différenciées. Je ne considère pas l'ethnopluralisme comme un concept philosophique vraiment durable et détaillé, et son utilité politique est assez limitée. En revanche, je le considère comme une « idée régulatrice » ayant une valeur essentiellement éthique.
En bref, c'est ce que je pourrais développer ici plus longuement, mais qui peut être mieux compris à partir de mon livre. La version anglaise comportera des mises à jour du texte, des ajouts et des chapitres supplémentaires. En fait, je pense qu'il s'agit d'un sujet qui, à première vue, semble simple, mais qui, en réalité, est très profond. Mon livre tente de donner un aperçu de cette « famille » d'idées et de ses opposants.
- Dans l'ensemble, que pensez-vous de Viktor Orbán en tant qu'homme politique ?
- Je ne peux pas aller trop loin dans ce domaine parce que je ne le connais pas assez bien, mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que pour nous, identitaires d'Europe occidentale, Orbán - malgré ses nombreux défauts, il est vrai - est plutôt un modèle que nous admirons et que nous espérons suivre. La situation politique et métapolitique en Hongrie semble bien meilleure qu'ici. C'est un objectif que nous nous efforçons d'atteindre. D'un autre côté, contrairement à la Hongrie, nous sommes déjà confrontés au problème que notre pays est gravement endommagé par l'immigration de masse et une situation démographique défavorable. Je devrais demander à des Hongrois comme vous ce qui, selon vous, ne va pas avec Orbán et ses initiatives politiques.
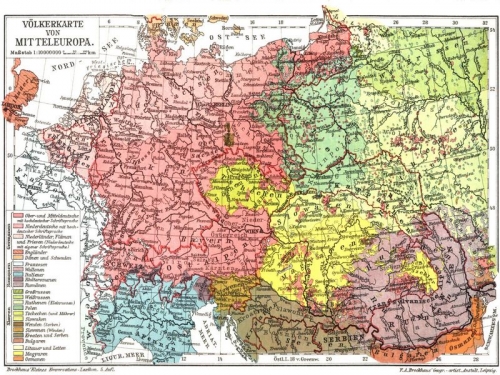
- Que signifie l'Europe centrale en tant que région ou en tant que base d'identité, en tant que strate d'identité, pour la Neue Rechte et/ou pour votre vision personnelle du monde ?
- Je ne peux parler que de ma vision personnelle du monde, et elle est plus sentimentale ou esthétique que purement politique. Il fut un temps où j'espérais que l'Autriche pourrait rejoindre une sorte de bloc de Visegrád « populiste » qui s'opposerait aux politiques mondialistes de l'Union européenne et de la République fédérale d'Allemagne. Cela aurait été, en substance, une sorte de « redémarrage » politique de l'espace autrefois dominé par l'empire des Habsbourg, que je tiens en très haute estime. Aujourd'hui, je crains que cela ne se produise jamais.
Personnellement, même si je me considère comme étant plutôt abstraitement ou historiquement « allemand », mon identité immédiate n'est pas vraiment « teutonne », mais plutôt distinctement autrichienne, avec des sympathies pour l'Est européen. Si je regarde mon arbre généalogique et les noms qui y figurent, je suis en fait un « bâtard de l'empire des Habsbourg », avec des ancêtres (semble-t-il) hongrois, slovènes et tchèques. Pourtant, aussi loin que je puisse remonter, les différentes branches de ma famille sont restées à peu près dans la même zone géographique, ont parlé allemand et sont catholiques depuis au moins deux siècles.
- Pourriez-vous nous donner un aperçu des tendances politiques actuelles en Autriche ?
Je peux honnêtement dire que je trouve la politique autrichienne contemporaine plutôt fatigante, ridicule et ennuyeuse et que je vais rarement voter. Le pays est gouverné par l'ÖVP, un parti pseudo-conservateur/de « centre-droit » corrompu et mafieux qui est bien plus nuisible que n'importe lequel de ses « opposants » de gauche (il est actuellement en coalition avec les Verts). Mon dédain pour eux a pris des proportions démesurées pendant la folie des années Cov id, lorsqu'ils ont terrorisé pratiquement tout le pays, ce qui a au moins suscité une résistance saine, patriotique et « populaire » et une méfiance à l'égard des grands médias, qui sont d'horribles putes du pouvoir - je ne veux pas insulter les vraies prostituées en les comparant aux journalistes, car elles sont plus honnêtes et font au moins du bien à la société.

Le seul choix d'opposition disponible est la FPÖ (« Parti de la liberté »), qui est bien sûr également imparfait, mais qui a au moins un génie au sommet, Herbert Kickl, qui a été vilipendé comme "fou" par les médias il y a deux ans pour s'être opposé par principe aux « confinements » et aux vaccinations obligatoires, mais qui est maintenant - au moins selon les derniers sondages - l'un des hommes politiques les plus populaires d'Autriche. Certains prédisent déjà qu'il sera le prochain chancelier. Je suis plutôt pessimiste à ce sujet et, d'une manière générale, je n'ai guère confiance dans la politique parlementaire, qui ne fait généralement que peu ou pas de différence. Je crains un peu que le Kickl sortant ne déçoive et ne fasse trop de compromis, comme c'est généralement le cas pour tout candidat dont on attend une solution. Je l'admire tellement pour son courage, son intelligence et son honnêteté que j'aimerais qu'il reste « propre », ce qu'il ne peut faire qu'en étant dans l'opposition.
17:11 Publié dans Entretiens, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, neue rechte, nouvelle droite allemande, martin lichtmesz, entretien, allemagne, hongrie, autriche, mitteleuropa |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 14 mai 2024
Neutralité perdue

Neutralité perdue
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/la-neutralita-perduta/
Il était une fois... le pays neutre. Celui qui, par sa constitution, ses lois et ses traditions, ne faisait pas partie de blocs armés, d'alliances ou de pactes militaires. Et qui déclarait explicitement qu'il n'avait pas l'intention de participer à des conflits de quelque nature que ce soit.
Neutre. Mais non désarmé. Ce sont deux choses très différentes. La Suisse a toujours eu une forte organisation défensive. De manière à garantir la neutralité et la sécurité. Favorisée d'ailleurs, aussi et surtout, par sa position géographique.
Et la Suède, autre pays historiquement neutre, a une longue et glorieuse tradition militaire.
La neutralité de certains États a toujours représenté, au cours du siècle dernier, un point fondamental dans les équilibres géopolitiques. En particulier les équilibres européens. En effet, les États neutres représentent des points névralgiques qui permettent de décanter les tensions entre blocs et puissances. Ce sont des chambres de compensation et, en même temps, des zones franches où les adversaires peuvent se rencontrer. Discuter et trouver des accords pour mettre fin au conflit.

Bref, les Neutres représentent une pièce fondamentale de la mosaïque géopolitique. En apparence seulement. Parce qu'elle fait partie de ces éléments qui, s'ils manquent, rendent l'ensemble de l'architecture plus incertaine. Plus exposée à un effondrement désastreux.
Je n'aurais cependant pas dû utiliser le présent pour parler des États neutres. Plutôt un passé proche. Car aujourd'hui, la neutralité a littéralement fondu comme neige au soleil.
La Suède n'est plus neutre. Depuis un certain temps déjà, elle donnait des signes de rapprochement avec l'OTAN. Elle en est devenue membre à part entière.
La Finlande n'est plus neutre. Et c'est encore plus sensationnel. Et plus grave. Car la neutralité d'Helsinki était garantie par un traité entre puissances - Washington et Moscou pour l'essentiel - signé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il avait précisément pour fonction de garantir un État tampon entre les deux rivaux de la guerre froide, dans une zone cruciale de l'échiquier européen.
Un traité qui a été déchiré. De manière unilatérale. Et la Finlande est maintenant non seulement dans l'OTAN, mais elle se prépare à accueillir ses bases et ses quartiers généraux opérationnels.
Un choix qui nous fait apprécier la sagesse différente des hommes qui ont pris les décisions en 45, par rapport à certains aventurismes inconsidérés qui s'affichent de nos jours.
Quant à la neutralité suisse, elle n'est plus qu'une feuille de vigne. Qui couvre à peine la dépendance de plus en plus étroite de Berne à l'égard de l'Occident collectif. Dans les décisions financières, en premier lieu.

Bien sûr... en Europe, il reste l'Autriche. Qui parvient, malgré son appartenance à l'UE, à maintenir une certaine neutralité. Avec difficulté. Et seulement parce qu'elle est trop petite, et essentiellement désarmée, pour vraiment compter.
La stratégie globale de Washington ne permet plus ni n'admet l'existence de pays neutres. Les zones grises de la décantation des tensions deviennent les carreaux d'un nouveau domino. Destiné à encercler l'ennemi, la Russie, comme les anneaux d'un boa constrictor.
Pour l'étouffer lentement.
On l'a vu, et on le voit clairement en Ukraine. Si un accord avait été trouvé à temps pour garantir la neutralité absolue de Kiev, un massacre aurait été évité. Et, peut-être plus important encore, un équilibre dans les relations entre la Russie et l'UE aurait été garanti.
Cela n'a pas été le cas. Et surtout, ce n'était pas censé être le cas. Les Ukrainiens en paient lourdement les conséquences. Et bientôt, nous, Européens, les paierons tous.
20:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, neutralité, suisse, autriche, suède, finlande, otan, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


