Par Bernard PLOUVIER
« La morale de pitié est une morale de décadence »
Leitmotiv nietzschéen des années 1887-1888
Juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une romancière et scénariste d’Hollywood, connue dans les universités américaines pour ses romans réservés à une élite intellectuelle et publiés sous le pseudonyme d’Ayn Rand, voulut se muer en philosophe.
Son double but était de lutter contre le marxisme et de féminiser l’enseignement du très misogyne Friedrich Nietzsche. Elle introduisit sa note personnelle, mélange de cynisme, d’individualisme forcené et d’anarchie morale, le tout servant à justifier l’opposition de la dame à tout ce qui lui déplaisait.
Née Alissia Zinovieva Rosenbaum en 1905, c’était la fille d’un riche pharmacien juif, implanté à Saint-Pétersbourg, ruiné par la Révolution bolchevique. Émigrée aux USA, elle y professera un mépris antisoviétique témoignant de sa grande intelligence. Mais, si elle a pu devenir, durant les années vingt, une étudiante d’université en Ukraine soviétisée, en dépit de son origine bourgeoise, c’est qu’elle avait adhéré de façon enthousiaste au marxisme-léninisme… il serait bon que ses bio-hagiographes y consacrent au moins un chapitre.
La rusée diplômée obtient un visa pour les USA en 1926. C’est donc qu’elle a promis d’espionner pour le Guépéou et qu’elle laisse des otages familiaux en URSS. Elle rompt avec les ignobles de Moscou et de Kiev et s’installe aux USA (New York et Hollywood). Elle y convole, devenant l’épouse d’un Frank O’Connor, passé aux oubliettes de la petite histoire.
L’auteure calme son angoisse existentielle de virago dominatrice, guère heureuse en ménage et pas trop heureuse non plus avec son amant, en fumant énormément, imitant en cela son congénère Sigismond-« Sigmund » Freud.
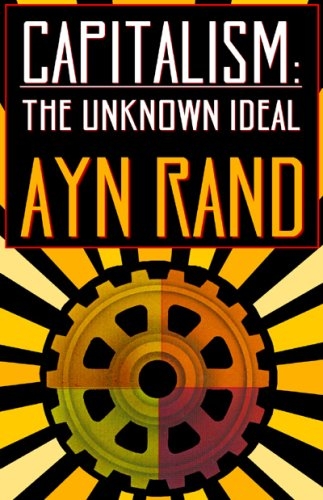 Sa vie bascule durant les années 1945-60, où elle devient une philosophe à la mode, soutenue par quantité de financiers et de littérateurs juifs, cyniques et conquérants. Durant les années 1960, un parent de l’épouse de son amant, Leonard Peikoff, anime le Mouvement objectiviste, à la gloire de la Dame.
Sa vie bascule durant les années 1945-60, où elle devient une philosophe à la mode, soutenue par quantité de financiers et de littérateurs juifs, cyniques et conquérants. Durant les années 1960, un parent de l’épouse de son amant, Leonard Peikoff, anime le Mouvement objectiviste, à la gloire de la Dame.
De 1950 à 1980, se multiplient les revues à brève durée de vie diffusant ses idées, dont les articles sont presque tous rédigés par des Juifs des deux sexes. Les admirateurs d’Ayn Rand ressemblent à ceux de Freud en ce sens qu’ils sont divisés en différentes chapelles, toutes dirigées par un grand-prêtre adoubé par la Diva. Elle meurt en 1982 et son école subit un passage à vide jusqu’au renouveau des années 2000, où triomphe l’ultra-capitalisme.
Quel est donc l’enseignement de la dame ? Assez éloignée de bien des idées nietzschéennes, elle paraphrase en réalité un contestataire d’Arthur Schopenhauer : « Max Stirner », authentique génie – ce qui ne signifie nullement qu’il ait été bienfaisant – et raté social, mort en 1856.
Johann-Caspar Schmidt, plus connu sous le pseudonyme de « Max Stirner », fut le vrai nihiliste moral du XIXe siècle. Dans son maître livre de 1845, L’Unique et sa propriété, il commence par démolir fort intelligemment la sanctification des idées générales et la glorification des théories fumeuses, affirmant, ce qui est fort juste, que l’homme, par sa complexité, se situe bien au-dessus d’elles… cela n’est guère original et rappelle les thèses du franciscain Guillaume d’Ockham (mort en 1347) qui avait scandalisé les universitaires de son époque, en s’opposant aux catégories d’Aristote, qu’il considérait comme des généralisations abusives – il les nommait des Universaux, estimant qu’il n’existe que des cas singuliers. De « Stirner », on peut retenir la nécessité du tri, volontairement effectué par tout individu intelligent, dans les conventions morales de son époque.

L’originalité de « Stirner » vient de sa conclusion : il nie la notion d’intérêt collectif, au profit du culte du moi. « Il n’est rien au-dessus de Moi… Je ne reconnais d’autre source du Droit que Moi-même… Devenez des égoïstes. Que chacun de vous devienne un Moi tout-puissant » (l’abus des majuscules figure dans le texte de « Stirner »… c’est un tic rédactionnel que Nietzsche reprendra durant les années 1880-88, quand sa paranoïa virera au délire).
C’était une réponse à l’un des essais majeurs d’Arthur Schopenhauer : Le fondement de la morale, paru en 1840 (Über die Grundlage der Moral). Un an après la mort du grandiose Arthur survenue en 1860, ses admirateurs ont fusionné l’essai avec celui paru en 1839 : La Liberté de la volonté humaine, et l’ensemble fut édité maintes fois depuis 1861 sous le titre : Les deux problèmes fondamentaux de l’éthique
Dans le court essai de 1840, Schopenhauer classait les deux archétypes humains selon leur motivation principale : l’égoïsme et la joie de nuire versus l’altruisme et la pitié. Tout était dit, en peu de pages, et l’on s’étonne que depuis 150 ans l’on continue d’accumuler, sans grand intérêt pour le lecteur, les publications à orientation religieuse ou philosophique consacrées aux principes moraux.
Certes, il faut compléter et moduler ce jugement. Un individu varie de comportement selon l’humeur du moment, l’occasion ou encore l’ambiance générale de l’opinion publique façonnée par les media. Mais il est indéniable que, depuis toujours, les humains, tous sexes et âges confondus, s’agitent en oscillant d’un pôle à l’autre, et les grands initiés de la foi ou les demi-dieux de la réflexion philosophique n’y ont rien changé, la génétique de chaque individu faisant presque tout.
Reprenant un thème voltairien, Schopenhauer considère les actes d’authentique altruisme comme étant seuls des actes moraux, car dénués d’égoïsme. La pitié est indispensable à la vie en société, car « la souffrance est le fond de toute vie » (c’était l’un des leitmotiv de son pavé Le monde comme volonté et représentation, de 1818). La véritable volonté de l’être humain, et ce qui fait sa noblesse, est le refus de céder devant la souffrance ; c’est grâce à cette volonté que la souffrance, physique ou morale, trouve sa justification métaphysique.
L’athée Schopenhauer se moque de la rhétorique chrétienne d’Augustin (dans Les confessions), où l’on prétend qu’il n’existe aucun mal, si grand fût-il, que la divinité ne puisse en faire jaillir un bien. Pour le grand Arthur, c’est l’homme qui, par sa noblesse, peut seul combattre le mal. L’altruisme est la volonté de lutter, gratuitement autant qu’efficacement, contre la souffrance d’autrui.
« Stirner » écrit en 1845 que l’altruiste n’est qu’un égoïste qui cherche un plaisir d’esthète dans la satisfaction procurée à autrui… il décrivait avec plus d’un siècle d’avance le Charity business des canailles d’affaires, parfois doublées de crapules sexuelles. Il est possible que le ratage intégral de sa carrière socio-professionnelle ait déterminé le cynisme de « Stirner », repris et amplifié par le Nietzsche des années 1880 et suivantes.
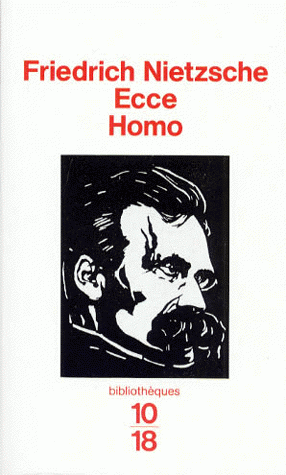 « Je reproche aux miséricordieux de manquer facilement de pudeur, de délicatesse, de ne pas savoir garder les distances. La compassion prend trop vite l’odeur de la populace. Surmonter la pitié, c’est une vertu aristocratique » (Nietzsche, Ecce Homo, de 1888). La compassion est une « valeur amorale » et la charité – le don gratuit, sans espoir de réciprocité – une « morale d’esclaves »… une autre analyse en ferait plutôt une valeur de Seigneur moral ! « Les horreurs de la réalité sont infiniment plus nécessaires que ce petit bonheur qu’on appelle “la bonté” », cette bonté que Friedrich, solitaire, aigri par son insuccès en terres germaniques, assimile à un hédonisme moral (même source). Il fait de la magnanimité une « vengeance sublimée »… alors qu’elle est surtout une forme subtile de mépris.
« Je reproche aux miséricordieux de manquer facilement de pudeur, de délicatesse, de ne pas savoir garder les distances. La compassion prend trop vite l’odeur de la populace. Surmonter la pitié, c’est une vertu aristocratique » (Nietzsche, Ecce Homo, de 1888). La compassion est une « valeur amorale » et la charité – le don gratuit, sans espoir de réciprocité – une « morale d’esclaves »… une autre analyse en ferait plutôt une valeur de Seigneur moral ! « Les horreurs de la réalité sont infiniment plus nécessaires que ce petit bonheur qu’on appelle “la bonté” », cette bonté que Friedrich, solitaire, aigri par son insuccès en terres germaniques, assimile à un hédonisme moral (même source). Il fait de la magnanimité une « vengeance sublimée »… alors qu’elle est surtout une forme subtile de mépris.
« Périsse les faibles et les ratés : premier principe de notre amour pour les hommes. Et qu’on les aide à disparaître… S’il m’est démontré que la dureté, la cruauté, la ruse, la témérité, la pugnacité sont de nature à augmenter la vitalité de l’homme, je dirais oui au mal et au péché » (L’Antéchrist, 1888).
L’éthique nietzschéenne a un but très différent de « l’éthique de l’Humanité supérieure » vantée par notre auteure Ayn Rand. L’antimorale chrétienne de Friedrich est fondée sur l’honneur et sur le sacrifice du bonheur que s’impose le héros au profit d’un but lointain : l’éclosion de la surhumanité, cette surespèce, forte et belle, physiquement et intellectuellement plus douée, mais aussi plus rude, dégagée de toute sensiblerie. « Il est des problèmes plus élevés que ceux du plaisir, de la souffrance et de la pitié. Toute philosophie qui s’arrête là est une naïveté » (in Par-delà bien et mal, de 1885-1886). « L’homme a tant à faire pour lui-même que, chaque fois qu’il agit pour autrui, il se rend coupable de grave négligence » (in Volonté de Puissance)… ou l’altruisme envisagé comme un gaspillage de temps et d’énergie.
Volonté de Puissance est une œuvre composée après la mort de Nietzsche par sa sœur et d’autres admirateurs à partir d’études, de fragments disjoints et d’aphorismes, datés de 1882 à janvier 1889, et publiée en 1901, augmentée en 1906. En 1886, Nietzsche voulait ajouter en sous-titre : Essai d’une transmutation de toutes les valeurs. On peut la considérer comme la quintessence de la pensée nietzschéenne – et dans ce cas, cette pensée est pré-hitlérienne, qu’on le veuille ou non – ou comme une « trahison » de son œuvre par Elisabeth Förster-Nietzsche… ce qui s’apparente à un pieux mensonge de précieux ridicules de la philosophie.
Comme à l’accoutumée, Sigismond-« Sigmund » Freud – un bourgeois solidement établi, empêtré dans les problèmes sexuels, les siens et ceux de sa famille de pédophiles incestueux (voir notre livre sur Freud de 2016) – erre totalement avec son surmoi, qui n’aurait pour but que de réprimer les deux pulsions élémentaires qui font le charme et l’originalité de sa pensée : le plaisir (qui, selon lui, est essentiellement sexuel) et le jeu avec la mort (Freud, 1920). Avec cette conception réductrice de la surconscience, on crée peut-être la variété la plus célèbre de la supercherie psychanalytique, mais le fondement éthique est bien mince.
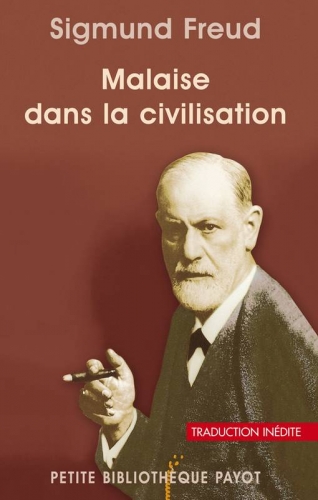 Dans son Malaise dans la civilisation (texte de 1930), le gourou de Vienne, alors en perte de vitesse, étant très contesté par ses concurrents et ses ex-élèves, écrit l’une des perles dont il a le secret : « Tout renoncement à une pulsion devient une source d’énergie pour la conscience », alors qu’elle ne fait généralement qu’alimenter la puissance d’une autre pulsion. Ne pas reprendre du gâteau fut une source d’intime satisfaction pour le stoïcien romain ; ne pas violer une jolie femme restera toujours une source d’honneur pour un homme.
Dans son Malaise dans la civilisation (texte de 1930), le gourou de Vienne, alors en perte de vitesse, étant très contesté par ses concurrents et ses ex-élèves, écrit l’une des perles dont il a le secret : « Tout renoncement à une pulsion devient une source d’énergie pour la conscience », alors qu’elle ne fait généralement qu’alimenter la puissance d’une autre pulsion. Ne pas reprendre du gâteau fut une source d’intime satisfaction pour le stoïcien romain ; ne pas violer une jolie femme restera toujours une source d’honneur pour un homme.
Il ne s’agit d’ailleurs pas de renoncement en valeur absolue, mais d’une hiérarchie des valeurs, adaptée à la surconscience de chacun et au code de lois de la société. C’est ce que ne feront jamais le psychopathe, authentique immature du sens éthique, attaché à la jouissance immédiate, compulsive, de son désir du moment, ni le sociopathe, dépourvu totalement de sens éthique, obnubilé par la joie de révéler sa formidable capacité de nuisance et de malfaisance à un maximum de contemporains… ce qui ressemble quelque peu aux théories de « Stirner » et « Rand ».
Un admirateur anti-individualiste de Schopenhauer et de Nietzsche, devenu un expert – très discuté de nos jours – de l’analyse des comportements sociaux a dit : « L’homme moyen ne voit pas, dans son époque, ce qui affecte la collectivité. Il n’aperçoit généralement que ce qui le gêne lui-même. Les contemporains n’ont que très rarement une conscience exacte de la décadence morale ou politique de leur époque, du moins tant que cette décadence n’envahit pas le domaine de l’économie et de l’emploi » (Adolf Hitler, discours public du 10 mai 1935, in réédition de 2014).
Et cette lutte contre le risque de décadence était d’actualité aux USA de la fin de 1945, une fois éteints les lampions de la victoire. La forme de décadence la plus immédiatement visible s’appelait le marxisme.
L’ultra-capitalisme, qui a détruit les valeurs de notre Occident depuis les années 1980, a été vanté, à ce moment crucial, par Ayn Rand. Cette virago, aussi dynamique qu’intelligente, a fondé un lobby prônant le « capitalisme objectif », implanté dans la citadelle judéo-capitaliste par excellence : New York.
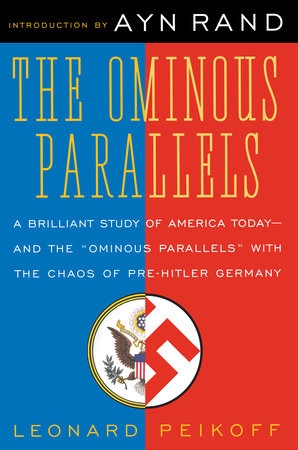 Se réclamant officiellement de « l’objectivité », la dame a fourni à ses lecteurs des analyses très « subjectives » de tout ce qu’elle a traité. Plutôt que les rhapsodies très lyriques de la romancière-philosophe, c’est le pavé de Leonard Peikoff (1991) qui explique le mieux les concepts assez rudimentaires de la dame, qui a tenté d’amalgamer le cynisme de « Stirner » et le délire mégalomaniaque du Nietzsche de ses dernières années d’éveil cérébral aux théories sommaires des économistes ultralibéraux des XVIIIe et XIXe siècles.
Se réclamant officiellement de « l’objectivité », la dame a fourni à ses lecteurs des analyses très « subjectives » de tout ce qu’elle a traité. Plutôt que les rhapsodies très lyriques de la romancière-philosophe, c’est le pavé de Leonard Peikoff (1991) qui explique le mieux les concepts assez rudimentaires de la dame, qui a tenté d’amalgamer le cynisme de « Stirner » et le délire mégalomaniaque du Nietzsche de ses dernières années d’éveil cérébral aux théories sommaires des économistes ultralibéraux des XVIIIe et XIXe siècles.
La dame a vanté les mérites de l’exploitation acharnée du travail d’autrui, libérée de toute entrave d’État. Les « managers » (chefs d’entreprise) devaient être débarrassés de tout contrôle gouvernemental, étant libres de négocier salaires et retraites, d’engager ou de licencier à leur guise… et les homosexuels ou les communistes étaient alors des cibles du patronat US, à l’égal des fainéants ou des incapables. En 1999, soit en pleine euphorie globalo-mondialiste, les postes US émirent un timbre à son effigie.
L’éthique de Dame « Rand » se réduit à « un égoïsme rationnel » – ou rationalisé, comme l’on voudra. Le monde doit être dirigé par les « humains supérieurs » et, dans cette catégorie, les femmes ont autant de droits que leurs mâles. Le féminisme de « Rand » ne devient une conception égalitariste qu’au sein de la caste des surdoués en intelligence et en énergie… et surtout pas des surdoués de la compassion ou de la pitié.
On conçoit que cette part de la doctrine « Rand » ait été mise à mal par la niaiserie écolo-tiers-mondiste du Charity business, lorsque des canailles d’affaires ou des crapules sexuelles ont tenté de se refaire une réputation en investissant une faible partie de leur fortune dans des libéralités fort médiatisées.
Arrivent la pandémie de coronavirus, baptisé Covid-19, et la catastrophe économique induite par le « confinement », imposé par l’OMS à la quasi-totalité des politiciens de la planète, sur recommandation intéressée des dictateurs chinois. Flambent aussitôt un peu partout, les doctrines prônant le splendide isolement, l’égoïsme national, voire l’égoïsme individuel envisagés comme autant de principes pragmatiques et rationnels… et l’on reparle de Dame « Rand ».
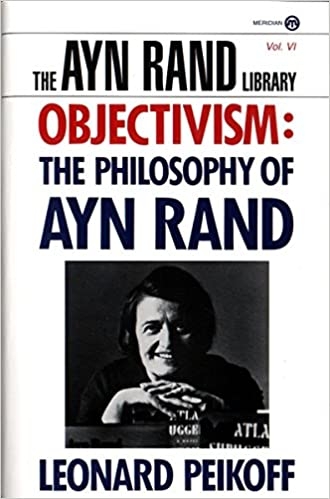 Chaque être humain est libre de butiner là où il trouve son bien, libre également de crier Au génie !, libre de vouloir faire partager son admiration. Toutefois, nier toute valeur à la compassion et repousser l’altruisme et la pitié, au profit de l’individualisme forcené ou d’un darwinisme social quelque peu absurde, ce sont de curieuses attitudes, peu enthousiasmantes.
Chaque être humain est libre de butiner là où il trouve son bien, libre également de crier Au génie !, libre de vouloir faire partager son admiration. Toutefois, nier toute valeur à la compassion et repousser l’altruisme et la pitié, au profit de l’individualisme forcené ou d’un darwinisme social quelque peu absurde, ce sont de curieuses attitudes, peu enthousiasmantes.
Le darwinisme social devient pure stupidité, quand il débouche sur un égoïsme de caste. Après tout, il naît des surdoués et des êtres de grande conscience éthique – hélas l’un ne va pas souvent de pair avec l’autre – dans toutes les races et ethnies, chez les riches comme chez les va-nu-pieds.
L’individualisme et l’hédonisme sont des objectifs de vie médiocres. Il serait peut-être temps d’en revenir aux grandes aventures collectives, en évitant bien sûr les écueils d’un passé proche.
Aux jeunes, il serait peut-être souhaitable d’enseigner l’essentiel de la philosophie de Schopenhauer, plutôt que la doctrine d’un « Stirner », les écrits de la phase de délire paranoïaque de Nietzsche ou les thèses de ce bas-bleu désabusé de « Rand »-Rosenbaum-O’Connor, apologiste de l’utilitarisme forcené envisagé comme source d’éthique.
Pour terminer sur une note extrêmement polémique, on dira que le féminisme, dans tous ses avatars, fut LA catastrophe intellectuelle et morale de l’occident au XXe siècle
Indications bibliographiques:
S. Freud : Essais de psychanalyse, Payot, 1970 (première édition allemande de 1920)
S. Freud : Malaise dans la civilisation, P.U.F., 1973 (texte de 1930 ; première édition en langue anglaise en 1961)
A. Hitler : Principes d’action, Déterna, 2014 (première édition française de 1936)
F. Nietzsche : Par-delà bien et mal. Prélude d’une philosophie de l’avenir, Gallimard, 1971 (texte de 1885-1886)
F. Nietzsche : Contribution à la généalogie de la morale, Union Générale d’Éditions, 1974 (texte de 1887)
F. Nietzsche : Ecce Homo. Comment on devient ce qu’on est, Mercure de France, 1909 (texte de 1888)
F. Nietzsche : Le crépuscule des idoles ou comment on philosophe à coups de marteau et autres textes (dont L’Antéchrist et Le cas Wagner), Mercure de France, 1952 (Ce sont les
ultimes œuvres achevées de l’auteur, écrites en 1888 ; première édition française en 1899)
F. Nietzsche : La Volonté de Puissance, éditions du Trident, 1989
L. Peikoff : Objectivism : the philosophy of Ayn Rand, Penguin Books, New York, 1991 (pour les insomniaques et les supporters inconditionnels, on signale que Leonard Peikoff, exécuteur testamentaire de dame « Rand », a édité en 1997, chez Penguin, un pavé de près de 700 pages des Lettres du sujet de son admiration)
 B. Plouvier : Le dérangement du monde ou des erreurs et des hommes, L’Æncre, 2016
B. Plouvier : Le dérangement du monde ou des erreurs et des hommes, L’Æncre, 2016
« A. Rand » : La vertu d’égoïsme, Les Belles Lettres, 1993 (c’est un recueil très partiel des textes réunis en 1964 aux USA ; la version française a expurgé plus de la moitié de la version nord-américaine, se débarrassant des petits essais les plus cyniques et arrogants)
A. Schopenhauer : Le fondement de la morale, Alcan, 1888 (première édition allemande de 1840)
« M. Stirner »-J. C. Schmidt : L’unique et sa propriété, L’Âge d’Homme, Lausanne, 1972 (première édition allemande de 1845)




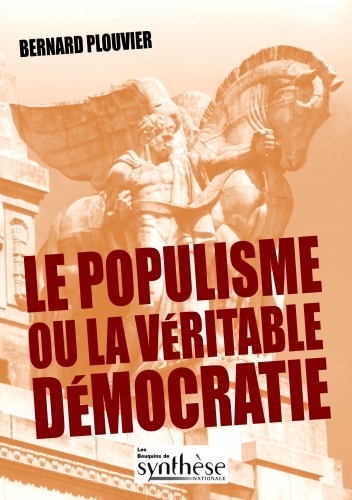 Nous autres, Européens autochtones, vivons indéniablement une période de « fin de civilisation », qui ressemble à s’y méprendre à celle vécue par les contemporains de la fin de l’Empire romain d’Occident. Cette constatation, assez peu réjouissante, mérite à la fois que l’on établisse un bilan des réalisations anciennes et que l’on apporte quelques réflexions comparatives sur les valeurs qui s’estompent et celles qui émergent.
Nous autres, Européens autochtones, vivons indéniablement une période de « fin de civilisation », qui ressemble à s’y méprendre à celle vécue par les contemporains de la fin de l’Empire romain d’Occident. Cette constatation, assez peu réjouissante, mérite à la fois que l’on établisse un bilan des réalisations anciennes et que l’on apporte quelques réflexions comparatives sur les valeurs qui s’estompent et celles qui émergent.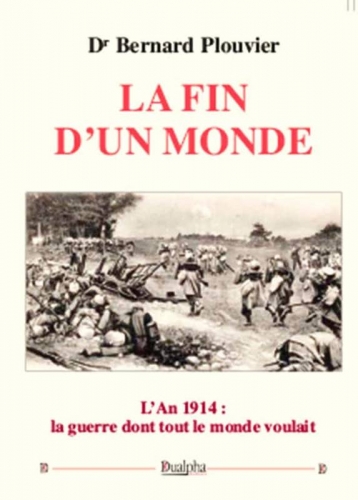 La propagande mondialiste reflète, c’est évident, les choix de nos maîtres, qui leur sont dictés par leur intérêt. Le grand village terrestre ne doit plus être composé que d’individus qui consomment beaucoup, au besoin à crédit, et pensent gentiment ce qu’imposent les fabricants d’opinion publique.
La propagande mondialiste reflète, c’est évident, les choix de nos maîtres, qui leur sont dictés par leur intérêt. Le grand village terrestre ne doit plus être composé que d’individus qui consomment beaucoup, au besoin à crédit, et pensent gentiment ce qu’imposent les fabricants d’opinion publique.
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg

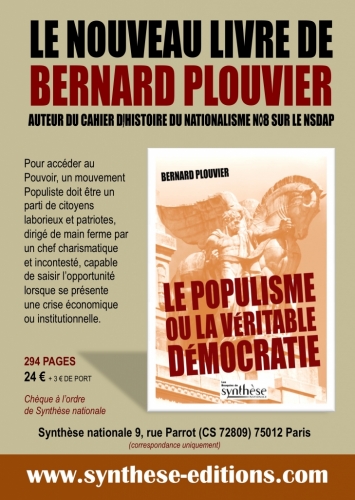 Pourtant les démocraties grecques antiques n’ont pas été des régimes populistes.
Pourtant les démocraties grecques antiques n’ont pas été des régimes populistes.
 Quelle est votre définition du « cosmopolitisme », un mot qui, au XVIIIe siècle, à l’époque des Lumières, représentait le nec plus ultra : cela revenait alors, pour l’élite, à s’informer des autres cultures que celle de son pays d’origine ?
Quelle est votre définition du « cosmopolitisme », un mot qui, au XVIIIe siècle, à l’époque des Lumières, représentait le nec plus ultra : cela revenait alors, pour l’élite, à s’informer des autres cultures que celle de son pays d’origine ?
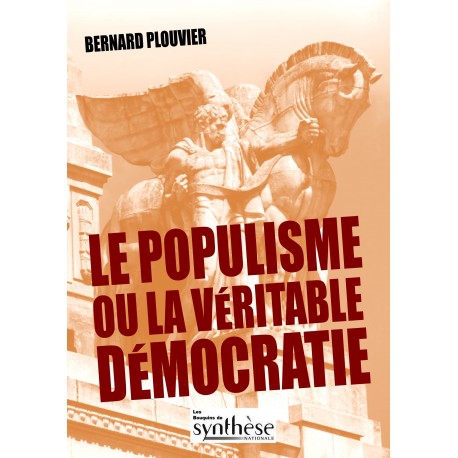 Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?
Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?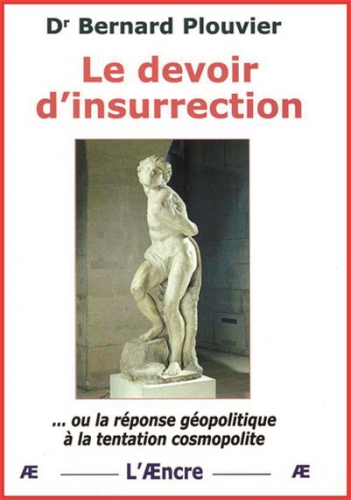 Fabrice Dutilleul :
Fabrice Dutilleul :