mercredi, 21 décembre 2016
Le platonisme de Jean-François Mattéi

Le platonisme de Jean-François Mattéi
par Francis Moury
Ex: http://www.juanasensio.com
Cette étude de 250 pages environ sur la trajectoire philosophique et politique du philosophe Jean-François Mattéi (1941-2014) est claire, nette, pédagogique tout en étant passionnée. Elle couvre toute la bibliographie de Mattéi et regorge de citations intéressantes, relatives à certaines problématiques classiques de l'histoire de la philosophie antique, moderne et contemporaine. Son titre provient d'une remarque de Pierre Boutang, l'un des maîtres de Mattéi, à propos de l'Odyssée d'Homère (1).
On pourrait résumer cette trajectoire d'une manière commode et intuitive en citant le titre du premier livre écrit par Mattéi, L'Étranger et le simulacre – Essai sur la fondation de l'ontologie platonicienne (sa thèse de doctorat publiée en 1983) puis celui de son dernier livre, L'Homme dévasté – Essai sur la déconstruction de la culture (paru posthume en 2015). Pour comprendre ses tenants et aboutissants, en quoi elle se voulut à la fois reconstructrice (d'une tradition) et critique (d'une tentative de déconstruction de cette tradition), il faut peut-être commencer par la fin du livre de Baptiste Rappin, donc lire la postface signée Pierre Magnard qui se souvient des circonstances intellectuelles, historiques, politiques, de sa rencontre en 1981 comme professeur au Centre Hegel de Poitiers, avec l'étudiant Jean-François Mattéi. Tous deux étaient métaphysiquement désespérés par l'entreprise déconstructrice de ceux qu'ils nommaient «Les quatre cavaliers de l'Apocalypse» (2), à savoir Gilles Deleuze, Michel Foucault, Pierre Bourdieu et Jacques Derrida qu'ils tenaient pour des sophistes fossoyeurs de la tradition philosophique, celle qui ordonnait la table des matières des manuels classiques, selon un ordre architectonique hérité du système d'Aristote et qu'on trouve encore dans les cours de philosophie d'Henri Bergson et, un peu plus près de nous, dans les excellents manuels d'Armand Cuvillier ou de Paul Foulquié qu'on peut encore aujourd'hui lire avec le plus grand profit.
Consacrer sa thèse de doctorat à Platon ne semble pas, aujourd'hui, un acte contre-révolutionnaire, surtout à la lumière de l'histoire des thèses de doctorat soutenues à la Sorbonne depuis 1900 à nos jours. Platon avait eu les faveurs de l'université française, à tel point que les éditions des Belles lettres avaient mis un point d'honneur à publier, à partir des années 1920, une édition critique complète du texte grec et de sa traduction (achevée en 1964) bien avant d'en publier une (encore attendue car incomplète) d'Aristote. De même, la bibliothèque de la Pléiade avait tenu à publier dès 1942 une traduction complète sous l'autorité de deux sommités des études platoniciennes (Léon Robin et son disciple Joseph Moreau), saluée par le grand Albert Rivaud (lui-même admirable éditeur et traducteur du Timée et du Critias aux Belles lettres en 1925), bien avant de s'intéresser, par exemple, aux Stoïciens (ils arrivent en 1962 seulement dans la même collection, à l'initiative d'Émile Bréhier) ou aux Présocratiques (1988).
 Mais en 1983, c'était un acte contre-révolutionnaire, dans la mesure où le platonisme était considéré par les déconstructeurs comme le modèle à abattre. Ni Baptiste Rappin, ni son postfacier Pierre Magnard, ni même le préfacier Jean-Jacques Wunenburger ne le signalent (à moins qu'une note m'ait échappé ?) : une annexe du livre de Gilles Deleuze, Logique du sens (éditions de Minuit, 1969) s'intitulait Platon et les simulacres. Il s'agissait de la reprise d'un article au titre original nettement plus virulent, Renverser le platonisme (les simulacres), paru en 1966 dans la Revue de Métaphysique et de Morale. C'est pourtant, de toute évidence, au titre de cette annexe que fait allusion le titre de la thèse de doctorat de Mattéi qui substituait au titre de Deleuze un «Étranger» à la place de Platon : cet Étranger fait bien sûr allusion à celui du Sophiste de Platon, un des dialogues métaphysiques les plus techniques et élevés de Platon. C'est peut-être aussi, et cela Rappin le signale à juste titre, une allusion au roman d'Albert Camus avec qui Mattéi éprouvait une affinité spirituelle en raison de leur communauté d'origine et de formation.
Mais en 1983, c'était un acte contre-révolutionnaire, dans la mesure où le platonisme était considéré par les déconstructeurs comme le modèle à abattre. Ni Baptiste Rappin, ni son postfacier Pierre Magnard, ni même le préfacier Jean-Jacques Wunenburger ne le signalent (à moins qu'une note m'ait échappé ?) : une annexe du livre de Gilles Deleuze, Logique du sens (éditions de Minuit, 1969) s'intitulait Platon et les simulacres. Il s'agissait de la reprise d'un article au titre original nettement plus virulent, Renverser le platonisme (les simulacres), paru en 1966 dans la Revue de Métaphysique et de Morale. C'est pourtant, de toute évidence, au titre de cette annexe que fait allusion le titre de la thèse de doctorat de Mattéi qui substituait au titre de Deleuze un «Étranger» à la place de Platon : cet Étranger fait bien sûr allusion à celui du Sophiste de Platon, un des dialogues métaphysiques les plus techniques et élevés de Platon. C'est peut-être aussi, et cela Rappin le signale à juste titre, une allusion au roman d'Albert Camus avec qui Mattéi éprouvait une affinité spirituelle en raison de leur communauté d'origine et de formation. Qu'on se souvienne aussi qu'en 1993, les éditions Vrin publiaient le tome 1 des actes (supervisés par Monique Dixsaut) d'un colloque intitulé Contre Platon : le platonisme dévoilé, qui prenait plaisir, sous ce titre provocateur, à faire l'histoire de l'anti-platonisme de l'antiquité au XVIIIesiècle, avant qu'un tome 2 Contre Platon : renverser le platonisme, dont le sous-titre reprenait explicitement le titre de l'article de Deleuze de 1966, la poursuive de Kant à nos jours. Et puis surtout pesait sur Platon la critique de Nietzsche, peut-être la plus redoutable dans la mesure où Nietzsche avait été, à son tour, récupéré (le terme était à la mode en politique, on l'importa vite en philosophie : les deux genres communiquaient) par Deleuze dans son Nietzsche et la philosophie (P.U.F., 1962) que certains étudiants de ma génération (celle des années 1980, celle de Mattéi, donc) prenaient naïvement pour la meilleure introduction à la pensée de Nietzsche, alors que c'était une étude deleuzienne polémique, technique, difficile d'accès et en outre dénuée de bibliographie. Concernant l'histoire du platonisme, Mattéi fait son miel des générations de platoniciens qui l'ont précédé : en lisant les pages 86-87 de l'étude de Rappin, on se dit que Mattéi a, par exemple, probablement lu, sur le rapport du mythe à la raison chez Platon, les études classiques de Perceval Frutiger, Les Mythes de Platon (éditions Félix Alcan, 1930) et de Pierre-Maxime Schuhl, La Fabulation platonicienne (première édition P.U.F., 1947, seconde édition revue et mise à jour Vrin, 1968), sans oublier celles de Jean-Pierre Vernant, le disciple (accessoirement communiste) de Louis Gernet. Un point commun intéressant à noter entre Deleuze et Mattéi : leur amour commun du cinéma comme paradigme métaphysique.
De la défense de l'ontologie platonicienne à la défense de la culture occidentale, le chemin de Mattéi passe alors par Martin Heidegger (cinq études en collaboration avec Dominique Janicaud sur le philosophe de la forêt noire aux P.U.F., en 1983), Pythagore et les Pythagoriciens (aux P.U.F., aussi en 1983), Jorge-Luis Borges, Albert Camus déjà cité et quelques autres. Métaphysiquement, Mattéi veut séparer le bon grain du mauvais : ceux qui pensent un ordre du monde (Platon, Nietzsche, Heidegger) doivent être privilégiés. Ils le pensent en prenant en charge l'irrationnel du mythe, de la poésie, de l'alchimie. Mattéi s'intéresse au symbolisme mythique et philosophique du pentagramme, à la poésie d'Homère et de Hölderlin, au film noir policier Vertigo [Sueurs froides] (1958) d'Alfred Hitchcock (scénario adapté librement du roman de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, D'entre les morts, éditions Denoël, 1954). Plus explicitement, il affirme sa communauté spirituelle et intellectuelle avec Pierre Boutang, l'héritier de Charles Maurras sur qui Mattéi publie un article intitulé Maurras et Platon en 2011 : la boucle méditerranéenne antique est bouclée. Leur point commun, in fine, est selon Mattéi un rapport charnel à l'idéal grec originel que Rappin allie avec pertinence à l'expressionnisme philosophique allemand de Heidegger.
Un mot concernant le rapport de la France à la Grèce dans l'histoire des lettres et de la pensée française. Ce rapport constitue non pas une originalité, mais un point commun avec celles des lettres et de la pensée anglaises, allemandes, espagnoles, italiennes. L'originalité est à chercher dans le style précis du rapport chez tel écrivain ou tel penseur. Du coup, pourquoi Boutang ou Maurras plutôt que Du Bellay ou Leconte de Lisle (qui donna en 1865-1870 la plus belle – sinon la plus philologiquement exacte – traduction d'Homère en préservant à peu près les noms grecs dans sa traduction) ? Après tout, Baptiste Rappin cite La Vie antérieure de Baudelaire en exergue car il juge son poème d'essence platonicienne : certes, il l'est. Mais on aurait pu citer tout aussi bien un fragment poétique de Leconte de Lisle ou de Théophile Gautier. C'est que Mattéi se veut le continuateur du combat contre l'oubli de la Grèce par la France, combat qu'il considère avoir été mené par Boutang et par Maurras, combat parallèle à celui contre l'oubli de l'être mené par Martin Heidegger. Combat que ni Du Bellay ni Leconte de Lisle n'avaient à mener en leurs temps respectifs où le marxisme d'une part, le déconstructivisme d'autre part, n'existaient ni l'un ni l'autre.
Sur le plan purement historique, certaines remarques font parfois un peu sourire : Rémy Brague n'est évidemment pas le premier, contrairement à ce qu'écrit Baptiste Rappin page 101, à avoir mis en évidence «la secondarité de Rome par rapport à Athènes» en écho à celle d'Athènes par rapport à l'Asie : G.W. F. Hegel l'écrivait déjà dans son Introduction à la philosophie de l'histoire en 1828-1830 et l'idée traverse l'historiographie occidentale depuis saint Augustin jusqu'à Bossuet. On aurait pu citer tout aussi bien un fragment poétique de Leconte de Lisle ou de Théophile Gautier. Certains voisinages théoriques sont suggestifs, d'autres s'avèrent parfois surprenants : à la page 124, l'esprit juif défini par Franz Roseinzweig se retrouve proche du pentagramme que Heidegger voulut qu'on gravât sur sa tombe et Baptiste Rappin ajoute : «C'est bien l'étoile de Pythagore, que les Francs-Maçons tracent entre l'équerre et le compas, c'est-à-dire entre Terre et Ciel, qui guida le regard de Mattéi, par-delà, ou peut-être en-deçà, du Soleil platonicien». Beaucoup plus intéressantes sont les remarques sur l'emploi du chiasme par Mattéi et leur rapprochement avec le style de Heidegger dont Mattéi fut un fervent lecteur.
Sur le plan de l'histoire de l'histoire de la philosophie (la philosophie a une histoire mais cette histoire a elle aussi son histoire : des esprits aussi pénétrants qu'Émile Boutroux, Émile Bréhier ou Henri Gouhier l'avaient d'ailleurs admirablement étudiée), il me semble qu'il manque à l'étude sincère et synthétique de Baptiste Rappin sur Mattéi, la mention approfondie d'un penseur déterminant pour comprendre pourquoi Mattéi privilégia non pas Parménide ni Héraclite mais bien Platon comme paradigme de la culture occidentale. Ce philosophe, c'est par l'intermédiaire de Martin Heidegger qu'il l'a peut-être réellement, effectivement, rencontré : j'ai nommé G.W.F. Hegel. Sans ce dernier, Nietzsche n'aurait pas critiqué le platonisme comme il l'a fait, Heidegger ne l'aurait pas non plus envisagé comme il l'a fait, Mattéi n'aurait pas pu allier en un même titre Platon, Nietzsche et Heidegger alors que, en apparence, ils ne sont pas conciliables. C'est qu'ils le sont d'un certain point de vue que Mattéi, je pense, trouva chez G.W.F. Hegel. Le moyen terme, le chaînon manquant qui permet de réconcilier dialectiquement, en profondeur, le mythe et la raison, l'irrationnel et le rationnel, c'est le système de G.W.F. Hegel, au premier rang duquel on doit mentionner l'histoire de la philosophie écrite par Hegel. On se souvient que Hegel considérait Parménide comme la thèse (l'être en repos, identique à lui-même), Héraclite comme l'antithèse (l'être en perpétuel devenir, en guerre avec lui-même comme avec le monde), Platon comme la synthèse (être fixe+devenir, même+autre = réalité sublunaire inférieure mais pouvant prendre conscience, par une conversion intellectuelle autant que mythique et vitale, de la réalité absolue des essences). Ce n'est, selon moi, pas un hasard si Mattéi est contemporain de la traduction de ce philosophe chez Vrin qui la révélait dans toute son ampleur à la Sorbonne. Ce qu'admire Mattéi dans la philosophie de Platon, c'est précisément l'alliage du même et de l'autre dans la pensée comme mouvement, comme devenir, comme odyssée, comme histoire d'un voyage partant d'une origine pour mieux y revenir, mais enrichi par ses péripéties qu'il faut nommer dialectiques. Cette odyssée homérique, devenue symbolique à telle point que les mythes d'Homère sont des piliers de la pensée grecque (je renvoie ici à mon article sur le livre classique de Félix Bussière), c'est bien celle décrite par le système hégélien tel qu'il pose, expose, repose enfin la philosophie et son histoire, l'esthétique et son histoire, l'histoire des religions et des mythes. Mattéi s'est intéressé à ces trois domaines.
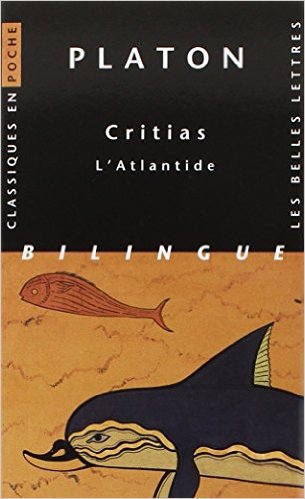 En politique, Mattéi pensa sur le mode platonicien pur et dur, de la fin du XXe siècle à sa mort : il combat dans La Barbarie intérieure – essai sur l'immonde moderne (1999), la subversion sophistique de la contre-culture, de l'art moderne qui nie le rapport au sens ou qui se veut non-sens, du rejet de l'autorité à l'école comme dans la société. Son pythagorisme le pousse même à critiquer sévèrement la musique dodécaphonique : elle est parfois très belle, pourtant, et Platon l'aurait peut-être appréciée... qui sait ? Baptiste Rappin rappelle que Mattéi fut hostile à certaines tendances contemporaines telles que le management ou le transhumanisme. Autant le premier me semble fondamentalement antipathique (3), autant le second me semble intéressant. Ces réserves sont destinées à montrer que la dernière période de la production de Mattéi, bien que cohérente avec sa période purement métaphysique antérieure, s'avère, en fin de compte, aussi peu originale qu'elle. Mais l'originalité étant un concept qui n'appartenait pas à la pensée antique, Mattéi aurait sans doute apprécié, in fine, d'être tenu pour un transmetteur fidèle, poursuivant un combat qu'il n'avait pas initié.
En politique, Mattéi pensa sur le mode platonicien pur et dur, de la fin du XXe siècle à sa mort : il combat dans La Barbarie intérieure – essai sur l'immonde moderne (1999), la subversion sophistique de la contre-culture, de l'art moderne qui nie le rapport au sens ou qui se veut non-sens, du rejet de l'autorité à l'école comme dans la société. Son pythagorisme le pousse même à critiquer sévèrement la musique dodécaphonique : elle est parfois très belle, pourtant, et Platon l'aurait peut-être appréciée... qui sait ? Baptiste Rappin rappelle que Mattéi fut hostile à certaines tendances contemporaines telles que le management ou le transhumanisme. Autant le premier me semble fondamentalement antipathique (3), autant le second me semble intéressant. Ces réserves sont destinées à montrer que la dernière période de la production de Mattéi, bien que cohérente avec sa période purement métaphysique antérieure, s'avère, en fin de compte, aussi peu originale qu'elle. Mais l'originalité étant un concept qui n'appartenait pas à la pensée antique, Mattéi aurait sans doute apprécié, in fine, d'être tenu pour un transmetteur fidèle, poursuivant un combat qu'il n'avait pas initié.Notes
(1) On la trouvera dans Pierre Boutang, Ontologie du secret (éditions P.U.F., 1973, réédition en 1988 dans la collection Quadrige, page 20). Soit dit en passant, la citation de Pierre Boutang par Baptiste Rappin à la p. 225 : «[...] analogue à celui d'Ulysse, son maître, reconnaissant une telle natale qu'ingrat, ou par quelque providence divine, il avait crue étrangère en y abordant» doit se lire terre natale. Certaines coquilles morphologiques ou syntaxiques dépareillent le texte, y compris celui de certaines citations. Concernant les sources bibliographiques, ce sont souvent les éditions récentes qui sont citées, sans que l'édition originale soit mentionnée. Il ne faudrait donc pas croire, en lisant la note 510 de la page 223, qu’Emmanuel Lévinas publia en 2003 son livre Totalité et infini. En réalité, il a paru à la Haye en 1961. Idem pour la note 267 de la page 127 : la traduction du Gorgias de Platon par Alfred Croiset fut initialement publiée aux Belles lettres en 1923, en regard du texte grec : elle ne date pas de 1991 ni de sa réédition en collection Tel chez Gallimard. Même remarque encore pour la note 145 de la page 78 : Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs date de 1965 en édition originale chez Maspéro. L’édition mentionnée (La Découverte en 1991) est aussi une réédition.
(2) Ils apparaissent cependant, à mesure que le temps passe et que leur influence s'estompe, moins redoutables, en dépit de leur surnom biblique, que ceux aperçus durant le générique d'ouverture du film classique signé par l'esthète Vincente Minnelli (The Four Horsemen of the Apocalypse [Les Quatre cavaliers de l'Apocalypse, États-Unis/Mexique, scope-couleurs, 1962) d'après le roman de Vincente Blasco Ibañez. Concernant les quatre philosophes ainsi surnommés, le plus profond et le plus intéressant demeure, en ce qui me concerne, Gilles Deleuze, pour ses travaux d'histoire de la philosophie qu'il publia entre 1953 et 1969. Rapportés à ceux des générations de 1900-1945, les travaux français d'histoire de la philosophie de la période 1945-2000 doivent cependant, on le mesure toujours mieux à mesure que le temps passe, être considérés comme des travaux de second plan ou de seconde main. La génération formée par Ferdinand Alquié, Maurice de Gandillac, Georges Canguilhem, Jean Hyppolite, fut une génération philosophiquement inférieure à celles formées par Félix Ravaisson, Émile Boutroux, Jules Lachelier, Victor Brochard, Victor Delbos, Émile Bréhier et Henri Gouhier.
Cette baisse de niveau fut la conséquence directe de l'influence marxiste qui mina en profondeur, entre 1945 et 1990, l'université française et l'École Normale supérieure, section philosophie, au premier chef. Dans cette dernière, le dément Louis Althusser – qui étrangla son épouse dans leur appartement de fonction de la rue d'Ulm en 1980 – exerça une redoutable influence politique marxiste-léniniste puis ouvertement maoïste à partir de 1965: le cas est unique dans l'histoire de l'enseignement supérieur français depuis Napoléon à nos jours. Entre 1945 et 1980, l'université française fut une des plus atteintes par la propagande communiste : sa réputation à l'étranger était exécrable pour cette raison. Une réaction morale, intellectuelle et politique débute dès les années 1970, notamment à partir de la traduction française des œuvres autobiographiques de l'écrivain russe Alexandre Soljenitsyne. Elle s'accélère au moment de la chute du mur de Berlin et de celle de l'U.R.S.S. L'ouverture de la Chine au capitalisme national et international, capitalisme autoritaire et soigneusement contrôlé mais capitalisme tout de même, sous Deng Xiao Ping, porte un coup fatal au marxisme-léninisme et signe le début d'une ère de prospérité internationale globale. Les seules exceptions positives universitaires françaises, concernant la période 1945 à 2000, seraient peut-être le cas des études hégéliennes et des études sur le positivisme logique qui multiplient les traductions inédites. En revanche, l'histoire de la philosophie ancienne, médiévale et moderne stagne, voire décroît en valeur d'une manière alarmante. Les grands travaux de la période 1850-1945 – ceux grâce auxquels Paris s'était rehaussé au niveau de Londres et de Berlin – ne sont parfois plus réédités.
Le retard à la traduction, cette spécificité française, aura par ailleurs considérablement impacté la connaissance de penseurs de premiers plans dans notre pays : c'est avec presque cent ans de retard que nous arrivent actuellement les traductions françaises de certains textes de Martin Heidegger, de Ludwig Wittgenstein ou de John Dewey. Sans parler de l'absence d'une édition critique française du texte grec de la Métaphysique d'Aristote avec traduction en regard : les Belles lettres (qui publient des tomes de problèmes aristotéliciens tenus pour apocryphes mais dont certains seraient authentiques) n'ont toujours pas achevé l'établissement de ce texte majeur alors que l'Angleterre et l'Allemagne en disposent depuis longtemps. Pire encore : Auguste Comte – alors que sa statue trône justement place de la Sorbonne – demeure privé d'une édition critique de ses œuvres complètes. Les positivistes spiritualistes (Ravaisson, Lachelier, Boutroux) demeurent dans la même situation. De tels «trous noirs» éditoriaux ne sont évidemment plus acceptables.
(3) Cf. mon article Heidegger contre les robots dans lequel j'examine le livre intéressant de Baptiste Rappin sur Heidegger et la question du «management».
15:37 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-françois mattéi, philosophie, philosophie politique, platon, platonisme, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 juillet 2016
La pensée cosmique de Jean-François Mattéi

Baptiste Rappin:
La pensée cosmique
de Jean-François Mattéi
Conférence de Baptiste Rapin au Cercle Aristote le 30 mai 2016
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-françois mattéi, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 26 avril 2015
L'HOMME DÉVASTÉ: De la déconstruction de la culture à la dévastation de l’homme

Kalli GIANNELOS*
Ex: http://metamag.fr
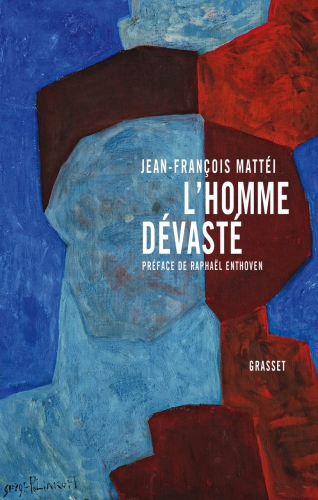 Autant par sa parution posthume que par la portée du projet qui en scelle l’unité, L’homme dévasté de Jean-François Mattéi s’apparente à une œuvre testamentaire. De Platon aux penseurs contemporains, Mattéi déploie une réflexion qui traverse les époques, les échelles (du monde à l’homme) et les disciplines, en quête des origines et des avatars de la figure de la dévastation de l’homme. La préface très nourrie qui introduit l’essai, réalisée par Raphaël Enthoven, situe le contexte, les enjeux, autant que la lignée dans laquelle la pensée de Mattéi s’inscrit (Platon, Heidegger, Camus...). Dans cet essai, Mattéi dénonce les effets dévastateurs de l’entreprise de déconstruction, tout en montrant que la déconstruction se déconstruit elle-même. À travers une analyse foisonnant d’exemples divers et une démarche limpide, Mattéi expose le processus de « destruction » de l’homme : son obsolescence, sa réification, sa désorientation, sa disparition. On y trouve, en creux, un humanisme redéfini à mi-chemin entre l’antihumanisme et un humanisme naïf. Les pérégrinations philosophiques de cet essai s’établissent par le biais de références multiples, puisant autant dans les ressources philosophiques que dans celles propres à la littérature, aux arts ou aux sciences. Aussi, la typologie des références de l’ouvrage, établie par Raphaël Enthoven, indique que cet essai séduira autant les « plus savants », que les « indignés », les « cinéphiles », les « snobs », les « amateurs de jargon » ou les « gamers ».
Autant par sa parution posthume que par la portée du projet qui en scelle l’unité, L’homme dévasté de Jean-François Mattéi s’apparente à une œuvre testamentaire. De Platon aux penseurs contemporains, Mattéi déploie une réflexion qui traverse les époques, les échelles (du monde à l’homme) et les disciplines, en quête des origines et des avatars de la figure de la dévastation de l’homme. La préface très nourrie qui introduit l’essai, réalisée par Raphaël Enthoven, situe le contexte, les enjeux, autant que la lignée dans laquelle la pensée de Mattéi s’inscrit (Platon, Heidegger, Camus...). Dans cet essai, Mattéi dénonce les effets dévastateurs de l’entreprise de déconstruction, tout en montrant que la déconstruction se déconstruit elle-même. À travers une analyse foisonnant d’exemples divers et une démarche limpide, Mattéi expose le processus de « destruction » de l’homme : son obsolescence, sa réification, sa désorientation, sa disparition. On y trouve, en creux, un humanisme redéfini à mi-chemin entre l’antihumanisme et un humanisme naïf. Les pérégrinations philosophiques de cet essai s’établissent par le biais de références multiples, puisant autant dans les ressources philosophiques que dans celles propres à la littérature, aux arts ou aux sciences. Aussi, la typologie des références de l’ouvrage, établie par Raphaël Enthoven, indique que cet essai séduira autant les « plus savants », que les « indignés », les « cinéphiles », les « snobs », les « amateurs de jargon » ou les « gamers ». Le constat de la dévastation de l’homme moderne porte en creux le dépérissement de ce qui fut : une construction de la culture européenne, humaniste, remontant à la Grèce antique. Mattéi retrace les rouages et la cible de la déconstruction, cet anti-humanisme théorique qui a désolidarisé le XXe siècle des fondements de la culture occidentale, annihilant non seulement une certaine pensée « architectonique » mais aussi du même coup les conditions d’accès à un monde doué de sens, lui-même garant de l’humanité . Cible des déconstructeurs, l’idée architectonique qui a longtemps porté la culture européenne connaît effectivement un déclin : un déclin de l’architectonique de la cité induisant celui de l’architectonique de la pensée . Contre la déconstruction et la « barbarie » qu’il y décèle, Mattéi dénonce la stérilité de celle-ci autant que son « mouvement ravageur » qui dénote une tentative « de suppression de la condition humaine dans son imbrication avec le monde » .
Le constat de la dévastation de l’homme moderne porte en creux le dépérissement de ce qui fut : une construction de la culture européenne, humaniste, remontant à la Grèce antique. Mattéi retrace les rouages et la cible de la déconstruction, cet anti-humanisme théorique qui a désolidarisé le XXe siècle des fondements de la culture occidentale, annihilant non seulement une certaine pensée « architectonique » mais aussi du même coup les conditions d’accès à un monde doué de sens, lui-même garant de l’humanité . Cible des déconstructeurs, l’idée architectonique qui a longtemps porté la culture européenne connaît effectivement un déclin : un déclin de l’architectonique de la cité induisant celui de l’architectonique de la pensée . Contre la déconstruction et la « barbarie » qu’il y décèle, Mattéi dénonce la stérilité de celle-ci autant que son « mouvement ravageur » qui dénote une tentative « de suppression de la condition humaine dans son imbrication avec le monde » .
 Il n’y a plus dans le livre, dans l’homme ou dans les choses ni profondeur ni hauteur, seulement des lignes indécises de segmentation, des tiges superficielles ou des plateaux connectés, puis déconnectés, sans qu’aucun horizon vienne éclairer un monde dévasté.
Il n’y a plus dans le livre, dans l’homme ou dans les choses ni profondeur ni hauteur, seulement des lignes indécises de segmentation, des tiges superficielles ou des plateaux connectés, puis déconnectés, sans qu’aucun horizon vienne éclairer un monde dévasté.
 Cible ultime de la déconstruction généralisée, le corps humain parachève ce mouvement de déconstruction, incarnant la figure extrême de la dévastation. Mattéi identifie ce nouveau rapport à la corporéité dans un double mouvement, de régression et de confusion de l’homme avec d’autres formes de vie et, d’autre part, une transgression vers une fusion de l’homme avec les machines : une « défiguration » ou « dénaturation » de l’homme qui conduit à sa destruction ou dévastation . La neutralisation du corps est aussi un des effets de cette déconstruction du corps, que l’on retrouve dans les gender studies : « le corps de l’homme [est] dissous par le discours qui le remplace. » . De la transgression du sexe vers le genre, Mattéi passe à la transgression de l’humain vers le surhumain : ce posthumanisme - qui a tendance à se sublimer en « transhumanisme » - procède à la construction d’un être artificiel, simulant l’homme naturel. Notre monde contemporain est pour Mattéi celui du « dernier homme » que Nietzsche avait annoncé, et le paradoxe de cette évolution en cours est qu’il s’agit bien d’un « projet humain d’en finir paradoxalement avec l’être humain » . La déconstruction théorique de l’humanité se dédouble ainsi en une déconstruction physique de l’homme.
Cible ultime de la déconstruction généralisée, le corps humain parachève ce mouvement de déconstruction, incarnant la figure extrême de la dévastation. Mattéi identifie ce nouveau rapport à la corporéité dans un double mouvement, de régression et de confusion de l’homme avec d’autres formes de vie et, d’autre part, une transgression vers une fusion de l’homme avec les machines : une « défiguration » ou « dénaturation » de l’homme qui conduit à sa destruction ou dévastation . La neutralisation du corps est aussi un des effets de cette déconstruction du corps, que l’on retrouve dans les gender studies : « le corps de l’homme [est] dissous par le discours qui le remplace. » . De la transgression du sexe vers le genre, Mattéi passe à la transgression de l’humain vers le surhumain : ce posthumanisme - qui a tendance à se sublimer en « transhumanisme » - procède à la construction d’un être artificiel, simulant l’homme naturel. Notre monde contemporain est pour Mattéi celui du « dernier homme » que Nietzsche avait annoncé, et le paradoxe de cette évolution en cours est qu’il s’agit bien d’un « projet humain d’en finir paradoxalement avec l’être humain » . La déconstruction théorique de l’humanité se dédouble ainsi en une déconstruction physique de l’homme.
00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jean-françois mattéi, philosophie, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 février 2015
Entretien avec le philosophe Jean-François Mattéi (2009)

Entretien avec le philosophe Jean-François Mattéi (2009)
Ex: http://marcalpozzo.blogspirit.com
Rappel: Jean-François Mattéi, Diagnostic d'une crise du sens
Marc Alpozzo : Votre pensée philosophique n’est pas, je dirais, une pensée de la décadence, mais de l’épuisement.
Jean-François Mattéi : Un peu, en effet. Certes, c’est une pensée qui n’est finalement pas très originale si je peux en juger moi-même. Mais dans la même lignée que Baudelaire, Poe, puis Valéry et, plus près de nous, Georges Steiner, à ce qui leur semble et me semble également, je soutiens que les intuitions majeures de la pensée européenne sont en train de s’affaiblir. Tout se passe comme si la culture universelle que l’Europe a apportée au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, était en train de s’affaiblir dans ses principes. Ses principes n’enrichissent plus suffisamment la réalité.
Je pense qu’il y a un choc des différentes cultures, non pas entre la culture arabo-musulmane et européenne par exemple, mais entre des visions différentes de la culture de notre temps : la vision ethnologique, l’approche anthropologique, la culture des banlieues, la culture des bourgeois, la contre-culture, etc. Il y a désormais une sorte d’éclatement de ce que l’on appelait autrefois classiquement la Culture.
Vous pensez à une dévalorisation, voire à un dépérissement de la Culture, avec l’apparition d’une diversité de cultures mises toutes sur le même pied d’égalité ?
Prenez Michel Maffesoli, le sociologue bien connu. Bien qu’il vive comme un grand bourgeois, il s’intéresse aux « tribus », au sens moderne évidemment, c’est-à-dire qu’il étudie et défend les cultures indigènes, de la drogue, des banlieues. Plus c’est éclaté, mieux c’est, même s’il n’y participe pas à titre personnel. Il défend sociologiquement les micros-cultures. Il n’y a selon lui aucune culture universelle, ni en réalité ni en projet, il n’y a que des micros-cultures. Par exemple, il est très intéressé par ces personnes qui font des « rave-party », des « drogue-party », ou encore les « gothiques ».
Mais n’avez-vous pas le sentiment que cette pensée sociologique-là, favorise le communautarisme ?
Beaucoup. Voilà pourquoi je suis réservé sur le sujet, non pas seulement philosophiquement mais politiquement, car je crois que la culture explose entre plusieurs petites communautés qui se fragmentent jusqu’à l’infini et qui se replient sur elles-mêmes, comme aux États-Unis. Pour moi, la culture est une ouverture sur l’universel. Un universel potentiel peut-être, mais un universel avisé. Au sens de Kant par exemple.
Votre ouvrage est celui d’un philosophe qui a une conscience politique, et qui constate le dépérissement progressif de la notion d’Europe, et de la notion d’altérité.
J’ai en effet tout un chapitre critique sur Jacques Derrida, même s’il est ambigu étant donné que l’auteur d’un côté défend l’eurocentrisme, puis de l’autre critique ce même eurocentrisme, etc. C’est le principe même de la déconstruction que Derrida a répété durant quarante ans : telle réalité ou tel concept n’est ni ceci ni cela : c’est la « double dénégation ». L’Europe n’est ni le centre du monde, dit-il, ni une société particulière, ni une société universelle, ni une société singulière. On trouve également d’autres auteurs, comme par exemple Marc Crépon, qui avancent que l’Europe a toujours été autre, et que donc elle ne recouvre plus rien car elle ne renvoie qu’à des altérités : l’altérité arabe, viking, américaine, communiste. Seulement, jamais une seule fois on ne se pose la question de savoir si toutes ces altérités, en tant qu’autres, ne renvoient pas à une identité, car pour être l’autre de quelque chose il faut que l’autre de son autre soit cependant lui-même.
Vous interrogez précisément la question de l’identité de l’Europe, et à travers cette question, vous mettez en problème la question des identités. L’âme européenne, c’est le souci du monde, c’est donc le souci de l’altérité. Contre les « sanglots de l’homme blanc », vous montrez subtilement dans ce livre que l’on a beau critiquer la culture européenne ou occidentale, à savoir la supériorité supposée affichée de sa culture, elle n’en a pas moins été soucieuse d’entrer en contact avec les autres cultures, et de les comprendre.
J’ai l’impression que l’Europe est une « méta-culture » au sens où l’on parle en logique et en mathématique d’un « métalangage » depuis Bertrand Russel : un langage qui permet de parler d’autres langages moins puissants. Je dirais volontiers que l’Europe et l’Occident, c’est-à-dire la culture universelle, est une « méta-culture ». On ne peut pas vraiment dire qu’elle serait supérieure aux autres par rapport à des critères absolus ; mais elle est une métalangue culturelle qui lui permet de s’attacher aux autres cultures avec l’invention de la philosophie, de l’ethnologie, de l’anthropologie, ou de la sociologie comparée. Vous noterez, entre parenthèses, que vous avez dans toutes ces sciences la présence même du mot logos : quand on dit que l’on va détruire le logos européen, le logocentrisme en tant qu’ethnocentrisme selon Derrida, ce logos revient par la fenêtre alors qu’on a tenté de le chasser par la porte. Il me semble que la culture européenne est une méta-philosophie et une méta-culture à trois niveaux : 1) Méta-méthodologie : aucune autre culture n’a étudié l’Europe ; elles ne se sont pas même étudiées entres elles. Marco Polo est allé en Chine pour la connaître, mais on n’a vu aucun chinois venir à Venise. 2) Méta-ontologie : puisque son noyau, l’universalité, au moins depuis Platon, est métaphysique. Tandis que les autres cultures dans le monde n’ont cherché à communiquer avec aucune autre. 3) Méta-éthique au sens moral, car toutes les autres cultures ont eu une morale qui ne renvoyait finalement qu’à elle-même, tandis que la morale de l’Europe, à tort ou à raison, se présente comme une morale universelle. Donc, à chaque fois, il y a un principe universel ontologique, méthodologique ou éthique qui régit la culture européenne.
Et c’est là toute l’ambiguïté de l’Europe. Elle est à la fois elle-même, mais aussi hors d’elle-même, non seulement parce qu’elle va absorber les autres peuples - ce sont les colonisations culturelles qui ne sont pas entièrement militaires ou religieuses - mais parce qu’elle est une absence à soi. L’Europe a toujours besoin d’absorber quelque chose d’autre. L’auteur qui l’a le mieux remarqué en philosophie c’est Hegel. Lorsqu’il parle de la Raison qui intègre les autres formes de culture, il montre qu’il y a une sorte de volonté métaphysique de l’Europe de sortir de soi[1] ; c’est toujours la même idée de sortir de soi ou d’être arraché de sa terre pour aller ailleurs.
Je n’irais pas jusqu’à dire que vous ne croyez plus en l’Europe, mais vous êtes actuellement dans le doute. A vous lire, on a le sentiment que notre Europe actuelle n’est plus une Europe de l’universel, c’est une Europe éclatée qui ne prend plus en compte, tel que vous venez à l’instant de l’expliquer, cette méta-culture, métamorale, etc.
Je me demande s’il n’y a pas actuellement une clôture de l’Europe sur son passé qui correspondrait à ce que Heidegger dit de la fin de la métaphysique, ou à ce que pressentait déjà Nietzsche, repris par Heidegger, de la fin de la philosophie et de la fin du platonisme. Nietzsche dès les années 1880 constate que la philosophie rattachée au platonisme, donc à l’universel et à la dialectique, est en train de se refermer sur elle-même, et que c’en est fini des grandes aventures de la pensée et de la culture. Heidegger, plus métaphysicien que Nietzsche, soutient que nous vivons le temps de la fin de la métaphysique et qu’autre chose va arriver à l’humanité avec une autre forme de pensée. Il y a toujours cette intuition qu’il y a une fin de l’Histoire.
 J’allais y arriver, car vous évoquez précisément dans votre précédent ouvrage une crise du sens[2] en Occident (fin de l’art, fin du monde, crise morale, etc.)
J’allais y arriver, car vous évoquez précisément dans votre précédent ouvrage une crise du sens[2] en Occident (fin de l’art, fin du monde, crise morale, etc.)
Mais les artistes du vingtième siècle l’avaient déjà dit : le dadaïsme, Ben, l’école de Nice, etc. Il y a beaucoup de théoriciens de l’art qui seraient même plus sérieux que Ben, par exemple Arthur Danto aux États-Unis, qui affirment que l’art n’est plus qu’une foire économique dans laquelle les galeristes font monter et descendre la côte des artistes. Le monde de l’art est devenu un grand marché de la consommation.
En effet, vous vous demandez d’ailleurs si par exemple Le vide de Klein ce serait si sérieux que cela. Vous avez un discours très critique et même sceptique quant à l’art contemporain.
Oui, par rapport à l’art conceptuel ou performatif comme on l’appelle. Le vide de Klein n’était rien d’autre qu’un discours « performatif », au sens linguistique du terme. Cela revient à dire : « Je déclare, par le seul fait de le déclarer, que cette exposition sur le vide est une œuvre d’art. » Lors de l’exposition sur Le vide de Klein il n’y avait rien dans la galerie d’art parisienne, et à l’inverse, avec l’exposition suivante, dans la même galerie, Le plein d’Arman, il y avait des tas de ferraille jusqu’au plafond, les invités ne pouvaient pas entrer dans la salle.
Penseriez-vous alors, à l’instar du très hégélien Fukuyama, à une fin de l’Histoire ? Ou penseriez-vous plutôt à une histoire des fins, c’est-à-dire une histoire qui se termine sur plusieurs type de fins, qui auront peut-être leurs métamorphoses, mais nous n’en savons encore rien ?
La seconde proposition correspondrait plutôt à mon intuition, même si on ne peut pas encore savoir ce qui se passera au XXIe siècle : y aura-t-il une catastrophe sous la forme d’une troisième guerre mondiale, un cataclysme écologique, ou une sorte de mutation ? Après tout, rappelez-vous, quel penseur antique, que ce soit Cicéron, Sénèque ou Saint-Augustin, aurait pensé à l’effondrement de l’Empire romain ? Même Saint-Augustin, l’auteur de La cité de Dieu, un berbère qui avait fait toutes ses études à Milan et à Rome, qui parlait latin comme nous parlons le français, ne pensait pas une minute que la vie allait s’arrêter sur terre ; il ne savait cependant pas ce qu’il y aurait historiquement ensuite. Nous en sommes au même point : à la croisée des chemins. Le développement de la science et des techniques est devenu quasiment exponentiel : voyez par exemple toutes les inventions qui bouleversent les systèmes de communication comme Internet, tous les systèmes de transmissions de l’information au point que l’on ne sait plus bien où l’on en est aujourd’hui. Quelle voie prendra l’humanité ? D’autant qu’il y a aujourd’hui ce que l’on appelle la mondialisation : est-elle d’ailleurs une manifestation de l’universel, c’est-à-dire de la culture, ou est-ce une mondialisation éclatée, qui va entraîner, comme le dirait Samuel Huntington[3], des chocs de civilisations ?… N’y aura-t-il pas une possibilité d’effondrement ou alors au contraire d’unification encore plus violente ?…
Dans les deux cas, on ne saura pas s’il y aura une évolution pour autant. Car, bien évidemment, l’idée chez Hegel, c’est que l’évolution est nécessaire aux différentes étapes que franchit l’humanité dans son histoire. Lorsqu’il évoque la fin de l’Histoire, il la date à sa propre époque, bien qu’il ne l’imaginât pas tant que cela au dix-neuvième, mais la philosophie ne saurait prédire. A présent, il semble que l’humanité soit parvenue à une phase finale d’arrachement au déterminisme de la nature, et Fukuyama par exemple, pense que l’humanité est advenue, par la démocratie libérale, et ses prouesses scientifiques et techniques, à son terme final et que l’on ne pourra pas dépasser cela.
Tous ces auteurs - qui sont pour la plupart des auteurs allemands, de Kant avec son Anthropologie jusqu’à Hegel, et au-delà comme Fukuyama qui est un hégélien tardif - pensent que nous sommes arrivés à un plateau, après avoir franchi un grand nombre de marches, notamment au siècle dernier, et que ce plateau est indéfini devant nous, mais qu’il n’y a pas de marche supérieure à venir. C’est donc cela la fin de l’Histoire. Pour illustrer cette idée, je vous rapporterai cette réflexion récente de M. Jean-Louis Guigou qui faisait à Marseille un exposé sur l’Union méditerranéenne, voulue par Nicolas Sarkozy, au Conseil économique et social de la région PACA où j’ai été récemment élu. Bien qu’il soit socialiste, le chercheur a reconnu que nous étions arrivés à la fin de l’économie. Cela recoupe ce que vous disiez. On ne peut pas dépasser le capitalisme, et on ne peut pas imaginer un autre système que le système rationnel libéral. Beaucoup de penseurs et de praticiens n’imaginent pas qu’il puisse y avoir autre chose. Certes, on peut faire en science des spéculations géologiques ou physiques ; mais des spéculations philosophiques ou économiques seraient beaucoup plus difficile, car comme le disait Bergson à un journaliste qui lui demandait ce que serait le théâtre de demain : « Cher Monsieur, si je le savais, je le ferais .» Cela veut bien dire qu’aucun schéma nouveau ne peut être proposé aujourd’hui. Par exemple, en matière de politique, quel système nouveau pourriez-vous proposer qui ne soit pas la démocratie ? On répète sans cesse : il faut plus de démocratie. Mais lorsque vous avez atteint l’égalité des individus, vous allez demander quoi ? Vous allez raboter les personnes les plus grandes pour que tout le monde ait la même taille ? On ne voit pas d’autre système politique que la démocratie. On n’a pas d’idée d’une nouvelle mathématique par exemple, ou voire même d’une nouvelle philosophie. C’est ce que Paul Valéry voulait dire en disant que les « noyaux pensants » de l’Europe sont épuisés. Ils sont là toujours, mais… Nietzsche l’avait annoncé également en disant que l’on avait tout sous la main : on ne fait donc plus que de l’ « histoire antiquaire ». Ce qui veut dire qu’on ne peut que repasser les vieux plats en les modernisant. Qu’est-ce qu’on a aujourd’hui de nouveau que ce soit sur Internet ou ailleurs ? Wikipédia ? Google ? Mais que crée-t-on vraiment de neuf ?

Vous citez Nietzsche, la mort de Dieu, le dépérissement de l’Universel. La fin des absolus.
Ces idées sont chez Nietzsche et ont été reprises par quasiment tous les auteurs du XXe siècle, Spengler dans Le déclin de l’Occident[4], Bernanos, Saint-Exupéry… Quand vous considérez les grands penseurs ou même les poètes comme René Char, vous vous apercevez que, tous, y compris les théoriciens de gauche, Walter Benjamin, Adorno, les marxistes purs et durs, style 1930, disaient que l’Occident capitaliste était en train de s’effondrer. Walter Benjamin dit par exemple, à propos de l’œuvre d’art, qu’elle s’épuise complètement. Il écrivait cela de l’époque de la reproductibilité mécanique des œuvres, alors qu’il ne connaissait pas encore la reprographie, les photocopies à l’infini, ce qui fait aujourd’hui qu’il n’y a plus d’objet original. On le voit par exemple avec les sérigraphies de Marilyn par Warhol qui sont absolument partout, alors qu’il n’y a pas d’original ou presque plus.
Même l’urinoir de Duchamp n’est plus un original, puisque l’original a été cassé.
Et le deuxième a été déclaré, par la société qui a repris Duchamp : original de Duchamp. Donc, comme nous le disions tout à l’heure, tout devient performatif. « Je déclare que cet urinoir est une œuvre d’art. » Mais si je la casse ? Alors je prends un autre urinoir, et je re-déclare : « cet urinoir est une œuvre d’art » ! On s’aperçoit que c’est la seule preuve de l’existence de l’œuvre d’art : l’acte de parole. C’est le fait de performer le dire qui fait la performance… Regardez Ben : « tout est art », « tout le monde est artiste ». Le mot, comme dirait Foucault, se substitue à la chose, et le discours se substitue à la réalité…
Diriez-vous derrière un Finkielkraut par exemple, qu’il faut être un critique pertinent du processus de la démocratie ? Ne pensez-vous pas que nous vivons une époque qui a épuisé toutes les idéologies ?
C’est ce que Jean-François Lyotard avait appelé « la fin des grands récits ». L’auteur a lancé dans les années 70 l’idée de post-modernisme[5]. Il a d’abord été marxiste, mais quand il a vu ce que c’était le marxisme à Budapest, et ailleurs, comme la plupart de ceux qui attendaient une grande révolution, il a compris que ça n’était même pas une idéologie, mais une illusion. Donc, tous les grands récits, c’est-à-dire la mise en ordre des événements comme dans un roman, lorsque l’on essaye de raconter l’histoire, se sont effondrés : le récit d’Auguste Comte, le positivisme, s’est effondré, le récit hégélien s’est effondré, le récit marxiste s’est effondré, le récit idéologique du libéralisme de type Adam Smith s’est effondré. Oui, comme vous le dites, c’est la fin des idéologies, et en même temps, comme il s’agit du même mot, c’est peut-être la fin des idéaux.
Et c’est probablement la raison pour laquelle vous n’êtes pas d’accord avec l’idée d’une fin de l’Histoire, puisque cela correspond avec l’avènement du Grand soir, et là, finalement, ce serait cohérent avec la fin de votre livre qui s’achève sur une gravure de Goya, Los Desastres de la Guerra. Car avec la fin du mythe, avec la fin des grands récits, avec la fin de la transcendance et la mort de Dieu, - Nietzsche avait tout dit ! -, votre épilogue est terrible, vous être en train de dire que l’Occident n’a plus ni boussole ni carte, se retrouvant désormais dans la même posture que des aveugles se guidant les uns les autres. A ce propos, vous citez fort à propos le tableau de Breughel commentant la parole du Christ aux Pharisiens dans La parabole des aveugles, disant « Si un aveugle guide un autre aveugle, tous les deux tomberont dans un trou[6]. »
En effet, je ne crois pas qu’il y ait un avènement. Nous continuons d’avancer en titubant. Quand j’ai écrit ce livre, je ne savais pas comment terminer, et comme je connaissais bien cette estampe de Goya, je me suis demandé si Goya n’avait pas voulu illustrer la belle peinture de Breughel. Cela dit, nous finirons tous dans un trou. Nous n’avons pas attendu Heidegger pour apprendre que l’homme était un « être-pour-la-mort ». Mais ce qu’il y a de frappant, c’est que les Grecs ou les Romains croyaient en leurs dieux, croyaient en une vie après la mort, ou tout du moins en des actions d’éclats comme celles d’Ulysse ou d’Achille, qui laisseraient une trace. Les premiers chrétiens n’avaient aucun problème, il croyaient dans leur salut. Les musulmans, les juifs croyants aussi n’ont aucun souci de ce côté. Mais pour celui qui n’a aucune espérance métaphysique, religieuse ou politique, qu’est-ce qui reste ? La télévision ? Star academy ?
Alors comment vivre aujourd’hui ?
Vivre en aveugle, ou faire ce que nous demandent Nietzsche et Camus : créer quelque chose. C’est l’idée du Zarathoustra : il faut assumer le surhomme, c’est-à-dire, l’idée qu’il faut la création, et même si l’univers, - Camus dit « le monde » -, même si le monde m’écrase, de façon toute pascalienne, il faut imaginer Sisyphe heureux. Heureux parce qu’il crée une œuvre. Et même s’il n’y a rien derrière ni devant, même s’il n’y a que l’attente de la mort, et la dislocation de toute chose, on peut essayer de donner un sens à cette vie par la création. Mais c’est une morale extrêmement aristocratique. D’où la critique de la démocratie chez Nietzsche et même chez Camus qui était pourtant un homme de gauche à l’origine. Vous ne pouvez pas proposer ce programme politique à six milliards d’êtres humains. Alors il ne nous reste plus qu’une attitude stoïcienne, ou le pessimisme d’un Cioran par exemple. Soit une vision tragique du monde, soit une vision pessimiste.
Penser la politique à partir de l’Europe, croyez-vous que cela soit possible ? Est-ce qu’on pourrait par exemple penser une politique européenne qui pourrait valoir pour le monde entier ?
Je l’écrivais dans un article du Figaro récemment[7] : pour faire l’Europe, on doit commencer par se mettre d’accord sur la définition même du mot « Europe ». J’en parle également dans mon livre. Alors qu’est-ce que cela recoupe le terme d’ E-U-R-O-P-E ? Cela renvoie-t-il seulement à un grand marché libre ?… Qu’est-ce que ça a de spécifique l’Europe ? On ne fera pas l’Europe politique, et même économique, si l’on ne se met pas d’accord sur les fondamentaux culturels, comme on parle de fondamentaux à l’école, c’est-à-dire : apprendre à lire, écrire et compter. Or, quels sont les fondamentaux européens ? Je ne suis pas sûr que l’école ou les Universités européennes les transmettent aujourd’hui, et ce, en dépit des programmes Erasmus. Voilà pourquoi les étudiants n’ont plus un sentiment vraiment européen. On n’a pas le cœur européen. Ni le cœur ni la tête ! Alors qu’est-ce qui reste ? La consommation et la télévision ?
Ce qui renvoie d’ailleurs au titre même de votre ouvrage Le Regard vide.
Vous avez noté que mon livre commence par un texte d’Edgar Poe : « Il entrait successivement dans toutes les boutiques, ne marchandait rien, ne disait pas un mot, et jetait sur tous les objets un regard fixe, effaré, vide. » Voyez la gradation qu’à fait Poe, et que Baudelaire, son traducteur, a bien suivi : « fixe, effaré, vide » ! C’est même plus fort dans la langue originale, car le mot anglais « vacant » signifie à la fois « vide », « privé de vie » et « ouvert sur rien ». Donc, « anéantissant ». J’ai repris cette image, car ce qui définit la pensée européenne, c’est un regard porté sur le monde, sur la cité, et sur l’homme. Toujours la même idée d’un regard distant, l’esprit de la critique dialectique depuis Socrate, ou la critique chez Voltaire, Diderot, etc. Tout le monde convient que l’Europe a inventé l’esprit critique au bon sens du terme. Ça n’est pas le scepticisme en un sens négatif. Voyez le texte de Rousseau que je cite : celui qui veut connaître les hommes doit regarder autour de lui, mais celui qui veut connaître l’Homme doit « porter ses regards au loin ». Il faut donc un regard éloigné, d’où le livre d’anthropologie de Claude Lévi-Strauss, Le regard éloigné, que je cite dans mon dernier chapitre[8].
D’où également le lien que vous faîtes avec Tocqueville et sa vision sceptique de la démocratie.
Il y a un phénomène d’épuisement de la démocratie qui est utilisée à tort et à travers et se trouve dissoute dans n’importe quoi. Certains auteurs disent aux Etats-Unis qu’il faut reconnaître un droit aux animaux et aux végétaux, une sorte de démocratie naturaliste en quelque sorte où tout ce qui est vivant aurait les mêmes droits que les êtres humains.
Par rapport à ces dérives, vous n’êtes pas très optimiste.
Pour revenir à l’idée développée plus haut, j’ai de plus en plus l’impression que l’on avance en aveugle : peut-être y aura-t-il un nouveau départ de l’Europe… Il se trouve que c’est en Europe que la culture dite universelle s’est développée au point d’être aujourd’hui mondialisée ; mais ce qui est mondialisé est peut-être ce qu’il y a de moins intéressant dans la culture. Une sorte d’économie de marché, mais qui n’a ni contenu spirituel ou intellectuel. Le fait de trouver des Mc Donald’s ou des Virgin partout, c’est surtout une manifestation de la culture économique ou financière, mais est-ce que cela donne un espoir de vivre aux êtres humains ?
Vous êtes un analyste critique de cette fin de la transcendance, et vous dîtes que nous sommes complètement englués dans l’immanence, pis, que nous sommes prisonniers d’un labyrinthe sans issue.
Regardez Joseph K. et le labyrinthe sans issue du Procès ou de l’Arpenteur du Château chez Kafka. Regardez Borges. Mais, une fois encore, Nietzsche a tout dit lorsqu’il écrit dans le Gai savoir que Dieu est mort (« L’insensé » : paragraphe 125). Il dit alors que la terre est dévastée de tout soleil. Vers où allons-nous à présent ? en haut en bas ? à droite à gauche ? On ne sait pas. Tout est éclaté. S’il n’y a plus de ciel, il n’y a plus de terre. Nietzsche a parfaitement compris, même si, pour parler comme Aragon, il ne croyait pas au ciel chrétien ni aux arrières-mondes platoniciens, que lorsqu’on détruit les arrières-mondes, on détruit en même temps le monde qui est accroché à lui en un accrochage symbolique. En bref, si vous détruisez la montagne, vous détruisez en même temps la vallée. Nous nous retrouvons alors dans un monde uniformément plat. Or une vallée ne se comprend qu’entre deux montagnes. Et voilà pourquoi Zarathoustra nous dit qu’il va nous ré-apprendre le sens de la terre. Il faut tout recommencer à zéro ; d’où la théorie d’un retour éternel chez Nietzsche. Mais il sait très bien que c’est anti-démocratique, et que seuls quelques esprits privilégiés pourront faire cela. En clair, ils donneront un sens à leur vie avant de mourir. Quant aux autres, Nietzsche est encore plus pessimiste que Pascal qui disait : « le dernier acte humain est sanglant », quoi qu’on dise, on jette un corps dans un trou avec quelques pelletées de terre dessus. Comme s’il n’y avait rien après. C’est le Pascal croyant qui disait cela... Mais Pascal s’en sort tout de même avec son argument du pari. Or, si vraiment on est mort pour rien, autant se pendre tout de suite ! Quand on voit la souffrance partout ! Le seul sens trouvé par Nietzsche ou Arendt, c’est la création : laisser quelque chose derrière soi…
Mais pour répondre à votre question, on ne sait pas si Nietzsche, d’autres penseurs ou d’autres artistes vont créer une nouvelle voie pour la recherche en général, étant entendu qu’il y a quand même une condition humaine qui jusqu’à présent n’a pas changé. Même si on vous change de cœur ou on fait de vous un anthropoïde, il y a une loi qui commande l’homme, ou le Dasein comme disait Heidegger, à savoir que toute chose est mortelle. Ce n’est pas simplement l’homme, mais tout dans l’univers, qui doit disparaître. C’est le principe de la dégradation de l’énergie. Tout va finir à la casse : une bouteille se vide, une pile électrique aussi. Même l’univers, ou du moins le nôtre, disparaîtra ! Et quand bien même continuerait-il à tourner, il n’y aurait de toute façon à terme plus personne pour le voir tourner. Et donc le monde, et tout ce qui existe, aura servira à quoi ? À rien ! Avec Nietzsche en revanche, on efface tout et on recommence. Mais qui va recommencer si on a tout effacé ?
Jean-François Mattéi, membre de l’Institut universitaire de France, est professeur émérite de philosophie à l’université de Nice-Sophia Antipolis et à l’Institut d’études Politiques d’Aix-en-Provence. Parmi une longue bibliographie d’œuvres philosophiques, il est notamment l’auteur de Le Regard vide, Essai sur l’épuisement de la culture européenne (Flammarion, 2007, Prix Montyon de littérature et de philosophie décerné par l’Académie française en 2008), L’Énigme de la pensée (Les Paradigmes, 2006), De l’indignation (La Table ronde, 2005), et de La Barbarie intérieure, Essai sur l’immonde moderne (PUF, Quadrige, 2004).
(Texte établi à partir de Le Regard vide, Essai sur l'épuisement de
la culture européenne, Flammarion, 2007.)
(Entretien paru dans Les carnets de la philosophie, n°5, oct-nov-déc 2008.)
00:05 Publié dans Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-françois mattei, entretien, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 décembre 2014
L'homme sans liens...
L'homme sans liens...
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Nous vous signalons la publication du douzième numéro de la revue Perspectives libres consacré à l'anomie qui frappe nos sociétés. La revue Perspectives libres, dirigée par Pierre-Yves Rougeyron, est publiée sous couvert du Cercle Aristote et est disponible sur le site de la revue .
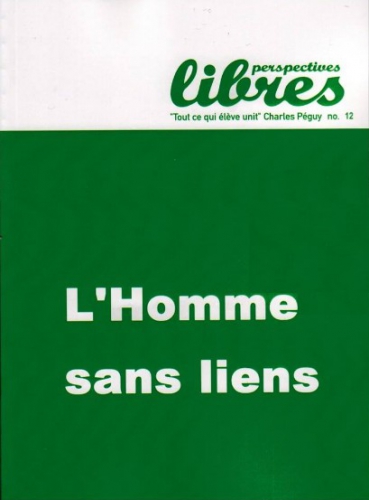
Présentation du numéro
« L’anomie de nos sociétés est aujourd’hui un fait sinon largement admis du moins globalement constaté avec une sorte de trépignement qui peut inquiéter. Ces germes de pourrissement social attirent à intervalles réguliers tout ce que la France et les sociétés dites avancées possèdent comme faune sociologique, entomologistes sociaux et autres inspecteurs de dépôt de bilan civilisationnel. Il y a quelque chose d’impudique – comme un fantasme de ruine – à contempler la tragédie avec gourmandise en priant de pouvoir abaisser le puce comme dans les arènes romaines devant la grande curée terminale censée emporter notre communion humaine dégradée en vulgaire vivre-ensemble.
C’est de cet homme délié car déraciné et par la même désincarné que nous allons esquisser un portrait ici. Délié face à ses semblables, face à tout destin collectif, il est désorienté dans le temps et de l’espace ; venu de rien, il n’entend aller nulle part. Déraciné car ne pouvant plus avoir de rapport à la terre et aux morts ; inapte à se figurer dans une société qui, comme l’avait souligné Auguste Comte, est faite de « plus de morts que de vivants ». Désincarné car ce qui fait de nous des êtres charnels, c’est ce qui nous distingue de l’autre à l’échelle individuelle, comme notre peau, ou à l’échelle collective, comme les clans, les nations, les frontières. Comment en sommes-nous arrivés là ?
[…]
Contre cette inhumanité qui vient, dominée par les puissances maîtrisant l’immatériel et l’approche réticulaire de la puissance, il faut reprendre la seule querelle qui vaille, « celle de l’homme » comme le disait le général de Gaulle. A cette fin, contre l’autonomie de l’individu auto-centré dans son néant, il faut redécouvrir l’incomplétude de nos sociétés. En effet, comme dans les théorèmes mathématique la solution se trouve peut-être à l’extérieur du problème : comme nos sociétés ne peuvent être leur propre référent, elles ont besoin de quelque chose qui les entoure, les pénètre et les unie, une transcendance civique ou religieuse. Cette transcendance doit être issue de notre histoire, de notre Tradition. Ce qui n’implique nullement une logique de passéisme mais une logique de transmission arrimée sur une nostalgie et sur une véritable conscience du passé. Il ne s’agit pas là des caricatures d’appartenance des idéologues du bien (parti espagnol/impérial, islamistes) mais d’une affirmation de soi tranquille et politique qui doit passer par des étapes de reprise en compte de soi et de mise à distance (la distance du dialogue) des autres. Commencer par se rendre compte que pour qu’il y ait eux et nous, il faut d’abord prendre conscience que la vraie fraternité implique que tous les hommes ne soient pas frères.
Pour ce faire, nous devons reprendre fierté et foi en nous et dans notre lignée. Pour préserver notre humanité, nous devons affirmer notre particularisme en tant que Français et le travailler jusqu’à le ressentir réellement, en nous rappelant que l’éthique est quelque chose de concret : prendre soin des siens d’abord. Politiquement, nous devons refaire communauté et nous battre pour la souveraineté et la gloire pour des objectifs clairement politiques. Comme à chaque fois où la France a failli être détruite, un camp des politiques doit se lever, car en la sauvant, nous sauvrons une part du génie humain, celui de nos ancêtres.
Les temps qui arrivent seront terribles, mais « [p]ourtant, à la fin des fins, la dignité des hommes se révoltera » »
Pierre-Yves ROUGEYRON, directeur de la rédaction.
Sommaire
Pierre-Yves ROUGEYRON : « Fraternité perdue »
Dossier : L’Homme sans liens
Marie-Céline COURILLEAULT : « L’Homme sans liens »
Michael Allen GILLESPIE : « La question de la Modernité et des possibilités de l’essor humain »
Jérémy-Marie PICHON : « L’Homo Canal +. Enquête sur un fascisme accompli : le Cool »
Maria VILLELA-PETIT : « Simone Weil et « L’Enracinement » »
Anthony ELLIOTT : « La Réinvention dans un monde au-delà des liens »
Jean-François GAUTIER : « Avec et sans lien(s) »
Stéphane VINOLO : « Le prisme diffractant du lien social »
Pierre-Antoine CHARDEL : « Une herméneutique sociologique dans la société liquide. Lecture de Zygmunt Bauman »
Libres pensées
Erik S. REINERT : « Le futur de la société d’information en Europe : contributions au débat »
Libres propos
Julien FUNNARO : « 1989 : l’anniversaire oublié »
Charles ROBIN : « « Mon ex est quelqu’un de bien ». Éloge de la décence amoureuse »
Dossier : Jean-François Mattéi
Pierre-Yves ROUGEYRON : « Jean-François Mattéi, le maître et le compagnon »
Marc HERCEG : « Esthétique et métaphysique dans l’œuvre de Jean-François Mattéi »
Jérôme PALAZZOLO : « La famille contemporaine face à la globalisation mondiale : approche systémique et anthropologique »
Marc ALPOZZO : « Entretien avec Jean-François Mattéi »
Pierre LE VIGAN : « Albert Camus, une vision grecque du monde »
00:05 Publié dans Philosophie, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, revue, jean-françois mattéi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 avril 2014
JEAN-FRANCOIS MATTEI Hommage à un humaniste européen
Jean Pierinot
Ex: http://metamag.fr
 Jean-François Mattéi, c'était d'abord un Grec. Homme d'une immense culture, profondément engagé dans la défense des plus hautes valeurs de l'humanisme européen, il s'inquiétait du déclin de l’Europe. Il laisse une œuvre de première importance consacrée autant aux philosophes grecs, dont il était un éminent spécialiste, qu’à Heidegger, Nietzsche, ou Camus.
Jean-François Mattéi, c'était d'abord un Grec. Homme d'une immense culture, profondément engagé dans la défense des plus hautes valeurs de l'humanisme européen, il s'inquiétait du déclin de l’Europe. Il laisse une œuvre de première importance consacrée autant aux philosophes grecs, dont il était un éminent spécialiste, qu’à Heidegger, Nietzsche, ou Camus.
Décédé ce lundi, à Marseille, Jean-François Mattéi était né à Oran, en Algérie, le 9 mars 1941. Il fut un professeur de philosophie grecque et de philosophie politique de renom, ancien élève de Pierre Aubenque et de Pierre Boutang. Il était un intellectuel engagé, à contre-courant du politiquement correct.
L’ouvrage qui le fit connaître au grand public fut incontestablement La barbarie intérieure, publié aux P.U.F. en 1999. Dans cet ouvrage, il dénonçait le monstrueux égalitarisme qui aplatit tout et qui nous prive du sens de l’excellence sans lequel rien de grand ne peut naître ni s’imposer.
Dans l'un de ses derniers essais, L'Homme indigné (paru aux éditions du Cerf en novembre 2012), il apporte son point de vue sur le sentiment de révolte - accru dans notre société actuelle -, à la lumière de Dostoïevski, Philip Roth, Nietzsche et Tom Wolfe.
Dans son ouvrage, "Le procès de l'Europe", Jean-François Mattéi exalte la culture européenne. Interviewé par Le Point, il évoquait sa conception de l’Europe : « L'Europe est essentiellement une identité culturelle qui n'a jamais réussi à réaliser son unité politique. Ce ne fut pas le cas à l'époque des Romains, puisque l'Empire s'est effondré. Ce ne fut pas le cas ensuite à l'époque de Charlemagne, ni même à celle de Napoléon. C'est d'autant plus paradoxal que ce sont l'Europe et les Européens qui ont inventé la politique et la démocratie. Or l'Europe n'est pas parvenue à s'unir, alors qu'elle avait trois facteurs d'unité évidents : la science grecque, le droit romain et la religion chrétienne, qui fut son ciment culturel. Ce qui m'intéresse, c'est donc moins l'Europe actuelle dans ses échecs que la substance culturelle qui la constitue dans ses réussites. ».
 Jean-François Mattei, le pied-noir d’Oran qui a quitté son pays en 1962 défendait, au nom de la fidélité à ses origines, la colonisation. Pour lui, « loin d'être l'abomination que l'on dénonce aujourd'hui, et en dépit de ses abus et de ses violences, la colonisation a été le processus historique de développement de l'humanité dans sa recherche de principes et de savoirs universels. »
Jean-François Mattei, le pied-noir d’Oran qui a quitté son pays en 1962 défendait, au nom de la fidélité à ses origines, la colonisation. Pour lui, « loin d'être l'abomination que l'on dénonce aujourd'hui, et en dépit de ses abus et de ses violences, la colonisation a été le processus historique de développement de l'humanité dans sa recherche de principes et de savoirs universels. »
Il s’était opposé à la mode actuelle de la repentance « parce que cela permet à certains de nos contemporains de se donner bonne conscience à peu de frais en battant leur coulpe sur les crimes de leurs prédécesseurs ».
Jean-François Mattei était avant tout un philosophe ancré dans le réel. Européen lucide, il manquera dans le débat à venir.
En savoir plus :
L’identité de l’Europe, PUF, juin 2010 (Sous la direction de Chantal Delsol et de Jean-François Mattéi)
Le Regard vide / Essai sur l’épuisement de la culture européenne, Flammarion, 2007.
La République brûle-t-elle ? : Essai sur les violences urbaines françaises, Ed Michalon, 2006(Sous la direction de Raphaël Draï et de Jean-François Mattéi)
La crise du sens, Ed Cécile Defaut, octobre 2006
L’énigme de la pensée, Ed Ovadia, novembre 2006
Nietzsche et le temps des nihilismes, PUF, août 2005 (Sous la direction de Jean-François Mattéi)
De l’indignation, Paris, La Table Ronde, 2005
La Barbarie intérieure, PUF, 1999
3 QUESTIONS A Jean François MATTEI

00:05 Publié dans Actualité, Hommages, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, actualité, philosophie, jean-françois mattei |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



