
Julien Freund : La fin des conflits ?
par Chantal Delsol
Ex: https://www.chantaldelsol.fr
Communication prononcée au colloque Julien Freund, Strasbourg, 2010
On sait que Julien Freund ne croit pas à la fin possible des conflits dans le monde humain. C’est bien d’ailleurs ce postulat, fondamental dans sa philosophie, qui l’avait opposé à son premier directeur de thèse, Jean Hyppolite, l’avait conduit à chercher un autre directeur de thèse qu’il avait trouvé en la personne de Raymond Aron, et avait occasionné un débat pathétique et drolatique avec Hyppolite lors de la soutenance de thèse.
L’accusation d’utopisme porté par Freund aux pacifistes ne l’englue pas dans un empirisme cynique, mais laisse la porte ouverte à une espérance qui est d’une autre sorte. Je voudrais montrer que cet idéal, outre qu’il marque l’empreinte religieuse dans l’esprit de notre auteur, signe la marque de son temps : il n’a pas pu voir quel genre de « fin des conflits » est attendue aujourd’hui, tout autre que celle des utopies présentes à son époque. Ce qui montre l’inscription de sa pensée dans une époque, en même temps que sa pérennité.
Appartenant à cette minuscule espèce des intellectuels non-marxisants de son temps, Freund use une bonne partie de son énergie à argumenter contre les utopies de la paix universelle. Il aime partir de l’argument kantien : si les rois européens ont réussi à éteindre les conflits privés sur leurs terres afin de constituer des Etats souverains nantis du monopole de la violence légitime, pourquoi un Etat universel ne pourrait-il un jour éradiquer les conflits inter-étatiques ? L’idée est belle, elle appelle l’instauration du souverain bien, si l’on veut apercevoir que le bien, inverse du diabolos, est lien, sumbolos – donc paix et fraternité. Mais l’instauration du souverain bien, déclinée comme un programme politique international, est simplement « l’un des rêves du socialisme ». La paix sous cet aspect universel et abstrait est une valeur non médiatisée, donc impraticable, car dès qu’il faudra en donner la définition, les conflits se développeront à ce sujet (« rien n’est plus ‘polémogène’ que les idées divergentes sur la perfection », Politique et Impolitique, Sirey, 1987, p.207). Pour Freund, les conflits existent simplement parce que les hommes nourrissent des croyances et des attachements, au nom desquels ils se querellent, et vouloir annihiler les conflits serait vouloir priver les hommes de pensée. Si l’on reprend un slogan actuel qui marque la misanthropie de notre contemporain : « les animaux, eux, au moins, ne se battent que pour manger », on pourrait dire que pour anéantir les conflits humains il faudrait tous nous décerveler, nous ramener à l’état animal… Cela signifie que l’Etat mondial ne sera pas soustrait, parce qu’unique, aux querelles et combats internes, d’autant qu’il pourra aisément, parce qu’unique, se retourner contre ses peuples (qui jugera le juge ultime ?). Freund se saisit lui aussi de la conclusion du dernier Kant : un Etat mondial serait despotique.
Il reste que la notion de « nature humaine », expression que Freund utilise souvent -je préfèrerais « condition humaine », qui est moins statique et moins fondée dans une dogmatique-, est plurivoque.
La « nature humaine » sous entend des caractères humains immuables et enracinés dans des spécificités : essentiellement, ici, quand il s’agit de la pérennité des conflits, la liberté humaine devant l’impossibilité d’atteindre la Vérité, et donc le débat infini entre les croyances ; et en même temps, l’enracinement de l’homme dans une culture particulière qu’il ne pourra que défendre face aux autres et contre les autres.
Mais aussi, la « nature humaine » comprise dans la dimension de l’espérance, sous entend que l’homme partout et toujours vise le bien parfait, entendu universellement comme un lien.
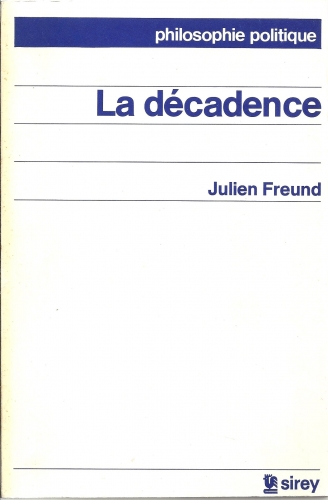 Ainsi, la paix est un idéal, et en tant que telle, comme l’espérance d’Epiméthée, elle mérite nos efforts plus que nos ricanements. Il est juste que nous fassions tout pour faire advenir une paix lucide, sachant bien qu’elle ne parviendra jamais à réalisation. En ce sens, l’aspiration à la société cosmopolite est une aspiration morale naturelle à l’humanité, et vouloir récuser cette aspiration au nom de la permanence des conflits serait vouloir retirer à l’homme la moitié de sa condition. En revanche, prétendre atteindre la société cosmopolite comme un programme, à travers la politique, serait susciter un mélange préjudiciable de la morale et de la politique. Parce que nous sommes des créatures politiques, nous devons savoir que la paix universelle n’est qu’un idéal et non une possibilité de réalisation. Parce que nous sommes des créatures morales, nous ne pouvons nous contenter benoîtement des conflits sans espérer jamais les réduire au maximum. Le « règne des fins » ne doit pas aller jusqu’à constituer une eschatologie politique (qui existe aussi bien dans le libéralisme que dans le marxisme, et que l’on trouve au XIX° siècle jusque chez Proudhon), parce qu’alors il suscite une sorte de crase dommageable et irréaliste entre la politique et la morale. Mais l’espérance du bien ne constitue pas seulement une sorte d’exutoire pour un homme malheureux parce qu’englué dans les exigences triviales d’un monde conflictuel : elle engage l’humanité à avancer sans cesse vers son idéal, et par là à améliorer son monde dans le sens qui lui paraît le meilleur, même si elle ne parvient jamais à réalisation complète.
Ainsi, la paix est un idéal, et en tant que telle, comme l’espérance d’Epiméthée, elle mérite nos efforts plus que nos ricanements. Il est juste que nous fassions tout pour faire advenir une paix lucide, sachant bien qu’elle ne parviendra jamais à réalisation. En ce sens, l’aspiration à la société cosmopolite est une aspiration morale naturelle à l’humanité, et vouloir récuser cette aspiration au nom de la permanence des conflits serait vouloir retirer à l’homme la moitié de sa condition. En revanche, prétendre atteindre la société cosmopolite comme un programme, à travers la politique, serait susciter un mélange préjudiciable de la morale et de la politique. Parce que nous sommes des créatures politiques, nous devons savoir que la paix universelle n’est qu’un idéal et non une possibilité de réalisation. Parce que nous sommes des créatures morales, nous ne pouvons nous contenter benoîtement des conflits sans espérer jamais les réduire au maximum. Le « règne des fins » ne doit pas aller jusqu’à constituer une eschatologie politique (qui existe aussi bien dans le libéralisme que dans le marxisme, et que l’on trouve au XIX° siècle jusque chez Proudhon), parce qu’alors il suscite une sorte de crase dommageable et irréaliste entre la politique et la morale. Mais l’espérance du bien ne constitue pas seulement une sorte d’exutoire pour un homme malheureux parce qu’englué dans les exigences triviales d’un monde conflictuel : elle engage l’humanité à avancer sans cesse vers son idéal, et par là à améliorer son monde dans le sens qui lui paraît le meilleur, même si elle ne parvient jamais à réalisation complète.
Or sur quoi repose cette notion d’idéal, et l’espérance qui la fonde ? Sur une vision du temps fléché, vision apparue avec les judéo-chrétiens et poursuivie à partir de la saison des Lumières grâce à la croyance au Progrès. Julien Freund se situe dans le temps fléché.
Dans la conclusion de Politique et Impolitique, Freund évoque la désaffection du politique, désaffection en plein développement. Il la lie au désir de destruction qui caractérise les courants extrêmes de son époque, et il évoque la complexité croissante des problèmes et l’identification de la politique et de la technique. Mais Freund n’a pas connu le développement tout récent d’un âge vraiment technocratique, notamment à partir du « gouvernement » européen depuis le début des années 90. Il s’agit là d’une gestion plutôt que d’un gouvernement, d’une administration au sens où Platon prétendait qu’ « il n’y a pas de différence de nature entre une grande oikos et une petite polis » (aussitôt critiqué à ce sujet par Aristote dans La Politique). Freund n’a pas connu le déploiement récent de l’idée de « gouvernance », et la fascination qu’exerce sur nous l’idée de consensus.
Le consensus, « mot-hourrah », représente une aspiration permanente depuis la fin du XX° siècle, et traduit la méfiance vis à vis du vote majoritaire en vigueur en Europe depuis le XIII° siècle (et même depuis le VII° siècle dans les monastères). Le consensus était le système de décision qui prévalait dans toutes les assemblées populaires anciennes, depuis le purhum mésopotamien jusqu’au fokonolona merina malgache, en passant par les diverses assemblées populaires de la plupart des peuples avant l’apparition des régimes autocratiques. Le regain du consensus se développe d’abord aujourd’hui dans les sociétés scandinaves, mais il se déploie dans les organisations internationales (ce qui est logique, puisque chaque pays y représente une souveraineté : il faut s’y soumettre dans la plupart des cas à une sorte de liberum veto). Le consensus est à la mode dans les instances dites de gouvernance, assemblées horizontales censées se substituer à la souveraineté et à la contrainte gouvernementale, ou au moins s’y surajouter. La gouvernance, type de gouvernement sans gouvernement, voudrait remplacer le débat entre les visions du monde par la négociation des intérêts. Dans un monde dénué désormais de croyances et d’idéologies communes, et marqué par le matérialisme, la querelle entre les finalités (ou guerre des dieux) est censée être remplacée par un compromis entre les intérêts matériels (on peut négocier les intérêts, mais on ne peut négocier les croyances).
L’appel au consensus s’accompagne de la récusation de la démocratie, récusation présente depuis peu d’années (alors que la démocratie se trouvait encore en pleine gloire après la chute du Mur). Les perversions démocratiques (corruptions des gouvernants), la lassitude des citoyens marginalisés (absentéisme électoral massif), l’accusation d’incompétence des citoyens devant des décisions de plus en plus complexes, et en outre, le soupçon devant un peuple conservateur voire sauvage (vote sur les minarets en Suisse), apportent de l’eau au moulin des antidémocrates et suscite l’avènement d’une ère technocratique, du gouvernement des experts – dans son Livre Blanc de la Gouvernance, la Commission européenne parle d’expertise et non de gouvernement. C’est, en termes grecs, le remplacement de la polis par l’oikos.
Ces évolutions extrêmement rapides traduisent une nouvelle manière de voir la société, en terme de fin attendue des conflits. Elles sous entendent :
– la recherche de la paix comme unique horizon : répondant à la fatigue du fanatisme partout présent au XX° siècle, fanatisme suscité par la multiplicité des croyances. On pouvait dire : fiat justitia pereat mundus, on pouvait dire : que le monde périsse, pourvu qu’il nous reste la classe pure ou la race pure, au moins on ne peut plus dire : que le monde périsse, pourvu qu’il nous reste la paix, ce serait contradictoire dans les termes.
– des sociétés marquées par le soin exclusif de la vie quotidienne, qui se négocie toujours, et probablement la gouvernance indique-t-elle des sociétés corporatistes ou « organiques », communautaires selon les adeptes de la philosophie pragmatiste qui se trouve à la pointe de ces changements de mentalité.
– la fin des idéologies, certes, mais plus encore : la fin des visions du monde pluralistes au sens de la fin des croyances en des « vérités » plurielles.
Le consensus, qui remplace l’attente d’un monde meilleur par la recherche permanente de la paix, enferme le monde social en lui-même et par là nous sort de la flèche du temps. La vie morale sans recherche de vérité nous replace dans le monde de la sagesse qui avait cours avant les monothéismes et qui a cours dans toutes les civilisations hors la nôtre. C’est là un changement de monde tel que Freund n’a pu le prévoir. Cela ne remet pas en cause sa pensée, selon laquelle le monde politique s’enracine dans le conflit, et selon laquelle le conflit demeure essentiel à l’humain, parce que les tragiques questions humaines sont médiatisées par de multiples cultures. Car même dans les sociétés structurées par des sagesses, les conflits surviennent pour des raisons de territoires ou de puissance, hors les conflits religieux ou idéologiques inexistants. C’est dire que dans l’avenir, les combats idéologiques ont toute chance d’être remplacés, non par la paix consensuelle qui est encore une utopie, mais par des conflits d’identités : la fin des « vérités » de représentation (liberté, justice, droits de l’homme), engendrera le retour des « vérités » d’être (patries, tribus).
Il n’en reste pas moins que cette tentative nouvelle pour biffer les conflits était difficile à prévoir dans la seconde moitié du XX° siècle, même si les appels étaient fréquents dès après-guerre à la féminisation du monde (Giono, Camus, Gary) qui en est un signe avant-coureur. Freund se situe dans un monde dominé par les idéologies, qu’il récuse, et dans la vision du temps fléché, qui lui inspire l’idéal d’une paix toute kantienne (s’agissant du dernier Kant). La rupture dans laquelle nous sommes se produit juste après lui. Nous aimerions qu’il soit encore là pour analyser cet aspect du post-moderne qu’il n’a pas pu voir.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
Les commentaires sont fermés.