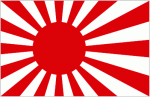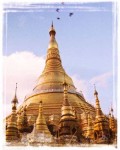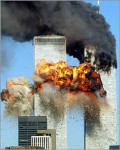Les empires océaniques des steppes et des mers ouvertes
Guido GIANNETTINI
L'empire qui a connu la plus grande expansion au cours de l'histoire a été celui des Mongols, qui ont proclamé leur chef Djingghis Khan (Gengis Khan), soit le “souverain océanique”. C'est dans ce sens que je vais parler, dans cet exposé, d'“empires océaniques”. Les “empires océaniques” des steppes sont originaires d'Asie Centrale, justement comme celui des Mongols. Les “empires océaniques” des mers extérieures se sont constitués à partir du 16ième siècle de notre ère sous l'impulsion des grandes puissances européennes qui se sont projetées sur les mers du globe.
Il existait toutefois, avant ces deux types d'empires “océaniques”, un type différent, anomal, qu'on pourrait attribuer au type “océanique”: c'est celui qui s'est constitué au départ de l'expansion des cavaliers arabes entre le 7ième et le 8ième siècles de notre ère et qui s'est dissous en l'espace d'un matin. Il s'agit à mes yeux d'une apparition mystérieuse et inexplicable sur la scène de l'histoire. Mais c'est un mystère que je me dois d'expliquer avant de passer à l'argument spécifique de mon exposé.
L'expansion des cavaliers arabes entre le 7ième et le 8ième siècles de notre ère est une expansion veritablement hors norme, que l'on ne pourra pas comparer à un autre exemple historique semblable, antérieur ou postérieur. D'un point de vue géopolitique, cette expansion paraît absurde.
Il n'existe aucun exemple de conquête par voie de terre partie d'une péninsule (la péninsule arabique) qui ait pénétré profondément dans la masse continentale (l'Asie occidentale) puis s'est étendue sur un littoral très long mais sans aucune profondeur (l'Afrique du Nord). Dans tout le cours de l'histoire, on n'a jamais vu quelque chose de semblable. D'un point de vue géopolitique, les conquêtes arabes présentent toutes les caractéristiques des expansions propres aux puissances navales, qui, elles, procèdent par “lignes extérieures”, sur les marges des masses continentales. Dans le cas de l'expansion arabe, nous avons une occupation d'une bande littorale, mais effectuée par voie terrestre.
Les causes de cette expansion hors norme sont au nombre de deux. Tout d'abord, il faut savoir que le désert est comme la mer: on ne peut pas l'occuper, on peut simplement tenir en son pouvoir les oasis, comme la puissance maritime occupe et tient en son pouvoir les îles de l'océan. La seconde cause doit être recherchée dans le caractère fortuit, inconsistent, inexistent des conquêtes —en langue arabe il existe un terme indiquant quelque chose qui n'existe pas, mahjas, dont dérive le mot italien mafia; c'est quelque chose d'inexistent mais qui existe tout de même. Nous avons donc affaire à un empire territorial créé à parti de ce rien qui est tout de même quelque chose.
L'expansion des Arabes au départ de leur péninsule d'origine a été rendue possible par une série inédite de facteurs fortuits, tous concentrés dans le même espace temporel. En premier lieu, l'expansion arabe a bénéficié de la faiblesse intrinsèque, à l'époque, des empires byzantin et sassanide, littéralement déchiquetés par plus de vingt années de guerres ruineuses où ils s'étaient mutuellement affrontés. Cet état de déliquescence mettait quasiment ces empires dans l'impossibilité d'armer des troupes et de les envoyer loin, à mille, à deux mille kilomètres de leur centre, où même plus loin encore, contre ce nouvel ennemi qui déboulait subitement du désert. Pire, il leur était impossible de reconstituer des armées dans des délais suffisamment brefs, si celles-ci étaient détruites. En effet, une puissante armée byzantine avait été anéantie sur le Yarmouk en 636 et une autre, sassanide, avait été écrasée par les Arabes à Nehavend en 642. La raison de cette double défaite était d'ordre climatique: le vent du désert, le simoun (de l'arabe samum), avait soufflé dans leur direction pendant plusieurs jours d'affilée, les avait immobilisés et assoiffés, tandis que leurs adversaires arabes combattaient avec le vent qui les poussait dans le dos, sans qu'ils ne fussent génés en rien par la tempête de sable.
Autre facteur qui a rendu aisée l'expansion des Arabes: les luttes intestines qui divisaient les Byzantins, d'un côté, les Wisigoths d'Espagne, de l'autre. L'empire byzantin venait de traverser une tumultueuse querelle d'ordre religieuse, assortie d'un cortège de violences et de persécutions. Pour toutes ces raisons, entre 635 et 649, les autorités religieuses et les populations ont confié spontanément aux Arabes les villes de Damas, Jérusalem, Alexandrie d'Egypte, de même que l'île de Chypre. Ensuite, à cette époque-là, les autorités musulmanes se montraient tolérantes (au contraire des fanatismes intégralistes que l'on a pu observer par la suite) et se sont empressées de souligner les traits communs unissant les fois chrétienne et islamique. Elles ont accepté que les habitants de confession chrétienne dans les cités conquises exercent librement leur culte et se sont borné à lever une taxe, modérée en regard de ce qu'exigeait auparavant le basileus byzantin.
La conquête de l'Espagne s'est déroulée dans des conditios analogues. Après le décès du roi wisigoth Wititsa, deux prétendants se sont disputé le trône: Roderich et Akila. Ce dernier a fait appel aux Arabes et leur chef, Tariq Ibn Ziyad débarque en 711 dans la péninsule ibérique en un lieu qui porte encore son nom, Gibraltar, de l'arabe Djabal Tariq, “la montagne de Tariq”. Son armée est forte de 7000 hommes, en grande partie originaires du Maghreb. Ils seront suivis par d'autres. Les Arabes et les Wisigoths partisans d'Akila finissent par avoir raison des Wisigoths partisans de Roderich. Ces derniers sont attaqués dans le dos par les Basques et par la communauté juive, qui est particulièrement nombreuse en Ibérie (elle est la plus forte diaspora d'Europe). Les Juifs se soulèvent, équipent une armée et s'emparent de plusieurs villes qu'ils livrent aux Arabes, tandis que les féaux de Roderich commencent à déserter.
Toutefois, les Arabes, malgré ce concours de circonstances favorables, ont eu du mal à briser la résistance des Wisigoths. Ils n'ont pas pu occuper toute la péninsule ibérique, parce que les montagnards du Nord et des Cantabriques ont repoussé toutes leurs tentatives de conquête. Ensuite, après avoir tenté de pénétrer en France, les Arabes sont définitivement vaincus en 732 près de Poitiers. La défaite de Poitiers, ainsi que l'échec de l'attaque contre Constantinople, mettent fin à l'expansion arabe.
Le déclin a été quasi immédiat. A peine 23 ans après avoir atteint le maximum de son expansion —à la veille de la bataille de Poitiers— le grand empire arabe de Samarcande à l'Atlantique commence à se désagréger: en 755, le Califat ommayade d'Espagne fait sécession, suivi immédiatement par d'autres Etats arabes séparatistes du Maghreb, d'Egypte et d'Orient. Mais un grand empire avait existé, pendant peu de temps, il n'a tenu que 23 ans!
Un empire rêvé, crée par un peuple de rêve et forgé par une culture imaginée: mahjas. En effet, le peuple arabe, créateur de cet empire, n'était pas un peuple selon l'acception commune, c'est-à-dire la fusion de tribus sœurs issues d'un même désert arabique; il n'allait pas le devenir non plus, mais au contraire, juxtaposer en sa communauté de combat des peuples de plus en plus différents, issus des pays conquis.
Mais la culture arabe, elle, est plus homogène. L'islamisme est une forme de syncrétisme religieux alliant des élements de judaïsme et de christianisme et reprenant à son compte des courants chrétiens considérés comme “hérétiques”. La philosophie arabe est une reprise pure et simple de la philosophie grecque, basée sur la dichotomie Platon/Aristote. Les bases des connaissances mathématiques, astronomiques, géographiques, physiques et même ésoteriques dans le monde arabe au temps de la grande conquête sont d'origines grecque et persane. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la pensée arabe est une pensée ouverte aux cultures grecque et iranienne (car l'ancienne civilisation du pays d'Aryanam n'est pas orientale). C'est patent à l'époque du Califat abasside, quand l'Islam, après la chute de l'empire sassanide, a subi directement et puissamment l'influence des peuples conquis.
L'art arabe en général, comme l'art mauresque en Espagne, est constitué de variantes de l'art roman ou byzantin. Enfin, les chiffres considérés comme “arabes” sont en fait indiens, mais les Arabes les ont transmis à l'Europe. Comme du reste d'autres faits de culture venus des régions indo-européanisées d'Asie, tel le jeu d'échecs, qui est iranien, mais nous est parvenu grâce à la médiation arabe.
En réalité, les Arabes ont surtout exporté leur langue en Afrique et en Orient. Mais comme on peut observer que les langues sémitiques sont très proches les unes des autres, et ne sont finalement que des dialectes d'une même langue, cette similitude a favorisé la diffusion de l'arabe dans de nombreuses régions.
Le grand atout de la culture arabe au temps de la grande conquête a été l'extraordinaire capacité, et même le mérite, d'appréhender sans frein tout ce qui venait d'ailleurs, de le remodeler et de le diffuser tous azimuts. Une telle capacité, même si elle peut être interprétée comme un absence de spécificité propre, a contribué à atténuer les rigidifications à l'œuvre dans le monde entourant les Arabes, rigidités qui expliquent aussi l'expansion fulgurante de ceux-ci, qui serait incompréhensible autrement.
Pendant près de 1800 ans, du début du Vième siècle ap. J.C., jusqu'à l'époque de Gengis Khan, les peuples turcs ont dominé l'Asie centrale septentrionale, puis se sont répandus dans l'Asie occidentale pour donner ensuite l'assaut à l'Europe. Cette phase d'expansion commence vers l'an 1000, quand la domination turque en Asie n'est pas encore achevée. Elle se manifeste surtout dans la longue lutte contre l'empire byzantin, qui se terminera par la chute de Constantinople (1453) et par les raids dans l'espace danubien. La phase descendante commence, elle, par l'échec du siège ottoman de Vienne (1683) et surtout par la reconquête du Sud-Est européen sous l'égide du Prince Eugène, actif dans la région de 1697 à1718, puis de ses successeurs qui guerroyèrent pendant vingt ans pour imposer aux Ottomans la Paix de Belgrade en 1739.
Même sans prendre en considération les 180 dernières années de vie de l'Empire ottoman —depuis la Paix de Belgrade jusqu'à sa fin en 1918— nous constatons que l'expansion de cette puissance turque s'étend sur un arc de treize siècles, pendant lesquels les peuples turcs, habitant à la charnière de l'Europe et de l'Asie, ont joué un rôle primordial parmi les protagonistes de l'Histoire. Il ne s'agissait certes pas d'un Etat unique et d'un peuple unique et cette histoire a connu des phases sombres et de déclin, mais cela s'observe également dans l'histoire de l'empire romain ou des empires des divers peuples de l'Iran, les Mèdes et les Perses, les Parthes et les Sassanides.
La préhistoire des peuples turcs présente encore beaucoup de zones d'ombre et d'incertitudes, comme du reste celle des peuples mongols. Malgré ces difficultés, nous pouvons affirmer aujourd'hui que le peuple proto-turc le plus ancien —le nom “Turc” ne se diffusera qu'ultérieurement— apparaît sur le théâtre de l'Histoire vers l'année 400 de notre ère: c'est le peuple des Tabgha'c, originaires d'Asie septentrionale, qui, en 70 ans à peu près, domine toute la Chine septentrionale, depuis les Monts Dabie Shan (limite septentrionale des affluents de la rive gauche du fleuve Yang-Tse). Ce sont eux qui fondent la dynastie Wei.
Tandis que les Proto-Turcs Tabgha'c descendent sur la Chine du Nord, en Asie septentrionale, dans la région dont les Tabgha'c sont originaires, se rassemble le peuple des Juan-Juan, connus également sous le nom de Ju-Jan, Ju-Ju ou Jui-Jui. Certains savants les identifient aux War ou Apar ou Avars qui atteindront la Hongrie. D'autres prétendent qu'ils ne sont pas identiques mais parents. Les Juan-Juan étaient des Proto-Mongols, mais leur empire a englobé aussi des peuples proto-turcs ou turcs, paléo-asiatiques et, forcément, des tribus d'autres ethnies.
Vers 520, leur empire commence à s'affaiblir, puis tombe en déclin, à la suite d'une révolte de deux clans que les sources chinoises appellent respectivement les T'u-küeh et les Kao-kü.
Les premiers sont originaires des Monts Altaï et sont les ancêtres des Turcs, le terme chinois T'u-küeh correspondant à Türküt, pluriel mongol de Türk, c'est-à-dire “homme fort” en langue turque. Notons toutefois que quelques auteurs interprètent le terme “Türk” comme un pluriel, “Tür-k”, par analogie à “Tur-an”, pluriel de “Tur”: dans ce cas, il s'agirait d'une reprise par les Turcs d'une dénomination d'origine iranienne, désignant l'“Iran extérieur”. Ensuite, l'autre clan en révolte contre les Juan-Juan était également turc, c'était celui des Tölös, ancêtres des Ouighours.
C'est ainsi que les Turcs, sur les ruines de l'empire des Juan-Juan, ont fondé leur propre empire, s'étendant de Jehol (aux confins de la Mandchourie moderne) jusqu'à la Mer d'Aral, territoire correspondant à toute la zone méridionale du Heartland de Mackinder. Pendant 300 ans environ, l'empire turc —malgré sa division en deux Etats (quasiment depuis le début), l'un oriental, l'autre occidental— a dominé le cœur de l'Asie. Puis, vers la moitié du VIIIième siècle, sa partie orientale est absorbée par les Ouighours, eux aussi d'origine turque, tandis que la partie occidentale se fractionne en khanats indépendants.
A partir du khanat des Oghuz, situé dans un territoire au nord du Lac Balkach, se profile d'abord le clan des Seldjouks, qui amorce par la suite un mouvement vers l'Ouest, leur permettant d'abord de conquérir l'Iran oriental, puis l'Iran occidental, ce qui les rend maîtres du versant sud-occidental du Heartland. C'est après la consolidation de cette phase-là de leurs conquêtes, que les Seldjouks se mettent à attaquer l'Empire romain d'Orient (Byzance), bastion avancé de l'Europe contre les invasions venues d'Asie. D'un point de vue géopolitique, il s'agit de la même ligne d'expansion qu'avaient empruntée précédemment les empires iraniens.
Mais les Seldjouks ne sont jamais arrivés en Europe. La dynastie des Osmanli se profile au XIIIième siècle en Anatolie, prend le contrôle de la partie occidentale de l'empire seldjouk et réamorce les pressions expansives en direction de l'Occident. Les Osmanlilar —pluriel turc qui désigne ceux que les Occidentaux appellent les Ottomans— s'emparent de toute l'Anatolie et, sans tenter de conquérir l'enclave byzantine que sont Constantinople et la Thrace orientale— passent en Europe, atteignent le Danube au cours du XIVième siècle. Ce n'est qu'après avoir atteint le Danube que les Turcs lancent l'ultime assaut contre Constantinople qu'ils conquièrent en 1453.
Ensuite, une série de campagnes militaires les amènent aux portes de Vienne qu'ils assiègent en 1683. Au même moment, les Ottomans, disposant de la plus forte puissance musulmane, deviennent les protecteurs du monde islamique et imposent leur autorité aux Etats arabes d'Afrique du Nord et du Maghreb.
Pourtant, l'histoire de l'expansion ottomane nous apprend que l'on ne peut pas contrôler l'Europe seulement en contrôlant les côtes méridionales de la Méditerranée. En pénétrant par le Sud-Est, à travers les Balkans et l'espace danubien, les Ottomans atteignent la porte d'entrée du cœur de l'Europe, Vienne et Pressburg/Bratislava. Leur calcul était clair: ou bien ils franchissaient cette porte et s'emparaient de l'Europe, ou bien ils étaient refoulés. L'avancée des Trucs en direction du cœur germanique de l'Europe a été bloquée. Les Européens ont reconquis les Balkans. Les Osmanlilar sont tombés en décadence. Les Turcs, comme toutes les tribus ouralo-altaïques avant de commencer leur expansion, habitaient les steppes eurasiatiques, dans des territoires voisins de ceux qu'avaient occupés plusieurs peuples indo-européens entre le IIIième et le IIième millénaires avant J.C. Ce voisinage a provoqué des échanges, ce qui a donné, à la longue, des similitudes culturelles entre Indo-Européens et Proto-Turcs: par exemple, le caractère guerrier de leurs sociétés, l'association homme/cheval et la structure hiérarchique et patriarcale des sociétés. En matières religieuses —l'islamisation des Turcs n'aura lieu que très tard et ne concernera que les Turcs d'Asie occidentale— nous constatons une typologie céleste et solaire des divinités suprêmes.
Citons par exemple Tenggri, “le dieu bleu du Ciel“ ouralo-altaïque, ou le bi-Tenggri turc, phrase signifiant “Dieu est” que l'on a retrouvé grâce à la tradition hsiung-nu. Elle se rapproche de la racine indo-européenne du nom de Dieu, *D(e)in/Dei-(e)/Dyeu, signifiant “lumière active du jour, splendeur, ciel”. L'origine ethnique des Turcs, selon leur Tradition, présente une analogie singulière avec l'origine mythique de Rome: le totem des Turcs était le loup et leur héros éponyme aurait été alaité par une louve, exactement comme Romulus et Remus.
Enfin, à la fin des temps archaïques, la culture indo-iranienne s'est imposée à toute l'Asie centrale. Cette influence a également marqué les Turcs Seldjouks aux XIième et XIIième siècles après J.C., quand ils se sont répandus à travers le territoire iranien et ont retrouvé une sorte de familiarité avec la culture iranienne, dans la mesure où les chefs et les souverains conquérants se paraient ostentativement de noms tirés des textes épiques du Shahnameh, comme Kai Kosrau, Kai Kaus, Kai Kobad.
Plus tard, les Ottomans, surtout après la conquête de Constantinople, ont voulu montrer qu'ils assuraient la continuité de l'empire byzantin. D'abord, ils installent leur capitale dans la ville même de Constantinople, en ne changeant son nom qu'en apparence, car Istanbul dérive de “is tin pol”, prononciation turque de la désignation grecque “eis ten polis”, soit “ceux qui viennent dans la Cité”.
Dans leur bannière, les Ottomans ont repris la couleur rouge de Byzance, la frappant non pas de l'étoile et du quart de lune actuels, mais du soyombo altaïque, qui possède la même signification que le t'aeguk coréen représentant le yin et le yang, c'est-à-dire l'union du soleil et de la lune que l'on retrouve encore dans les drapeaux mongol et népalais: le soleil y est un astre à plusieurs rayons (de nombre paire), la lune y est un croissant comme dans le premier et le dernier quart de ses phases. Le soleil contenu dans le soyombo était encore bien présent au début de notre siècle: il n'a été remplacé que sous l'influence des “Jeunes Turcs” par l'étoile maçonnique à cinq branches qui, avec le quart de lune, évoque le symbolisme oriental du ciel nocturne.
L'empire ottoman et, avant lui, celui des Seldjouks, ont été en contact avec des territoires dont la valeur géopolitique est spécifique et significative: la région danubienne-anatolienne et la région iranique. Ces territoires semblent exiger de leurs maîtres d'assumer la même fonction que celle qu'assumaient avant eux les peuples qui les ont habités. Surtout dans le cas iranien, qui évoquait en un certain sens le monde de leurs origines.
Les Mongols sont le seul peuple à avoir conquis une bonne part de la World-Island, l'île du monde eurasiatique telle que la définissent les théories géopolitiques de Halford John Mackinder, étendant leur domination des côtes du Pacifique à la Mer Noire, en poussant même des pointes en direction de l'Allemagne et de l'Adriatique. La base de départ de leur expansion était la zone centrale du Heartland, selon un développement qui semblait suivre avec grande précision les lignes de la géopolitique la plus classique.
Dans ce cas, toutefois, le terme “mongol” est impropre. En fait, au début de l'“Année de la Panthère”, soit au printemps de 1206, Gengis Khan, le “souverain océanique”, dont le pouvoir s'étendait aux rives de quatre océans, qui descendait du Börte-Chino (le “Loup bleu du Ciel”) et de Qoa-Maral (la “Biche fauve”), convoque aux bouches du fleuve Onon le quriltai, la grande assemblée, réunie autour du tuk impérial (le drapeau blanc avec le gerfaut, le trident de flammes, les neuf queues bleues de yaks et les quatre queues blanches de chevaux). Y viennent les chefs d'une vaste coalition de peuples appelés à former le monghol ulus, la nouvelle grande nation mongole. Mais, outre le Kökä Monghol, c'est-à-dire les “Mongols bleus gengiskhanides”, on trouvait, au sein de ce rassemblement qu'était la nouvelle grande nation mongole, des Mongols Oirat et Bouriates, les Turco-Mongols Merkit, les Toungouzes Tatarlar (Tatars) et les Turcs Kereit, Nemba'en (ou Nayman), les Ouighours et les Kirghizes.
Pour avoir accordé à tous ces peuples la nouvelle “nationalité” mongole dans le cadre de l'empire du “souverain océanique”, le “monghol ulus” était une coalition ethnique aux composantes variées, que l'on ne définira pas comme proprement “mongole” mais plutôt comme “altaïque” ou comme “centre-asiatique”, vu que cette nation élargie comprenait des peuples importants, ainsi que des tribus et des clans paléo-asiatiques et irano-touraniques.
L'expansion des Mongols en direction de l'Occident a été jugée de manières forts différentes par les peuples qui l'ont subie ou observée. En règle générale, cette expansion a suscité la terreur, de l'Asie centrale à la Russie, de l'Allemagne à la Hongrie, surtout en raison des terribles massacres commis par les envahisseurs.
Cependant, les Francs du Levant, détenteurs des Etats croisés survivant vaille que vaille, ont, eux, accueilli les Mongols comme des libérateurs. Dans leur cas, il ne s'agissait plus du “souverain océanique” mais de son petit-fils Hülagü, Khan de Perse et grand massacreur de musulmans. Hülagü combattait sans distinction tous les peuples islamiques, tant les Arabes que les Turcs occidentaux (les Seldjouks), et cela, pour deux motifs: l'un d'ordre essentiellement stratégique, l'autre, religieux. Le motif stratégique, c'était que, de fait, les Turcs occidentaux et les Arabes constituaient un obstacle à l'expansion mongole. Quant au motif religieux, les Mongols étaient à cette époque, pour une grande partie d'entre eux, des chrétiens nestoriens ou des bouddhistes. Hülagü était bouddhiste et sa favorite, Doquz-Khatoun, était chrétienne-nestorienne. Dès lors, ils massacraient tous les musulmans et épargnaient les chrétiens.
C'est pour cette raison que les Francs du Levant ont proclamé Hülagü et Doquz-Khatoun, le “nouveau Constantin et la nouvelle Hélène, très saints souverains unis pour la libération du Sépulcre du Christ”. Mongols et Croisés frappaient tous leurs étendards de croix et égorgeaient ou décapitaient tous les musulmans qui avaient l'infortune de se trouver sur leur chemin en Syrie ou en Palestine: les anciennes chroniques parlent de 1755 pyramides de têtes tranchées.
Mais quand la terreur a cessé, la moitié septentrionale de l'empire gengiskhanide a vécu la “pax mongolica”, permettant de réouvrir la “route de la soie” et de reprendre les échanges commerciaux entre l'Europe, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient.
Plus tard, entre le XIVième et le XVième siècles, l'expansion ottomane en Europe et au Levant, de même que la turcisation et l'islamisation des khanats d'origine gengiskhanide d'Asie occidentale, ont provoqué un renversement complet de la situation: les contacts et les échanges entre l'Europe, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient sont devenus très problématiques. Cette rupture des communications ont contraint notamment le Portugal et l'Espagne à franchir l'obstacle en amorçant une expansion maritime. Cette expansion outre-mer non seulement a réussi à rouvrir la route de l'Inde, mais aussi permi la découverte du Nouveau Monde. L'enjeu a donc été bien plus important qu'on ne l'avait prévu et l'expansion maritime des deux nations ibériques a été vite imitée par de nouvelles puissances navales, telles l'Angleterre, la Hollande et la France.
L'impossibilité d'atteindre rapidement et facilement l'Asie centrale et l'Extrême-Orient par les routes terrestres a obligé les Etats européens, à partir du XVième siècle, a opté pour une approche géopolitique complètement différente et de contourner par voie maritime toute la World-Island, dans le but d'en atteindre les extrémités orientales par des voies extérieures. En d'autres termes, l'Europe, ne pouvant plus appliquer les règles découvertes cinq siècles plus tard par Mackinder, soit les règles de la géopolitique continentale, a à l'unanimité adopté celles de la géopolitique maritime, soit celles qu'allaient découvrir Mahan. L'Europe a donc abandonné son pouvoir continental pour partir à la recherche d'un pouvoir naval.
Au début, la valeur géopolitique de cette nouvelle option n'apparaissait pas très claire: il ne s'agissait pas encore d'une véritable expansion politique et stratégique, mais seulement de l'ouverture de voies commerciales. Toutefois, on est rapidement passé des comptoirs et établissements commerciaux à l'organisation de bases militaires et de points d'appui, occupés par des troupes. Ensuite, on s'est conquis des domaines coloniaux. A partir de ce moment-là, la pertinence géopolitique de l'expansion européenne d'outre-mer est dévenue très évidente.
Le Portugal établit ainsi en 1415 sa première tête de pont en Afrique, mais c'est encore en Méditerranée: il s'agit de la ville de Ceuta au Maroc, qu'il perdra par la suite à l'avantage de l'Espagne. Ensuite, les Portugais traversent l'Atlantique oriental, et commencent à contourner par voie maritime le continent noir. Ils abordent à Madère en 1417, aux Açores en 1431, au Cap Vert en 1445; ils atteignent l'embouchure du fleuve Congo en 1485, arrivent au Cap de Bonne Espérance en 1487 et, enfin, débarquent à Calicut (Kalikat/Kojikode) sur la côte sud-occidentale de la péninsule indienne. Ce n'est qu'après avoir ouvert la route des Indes que les Portugais se donnent de solides possessions coloniales le long de cette voie. Elles sont de véritables points d'appui stables pour garantir la libre circulation sur cette grande voie maritime. Ainsi, après Madère, les Açores, le Cap Vert et la Guinée, qui, de concert avec la métropole portugaise, formaient un système en soi, se sont ajoutées des colonies lointaines comme le Mozanbique (1506-07), la ville de Goa en Inde (1510) et l'Angola (1517).
Après s'être assuré de tous ces points d'appui et territoires, les Portugais complètent leur réseau de relais sur le chemin de la Chine en conquérant la partie orientale de l'île indonésienne de Timor en 1520 et en s'installant à Macao en 1553. Les Hollandais les empêchent de prendre l'ensemble de l'archipel. L'accès aux voies maritimes vers l'Orient est consolidé par la prise de possession de la côte occidentale de l'Atlantique, c'est-à-dire le Brésil, où le Portugal installe son premier point d'appui en 1526. Il achève la conquête du pays en 1680, après en avoir chassé les Hollandais.
L'Espagne évite dès lors toute tentative sur la route des Indes, déjà contrôlée par les Portugais. C'est cet état de choses qui motive la décision de la Reine Isabelle d'appuyer le projet de Colomb de trouver une autre route vers les Indes, en partant de l'Ouest au lieu de se diriger directement vers l'Est. Colomb n'a jamais atteint les Indes, mais, en revanche, il a découvert un autre continent, l'Amérique, qui s'est vite révélée très riche. L'Espagne s'est donc étendue à ce nouveau continent et en a occupé la moitié.
La découverte de l'Amérique réveille l'intérêt de l'Angleterre et de la France qui, contrairement à l'Espagne qui se projette sur la partie centrale et méridionale de ce double continent, tentent de s'emparer de sa partie septentrionale, à l'exception d'une brève parenthèse constituée par une tentative française de s'installer au Brésil entre 1555 et 1567. Anglais et Français commencent par n'assurer qu'une simple présence commerciale puis se taillent des domaines ouverts à la colonisation. Pour prospecter ce continent, les Anglais envoient en Amérique du Nord l'Italien Sebastiano Caboto (John Cabot) entre 1497 et 1498. Les Français envoient un autre Italien, Verrazzano en 1524, puis un des leurs, Cartier, en 1534. Mais toutes ces tentatives françaises et anglaises ne sont encore que des expédients: elles n'indiquent pas une ligne géopolitique spécifique et bien définie.
Le pouvoir naval anglais trouve ses origines dans les opérations conduites par l'ex-corsaire Sir Francis Drake entre 1572 et 1577. Ensuite, en 1584, Sir Walter Raleigh fonde la colonie de la Virginie, premier foyer de la future Nouvelle-Angleterre. Enfin, à partir de 1600, l'Angleterre se projette au-délà de l'Atlantique Sud et de l'Océan Indien et commence son expansion aux Indes, affrontant d'abord les Portugais, puis les Français.
Pendant une brève période de quelques décennies, le sea power anglais connaît une éclipse, causée par l'expansion outre-mer de la Hollande, qui venait d'arracher son indépendance à l'Espagne.
Les Hollandais, après l'expédition de Willem Barents dans les régions polaires, dans l'intention de trouver un passage maritime par le Nord pour atteindre la Chine, et après une guerre contre l'Angleterre au XVIIième siècle, prennent la même route que les Portugais vers les Indes, s'installent en Indonésie à partir de 1602, chassent les Portugais de Ceylan en 1609, et commencent à coloniser l'Afrique du Sud à partir de 1652. Les Boeren (Boers), terme signifiant “paysans”, sont donc les premiers habitants du pays, car ils s'y installent avant toutes les populations noires-africaines d'aujourd'hui. Toutefois les Hollandais ne renoncent pas à l'Amérique: en 1626, ils acquièrent l'île de Manhattan qu'ils achètent aux Ongwehonwe (les Iroquois) et lui donnent le nom de Nieuw Amsterdam. Les Anglais, en s'en emparant, lui donneront le nom de New York. Enfin, les Hollandais tentent de s'installer entre 1624 et 1664 dans le Nord-Est du Brésil.
Au cours de la seconde moitié du XVIIième siècle, la puissance navale anglaise renaît et la puissance navale française se forme. Toutes deux vont s'affronter. Tant la France que l'Angleterre tenteront une double expansion, vers l'Asie et vers l'Amérique du Nord.
La France en particulier tente de consolider ses possessions canadiennes, à partir de 1603. Ensuite, elle projette ses énergies vers l'Océan Indien, prend le contrôle de Madagascar entre 1643 et 1672, s'empare de l'île de la Réunion en 1654, afin de pénétrer dans le sub-continent indien. Toutefois tant l'Inde que le Canada lui échapperont, en dépit de l'acquisition de la Louisiane en 1682, qui soudait le territoire français d'Amérique du Nord, depuis la Baie de Hudson jusqu'au Golfe du Mexique. La France a dû céder le pas à l'Angleterre qui impose sa suprématie.
Après ce double échec français, l'histoire sera marquée, aux XVIIIième et XIXième siècles par l'expansion maritime de l'Angleterre et par la création de son “empire global”, basé sur le sea power. Comme l'empire britannique était fondé sur le pouvoir naval, son Kernraum n'est pas constitué du Heartland, mais par la maîtrise d'une masse océanique, l'Océan Indien, contre-partie maritime du “cœur du monde” continental.
Guido GIANNETTINI.






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg Les pays arabes envisagent l’expulsion de millions d’étrangers. Motif ? Érosion inacceptable de la culture locale !
Les pays arabes envisagent l’expulsion de millions d’étrangers. Motif ? Érosion inacceptable de la culture locale !




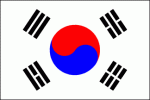


 Nikolaï Podgorny, président du Soviet Suprême de l’URSS, inaugure, avec le shah d’Iran, Mohammed Reza Pahlavi, le plus long gazoduc du monde. Cet événement montre que la question énergétique est la clef pour comprendre l’histoire contemporaine depuis le rapprochement entre le shah et les Soviétiques, jusqu’à sa chute sous les coups de la révolution des mollahs et jusqu’aux événements actuels, où les Etats-Unis affrontent l’Iran d’Ahmadinedjad.
Nikolaï Podgorny, président du Soviet Suprême de l’URSS, inaugure, avec le shah d’Iran, Mohammed Reza Pahlavi, le plus long gazoduc du monde. Cet événement montre que la question énergétique est la clef pour comprendre l’histoire contemporaine depuis le rapprochement entre le shah et les Soviétiques, jusqu’à sa chute sous les coups de la révolution des mollahs et jusqu’aux événements actuels, où les Etats-Unis affrontent l’Iran d’Ahmadinedjad.



 Non si placa la repressione e non cessa la rivolta in Myanmar. Ma Russia, India e Cina credono di vedere, nel mare “zafferano” della rivolta birmana, anche le bandiere a stelle e strisce della potenza americana. E mai come questa volta il duro giudizio geostrategico accomuna le diplomazie dei tre paesi. Ossessionati dall’espansionismo americano temendo che il sì a un’ingerenza negli affari interni di un Paese sovrano possa in futuro essere usata anche contro di loro. Come già avvenuto in Ucraina e in Georgia per la Russia, nel Pakistan per l’India e per la Cina con il Tibet. E così c’è un “no” agli americani che non è solo un grido che esce dai palazzi delle diplomazie. Fanno così ingresso nell’arena politica asiatica alcune concezioni geopolitiche che vanno ad opporsi alle idee sviluppate, nei media mondiali, sulla base di quanto avviene a Bangkok. Perché sia al Cremlino di Putin che nella capitale indiana che fu di Gandhi, che nella cittadella cinese che fu di Mao, la questione birmana è seguita sotto due aspetti. Il primo - che è poi quello più importante - riguarda la preoccupazione che si riferisce al fatto che le proteste che sconvolgono il paese asiatico siano il frutto di precise manovre di stampo americano.
Non si placa la repressione e non cessa la rivolta in Myanmar. Ma Russia, India e Cina credono di vedere, nel mare “zafferano” della rivolta birmana, anche le bandiere a stelle e strisce della potenza americana. E mai come questa volta il duro giudizio geostrategico accomuna le diplomazie dei tre paesi. Ossessionati dall’espansionismo americano temendo che il sì a un’ingerenza negli affari interni di un Paese sovrano possa in futuro essere usata anche contro di loro. Come già avvenuto in Ucraina e in Georgia per la Russia, nel Pakistan per l’India e per la Cina con il Tibet. E così c’è un “no” agli americani che non è solo un grido che esce dai palazzi delle diplomazie. Fanno così ingresso nell’arena politica asiatica alcune concezioni geopolitiche che vanno ad opporsi alle idee sviluppate, nei media mondiali, sulla base di quanto avviene a Bangkok. Perché sia al Cremlino di Putin che nella capitale indiana che fu di Gandhi, che nella cittadella cinese che fu di Mao, la questione birmana è seguita sotto due aspetti. Il primo - che è poi quello più importante - riguarda la preoccupazione che si riferisce al fatto che le proteste che sconvolgono il paese asiatico siano il frutto di precise manovre di stampo americano.