Pour une Grande Alliance eurasienne et ibéro-américaine
Extrait d’une conférence prononcée par Robert Steuckers à la tribune de l’association “Terre & Peuple” de Nancy, 26 novembre 2005
Henri de Grossouvre a publié naguère un ouvrage important, suggérant à ses lecteurs les bases concrètes d’une alliance Paris/Berlin/Moscou. Cette alliance, nécessaire, ne pouvait être que défensive, n’être qu’une première étape en direction d’un projet plus vaste, dans la mesure où les territoires de cette “Triplice” étaient dépourvus de glacis, surtout en Asie centrale, après la dissolution de l’URSS, héritière de l’empire des tsars dans cette région. Pour être complète, l’alliance doit également comprendre l’Iran, l’Inde, la Chine et le Japon. De cette façon, la puissance thalassocratique du Nouveau Monde éprouverait d’immenses difficultés à se fixer et s’incruster dans les rimlands et à y disloquer les cohésions impériales.
Les cinq premières puissances de cette alliance à sept, jusqu’ici hypothétique, sont indo-européennes, c’est-à-dire qu’elles ont des références à un passé indo-européen, en dépit de l’adstrat chrétien ou musulman, le bouddhisme étant une émanation particulière de la psyché indo-européenne de l’Inde, portée au départ par un prince indien, issu de la classe des kshatriyas. L’Iran n’est islamiste aujourd’hui que parce les Etats-Unis ont soutenu Khomeiny au départ, pour éliminer le Shah et son programme de retour aux racines perses de l’antiquité, assorti d’une vision diplomatique active axée sur l’organisation du pourtour de l’Océan Indien. Le projet géopolitique du Shah était visionnaire et intéressant: Zaki Laïdi et Mohammed Reza Djalili, géopolitologues de langue française, originaires du monde musulman et, de ce fait, excellents connaisseurs des sources arabes, iraniennes, pakistanaises et indiennes, l’ont bien mis en exergue dans leurs divers travaux. La nouvelle campagne médiatique contre l’Iran, engagée à fond depuis cet automne, au nom de la non-prolifération des armements nucléaires, est un prétexte, un de plus, pour intervenir sur le rimland eurasien, et élargir les conquêtes effectuées en Afghanistan et en Irak.
Le projet de « Grand Moyen Orient »
Comme le titrait le Corriere de la Sera du 25 novembre 2005, l’Iran envisage de traiter son uranium sur le sol russe, échappant de la sorte à d’éventuelles représailles américaines ou israéliennes. Beijing soutient ce projet, tout simplement parce que l’apport de pétroles iraniens est vital pour la Chine en pleine expansion, une expansion que tente de contrecarrer Washington.
L’Europe, pour sa part, n’a aucun intérêt à ce qu’un embargo général, dans le cadre de sanctions décidées par Washington, soit imposé à l’Iran: elle en ferait les frais, car les échanges entre les Etats-Unis et l’Iran sont infimes; de ce fait, les manques à gagner frapperaient uniquement les exportateurs européens de technologies, qui, en ne commerçant pas avec l’Iran, ne bénéficieraient pas de fonds suffisants pour investir ultérieurement dans la recherche et les innovations. L’affaire iranienne, si elle est analysée au départ des règles éternelles de la géopolitique, pourrait contribuer à consolider, de manière effective, un projet de défense commun sur la masse continentale eurasienne, car, en frappant l’Iran, les Etats-Unis frapperaient le coeur géopolitique de l’espace central de cette immense masse territoriale, feraient tomber le dernier obstacle politique à leurs projets. Ils veulent en effet fabriquer un “Grand Moyen Orient”, équivalant au territoire de l’USCENTCOM, et qui serait le débouché majeur de leurs industries de consommation, tout en excluant toutes les autres puissances économiques de ce marché juteux. Ni Moscou ni Beijing ne peuvent le tolérer, car ce ré-agencement géostratégique réduirait leurs territoires respectifs à une périphérie affaiblie, sans accès à l’Océan du Milieu, objet de toutes les convoitises impériales depuis la plus haute antiquité.
Dans cette synergie, qui se dessine actuellement, les sixième et septième puissances de l’hypothétique “Grande Alliance” (GA), que nous appelons de nos voeux, soit la Chine et le Japon, commenceraient par restaurer la fameuse “sphère de co-prospérité est-asiatique”, qui donnerait ipso facto cohérence à l’aire orientale de la masse continentale eurasienne. Sur le plan spirituel et métaphysique, ces deux puissances reposent sur des religions autochtones non prosélytes, non messianiques. On ne peut donc pas se servir d’une religion de ce type, dans ces deux pays, pour déclencher désordres et révolutions, comme on le fait avec l’islam, ou pour enclencher un processus d’auto-dénigrement masochiste, comme on le fait avec le christianisme en Europe, et plus particulièrement en Allemagne et dans les pays protestants. L’héritage religieux, en Chine et au Japon, y est un faisceau de legs ancestraux, de rites et de coutumes qui échappent à toute manipulation, car elles sont fixes et immuables, tout en permettant la modernité technologique.
La Chine se défend
Dans l’espace de co-prospérité est-asiatique, il y a certes l’Indonésie, agitée par quelques sectes fondamentalistes musulmanes, mais ses réseaux nationalistes, arrivé au pouvoir après 1945, ont participé aux efforts japonais, pendant la seconde guerre mondiale, pour que cette sphère voie le jour et se consolide. Le projet de “Grande Alliance” —qui comprendra aussi la Thaïlande, autre ancien allié des Japonais, considéré pendant longtemps comme “pays ennemi des Nations-Unies”— implique la défense, dans ce pays, de la tradition nationale bouddhiste contre les menées subversives d’éléments fanatiques musulmans dans le sud, qui entendent déstabiliser le pays et freiner son élan économique.
La Chine, de son côté, s’est toujours défendue contre les désordres provoqués par les nomades hunniques et turco-mongols: c’est sa raison d’être, le secret de sa continuité politique pluri-millénaire. De ce fait, fidèle à cette continuité, à cette longue durée, en dépit des idéologies occidentales et modernistes qui l’ont travaillée, elle n’est pas prête à lâcher du lest dans le Sinkiang, anciennement dénommé le “Turkestan chinois”, ni à y accepter l’émergence de bandes insurrectionnelles musulmanes, turco-ouïghoures, téléguidées par un panturquisme activé en ultime instance par les Etats-Unis. Et qui viserait à détacher ce Sinkiang de la sphère d’influence chinoise (et russe) pour en faire un éventuel appendice du “Grand Moyen-Orient”. Les Etats-Unis réaliseraient par personnes interposées le projet arabo-musulman jadis avorté de conquérir les avant-postes turkestanais de la Chine et, dans une phase ultérieure, se serviraient, pendant longtemps, du trop-plein démographique musulman pour contenir la Chine sur ses confins occidentaux.
Le problème de l’Islam, et plus exactement de ses factions les plus extrémistes, c’est qu’il est allié des Etats-Unis, en dépit des proclamations et des rodomontades, des attentats et des croquemitaines que l’on agite dans les médias. L’espace du “Grand Moyen Orient” (GMO), voulu par les Américains, sera musulman, si possible rétrograde pour éviter tout envol industriel et économique (comme l’envisageaient les agents de la CIA qui ont mis Khomeiny en selle), de préférence prosélyte pour grignoter les territoires adjacents comme en Thaïlande, mais aussi, à terme, dans la vallée de la Volga et de la Kama sur le territoire de la Fédération Russe, dans le Sin-Kiang contre la Chine et dans les communautés immigrées en Europe occidentale (qui serviront, le cas échéant, quand il le faudra, de leviers pour provoquer des désordres ingérables, déstabiliser les systèmes de sécurité sociale et affaiblir financièrement les concurrents européens sur tous les plans, comme on le voit aujourd’hui, en novembre 2005, dans les banlieues des grandes villes françaises).
La leçon de Naipaul, Prix Nobel de littérature
L’antidote idéologique à ce prosélytisme virulent nous est livré aujourd’hui par le Prix Nobel de littérature V. S. Naipaul, un Indo-Britannique auquel nous devons plusieurs livres très intéressants sur le destin de la civilisation indienne, minée par le prosélytisme islamique. Naipaul, notamment dans India: A Wounded Civilization et Among the Believers. An Islamic Journey, démontre la nocivité de tout prosélytisme, car il mutile en profondeur les peuples ou les civilisations qui le subissent. Le premier de ces livres a été écrit en 1975, à la suite d’une troisième visite en Inde, patrie de ses ancêtres qui l’avaient quittée pour se fixer en Jamaïque. Ses pérégrinations d’émigré, qui revient à ses sources, lui révèlent la profonde mutilation de l’Inde hindouiste, après des siècles de domination étrangère, musulmane et britannique.
Cette blessure fait que l’Inde n’avait pas encore trouvé l’idéologie de sa régénérescence, car le gandhisme, malgré qu’il ait in fine obtenu l’indépendance du sous-continent, se solde, aux yeux de Naipaul, par un échec. Le gandhisme ne fait pas revivre le passé, ne donne pas les recettes d’un Etat efficace, viable sur le long terme; il exprime les sentiments d’une Inde qui résiste, mais nous pas d’une Inde qui guérit et ressuscite, se fortifie et s’impose. Sous les coups d’un prosélytisme étranger, un “vieil équilibre” a été rompu, constatait Naipaul en 1975, la règle qu’il énonce là pouvant s’appliquer à tous les prosélytismes et à tous les “vieux équilibres” qu’ils ont rompus au cours de l’histoire.
Prosélytisme islamique et prosélytisme médiatique
Le second livre, que nous évoquons ici, montre la rage que les nouveaux convertis développent pour détruire les legs de leur civilisation-mère. L’apport de la Chine et du Japon serait dès lors, dans la “Grande Alliance”, celui d’une force qui résiste aux prosélytismes, qui leur demeure imperméable, qui permet de garder ses forces originelles intactes, de ne pas rompre le “vieil équilibre”. Au 21ième siècle, cette force servirait à résister à deux formes de pénétrations mutilantes, de prosélytismes actuels, l’un laïc, l’autre religieux: celle du discours médiatique véhiculé par les grandes agences de presse américaines et celui de l’Islam, sur le terrain, à la périphérie du “Grand Moyen Orient” (GMO).
Les médias américains servent à endormir et distraire les esprits en Europe et en Russie, à oblitérer la conscience géopolitique; le prosélytisme islamique sert à élargir l’espace du GMO par une application dosée et bien téléguidée de la djihad contre les minorités non musulmanes ou contre des pays limitrophes afin de grignoter leurs frontières (comme ce fut le cas avec les mudjahiddins et les talibans: argent saoudien et armes américaines); ensuite ce prosélytisme sert à disloquer la paix intérieure dans les pays européens accueillant une forte immigration islamique (les événements de la France en novembre 2005 deviendront à ce titre un exemple d’école).
Les deux prosélytismes ont pour objectif de gommer des mémoires vives, de briser des continuités historiques, d’instaurer des systèmes manipulatoires. Sans mémoire vive, sans le sentiment de vivre dans une continuité historique, les peuples, comme le peuple indien selon Naipaul, tombent dans l’apathie, chavirent dans le désordre et la putréfaction, après des crises de fanatisme et d’iconoclasme.
HUIT AXES D’ACTION
Concrètement, la Grande Alliance émergera, si les dirigeants européens, russes, chinois, iraniens, indiens et japonais appliquent huit axes d’action:
1. Réaliser de concert un réseau indépendant d’oléoducs et de gazoducs dans toute l’Eurasie (cf. les articles de Gerhoch Reisegger dans Au fil de l’épée/Arcana Imperii). La visite récente de Poutine au Japon, où les pourparlers ont été concluants, abonde dans ce sens. Poutine vise à arbitrer un équilibre entre la Chine et le Japon, alors que les grandes agences médiatiques excitent les deux puissances asiatiques l’une contre l’autre, au nom de différends issus des années 30 et 40. Cette politique vise à raviver de vieux conflits, aujourd’hui dépourvus de pertinence, et à entraver toute synergie commune en matière de communication et de transport de l’énergie dans cette région à très forte densité démographique. Notre objectif doit être de contrer cette propagande, de créer les conditions idéologiques qui la rendraient inopérante, de faire éclore les réflexes psychologiques forts qui les rendraient nulles et non avenues.
2. Créer un réseau de routes et de chemins de fer entre la Russie, la Chine, les Corées et le Japon, d’une part, la Russie et l’Inde, d’autre part. La nécessité d’assurer des liaisons terrestres optimales entre la Russie et l’Inde donne tout leur relief aux questions tadjiks et cachemirites. En effet, le Tadjikistan et le Cachemire sont des terres indo-européennes, partiellement islamisées mais persophones au Tadjikistan, qu’il convient de dégager de toutes influences étrangères. Le soutien à l’Inde, dans ses revendications légitimes à l’endroit du Cachemire, est un impératif incontournable de la future nouvelle géopolitique de la Grande Alliance. En aucun cas, le Cachemire et le Tadjikistan ne doivent être inclus dans le GMO.
Le projet GALILEO
3. Sous l’impulsion de l’UE, le Grande Alliance (GA) doit se constituer autour du projet satellitaire GALILEO, qui doit être la réponse européenne, russe, chinoise et indienne à la domination américaine dans l’espace et, partant, dans le domaine des télécommunications. La demande d’Israël, de participer à ce projet, doit être vue avec la plus grande méfiance, vu les liens trop étroits de vassalité qui lient ce petit pays du Moyen Orient au géant américain.
4. Il faut soutenir et amplifier le projet de gazoduc de la Baltique, créant de facto un axe économique germano-russe. Ce projet, en voie de réalisation grâce à l’entêtement de l’ancien Chancelier Schröder, permet de contourner les pays de la “Nouvelle Europe”, satellisés par les Etats-Unis, comme l’Ukraine, après sa “révolution” orange, comme la Pologne, entièrement inféodée à l’OTAN, et la Lituanie, qui suit la même détestable orientation. Le gazoduc de la Baltique a permis de réduire à néant la nouvelle stratégie du “cordon sanitaire”, soit la création d’un chapelet de puissances petites et moyennes entre l’UE (jadis l’Allemagne) et la Fédération de Russie (jadis l’URSS), auxquelles on accorde une garantie parce qu’elles s’inféodent à l’OTAN. Cette contre-stratégie germano-russe avait connu un antécédent en 1986, avec le projet de relier, par un système de ferries et de gros transporteurs, le port de Memel/Klaipeda en Prusse orientale à Kiel, et via le canal de Kiel, à la Mer du Nord. Avant que ces tractations n’aboutissent, tout au début de l’ère Gorbatchev, le ministre-président du Slesvig-Holstein avait été retrouvé mort, assassiné, dans sa baignoire... (cf. Vouloir, n°30 & 31). On n’a jamais retrouvé les assassins. Si la future Grande Alliance ne peut atteindre l’Océan Indien, vu la présence militaire américaine dans les eaux de cet “Océan du Milieu”, elle doit avoir une ouverture sur le large en Mer Baltique. Ainsi se réalisera le rêve de Haushofer: celui de la “Troïka” eurasiatique, avec les trois chevaux que sont l’Allemagne (l’UE), la Russie et le Japon. Une autre stratégie de “dés-étranglement” est en train de se mettre en place dans l’Arctique: les brise-glace russes de la nouvelle génération, qui sont simultanément des usines nucléaires flottantes, générant leur propre énergie, ouvriront bientôt la voie du Nord et relieront Hambourg au Japon.
Briser l’alliance entre Washington et Ankara
5. Autre objectif: faire sauter l’alliance entre les Etats-Unis et la Turquie. Cette alliance, indéfectible jusqu’aux prémisses de l’invasion de l’Irak en mars 2003, bloquait l’Europe dans les Balkans, visait l’endiguement de l’UE sur le cours du Danube à hauteur de Belgrade, empêchait une voie terrestre directe entre la plaine hongroise et l’Egée, et endiguait ensuite la Russie en Mer Noire et dans le Caucase. Clinton, dans les discours qu’il avait tenus à Istanbul et à Ankara lors de sa dernière visite officielle en Turquie, jouait à fond la carte de l’alliance américano-turque; il exerçait des pressions constantes pour faire entrer la Turquie dans l’UE, de façon à ce que les Européens épongent les déficits turcs et accueillent son trop-plein démographique. Bush ne suit pas exactement la même politique, une politique qui était dictée, certes par les droits de l’homme, mais encore pour une bonne partie par le jeu classique des alliances. Bush II, lui, privilégie une stratégie pétrolière, bien dans la tradition de sa famille et des lobbies qui la soutiennent. La guerre en Irak est, à l’évidence, une guerre pour le pétrole. Les pétroliers américains veulent s’assurer la gestion de toutes les nappes pétrolifères du pays, voire de la région, pour trois raisons essentiellement:
a) maximiser leurs profits dans l’immédiat et couvrir les frais des opérations militaires;
b) pomper le pétrole partout et diminuer ainsi la dépendance à l’égard du pétrole saoudien, vu l’ambiguïté de la politique saoudienne, qui proclame, d’une part, sa fidélité à l’alliance américaine, mais, d’autre part, est “mouillée” dans l’affaire d’Al Qaeda, un réseau de la stratégie anglo-saxonne de l’“insurgency”, mais qui a suivi sa propre piste, jouant double ou triple jeu (cf. les ouvrages d’Eric Laurent à ce sujet);
c) ôter la gestion du pétrole à toutes les autres puissances de la masse continentale eurasienne, exploiter les champs pétrolifères pendant les années de “pic pétrolier” et au cours des premières décennies du déclin annoncé du pétrole, afin d’engranger des plus-values pour financer les technologies de l’après-pétrole et continuer de la sorte à dominer la planète.
Avec les promesses de Clinton, les Turcs avaient espéré récupérer la région du Kurdistan irakien autour des champs pétrolifères de Mossoul, quitte à envahir cette province septentrionale de l’Irak, à y liquider les implantations du PKK kurde et à l’annexer de facto, de manière à gagner une certaine indépendance énergétique, dont ils étaient privés depuis les accords de Lausanne en 1923. La stratégie américaine aurait dans ce cas parié sur son allié de longue date et fait jouer la position centrale de la Turquie dans l’arc de crises qui va des Balkans à la frontière iranienne. Mais faire jouer l’armée turque, comme le voulait la dernière administration démocrate, impliquait de renoncer à des puits particulièrement abondants. La stratégie pétrolière de Bush II ne pouvait l’accepter. Faire la guerre contre Saddam Hussein exigeait une mise énorme, qui, à terme, en butin, devait rapporter gros. Les puits du Kurdistan irakien ont constitué ce butin idéal. Pas question donc de le laisser aux Turcs.
Depuis les préliminaires de la guerre contre l’Irak, les relations américano-turques se sont considérablement refroidies. L’opinion publique turque se sent trahie. Non récompensée pour son indéfectible fidélité à l’Alliance Atlantique, depuis les prémisses de la guerre froide et la Guerre de Corée, où les troupes turques avaient payé le prix du sang pour se faire accepter dans la “communauté atlantique”.
Pire: pour conserver cette place qu’elle estimait valorisante, la Turquie avait créé les conditions matérielles de sa rupture avec les pays arabes du Croissant Fertile. Le barrage Atatürk, inauguré par l’ancien homme fort de la Turquie, Özal, entre bel et bien dans la ligne kémaliste, occidentaliste et libérale. La construction des barrages reflète une volonté de couper avec le monde arabe, avec les sources du pétrole, avec le passé ottoman. En coupant le cours des fleuves du Croissant Fertile, en limitant leur débit, les Turcs fragilisent ipso facto les économies et les agricultures de leurs voisins arabes. Ce qui va dans l’intérêt des Etats-Unis, qui, à terme, pourront pratiquer leur éternelle politique d’aide alimentaire (Food Aid) contre des matières premières ou des concessions politiques, et à consolider ainsi leur emprise sur les Etats.
Soutien total à l’Arménie
6. Faire sauter l’alliance américano-turque implique un soutien à l’Arménie enclavée dans le massif caucasien. L’an dernier, en août 2004, quelques semaines à peine avant l’abominable massacre des écoliers de Beslan en Ossétie, l’armée arménienne avait organisée des manœuvres remarquées dans la région, avec l’appui russe, démontrant par là même que le pays constituait un solide abcès de fixation, empêchant le projet panturquiste de s’élancer de l’Egée aux confins chinois, comme l’avait espéré Özal. Il faut avoir en tête que la dynamique du projet panturquiste, ou pantouranien, est l’un des ingrédients qui sert les Etats-Unis à créer le « Grand Moyen Orient » ou à asseoir leur domination sur la « nouvelle Route de la Soie », comme l’a théorisé Zbigniew Brzezinski (« New Silk Road Project »). L’objectif de toute bonne politique eurasienne serait dès lors de ralentir ou de contrer tous ces projets, en mobilisant les forces hostiles au panturquisme. Le hérisson militaire arménien est de première utilité dans toute contre-stratégie de la « Grande Alliance » que nous appelons de nos vœux.
7. Il convient ensuite d’organiser l’espace pontique, les pays riverains de la Mer Noire. Les grands axes fluviaux que sont le Danube, le Dniepr, le Don et, via le canal Don-Volga, la Volga et le bassin de la Caspienne doivent être organisé en synergies, en en excluant la Turquie, qui est étrangère à l’espace pontique, vu qu’aucun fleuve important ne provient du territoire anatolien et ne participe à la synergie hydrographique de la région. L’espace pontique doit être dominé par les puissances qui lui donnent l’eau de leurs fleuves, dans la perspective des puissances européennes qui ont voulu soustraire cet espace de civilisation à l’emprise de conquérants étrangers, des Seldjoukides aux Ottomans. Pour notre tradition politique, la reconquête de cet espace pontique, pour la consolidation de l’Europe, est inscrite à l’ordre du jour depuis plus de six siècles, depuis le Duc de Bourgogne Jean Sans Peur et la création de l’Ordre de la Toison d’Or : tous ceux qui s’y opposent, à commencer par les sinistres souverainistes gallicans qui suivent la détestable tradition de François I, sont de vils traîtres, qu’il faut empêcher de nuire et combattre sans merci. L’espace pontique sera dès demain le site sur lequel transitera le brut de la Caspienne et les gaz de Russie et du Kazakhstan : aucune puissance qui n’est pas européenne de souche ne devrait avoir barre sur l’acheminement de ces matières premières.
Soutien total à Chavez
8. Enfin, il convient de défendre les intérêts communs des principales composantes eurasiatiques de la « Grande Alliance » en Amérique ibérique et d’englober ce continent dans le combat planétaire contre Washington. Dans l’immédiat, cela implique un soutien sans faille à Chavez, président du Venezuela. L’Espagne, au nom de l’hispanité, a un rôle-clef à jouer dans cette stratégie. La présence de Zapatero au sommet latino-américain de la fin de l’année 2005 avait été un signe prometteur : Zapatero y avait affirmé le refus de tout boycott contre Cuba, qui, pour nous, demeure une province espagnole, puisque nous n’acceptons pas les retombées de la guerre hispano-américaine de 1898, déclenchée après un casus belli fallacieux et une campagne de presse hystérique et mensongère, orchestrée par l’infâme Teddy Roosevelt. Condoleeza Rice a évidemment refusé de mettre un terme à ce boycott, ce qui a créé l’unanimité contre elle et donné le rôle de la vedette à Zapatero, qui ne tiendra évidemment pas ses promesses de faux socialistes à la mode. Le premier ministre espagnol a promis de vendre des armes au Venezuela, de façon à ce que celui-ci puisse, disent les autorités américaines, « exporter sa révolution bolivariste » partout en Amérique ibérique. Lors de ce sommet, dont les travaux permettent de dégager les grandes lignes d’une éventuelle politique eurasiatico-ibéro-américaine, la promesse de vendre des armes espagnoles à Chavez est une riposte parfaitement justifiée à la vente de F-16 et d’autres matériels performants au Maroc, juste avant l’invasion de l’îlot de Perejil en juillet 2002, un acte de guerre que l’on peut considérer comme purement « symbolique ». Mais l’Europe ne peut se permettre de perdre une bataille « symbolique » supplémentaire, surtout dans le bassin occidental de la Méditerranée.
Conclusion philosophique
La vulgarisation de ce programme, son ancrage dans les pratiques diplomatiques, est le but de notre combat. Notre combat est identitaire ; il vise un retour à notre identité, à notre authenticité profonde. Mais cette authenticité ne saurait demeurer une petite pièce de musée que l’on admire avec tendresse, sans agir. Hegel nous a enseigné qu’être homme, cela ne se faisait pas seul, mais que cela se faisait au sein de « nous collectifs ». Hier, ces « nous collectifs » étaient des identités régionales ou nationales. Aujourd’hui, nous visons l’avènement d’un « nous collectif » plus vaste, celui de la communauté des peuples européens et des peuples qui refusent la logique du prosélytisme qui, comme nous l’a enseigné Naipaul, éradique les identités et rend les hommes malheureux. Hegel disait que nous ne pouvions vivre notre liberté que si nous donnions un sens, notre sens, à la réalité concrète du monde qui nous entoure. L’humanité est un mot vide de sens, ajoutait-il, si les hommes ne retournaient pas à leur moi profond avant d’arraisonner une réalité concrète, ici et maintenant, une réalité concrète qui subit sans cesse des mutations et des changements qu’il s’agit aussi d’affronter. Et l’ « humanité » de nos adversaires est effectivement un mot vide de sens, puisqu’ils refusent ce retour à l’authenticité profonde des peuples pour adopter les schémas figés, dépourvus de dialectique combattante, invitant à la démission, que leur suggèrent les prosélytes de tous poils, surtout ceux qui véhiculent les discours médiatiques. Washington représente la thèse, le pouvoir mondial en place, figé, dépourvu de sens pour les autres ; notre Grande Alliance représente l’anti-thèse, encore fragile, encore en jachère, mais seule pourvue d’un réel dynamisme. Je vous invite à y participer.
Robert STEUCKERS,
Forest-Flotzenberg, Nancy, novembre 2005.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg

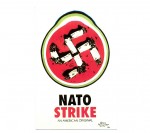

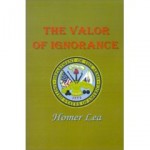




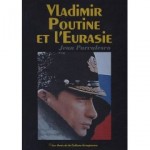


 Harde toespraak in München kan begin zijn van een ‘Poetindoctrine’
Harde toespraak in München kan begin zijn van een ‘Poetindoctrine’