La guerre en cours depuis dix-huit mois se joue aussi dans le poids et la vitesse de croissance des différents groupes qui se partagent le territoire ou s’entredéchirent.
 - Des enfants jouent dans des ruines, au nord de la Syrie, le 8 octobre 2012. REUTERS/Stringer. -
- Des enfants jouent dans des ruines, au nord de la Syrie, le 8 octobre 2012. REUTERS/Stringer. -
Avec 33.000 morts et 340.000 réfugiés hors des frontières, la démographie est évidemment présente dans le conflit qui ravage la Syrie depuis mars 2011, ce délicat bras de fer où l’on se contente souvent d’une vérité qui, pour n’être pas reconnue, est pourtant connue de tous: un groupe confessionnel minoritaire démographiquement, les alaouites (originaire du chiisme musulman), monopoliserait le pouvoir et ses multiples instruments. Ou, de manière plus nuancée: l’ensemble des minoritaires, peu ou prou unifiés, se seraient ralliés à ce pouvoir, s’opposant par là même à la majorité de la population.
La dimension démographique du conflit se joue aussi dans le poids et la vitesse de croissance des différents groupes qui se partagent le territoire ou s’entredéchirent, facteur décisif vis-à-vis du pouvoir central. En effet, la transition démographique —vecteur essentiel de la modernisation des sociétés— n’y avance pas au même rythme: si le conflit est inscrit dans l’état démographique des forces en présence, il se joue donc aussi dans le mouvement (natalité, mortalité, migrations…) qui différencie ou oppose ces populations, par leur natalité surtout [1].
D’abord, la question la plus simple: que pèsent démographiquement les différents groupes aujourd’hui? Malgré le mutisme officiel (recensement, état-civil, enquêtes…), les estimations abondent: plus de 40% de minoritaires selon certaines estimations très généreuses; beaucoup moins selon la nôtre, qui les amène à 27%.

Cette «bataille de chiffres» en serait restée à ce stade si elle n’avait dégénéré en conflit ouvert entre diverses factions de la population. Occultée par l’idéologie dominante de l’Etat-Nation syrien, la démographie communautaire [2] a repris des couleurs, comme sous le mandat français (1920-1944), qui avait divisé un temps la Syrie en Etats confessionnels, communautaires ou régionaux: alaouite, druze, sandjak d’Alexandrette, et même un Etat de Damas et un Etat d’Alep.
Les sunnites, dominants démographiquement, dominés politiquement
Démographie et pouvoir sont en porte-à-faux, les sunnites arabes (73% de la population) vivant depuis 1963 une situation d’éclipse politique. Mais s’agit-il vraiment d’un groupe? Plutôt d’un agrégat composite, urbain, rural, bédouin, très hétérogène, régionaliste, sans ossature réelle après la destruction du parti des Frères Musulmans en 1982, qui s’était fait fort —sans réussir— de rallier les sunnites de Syrie.
Les années 2011-2012 amorcent peut-être un semblant de regroupement, dans la mouvance d’une guerre qui pour la première fois n’épargne aucune des villes moyennes à dominante sunnite et rapproche symboliquement les deux capitales, Damas et Alep, longtemps rivales.
Pour autant, le pouvoir syrien ne manque pas d’y entretenir des groupes d’intérêt, des milieux d’affaires à la pègre, en passant par le souk de Damas, plus récemment celui d’Alep, qui lui sont obligés. Les allégeances ne sont jamais évidentes, il n’y a pas congruence parfaite entre le sunnisme syrien et l’opposition au régime.
Les Kurdes, minorité démographique politiquement dominée
Qu’en est-il des minorités? A défaut d’une unité nationale réelle, le pouvoir tente de les agréger au noyau dur alaouite. Il s’agit là d’un impératif démographique aux fortes connotations politiques et militaires.
Les Kurdes, qui représentent 8% de la population (certaines estimations vont jusqu’à 10%, ce qui en ferait la première minorité du pays devant les alaouites), principalement sunnites (95%), ne jouent pas la carte sunnite, mais ne penchent pas pour autant du côté d’un pouvoir qui les a privés de la majeure partie de ce qu’ils jugent être leurs droits nationaux, de la reconnaissance de leur langue, voire, pour de larges pans de la population, de la nationalité syrienne.
En 1962, un «recensement» de la région principalement kurdophone de la Jézira, a abouti à priver de la nationalité syrienne 120.000 Kurdes désormais considérés comme étrangers. Plus de 300.000 Kurdes apatrides vivaient en Syrie à la promulgation du décret d’avril 2011 de restitution de la nationalité syrienne aux Kurdes. Un geste destiné à les rallier à la cause du pouvoir après plusieurs décennies d’ostracisme, mais dont seulement 6.000 personnes auraient bénéficié.
Leur forte concentration géographique aux frontières de la Turquie et de l’Irak, jointe à leur croissance démographique —la plus élevée du pays—, favorise les penchants sécessionnistes, à l’écoute des Kurdes de Turquie ou d’Irak, un peu moins d’Iran. C’est pourquoi l’opposition syrienne, qui se méfiait des pulsions sécessionnistes kurdes, a tardé à enrôler des opposants de ce côté. Mais récemment, le Conseil national syrien a élu un Kurde, Abdelbasset Sida, à sa tête.
Pour ajouter à l’ambivalence de la situation de cette minorité à l’égard du pouvoir central, il faut souligner les liens entre une partie des Kurdes de Syrie et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), anti-turc, occasionnellement pro-syrien et se retrouvant donc loyaliste par la force des choses.
Les yazidis, cette archi-minorité kurdophone non-musulmane, se distinguent eux par leur religion des Kurdes musulmans. Démographiquement et politiquement, ils pèsent d’un poids négligeable.
Les chrétiens, minoritaires proches du pouvoir?
Les chrétiens sont très largement surestimés dans les estimations, jusqu’à 12% —la CIA leur accorde 10%, plus de deux fois plus que notre estimation (4,6%). Il y a là comme une extrapolation à la démographie de la surreprésentation des chrétiens syriens dans le monde prestigieux des affaires et de la culture. Pourtant, ils sont parmi les premières victimes de leur succès en termes de transition démographique avancée, le payant par un recul de leur nombre en valeur relative, sinon absolue.
Pour ces raisons démographiques, ils ne constituent qu’une force d’appoint qui pèse peu dans la balance: faible fécondité, tombée à quelque 1,8 enfant par femme, et forte émigration hors du pays. La ville d’Alep, la plus «chrétienne» de Syrie, illustre remarquablement ce déclin, des 30% (sans doute exagérés) de chrétiens dans les années 40 à 3,5% aujourd’hui.
Les chrétiens se sont souvent retrouvés comme minoritaires mais proches du pouvoir —parfois à leur corps défendant—, un pouvoir qui tente, surtout depuis le conflit en cours, de les agréger encore plus au noyau dur. Mais ils ne sont unis ni sur le plan confessionnel ni sur le plan politique.
Leur présence au sein du parti au pouvoir, le Baath, ne date pas d’aujourd’hui et, faut-il le rappeler, l’un de ses fondateurs, Michel Aflak, était un Syrien chrétien. Une certaine continuité puisque le ministre de la Défense Daoud Rajha, tué dans l’attentat de Damas en juillet dernier, était chrétien. Et l’armement de miliciens chrétiens en soutien du régime a été tenté, mais certains groupes chrétiens —des Assyriens— ont pris les armes contre le pouvoir, tout en restant en marge de l’opposition.
Les dignitaires ecclésiastiques chrétiens ont, pour la plupart, mais avec des exceptions notables, prêté allégeance au pouvoir. Mais leurs voix sont largement compensées par celles des opposants chrétiens, qui siègent aux plus hautes instances du Conseil national syrien ou des autres groupes de l’opposition.
Les moins politisés des chrétiens vivent eux mal les visées du pouvoir sur le Liban, qui remontent surtout à 1975, alors qu’ils ont tissé depuis des temps immémoriaux des relations poussées, familiales notamment, avec le pays —ce qui n’est d’ailleurs pas un phénomène chrétien seulement, mais celui de Syriens de toutes confessions, pour qui le Liban reste une option comme pays-refuge.
Parmi les chrétiens, les Arméniens, pour la plupart originaires de Cilicie, se découvrent eux des affinités avec la république d’Arménie, qui pourrait bien devenir une autre patrie-refuge.

Attitude contrastée des autres minorités
Comme ceux des chrétiens, les effectifs des druzes, concentrés dans le Djébel Druze (gouvernorat de Soueida), sont largement surévalués: 500.000, voire 700.000, contre moins de 400.000 effectivement. Cela tient en partie à l’imprécision du décompte des Druzes expulsés du Golan à la suite de la guerre israélo-arabe de 1967.
L’ambivalence rencontrée chez les Kurdes ou les chrétiens se retrouve chez eux. Le réflexe minoritaire les pousserait à faire front avec les autres minorités, mais un long contentieux avec les pouvoirs successifs qui se sont succédés depuis l’Indépendance jusqu’au coup d’état de 1963 et l’éviction des officiers druzes de l’armée les inciterait à la méfiance vis-à-vis des autorités.
Ces druzes de Syrie —originaires pour la plupart du Mont-Liban après leur migration forcée au XVIIIe siècle— manquent d’un leadership national, qu’ils trouvent en partie au Liban en la personne de Walid Joumblatt, le leader du PSP libanais, un druze qui se fait fort d’encourager ses coreligionnaires de l’autre côté de la frontière à refuser de servir dans l’armée et dans les services de sécurité.
Pour les archi-minorités, qui comptent peu du point de vue démographique, les préférences politiques sont également contrastées. Cela va des Turkmènes, les plus opposants, car sunnites, turcophones et en symbiose avec la Turquie, aux chiites duodécimains, plus en phase avec l’Iran et son allié syrien.
Les Ismaéliens, des chiites non-duodécimains, seraient –modérément— proches du pouvoir. Les Tcherkesses, des sunnites non-arabes originaires du Caucase, semblent plutôt neutres dans le conflit en cours. Mais leur malaise se traduit par le fait que certains envisageraient le «retour» en «Russie».
En définitive, ces minoritaires dominés, si on agrégeait leurs effectifs, se retrouveraient à mi-chemin du pouvoir et de l’opposition, mais en aucun cas une force décisive ni pour les uns ni pour les autres.
Les alaouites: une minorité démographique politiquement dominante
Que les alaouites, de leur côté, soient la minorité au pouvoir ou celle du pouvoir importe peu. Comme mentionné plus haut, les cercles confessionnels et politiques ne se recoupent jamais intégralement. Et de la même façon que le pouvoir a réussi à fidéliser nombre de sunnites, l’opposition compte également de prestigieuses personnalités alaouites.
Les alaouites font corps avec la Syrie, mais leur présence déborde le cadre syrien: plus de 400.000 alaouites arabes (à ne pas confondre avec les 15 millions d’Alévis des turcophones chiites) vivent en Turquie. Près de 100.000 au Liban, paradoxalement le seul pays qui leur accorde une reconnaissance officielle, un état-civil et une représentation parlementaire comme alaouites. En revanche, en Turquie et en Syrie, ils sont officiellement musulmans, mais ne peuvent se réclamer de leur confession précise.
L’actualité brûlante a ravivé l’intérêt accordé à leur religion. Issue de l’islam chiite duodécimain, elle s’en est éloignée par son caractère trinitaire, initiatique, syncrétique. Que les alaouites croient à la transmigration des âmes (métempsycose) —ce qui n’est pas sans effet sur leur faible fécondité comme chez les druzes—, se passent de mosquées, tolèrent l’alcool, ne voilent pas leurs femmes, etc., les a mis au ban de l’islam officiel.
Toutefois, depuis 1936 et surtout depuis 1973, les alaouites tentent de s’insérer dans le giron de l’islam officiel chiite, voire sunnite. Mais plus que par leur religion, c’est par leur asabiyya, ce concept forgé au XIVème siècle par Ibn Khaldoun, une valorisation du réseau social où les liens sont surdéterminés par l’appartenance familiale, clanique ou communautaire, qu’ils se distinguent des autres Syriens. Cette asabiyya a été aiguisée par leur histoire conflictuelle avec le pouvoir central, de Saladin jusqu’aux Ottomans en passant par les Mamelouks, les plus féroces de leurs adversaires.
Une histoire faite aussi d’oppression socioéconomique, qui allait vivifier leur solidarité. Seul le mandat français, et pour une brève période (1922-1936), a tenté de les rallier au pouvoir central —avec des succès très mitigés— en leur concédant l’«Etat des Alaouites». Piètre consolation, puisque cette entité, selon le géographe Etienne de Vaumas, était «coupée du reste du monde… conservatoire d’une société condamnée à un dépérissement qui pour être lent n’en était pas moins certain».
De cette préhistoire antérieure au coup d’Etat de 1963, il est resté beaucoup de rancœurs. Les alaouites ont conservé la mémoire de leurs pères, métayers chez les seigneurs féodaux de la plaine et surtout de la ville-symbole sunnite de Hama. Celle aussi des petites filles que l’on «vendait» comme bonnes à tout faire, aux bourgeois et petits-bourgeois des villes de Lattaquié, Damas, Alep et jusqu’à Beyrouth.
Seul vecteur de l’ascenseur social, le parti Baath et la profession militaire. Ce fut d’abord le fait du mandat français, qui recruta, hors de toute relation de proportionnalité avec leur population, des alaouites dans ses bataillons du Levant, présence qui se perpétua après l’indépendance. La démographie militaire montre qu’en 1955, 65% des sous-officiers étaient alaouites et le Comité militaire, chargé du recrutement dans les académies militaires, entre leurs mains. Mais la majorité des officiers restaient sunnites.
De 1963 à 1970, le pouvoir confortera leurs positions au sein de l’appareil et de l’armée, allant crescendo jusqu’au coup d’état de 1970, avant la vigoureuse correction survenue entre 1970 et 1997, année où 61% des principales personnalités militaires et des forces de sécurité étaient alaouites et 35% sunnites.
Un mouvement correctif socioéconomique
Du «mouvement correctif» engagé en 1970, idéologique (abandon de la référence au socialisme), politique et militaire, naîtra un autre mouvement correctif socioéconomique de longue haleine, dont les effets laissent une empreinte forte sur les statistiques, celles du recensement de 2004 notamment.
Rurales avant l’indépendance à plus de 97%, les populations alaouites dominaient, dès 1990, les villes du littoral: 55% à Lattaquié, 70% à Tartous, 65% à Banias, villes, qui sous le mandat français, étaient encore des bastions sunnites (78% environ). L’ascension des alaouites dans l’armée, les services de sécurité, la fonction publique, les entreprises d’Etat et, plus récemment, dans le secteur privé, leur a également assuré une présence marquée à Damas, à Homs, à Hama, mais non à Alep. L’accès à la ville, à l’administration, à l’enseignement, notamment universitaire (avec un système de discrimination positive pour les bourses à l’étranger), a donné un coup de fouet à leur mobilité dans l’échelle sociale.
La rente de situation ainsi générée au profit des alaouites ressort parfaitement des données de 2003-2004. Leur niveau de vie est franchement plus élevé qu’ailleurs (sauf dans la capitale): la dépense mensuelle par personne atteignait 3.310 livres syriennes (un peu moins de 40 euros d’aujourd’hui) dans la région côtière, pour 2.170 seulement dans le gouvernorat d’Alep.

Tous les indicateurs vont d’ailleurs dans le même sens: faible proportion d’actifs dans l’agriculture, un secteur à basse productivité; faible taux d’analphabétisme des adultes, notamment féminin; faible proportion de filles de 5-24 ans non-scolarisées; enfin, une plus forte féminisation de la main-d’œuvre non-agricole, un autre et important critère de la modernité.
L’Etat a également fourni avec plus de générosité aux gouvernorats côtiers l’électricité, l’eau potable, les réseaux d’égouts. Ces statistiques ne signifient pas que les alaouites sont tous devenus aisés ou se sont tous métamorphosés de paysans sans terre en petits ou grands bourgeois: il existe naturellement plus d’un village ou un quartier de ville alaouites pauvres. Mais en moyenne, leur région a connu une progression sans pareil.



Les risques des transitions à deux vitesses
Les alaouites ne sont pas les seuls à connaître au fil des années cette érosion de leurs taux de natalité, solidaires par cette transition démographique des druzes (bien représentés par les gouvernorats de Soueida et de Quneitra) et des chrétiens (disséminés dans tout le pays). En 2004, le nombre moyen d’enfants par femme de la région côtière était tombé à 2,1, soit le seuil de renouvellement des générations (1,8 chez les druzes et autant chez les chrétiens).
La même année, et pour ne retenir que les lieux qui ont fait la une des journaux par l’intensité des combats, la fécondité était de 3,8 enfants par femme à Alep (presque deux fois plus), 3,1 dans le pourtour rural de Damas, 3,5 à Hama, 3,1 à Homs, 5,1 à Idleb, 6,2 à Deir el Zor. A Dera’a, qui a inauguré la série sanglante, elle était de 4,6.
Cette transition à deux vitesses signifie que la population majoritaire, déjà très nombreuse, est alimentée en sus par un flux de naissances très abondantes et en augmentation, là où la minorité ou les minorités (à l’exception notoire des Kurdes) voient leurs naissances s’atrophier et diminuer.
Dans un contexte de conflit, la transposition des chiffres démographiques en chiffres militaires est automatique: tous les ans, à 18 ans ou un peu plus, des jeunes issus de la majorité vont se présenter de plus en plus nombreux sous les drapeaux, alors même qu’en face les jeunes issus des minorités sont de moins en nombreux. Le youth bulge syrien, l’explosion démographique des jeunes à l’âge d’entrée dans l’armée, est uniquement l’affaire de la majorité. Entre 1963 et 2012, leurs effectifs ont été multipliés par 5,3 dans la majorité sunnite, mais seulement par 2,4 dans la minorité chiite.
L’impossible partition
Devant ce conflit qui s’éternise, d’aucuns en viennent à penser que l’ultime recours serait la partition du pays et la création d’un mini-état alaouite, d’un réduit ou d’une zone de repli dans la zone côtière —une nouveauté dans la région, où le Liban a connu seize ans de guerre civile et a réussi à échapper à la partition, de même que l’Irak malgré la région autonome kurde.
Mais ce sont surtout des raisons démographiques qui rendent ces projets chimériques. En 2012, le «réduit» alaouite compte 1,8 million d’habitants. Sa population se décompose en 1,2 millions d’alaouites et 665.000 non alaouites, dont 340.000 sunnites, les plus exposés aux transferts de population en cas d’aggravation du conflit. Les autres communautés des deux gouvernorats de Lattaquié et Tartous, chrétiens et ismaéliens, seraient moins exposés.
Mais en dehors de ces deux gouvernorats, la Syrie compte un million d’alaouites, presque autant qu’à Lattaquié et Tartous. Pour la plupart, ils sont désormais très enracinés dans leurs lieux de vie et n’entretiennent plus que des liens ténus avec leurs villages ou leurs villes d’origine. Ces chiffres imposants montrent bien toute la démesure d’un découpage de la Syrie, inimaginable du fait du brassage de ses populations.
Youssef Courbage pour Slate.fr
A lire sur le sujet, de Youssef Courbage: Christian and Jews under Islam (avec Philippe Fargues, Tauris, 1998); «La population de la Syrie: des réticences à la transition (démographique)», in Baudoin Dupret, Youssef Courbage et al., La Syrie au présent, reflet d’une société (Paris, Actes-Sud, 2007).
D’autres auteurs: Jacques Weulersse, Le pays des Alaouites (Tours, 1940); Etienne de Vaumas, «Le Djebel Ansarieh. Eude de géographie humaine», Revue de géographie alpine (1960); Hana Batatu, Syria’s peasantry, the descendants of its lesser notables, and their politics, (Princeton U.P., 1999); Fabrice Balanche, La région alaouite et le pouvoir syrien(Karthala, 2006).
[1] Dans l’ensemble de ce pays de 21,6 millions d’habitants, la transition démographique piétine. Malgré la baisse rapide de la mortalité infantile (18/1000), la fécondité reste élevée et constante, avec 3,5 enfants lors de l’enquête sur la santé de la famille de 2009, ce qui situe la Syrie au rang des pays arabes les plus féconds (70% de plus que la Tunisie, 60% de plus que le Maroc, deux fois plus que le Liban). Avec des différences régionales phénoménales: les gouvernorats de minorités, Lattaquié et Tartous, ou celui de Soueida, où la fécondité est désormais très basse, ne croissent qu’au rythme de 1,6%, l’an contre 2,5% pour le reste du pays. Revenir à l’article
[2] A l’époque ottomane, la population de la Syrie était recensée selon la religion: musulmane (sans distinction des confessions détaillées), chrétienne (confessions détaillées) et juive. Sous le mandat français, les recensements mentionnaient la confession précise. Les recensements ultérieurs de 1947 et de 1960 donnaient la religion, mais non la confession précise, habitude qui fut abandonnée avec le recensement de 1970. L’état civil, en revanche, a longtemps continué à mentionner la religion pour les musulmans et les chrétiens, précisant pour ces derniers leur confession détaillée.
Les estimations actuelles sont fondées sur des projections démographiques réalisées à partir de données anciennes, des évaluations effectuées par des spécialistes du milieu syrien (Balanche, de Vaumas, Weulersse) et sur des imputations de certains paramètres démographiques à partir de données régionales (par exemple les gouvernorats de Lattaquié et Tartous pour les alaouites, celui de Soueida pour les druzes). On a donc en main des ordres de grandeurs raisonnables, mais en aucun cas des chiffres irréfutables à 100% comme auraient pu l’être ceux de recensements qui mentionneraient la confession détaillée ou la langue maternelle.









 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg



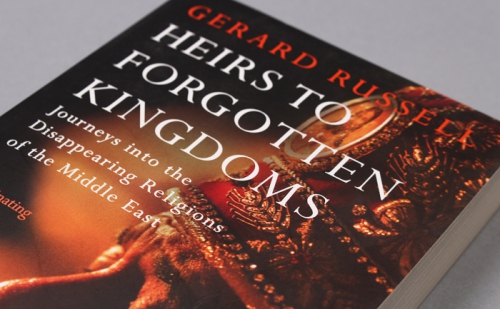



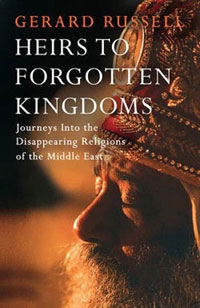 In the spring of 2006, Gerard Russell was a bored British diplomat stewing in the heat of the Green Zone in Baghdad, “a five-mile 21st-century dystopia filled with concrete berms and highway bridges that ended in midair where a bomb had cleaved them”. Then he received a call from the high priest of the Mandeans.
In the spring of 2006, Gerard Russell was a bored British diplomat stewing in the heat of the Green Zone in Baghdad, “a five-mile 21st-century dystopia filled with concrete berms and highway bridges that ended in midair where a bomb had cleaved them”. Then he received a call from the high priest of the Mandeans.

par Youssef Courbage
Ex: http://mediabenews.wordpress.com/