dimanche, 02 juin 2013
Presseschau - Juni 2013
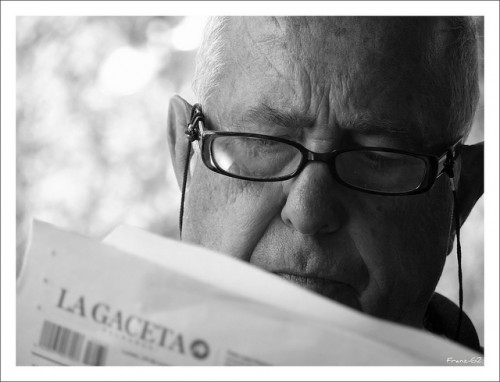
#####
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, journaux, médias, europe, allemagne, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Gilbert Durand, l'esploratore dell'immaginario
di Massimo Introvigne
Fonte: lanuovabq
A funerali avvenuti, come desiderava, è stata data notizia della morte, avvenuta il 7 dicembre 2012, di Gilbert Durand (1921-2012), uno dei più grandi antropologi del secolo XX. Se mi è concesso partire da un ricordo personale, la pubblicazione in italiano nel 1972 della sua opera principale, «Le strutture antropologiche dell’immaginario» (Dedalo, Bari) – mentre l’edizione francese risaliva al 1960 – fu per me una vera rivelazione, e per certi versi perfino una liberazione. Un grande accademico, in un certo senso, «sdoganava» tutto il discorso sui miti e sui simboli, mostrando che si trattava di oggetti assolutamente legittimi dello studio e del sapere universitario, e che le scienze umane – cui cominciavo ad accostarmi, terminando il liceo – non dovevano limitarsi a considerare l’uomo nella sua dimensione di lavoratore, produttore e consumatore ma potevano e dovevano studiare anche le sue dimensioni simboliche, religiose, mistiche.
Si capisce difficilmente Durand – lo affermava volentieri lui stesso – se si trascurano le sue origini savoiarde, l’amore per la regione di origine, la montagna, la neve – che, nella sua valenza simbolica, è oggetto dei suoi primi studi –, il legame con la capitale della Savoia, Chambéry, dove inizia la sua carriera come professore di liceo dopo avere studiato filosofia e avere partecipato attivamente alla resistenza anti-nazista. Dopo la guerra decide di completare gli studi a Parigi, dove ha l’incontro decisivo con il filosofo Gaston Bachelard (1884-1962), il primo che – in una Sorbona ancora molto sospettosa – comincia a studiare l’immaginario e i simboli, articolati intorno ai quattro elementi classici terra, aria, acqua e fuoco, sebbene con un accostamento ancora ampiamente condizionato dal positivismo e dalla psicanalisi freudiana che il suo allievo Durand tenterà più tardi di superare.
Con l’università Durand ha sempre avuto un rapporto ambivalente. Con molta riluttanza nel 1956 lascia il liceo di Chambéry – di cui affermerà sempre di avere i migliori ricordi – per accettare – pur essendo laureato in filosofia – una cattedra di sociologia all’Università di Grenoble II. Studia coscienziosamente i sociologi del XIX e del XX secolo, ma si rende conto rapidamente che nel mondo della sociologia accademica francese non c’è spazio per quanto comincia soprattutto a interessarlo, lo studio dei simboli e dei miti, appreso da Bachelard e approfondito anche al di là dell’Occidente e dell’Europa dopo avere incontrato a Parigi Roger Bastide (1898-1974), uno dei contro-relatori della sua tesi di dottorato, un grande studioso delle religioni afro-brasiliane che per primo gli fa conoscere il metodo antropologico. All’insegnamento della sociologia Durand affianca così, sempre a Grenoble, quello dell’antropologia, ed è come antropologo che pubblica nel 1960 «Le strutture antropologiche dell’immaginario», un’opera che gli assicura una fama mondiale, e fonda nel 1966 il Centro di ricerche sull’immaginario, nucleo della cosiddetta «scuola di Grenoble».
Durand ha sempre presentato come fondamentale per il suo pensiero l’incontro con lo studioso dell’islam Henri Corbin (1903-1978), che a sua volta lo presenta allo storico delle religioni Mircea Eliade (1907-1986) e lo introduce nel Circolo di Eranos, un cenacolo di studio delle mitologie di tutti i tempi e Paesi che si riunisce ad Ascona e dove ha avuto un ruolo centrale lo psicanalista Carl Gustav Jung (1875-1961), che peraltro nel momento in cui Durand entra nel circolo è già morto. Lo stesso incontro con Corbin avviene due anni dopo la pubblicazione de «Le strutture antropologiche dell’immaginario», un libro rispetto al quale le opere successive di Durand mostrano maggiori aperture verso forme simboliche non occidentali, specie dopo il matrimonio con l’allieva cinese Chaoying Sun, che lo spinge a studiare il ricchissimo patrimonio di miti e simboli della Cina.
La sociologia e l’antropologia accademiche accettano Durand con molte difficoltà, ed egli mantiene sempre un suo ambito di lavoro indipendente che prescinde dall’università. Con molta prudenza, com’è d’obbligo per l’antropologia del suo tempo, Durand ha cura di partire sempre da un dato biologico, la struttura del cervello umano, ed è anzi fra i pochi ad approfondire le ricerche della scuola di riflessologia di Leningrado fondata dallo psichiatra Vladimir Michajlovi? Bechterev (1857-1927), scomparso in circostanze misteriose dopo avere diagnosticato una sindrome paranoica al suo illustre paziente Iosif Stalin (1879-1953) e studioso di rilievo internazionale, anche se è passato alla storia soprattutto per l’affermazione iperbolica secondo cui «solo in due conoscono il mistero della struttura ed organizzazione del cervello: Dio e Bechterev».
Ma, benché parta dall’anatomia, Durand si rifiuta assolutamente di ridurre l’antropologia allo studio anatomico, così come – pur avendo studiato e insegnato la sociologia – non accetta di ridurre lo studio dell’uomo a quello dei fattori sociali che lo condizionano. Lo studioso savoiardo mantiene per molti anni un rapporto di amicizia e stima reciproca con l’antropologo Claude Lévi-Strauss (1908-2009), il padre dello strutturalismo. Tuttavia, l’antropologia di Durand – come egli stesso scriverà – è, da un certo punto di vista, il contrario di quella di Lévi-Strauss: per quest’ultimo le strutture pre-esistono all’uomo e lo determinano, mentre per Durand le strutture sono «antropologiche», nel senso che nascono dall’uomo.
Il nucleo centrale della teoria di Durand – in questo senso davvero innovativa rispetto all’antropologia materialista dominante quando pubblica la sua opera fondamentale – è che l’uomo si differenzia radicalmente dagli animali anzitutto per la sua capacità di produrre simboli e di esprimersi tramite simboli. Certamente il linguaggio e la socialità sono caratteristiche fondamentali dell’uomo, e Durand riprende dalla scuola francese di sociologia l’idea secondo cui la società è necessaria perché il piccolo d’uomo, a differenza di quello degli animali, per molti anni non è in grado di sopravvivere da solo. Ma socialità e linguaggio, per Durand, sono resi possibili solo dai simboli.
A partire dallo studio della più piccola unità che costituisce i simboli e i miti – che, riprendendo un’espressione di Lévi-Strauss, chiama «mitema» – Durand propone un’ambiziosa cartografia dei principali simboli che hanno caratterizzato le culture umane, distinguendo le strutture dell’immaginario in diurne, notturne e sintetiche. Le strutture diurne fanno riferimento alla conquista del tempo, alla vittoria sulla morte, al trionfo della luce sulle tenebre. I miti che fanno da sfondo – sovente non riconosciuto – alla cultura scientifica moderna sono esclusivamente di natura diurna e, in quanto tali, rischiano di perdere contatto con le altre strutture e di conferire alla scienza un accostamento unilaterale. Le strutture notturne sono invece di natura mistica e drammatica, danno valore al cuore più che alla ragione, permettono di vedere il mondo in tutti i suoi colori e non solo in bianco e nero. La prevalenza delle sole strutture notturne – di cui Durand vede il trionfo nei racconti del ciclo del Graal e anche nell’arte del pittore olandese Vincent van Gogh (1853-1890) – si ritrova in molte forme del pensiero religioso ma può provocare fenomeni che l’antropologo chiama di «gulliverizzazione» – con riferimento al personaggio Gulliver del romanzo satirico dello scrittore irlandese Jonathan Swift (1667-1745), che si ritrova in un’isola abitata da uomini di piccolissima statura –, cioè di attenzione maniacale al piccolo dettaglio che portano a perdere di vista il quadro generale.
Infine le strutture sintetiche dell’immaginario, insieme diurne e notturne e tipicamente europee e occidentali, danno rilievo alla dialettica di luce e tenebre che costituisce propriamente la storia, generano miti orientati al futuro e, non integrate con le altre strutture, rischiano di portare a una visione della storia considerata esclusivamente come necessario progresso verso il bene, che Durand ritrova nel monaco calabrese Gioacchino da Fiore (ca. 1130-1202) e nella sua posterità diretta e indiretta – studiata in seguito dal cardinale Henri de Lubac (1896-1991) – che arriva fino al fondatore del positivismo Auguste Comte (1798-1857) e a Karl Marx (1818-1883).
Per Durand tutti e tre i tipi di strutture e di miti sono necessari a un’esistenza umana integrata e aperta all’altro, alla compassione e alla moralità. Pensatore spirituale ma non religioso – nel senso di non aderente ad alcuna religione organizzata –, Durand ritrova l’eredità di questo «politeismo» dei simboli nel cattolicesimo, che cerca nella sua liturgia, mistica e arte d’integrare tutti i simboli senza trascurarne nessuno. In questa chiave, critica anche alcuni testi del Concilio Ecumenico Vaticano II e la riforma liturgica post-conciliare che, a suo avviso, avrebbero privato la Chiesa di una parte della sua grande ricchezza simbolica.
In una chiave analoga, Durand critica anche la massoneria moderna, che sarebbe diventata un’organizzazione politica e razionalista perdendo il ruolo di contenitore di miti e di leggende che avrebbe avuto in alcune sue incarnazioni settecentesche. Si spiega così il suo tentativo, nel 1973, di rifondare – insieme all’etnologo Jean Servier (1918-2000) – una loggia massonica di tipo «arcaico», Les Trois Mortiers di Chambéry, che era stata nel Settecento un’istituzione tipica della Savoia e di cui aveva fatto parte in un certo periodo della sua vita Joseph de Maistre (1753-1821), di cui lo stesso Durand ricostruirà con passione la carriera nella massoneria. I diversi scritti sulla massoneria di Durand hanno tutti un tono arcaizzante: e forse l’antropologo coltivava qualche illusione – come de Maistre, che finì però poi per disilludersi, nella prima parte della sua vita – sulla possibilità di contrapporre alle logge laiche e razionaliste organizzazioni massoniche «tradizionali» dedite principalmente allo studio e alla meditazione di alcuni complessi di miti antichi.
Durand stesso ha presentato come suoi principali contribuiti all’antropologia tre nozioni. La prima è il «tragitto antropologico», cioè l’interazione fra la soggettività della persona e l’ambiente circostante, da cui nascono i simboli e i miti. La seconda è il «bacino semantico», cioè il clima che caratterizza un’epoca in cui l’immaginario si declina in simboli e miti particolari che, dapprima «attivi», diventano in seguito «passivi» e infine perdono il loro vigore, sostituiti da altri. La terza è lo «scambio interattivo fra attività e passività», per cui i simboli possono costantemente trasformarsi da attivi in passivi e viceversa. Queste nozioni mostrano la grande attenzione – spesso trascurata dai critici – che Durand aveva nei confronti della storia, così com’era attento alla letteratura e all’arte, dal cui percorso spesso si comprende quali simboli si stanno affermando in una determinata cultura.
E l’arte, secondo Durand, è anche densa di contenuti etici. Si può ricordare in particolare la sua appassionata difesa, contro le accuse di chi tentava di metterlo al bando come presunto precursore del nazional-socialismo, della musica di Richard Wagner (1813-1883), che aveva in comune con l’antropologo francese la passione per il mito del Graal e dalle cui opere secondo Durand si ricava una nozione di «comprensione profonda» attraverso il cuore, che porta alla compassione ed è precisamente agli antipodi del nazismo.
Uomo del suo tempo e – nonostante le riserve e i distinguo – figlio dell’università francese del secolo XX, Durand non ci appare oggi come totalmente libero dai condizionamenti relativisti tipici del suo ambiente culturale di origine, da cui deriva anche un certo gergo psicanalitico o derivato da una psichiatria riduzionista oggi forse – e fortunatamente – meno di moda nelle scienze umane in genere. Il suo sforzo di riabilitare i simboli come elementi fondamentali dell’esperienza umana resta però un contributo fondamentale e positivo a uno studio della persona umana che non la riduca soltanto alla sua dimensione biologica ovvero a quella dell’economia e del lavoro, e tenga conto del mito, della mistica e della religione.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religiologiques, gilbert durand, philosophie, imaginaire religieux, religion |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Calabria Fest 2013
00:05 Publié dans Affiches, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, fête, événement |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 01 juin 2013
En souvenir de Dominique Venner

Robert STEUCKERS:
En souvenir de Dominique Venner
Il faut que je l’écrive d’emblée: je n’ai guère connu Dominique Venner personnellement. Je suis, plus simplement, un lecteur très attentif de ses écrits, surtout des revues “Enquête sur l’histoire” et “La nouvelle revue d’histoire”, dont les démarches correspondent très nettement à mes propres préoccupations, bien davantage que d’autres revues de la “mouvance”, tout bonnement parce qu’elles exhalent un double parfum de longue mémoire et de géopolitique. Lire les revues que publiait Dominique Venner, c’est acquérir au fil du temps, un sens de la continuité européenne, de notre continuité spécifique, car je me sens peut-être plus “continuitaire” qu’“identitaire”, plus imbriqué dans une continuité que prostré dans une identité figée, mais c’est là un autre débat qui n’implique nullement le rejet des options dites “identitaires” aujourd’hui dans le langage courant, des options “identitaires” qui sont au fond “continuitaires”, puisqu’elles veulent conserver intactes les matrices spirituelles des peuples, de tous les peuples, de manière à pouvoir sans cesse générer ou régénérer les Cités de la Terre. Lire “La nouvelle revue d’histoire”, c’est aussi, surtout depuis l’apport régulier d’Ayméric Chauprade, replacer ces continuités historiques dans les cadres d’espaces géographiques précis, dans des lieux quasi immuables qui donnent à l’histoire des constantes, à peine modifiées par les innovations technologiques et ballistiques.
J’ai découvert pour la première fois un livre de Dominique Venner dans une librairie bizarre, qui vendait des livres et tout un bric-à-brac d’objets des plus hétéroclites: elle était située Boulevard Adolphe Max et n’existe plus aujourd’hui. Ce livre de Dominique Venner s’intitulait “Baltikum”. Nous étions en août 1976: je revenais d’un bref séjour en Angleterre, d’une escapade rapide à Maîche, j’avais vingt ans et huit bons mois, la chaleur de ce mois des moissons était caniculaire, torride, l’herbe de notre pelouse était rôtie comme en Andalousie, le plus magnifique bouleau de notre jardin mourrait en dépit des efforts déployés pour le sauver coûte que coûte. J’allais rentrer en septembre, le jour où l’on a inauguré le métro de Bruxelles, à l’Institut Marie Haps, sous les conseils avisés du Professeur Jacques Van Roey, l’éminent angliciste de l’UCL. C’est à ce moment important de mon existence, où j’allais me réorienter et trouver ma voie, que j’ai acheté ce livre de Venner. L’aventure des “Corps francs” du Baltikum ouvrait des perspectives historiques nouvelles au lecteur francophone de base, peu frotté aux souvenirs de cette épopée, car les retombées à l’Est de la première guerre mondiale étaient quasi inconnues du grand public qui ne lit qu’en français; l’existence des Pays Baltes et de la communauté germanophone de Courlande et d’ailleurs, fidèle au Tsar, avait été oubliée; en cette époque de guerre froide, les trois républiques baltes faisaient partie d’une Union Soviétique perçue comme un bloc homogène, pire, homogénéisé par l’idéologie communiste. Personne n’imaginait que les langues et les traditions populaires des ethnies finno-ougriennes, tatars, caucasiennes, etc. étaient préservées sur le territoire de l’autre superpuissance, finalement plus respectueuse des identités populaires que l’idéologie du “melting pot” américain, du “consumérisme occidental” ou du jacobinisme parisien. La spécificité du “Baltikum” était tombée dans une oubliette de notre mémoire occidentale et ne reviendra, pour ceux qui n’avaient jamais lu le livre de Venner, qu’après 1989, qu’après la chute du Mur de Berlin, quand Estoniens, Lettons et Lituaniens formeront de longues chaînes humaines pour réclamer leur indépendance. Pour l’épopée des Corps francs et des premières armées baltes indépendantes, tout lecteur assidu de “La nouvelle revue d’histoire” pourra se rendre au Musée de l’Armée de Bruxelles, où de nombreuses vitrines sont consacrées à ces événements: j’y ai amené un excellent ami, homme à la foi tranquille, homme de devoir et de conviction, le Dr. Rolf Kosieck, puis, quelques années plus tard, un jeune collaborateur de Greg Johnson; ils ont été ravis.
Liberté et rupture disloquante
Outre ces pages d’histoire qui revenaient bien vivantes à nos esprits, grâce à la plume de Dominique Venner, il y avait aussi, magnifiquement mise en exergue, cette éthique de l’engagement pour la “continuité” (russe, allemande ou classique-européenne) contre les ruptures disloquantes, que les protagonistes de celles-ci posaient évidemment comme “libératrices” sans s’apercevoir tout de suite qu’elles engendraient des tyrannies figeantes, inédites, qui broyaient les âmes et les corps, mêmes ceux de leurs plus féaux serviteurs (cf. les mémoires d’Arthur Koestler et la figure de “Roubachov” dans “Le Zéro et l’infini”). Il n’y a de liberté que dans les continuités, comme le prouve par exemple le maintien jusqu’à nos jours des institutions helvétiques dans l’esprit du “Serment du Rütli”: quand on veut “faire du passé table rase”, on fait disparaître la liberté dans ce nettoyage aussi atroce que vigoureux, dans ces “purgations” perpétrées sans plus aucune retenue éthique, semant la mort dans des proportions inouïes. Aucune vraie liberté ne peut naître d’une rupture disloquante de type révolutionnaire ou trotskiste-bolchevique, sauf peut-être celle, d’un tout autre signe, qui fera table rase des sordides trivialités qui forment aujourd’hui l’idéologie de l’établissement, celle du révolutionarisme institutionalisé qui, figé, asseoit sans résistance notable son pouvoir technocratique, parce que tous les repères sont brouillés, parce que les “cives” de nos Cités n’y voient plus clair... Rétrospectivement, après 37 ans, c’est la première leçon que le Prof. Venner m’a enseignée...
Ensuite, toujours rétrospectivement, la liberté dans la continuité a besoin de “katechons”, de forces “katechoniques”, qui peuvent se trouver dans l’âme d’un simple volontaire étudiant, fût-il le plus modeste mais qui, en passant de sa Burschenschaft à son Freikorps, donne son sang et sa vigueur physique pour arrêter l’horreur liberticide qui avance avec le masque de la liberté ou de la “dés-aliénation”, tandis que les “bourgeois” comptent leurs sous ou se livrent à la débauche dans le Berlin qu’a si bien décrit Christopher Isherwood: tous les discours sur la liberté, qui cherchent à vendre une “liberté” qui permet la spéculation ou qui fait miroiter le festivisme, une “liberté” qui serait installée définitivement dans tous les coins et recoins de la planète pour aplatir les âmes, sont bien entendu de retentissantes hypocrisies. La liberté, on ne la déclame pas. La liberté, ce n’est pas une affaire de déclamations. On la prend. On se la donne. On ne se la laisse pas voler. En silence. Maxillaires fermées. Mais on la garde au fond du coeur et on salue silencieusement tous ceux qui font pareil. Comme Cinccinatus, on retourne à sa charrue dès que le danger mortel est passé pour la Cité. Les “Corps francs”, qui fascinaient Venner, étaient une sorte de “katechon” collectif, dont toutes les civilisations en grand péril ont besoin.
Nous ne savions rien des aventures politiques de Venner
Nous ignorions tout bien entendu des aventures politiques de Dominique Venner quand nous lisions “Baltikum”: elles s’étaient déroulées en France, pays que nous ne connaissions pas à l’époque, où la télévision n’était pas encore câblée, même si ce pays est voisin, tout proche, et que nous parlions (partiellement) la même langue que lui. Je n’avais jamais été que dans une toute petite ville franc-comtoise, en “traçant” sur la route sans aucun arrêt, parce que mon père, homme toujours pressé, le voulait ainsi et qu’il n’y avait pas moyen de sortir une idée de sa tête (le seul arrêt de midi se résumait à un quart d’heure, dûment minuté, pour avaler deux tartines, un oeuf dur et une pomme le long d’un champ). De la France, hormis Maîche en Franche-Comté et un séjour très bref à Juan-les-Pins (avril 1970) dans un immeuble dont tous les locataires étaient belges, je n’avais vu que quelques coquelicots dans l’un ou l’autre champ le long des routes lorraines ou comtoises et n’avais entendu que le bourdonnement d’abeilles champêtres, à part, c’est vrai, une seule visite à l’Ossuaire de Douaumont et un arrêt de dix minutes devant la “Maison de la Pucelle” à Domrémy. En 1974, aucun de nous, à l’école secondaire, n’avait jamais mis les pieds à Paris.
De l’aventure de l’OAS, nous ne savions rien car elle ne s’était pas ancrée dans les mémoires de nos aînés à Bruxelles et personne n’évoquait jamais cette aventure, lors des veillées familiales ou après la poire et le fromage, ni n’émettait jamais un avis sur l’Algérie: les conversations politiques dont je me souviens portaient sur la marche flamande sur Bruxelles en 1963, sur l’assassinat de Kennedy la même année, sur le déclin de l’Angleterre (à cause des Beatles, disait un oncle), sur le Shah d’Iran (mon père était fasciné par l’Impératrice), sur Franco (et sur la “Valle de los Caidos” et sur l’Alcazar de Tolède qui avait tant marqué mon père, touriste en mai 1962) voire, mais plus rarement, sur le Congo (lors de l’affaire de Stanleyville, car une de mes cousines germaines avait épousé un parachutiste...). Les traces de la guerre d’Algérie, la tragédie des Pieds-Noirs, les aventures politiques du FLN et de l’OAS sont très présentes dans les débats politico-historiques français: je ne m’en apercevrai que très tard, ce qui explique sans doute, pour une bonne part, le porte-à-faux permanent dans lequel je me suis retrouvé face à des interlocuteurs français qui faisaient partie de la même mouvance que Dominique Venner. Mais ce porte-à-faux, finalement, concerne presque tous mes compatriotes, a fortiori les plus jeunes (maroxellois compris!), qui n’ont jamais entendu parler des événements d’Algérie: combien d’entre eux, à qui les professeurs de français font lire des livres d’Albert Camus, ne comprennent pas que cet auteur était Pied-Noir, a fortiori ce qu’était le fait “pied-noir”, ne perçoivent pas ce que cette identité (brisée) peut signifier dans le coeur de ceux qui l’ont perdue en perdant le sol dont elle avait jailli, ni quelles dimensions affectives elle peut recouvrir dans la sphère politique, même après un demi-siècle.
Attitude altière
Au cours de toutes les années où j’ai côtoyé les protagonistes français du “Groupement de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne”, c’est-à-dire de 1979 (année de ma première participation à une journée de débats auprès du cercle “Etudes & Recherches”, présidé à l’époque par Guillaume Faye) à 1992 (date de mon départ définitif), je n’ai vu ni aperçu Dominique Venner, sauf, peut-être, en 1983, lors d’une “Fête de la Communauté” près des Andelys, à la limite de l’Ile-de-France et de la Normandie. Cette fête avait été organisée par le regretté Jean Varenne, le grand spécialiste français de l’Inde et du monde védique, qui avait invité une célèbre danseuse indienne pour clore, avec tout le panache voulu, cette journée particulièrement réussie, bien rythmée, avec un buffet gargantuesque et sans aucun couac. Ce jour-là, un homme engoncé dans une parka kakie (tant il pleuvait), correspondant au signalement de Dominique Venner, est venu se choisir deux ou trois numéros d’ “Orientations” dans le stand que j’animais, sans mot dire mais en braquant sur ma personne son regard bleu et perçant, avant de tourner les talons, après un bref salut de la tête. Cette attitude altière —besser gesagt diese karge Haltung— est le propre d’un vrai croyant, qui ne se perd pas en vains bavardages. De toutes les façons, je pense qu’on s’était compris, lui le Francilien qui avait des allures sévères et jansénistes (mais l’évêque Jansen était d’Ypres, comme ma grand-mère...), moi le Brabançon, plus baroque, plus proche de la Flandre espagnole de Michel de Ghelderode qui pense souvent qu’il faut lever sa chope de gueuze ou de faro pour saluer, ironiquement, irrespectueusement, les cons du camp adverse car leurs sottises, finalement, nous font bien rire: il faut de tout pour faire une bonne Europe. C’est le sentiment que j’ai eu, après avoir croisé pour la première fois le regard vif et silencieux de Venner, un sentiment dont je ne me suis jamais défait.
La carte d’identité de Venner s’est constituée dans ma tête progressivement: je découvrais ses ouvrages militaires, ses volumes sur les armes de poing ou de chasse, les armes blanches et les armes à feu, et surtout sa “Critique positive”, rédigée après les aventures politiques post-OAS, etc. Je découvrais aussi son livre “Le Blanc soleil des vaincus”, sur l’héroïsme des Confédérés lors de la Guerre de Sécession, sentiment que l’on partageait déjà en toute naïveté, enfants, quand on alignait nos soldats Airfix, les gris de la Confédération —nos préférés— et les bleus de l’Union sans oublier les bruns du train d’artillerie (Nordistes et Sudistes confondus), sur la table du salon, quand il pleuvait trop dehors, notamment avec mon camarade d’école primaire, Luc François, devenu fringant officier au regard plus bleu que celui de Venner, alliant prestance scandinave et jovialité toujours franche et baroque, bien de chez nous, puis pilote de Mirage très jeune, et tué à 21 ans, en sortant de sa base, sur une route verglacée de la Famenne, laissant une jeune veuve et une petite fille...
Cependant, Venner n’est devenu une présence constante dans mon existence quotidienne que depuis la fondation des revues “Enquête sur l’histoire” et “La nouvelle revue d’histoire” parce que le rythme parfait, absolument régulier, de leur parution amenait, tous les deux mois, sur mon bureau ou sur ma table de chevet, un éventail d’arguments, de notes bibliographiques précieuses, d’entretiens qui permettait des recherches plus approfondies, des synthèses indispensables, qui ouvrait toujours de nouvelles pistes. Ces revues me permettaient aussi de suivre les arguments de Bernard Lugan, d’Ayméric Chauprade, de François-Georges Dreyfus, de Bernard Lugan, de Philippe Conrad, de Jacques Heers, etc. Chaque revue commençait par un éditorial de Venner, exceptionnellement bien charpenté: son éditeur Pierre-Guillaume de Roux ferait grande oeuvre utile en publiant en deux volumes les éditoriaux d’“Enquête sur l’histoire” et de “La nouvelle revue d’histoire”, de façon à ce que nous puissions disposer de bréviaires utiles pour méditer la portée de cette écriture toute de clarté, pour faire entrer la quintessence du stoïcisme de Venner dans les cerveaux hardis, qui entretiendront la flamme ou qui créeront un futur enfin nettoyé, expurgé, de toute la trivialité actuelle.
Historien méditatif
Récemment, Dominique Venner se posait comme un “historien méditatif”. C’est une belle formule. Il était bien évidemment l’exemple —et l’exemple le plus patent que j’ai jamais vu— du “civis romanus” (du “civis europaeus”) stoïque qui se pose comme l’auxiliaire volontaire du “katechon”, surtout quand celui-ci est un “empereur absent”, dormant sous les terres d’un Kyffhäuser tenu secret. L’historien méditatif est un historien tacitiste (selon la tradition de Juste Lipse) qui dresse les annales de l’Empire, les consigne dans ses tablettes, espère faire partager un maximum de ses sentiments “civiques” aux meilleurs de ses contemporains, sans pouvoir se mettre au service d’un Prince digne de ce nom puisqu’à son grand dam il est condamné à vivre dans une période particulièrement triviale de l’histoire, une période sombre, sans aura aucun, où la patrie et l’Empire, le mos majorum et la civilisation, sombrent dans un Kali Yuga des plus sordides. Il y a un parallèle à tracer entre la démarche personnelle, stoïque et tacitiste de Venner, et les grands travaux de Pierre Chaunu, qui voyait, lui aussi, l’histoire comme héritage et comme prospective: histoire et sacré, histoire et foi, histoire et décadence, tels sont les mots qui formaient les titres de ses livres.
En effet, Pierre Chaunu, dans “De l’histoire à la prospective”, posait comme thèse centrale que “la méditation du futur, c’est la connaissance du présent”. Et du passé, bien évidemment, puisque le présent en est tributaire, puisque, dixit encore Chaunu, le présent devient passé dès qu’on l’a pensé. Chaunu plaidait, on le sait, pour une “histoire sérielle”, capable de récapituler toutes les données économiques, sociales et culturelles, de la manière la plus exhaustive qui soit, de manière à disposer d’un instrument d’analyse aussi complet que possible, donc non réduit et, partant, très différent de tous les réductionnismes à la mode. Chaunu, par cet instrument que devait devenir l’histoire sérielle, entendait réduire les “à-coups” contre lesquels butent généralement les politiques, si elles ne sont pas servies par une connaissance complète, ou aussi complète que possible, du passé, des acquis, des dynamiques à l’oeuvre dans la Cité, que celle-ci soient de dimensions réduites ou aient la taille d’un Empire classique. Chaunu est donc l’héritier des tacitistes de Juste Lipse, armé cette fois d’un arsenal de savoirs bien plus impressionnants que celui des pionniers du 16ème siècle. L’objectif des revues “Enquête sur l’histoire” et “La nouvelle revue d’histoire” a été de faire “oeuvre de tacitisme”. Dans l’éditorial du n°1 de “La nouvelle revue d’histoire”, Venner écrivait: “L’héritage spirituel ne devient conscient que par un effort de connaissance, fonction par excellence de l’histoire, avec l’enseignement du réel et le rappel de la mémoire collective”. Oeuvre nécessaire car comme l’écrit par ailleurs Chaunu, dans “De l’histoire à la prospective”: “La nouvelle histoire (...) n’a pas réussi à pénétrer la culture des milieux de la décision technocratique” (p. 39). Chaunu écrivait cette phrase, raisonnait de la sorte, en 1975, quand le néo-libéralisme de la “cosmocratie” (vocable forgé par Venner dans “Le siècle de 1914”) n’avait pas encore accentué les ravages, n’avait pas encore établi la loi de l’éradication totale de toutes les mémoires historiques. Trois ans plus tard, en 1978, Chaunu, dans “Histoire quantitative, histoire sérielle”, était déjà plus pessimiste: il n’espérait plus “historiciser” les technocrates. Son inquiétude s’exprimait ainsi: “Nous sommes arrivés au point où l’Occident peut tout, même se détruire. Une civilisation se détruit en se reniant. Elle se défait comme une conscience de soi, sous la menace, plus grave que la mort, de la schizophrénie” (p. 285). Nous y sommes... Dans “Histoire et décadence”, paru en 1981, Chaunu constate que les bases de la vie sont désormais atteintes, que la décadence occidentale, partie des Etats-Unis pour envelopper progressivement la planète entière par cercles concentriques, avec pour élément perturbateur premier, voire moteur, ce que Chaunu appelait le “collapsus” de la vie, la réduction catastrophique des naissances dans la sphère occidentale (Etats-Unis et Europe, URSS comprise). Pour lui, ce collapsus démographique (qui ne se mesurera pleinement, annonçait-il, que dans les années 1990-2000), est un phénomène de “décadence objective” (p. 328). Avec la détérioration de plus en plus accélérée des systèmes éducatifs, “l’acquis ne passe plus, le vieillissement [de la population] s’accompagne d’une viscosité qui empêche l’écoulement de l’acquis” (p. 329).
Du “civis” au zombi
Chaunu était un pessimiste chrétien qui enseignait à la Faculté de Théologie Réformée d’Aix-en-Provence, un protestant proche du catholicisme, un combattant contre l’avortement, qui inscrivait sa démarche dans sa foi (cf. “Histoire et foi – deux mille ans de plaidoyer pour la foi”, 1980). Venner alliait le paganisme immémorial, sans épouser les travers des folkloristes néo-païens, à un stoïcisme qui le fascinait comme le prouvent d’ailleurs de nombreuses pages d’“Histoire et traditions des Européens”. Chaunu et Venner partageaient toutefois la notion de déclin par schizophrénie, amnésie et collapsus démographique. Les années 1990 et la première décennie du 21ème siècle n’ont apporté aucun remède à la maladie, malgré l’espoir, finalement fort mince, de Chaunu: on a titubé de mal en pire, jusqu’aux folies du festivisme, dénoncées par Muray, pour aboutir à la mascarade du “mariage pour tous” qu’un peuple, auparavant indolent, refuse instinctivement aujourd’hui (mais cette révolte durera-t-elle?). On est arrivé au moment fatidique du Kali Yuga, quand tous les phénomènes de déclin s’accélèrent, se succèdent en une sarabande infernale, en un cortège monstreux comme sur les peintures de Hieronymus Bosch, dans les salles du Prado à Madrid: c’est sans nul doute un âge particulièrement horrible pour le “civis” traditionnel qui voit s’évanouir dans la Cité toutes les formes sublimes de “dignitas”, que la “viscosité” du festivisme décadent ne permet plus de transmettre. Le “civis” cède la place au “zombi” (Venner in “Le siècle de 1914”, p. 355).
On peut comprendre que cet enlisement hideux ait révulsé Venner: c’en était trop, pour un esprit combattant, au seuil de sa huitième décennie; il n’aurait plus eu, à ses propres yeux, la force surhumaine nécessaire (celle que nous allons tous devoir déployer) pour endiguer dans un combat quotidien, inlassable et exténuant, le flot de flétrissures morales qui va encore nous envahir, au risque de nous noyer définitivement. Il a voulu donner un exemple, le seul qu’il pouvait encore pleinement donner, et nous allons interpréter ce geste comme il se doit. Exactement comme Mishima, à coup sûr l’un de ses modèles, il ne pouvait voir disparaître un monde qui n’a eu d’heures de gloire que tant que la “dignitas” romaine demeurait, même atténuée et marginalisée, comme l’écrivain japonais ne pouvait se résoudre à voir sombrer le Japon traditionnel dans la “culture-distraction” made in Hollywood et ailleurs aux “States”. Une telle société ne convient ni à un “civis”, dressé par la haute morale du stoïcisme et de Sénèque, ni à un “coeur rebelle”, marqué par la lecture d’Ernst Jünger.
Venner, exégète de Jünger
Dans “Ernst Jünger – Un autre destin européen”, Venner nous a légué le livre le plus didactique, le plus clair et le plus sobre, sur l’écrivain allemand, incarnation de l’anarque et ancien combattant des “Stosstruppen”. Cet ouvrage de 2009 s’inscrit dans le cadre d’une véritable renaissance jüngerienne, avec, pour apothéose, le travail extrêmement fouillé de Jan Robert Weber (“Ästhetik der Entschleunigung – Ernst Jüngers Reisetagebücher 1934-1960”) et surtout l’ouvrage chaleureux de Heimo Schwilk (“Ernst Jünger – Ein Jahrhundertleben”), où l’auteur se penche justement sur les linéaments profonds du “nationalisme révolutionnaire” d’Ernst Jünger et de son “anti-bourgeoisisme”, un “anti-bourgeoisisme” qui critique précisément cette humanité qui sort de l’histoire pour s’adonner à des passe-temps stériles comme la spéculation, la distraction sans épaisseur éthique ou civique, le confort matériel, etc., bref ce que Venner appelait, dans “Pour une critique positive”, “la décomposition morbide d’un certain modernisme”, qui “engage l’humanité dans une impasse, dans la pire des régressions”. Les esprits et les forces “kathéchoniques” participent, disait Venner dans “Pour une critique positive”, d’un “humanisme viril”, assurément celui de Brantôme, garant d’un “ordre vivant” (et non pas mortifère comme celui dont Chaunu redoutait l’advenance). Jünger: “Cette engeance [bourgeoise, ndt] n’a pas appris à servir, n’a pas appris à surmonter le porc qu’elle a en son intériorité, à maîtriser son corps et son caractère par une auto-disciple [Zucht] rigoureuse et virile. C’est ainsi qu’advient ce type-mollusque: mou, verbeux, avachi, non fiable, qui fait spontanément horreur au soldat du front” (EJ: in “Der Jungdeutsche”, 27 août 1926). Je ne sais si Venner avait lu cette phrase, issue d’une revue nationale-révolutionnaire du temps de la République de Weimar, que peu de germanistes méticuleux ont retrouvée (pas même Schwilk qui cite une source secondaire); en tout cas, cette “Zucht” permanente, que Jünger appelait de ses voeux, Venner l’a toujours appliquée à lui-même: en cela, il demeurera toujours un modèle impassable.
J’ai travaillé récemment sur Moeller van den Bruck et j’aurais voulu transmettre le texte final (loin d’être achevé) à Venner; je travaille aussi, à la demande d’un jeune Français —certainement un lecteur de Venner— sur maints aspects de l’oeuvre de Jünger (et ce jeune doit me maudire car je ne parviens pas à achever l’entretien en six questions clefs qu’il m’a fait parvenir il y à a peu près vingt mois... mais pourquoi irai-je répéter ce que Venner a dit, mieux que ne pourrai jamais le dire... il faut donc que j’aborde des aspects moins connus, que je fasse connaître les recherches allemandes récentes sur l’auteur du “Travailleur”). Le “coeur rebelle”, soit l’attitude propre à l’humanisme viril qui rejette le type-mollusque et les inauthentiques passe-temps bourgeois, est aussi le titre du livre-manifeste que Dominique Venner a fait paraître aux “Belles-Lettres” en 1994. La rébellion de Venner est naturellement tributaire de celle de Jünger, du moins quand, comme Jünger, Venner a fait un pas en arrière au début des années 70, a pris, lui aussi, la posture de l’anarque: fin des années 20, voyant que l’agitation nationale-révolutionnaire sous la République de Weimar, ne donne pas les résultats immédiats escomptés, Jünger amorce, en son âme, le processus de décélération que Jan Robert Weber vient de nous décortiquer avec toute la minutie voulue. Ce processus de décélération fait de l’ancien combattant des “Stosstruppen” un voyageur dans des pays aux paysages encore intacts, aux modes de vie non encore “modernisés”. Voir l’humanité intacte, voir des humanités non affligés par les tares du “bourgeoisisme”, telle était la joie, forcément éphémère, que le Lieutenant Jünger entendait se donner, après être sorti des univers excitants de la marginalité politique extrémiste. Il poursuivra cette quête de “non modernité” jusqu’à ses voyages des années 60 en Angola et en Islande. Venner, lui, après les échecs du MNP (Mouvement Nationaliste du Progrès) et du REL (Rassemblement Européen pour la Liberté), qui auraient dû incarner rapidement les principes consignés dans “Pour une critique positive” et procurer à la France les “mille cadres révolutionnaires” pour contrôler les “rouages de l’Etat” (but de toute métapolitique réaliste), s’adonne à la passion des armes et de la chasse, pour devenir non pas tant l’anarque jüngerien, replié à Wilflingen et apparemment détaché de toutes les vanités humaines, mais l’historien méditatif qui publie d’abord des livres ensuite des revues distribuées partout, capables de provoquer, chez “mille futurs cadres révolutionnaires” (?), le déclic nécessaire pour qu’ils rejettent à jamais, sans la moindre tentation, les chimères du système “cosmocratique”, et qu’ils oeuvrent à sortir l’Europe de sa “dormition”.
Jünger, Mohler et le “Weltstaat”
Heimo Schwilk rappelle toutefois que Jünger, à partir de 1960, année où meurt sa femme Gretha, se détache d’idéaux politiques comme ceux de “grands empires nationaux” ou d’unité européenne: il estime qu’ils ne peuvent plus servir d’utopie concrète, réalisable au terme d’une lutte agonale, avec des hommes encore imbriqués dans l’histoire. C’est l’année de la rédaction de l’ “Etat universel” (“Der Weltstaat”), prélude à ce que Venner appelera la “cosmocratie”. Jünger est pessimiste mais serein, et même prophète. Je cite Schwilk: “Dans l’Etat universel, les victimes des guerres et des guerres civiles, les nivellements par la technique et la science, trouvent, en toute égalité, leur justification finale. Sur le chemin qui y mène, le citoyen-bourgeois moderne est tout entier livré aux forces matérielles et à l’accélération permanente des processus globaux. Avec la disparition des catégories historiques comme la guerre et la paix, la tradition et le limes, la sphère politique entre dans un stade expérimental, où les lois de l’histoire ne peuvent absolument plus revendiquer une quelconque validité – dans ce monde-système, même l’espèce humaine est remise en question. A la place de la libre volonté (du libre arbitre), craint Jünger, nous aurons, en bout de course, l’instinct brut qui consiste à fabriquer des ordres parfaits, comme on en connaît dans le monde animal” (Schwilk, op. cit., p. 486). Cette position jüngerienne de 1960 suscite l’étonnement à gauche, une certaine irritation à droite: le vieux compagnon de route, Armin Mohler, estime que son maître-à-penser a sombré dans l’“inhéroïque”, qu’il abandonne les positions sublimes qu’il a ciselées dans le “Travailleur”, qu’il a composé, à la façon d’un coiffeur, “une permamente pour son oeuvre ad usum democratorum”, qu’il est sorti du “flot du temps” pour s’accomoder de la “démocratie des occupants”. Pour Jünger, il faut regarder le spectacle avec mépris, attendre sereinement la mort, ne pas se faire d’illusions sur une humanité qui marche, heureuse, vers le destin de fourmi qu’on lui concocte.
Fidèle aux valeurs de droiture de son enfance
Venner, qui n’a pas l’extraversion exubérante de Mohler, n’a jamais cessé d’espérer un “réveil de l’Europe”: son geste du 21 mai 2013, d’ailleurs, le prouve. Venner n’a cessé de croire à une élite qui vaincra un jour, fidèle à son passé, capable de rétablir les valeurs européennes nées lors de la “période axiale “ de son histoire. Dans le “post scriptum” du “Siècle de 1914”, qu’il nous faudra méditer, Venner explique qu’il est sorti des “actions partisanes” de sa jeunesse, comme Jünger, pour demeurer “fidèle aux valeurs de droiture de son enfance”, pour plaider uniquement “pour le courage et la lucidité”, tout en se sentant “profondément européen au sens atavique et spirituel du mot”. Venner ne croyait plus aux actions politiques, dans les formes habituelles que proposent les polities occidentales ou, même, les marginalités hyper-activistes de ces sociétés. Il croyait cependant aux témoignages de héros, de militants, de combattants, qui, révélés, pouvaient éveiller, mobiliser les âmes pour sortir des “expérimentations” qui conduisent à l’avénement catamorphique des “zombis de la cosmocratie” ou des “unités de fourmilière”, envisagées par Jünger en 1960, quand Venner était engagé à fond dans le combat pour l’Algérie française.
Mais pour éviter ce destin peu enviable de “fourmis”, homologuées, homogénéisées dans leur comportement, il faut une “longue mémoire”, celle que Venner nous esquisse en toute clarté dans “Histoire et tradition des Européens”. Ce livre a, à mes yeux, une valeur testamentaire, un peu comme celui, tout aussi important mais différent, de Pino Rauti (à qui Venner rendait hommage dans la dernière livraison de 2012 de “La nouvelle revue d’histoire”), intitulé “Le Idee che mossero il mondo” (= “Les idées qui meuvent le monde”). Rauti nous décrivait les grande idées qui avait mu le monde, avaient mobilisé et enthousiasmé les peuples, les avaient extraits de leurs torpeurs, de leurs dormitions; Venner nous expose les linéaments les plus profonds d’une éthique européenne altière, romaine, pessimiste, stoïque et politique. Il nous dit là quelles sont les traditions à méditer, à intérioriser et à perpétuer. C’est donc un livre à lire et à relire, à approfondir grâce aux références qu’il fournit, aux pistes qu’il suggère: c’est dans les legs que Venner expose qu’il faudra recréer des humanités dans nos écoles, aujourd’hui privées de valeurs fondatrices, mêmes celles, de plus en plus rares, qui enseignent encore le latin. Sans doute à son insu, Venner est aux humanités scolaires futures, qui devront être impérativement transposées dans les curricula des établissements d’enseignement faute de quoi nous basculerons dans l’insignifiance totale, ce que fut jadis Jérôme Carcopino pour les latinistes.
C’est lors d’une présentation de cet ouvrage, peu après sa sortie de presse, que j’ai vu Venner pour la seconde et la dernière fois, en avril 2002. C’était à “La Muette”, dans le 16ème arrondissement de Paris, à l’initiative d’un autre personnage irremplaçable dont nous sommes orphelins: Jean Parvulesco, mort en novembre 2010. “Histoire et tradition des Européens – 30.000 ans d’identité” est un livre qui nous rappelle fort opportunément que nos sources “ont été brouillées”, que nous devons forcément nous efforcer d’aller au-delà de ce brouillage, que le retour à ces sources, à cette tradition, ne peut s’opérer par le biais d’un “traditionisme”, soit par une répétition stérile et a-historique de schémas figés, faisant miroiter un âge d’or définitivement révolu et condamnant l’histoire réelle des peuples comme une succession d’événements chaotiques dépourvus de sens. Pour Venner, les racines immémoriales de l’Europe se situent dans la proto-histoire, dans “l’histoire avant l’histoire”, dans une vaste époque aujourd’hui étudiée dans tous les pays du “monde boréal” mais dont les implications sont boudées en France, où quelques “vigilants”, appartenant au club des “discoureurs sur les droits de l’homme” ou des “Pangloss de la rhétorique nombrilique” (dixit Cornelius Castoriadis), barrent la route aux savoirs historiques nouveaux, sous prétexte qu’ils ressusciteraient une certaine horreur. Les racines de l’Europe sont grecques-homériques, romaines, arthuriennes. Elles englobent l’amour courtois, où la polarité du masculin et du féminin sont bien mises en exergue, où Mars et Vénus s’enlacent. Nous verrons comment la revalorisation du féminin dans notre imaginaire et dans nos traditions est un élément cardinal de la vision d’Europe de Venner.
“Le siècle de 1914”
“Le siècle de 1914” commence par déplorer la disparition d’un “monde d’avant”, où les linéaments exposés dans “Histoire et tradition des Européens” étaient encore vivants, notamment dans l’espace de la monarchie austro-hongroise. S’ensuit une critique serrée, mais non incantatoire comme celle des “vigilants”, du bolchevisme, du fascisme italien et du national-socialisme hitlérien: une critique bien plus incisive que les proclamations, déclamations, incantations, vitupérations des anti-fascistes auto-proclamées qui hurlent leurs schémas et leurs bricolages à qui mieux mieux et sans interruption depuis septante ans, depuis que le loup a été tué. Cette critique lucide, sobre, équilibrée et dépourvue d’hystérie est récurrente —il faut le rappeler— depuis “Pour une critique positive”; elle est suivie d’une apologie retenue mais irréfutable de la figure de l’idéaliste espagnol José Antonio Primo de Rivera, dont les idées généreuses et pures se seraient, dit Venner, fracassées contre “le granit du pragmatisme”. La mort tragique et précoce de ce jeune avocat l’a préservé de “toute souillure”: il reste un modèle pour ceux qui veulent et qui voudront nettoyer la Cité de ses corruptions.
Un différentialisme dérivé de Claude Lévi-Strauss
Le portrait de “l’Europe en dormition”, proposée par Venner dans le dixième et dernier chapitre du “Siècle de 1914” est un appel à l’action: il énumère, avec la clarté des moralistes français du “Grand Siècle”, tant admirés par Nietzsche, les travers de l’Europe sous la tutelle des Etats-Unis, du libéralisme déchaîné (surtout depuis la disparition du Rideau de Fer), des oligarchies liées à la “Super-classe”. Venner se réfère à Heidegger, pour la critique du technocratisme propre aux matérialismes communiste et libéral, et justifie son “différentialisme”, son “ethno-différentialisme”, en se référant à la seule source valable pour étayer une telle option politico-philosophique: l’oeuvre de Claude Lévi-Strauss. Nous mesurons, en lisant ces lignes de Venner, toute la perfidie et la mauvaise foi des critiques ineptes, prononcées par les “Vigilants” à l’encontre de cet aspect particulier du discours des “nouvelles droites”, qui n’a jamais puisé dans le corpus hitlérien —que Venner soumet, pour son racisme et son antisémitisme, à une critique dépourvue de toute ambigüité— mais chez ce philosophe et ethnologue d’origine israélite, qui mettait très bien en exergue les limites de la pensée progressiste. Venner rappelait aussi la trajectoire très personnelle de Victor Segalen (1878-1919), explorateur des “exotismes” qui avait écrit: “Ne nous flattons pas d’assimiler les moeurs, les races, les nations, les autres; mais au contraire réjouissons-nous de ne le pouvoir jamais” (cité par Venner, p. 389). Apparemmant, la triste “intellectuelle” du misérable club des “Vigilants”, qui a agité, sur internet, dans un essai aux allures soi-disant “savantes” mais à la “sagacité” plus que bancale, le spectre d’un Venner “rénovateur du racisme” dans les jours qui ont immédiatement suivi son suicide n’a jamais lu ce deuxième ouvrage testamentaire de Venner, “Le siècle de 1914”. Venner, et nous tous, avons des adversaires qui ne nous lisent pas, qui affirment péremptoirement leurs lubies, avec la complicité d’un pouvoir aux abois et de ses nouvelles militantes stipendiées, les “femens”.
La quintessence d’“Histoire et tradition des Européens” et du “Siècle de 1914” paraissait et transparaissait dans les éditoriaux des revues historiques de Venner, que traduisait, avec diligence, dévouement et respect, l’ami américain Greg Johnson, permettant au monde entier de lire le futur suicidé de Notre-Dame dans la “koiné” globale, dont il maîtrise avec une belle élégance toutes les nuances, très éloignées du sabir “basic” qui sert de lingua franca à tous les technocrates de la planète. Venner a trouvé le traducteur qu’il mérite et l’éditeur qui, j’espère, compilera bientôt les meilleures traductions de ses éditoriaux en un volume.
21 mai 2013
Reste à tenter d’expliquer le geste de Dominique Venner en cet après-midi du 21 mai 2013. A mon retour du boulot, où une “Vigilante” particulièrement bête venait de monter une cabale contre moi, et après un bref détour à la librairie italienne du Quartier Schuman (où je devais me trouver quand Venner a appuyé sur la détente de son pistolet de Herstal, lieu d’origine des Pippinides), j’apprends en ouvrant mon ordinateur le suicide de Dominique Venner devant le maître-autel de Notre-Dame de Paris. Je ne vais pas cacher, ici, que j’étais d’abord très perplexe. Mais non étonné. Je connaissais les lignes de Venner sur les stoïques, qui quittent la vie sans regret quand ils ne peuvent plus oeuvrer dans la “dignitas” qu’ils se sont imposée, quand ils ne peuvent plus servir l’Empire comme ils le voudraient. Je savais aussi Venner guetté par la maladie: un de ses éditoriaux récents l’évoquait. Certaines photos trahissaient la présence sournoise d’une pathologie tenace. Ma perplexité était suscitée par le lieu: pourquoi Notre-Dame, pourquoi le choeur de la Cathédrale de Paris? Pourquoi pas Chartres, Château-Gaillard, Montségur? Dans sa dernière lettre, Venner écrivait: “C’est un endroit que j’admire et que je respecte”. Ces mots voilaient évidemment un sens précis. Notre-Dame est construite sur le site d’un temple romain de Lutèce, temple probablement bâti sur un sanctuaire gaulois antérieur. C’est donc là, dans la sacralité celtique la plus ancienne du lieu où Venner a vu le jour en 1935, que devait résider l’énigme. J’ai réfléchi et me suis rappelé d’un ouvrage de la série des “Voyages d’Alix” de Jacques Martin et de son collaborateur Vincent Henin, consacré à la Lutèce romaine. Aux pages 52 et 53 de cet ouvrage destiné principalement aux amoureux de la culture classique et aux latinistes —Martin a pris le relais, en quelque sorte, de Jérôme Carcopino en pubiant cette admirable série chez Casterman— nous trouvons quatre illustrations du “Pilier des Nautes”, une pour chacun de ses côtés. Martin et Henin rappellent que ce “Pilier des Nautes” a été découvert en 1711, exactement sous le choeur de Notre-Dame. Probablement surmonté d’une statue de Jupiter impérial, cette colonne montrait sur sa face antérieure le dieu celtique Cernunnos, Iovis (= Jupiter) et un couple divin, Mars et Minerve (ou la déesse celtique Boudana). Sur les autres faces, on trouve des représentations de Smertios, Esus, Tarvos Trigaranus (le taureau flanqué de trois grues), Castor, Pollux et Vulcain, de même qu’un autre couple divin, Mercure et Rosmerta, puis, à la base, des divinités féminines: Junon, Fortuna, Vénus et une figure mythologique non identifiée. C’est évidemment la présence, au-dessus de Iovis, de Cernunnos qui m’interpelle.
Cernunnos, dieu à ramure de cervidé
Dans leur magnifique lexique de mythologie celtique, Sylvia et Paul F. Botheroyd mettent fort bien en évidence l’importance de Cernunnos, le dieu à la ramure de cervidé. On sait que Venner vouait un culte discret au Cerf et ornait la page d’accueil de son blog d’une belle image-silhouette de grand cerf. On sait aussi le grand intérêt que portait Venner à la vénerie. Cernunnos est un dieu campé comme celtique mais, disent Sylvia et Paul F. Botheroyd, on en trouve des représentations de l’Irlande à la Roumanie, toujours affublé d’une ramure et d’une torque et accompagné de serpents. Il est donc un dieu ancien de la très vieille Europe proto-historique. On l’appelle aussi le “dieu cornu” mais si “ker” est un terme indo-européen pour désigner les cornes animales, il désigne aussi les forces vitales, celles de la croissance. Il agit d’un lieu souterrain, d’un autre monde enfoui dans la Terre-Mère: il y accueille les morts et, chaque fois qu’un défunt se présente, Cernunnos libère de l’énergie vitale avec l’aide de la Déesse-Mère et lui donne une nouvelle forme. Il est aussi le dieu qui fait monter la sève dans les plantes, qui incite la volonté de reproduction des êtres. Il est donc un dieu de la Vie au sens le plus large. Une gravure rupestre du Val Camonica en Italie alpine représente le “Cornu” avec un sexe en forme de long serpent qui unit ce dieu dispensateur de Vie à la Déesse-Mère: il unit donc principe masculin et principe féminin, comme le bas du “Pilier des Nautes” représente, lui aussi, des couples divins. Le Cernunnos de Val Camonica, et tous les dieux cornus de la très vieille Europe, symbolise l’éternelle victoire de la Vie sur la mort. Il est, écrit Yann Brekilien dans “La mythologie celtique” (Jean Picollec, 1981), “l’époux de la Déesse-Mère, le principe masculin fécondant, le Verbe créateur” (p. 97). Mais, toujours pour Brekilien, “la matière trahit la force spirituelle qui l’a fécondée et se soumet à la destruction, jusqu’à ce que recommence le cycle” (ibid.). En tant que force spirituelle, Cernunnos est un “dieu de nature ignée” (cf. Myriam Philibert, “De Karnunos au roi Arthur”, Ed. du Rocher, 2007). Alliance donc du feu sacré, de l’esprit, du monde souterrain où se recrée la Vie, épousailles permanentes avec la Terre Mère: telle est la sacralité profonde du sol sous le choeur de Notre-Dame de Paris, où se dressait, dès le règne de l’Empereur Tibère, le “Pilier des Nautes”. Pour Venner, c’était là, et là seul pour un natif de Paris, qu’il fallait aller offrir sa vie, son enveloppe charnelle, pour que le principe vital de Cernunnos la transforme en nouvelle énergie, plus puissante encore.
Montée de l’insignifiance
Au moment où la France du Président Hollande enfreint les règles traditionnelles du mariage, édictées par l’Empereur Auguste sur base des vieilles traditions romaines, les bases du “Pilier des Nautes”, avec ses couples divins hétérosexuels, étaient ébranlées. La Cité frappée à la base même de ses facultés reproductrices, engendrant potentillement un “collapsus démographique” (Chaunu) plus accéléré et plus nocif que jamais... Sur fond d’une trivialité sociale en apparence sans remède: ce n’est pas seulement une idée ancrée dans la “droite” où l’on fourre un peu vite Dominique Venner, quand on l’évoque dans les salons des terribles simplificateurs. Constatons le même refus et le même dégoût chez des auteurs contemporains de la publication de “Coeur rebelle” (1994). Cornelius Castoriadis a fustigé la “montée de l’insignifiance”: “il ne peut pas y avoir d’‘autonomie’ individuelle s’il n’y a pas d’autonomie collective, ni de ‘création de sens’ pour sa vie par chaque individu qui ne s’inscrive dans le cadre d’une création collective de significations. Et c’est l’infinie platitude de ces significations dans l’Occident contemporain qui conditionne son incapacité d’exercer une influence” (“La montée de l’insignifiance”, Seuil-Points, n°565, 1996). Langage qui revendique le retour des identités collectives, tout simplement sans citer le terme “identité”. Gilles Châtelet est encore plus virulent dans les critiques qu’il consigne dans “Vivre et penser comme des porcs” (Folio-Actuel, n°73, 1998). Jacques Ellul fustige la transformation du politique en illusion, où “le peuple ne contrôle plus rien que des hommes politiques sans pouvoir réel” (”L’illusion politique”, La Table Ronde, 2004, 3ème éd.).
Au-delà des étiquettes de droite ou de gauche, Venner —comme d’autres, innombrables, mais non élèves respectueux de Sénèque et des stoïques— constate l’enlisement général de nos sociétés, affligées de cette viscosité qui empêche toute transmission (Chaunu). Il n’est plus possible de vivre selon les règles et les rites de la “dignitas” romaine. Mais Venner, déçu jusqu’aux tréfonds de son âme, n’est pas un fataliste: il offre à Cernunnos sa vie pour qu’il insuffle une charge vitale plus forte encore que la sienne dans ce magma poisseux, en espérant qu’un cycle nouveau s’enclenche. Ce cycle, ce sont ses lecteurs, ses élèves qui devront l’animer avec la même constance et la même fidélité que lui.
La disparition de Venner est une disparition de plus pour nous. La génération fondatrice disparaît: celle du “grand refus” dans l’Europe qui a chaviré dans l’indolence et le consumérisme. Son heure est venue. Venner, homme libre, n’a fait que devancer la Grande Faucheuse, qui a emporté Mohler, Tommissen, Dun, Rauti, Mabire, Schrenck-Notzing, Kaltenbrunner, Parvulesco, Thiriart, Locchi, Romualdi, Fernandez de la Mora, Willms, Eemans, Bowden (à 49 ans seulement!), Valla, Debay, Varenne, Freund, et bien d’autres... La première tâche est de faire lire les livres dont j’ai tenté, vaille que vaille, d’esquisser l’essentiel dans cet hommage à Venner. Ensuite, il me paraît impératif de sauver à tout prix “La Nouvelle revue d’histoire”. En mars 2006, nous avions perdu un guide précieux, un excellent professeur de lettres, en la personne de Jean Mabire: nul, à mon immense regret, n’a pu reprendre le travail hebdomadaire du lansquenet normand, celui de fabriquer une fiche synthétique sur un écrivain oublié et important. Qui reprendra “La Nouvelle revue d’histoire”? Philippe Conrad, le plus apte à en perpétuer l’esprit? Quel que soit l’officier qui prendra le poste de Venner, à la proue du meilleur navire de la mouvance, je lui souhaite le meilleur vent, longue course.
J’écoutais, à côté d’Yvan Blot, la fille de Jean van der Taelen prononcer quelques paroles lors des obsèques de son père à l’Abbaye de la Cambre à Ixelles: elle nous demandait de lui parler comme s’il était dans la pièce d’à côté, séparé seulement par une maigre cloison, de lui poser les questions qu’on lui aurait posées de son vivant. Pour Venner, je dirai ceci, dans le même esprit, et je souhaite que tous les amis fassent de même; quand j’écrirai une phrase sur un thème cher à Venner, sur une position que je prendrai, sur une innovation sur l’échiquier international, je lui poserai la question: “Qu’en pensez-vous?”. De même qu’en penseraient Locchi, Mohler, Schrenck-Notzing, Mabire, etc.? Meilleure façon d’assurer l’immortalité de nos défunts.
Robert Steuckers.
19:07 Publié dans Actualité, Hommages, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : dominique venner, nouvelle droite, mort volontaire, paris, actualité, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
John Morgan: Theory of multipolar world
Theory of multipolar world
An interview with John Morgan
Natella Speranskaya: The collapse of the Soviet Union meant the cancellation of the Yalta system of international relations and the triumph of the single hegemon - the United States, and as a consequence, transformation of the bipolar world order to the unipolar model. Nevertheless, some analysts are still talking about a possible return to the bipolar model. How do you feel about this hypothesis? Is there a likelihood of emergence of a power capable of challenging the global hegemon?
John Morgan: I’m not certain about a return to the bipolar model anytime soon. While we have seen the rise of new powers capable of challenging American hegemony in recent years – China, India, Iran, and of course the return of Russia to the world stage – none of them are capable of matching the pervasive influence of the American economy and its culture, nor of projecting military power around the world as NATO has been doing. At the same time, we can plainly see now that America and its allies in Western Europe have already passed their economic limits, now racking up unprecedented debt, and their power is beginning to wane. This process is irreversible, since the post-1945 American lifestyle is unsustainable on every level. America may be able to coast for a few more years, or at most decades, but the “American century” that began at the end of the Second World War will probably be over by mid-century at the latest. Rather than the return of a bipolar world, I think we will see the emergence of the multipolar one, as Prof. Dugin has suggested, in which several nations wield significant power but none reigns supreme above all. In order to protect their interests, stronger nations will need to forge alliances with weaker ones, and sometimes even with other strong nations. But I think the era of the superpower is rapidly coming to an end.
NS: Zbigniew Brzezinski openly admits that the U.S. is gradually losing its influence. Here it is possible to apply the concept of "imperial overstretch", introduced by renowned historian Paul Kennedy. Perhaps, America has faced that, what was previously experienced by the Soviet Union. How do you assess the current state of the U.S.?
JM: As an American, I have witnessed this firsthand. I don’t think the American era is over just yet; it still possesses awesome military might, and will most likely retain this advantage for a little while longer. But the persuasive powers of a country whose defense spending comprises nearly half of all global military expenditures each year are obviously on the wane. My understanding of the collapse of the Soviet Union is that it occurred more because of domestic economic problems rather than as a direct result of its military failure in Afghanistan in the 1980s, even if that exacerbated the problem. Similarly, while the many wars the U.S. has engaged in over the past decade have unquestionably weakened it, it is the ongoing financial crisis, brought about by America’s reliance on debtor spending, that is the most important factor in the decline of American power. And actually, America’s military adventures have brought little in terms of benefits. The Iraq War has really only served to strengthen Iran and Syria’s position. Afghanistan remains a sinkhole in which America stands little to gain, apart from ongoing humiliation as the failure of its policies there is as plain as day. Nations like Iran and North Korea have been emboldened, since they know that America isn’t interested in challenging them militarily, at least for the time being. This has no doubt been a large factor in the increasing use of drones by the U.S., as well as its return to waging proxy wars against enemy regimes through concocted “rebel” movements, as it did during the Cold War against the Soviets, and as we have seen in Libya and now in Syria. Regardless, the primary factor in American decline is definitely its economic predicament. But if it returns to its earlier policies of attempting to spread democracy and the free market through war, this will only hasten its end. Obama seems to be aware of this and has sought to keep America from engaging directly in wars at all costs, but we don’t know who his successor will be.
NS: The loss of global influence of the U.S. means no more, no less, as the end of the unipolar world. But here the question arises as - to which model will happen the transition in the nearest future? On the one hand, we have all the prerequisites for the emergence of the multipolar world, on the other – we face the risk of encountering non-polarity, which would mean a real chaos.
JM: This is an interesting question, but I think it is difficult to answer definitively at the present time. The United States as a whole has still not acknowledged the fact of its own inevitable decline, and for the time being I expect it to continue to attempt to maintain the unipolar world for as long as it possibly can. Once the fact of the death of the hegemonic system can no longer be denied, I can see several possible directions. The U.S. may adopt some sort of primitive, imperialistic nationalism and attempt to restore its position through military means. Or, it may become too overwhelmed with its own domestic problems, as they increase, and perhaps disengage from the world stage, opening up possibilities for new geopolitical orders that have been restricted by American power for nearly a century. But since we do not yet know how severe the coming economic and political collapse will be, or what its impact will be globally, we cannot know whether it will lead to multipolarity or non-polarity. We can only attempt to set the stage for the former and hope that circumstances permit it.
NS: The project of "counter-hegemony," developed by Cox, aims to expose the existing order in international relations and raise the rebellion against it. For this, Cox calls for the creation of counter-hegemonic bloc, which will include those political actors who reject the existing hegemony. The basis of the unipolar model imposed by the United States, is a liberal ideology. From this we can conclude that the basis of the multipolar model just the same has to be based on some ideology. Which ideology, in your opinion, can take replace the counter-hegemonic one, capable of uniting a number of political actors who do not agree with the hegemony of the West?
JM: I agree with Prof. Dugin that the three ideologies which dominated the twentieth century have already exhausted themselves as paradigms for the nomos of the Earth. What I imagine and hope to see will be the emergence of blocs which may be similar to the Holy Roman Empire and other ancient empires, in which there will be loose confederations of nations and communities where there is indeed an overarching central political authority (perhaps a monarchy, as Evola prescribed) that will defend the sovereignty of its subjects, but in which most of the political power will rest with local, communal authorities. They may not have a specific ideology in themselves. However, there may be variations in how this is realized within the various communities which comprise them. Some peoples may choose to return to some variant of socialism or nationalism, or perhaps even some sort of pre-modern form of social organization. And these communities should be free to choose the particular form of their social organization, in accordance with their unique traditions. Liberalism, however, which depends for its survival on the consumption of all attainable resources, will completely die, I believe, since before long everyone will understand that it only leads to short-term gains followed by total destruction on every level.
NS: If we project the multipolar model on the economic world map, then we’ll get the coexistence of multiple poles, and at the same time, will create a complete matrix for the emergence of a new economy - outside of Western capitalist discourse. In your opinion, is the concept of “autarky of big spaces”, suggested by List, applicable for this?
JM: I have not studied Friedrich List in any detail, so I’m not familiar with this concept, although of course I am in favor of the development of a new economic order to supplant the current, capitalist model. I do know that List opposed the justification of individual greed favored by the English liberal economists, in contrast to an economic model that considers the needs of the community/nation as a whole, as well as the impact one’s actions have on future generations. Given that the destructiveness of the current economic order is the result of its shameful neglect of these two factors, List’s conception is much better.
NS: We are now on the verge of paradigmatic transition from the unipolar world order model to the multi-polar one, where the actors are no more nation-states, but entire civilizations. Recently in Russia was published a book "Theory of multipolar world," written by the Doctor of Political and Social Sciences, Professor Alexander Dugin. This book lays the theoretical foundation, basis, from which a new historical stage can start, and describes a number of changes both in the foreign policy of nation-states and in today's global economy, which involve a transition to the multipolar model. Of course, this also means the emergence of a new diplomatic language. Do you believe that multipolarity is the natural state of the world and that transition to the multipolar model is inevitable?
JM: Yes, and my company, Arktos, will soon be making an English edition of this vital text available. I absolutely agree that multipolarity is both necessary and desirable. If we survey human history, this was always how the world was ordered in ages which we, as traditionalists, consider to have been far superior to the way the world is today. It is only from the unique, and degenerative, conditions of modernity that unipolarity has emerged in recent centuries, first in the efforts of the European colonial powers to dominate the planet, and culminating, of course, in American hegemony, which is the direct heir to the European colonial project. As we can see with our own eyes, hegemony hasn’t been good for anyone, neither for those peoples who have enjoyed its ephemeral material benefits nor for those who have been dominated by it. The unipolar idea is what brought the “Third World” into existence and perpetuates it (since, today, it has even conquered these peoples culturally and psychologically). Simultaneously, it has deprived those nations which pursued it, both in America and Europe, of security, stability, sustainability, and most importantly, of any form of genuine culture or identity, replacing it with plastic consumer culture and identities. Ultimately, unipolarity has victimized everything in human civilization that is good while offering nothing apart from the purely material benefits temporarily reaped by those in charge of it in return, and even that will soon cease. We can only hope that multipolarity will re-emerge, since it is obvious to anyone who looks at the world with an open mind that unipolarity is rapidly coming to an end.
00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Géopolitique, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john morgan, politique internationale, nouvelle droite, multipolarité, monde multipolaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Parsifal & the Possibility of Transcendence

Wagner Bicentennial Symposium
Parsifal & the Possibility of Transcendence
By Christopher Pankhurst
Ex: http://www.counter-currents.com/
In 1878 Nietzsche sent a copy of his book Human, All Too Human to Richard Wagner. At the same time Wagner sent Nietzsche a copy of the verse for his opera Parsifal. Nietzsche was later to write that when received this text, “I felt as if I heard an ominous sound – as if two swords had crossed.”[1] Nietzsche had immediately realized that the two men had drifted irreparably apart. In Human, All Too Human, Nietzsche had made a decisive move against the Western metaphysical tradition and he saw the text of Parsifal as being deeply embedded within that tradition.
By the time of Tristan und Isolde and Parsifal Wagner had become immersed in the philosophy of Schopenhauer and he was able to infuse those works with a thoroughly Schopenhauerian atmosphere. In particular, Parsifal was the culmination of Wagner’s life’s work, and with its theme of redemption through compassion it fully articulated his mature Schopenhauerian beliefs. Largely because of Wagner’s lucid expression of this theme, the opera was to become a persistent bête noir of Nietzsche. Although he had previously enjoyed a deep and rewarding friendship with Wagner, Nietzsche came to view Parsifal as the epitome of everything that was wrong with culture, and he continued to gnaw away irritably at it, like a dog with an old bone, for the rest of his sane life.
At the heart of Nietzsche’s criticism of Parsifal is his rejection of the possibility of redemption from this world, and of transcendence to a higher realm. With Schopenhauer, the idea of transcendence had reached its most highly developed articulation within the Western philosophical tradition; after Nietzsche’s attack on Parsifal it became impossible to uncritically accept the possibility of transcendence at all.
With the influence of Schopenhauer, the lucid artistry of Wagner, and the devastating critique by Nietzsche, Parsifal can be seen as a nexus for some of the most important tributaries of 19th century philosophical thought.
Schopenhauer’s philosophy begins with the observation that everything that exists can only be known to us through our senses, through perception. Therefore we have no direct access to an objective, independently existing world. For us the world exists only as representation. This applies not only to objects but also to all of the natural laws that connect objects with each other, such as magnetism and gravitation. Space and time are also not independently existing qualities but are dependent on the perceptual faculties of an observing subject, and so are expressions of the world as representation. The ways in which things interact in space and time are determinable by laws, but these laws themselves all belong to that same plane of phenomenal existence. In other words, even causality belongs to the world of representation. Schopenhauer was a great admirer of many of the mystical works of ancient India such as the Vedas and the Upanishads, and he saw an affinity between them and his own philosophical work. The ancient teaching that this world is Maya, or illusion, is often cited by Schopenhauer as being parallel with his own observation that the world is representation.
So, in the world of representation, objects and forces interact with each other in causally determined ways. The individual observer is himself a part of this interplay, so he is also part of the world of representation; he is one object of representation amongst many, many others. If there was nothing else to this explanation then the individual would find himself to be a mere observer of a world of interacting objects and his actions would simply occur according to deterministic laws. But this is not at all how reality appears to us. We feel that we are agents in the world, that we have a self-determined power of volition. So, whilst we recognize ourselves as existing in the world of representation as an object, we also feel that there is something more to it than this. It seems that the world of representation is insufficient to explain the totality of the world that we experience, that there must be some additional, hidden quality to the world anterior to the world of representation. Otherwise the world would consist merely of “empty phantoms.”[2] For Schopenhauer, this additional something is will.
An individual experiences his own sense of will as the volitional manifestation of particular actions of his body. These do not simply appear to him as occurring due to some causal situation, instead they feel deliberately willed. When he stands up and walks to the window he feels that he is acting in the world, not merely observing it. This sense of volition is precisely the action of the will. As soon as the action is performed it is perceived through the senses and becomes a part of the world of representation. But the initial volition does not arise from the world of representation but from the world of will. So, the individual exists both as will and representation.
From this, Schopenhauer extrapolates that everything that exists in the world as representation also has another, and unconditional, aspect as will. In fact, Schopenhauer’s assertion that everything that exists as representation also consists of will is not merely drawn analogically from the experience of a particular individual but is shown to be a necessary state of existence. This is so because representation alone cannot explain the existence of anything. It is possible to describe the actions of all sorts of phenomena and to explain how they interact with each other but we are left with a puzzle regarding the inner nature of these phenomena. However we choose to measure or describe objects or forces, we are measuring and describing only that part of them that manifests itself as phenomena, that is, the aspect of the object manifested as representation. This form can express extension in space or duration in time but its inner quality, its essence, is hidden from us. This hidden essence is “an insoluble residuum”[3] and cannot be discerned by investigating the form of phenomena but only by recognizing the presence of will as the hidden essence within all forms.
Once we are able to understand that it is will that manifests itself in representation, that it is the hidden essence behind all perceptible forms, then we can see that it is, “the force that shoots and vegetates in the plant, indeed the force by which the crystal is formed, the force that turns the magnet to the North Pole, the force whose shock he encounters from the contact of metals of different kinds, the force that appears in the elective affinities of matter as repulsion and attraction, separation and union, and finally even gravitation, which acts so powerfully in all matter, pulling the stone to the earth and the earth to the sun; all these he will recognize as different only in the phenomenon, but the same according to their inner nature.”[4]
Thus, behind all the apparent plurality of phenomena there is a higher unity which is the will. The world of representation is secondary to this because it is dependent for its existence on a knowing subject and so is conditional. The world of will is unconditional; it exists prior to every manifestation. Thus, the world of will, which expresses a unity between all things which appear distinct, is fundamentally real in a way that the world of representation is not. The world of representation, of all perceptible phenomena, is shrouded in the illusory veil of Maya. When we lift the veil we are left with will.
So human beings, like all other things in the universe, have a “twofold existence,”[5] consisting of both will and representation. In impersonal forces such as gravitation and magnetism the will is not especially developed; it acts blindly and in completely uniform ways. In living things such as plants it has a higher degree of organizational development and expresses itself through life-cycles, growing to seed before dying off. In animals it is more highly developed still, so that each individual creature fights for its own food, territory and mates, and so on. In humans the will has developed to its highest form and has the greatest degree of self-awareness, to the extent that, uniquely, it is able to deny itself. In humans, then, we see the greatest degree of self-awareness. But the will manifested in a world of representation finds itself refracted into untold billions of distinct, causal phenomena. In the midst of this illusory fragmentation the will seeks satiety and fulfilment. But this relentless desire, according to Schopenhauer, can never reach an end.
Because humans live in the world of representation we are only aware of the illusory existence of diverse, discrete individuals. Each of us thinks that he exists as a single and separate entity forever cut off from the inner processes of other individuals. For Schopenhauer, this is pure delusion. The reality is that we are all expressions in causal reality of a deeper and more fundamental unity. The will itself is singular and indivisible and it establishes itself in a bewildering multiplicity of varied forms. So, the perception of a world of distinct and separated objects and forces is illusory and, to this extent, is an error. The hidden truth is that of a single, unified will outside of space and time.
But this reality is hidden from us because it does not exist in the perceptual world. So the illusion of a world of many distinct individual objects and forces compels us to constantly strive to achieve union with those things that are separate from us, and which we experience as a lack. The desire for sexual intercourse, hunger for food, and the striving for wealth are all driven by our feeling that we lack those things and we believe that we will achieve happiness and satiety if we obtain them. But as soon as we do achieve one of our desires it begins to lose the appeal that drew us to it in the first place, and we begin to desire other things. This is an endless and inescapable process. It means that the world consists of endless suffering because we are always aware of a lack of something or other, and any fulfilment of desire is always short-lived and leads to the arising of new desires. Longing is eternal, satisfaction brief and illusory.
So, we find ourselves living in a world of illusion and suffering and with an unquenchable thirst for an unknown and hidden world of true unity. One of the primary intimations of this world of unity, according to Schopenhauer, comes from our facility for compassion. Egotism and selfishness derive from the desire to benefit oneself at the expense of others. But the self that benefits from this is, as we have seen, an illusory construct that veils the deeper truth. Compassion and pity begin to erase the boundaries between the illusory phenomena of individuals, and to reveal the hidden unity that actually lies behind appearance. So selfishness reinforces the illusion of discrete phenomena, whereas compassion unveils the truth that everything is the manifestation of an undifferentiated will.
Another way in which we may apprehend this noumenal reality is through art. Art is a means whereby the will is able to objectify itself and this is achieved with reference to Platonic Ideas. Schopenhauer sees these Ideas, which are eternal and unchanging forms outside the incessant becoming and passing away of nature, as “definite grades of the objectification of that will, which forms the in-itself of the world.”[6] In other words, art is able to step outside the individuated world of representation and partake of the undifferentiated world of eternal Ideas. Because art takes us to this noumenal place, we are able to feel a sense of completeness, or rather the absence of willing, whilst we contemplate the art object. With this quieting of the will, suffering recedes, and we are able to apprehend the unity of things.
Schopenhauer singles out music as a special art form quite unlike all the others. Whereas other art forms are concerned with representing the essential and universal elements of things, music is not representational in the same way. Instead, Schopenhauer sees music as being a direct manifestation of will: “Therefore music is by no means like the other arts, namely a copy of the Ideas, but a copy of the will itself, the objectivity of which are the Ideas. For this reason the effect of music is so very much more powerful and penetrating than is that of the other arts, for these others speak only of the shadow, but music of the essence.”[7]
When Wagner discovered Schopenhauer, the effect was utterly revelatory. He had spent years carefully devising a theoretical scheme for opera wherein the text was paramount and the music needed to be subordinated to it. Now he found in Schopenhauer a philosophical explanation of music’s superiority to other art forms, and of its deeper resonance, its natural tendency to articulate the essence of things. Wagner’s conversion first manifested itself in the scores for Die Walküre, Siegfried and Götterdämerung, although the libretti for those works had already been written. Of the three operas fully composed after his conversion to Schopenhauer’s philosophy Parsifal was the one he considered to be “the crowning achievement.”[8]
Wagner’s Parsifal tells the story of the Grail Knights and their King, Amfortas. They are responsible for guarding the Holy Grail and the spear which was used to pierce the side of Christ during His crucifixion. But Amfortas is wounded; he was stabbed with the same spear by the evil magician Klingsor, who then stole it. Amfortas’ wound will now not heal. Klingsor has also disempowered the Knights by seducing them with his flower maidens. Until the Knights can win back the spear, the holy rites seem empty and the land has become wasted. A prophecy has been given by the Grail that the spear will only be won back by one, “made wise through pity, the pure fool.”
Parsifal himself is introduced to the drama when he kills a swan. He does not know why he killed the swan, and it transpires that he is ignorant of his parentage and he does not even know his own name. Evidently, he is the prophesied fool. But Parsifal cannot understand the Grail Knights’ rites, and so he is dismissed as a mere fool, not the prophesied redeemer. He soon finds his way to Klingsor’s castle where Kundry, who is simultaneously a servant of the Knights and one of Klingsor’s maidens, attempts to seduce him. This is the cause of an epiphany for Parsifal. With the arrival of sexual arousal, Parsifal is no longer the innocent fool he was, but he is immediately able to overcome this desire and exercise a will-less compassion. He then becomes the pure fool who will fulfil the prophecy. He wins the spear from Klingsor, which he will use to heal Amfortas’ wound. Klingsor and his castle disappear: they were mere phenomena, and Parsifal has revealed their illusory character.
It transpires that Kundry was present at Christ’s crucifixion and that she mocked Him. She has been trapped in an eternal life of repentance ever since. Now Parsifal, through his compassion, has redeemed her. At the close of the opera, on Good Friday, the sacred rites are once more performed but this time with appropriate numinosity. Parsifal is acknowledged as the Redeemer.
The influence of Schopenhauer throughout Parsifal is absolutely clear. The world of Parsifal is one of ubiquitous and lingering suffering. The Grail Knights are condemned to meaningless ritual because of their failure to remain chaste. By succumbing to sexual desire they are chained to the illusory pleasures of the world, and these pleasures, as Schopenhauer has it, are transient, illusory and outweighed by the greater reality of suffering.
Kundry, through her mockery of Christ, is locked in an eternity of suffering. The significant point to Kundry’s suffering is not that she is being punished for mocking God, but that she suffers due to a lack of compassion. By laughing at the suffering of Christ she failed to recognize that the suffering of one is, in essence, the suffering of all.
The eponymous hero is able to redeem the Grail Knights through compassion, by realizing the hidden reality behind the illusory phenomena conjured by Klingsor. When Parsifal causes Klingsor’s realm to disappear he is banishing the world of mere appearance, with all its beguiling desires and pleasures. The final redemption comes from the realization that compassion reveals the hidden unity behind all phenomena. This redemption is not effected through the divinity of Christ; the Good Friday scene is the fulfilment of this redemption, and the Redeemer is Parsifal. Redemption comes from the acceptance of the singular essence of the will and the unity of all things, not from a supernatural intervention.
There is also an interesting structural resonance with Schopenhauer’s thought. Amfortas’ wound is an analogue of the suffering of Christ: his wound was caused by the same spear that pierced the side of Christ. But when Parsifal enters the drama he shoots a swan with an arrow. The swan is a symbol of the sacred so this image again recapitulates the piercing of Christ. In this way, a threefold analogue of suffering becomes a depiction of the Schoperhauerian idea that the will is a unified whole which merely appears to become separate and distinct in various manifestations. The trinity of pain enfolded into the drama exemplifies the notion that the suffering of Christ is important because it is the suffering of all, even of animals. The importance of Christ for Wagner, as for Schopenhauer, comes from the fact that his story of suffering and redemption through surrendering the will is a universal truth and is a metaphysical reality inherent in all living things.
So, Parsifal is not a Christian work of art, despite what many seem to think. It is a work of art which elaborates a sophisticated piece of secular philosophy. The importance of Parsifal, and perhaps the source of misunderstanding, comes from the fact that it is a secular, atheist work which nonetheless presents the reality of transcendence as a proximate and intimate possession of all living things. The Grail hall is a place where, “Time is one with Space.” When Parsifal approaches this hall with one of the Grail Knights, Gurnemanz, the stage directions indicate that the scene begins to change: “the woods disappear and in the rocky walls a gateway opens, which closes behind them. . . . Gurnemanz turns to Parsifal, who stands as if bewitched.”[9] Clearly, the Grail Knights are guarding a numinous place, or at least a place infused with numinous emanations from the Grail itself, but deeper than this they are guarding the concept of transcendence itself. And, with his portrayal of Schopenhauer’s ideas concerning the possibility of redemption within a secular framework, Wagner himself is guarding the possibility of transcendence against the ongoing decline of Christianity.
When Nietzsche first read Parsifal, and heard the sound of swords clashing, he had come to view the notion of transcendence, whether through religion or through art, as an impossibility. Whilst he had already decisively rejected religion he had gone still further and questioned the notion that there is a metaphysical side to existence at all. Despite his friendship with Wagner and his earlier allegiance to Schopenhauer he had come to the conclusion that such a metaphysical realm, the hidden unity of the will, simply did not exist; or if it did exist, that it was completely unknowable to man and so not worth considering.
Nietzsche had come to realize that Schopenhauer, in working out his philosophical worldview, had taken a number of impermissible steps. When Schopenhauer had described the phenomenal world of appearance as illusory he was entirely correct, but he then went on to assume that there must be a world of ultimate reality, a “real” world distinct from representation, lying anterior to the apparent world. Nietzsche questions why, if we are constantly deceived about the nature of the apparent world, we should give any credence to speculations about a hidden world. In fact, he goes on to question why, if such a world anterior to appearance did in fact exist, it should be assumed to have any greater validity than the world of “mere” appearance: “It is no more than a moral prejudice that truth is worth more than mere appearance; it is even the worst proved assumption there is in the world. Let at least this much be admitted: there would be no life at all if not on the basis of perspective estimates and appearances.”[10]
In addition, when Schopenhauer perceived the will as an intimately known presence within himself he falsely assumed that it was a singular force. From this perception he inferred an undifferentiated reality behind the entire world of appearance. But Nietzsche realizes that the will cannot be described in such a way. For Nietzsche, the will is something that emerges as the result of a conflict of impulses and desires that exist simultaneously within an individual. The act of willing emerges as the effect of the most domineering of these impulses. Crucially, it is the result of a prior battle that gives rise to the act of willing and it is an error to ascribe this will to “the synthetic concept ‘I’.”[11] The individual contains many souls, and the one that wins the battle of the wills becomes identified as the individual’s will. In this respect, Nietzsche has stood Schopenhauer’s thinking on its head. Instead of a unified whole manifesting itself as plurality, Nietzsche perceives a battleground of competing interests, one of which achieves victory and is then assumed to be the volition of an integrated agent. From here it is a short step to the realization that “life simply is will to power.”[12]
This realization reveals another false step in Schopenhauer’s argumentation, or rather a severe error of evaluation. If it is assumed there is a holistic and in some sense “higher” reality behind appearances, then this reality assumes a position of superiority to the world of appearances. In Nietzsche’s terms this means that a fictional world has the whip hand over the real world: “Once the concept ‘nature’ had been devised as the concept antithetical to ‘God’, ‘natural’ had to be the word for ‘reprehensible’ – this entire fictional world has its roots in hatred of the natural (actuality!), it is the expression of a profound disgust with the actual. . . . But that explains everything. Who alone has reason to lie himself out of actuality? He who suffers from it. But to suffer from actuality means to be an abortive actuality. . . . The preponderance of feelings of displeasure over feelings of pleasure is the cause of a fictitious morality and religion: such a preponderance, however, provides the formula for decadence . . .”[13] Although this polemic is aimed at the Christian concept of God, the point is equally applicable to Schopenhauer’s world of will. And, once more, Nietzsche has turned Schopenhauer’s thought on its head. Rather than suffering and want being caused by the splintering of a prior unity into discrete phenomena, Nietzsche sees the presence of suffering in the individual as the cause of the creation of this fictional world of unity. It is simply a palliative created to alleviate dissatisfaction with the real.
Of course, this is no neutral matter of academic philosophy; it is fundamental to knowing whether it is possible or desirable to believe in the existence of a noumenal world, whatever its character might be. The existence or non-existence of such a transcendent world has ultimate implications for questions concerning God, life after death, and so on. And this is why Nietzsche’s attack on Wagner’s perceived decadence was so vociferous: “He flatters every nihilistic (Buddhistic) instinct and disguises it in music; he flatters everything Christian, every religious expression of decadence. Open your ears: everything that ever grew on the soil of impoverished life, all of the counterfeiting of transcendence and beyond, has found its most sublime advocate in Wagner’s art.”[14]
And this is the heart of the matter: the counterfeiting of transcendence. When one becomes a fellow traveler with Nietzsche one realizes the intellectual impossibility of accepting notions of transcendence. The very idea of transcendence itself becomes anathema because it implies a belittling of the here and now, of actuality. Consequently art that posits transcendence as an ultimate aim becomes risible, and the beauty of Wagner’s opera dissipates like Klingsor’s castle.
But whilst one listens to the music of Parsifal and becomes immersed in the extraordinarily high level of dramatic development, the possibility of transcendence comes back in to focus and inspires an intuitive yearning to grasp it: the ultimate grail quest. And, in fact, when Nietzsche actually heard Parsifal for the first time he was to write, “Did Wagner ever compose anything better? The finest psychological intelligence and definition of what must be said here, expressed, communicated, the briefest and most direct form for it, every nuance of feeling pared down to an epigram; a clarity in the music as descriptive art, bringing to mind a shield with a design in relief on it; and, finally, a sublime and extraordinary feeling, experience, happening of the soul, at the basis of the music, which does Wagner the highest credit.”[15] Wagner’s desire to present Schopenhauer’s metaphysics in artistic form might appear now to be an item of merely historical interest. But what we know intellectually will not always remain sovereign, and Parsifal is unlikely to be the last time we seriously consider the possibility of transcendence.
Notes
1. Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, in Basic Writings of Nietzsche, trans. Walter Kaufmann (New York: The Modern Library, 1967), 744.
2. Arthur Schopenhauer, The World as Will and Representation, trans. E. F. J. Payne (New York: Dover Publications, 1969), vol. 1, 119.
3. Ibid., 124.
4. Ibid., 110.
5. Ibid., 371.
6. Ibid., 170.
7. Ibid., 257.
8. Bryan Magee, Wagner and Philosophy (London: Penguin Books, 2000), 196.
9. Richard Wagner, Parsifal, in Parsifal (Wagner): Opera Guide 34 (London: John Calder, 1986), 96.
10. Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, in Basic Writings of Nietzsche, trans. Walter Kaufmann (New York: The Modern Library, 1967), 236.
11. Ibid., 216.
12. Ibid., 393.
13. Friedrich Nietzsche, The Anti-Christ, in Twilight of the Idols and The Anti-Christ, trans. R.J. Hollingdale (London: Penguin Books, 1968), 135–36.
14. Friedrich Nietzsche, The Case of Wagner, in Basic Writings of Nietzsche, trans. Walter Kaufmann (New York: The Modern Library, 1967), 639.
15. Magee, Wagner and Philosophy, 325.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2013/05/parsifal-and-the-possibility-of-transcendence/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/05/hacker.jpg
00:05 Publié dans Musique, Musique, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wagner, richard wagner, musique, allemagne, parsifal, philosophie, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 31 mai 2013
René Baert: la mesure du monde
par René BAERT (1903-1945)
Ex: http://renebaert.wordpress.com/
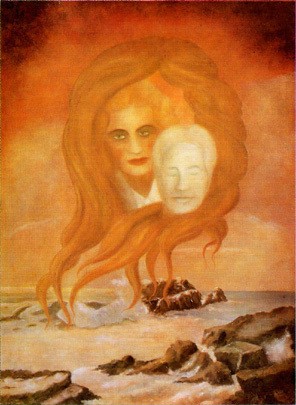 N’importe-t-il pas, avant toute chose, non pas d’agir, mais de comprendre le sens de l’acte que l’on va accomplir ? Savoir distinguer est à la fois le premier signe de l’intelligence et le premier échelon de l’éthique. Connaître l’origine, la cause, de la maladie, c’est à quoi s’applique le médecin. De son diagnostic ne dépend pas la guérison, mais la possibilité de choisir une médication appropriée à la nature du mal.
N’importe-t-il pas, avant toute chose, non pas d’agir, mais de comprendre le sens de l’acte que l’on va accomplir ? Savoir distinguer est à la fois le premier signe de l’intelligence et le premier échelon de l’éthique. Connaître l’origine, la cause, de la maladie, c’est à quoi s’applique le médecin. De son diagnostic ne dépend pas la guérison, mais la possibilité de choisir une médication appropriée à la nature du mal.
Notre intention n’est pas d’exiger que chacun respire l’air pur des sommets, ni que l’on se donne tout entier à la culture des vertus supérieures: notre tâche se borne à montrer d’où proviennent notre petitesse et notre indignité. n faudrait être le dernier des naïfs pour croire que la dénonciation d’une carence entraînat aussitôt son remplacement par quelque discipline exemplaire. Nous croyons savoir que nous nous adressons à des hommes qui, la plupart du temps, ne méritent même plus ce nom. Dès lors il serait absurde d’imaginer que nos diatribes influençassent, sur-le-champ, un peuple qui chaque jour davantage se distingue par sa bêtise et par son inconséquence. Pourtant, dès qu’un doute monte à l’esprit, dès que l’on s’étonne: on se trouve dans la bonne voie.
Toute grande pensée naquit un jour de la curiosité ; il en va de même de tout acte de noblesse. Si nos misérables compatriotes étaient curieux, si la recherche des causes les sollicitait quelque peu, nous nous sentirions brusquement envahis par une grande espérance. Ce que nous essayons de faire, depuis que nous vivons l’une des plus lamentables pages de notre histoire, n’est rien d’autre que de hâter l’éclosion de cette curiosité. Le mal dont souffrent nos contemporains énervés, leur désarroi devant les faits, leur refus d’adhérer à la marche inéluctable des choses, leur manière ridicule de nier l’évidence, leur arrogance et leur singulier pouvoir de déplacer les problèmes, tout cela trouve son point de départ dans un manque absolu du besoin de connaître.
Il importe de remarquer tout d’abord que nous n’avons la notion de ce qui est mal et terrible, que lorsque ce mal et ce terrible se rapportent à quelque grand fléau social. Une grande guerre, une épidémie, une révolution sanglante, ne manquent jamais de nous indigner profondément et de faire en sorte que nous nous lamentions sur l’abominable condition humaine. L’indignation touche rapidement à son comble. Comment, s’écrie-t-on, de telles aberrations et de tels égarements peuvent-ils encore se produire de nos jours ! On est effrayé par le massacre des innocents que chaque guerre ne manque pas d’entraîner. On crie haro sur ceux que l’on croit responsables de ces hécatombes. On se prend à juger les grands de la terre qui recourent à la violence. On voudrait tenir là, à portée de la main, les quelques hommes qui menèrent les peuples à leur ruine ; mais chose étrange, alors qu’on aperçoit lumineusement les effets, on se perd en conjectures sur la cause ; or, la cause est en nous-même. Car n’est-il pas vrai, que chaque jour, dans le secret de notre âme, nous tolérons les pires désordres, n’est-il pas vrai que la journée d’un homme compte mille petites lâchetés, mille manquements à la dignité ? Ce n’est pas lorsque la tempête éclate qu’il faut pleurer sur la pauvreté de nos moyens de défense, ce n’est pas lorsque le ver est dans le fruit qu’il faut condamner les intentions de la nature ! Regardons tout d’abord en nous-même… et avouons humblement que notre indignation devant les . désastres et les injustices sociales naît d’un esprit d’intolérance que nous n’aurions garde d’appliquer à notre propre cas. Encore une fois, nos paroles n’ont qu’un très vague rapport avec nos actes.
Si, par ailleurs, nous voulons parler de révolution, si notre intention est de collaborer à l’édification d’un monde nouveau, n’oublions pas que ce monde sera exactement ce qu’auront été les hommes. L’homme toujours demeure la véritable mesure du monde. Si la révolution rate, c’est parce qu’elle aura été faite par des ratés. Il convient de mettre de l’ordre dans sa propre maison avant de vouloir changer le cours des choses. Tant que dans nos cœurs la faiblesse l’emportera sur la force et tant que les peuples constitueront des masses abouliques. nous ne devons pas espérer le moindre changement social.
L’esprit révolutionnaire ne vas pas sans une forte discipline intérieure. Il est inadmissible que l’on parle durement aux autres, si l’on n’est pas intransigeant pour soi-même. La révolution n’a que faire de ceux qui se contentent de voir la poutre dans l’œil du voisin. La cause de l’Europe réclame des soldats, mais des soldats qui soient purs. Sans doute, la pureté dont nous voulons parler n’a-t-elle rien de commun avec la sainteté ; nous savons bien que la créature est imparfaite et que l’homme est un composé de bien et de mal. Pourtant, il est indispensable que nous nous accusions avant d’accuser autrui ; et surtout que nous sachions que nos trahisons les plus nombreuses prennent place dans le cadre de notre vie quotidienne. Avant de condamner le siècle, sachons reconnaître ceux qui le firent tel qu’il nous apparaît. Rappelons-nous encore que les premières batailles doivent se livrer dans notre âme. Tant que la révolution ne sera pas dans nos cœurs, il ne sera pas possible de la hisser sur le plan social. La révolution se fait avant tout dans la conscience et c’est la conscience qui doit être réformée si l’on souhaite réformer le monde. Soyons des apôtres et des soldats, soyons durs et impitoyables, mais ne le soyons pas si notre conscience n’est pas en paix ! Il est vain de vouloir opposer un sang impur à un autre sang impur. Travaillons à nous rendre meilleurs. Ce contrôle de soi, cette discipline, cette foi que nous exigeons du monde, demandons-nous tout d’abord s’ils prolongent leur écho dans notre cœur. N’incitons pas autrui à s’engager dans une voie où nous n’avons jamais osé nous aventurer nous-même. Ici, comme ailleurs, il n’y a que le premier pas qui coûte, mais de ce premier pas dépend la vie ou la mort de notre cause ; or, notre cause ne peut vivre que si rien n’entache la pureté de nos intentions.
Baert, R. (1944). A la recherche d’une ethique. Bruxelles: La roue solaire, 9-14
00:05 Publié dans Belgicana | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené baert, philosophie, belgique, belgicana |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 30 mai 2013
In memoriam Dominique Venner (1935-2013)
JURE VUJIC
In memoriam Dominique Venner (1935-2013)
Testament modernog samuraja
Dominique Venner francuski povjesničar je 21. svibnja počinio samoubojstvo ispred oltara u Pariškoj katedrali Notre Dame. Za one koji su ga poznavali i imali čast s njime surađivati, takva gesta simbolizira ne samo ljudski očaj već i eminentnu političku gestu i poruku. Objavljujem prijevod njegovog pisma-oporuke koji pojašnjava uzroke njegove nagle smrti.
« Duhovno i tjelesno sam zdrav, upotpunjen ljubavlju svoje supruge i djece. Volim život i ništa ne očekujem od nadnaravnog svijeta, jedino opstanak i obnovu moje vrste i duha. Međutim, u zalazu mog života, i ispred golemih ugroza za moju francusku i europsku domovinu, osjećam dužnost da djelujem dok imam još snage. Vjerujem da se trebam žrtvovati kako bi prekinuo s letargijom koja nas muči. Darujem ono što mi preostaje od života u znak protesta i re-fundacije. Odabirem visoko simbolično mjesto, parišku katedralu Notre-Dame koju poštivam i štujem, koju je izgradio genij mojih predaka na mjestu drevnih kultova koji me podsjećaju na moje pramemorijalno podrijetlo.
Kada većina ljudi pristaje biti robovi vlastitog života, moja gesta utjelovljuje jednu etiku volje. Dajem si smrt kako bi razbudio uspavane svijesti. Pobunjujem se protiv fatalnosti. Pobunjujem se protiv otrova duše i individualnih želja koje narušavaju identitarna usidrenja kao što su obitelj, kao intimni stup tisućljetne civilizacije. Kada branim identitet svih naroda, također se bunim protiv zločina koji nastoji zamijeniti naša pučanstva.
Dominantni diskurs nije se u stanju osloboditi svoje toksične dvosmislenosti. Europljanima pripada da snose posljedice. S obzirom da više nemamo identitarnu vjeru na koju se možemo osloniti, dijelimo još od Homera zasebno sjećanje, kao ostavštinu svih vrednota na kojem možemo restaurirati naš budući preporod kao prekid s metafizikom neograničenog, pogubni izvor svih modernih stranputica.
Molim oprost od svih onih koji će patiti zbog moje smrti, a prvenstveno moju suprugu i djecu, kao i nećake i moje vjerne prijatelje. Jednom kad prebole šok patnje, ne sumnjam da će razumjeti smisao moje geste i transcendirati sa ponosom svoju tugu. Želim da se što bolje razumiju kako bih što više trajali. Pronaći ćete u mojim spisima prefiguriranje i pojašnjenje moje geste. «
Dominique Venner rođen je 1935, bio je esejist i povjesničar. Utemeljitelj časopisa „Nouvelle Revue d’histoire“. Objavio je niza knjiga :Le Cœur rebelle, le Dictionnaire amoureux de la ChasseLe Siècle de 1914, Histoire et tradition des Européens). Le Choc de l’Histoire (Editions Via Romana, 2011) L’Imprévu dans l’Histoire (Ed. Pierre-Guillaume de Roux, 2012). Simptomatična činjenica za njegovo samoubojstvo je da bi uskoro trebao izići iz njegov novi esej « Un Samouraï d’Occident. Le bréviaire des insoumis » Samuraj Zapada. Brevijar nepokorenih. » .
Dominique Venner nije bio «ekstremni desničar» kako ga lažno i površno etiketiraju « mainstream » mediji. Iznad umjetne diobe ljevice/desnice, on je u pravom smislu riječi bio aristokrat (aristoi, «među najboljim»), zagovornik «Velike Europe», duhovne, kulturološke i povijesne Europe nacija, naroda, regija, a ne Europe trgovaca, burzovnih mešetara i korporacija. Posvetio je cijeli život obrani indo-europske civilizacije i francuske nacije, a ostat će zapamćen kao simbol ljudske dosljednosti i hrabrosti. Odlazi svojom lucidnom voljom, u maniri drevnih Germana i Rimljana, ponosnih samuraja postmodernog nihilističkog doba, poput japanskog književnika Yukio Mishime, francuskih književnika Drieu la Rochelle i Robert Brasillacha. Samoubojstvo kao posljednji argument otpora. Ultima ratio regis.
00:05 Publié dans Actualité, Hommages, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, mort volontaire, dominique venner, nouvelle droite, paris, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
APOTEOSIS DE DOMINIQUE VENNER EN NOTRE DAME
APOTEOSIS DE DOMINIQUE VENNER EN NOTRE DAME
Ex: http://enricravello.blogspot.com/
Del antiguo griego apo (intensidad, presencia) y theos (Dios, de ahí el nombre de Zeus) la apoteosis, es decir el elevarse hasta el nivel de los dioses, era para los antiguos helenos un privilegio sólo al alcance de muy pocos héroes.
00:05 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mort volontaire, dominique venner, nouvelle droite, france, paris, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Une époque sans victoire, sans issue, sans rien...
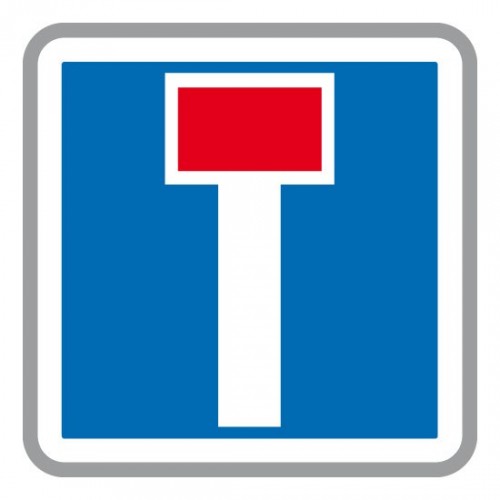
Une époque sans victoire, sans issue, sans rien...
Ex: http://www.dedefensa.org/
23 mai 2013 – Nous parlions il y a quelques jours (voir le 11 mai 2013) d’une “phase dépressive” pour les USA vis-à-vis de la Syrie. Nous aurions pu écrire : “pour le bloc BAO”, ou, d’une façon plus générale, pour toutes les agitations, manigances et manœuvres qui, depuis l’été 2011, caractérisent la situation de la crise syrienne. Nous aurions pu faire encore plus tranchant et simplement constater une “phase dépressive” générale, qui n’épargne personne. Même les Russes, qui s’annoncent comme les grands vainqueurs de cette épreuve syrienne parce qu’ils tiennent sur des principes, même s’ils sortaient renforcés dans la situation générale du Moyen-Orient, comme nous commencions à le constater le 14 mai 2013, même les Russes ne “gagnent” rien parce qu’il s’agit d’une “époque sans victoire”, parce qu’il s’agit d’une “époque sans issue”.
Nous traversons une période singulière, faite à la fois des restes des fureurs et des emportements des narrative du bloc BAO, et des amertumes de plus en plus prégnantes du constat des illusions perdues et des ambitions déçues, – d’ailleurs comme si les unes et les autres, “illusions” et “ambitions”, se confondaient, les ambitions n’étant rien d’autre que de piètres illusions. Les marques de l’amertume qui nous envahit sont celles des catastrophes en cours, qui composent la crise d’effondrement du Système, et qui se signalent partout, – en Syrie certes, mais ailleurs aussi bien, dans une chaîne ininterrompue, dans un contexte impeccablement plaqué sur une infrastructure crisique qui nous tient dans ses griffes.
Nous ne disons pas qu’il s’agit d’un Moment définitif et donc décisif ; il l’est peut-être, il ne l’est peut-être pas... Nous disons que, dans tous les cas et s’il est effectif comme nous le croyons, c’est un moment significatif, qu’il soit ou non définitif et donc décisif. Nous évoquions ce Moment dans notre texte du 22 mai 2013, pourtant sur un tout autre sujet : «Ce sentiment d’un changement de “tonalité” de la crise ne concerne pas seulement le corps de ce message, il implique un jugement général de notre part et il devrait faire l’objet de l’un ou l’autre texte à cet égard, sur ce site. Il s’agit de l’observation que notre “crise d’effondrement“, crise générale par définition, est effectivement entrée dans une phase nouvelle, non pas spécifiquement d’elle-même mais dans la perception que nous en avons. (Le rapport entre les deux, rythme de la crise et notre perception, n’est pas direct ni proportionné parce que la dynamique de la première est constante mais dissimulée [les termites] et que la seconde n’y réagit que par saccades.) Nous pensons que les psychologies, la psychologie collective touchée par les effets des événements et les impressions des grands courants métahistoriques, et par conséquent les psychologies individuelles qui en recueillent elles-mêmes les effets secondaires par le biais du collectif, ont incubé un fait nouveau. Il s’agit bien entendu d’un “fait” méritant des guillemets par rapport au sens commun subverti par le Système et qui lui est hostile, puisque fait non exprimé consciemment, et encore moins répandu dans le système de la communication où les forces du Système ont leurs positions et leurs diktat. Il s’agit, à notre estime qui est de l’ordre de l’intuitif, du fait de l’inéluctabilité de cette crise...»
C’est un de ces moments où nous pouvons mesurer, toucher du doigt, physiquement sentir ce que cette crise a d’irrémédiable, et donc cet événement eschatologique dont nul vainqueur ne peut émerger, dont nulle issue ne peut être conçue par la raison seule et d’ailleurs discréditée par sa subversion par rapport au Système, et cet événement nous confrontant à notre destin. C’est, littéralement, un “Moment eschatologique”, où l’idée terrible s’inscrit brutalement dans nos psychologies qu’il nous faut attendre ce que le sort, ou la Providence, va décider, – et certains esprits acceptant cette confidence de perception de leurs psychologies, les autres (la plupart) la refusant ou la réfutant.
Nous relevons plusieurs signes physiques et politiques, matériels et conceptuels, qui marquent selon notre perception cette amertume. Tout se passe comme si les événements eux-mêmes avaient décidé de s’orienter d’eux-mêmes de telle façon qu’il ne puisse y avoir, dans notre psychologie et dans notre âme, rien d’autre que ce goût acre de l’amertume. Nous sommes littéralement eschatologisés, dans tous les sens, mais également et précisément pour accorder croyances et non-croyances, dans le sens le plus concret du cours des événements terrestres. C’est comme nous l’écrivions le 14 mai 2008 déjà : «[N]ous voulons dire, si nous nous référons à cette définition pratique et concrète, et excellente en tous points, que donne Roger Garaudy de l’eschatologie (à côté de la définition théorique : “Etude des fin dernières de l’homme et du monde”): “L’eschatologie ne consiste pas à dire: voilà où l’on va aboutir, mais à dire: demain peut être différent, c’est-à-dire: tout ne peut pas être réduit à ce qui existe aujourd’hui.”» Veut-on une revue de détail ?
• Aux USA, à Washington, on connaît l’état général du système. On voit également que des formes plus agressives de crises se développent (Scandalgate, dont l’affaire FBI/AP, le 16 mai 2013), qui fragilisent considérablement la position du président. Alors que son second mandat vient à peine de commencer, l’autorité et l’influence d’Obama sont en train de s’affaiblir, d’une façon désormais classique et du type-entropique mais pas plus lente pour autant, à partir d’une situation crisique du pouvoir à Washington déjà elle-même catastrophique. L’hypothèse qu’on nommerait Watergate-II, ou “watergatisation” de Scandalgate, n’est plus de la vaine spéculation mais une possibilité bien réelle. Bien entendu, tout cela se plaque sur la situation générale catastrophique des USA qu’on connaît, qui affecte tous les domaines constituant la structure désormais en voie de dissolution de cette puissance. Depuis au moins 2008, les tensions centrifuges à caractère déstructurant et dissolvant, rejoignant les problèmes de l’origine de ce projet américaniste qui furent brutalement écartés, d’abord par les législateurs de la Constitution puis par les canons du général Grant, se manifestent par toutes les issues possibles, de la haine du “centre” washingtonien à la question de la vente libre des armes. Les crises conjoncturelles de l’ensemble américaniste se concentrent dans cette structure crisique structurelle de la désunion.
• En Europe, le phénomène crisique est également général et touche tous les domaines possibles, dans toutes les dimensions possibles, y compris au niveau des composants du concept ; de la question de la souveraineté et de l’identité des nations devenant des références inexistantes engendrant des angoisses et des souffrances intolérables pour les peuples ; de la question de la paralysie et de l’impuissance bureaucratique grandissante des institutions à prétention supranationale et qui semblent se contracter en des non-actes significatifs à mesure que cette affirmation est de plus en plus proclamée. Les crises conjoncturelles (l’euro et la finance, les crises sociales et sociétales, la crise diplomatique illustré par la Syrie et par l’Iran, les crises culturelles et identitaires) se développent et s’additionnent sans qu’aucune solution pour aucune d’entre elles ne puisse être envisagée, et se connectent directement sur des processus d’effondrement structurels en une infrastructure crisique proprement européenne qui semble bien être la seule création solide du processus européen. L’Europe n’a jamais été aussi présente et étouffante et aussi profondément plongée dans l’impuissance et dans le rejet des populations. C’est toute une civilisation et toute une psychologie qui se trouvent plongées dans l’abîme de la dépression. La seule solution en vue pour les dirigeants-Système, qui font partie d’une sorte de “génération-zombie” d’une manufacture incontestablement européenne, est nécessairement “toujours plus d’Europe”. (Pour une référence raisonnable mais sans aucune illusion sur cette crise, voir William Pfaff sur son site, le 16 mai 2013 : «It is not simply the Eurozone, composed of the 17 European states that have the euro as currency, that is threatened... [...] Now it is the European Union itself that is in danger...» On peut également consulter l’article présenté en Ouverture libre, ce 21 mai 2013.)
• Autour de ce bloc BAO, concepteur, moteur et ordonnateur de la civilisation, qui semble se contracter en une infrastructure crisique, the Rest Of the World (ROW nouvelle formule, d’après-2008) cherche à comprendre une situation où on lui enjoint de suivre une conception générale maximaliste dont le résultat évident et direct est d’accélérer exponentiellement la course à l’effondrement. Lorsqu’il songe à une résistance, sinon à une révolte, ROW se réfère à des structures en formation telles que BRICS ou OCS, mais sans réelle conviction. Dans cet ensemble, la Russie domine conceptuellement par la puissance qualitative de sa démarche ; d’une certaine façon, on pourrait penser que la Russie sait bien qu’elle a raison mais qu’elle sait également que c’est trop tard. Elle développe la diplomatie la plus intelligente du moment, avec un esprit ferme pour concevoir les fondements et les orientations de son exécution (Poutine) et le meilleur ministre des affaires étrangères de son temps, de très loin, pour exécuter cette conception en la comprenant parfaitement (Lavrov), – l’inspirateur de tout cela étant simplement la présence irréfragable du fait national russe qui semble avoir gardé quelque transcendance. Mais ce déploiement opérationnel, qui vaut pour une situation classique où la raison non subvertie aurait encore sa place dans les relations internationales, n’a aucune chance de modifier fondamentalement l’irrésistible courant d’entropisation.
• La Syrie est, pour l’instant, le point de fusion central de ce que nous nommons crise haute, et c’est là que se mesure la différence abyssale entre la diplomatie russe et la pseudo-diplomatie du bloc BAO. Effectivement, les Russes dominent la scène mais, comme nous le constations plus haut et selon notre estimation, «Tout le brio des Russes ne peut rien sur l’essentiel, parce que personne ne peut rien sur l’essentiel.» La Syrie est effectivement un tourbillon de désordre et de chocs divers, où chacun croit disposer d’un plan sûr pour “la victoire” et agit dans un sens qui ne peut qu’accélérer le tourbillon. La méconnaissance des enjeux réels, chez la plupart des acteurs, est littéralement stupéfiante. Une conversation à bâtons rompus d’une heure avec un ministre des affaires étrangères d'un pays du bloc BAO, comme cela fut le cas très récemment, laisse confondu sur le degré d’ignorance de cette sorte de personnage («On a l’impression de parler à un idiot», dit, presque attendri, un participant actif de cette rencontre). En Syrie, à cause des circonstances, des combinaisons de puissance du système de la communication, des pressions diverses (dont celles, terrifiantes, du parti des salonnards), se trouve rassemblée la scène la plus expressive du naufrage intellectuel des directions politiques et des élites-Système de ce que nous nommons la “contre-civilisation”.
• Autour du monde globalisé mais avec des effets jusqu’au cœur de lui-même, les crises eschatologiques se poursuivent, que ce soit celle du simple désordre de nos politiques rendues nécessairement absurdes par des influences insaisissables (Libye), que ce soit celle des effets effrayants du Système sur la situation du monde (la crise climatique et tout ce qui va avec), voire à l’extrême la crise permanente qu’est le machinisme, transmuté décisivement en technologisme catastrophique, et cette crise proche d’arriver au point de rupture. Cela signifie que si, demain, par une sorte de miracle qu’on arriverait malgré tout à mettre à l’actif du Système, tous les affrontements, les mésententes, les coups fourrés cessaient, remplacés par une concorde universelle, nous nous trouverions tout de même devant un empilement de crises eschatologiques sans issue ni solutions.
• Nous terminons in extremis (le Guardian de ce 23 mai 2013) par une observation qui semblera plus anecdotique, moins universelle disons, voire people si l’on a l’esprit mal tourné, l’esprit “peuple-blingbling” de cette époque crépusculaire. Elle nous paraît significative, et pas moins fondamentale que les autres. Il s’agit des remarque d’un acteur-réalisateur, qui fit et continue à faire profession d’avoir une pensée progressiste, Robert Redford, qui est à Cannes pour le film All Is Lost, réalisé par le jeune JC Chandor que Redford a soutenu au travers de son institution (le festival de Sundance du film indépendant) pour la réalisation de Margin Call, – le film le plus profond réalisé sur la crise financière de l’automne 2008. Redford observe à propos de All Is Lost qui est une allégorie de la crise que nous traversons : «Certain things have got lost. Our belief system had holes punched in it by scandals that occurred, whether it was Watergate, the quiz show scandal, or Iran-Contra; it's still going on…Beneath all the propaganda is a big grey area, another America that doesn't get any attention; I decided to make that the subject of my films. [...] We are in a dire situation; the planet is speaking with a very loud voice. In the US we call it Manifest Destiny, where we keep pushing and developing, never mind what you destroy in your wake, whether its Native American culture or the natural environment. [...] I've also seen the relentless pace of technological increase. It's getting faster and faster; and it fascinates me to ask: how long will it go on before it burns out.» Nous observerons que, contrairement à ce qu’il laisse entendre, Redford a évolué : critique de son époque qu’il tendait à réduire à ce qu’il jugeait être la vertu perdue des USA, mais la jugeant réformable comme la vertu des USA elle-même (The President’s Men, sur le Watergate, en 1976), il tend plutôt à parler aujourd’hui du “système” et de “la planète” ; et l’on voit bien qu’il ne croit plus à sa réforme possible (du Système), et qu’il juge qu’il se développe de lui-même jusqu’à son effondrement venant comme un fait inéluctable de lui-même («... and it fascinates me to ask: how long will it go on before it burns out»). Sa psychologie a effectivement incubé, de manière inconsciente, l’inexorabilité de l’effondrement.
Un Moment eschatologique
L’image du Titanic pour figurer le Système est juste, mais l’on comprend évidemment qu'elle ne l’est que partiellement. Lorsque le Titanic sombra, on savait bien que tout continuait après lui, que la catastrophe, outre la cruauté des vies emportées, n’apporterait qu’une occasion de plus pour tel ou tel débat, notamment sur l’application et le bon usage du technologisme naval, et que le reste continuerait. Le Système-Titanic, lui, n’a pas d’après... Le Système-Titanic sombre et, parce qu’il est hermétique et qu’il a happé en lui la globalité du monde, il est assuré que nous ne pouvons savoir ce qui va suivre, et encore moins imaginer puisque l’autorisation de le tenter ne nous est pas parvenue. La cause directe et parfaitement compréhensible de notre ignorance est que ce qui va suivre n’a aucun rapport avec le Système, que l’affirmation et la construction de cette “succession” qui ignore complètement son légataire ne dépendent pas de nous, du sapiens et de ses prodiges, et de sa prodigieuse hubris, – parce que «tout ne peut [...] être réduit à ce qui existe aujourd’hui»... Le Système-Titanic sombre aux accents d’une sorte de “marche eschatologique” exécutée par l’orchestre bien connu, dont on attend qu’il reste à son poste jusqu’au bout.
Observant tout cela et déroulant ces remarques diverses sans fièvre particulière, nous n’avons nullement l’impression, ni d’être excessivement pessimiste, ni d’être disons “catastrophistes”. Nous avons plutôt le sentiment de rendre compte d’une situation qui est singulière, sinon peu ordinaire, essentiellement par l’identification instantanée que nous en avons, et par l’effet de l’accélération de l’Histoire et de la contraction du temps. (Il suffit à cet égard de se rappeler où nous en étions il y a dix ans, quand la plupart des commentateurs et observateurs pensaient précisément dans le sens de cette remarque désormais immortelle d’un “officiel” de l’administration Bush à l’été 2002 : «We're an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you're studying that reality — judiciously, as you will – we'll act again, creating other new realities...» [voir notre Glosssaire.dde sur le “virtualisme”, le 27 octobre 2012].) Il faut admettre que la puissance d’un tel basculement de la perception répond à une dynamique des événements si extraordinaire qu’on doit parler de métahistoire, et bouleverse les psychologies à ce point du désordre qui permet d’assumer et de favoriser, la plupart du temps sans la moindre conscience de cela, des bouleversements aussi inouïs que ceux qu’on connaît. Nous voulons dire par là que la transformation et l’affolement des psychologies depuis dix ans font, singulièrement des directions politiques et des élites qui les soutiennent, de ces acteurs-Système qui sont plutôt et de plus en plus des figurants-Système, des outils très efficaces pour aller dans le sens de la dynamique de l’autodestruction et favoriser involontairement, et en croyant éventuellement l’inverse, la crise d’effondrement du Système.
Les commentaires généraux de ces événements nous paraissent manquer d’ampleur et d’audace à cet égard, simplement en n'acceptant pas de considérer des hypothèses que la raison rejette en général, et à cause de cela. (L’état de la raison étant aujourd’hui celui de la complète subversion d’elle-même, cet argument serait plutôt le contraire de ce qu’il veut prouver.) Ces commentaires se font principalement entre les partisans du Système (les figurants-Système, également négationnistes de la crise), qui répètent simplement, en guise d’incantation plus que de démonstration, que tout continue et que le Système est plus cohérent et nécessaire que jamais. Leurs adversaires, qu’on devrait qualifier d’antiSystème mais qui le sont de moins en moins d’un point de vue fondamental, continuent à développer une logique d’affrontement, à parler en termes de victoire-défaite, arguant que des forces se constituent avec de plus en plus de puissance pour inquiéter le Système tel qu’il est. Pour ceux-là et pour prendre le cas événementiel le plus intéressant, l’effondrement des USA dans le sens de l’effondrement du pouvoir central du Système constituerait une victoire décisive à partir de laquelle on pourrait entreprendre une reconstruction et une réforme radicale du Système. Dans cet exemple, nous pouvons dire que nous sommes décisivement d’un avis différent, si l’on veut effectivement développer une dynamique antiSystème. L’effondrement des USA per se ne nous intéresse pas dans le sens qu’il ne peut être considéré à lui seul comme un événement décisif, et que le considérer de la sorte lui enlève tout caractère de décision. (Nous n’avons certainement pas toujours pensé dans ce sens, mais la pensée évolue nécessairement au rythme de l’accélération de l’Histoire. Une évolution de la pensée, même et surtout radicale, est une chose inévitable et nécessaire. On notera que nous avançons cette idée nouvelle du caractère insuffisant du seul effondrement des USA, ou les prémisses de cette idée nouvelle, depuis au moins 2009, – une fois incubé l’événement pour nous rupturiel, et nécessitant un changement d’appréciation, de la crise de l’automne 2008. [C’est à partir de cette époque que nous avons observé la constitution du bloc BAO.] On peut apprécier les prémisses de ce changement conceptuel dans des textes du 3 janvier 2009 et du 14 octobre 2009, au moins.)
Pour poursuivre l’exemple, nous considérons que l’effondrement de l’Amérique ne nous apparaîtrait comme un événement décisif que dans la mesure où il entraînerait l’effondrement du Système. C’est la condition sine qua non pour faire passer l’événement de la catégorie des événements très importants à l’intérieur du Système, à la catégorie de l’événement antiSystème fondamental. (Cela dit, ajoutons cette précision essentielle que, pour nous, il est acquis, disons à 99,95%, que l’effondrement des USA amènerait nécessairement l’effondrement du Système. Mais il est essentiel de comprendre cette nécessité relationnelle entre les deux, pour mieux distinguer les caractères de l’événement, ses orientations, ses effets, etc.)
C’est-à-dire que, pour nous, le point de non-retour est non seulement atteint mais très largement dépassé. Subrepticement et nécessairement pour leur pauvre cause, les partisans du Système, mentionnés plus haut mais brièvement à cause de l’extrême pauvreté de leur pensée, sont passés de l’argument TINA (There Is No Alternative), qui impliquait une sorte de “volontarisme”, de la nécessité optimiste de se battre, d’innover, d’aménager, pour s’adapter à ce Système auquel, selon eux, il n’y avait pas d’alternative ; à l’argument qu’on résumerait sous le sigle TINNOA (There Is No Necessity Of Alternative), qui implique que tout est parfait telles que les choses sont, que le Système représente une sorte de perfection intangible, effectivement la Nécessité universelle réalisée. De ce point de vue, nous sommes au niveau d’une religion (cet exotérisme qui estime le débat clos) demandant à ses adeptes un complet aveuglement ; cette logique religieuse implique que rien d’autre d’humainement et même de “spirituellement” acceptable ne peut se concevoir, et qu’à l’extérieur de cela on ne trouve que la barbarie conceptuelle. Par cette position, et compte tenu de ce qu’est le Système, les partisans-Système représentent eux-mêmes un nihilisme totalement clos et même verrouillé, une sorte de barbarie eux-mêmes, justement selon leur démarche d’inversion, ici d’accuser les autres d’être ce qu’ils sont eux-mêmes en vérité. Il s’agit de la “barbarie postmoderniste” combinant le «barbare intérieur» selon Jean-François Mattéi, et le barbare augmenté de la barbarie faite de technologisme prédateur et de narrative dissimulatrice qui permet de faire avancer l’équation dd&e (déstructuration-dissolution-entropisation) que le Système lui-même exsude et d’accélérer la dissolution de la société produisant elle-même des caractères barbares supplémentaires.
Plus que jamais, le produit du Système, l’équation dd&e, est implicitement présenté selon la formule-narrative du “chaos créateur”. Mais ce chaos, qui est effectif, est désormais exclusivement producteur de nihilisme (sa forme opérationnelle est l’entropisation), c’est-à-dire un chaos producteur d’un chaos de lui-même. Il est indiscutable qu’un monde “organisé” selon de tels déséquilibres insensés en constante accélération, et par conséquent en constante aggravation de leur instructure de déséquilibre et de non-sens, et par conséquent ce monde de plus en plus condamné à se trouver enfermé dans ces déséquilibres, il est indiscutable qu’un tel monde ne peut survivre en aucune façon. Il s’oppose hermétiquement à toutes les lois concevables, qu’elles soient physiques ou métaphysiques. C’est la situation où nous nous trouvons présentement, qui nous apparaît effectivement, dans sa phase autodestructrice, comme la formule d’accélération ultime de la crise d’effondrement du Système. Pour autant, nous ne savons et ne pouvons savoir quand et comment s’accomplira cet événement dans sa finalité.
Ce n’est pas être particulièrement pessimiste qu’affirmer cela, mais simplement faire un constat réaliste d’une situation qui s’exprime de toutes les façons possibles. La question inévitable que l’“esprit de l’époque” nous conduit quasiment comme une obligation à poser est, non seulement d’envisager, mais de connaître ce qui va suivre : cette connaissance de l’avenir, même catastrophique et post-catastrophique, c’est-à-dire même eschatologique, est impossible, ce qui contrevient au diktat nécessaire de la modernité qui est la maîtrise, et donc la connaissance de l’avenir. La crise étant évidemment eschatologique, aucune réponse ne peut être apportée ; cela explique notre profond désarroi par rapport à l’“esprit de l’époque” et la réaction la plus marquée répondant au diktat de la modernité est de nier la vérité de cette crise, y compris ce que certains considèrent comme sa nécessité au sens métaphysique. (Cas du négationnisme de la crise.) Cet état d’esprit, qui fut considéré comme une immense victoire humaine, apparaît aujourd’hui comme un terrible handicap, par exemple par rapport aux sociétés anciennes qui ignoraient évidemment, et rejetaient in fine par leurs conceptions, le diktat moderniste de la maîtrise et de la connaissance de l’avenir. Dans son discours de réception à l’Académie d’Athènes, en 1997, consacré à La pensée grecque (dans L’homme qui riait avec les dieux, Albin Michel, 2013), Lucien Jerphagnon exposait ceci qui était à la gloire de cette “pensée grecque”: «Ainsi, cette dialectique de l’un et du multiple, de l’illimité et de la limite, de l’absolu et du relatif, de l’universel et du particulier, du parfait et de l’imparfait, exorcisait d’avance le mauvais démon de l’hybrys, de la démesure qui aimerait s’affranchir des limites du possible, et qui voudrait faire porter au discours humain une charge d’absolu qu’il ne peut contenir.»
Ces conceptions rejoignent en les nourrissant de l’antique sagesse notre propre approche de l’inconnaissance. Cela était exprimée d’une façon “opérationnelle” qui pourrait être proposée comme l’attitude à observer face au tumulte du temps présent et à l’énigme de l’après cette crise d’effondrement du Système, dans la Chronique du 19 courant... du 19 avril 2013 : «L’inconnaissance se dégage d’elle-même avec l’âge si l’élan de la pensée y pousse, et l’âge conduit effectivement à trouver, non comme une porte de sortie mais comme une fenêtre ouverte sur un nouvel élan, une activité qui avait pris comme mot d’ordre “le savoir” satisfait de lui-même et qui ne s’en satisfait plus. Il y a une certaine ironie, qui est, comme on dit aux jeunes gens irrespectueux, le “privilège de l’âge”, à pouvoir dire : “oui, oui, ‘je sais’, mais je sais aussi qu’il est préférable de ne pas s’attacher à ce savoir et de lui préférer ‘je sais que je ne sais pas’” ; et, disant cela (“je sais que je ne sais pas”), poursuivre en constatant que “ce savoir-là vaut bien plus que le savoir tout court”...» Nous sommes dans un temps qui nous impose nécessairement le constat que nous ne pouvons pas savoir (que nous ne savons pas), et l’occasion est belle, et liquidant ainsi définitivement le diktat (l’hybrys) de la modernité, d’en faire une gloire de l’esprit sous la forme de l’inconnaissance («la métaphysique et la spiritualité les plus hautes qu’on puisse imaginer», selon le texte référencé).
00:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Gustave de Beaumont et la critique radicale de la démocratie américaine
Gustave de Beaumont et la critique radicale de la démocratie américaine
 Comme je le dis parfois, nous vivons dans un présent permanent depuis environ deux siècles. Les années 1830 sont déjà notre société et nous ne les quitterons qu’à la prochaine comète qui s’écrasera sur notre vieille planète. Ce n’est pas un hasard. Le progrès et la blafarde modernité ont paralysé l’histoire de l’humanité. Pronostiquée par Hegel en 1806, la Fin de l’Histoire n’en finit pas de prendre son congé.
Comme je le dis parfois, nous vivons dans un présent permanent depuis environ deux siècles. Les années 1830 sont déjà notre société et nous ne les quitterons qu’à la prochaine comète qui s’écrasera sur notre vieille planète. Ce n’est pas un hasard. Le progrès et la blafarde modernité ont paralysé l’histoire de l’humanité. Pronostiquée par Hegel en 1806, la Fin de l’Histoire n’en finit pas de prendre son congé.
Gustave de Beaumont est le célèbre accompagnateur de Tocqueville en Amérique. Ils allaient y étudier les établissements pénitentiaires (c’est prémonitoire, il y a trois millions de détenus là-bas, et les matons forment le premier syndicat dans une dizaine d’Etats). Je n’avais jamais pensé à le lire mais c’est Karl Marx qui le cite ! Ma curiosité éveillée, je trouve sur un site québécois son très beau livre (avec une partie romanesque un peu niaise et trop copiée sur Manon Lescaut) sur Marie et l’esclavage, où Gustave de Beaumont révèle une lucidité française bien digne de Tocqueville et un style d’exception digne de Chateaubriand, du Lamartine de Graziella (texte préféré de Joyce en français) et plus généralement de l’aristocrate qu’il était – après ce sera fini avec Balzac ; après la prose sentira la roture, je le dis comme je le pense.
Les jugements de Beaumont sont encore plus durs que ceux de Tocqueville. Il ne digère pas l’hypocrisie éhontée de l’esclavage dans une nation libre et donneuse de leçons, et aussi beaucoup d’autres choses. J’ai picoré ces réflexions çà et là dans son si beau texte :
Les Américains des États-Unis sont peut-être la seule de toutes les nations qui n’a point eu d’enfance mystérieuse.
Là, on est bien d’accord. Le prosaïsme américain a écœuré toutes les grandes âmes yankees, Poe (Colloque entre Monos et Una), Melville (Pierre), Hawthorne (lisez l’admirable Petite fille de neige) entre autres. Encore qu’en analysant mieux le caractère Illuminati du dollar qui continue de fasciner l’humanité alors que l’Amérique est en faillite…
Il est clair en tout cas que pour Beaumont l’argent fait le bonheur des Américains, qui réifient tout, comme disent aussi les marxistes : la nature c’est de l’environnement, et l’environnement ça sert d’abord à faire de l’argent.
Absorbé par des calculs, l’habitant des campagnes, aux États-Unis, ne perd point de temps en plaisirs ; les champs ne disent rien à son cœur ; le soleil qui féconde ses coteaux n’échauffe point son âme. Il prend la terre comme une matière industrielle ; il vit dans sa chaumière comme dans une fabrique.
Vrai Saroumane, l’Américain déteste la nature et en particulier la forêt (on se souvient du beau poème de Ronsard sur la destruction des bois du Gâtinais) :
Les Américains considèrent la forêt comme le type de la nature sauvage (wilderness), et partant de la barbarie ; aussi c’est contre le bois que se dirigent toutes leurs attaques. Chez nous, on le coupe pour s’en servir ; en Amérique, pour le détruire. L’habitant des campagnes passe la moitié de sa vie à combattre son ennemi naturel, la forêt ; il le poursuit sans relâche ; ses enfants en bas âge apprennent déjà l’usage de la serpe et de la hache… l’absence de bois est, à leurs yeux, le signe de la civilisation, comme les arbres sont l’annonce de la barbarie.
Beaumont comprend comme Baudelaire et aussi Edgar Poe qu’avec l’Amérique on entre dans un nouvel âge du monde : l’âge de l’intérêt matériel, du conformisme moral (la tyrannie de la majorité) et de la standardisation industrielle.
Tout d’ailleurs s’était rapetissé dans le monde, les choses comme les hommes. On voyait des instruments de pouvoir, faits pour des géants, et maniés par des pygmées, des traditions de force exploitées par des infirmes, et des essais de gloire tentés par des médiocrités.
Beaumont a raison : le monde moderne c’est Lilliput.
La force d’imprégnation américaine est elle qu’elle uniformise toutes les nations immigrées chez elles. Cela est intéressant car cela se passe bien avant la machine à broyer hollywoodienne ou l’irruption de la télévision. L’Amérique c’est l’anti-Babel, le système à tuer les différences que la chrétienté avait si bien su préservé.
Chose étrange ! La nation américaine se recrute chez tous les peuples de la terre, et nul ne présente dans son ensemble une pareille uniformité de traits et de caractères.
Le rapport sacré à la terre n’existe bien sûr pas. On n’y connaît pas le paysan de Heidegger (Beaumont explique que le Tasse et Homère ne seraient pas riches, alors…). Tout n’est qu’investissement immobilier au paradis du déracinement libéral :
L’Américain de race anglaise ne subit d’autre penchant que celui de l’intérêt ; rien ne l’enchaîne au lieu qu’il habite, ni liens de famille, ni tendres affections… Toujours prêt à quitter sa demeure pour une autre, il la vend à qui lui donne un dollar de profit.
C’était bien avant les sub-primes !
Une des grandes victimes de la civilisation américaine est alors la femme (avec les noirs et les indiens dont Beaumont parle très bien, et objectivement). Ce n’est pas pour rien que toutes les cultures du ressentiment au sens nietzschéen, l’antiracisme, la théorie du genre, le féminisme, le sectarisme sont nés aux USA au dix-neuvième siècle et après :
Sa vie est intellectuelle. Ce jeune homme et cette jeune fille si dissemblables s’unissent un jour par le mariage. Le premier, suivant le cours de ses habitudes, passe son temps à la banque ou dans son magasin ; la seconde, qui tombe dans l’isolement le jour où elle prend un époux, compare la vie réelle qui lui est échue à l’existence qu’elle avait rêvée. Comme rien dans ce monde nouveau qui s’offre à elle ne parle à son cœur, elle se nourrit de chimères, et lit des romans. Ayant peu de bonheur, elle est très religieuse, et lit des sermons.
On dirait notre bonne vieille Emma ! Tout cela ne fait pas le bonheur des femmes, qui n’ont pas encore le féminisme et la pension alimentaire pour bien se rattraper. L’Amérique invente madame Bovary plus vite que Flaubert (l’adaptation de Minnelli avec Jennifer Jones est éblouissante d’ailleurs) et le couple qui n’a rien à se dire – sauf devant l’avocat ou le psy, comme Mr and Mrs Smith (ils veulent bien se parler, mais il faut qu’ils paient !). La famille US est déjà telle que nous la connaissons aujourd’hui : quand elle n’est pas recomposée ou divisée, elle n’est pas ; Et cela sans qu’il y ait eu besoin de la télévision, du frigidaire et du portable pour abrutir et isoler tout le monde. Beaumont ajoute qu’il n’y a aucune affection, c’est cela le plus moderne – et donc choquant.
Ainsi se passent ses jours. Le soir, l’Américain rentre chez lui, soucieux, inquiet, accablé de fatigue ; il apporte à sa femme le fruit de son travail, et rêve déjà aux spéculations du lendemain. Il demande le dîner, et ne profère plus une seule parole ; sa femme ne sait rien des affaires qui le préoccupent ; en présence de son mari, elle ne cesse pas d’être isolée. L’aspect de sa femme et de ses enfants n’arrache point l’Américain au monde positif, et il est si rare qu’il leur donne une marque de tendresse et d’affection, qu’on donne un sobriquet aux ménages dans lesquels le mari, après une absence, embrasse sa femme et ses enfants ; on les appelle the kissing families.
L’obsession de l’argent qui crée des crises et de banqueroutes continuelles est continuelle : on n’a pas attendu Greenspan, Bernanke et les bulles de la Fed pour se ruiner – ou refaire fortune.
Le spectacle des fortunes rapides enivre les spéculateurs, et on court en aveugle vers le but : c’est là la cause de ruine. Ainsi tous les Américains sont commerçants, parce que tous voient dans le négoce un moyen de s’enrichir ; tous font banqueroute, parce qu’ils veulent s’enrichir trop vite.
Voyons la religion dont on a fait si grand cas là-bas. Si la femme est une « associée », un partner, comme on dit là-bas, l’homme religieux est un homme d’affaires. Beaumont est ici excellent dans son observation (c’est le passage que cite Marx dans un fameux petit essai) :
Le ministère religieux devient une carrière dans laquelle on entre à tout âge, dans toute position et selon les circonstances. Tel que vous voyez à la tête d’une congrégation respectable a commencé par être marchand ; son commerce étant tombé, il s’est fait ministre ; cet autre a débuté par le sacerdoce, mais dès qu’il a eu quelque somme d’argent à sa disposition, il a laissé la chaire pour le négoce. Aux yeux d’un grand nombre, le ministère religieux est une véritable carrière industrielle. Le ministre protestant n’offre aucun trait de ressemblance avec le curé catholique.
On s’en serait douté ! La religion évangélique comme business et comme programmation mentale malheureusement a un beau futur devant elle.
Beaumont n’a pas vu de western mais on va voir qu’il aurait pu en écrire les scénarios.
En Amérique, le duel a toujours une cause grave, et le plus souvent une issue funeste ; ce n’est pas une mode, un préjugé, c’est un moyen de prendre la vie de son ennemi. Chez nous, le duel le plus sérieux s’arrête en général au premier sang ; rarement il cesse en Amérique autrement que par la mort de l’un des combattants.
Il y a dans le caractère de l’Américain un mélange de violence et de froideur qui répand sur ses passions une teinte sombre et cruelle… On trouve, dans l’Ouest, des États demi-sauvages où le duel, par ses formes barbares, se rapproche de l’assassinat.
Il ne manque plus que Liberty Valance, que Wayne abat d’ailleurs comme un chien dans le classique postmoderne de Ford. Comme on voit, la situation réelle est aussi sinistre que celle décrit dans bien des films (contrairement à ce qu’une histoire révisionniste – il y en a pour tous les genres – a voulu nous faire croire).
Venons-en au thème de son ouvrage.
Scandalisé par l’esclavage et par le préjugé auto-entretenu qui lui sert de base, Beaumont comprend très bien le rôle du capitalisme – et surtout du christianisme – mal digéré :
L’exploitation de sa terre est une entreprise industrielle ; ses esclaves sont des instruments de culture. Il a soin de chacun d’eux comme un fabricant a soin des machines qu’il emploie ; il les nourrit et les soigne comme on conserve une usine en bon état ; il calcule la force de chacun, fait mouvoir sans relâche les plus forts et laisse reposer ceux qu’un plus long usage briserait. Ce n’est pas là une tyrannie de sang et de supplices, c’est la tyrannie la plus froide et la plus intelligente qui jamais ait été exercée par le maître sur l’esclave.
Voir Tocqueville et son analyse de l’extermination légale et philanthropique des Indiens (« On ne saurait détruire les hommes en respectant mieux les lois de l’humanité »). S’il n’y a vite eu plus d’Indiens, il y avait en tout cas 700 000 africains en 1799, quatre millions lors de la Guerre civile (qui tue 3% de la population, ruine puis pille le Sud, et endette le pays), 40 millions aujourd’hui ! L’esclavage est un beau calcul !
Beaumont constate que racisme finit par découler de l’esclavage ce qui n’était pas le cas avant. Cela aura des conséquences importantes dans les années vingt du siècle, quand les Allemands décrèteront que les Ukrainiens sont bons à leur servir d’esclaves ou que les Polonais peuvent être remplacés parce que moins techniques et moins universitaires (comme on sait l’antisémitisme a d’autres fondements). Ils avaient moins de « lumières », comme disait Washington à propos des Indiens ou Ferry à propos des « races inférieures » – on en dit quoi dans les loges du mariage pour tous ?
Faudrait-il, parce qu’on reconnaîtrait à l’homme d’Europe un degré d’intelligence de plus qu’à l’Africain, en conclure que le second est destiné par la nature à servir le premier ? Mais où mènerait une pareille théorie ?
Il y a aussi parmi les blancs des intelligences inégales : tout être moins éclairé sera-t-il l’esclave de celui qui aura plus de lumières ? Et qui déterminera le degré des intelligences ?
Le grand ennemi spirituel des sectes protestantes souvent athées ou folles (les quakers par exemple : « rien dans cette cérémonie burlesque ne fait rire, parce que tout fait pitié ») qui se partagent le pays est bien sûr le catholicisme. Ici Beaumont va aussi plus loin que Tocqueville :
Au milieu des sectes innombrables qui existent aux États Unis, le catholicisme est le seul culte dont le principe soit contraire à celui des autres.
On dirait du Chesterton. L’Eglise fait enrager tout le monde, et cela n’a pas changé !
L’unité du catholicisme, le principe de l’autorité dont il procède, l’immobilité de ses doctrines au milieu des sectes protestantes qui se divisent, et de leurs théories qui sont contraires entre elles, quoique partant d’un principe commun, qui est le droit de discussion et d’examen ; toutes ces causes tendent à exciter parmi les protestants quelques sentiments hostiles envers les catholiques.
La haine du catholicisme devient alors le seul commun dénominateur (on se doutait que ce n’était pas Jésus !) du discours américain, comme de tout discours moderne en général (c’est ce que disait notre ami Muray et il avait bien raison !)
Il paraît bien constant qu’aux États-Unis le catholicisme est en progrès, et que sans cesse il grossit ses rangs, tandis que les autres communions tendent à se diviser. Aussi est-il vrai de dire que, si les sectes protestantes se jalousent entre elles, toutes haïssent le catholicisme, leur ennemi commun.
L’Etat américain n’est bien sûr pas chrétien, il est comme dit Marx judaïque – on dira vétérotestamentaire (on jure sur la Bible, on ignore toujours l’Evangile ; vous avez déjà vu une allusion à la naissance du Christ pour le fête de Noël en Amérique ?), et il a même inventé la laïcité, aujourd’hui battue en brèche par le ressentiment communautariste venu aussi d’Amérique.
Ainsi il n’existe aux États-Unis ni religion de l’État, ni religion déclarée celle de la majorité, ni prééminence d’un culte sur un autre. L’État est étranger à tous les cultes.
Enfin Beaumont trouve que les Américains deviendront dangereux avec leur orgueil ; et que l’on pourrait même arrêter de trop critiquer sa pauvre vieille France !
Je blâme cet aveuglement de l’orgueil national des Américains, qui leur fait admirer tout ce qui se passe dans leur pays, mais j’aime encore moins la disposition des habitants de certaine contrée, qui, chez eux, trouvent toujours tout mal.
Il n’y a pas de quoi s’en faire, si l’on trouve que Gustave Beaumont exagère, qu’il est un hystérique opposé à l’Obama-land ou à la marche du progrès. Car comme disait mon ami l’éditeur Yves Berger, l’Amérique est partout maintenant ! On a Lady Gaga, le shopping centre et le dernier Apple ! Alors consolez-vous !
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : gustave de beaumont, etats-unis, philosophie, tocqueville, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 29 mai 2013
Von Michel Mourre zu Dominique Venner
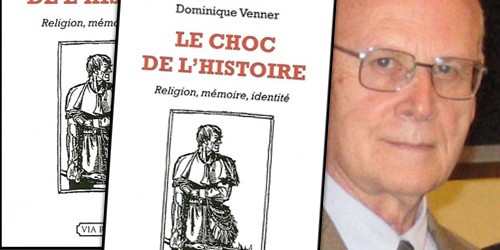
Von Michel Mourre zu Dominique Venner
von Martin Lichtmesz
Ex: http://www.sezession.de/
Auf der Netzseite der Jungen Freiheit [2]ist ein Nachruf auf Dominique Venner von Karlheinz Weißmann erschienen. Weißmann unterscheidet darin Venners „Geste“ des Freitods von jener der geistesverwandten Schriftsteller Drieu la Rochelle, Henry de Montherlant und Yukio Mishima.
… man scheut sich, ihn ohne weiteres in diese Reihe einzuordnen. Offenbar hat Venner nicht gehandelt in Reaktion auf den Zusammenbruch seiner ideologischen Hoffnungen, nicht aus einem Widerwillen gegen die Miserabilität des Daseins und auch nicht um der schönen Geste willen. Das Wort „Geste“ kommt zwar bei ihm vor, aber doch im Sinn der – großen – Tat, die am Anfang alles Neuen steht.
In einem Buch, das er vor Jahren über den französischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs geschrieben hat, sprach er über die Notwendigkeit des „starken Bildes, das bleiben wird“. Es entstehe nur durch jene Akte, die Zugang eröffnen zu den „tiefen und geheimnisvollen Kräften, die das Überdauern der Völker sichern“.
In dem finalen Eintrag [3] auf seinem Blog schrieb Venner:
Es bedarf vor allem einer tiefgehenden „intellektuellen und moralischen Reform“, um es mit Renan zu sagen. Diese müßte zur einer Wiedergewinnung der vergessenen französischen und europäischen Identität führen, deren Notwendigkeit immer noch nicht in aller Klarheit wahrgenommen wird.
Dazu müssen gewiß neue Ausdrucksformen gefunden werden, spektakulär und symbolisch, um die Schlaftrunkenen wachzurütteln, um das betäubte Bewußtsein zu erschüttern und die Erinnerung an unsere Wurzeln zu wecken. Wir werden in eine Zeit eintreten, in der Worte durch Taten bekräftigt werden müssen.
Wir sollten uns auch erinnern, daß, wie es auf geniale Weise Heidegger in „Sein und Zeit“ formuliert hat, die Essenz des Menschen in seinem Dasein und nicht in einer „anderen Welt“ liegt. Es ist im Hier und Jetzt, wo sich unser Schicksal bis zur letzten Sekunde erfüllt. Und diese allerletzte Sekunde hat genauso viel Bedeutung wie der Rest eines Lebens. Darum muß man bis zum letzten Augenblick man selbst bleiben. Nur indem man selbst entscheidet und sein Schicksal wahrhaftig bejaht, besiegt man das Nichts. Angesichts dieser Herausforderung gibt es keine Ausrede, da wir nur dieses eine Leben haben, in welchem es von uns abhängt, ob wir entweder ein Nichts oder ganz wir selbst sind.
Venners nächster Wahlverwandter war jedoch zweifellos Ernst Jünger, mit dem er das „abenteuerliche Herz“ der Jugendjahre und die militärische Erfahrung teilte, sowie die seltene Fähigkeit „Feder und Schwert“ – also Wort und Tat – in Einklang zu bringen. In einem Interview [4]mit der JF pries Venner Jünger als Prototypen des „guten Europäers“:
Aus seiner Lebensgeschichte lassen sich unendlich viele Lehren ziehen über die europäischen Dramen dieser Zeit. Sein ritterlicher Geist und seine Haltung waren unverwüstlich. In seiner Körperhaltung drückte sich seine geistige Haltung aus. Haltung zu haben, heißt auch, Distanz zu wahren: Distanz zu den niederen Leidenschaften wie zur Niedertracht der Leidenschaften. Jünger gab sich nicht mit dem Schreiben zufrieden, sondern er lebte, was er schrieb. Ich sehe in ihm ein Vorbild für eine Erneuerung, eine Renaissance.
Im selben Interview beschrieb Venner die heutige Zivilisation Europas als fehlgeleitet und selbstmörderisch:
Hier in Europa erleben wir eine beginnende Verweigerung des wahnwitzigen Konsums und eine Sehnsucht, sich ein authentischeres Leben aufzubauen, um mit Heidegger zu sprechen. Immer mehr Menschen kommen zu der Überzeugung, daß man, um besser zu leben, weniger konsumieren muß. Das ist ein zutiefst revolutionärer Gedanke. Wir beginnen zu sehen, daß die Produktivität um jeden Preis zerstörerisch ist. Das zeigt zum Beispiel eine französische Statistik vom Herbst 2009 über Selbstmorde bei der Arbeit. Die neuen Arbeitsformen und der Leistungswettbewerb, dem die Kosmokratie das „Humankapital“ unterwirft, treiben demnach Menschen in den Freitod!
Von hier aus führt eine unterirdische Verbindungslinie in ein anderes Kapitel und eine andere Schule der französischen Dissidenz. Dazu müssen wir ein wenig ausholen.
Diese Distanz wird auch spürbar in den Zeilen seiner Abschiedsnote:
Ich wähle einen hochsymbolischen Ort, die Kathedrale von Notre Dame de Paris, die ich respektiere und bewundere: das Genie meiner Vorfahren hat sie auf einer Kultsstätte errichtet, die viel älter ist und an unsere weit in die Geschichte zurückreichenden Wurzeln erinnert.
Hat seine Tat also frisches Blut in alte Kathedralen fließen lassen, auf daß sich erneut Götter auf ihre verlassenen Altäre niederlassen? Die Dome Frankreichs, Deutschlands und Italiens gehören in der Tat zu den herrlichsten Zeugen des europäischen Geistes. Aber sie scheinen heute, da sich der christliche Glaube säkularisiert und historisiert hat, nur mehr als Museen und touristische Schaustücke der Großstädte weiterzubestehen, nicht anders als die zwar prächtige, aber keinen Gott (inzwischen auch keinen Allah) mehr preisende Hagia Sophia im ehemaligen Konstantinopel.
Nietzsche schrieb in seinem berühmten Gleichnis vom „tollen Menschen“, der auf den Straßen den „Tod Gottes“ verkündigt:
Man erzählt noch, dass der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedenen Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem aeternam deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet: „Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Gräber und die Grabmäler Gottes sind?“
In diesem Geiste tat sich im Jahre 1950 eine Gruppe junger Männer zusammen, um die Ostersonntagsmesse in Notre-Dame mit einem schockartigen Überfall [5] zu stören. Ihr Kopf, der 21jährige Michel Mourre, [6] erschien auf der Kanzel im Ornat eines Dominikanermönches und hielt eine flammende Rede, im Stile eher Zarathustras als des „tollen Menschen“:
Wahrlich, ich sage euch: Gott ist tot. / Wir speien die Lauheit eurer Gebete aus, / Denn eure Gebete waren der schmierige Rauch über den Schlachtfeldern unseres Europa. / Geht fort in die tragische und erhabene Wüste einer Welt, in der Gott tot ist, / bis die Erde erneuert ist mit euren bloßen Händen, / Mit euren stolzen Händen, / Mit euren Händen, die nicht beten. / Heute, Ostern des Heiligen Jahres, / hier unter dem Zeichen von Notre Dame de Paris, / Verkünden wir den Tod des Christengottes, auf daß der Mensch lebe zuletzt.
Die Störenfriede wurden verhaftet, und Mourre für zwei Wochen in die Psychiatrie gesteckt. Der Skandal wurde zum Gegenstand monatelanger Debatten in den französischen Feuilletons, an denen sich zahlreiche Geistesgrößen von André Breton bis Gabriel Marcel beteiligten. Man kann allerdings der Rede entnehmen, daß Mourre alles anderer als platter, pöbelnder Ikonoklast war – die Differenz zu steindummen und vermutlich von interessierter Seite gesponserten „letzten Menschen“ wie den Nacktweibern von „Pussy Riot“, die vor ein paar Monaten vor Notre-Dame einem abgetretenen Papst hinterherspuckten, ist immens.
Mourres Predigt richtete sich explizit an die „Lauwarmen“, die nach dem berühmten Wort aus der Johannesoffenbarung „weder heiß noch kalt“ sind, und die der Herr aus seinem Mund „ausspucken“ wird. Mourres eigener Lebensweg verlief sehr eigenwillig. Der Sohn eines bürgerlichen Sozialisten und „Pfaffenfressers“ hatte sich als Jugendlicher noch in der Phase des Zusammenbruchs der Kollaboration angeschlossen. Dafür mußte er nach Kriegsende im Gefängnis büßen, wo er die Schriften von Charles Maurras entdeckte (Venner schrieb übrigens eine bedeutende „Geschichte der Kollaboration“).
Es folgte eine katholisch-royalistische Phase, die er mit dem Eintritt in den Dominikanerorden besiegelte. Sein spiritueller Durst nach dem Absoluten wurde jedoch auch dort nicht gestillt. Schließlich verlor er vollständig den Glauben, und schloß sich den von dem Exilrumänen Isidore Isou gegründeten „Lettristen“, einer Künstlergruppe in der Tradition der Dadaisten und Surrealisten, an. Karlheinz Weißmann [6] schrieb dazu:
Mourre zog auch jetzt die Konsequenz, verließ den Orden, ging wieder nach Paris, verbummelte seine Tage in den Cafés von Saint Germain des Prés, ein Bohémien unter Bohémiens. Darf man den Schilderungen seines Freundes Armin Mohler glauben, waren seine Lebensumstände mehr als abenteuerlich. Aber fertig war er noch nicht mit der letzten großen Sache, der er sich verschrieben hatte. Vielleicht fiel der Entschluß zu der Aktion in Notre Dame tatsächlich erst zwei Tage vorher, aber der Wunsch, sich an Gott zu rächen, muß längst schon mächtig gewesen sein.
Danach verschwand Mourre in der Obskurität, und widmete sich fortan der geisteswissenschaftlichen Arbeit.
Mourre wurde nach vierzehn Tagen aus der Psychiatrie entlassen, gab den Kontakt zu seinen alten Freunden auf, schloß sich in seiner Bibliothek ein und begann ein Buch über seine Entwicklung zu schreiben, das unter dem Titel „Malgré le blasphème“ erschien.
Der deutsche Titel „Gott ist tot?“ wirkt nichtssagender, ohne daß das dem Erfolg geschadet hätte. Die Übersetzung erschien in einem renommierten katholischen Verlag und wurde zum Anlaß einer intensiven Diskussion, nicht nur in kirchlichen Kreisen der Bundesrepublik. Aber der Ruhm verging rasch. In Deutschland blieben Mourre nur einige Bewunderer, darunter Carl Schmitt und Ernst Jünger. (…)
Nur ein paar Anarchisten bewahren ihm ein ehrendes Andenken. Er selbst lebte ein exzentrisches, jedenfalls rastloses Leben und hat die innere Ruhe, die er so ersehnte, wohl nie gefunden. Michel Mourre starb 1977, nur neunundfünfzig Jahre alt, an einem Gehirntumor.
Die Lettristen aber spalteten sich nach der Notre-Dame-Aktion in „Künstler“ und „Aktivisten“. Dem zweiteren, radikaleren Flügel schloß sich der junge Guy Debord an, der später zu einem bedeutenden Kritiker des Konsumgesellschaft und der Massenmedien wurde. 1985 schrieb Debord einen scharfkantigen Text [7]über den Identitätsverlust Frankreichs und das Problem der Masseneinwanderung, in dem es viele Berührungspunkte zu Dominique Venner gibt.
Debord gebrauchte oft das Bild einer Gesellschaft von „Schlafwandlern“ , [8]die vom „Spektakel“ [9] im Tiefschlaf gehalten wird; 2013 gebrauchte Venner ein ähnliches Bild, als er seine Tat als gezielten Schock konzipierte, um die Gesellschaft aus einer fatalen Bewußtlosigkeit und Lethargie, aus einem tödlichen Schlummer zu reißen.
Wie Venner wählte übrigens auch der (gleich Michel Mourre rastlose) Debord den Freitod – allerdings aus Lebensüberdruß infolge einer schweren Krankheit, die die Quittung für jahrzehntelange Alkoholexzesse war. Alle drei Genannten entstammten ungefähr derselben Generation: Mourre war Jahrgang 1928, Debord 1931, Venner 1935.
Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de
URL to article: http://www.sezession.de/38863/von-michel-mourre-zu-dominique-venner.html
URLs in this post:
[1] Image: http://www.sezession.de/38863/von-michel-mourre-zu-dominique-venner.html/eccehomo
[2] Jungen Freiheit : http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M50456d2e59c.0.html
[3] Eintrag : http://www.dominiquevenner.fr/2013/05/la-manif-du-26-mai-et-heidegger/
[4] Interview : http://www.jungefreiheit.de/Archiv.611.0.html?jf-archiv.de/archiv10/201012031955.htm
[5] schockartigen Überfall: http://en.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_Affair
[6] Michel Mourre,: http://www.jungefreiheit.de/Archiv.611.0.html?jf-archiv.de/archiv10/201014040245.htm
[7] scharfkantigen Text : http://www.sezession.de/38260/guy-debord-uber-identitat-und-einwanderung-fundstucke-15.html
[8] „Schlafwandlern“ , : http://www.youtube.com/watch?v=3TNurvWW4_0
[9] „Spektakel“: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Gesellschaft_des_Spektakels
18:28 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mort volontaire, dominique venner, paris, france, nouvelle droite, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dominique Venner – Von „Vorbildern“ und Haltungen

Ein Gestörter?
von Manfred Kleine-Hartlage
Ex: http://www.sezession.de/
Ich will die Haltung, die der eine oder andere politische Kommentator anläßlich von Dominique Venners Selbsttötung [2]bekundet, nicht gerade zum Gesinnungs-Lackmustest erklären, aber bezeichnend ist doch, wie sich gerade an dieser Tat die Geister scheiden: Was für den einen eine politische Tat ist, die ihre Erklärung in sich trägt und daher der Erläuterung nicht bedarf, erscheint dem anderen als ein Akt bloßer Verrücktheit, als eine „schreckliche und unnötige“, eine „gewaltsame und schlimme Geste eines Gestörten“ [3].
Daß es Ersteren – auch mir – schwerfällt, Letzteren zu erklären, was es mit dieser Tat auf sich hat, hängt auch damit zusammen, daß man es solchen Adressaten im Grunde nicht erklären will.
Ja, man könnte durchaus aufwendig und mit analytischer Gründlichkeit zeigen, daß sie eine politische Wirkung hat, oder daß es doch zumindest nicht abwegig ist, auf eine solche zu spekulieren; schließlich bemißt sich in einer Mediengesellschaft die Wirkung einer Tat an den Schlagzeilen, die sie produziert. Man könnte zum Vergleich die tibetischen Unabhängigkeitskämpfer heranziehen, die regelmäßig durch spektakuläre Selbstverbrennungen auf ihr Anliegen aufmerksam machen, ohne daß irgendjemand sie deshalb als Verrückte abtun würde. Man könnte darlegen, warum die demonstrative Selbsttötung eine Waffe sein kann, die einem (zumal in einer Gesellschaft, die einen am liebsten mundtot machen würde) das letzte Wort sichert. Man könnte das alles tun. Aber es erschiene mir unangemessen, kleinkariert und letztlich sinnlos.
Sinnlos einer Gesellschaft gegenüber, die eine solche Tat nicht versteht, sondern bestenfalls durch sie verstört wird: Sie zu verstören, war ja genau der Sinn der Sache. Diejenigen, die es dann genauer verstehen wollen, werden ihren Weg zum Verständnis schon finden.
Sinnlos aber vor allem den konservativen Kritikern gegenüber, die durch ihre hektische Abwehr unfreiwillig zu verstehen geben, wie genau sie verstanden haben, worum es Venner ging – und die es genau deshalb ablehnen.
Ich habe, als ich von der Selbsttötung hörte, keine Sekunde daran gezweifelt, daß – wer auch immer „wir“ sind – Venner einer von „uns“ ist. Die Tat verstehen heißt nicht ihre Wirkung analysieren, sondern die innere Haltung verstehen und bejahen, der sie entspringt:
Es ist nämlich inkonsequent, dem drohenden Untergang des Abendlandes nicht in einem Geist und einer Haltung zu begegnen, die der Größe dieser Gefahr angemessen ist, deren absehbare Folgen jeden Vergleich mit denen aushalten, die der Untergang des Römischen Reiches nach sich zog.
Dem existentiellen Ernst der Lage, in die die Zustände uns bringen, muß die Ernsthaftigkeit der Opposition entsprechen, und die Radikalität der Opposition muß der Radikalität der Herrschenden wenigstens gleichkommen. Wer dem de facto existierenden politischen Ausnahmezustand mit der Anwendung bewährter Regeln begegnen möchte (bürgerlicher Lebensregeln, die auf den Normalzustand zugeschnitten sind und dort ihren Sinn haben), hat nicht nur ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil sein tatsächliches Handeln nicht zu seiner theoretischen Wirklichkeitsbeschreibung paßt; er signalisiert, daß seine Opposition dem Gegner und seiner Skrupellosigkeit nicht gewachsen ist und deshalb von diesem nicht ernstgenommen zu werden braucht.
Henning Hoffgaard hat im Blog der Jungen Freiheit die Mentalität dieser Art von Opposition exemplarisch zum Ausdruck gebracht [3]. Nicht sein unbedeutendstes Argument ist die Behauptung, daß
der Historiker seinem eigentlichen Anliegen nur geschadet hat. Die konservative familienbejahende Bewegung steht plötzlich unter dem Verdacht der Radikalität.
Für diese Art Opposition gilt es, bereits den „Verdacht der Radikalität“ – und folgerichtig erst recht die Radikalität selbst – zu scheuen. Nun gut, Menschen sind verschieden, und Radikalität ist nicht jedermanns Sache. Das ist weder verdienstvoll noch verwerflich. Durchaus verwerflich, und zwar nach den von Hoffgaard selbst hochgehaltenen Maßstäben der bürgerlichen Moral, ist es, einem Toten hinterherzuspucken:
Kein Wunder also, daß die Initiatorin der Demonstrationen gegen die Homo-Ehe, Frigide Barjot, auf Distanz geht und von einer „gewaltsamen und schlimme Geste eines Gestörten“ spricht.
Dominique Venner hat keine Bewunderung verdient. Sondern Mitleid.
Der herablassende Gestus ist nicht einfach nur pietätlos (das ist er auch), und der Grund für die kaum verhohlene Aggressivität liegt erkennbar nicht in der Sache. Über Sinn oder Unsinn der Tat Venners kann man mit Argumenten diskutieren; es geht aber eben nicht um die Tat, sondern um die Haltung: um die Haltung Venners und um die seiner Kritiker. Hoffgaard gibt Auskunft:
Besonders verstörend ist die merkwürdige Selbstüberhöhung Venners, die in Sätzen wie „Meine Tat dagegen verkörpert eine Ethik des Willens“ zum Ausdruck kommt. Sie zeugt von Arroganz und erklärt diejenigen, die diesem vermeintlichen „Vorbild“ nicht folgen wollen, zu willenlosen Sklaven.
Tatsache ist, daß Venner dies mit keiner Silbe geschrieben oder auch nur angedeutet hat. Auch dürfte es kaum seine Absicht gewesen sein, einen Werther-Effekt auszulösen oder Gleichgesinnten die öffentliche Selbsttötung als Waffe der Wahl vorzuschreiben. Nicht Venner ist arrogant, sondern Hoffgaard spürt die Größe, die Ernsthaftigkeit, die Unbedingtheit, die Hingabe seiner Haltung und steht ihr befremdet gegenüber.
Ob es dem Verstorbenen bewußt war oder nicht: Sein dramatischer Abgang konfrontiert jeden Einzelnen mit einem Maßstab, dem er gerecht werden kann oder auch nicht. Es ist keine Schande, ihm nicht gerecht zu werden. Es ist keine Schande, mittelmäßig zu sein, zumal es ohne das Mittelmaß als Normalfall so etwas wie Größe gar nicht gäbe. Verachtenswert ist das Mittelmaß erst dann, wenn es sich selbst zum Maßstab erhebt, das Große nicht als solches anerkennt und dem Herausragenden den ihm zustehenden Respekt verweigert.
Dominique Venner – Von „Vorbildern“ und Haltungen
von Martin Lichtmesz
Um mich dem Kommentar [2] von Manfred Kleine-Hartlage apropos Dominique Venner anzuschließen: die Bedeutung und den Sinn einer solchen „Geste“ versteht man entweder auf Anhieb, oder eben nicht. Mit denen, die sie nicht verstehen, erübrigt sich jeder weitere Dialog. Das ist eine Frage der Haltung, die man je nach Verfassung des Charakters einnehmen kann oder nicht.
Ein Kommentar wie jener von Henning Hoffgaard, [3]bedauerlicherweise auf der Netzseite der Jungen Freiheit erschienen, ist dagegen vor allem eine Frage der Abwehrhaltung, mit anderen Worten eines ängstlichen Manövers, um bloß nicht die Deckung gewisser konservativer Lebenslügen aufgeben zu müssen. Auch das hat selbstverständlich mit Charakter zu tun.
Ich frage mich, ob der Autor auch imstande wäre, sich neben einem Jan Palach [4] oder einem brennenden tibetanischen [5] oder vietnamesischen Mönch aufzustellen, und diesen mit sorgenvoll gerunzelter Stirn, erhobenem Zeigefinger, gerichteter Krawatte und biederer Miene zu belehren, wie unkonservativ und unnötig und generell garstig radikal ein solcher Akt doch sei, im schönsten treuherzigsten Glauben, er würde nun munter aus der Quelle des „gesunden Menschenverstandes“ schöpfen.
Warum „diskutiert“ denn dieser arme, geistesgestörte Mönch nicht lieber mit seinen Besatzern oder geht grundgesetzdemokratisch gegen sie demonstrieren oder warum gründet er keine konservative Partei oder warum geht er nicht nach Hause, läßt friedlich die Gebetsmühle rotieren, damit die Götter alles wieder richten? „Gesunder Menschenverstand“ in diesem Sinne genügt nicht. Man muß auch wissen, wovon man redet, ehe man die Losschwatzsicherung entriegelt.
Ich will lieber nicht wissen, wie die Antwort vermutlich ausfallen würde. Und wenn wir schon die Maßstäbe „konservativer“ Wohlanständigkeit und Bedachtsamkeit an eine Ausnahmetat (die selbstverständlich nicht im buchstäblichen Sinne „vorbildhaft“ sein kann) anlegen, dann erstaunt einen doch die gedankenlose Herablassung, mit der hier der Tod und das Selbstopfer eines Menschen bagatellisiert werden.
Daß man einer solchen Attitüde ausgerechnet in einer Zeitung begegnet, die das Andenken an den 20. Juli so grandios bewahrt wie kein anderes Medium in Deutschland, ist schon traurig genug. Wer nun mit dem Einwand kommt, daß wir uns doch im Gegensatz zu Stauffenberg nicht mitten in einem schrecklichen Krieg und in einer offenen Tyrannis oder Diktatur befinden, hat nicht begriffen, daß es hier um grundsätzliche Haltungen geht, und wohl ebensowenig, was das überhaupt ist: eine Haltung.
Das Ausmaß des Mißverständnisses über die Natur des „Konservatismus“ offenbart sich aber erst so richtig in dem letzten Satz, in dem Hoffgaard, zweifellos „gut gemeint“, de facto aber herabschauend und arrogant, zu „Mitleid“ für Venner aufruft. Das ist, wohl unbemerkt vom Autor, fast so ekelerregend wie der höhnische Auftritt einer plärrenden, tittenschwingenden Dummnudel [6] in Notre-Dame kurz nach dem Freitod Venners. „Mitleid“ und Nasenschleim, erst recht von den bien-pensants, ist nun wirklich das Allerletzte, das ein Mann wie Venner gewollt oder gar verdient hätte.
Hoffgaard scheint überhaupt nicht die geringste Ahnung davon zu haben, mit was für einem Mann er es hier zu tun hat, was er indessen auch in der Jungen Freiheit [7] selbst hätte nachlesen können. Die Behauptung, Venner habe „es sich furchtbar einfach gemacht“ ist so unverschämt, daß sie nach Satisfaktion verlangt, nicht nur wegen seines geistigen Kalibers, sondern auch, weil niemand es „sich einfach macht“, der bereit ist, sich sein Leben zu nehmen.
Letzteres ist nichts anderes als ein Kinderpfeifen im finstern Walde, die klassische Ente all jener Arg- und Ahnungslosen, die es nötig haben, ihrer Angst vor gewissen Dingen jenseits des bürgerlichen Sandkastens mit Verharmlosung zu begegnen. Können Leute dieser Art auch verstehen, daß es Menschen gibt, die sich nicht versöhnen und abfinden wollen, die in sich Überzeugungen tragen, die sich nicht kaufen und abkaufen lassen?
Vor allem sprechen wir hier nicht von jemandem, der einen Suizid aus pathologischem Lebensüberdruß begangen hat, genausowenig wie die tibetanischen Nonnen und Mönche. Ob Hoffgaard auch schon mal etwas von Sokrates oder Seneca gehört hat? Venner, ein eingefleischter, europäischer Heide, starb wie ein antiker Stoiker.
Venners Tat sei „kein Vorbild für niemanden“. „Vorbild“, auch das ist ein Ausdruck, der nach dem Fundus pädagogischer Artigkeit schmeckt. Kids, don’t try this at home! [8] Wer redet eigentlich von „Vorbildern“? Ich will hier nicht darauf eingehen, was für diejenigen, die nun den Hut vor Venner ziehen, wirklich „vorbildlich“ ist und was nicht. Es ist, wie gesagt, etwas, das man entweder auf Anhieb versteht oder nicht. Niemand muß Venners Tat gut, sinnvoll oder „vorbildhaft“ finden. Aber es gibt Grenzen der Besserwisserei, die insbesondere vor dem Grab eines Menschen gezogen werden müssen.
Der Kern dieser schiefen Sicht ist, wie oben angedeutet, wohl eine autohypnotische Fehleinschätzung der Lage. Venner hat nicht, wie vielfach grob vereinfachend berichtet wurde, bloß gegen die von der Linksregierung durchgedrückte „Homo-Ehe“ protestiert (die, nebenbei gesagt, weder mit Homosexuellen noch mit „Ehe“ das Geringste zu tun hat). Seine Abschiedsnoten verweisen deutlich auf eine Lage, in der es um das Ganze Frankreichs und Europas geht.
Wer die Bilder von den Demonstrationen in Frankreich inhaliert wie Opium, gierig nach dem Sauerstoff der Hoffnung, hat noch nicht begriffen, daß die überwiegende Mehrheit der Franzosen ihrem „grand replacement“, wie es der (übrigens offen homosexuelle) Schriftsteller Renaud Camus formuliert hat, also dem großen demographischen „Bevölkerungsaustausch“ im Namen der globalistischen Utopie mit passiver Lethargie gegenübersteht.
Venner hat eben nicht „vor den nicht in Stein gemeißelten Umständen kapituliert“, wie Hoffgaard vermutet, der sich offenbar nicht einmal die Mühe gemacht hat, die entsprechenden Erklärungen [9] zu lesen. Au contraire:
Ich erhebe mich gegen den Fatalismus. Ich erhebe mich gegen die seelenzerstörenden Gifte und gegen den Angriff individueller Begierden auf die Anker unserer Identität, besonders auf die Familie, der intimen Säule unserer jahrtausendealten Zivilisation. Ebenso wie ich für die Identität aller Völker in ihren Heimatländern eintrete, erhebe ich mich des weiteren gegen das vor unseren Augen begangene Verbrechen der Ersetzung unserer Völker durch andere.
Was Venner nicht geteilt hat, war lediglich die Illusion, daß ein paar „artige Demonstrationen“ („gentilles manifestations“) genügen würden, um das Ruder herumzureißen. Und wie recht er damit hat, bestätigt die Reaktion der „Initiatorin der Demonstrationen gegen die Homo-Ehe“, die es für angebracht hielt, dem Toten ins Grab nachzuspucken, und anbiedernd-konformistisch von der „schlimmen Geste eines Gestörten“ sprach.
Diese „Initiatorin“ tritt übrigens unter einem Pseudonym auf, das offenbar aus einer Transvestiten-Show geklaut wurde: „Frigide Barjot“ [10] ist eine nicht allzu subtile Verballhornung von „Brigitte Bardot“, und heißt soviel wie „frigide Durchgeknallte“. Barjot, die aus dem Show-Biz kommt und auch äußerlich reichlich „durchgeknallt“ (oder gar „gestört“?) wirkt, ist das weibliche Pendant zu Beppe Grillo, und hat auch mal ein die Bardot parodierendes Lied mit dem Titel „Fais-moi l‘amour avec deux doigts“ (das lasse ich mal unübersetzt), was unter ihren vielen konservativ-katholischen Anhängern sicher ein beliebter Schlager ist.
Fast könnte man hier den Verdacht einer „controlled opposition“ schöpfen. Man kann „Barjots“ Namen kaum zitieren, ohne das Gefühl zu haben, in einer Live-Satire oder einer Szene aus Raspails „Heerlager der Heiligen“ gelandet zu sein. Das gibt auch Hoffgaards Anrufung der Kronzeugin eine nicht umkomische Note. „Venner hat sich erschossen, aber Frigida Ziege und Lady Gaga finden das gestört und uncool, Klappe zu, Affe tot.“
Im April dieses Jahres bezeichnete „Barjot“ Frankreich übrigens als „Diktatur“ (Wie unter Stauffenberg? Wie in Tibet?), und scheute nicht vor markigen, womöglich radikalismusverdachterweckenden Sprüchen zurück: „Hollande veut du sang, il en aura ! “ – „Hollande will Blut sehen, und das wird er bekommen!“ Blut? Jenes Blut etwa, das nun tatsächlich vor dem Altar von Notre-Dame geflossen ist?
Und einer solchen Figur läuft die „konservative familienbejahende Bewegung“ Frankreichs hinterher.
Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de
URL to article: http://www.sezession.de/38924/38924.html
URLs in this post:
[1] Image: http://www.sezession.de/38913/ein-gestorter.html/220px-notre-dame-de-paris_-_rosace_sud
[2] Kommentar: http://www.sezession.de/38913/ein-gestorter.html
[3] Henning Hoffgaard, : http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5a655a77084.0.html
[4] Jan Palach: http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach
[5] tibetanischen: http://www.abendblatt.de/politik/ausland/article2289544/Erstmals-Selbstverbrennungen-in-Tibets-Hauptstadt-Lhasa.html
[6] Dummnudel: http://www.bild.de/politik/ausland/femen/nach-suizid-in-notre-dame-femen-frau-zieht-blank-gegen-rechts-30502082.bild.html
[7] Jungen Freiheit: http://www.jungefreiheit.de/Archiv.611.0.html?jf-archiv.de/archiv10/201012031955.htm
[8] Kids, don’t try this at home! : http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Try_This_at_Home
[9] entsprechenden Erklärungen: http://www.sezession.de/38857/begrundung-fur-einen-freitod-dominique-venners-erklarung.html
[10] „Frigide Barjot“: http://fr.wikipedia.org/wiki/Frigide_Barjot
18:21 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommages, mort volontaire, dominique venner, nouvelle droite, paris, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Venner: symbolish, männlich, frei und hart
Venner: symbolish, männlich, frei und hart
von Götz Kubitschek
Ex: http://www.sezession.de/
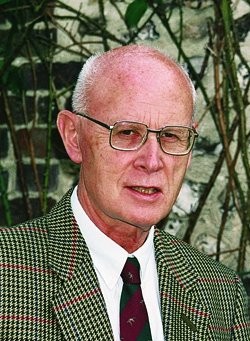 Indem der 79jährige Historiker Dominique Venner sich am 21. Mai in der Kathedrale Notre Dame zu Paris erschoß, reagierte er radikal auf den Weg ins Verderben, den sein Vaterland und Europa seit Jahrzehnten beschreiten. Er reagierte dabei nicht so, wie es uns das liberale System und die offene Gesellschaft nahelegen: ertragend, selbstkritisch, ausweichend, akzeptierend, weich, anknüpfungsbereit.
Indem der 79jährige Historiker Dominique Venner sich am 21. Mai in der Kathedrale Notre Dame zu Paris erschoß, reagierte er radikal auf den Weg ins Verderben, den sein Vaterland und Europa seit Jahrzehnten beschreiten. Er reagierte dabei nicht so, wie es uns das liberale System und die offene Gesellschaft nahelegen: ertragend, selbstkritisch, ausweichend, akzeptierend, weich, anknüpfungsbereit.
Venners Reaktion war überlegt [3], symbolisch, männlich, frei und hart. Sie war schockierend für all jene, die das Leben quantitativ und nicht qualitativ, individualistisch und nicht eingebettet, hedonistisch und nicht in erster Linie als Dienst auffassen. Was Venner am Altar der Kathedrale tat, begreift man entweder sofort oder gar nicht: Es umgibt sein Leben und seine Argumentation mit der Aura radikaler Unabhängigkeit und jäher Fremdheit, und alle Versuche, seine Tat zu instrumentalisieren, sind peinlich und müssen scheitern, auch jene von unserer Seite. Man muß schweigen können beim Blick auf etwas, das so weit entfernt von dem ist, was wir uns vorgenommen und was wir Tag für Tag zu tun haben.
18:12 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, dominique venner, mort volontaire, actualité, france, paris |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Suicide in the Cathedral: The Death of Dominique Venner
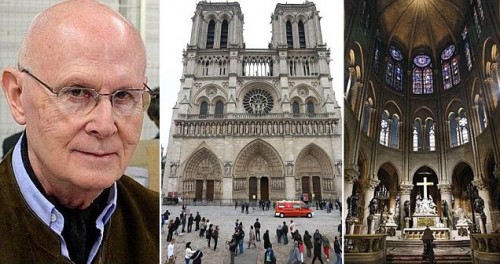
Suicide in the Cathedral:
The Death of Dominique Venner
By Greg Johnson
Ex: http://www.counter-currents.com/
Dominique Venner is too big for me to judge. Thus I am not going to criticize or second-guess his decision to end his life with a bullet at the altar of the Cathedral of Notre Dame on May 21, 2013.
But I have no qualms about judging the reactions of smaller men to his suicide.
1. Venner’s Suicide was not a Protest Against Gay Marriage
Venner made it clear in his final blog post [2] that he believed that the gay marriage protests were merely a distraction. Venner was opposed to gay marriage, but without passion and without “homophobia [3].” He was, however, intrigued by the massive protests, as well as France’s pervasive cynicism [4] about the political establishment, phenomena that he judged to have revolutionary potential [5]. But he believed that this potential was being wasted on the issue of gay marriage when a much greater threat to France was looming unopposed: the replacement of the French people with non-white immigrants organized under the banner of Islam. Venner made it clear that his suicide was not a protest against gay marriage but an attempt to awaken people to the danger of demographic displacement.
The gay marriage statute, after all, is only a law. Laws can be changed. And this particular law clearly will be abolished, along with the rest of liberalism, when Sharia law is imposed by France’s rising Muslim majority. Sharia law, of course, is not forever either. But Sharia law will be imposed only by the demographic swamping of the French, which will lead to their genetic and cultural obliteration. And extinction is forever.
Of course the mainstream media wish to keep our people unaware of this very danger. So naturally they are reporting that Venner killed himself simply to protest gay marriage. Venner has even been described as a traditionalist Catholic, although a traditionalist Catholic would not commit suicide at all, much less at the altar of Notre Dame. Beyond that, Venner makes it clear in his final writings that he was an atheist and a cultural pagan.
But when people on the Right, who should be both sympathetic to Venner and skeptical of the press, repeat these false claims at face value, what is their excuse?
2. “One more bullet that will not be fired at the enemy.”
Many of Venner’s Right-wing critics fault him for killing himself rather than one of our enemies. But Venner was right, for two reasons. First, as I have argued elsewhere [6], revolutionary violence today is premature and thus pointless. Second, if Venner had killed another individual, the primary focus would be on the victim, and Venner himself would simply be dismissed as another crazed, embittered Right-wing loser. By killing himself, he knew that he would still be vilified and mocked. But he also knew that it would be far more likely that at least some people would actually take his ideas seriously. Very few people have convictions they will die for, thus some people will want to learn what those convictions were.
3. Venner’s Career as Activist and Intellectual
Some of Venner’s Right-wing critics reproach him for killing himself, as opposed to engaging in political or metapolitical activism. But from 1956 to 1971, Dominique Venner was very much a political and metapolitical activist.
According to Wikipedia [7] – which all of Venner’s critics could have read before attacking him in online forums — after serving in the Algerian War, Venner was demobilized in 1956 and joined the Jeune Nation [8] (Young Nation) movement, which later folded into the Organisation de l’Armée Secrète [9] (OAS, Secret Army Organization). On November 7, 1956, Venner took part in the ransacking of the office of the French Communist Party as a protest against the Soviet repression of the Hungarian Revolution. Venner then helped found a short-lived Parti Nationaliste (Nationalist Party).
Venner strongly opposed the French decolonization of Algeria. Thus he took part in General Chassin’s pro-colonist Mouvement populaire du 13-mai [10] (Popular Movement of May 13). Venner was also a member of the OAS, which used bombings and assassinations to try to halt the betrayal of European colonists in Algeria. Members of the OAS took part in the attempted military coup of April 1961 and tried to assassinate Charles De Gaulle in August of 1962. Because of his OAS membership, Venner was jailed for 18 months and was released in 1962.
After prison, Venner became increasingly involved in metapolitics: writing essays and books; founding intellectual organizations, journals, and publishing houses; networking with other Right-wing intellectuals, and the like. In the autumn of 1962, Venner wrote For a Positive Critique [11] (online at Counter-Currents), a manifesto analyzing the failure of the coup and outlining a new, somewhat “Leninist” model for a revolutionary, militant Right wing.
In January of 1963, Venner and Alain de Benoist created a movement and magazine called Europe-Action. Venner then founded the publisher Éditions Saint-Just, which was associated with Europe-Action. Venner was also an early member of the flagship organization of the French New Right, Alain de Benoist’s Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne (GRECE) (Research and Study Group for European Civilization) from its beginning until the 1970s. With Thierry Maulnier, Venner founded the Institut d’études occidentales (IEO) (Institute of Western Studies), and its journal, Cité-Liberté (City-Liberty), founded in 1970.
In 1971, the IEO was dissolved and Venner withdrew from political entanglements to focus entirely on his career as a historian, a metapolitical activity in itself. He wrote and edited some 50 books, edited two journals, authored countless essays, gave many print and broadcast interviews, and mentored and promoted numerous writers.
In short, at the age of 78, Dominique Venner had done more for our people as a writer or political activist than practically anyone else. Thus it is absurd, if not obscene, to claim that “he could have done more” and that his suicide was somehow a dereliction of duty.
4. The Rationale for a Revolutionary Suicide
Venner decided, evidently after long deliberation, that there was one more thing he could do for his people, i.e., that a spectacular public suicide would (a) raise public awareness of the danger of white race replacement, and (b) encourage people who are already aware of the danger to do more to stop it.
And maybe, just maybe, Venner thought, his death would be enough to make a difference.
Because as a historian, Venner knew that individual actions can and do change history. But as a historian, he also knew that such actions and their consequences are contingent and thus unpredictable [12]. Thus, in the end, it was a gamble. But it was his own life that he was gambling with, and I, for one, do not feel it is my right to second-guess him.
I should note, however, that the first of Venner’s predictions has already been proven right. His death has won enormous publicity for our cause. That can be verified by anyone with a simple web search. But I have additional evidence: because Counter-Currents/North American New Right is the primary source of English translations of Venner’s essays, our traffic increased dramatically due to his death. Indeed, on Tuesday the 21st and Wednesday the 22nd we had the highest traffic in our history so far.
As for Venner’s second prediction: whether he is proved right or wrong is in your hands, dear reader. No, Venner did not wish to inspire the rest of us to take our lives, which would be absurd. But he did want to inspire us to take courage in moving our flag forward. All of us know of some constructive steps toward saving our race, constructive steps that we could take if only we were not afraid. But if Dominique Venner conquered the fear of death to serve our people, then surely you can conquer the lesser fears that are holding you back. Our duty is to make sure that his sacrifice was not in vain.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2013/05/suicide-in-the-cathedralthe-death-of-dominique-venner/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/05/VennerNotreDame.jpg
[2] final blog post: http://www.counter-currents.com/2013/05/the-may-26-protests-and-heidegger/
[3] without passion and without “homophobia: http://www.counter-currents.com/2012/12/are-marriage-and-children-consumer-goods/
[4] pervasive cynicism: http://www.counter-currents.com/2013/04/theyre-all-rotten/
[5] revolutionary potential: http://www.counter-currents.com/2013/04/how-are-revolutions-born/
[6] argued elsewhere: http://www.counter-currents.com/2013/05/on-violence-2/
[7] Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Dominique_Venner
[8] Jeune Nation: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeune_Nation
[9] Organisation de l’Armée Secrète: https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_l%27arm%C3%A9e_secr%C3%A8te
[10] Mouvement populaire du 13-mai: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_populaire_du_13-Mai
[11] For a Positive Critique: http://www.counter-currents.com/tag/for-a-positive-critique/
[12] unpredictable: http://www.counter-currents.com/2011/11/the-unforeseen-the-chinese-and-the-favorable-moment/
15:53 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, france, paris, dominique venner, mort volontaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'occidentalisme contre l'Europe

L'occidentalisme contre l'Europe
Ex: http://www.europe-identite.com/
Tomislav Sunic
Conférence prononcée à Lyon le 25 mai 2013 („GUD-Europe Identité“)
Le terme « occidentalisme » n’existe qu’en langue française et il a une signification bien particulière. Souvent les mots « Occident » et « occidentalisme » reçoivent leurs sens particulier en fonction de son utilisateur et de son état des lieux. Le terme « occidentalisme » ne s’utilise guère en langue allemande ou en langue anglaise. Même le vocable français « Occident » possédant une signification largement géographique est traduit en allemand comme « l’Ouest », à savoir « der Westen. Il en va de même pour l’anglais où le terme français « Occident » est traduit en anglais par « the West », le sujet auquel on a consacré pas mal de livres et de traductions. À ce propos, Patrick Buchanan, ancien conseiller de Ronald Reagan et écrivain conservateur ẚ gros tirage a publié y il a une dizaine d’années le bestseller « Death of the West » (La Mort de l’Occident) où il se lamente sur le sort de l’Ouest envahi par des millions d’immigrés non chrétiens. Dans sa prose, l’Amérique et l’Europe sont mises dans le même sac.
Or nous savons fort bien que l’Amérique et l’Europe ne sont pas synonymes – ni par leur notion des grands espaces, ni par leurs volontés hégémoniques – quoique ces deux continents soient pour l’heure toujours peuplés d’une majorité d’Européens de souche. Fort souvent dans notre histoire récente, ces deux grands espaces, malgré leurs populations quasi identiques, se sont livré des guerres atroces.
Dans les langues slaves, le substantif « Occident » et l’adjectif « occidental » n’existent pas non plus. À la place « d’Occident », les Croates, les Tchèques ou les Russes utilisent le substantif « zapad » qui signifie « l’Ouest ».
Le substantif français « occidentalisme », indique une notion de processus, une motion, à savoir une idéologie, et non l’idée d’une entité stable dans le temps et dans l’espace comme c’est le cas avec le substantif « Occident ». Je vous rappelle que le titre français du livre d’Oswald Spengler, Der Untergang des Abandlandes, ou en français Le déclin de l’Occident, ne reflète pas exactement le sens du titre allemand. Le mot allemand « der Untergang » signifie, en effet, la fin des fins, une sorte de débâcle finale, et il est plus fort que le terme français «déclin » qui sous-entend une gradation, donc une « déclinaison du mal », et qui laisse envisager pourtant une possibilité de demi-tour, une fin qu’on peut renverser au dernier moment. Tel n’est pas le cas en allemand où le substantif « Untergang » porte un signifié final à sens unique, irréversible et tragique. La même chose vaut pour le substantif allemand « das Abendland », qui traduit en français, signifie « le pays du soleil couchant » et qui porte en langue allemande une signification largement métaphysique.
Je dois vous rappeler ces nuances lexicales afin que nous puissions bien conceptualiser notre sujet, en l’occurrence l’occidentalisme. Il faut être bien conscient que les termes, « L’Occident « et « l’Ouest », dans les différentes langues européennes, portent souvent des significations différentes lesquelles engendrent souvent des malentendus.
Nul doute que les termes « Occident » et « occidentalisme » ont subi un glissement sémantique. Au cours de ces quarante ans, ils ont pris en français une connotation associée au mondialisme, à l’américanisme vulgaire, au libéralisme sauvage et au « monothéisme du marché », très bien décrit par Roger Garaudy. On est loin des années soixante et soixante-dix, quand le journal Défense de l’Occident sortait en France contenant des plumes bien connues dans nos milieux. La même chose vaut pour le mouvement politico–culturel français « Occident » qui portait dans les années soixante une certaine promesse tant pour les nationalistes français que pour toute la jeunesse nationaliste européenne.
Or les deux termes – « Occident » et « occidentalisme » – qui sont aujourd’hui fustigés par les cercles identitaires et nationalistes français sont toujours objet d’éloges chez les identitaires et les nationalistes est-européens qui souffrent d’un complexe d’infériorité quant à leur nouvelle identité postcommuniste et européenne. En Pologne, en Hongrie ou en Croatie par exemple, se dire de « l’Ouest » est souvent une manière de mettre en lumière sa grande culture ou bien de se targuer de son style d’homme du monde.
Je vous rappelle qu’à l’époque communiste, les Européens de l’Est se sentaient non seulement vexés par les brimades et les oukases communistes, mais également par leur statut d’Européens de deuxième classe lorsque les Occidentaux, à savoir les Francophones et les Anglais utilisaient le terme « l’Est » pour désigner leur coin d’Europe, à savoir l'Europe de l'Est c’est-à-dire, « Eastern Europe ». D’ailleurs, en français, on utilise parallèlement l’adjectif « orientale » – à savoir « l’Europe orientale » – pour désigner l’Europe de l’Est, un adjectif dont l’homonymie rend les Européens de l'Est franchement furieux. L’adjectif « oriental » rappelle aux Européens de l’Est l’Orient, la Turquie, l’Arabie, l’islam, des notions avec lesquelles ils ne veulent absolument pas être rangés. Même les Européens de l’Est qui maîtrisent parfaitement la langue française et connaissent la culture française préfèrent, faute de mieux, que les Francophones, au lieu d’« Europe orientale », désignent leur coin d’Europe, comme « l’Europe de l’Est ».
Balkanisation et Globalisation
L’histoire des mots et les glissements sémantiques ne s’arrêtent pas là. Tous les Européens de l’Est, qu’ils soient de gauche ou de droite, les globalistes ou les anti-globalistes, et même la classe politique au pouvoir en Europe de l’Est aiment bien se désigner comme membres de la « Mitteleuropa » et non comme citoyens de l’Europe de l’Est. Le terme allemand Mitteleuropa veut dire « l’Europe du centre », terme qui renvoie aux beaux temps nostalgiques de l’Empire habsbourgeois, au biedermeier, à la douceur de vie assurée autrefois par la Maison d’Autriche et à laquelle les Slovaques, les Polonais, les Croates, les Hongrois, et mêmes les Roumains et les Ukrainiens appartenaient il n’y pas si longtemps.
La notion d’appartenance à l’Europe, surtout dans ce coin de l’Est européen s’aggrave davantage par les vocables utilisés par mégarde. Ainsi le terme « Balkans » et l’adjectif « balkanique », utilisés dans un sens neutre en France pour désigner l’Europe du sud-est, ont une connotation injurieuse dans la culture croate même si cette désignation ne véhicule aucune signification péjorative. La perception que les Croates se font d’eux-mêmes va souvent à l’encontre de celle qui provient de l’Autre, à savoir de leurs voisins serbes ou bosniaques. Aux yeux des Croates, les termes « Balkans » et « balkanisation » signifient non seulement une dislocation géopolitique de l’Europe ; le vocable « Balkans », qui peut porter un signifiant tout à fait neutre en français ou en anglais, et qui est souvent utilisé dans des études géopolitiques, provoque souvent chez les nationalistes et identitaires croates des sentiments associés au comportement barbare, des complexes d’infériorité politique, et l’image de dégénérescence raciale de leur identité blanche. De plus le terme « balkanique » en croate induit souvent un sentiment négatif où se mélangent et se confondent diverses identités raciales et culturelles venues de l’Asie et non de l’Europe. On entend souvent les Croates de n’importe quel bord, se lancer mutuellement pour leurs prétendu mauvais comportement, la boutade : « Ah t’es un vrai Balkanique !». Ce qui veut dire, dans le langage populaire croate, avoir un comportement non civilisé, ou être un « plouc » tout simplement. En Serbie, ce n’est pas le cas, l’identité serbe étant bien réelle et bien ancrée dans le temps et dans l’espace des Balkans et ne portant aucune signification péjorative.
Les Allemands, qui connaissent le mieux la psychologie des peuples de l’Europe centrale et des Balkans, sont très au courant de ces identités conflictuelles chez les peuples de l’Europe de l’Est et des Balkans. D’ailleurs, le terme « der Balkanezer » possède une signification fortement injurieuse dans le lexique allemand.
Quelle Europe ?
Passons à l'Europe. A la fameuse Union européenne, bien sûr. Alors, qu’est que cela veut dire être un bon Européen aujourd’hui ? Soyons honnêtes. Compte tenu de l’afflux massif d’immigrés non-européens, surtout du Moyen Orient, tous les Européens – que ce soient les Français de souche, ou les Anglais de souche et les « souchiens » de toute l’Europe, sont en train de devenir de bons « balkanesques Balkaniques. » En effet, qu’est-ce que cela veut dire aujourd’hui, être Allemand, Français, ou bien Américain, vu le fait que plus de 10 à 15 pour cent d’Allemands et de Français et plus de 30 pour cent des citoyens américains sont d’origine non–européenne, donc non-blanche ? En passant par Marseille on a l’impression de visiter la ville algérienne ; l’aéroport de Francfort ressemble à celui de Hongkong. Les alentours de Neukölln à Berlin charrient les parfums de la casbah libanaise. La glèbe, le terroir, la terre et le sang, si chères à Maurice Barrès, si chers à nous tous, qu’est-ce que cela veut dire aujourd’hui ? Strictement rien.
On a beau prendre maintenant les allogènes comme coupables. Force est de constater que ce sont nous, les Européens, qui sommes les premiers responsables de l’occidentalisation et donc de la perte de notre identité. Ce faisant on a beau vilipender la prétendue inculture des Américains, au moins ils ne sont pas tiraillés par le petit tribalisme intra-européen. Les Américains de souche européenne peuvent demain, à la rigueur, devenir le fer de lance de la renaissance d’une nouvelle identité euro-blanche. Force et de constater que les sentiments d’identité raciale chez les nationalistes blancs américains sont plus forts que chez les nationalistes européens.
Or en Europe de demain, dans le meilleur des mondes européens, même sans aucun allogène, il est douteux que le climat sera d’emblée propice à des grandes embrassades fraternelles entre les Irlandais et les Anglais, entre les Basques et les Castillans, entre les Serbes et les Croates, entre les Corses et les Français. Soyons francs. Toute l’histoire de l’Europe, toute l’histoire des Européens, au cours de ces deux millénaires s’est soldée par des guerres fratricides interminables. Cela vaut toujours pour L’Europe orientale, à savoir « l’Europe de l’Est, » qui continue toujours d’être en proie à la haine interethnique. Le dernier conflit en date fut la guerre récente entre deux peuples similaires, les Serbes et les Croates. Qui peut nous garantir le contraire demain, même si l’afflux des Asiatiques et les Africains devait prendre subitement fin ?
Se dire « être un bon Européen » aujourd’hui, ne veut rien dire. Se proclamer un « bon Occidental » non plus. Etre enraciné dans son terroir dans un monde globaliste n’a strictement aucun sens aujourd’hui, vu que nos quartiers sont peuplés d’allogènes qui avec nous sont soumis à la même culture marchande. Il y a au moins quelque chose de paradoxal avec l’arrivée des non-Européens : les interminables guerres et les disputes entre les grands discours des nationalistes européens, entre les Polonais et les Allemands, entre les Serbes et les Croates, entre les Irlandais et les Anglais – semblent devenus dérisoires. L’afflux constant de non-Européens dans nos contrées européennes fait de la désignation « L’Europe européenne » une absurdité lexicale.
Ce qu’il nous reste à nous tous à faire c’est le devoir de nous définir tout d’abord comme héritiers de la mémoire européenne, même si nous vivons hors d’Europe, même en Australie, au Chili, ou en Amérique et même sur une autre planète. Force est de constater que nous tous « les bons Européens » au sens nietzschéen, nous pouvons changer notre religion, nos habitudes, nos opinions politiques, notre terroir, notre nationalité, voir même nos passeports, mais nous ne pouvons jamais échapper à notre hérédité européenne.
Non les allogènes, mais les capitalistes, les banksters, les « antifas » et les architectes des meilleurs des mondes, sont désormais nos principaux ennemis. Pour leur résister, il nous incombe de ressusciter notre conscience raciale et notre héritage culturel. Tous les deux vont de pair. La réalité de notre race et culture blanche ne peut pas être niée. Nous tous, nous pouvons tout changer et même aller sur une autre planète. Mais notre hérédité, à savoir notre fond génétique, on ne peut jamais changer.
La race, comme Julius Evola ou Ludwig Clauss nous l’enseignent, n’est pas seulement la donnée biologique – notre race est aussi notre responsabilité spirituelle qui seule peut assurer notre survie européenne.
Tomislav Sunic ( www.tomsunic.com)est écrivain et membre du Conseil d’Administration de American Freedom Party. http://a3p.me/leadership
14:57 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occident, occidentisme, occidentalisme, tomislav sunic, nouvelle droite, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 mai 2013
Dominique Venner, la lueur sacrée de l’arme

Dominique Venner, la lueur sacrée de l’arme
par Claude BOURRINET
Le mardi, Dominique Venner s’est tiré une balle dans la bouche, peu après 16 heures, dans le chœur de Notre-Dame de Paris, ce haut monument de la grandeur française, de sa spiritualité, de son génie, après avoir glissé un message sur l’autel. On a retrouvé sur lui six enveloppes cachetées adressées à ses proches. La presse, rapidement, a identifié le « désespéré » comme étant un « essayiste et ancien membre de l’O.A.S., proche de la mouvance des anti-mariage gay ». Fiche signalétique un peu courte. Dominique Venner était, par ses ouvrages historiques, la Nouvelle Revue d’Histoire, qu’il animait, ses interventions, sa personne, son personnage, une figure importante de la constellation nationale, un phare pour certains, un témoin capital pour tous.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=3186
18:38 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, nouvelle droite, dominique venner, mort volontaire, paris, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dominique Venner ou la fondation de l’avenir
Dominique Venner ou la fondation de l’avenir
par Georges FELTIN-TRACOL
 Le 21 septembre 1972, jour de l’équinoxe d’automne, se suicidait Henry de Montherlant. C’est au lendemain de la Pentecôte chrétienne qui marque la montée du Christ au Ciel, un mardi – jour de Mars – et au mois de la Vierge Marie – mai -, que Dominique Venner s’est donné la mort dans « un lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre Dame de Paris que je respecte et admire », précise-t-il dans son testament politique.
Le 21 septembre 1972, jour de l’équinoxe d’automne, se suicidait Henry de Montherlant. C’est au lendemain de la Pentecôte chrétienne qui marque la montée du Christ au Ciel, un mardi – jour de Mars – et au mois de la Vierge Marie – mai -, que Dominique Venner s’est donné la mort dans « un lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre Dame de Paris que je respecte et admire », précise-t-il dans son testament politique.
À 78 ans, Dominique Venner a librement choisi de se retirer définitivement de ce monde dont il voyait poindre l’avènement du nihilisme triomphant. Il est mort comme il a toujours vécu : en homme debout qui ne plia jamais face à l’adversité. Toute sa vie, il a montré, il a été l’exemple même de la virilité, et pratiqué cette virtu chère à Machiavel et aux vieux Romains. La verticalité faisait sens en lui et a ordonné son existence jusqu’à la fin.
Le jeune parachutiste volontaire qui traquait le fellagha dans le djebel, l’expert renommé des armes, l’activiste pro-Algérie française qui rêvait de renverser par l’opération « Gerfaut » la Ve République naissante, le militant politique qui sut renouer et réinscrire la tradition française dans la continuité européenne, le chasseur réputé dont le patronyme se rapproche si symboliquement de la vénerie, l’écrivain et l’historien à la riche bibliographie, le fondateur et responsable d’Enquête sur l’Histoire, puis de La Nouvelle Revue d’Histoire, l’homme privé, père et grand-père heureux, représentent diverses facettes qui, loin de se contredire, expriment en réalité une cohérence intérieure d’une rare intensité.
En observateur attentif de la longue durée des peuples, Dominique Venner s’inquiétait des signes chaque jour plus visibles de la langueur mortifère de ses compatriotes autochtones. Ce guetteur de l’imprévu historique désirait les voir se réveiller le moment venu. C’est dans cette perspective salvatrice qu’il commit en pleine lucidité un acte ultime.
Par cette action sacrificielle, il a voulu secouer la psyché des Européens, car toute guerre est d’abord psychologique, culturelle, idéologique. Il savait que ce serait le don de soi absolu, l’affranchissement total des siens, de leur amour et de leur amitié, et l’acceptation sereine que son sang vienne, tel un nouveau Saint Chrême, oindre une mémoire collective pas encore amnésique.
« Dans toute guerre, des hommes sont volontaires pour des missions sacrifiées, note-t-il dans Le cœur rebelle (p. 85) ». Cette décision héroïque, Dominique Venner l’a nourrie, méditée, réfléchie patiemment. Dans son billet du 23 avril 2013, « Salut à toi, rebelle Chevalier ! », interrogeant, après Jean Cau, la superbe gravure d’Albrecht Dürer Le Chevalier, la Mort et le Diable, il conclut que « l’image du stoïque chevalier m’a souvent accompagné dans mes révoltes. Il est vrai que je suis un cœur rebelle et que je n’ai pas cessé de m’insurger contre la laideur envahissante, contre la bassesse promue en vertu et contre les mensonges élevés au rang de vérités. Je n’ai pas cessé de m’insurger contre ceux qui, sous nos yeux, ont voulu la mort de l’Europe, notre civilisation millénaire, sans laquelle je ne serais rien ». Il comprend que, au-delà de l’adoption du mariage contre-nature, s’opère un changement d’essence civilisationnelle contre lequel seule peut contrecarrer une ardente et ferme résolution.
S’il a commis le geste irréparable devant l’autel de Notre Dame de Paris, lui le païen qui ne se sentait aucune affinité avec le monothéisme, c’est peut-être parce qu’il a saisi l’urgence du Katékhon, cette figure eschatologique qui retient l’Antéchrist afin de maintenir l’ordre normal du cosmos.
« Alors que tant d’hommes se font les esclaves de leur vie, mon geste incarne une éthique de la volonté. » Il ajoute dans son ultime billet, « La manif du 26 mai et Heidegger », mis en ligne sur son blogue ce mardi 21 mai dans la matinée qu’« il faudra certainement des gestes nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences, secouer les consciences anesthésiées et réveiller la mémoire de nos origines. Nous entrons dans un temps où les paroles doivent être authentifiées par des actes ». Il y souligne en outre qu’on trouvera « dans mes écrits récents la préfiguration et les explications de mon geste ».
Dominique Venner n’était pas un désespéré. Il en était même aux antipodes. Déjà, dans Le cœur rebelle, il insistait, lui l’admirateur de Maurice Pinguet, auteur de La mort volontaire au Japon, sur la haute figure du samouraï et de sa dernière métamorphose historique, le kamikaze, le combattant d’assaut qui, au nom de ses principes, se dépasse une dernière fois. « Mourir en soldat, avec la loi pour soi, exige moins d’imagination et d’audace morale que de mourir en rebelle solitaire, dans une opération suicide, sans autre justification intime que l’orgueilleuse certitude qu’on est le seul à pouvoir accomplir ce qui doit être fait (Le cœur rebelle, p. 85) ». Dans des circonstances qu’il a estimées propices, il a proclamé qu’« il faudrait nous souvenir aussi, comme l’a génialement formulé Heidegger (Être et Temps) que l’essence de l’homme est dans son existence et non dans un “ autre monde ”. C’est ici et maintenant que se joue notre destin jusqu’à la dernière seconde. Et cette seconde ultime a autant d’importance que le reste d’une vie. C’est pourquoi il faut être soi-même jusqu’au dernier instant. C’est en décidant soi-même, en voulant vraiment son destin que l’on est vainqueur du néant. Et il n’y a pas d’échappatoire à cette exigence puisque nous n’avons que cette vie dans laquelle il nous appartient d’être entièrement nous-mêmes ou de n’être rien ». « Je me sens le devoir d’agir tant que j’en ai encore la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable », répond-il par avance à tous ses détracteurs.
« On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres (p. 57) » rappelle Georges Bernanos dans Le Dialogues des Carmélites. L’altruisme héroïque, combattant et radical défendu par Dominique Venner se concrétise par un acte décisif qui transcende toute une œuvre d’écriture et de réflexions pour rejoindre les antiques préceptes des vieux Romains, en particulier ceux du stoïcien Sénèque pour qui « bien mourir, c’est échapper au danger de mal vivre ». Or, ce mal vivre, par-delà la simple condition personnelle, affecte toute la société française et européenne. Arrive le temps que, « le discours dominant ne pouvant sortir de ses ambiguïtés toxiques, il appartient aux Européens d’en tirer les conséquences. À défaut de posséder une religion identitaire à laquelle nous amarrer, nous avons en partage depuis Homère une mémoire propre, dépôt de toutes les valeurs sur lesquelles refonder notre future renaissance en rupture avec la métaphysique de l’illimité, source néfaste de toutes les dérives modernes ». Dans ce contexte mortel pour l’esprit et pour les âmes, « apprendre aux gens à bien mourir est la grande affaire du stoïcisme, écrit Gabriel Matzneff (« La mort volontaire chez les Romains » dans Le Défi, p. 147) ».
Gabriel Matzneff distingue par ailleurs qu’« il y a ceux qui se tuent au nom d’une certaine idée qu’ils se font de la morale privée et publique, au nom d’une certaine idée qu’ils se font de l’homme : ils quittent un monde où les valeurs à quoi ils sont attachés n’ont plus cours et où partout triomphent celles qu’ils méprisent (pp. 164 – 165) ». Dominique Venner appartient à ces derniers. Il récuse en effet avec vigueur l’antagonisme artificiel et fallacieux entre le postmodernisme sociétal hyper-individualiste et le holisme conquérant de communautés allogènes, parfois musulmanes, sur notre continent. Il s’élève contre cette submersion migratoire qui bouleverse la physionomie européenne habituelle. « Alors que je défends l’identité de tous les peuples chez eux, je m’insurge contre le crime visant au remplacement de nos populations. »
En mettant fin à ses jours, Dominique Venner témoigne qu’une troisième voie autochtone identitaire française et européenne est la seule apte à préserver nos traditions plurimillénaires. Non, ce n’est pas en entérinant l’institution de l’homosexualité, de la famille monoparentale et de l’avortement de masse qu’on fera reculer l’islam et l’immigration extra-européenne. Et ce n’est pas en acceptant l’implantation de minorités étrangères aux mœurs exotiques qu’on rétablira les principes traditionnels de l’Être européen. C’est en les affrontant simultanément que les Européens ne sombreront pas dans le néant de l’histoire. Mais il faudra beaucoup de force morale pour mener de front ce double combat.
Dominique Venner n’a pas manqué de force morale. En allant, une arme à la main, jusqu’au chœur d’un espace consacré, depuis longtemps profané par des masses de touristes, il a resacralisé le lieu. Avait-il en ses derniers instants le souvenir du seppuku du Japonais Yukio Mishima en novembre 1970, et des immolations anti-communistes du Tchèque Jan Palach en janvier 1969 et du militant solidariste français Alain Escoffier en février 1977 ? Plus que marquer l’opinion, Dominique Venner qui savait que toute fondation pérenne exige un sacrifice préalable a surtout semé par sa disparition assumée les germes d’un renouveau continental et poser les assises d’un nouveau cycle boréen au XXIe siècle.
Georges Feltin-Tracol
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=3190
18:26 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, dominique venner, actualité, paris, france, mort volontaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





